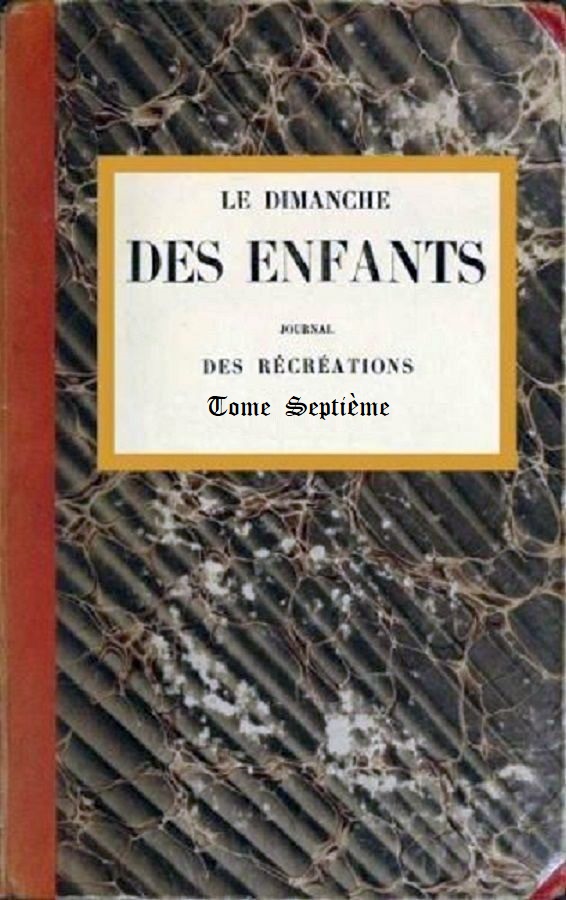
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: Le Dimanche des Enfants-Tome 7 (Le Dimanche des Enfants #7)
Date of first publication: 1840
Editor: Janet, Louis (Madame Veuve)
Author: Foa, Eugénie
Author: De Sainte-Marguerite
Author: De Somerville, Jules
Author: Des Essards, Gustave
Author: Saunders, Lucy
Author: D***, H.
Author: Foster, James
Author: Guérin, Léon
Author: De Rossmalen
Author: de Toureil, Louis
Author: Amiel, L.
Author: Midy, Th.
Author: Brunne, Claire
Author: Charles-Malo
Author: Anonyme
Illustrator: Emy, H.
Date first posted: February 16, 2026
Date last updated: February 16, 2026
Faded Page eBook #20260227
This eBook was produced by: Marcia Brooks, Cindy Beyer & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
This file was produced from images generously made available by Internet Archive.
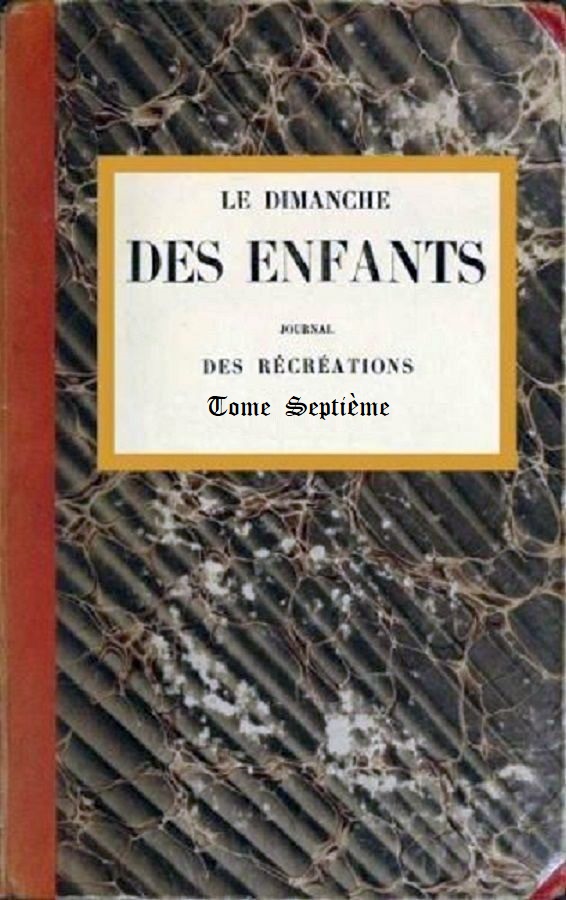
LE DIMANCHE
DES ENFANTS
——————
Imprimerie de Ducessois, 55, quai des Grands-Augustins,
près le Pont-Neuf
LE DIMANCHE
DES ENFANTS
JOURNAL
DES RÉCRÉATIONS
Tome Septième.
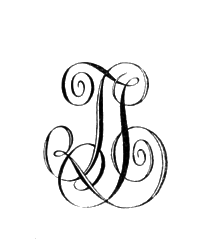
PARIS
MADAME VEUVE LOUIS JANET, LIBRAIRE-EDITEUR,
RUE SAINT-JACQUES, 39.
TABLE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME

| Pages | |||
| Histoire de Bébé | 1 | Léon Guérin. | |
| Le petit domestique du collège de Navarre | 6 | Mme Eugénie Foa. | |
| Les deux pupilles de lord Aresvood | 20 | Gustave des Essards. | |
| Le jeune mousse | 30 | de Roosmalen. | |
| L’onguent miton-mitaine | 39 | Mlle Lucy Saunders. | |
| Don Juan d’Autriche | 47 | Mme de Sainte-Marguerite. | |
| Petit-Pierre ou le dénicheur d’oiseaux | 57 | Louis de Toureil. | |
| Les Peaux-Rouges du Labrador | 70 | James Forster. | |
| L’enfance de Mozart | 79 | Léon Guérin. | |
| Le marchand forain | 88 | Gustave des Essards. | |
| Le petit saint | 104 | Mme Eugénie Foa. | |
| Le fils du Maréchal d’Ancre | 113 | L. Amiel. | |
| Le nécessaire et le superflu | 120 | Mlle Lucy Saunders. | |
| Un honnête jeune homme | 127 | Th. Midy. | |
| Un prix de vertu | 141 | H** D***. | |
| André le savoyard | 147 | Jules de Somerville. | |
| Les deux frères | 157 | Claire Brunne. | |
| Les Chinois de Maimatchin | 169 | Anonyme. | |
| Les animaux qui parlent | 174 | Charles-Malo. | |
| Le conducteur de l’aveugle | 188 | Mme Eugénie Foa. | |
| La tour de Mayenne | 197 | James Forster. | |
| Tout pour une bague | 202 | Mlle Lucy Saunders. | |
FIN DE LA TABLE.
LISTE
DES VIGNETTES DE CE VOLUME
DESSINS
de m. H. Emy.
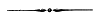
| Pages | ||
| 1. | Le petit domestique du collège de Navarre | 7 |
| 2. | Les deux pupilles de lord Aresvood | 20 |
| 3. | L’onguent miton-mitaine | 39 |
| 4. | Petit-Pierre ou le dénicheur d’oiseaux | 57 |
| 5. | Les Peaux-Rouges du Labrador | 70 |
| 6. | Le marchand forain | 88 |
| 7. | Le petit saint | 104 |
| 8. | Le nécessaire et le superflu | 120 |
| 9. | Un honnête jeune homme | 127 |
| 10. | André le savoyard | 147 |
| 11. | Les deux frères | 157 |
| 12. | Les animaux qui parlent | 174 |
| 13. | Le conducteur de l’aveugle | 188 |

LE
DIMANCHE DES ENFANTS
JOURNAL DES RÉCRÉATIONS.
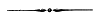

Bien que Nicolas Ferry ait été le favori d’un roi, sa destinée fut des plus malheureuses ; car, n’est-ce point un malheur que de se savoir homme et de ne pas compter parmi les hommes ? N’est-ce pas un malheur aussi que de voir les autres créatures humaines s’élever par le travail, se distinguer par des services rendus à la société, quand soi-même on ne peut ni travailler, ni rendre aucun service, quand il faut rester le jouet des autres et être à jamais un objet de pitié ? Celui dont nous voulons parler eut des envieux peut-être, attendu que la faveur d’un souverain excite toujours l’envie ; il eut des admirateurs, sans doute ; mais l’admiration qu’il fit naître n’avait rien d’honorable pour l’homme moral ; elle se rapportait tout entière à la physionomie singulière de l’individu ; c’étaient et l’exiguité de son corps, et la délicatesse de ses membres, et la faiblesse de sa voix, qui excitaient la surprise ; on s’étonnait de voir vivre une si frêle créature, comme on est étonné quand on voit un ouvrage d’une délicatesse extrême sortir, sans être brisé, des mains de l’ouvrier qui l’a formé.
Charles Perrault, cet ami de tous les enfants de son siècle et des enfants de tous les siècles à venir, semble avoir pressenti l’existence de Nicolas Ferry, quand il écrivit l’histoire du Petit Poucet. Bien entendu qu’il ne s’agit là que de la taille de notre héros.
C’est à Plaines, le 13 novembre 1741, que naquit le favori du roi de Pologne, Stanislas. On dit que la bonne villageoise qui fut sa mère, avait eu sans cesse devant les yeux une figure de cire, haute d’un demi-pied environ, qui représentait l’Enfant Jésus dans sa crèche. On ajoute que le petit Nicolas était, en tout point, semblable à cette image de Notre-Seigneur. La maman avait préparé pour son nouveau-né une belle layette, avec des brassières et des bonnets de dimension ordinaire ; mais rien de tout cela ne put servir pour habiller le nouveau-né, et, sans une petite fille qui consentit à prêter les habits de sa poupée, on n’aurait rien trouvé d’assez petit pour aller à la taille de cet enfant.
Quand il fut question de présenter Nicolas Ferry au baptême, on se trouva fort embarrassé ; c’était une si petite créature, qu’on n’osait pas même le porter sur les bras. Une mère est toujours ingénieuse lorsqu’il s’agit du bien-être de son enfant : la villageoise ne trouva rien de mieux que de faire, au chétif marmot, un petit lit de filasse dans un sabot, et c’est ainsi qu’il fut porté à l’église. Le sabot rembourré devint le berceau de Nicolas Ferry ; et, à l’âge de six mois, ce lit était encore assez grand pour lui. Il avait une bouche si petite, oh ! mais si petite, qu’on fut plusieurs jours avant de savoir quel moyen on emploierait pour le nourrir ; à défaut de sa mère, une chèvre fut la nourrice de l’enfant, et nous devons dire que l’excellent animal se prit d’une affection toute maternelle pour son nourrisson. Nicolas, ou plutôt Bébé (car c’est sous ce nom qu’il est généralement connu), se développait lentement ; c’est à deux ans seulement qu’il commença à marcher. Alors on lui fit faire des souliers qui n’avaient, dit-on, que dix-huit lignes de longueur : encore ses pieds étaient-ils fort à l’aise dedans ; mais le cordonnier du village, habitué à confectionner des chaussures de rouliers, prétendit n’en pouvoir faire de plus petits, et, faute de mieux, il fallut bien se contenter de ces grands souliers-là.
Quand Bébé eut atteint l’âge de six ans, la renommée porta son nom jusqu’à la capitale du duché de Lorraine. Le roi de Pologne, Stanislas, qui habitait alors Lunéville, manifesta le désir de voir cet enfant extraordinaire. Le père Ferry arriva à la cour, portant au bras un tout petit panier ; Stanislas, surpris de voir que le villageois était seul, lui demanda pourquoi il n’amenait pas son fils avec lui ; pour toute réponse, le père Ferry tira de son panier un petit bonhomme haut de vingt-deux pouces, et qui pesait environ huit livres. La mignonne créature avait un joli visage, et ses membres étaient parfaitement proportionnés à sa petite taille ; le timbre de sa voix ne sonnait pas plus haut que celui d’un enfant de quelques semaines ; il parlait difficilement, et la syllabe qu’il accentuait le plus souvent était bé... bé... bé... de là lui vint son nom de Bébé. Le roi décida sans peine le père Ferry à laisser le jeune nain à Lunéville. Le paysan retourna dans son village, emportant une bonne récompense et s’estimant trop heureux d’avoir pu placer si avantageusement cet enfant qui ne pouvait être qu’un embarras de plus dans une si pauvre famille que la sienne. Sa femme, qui avait un vrai cœur de mère, ne se montra pas si empressée que le père Ferry à rendre grâce à Dieu des bonnes dispositions du roi pour le petit Bébé : à toute force, elle voulut revoir son fils, et, quoique son mari ne cessât de lui répéter, à chaque instant, qu’il n’était ni beau, ni poli d’aller déranger le roi tous les jours pour un enfant dont Sa Majesté avait promis d’avoir soin, la bonne femme fit la sourde oreille ; elle mit ses habits des dimanches, et s’en alla à Lunéville.
Quoiqu’on ait prétendu que Bébé prît si fort à cœur sa séparation d’avec ses parents, qu’il en tomba malade, nous dirons, pour être plus exact, que cette fragile créature était presque entièrement privée de l’organe de la mémoire ; aussi, lorsque Bébé revit sa mère à Lunéville, bien qu’il se fût passé fort peu de temps entre le voyage de la bonne femme et le séjour de Bébé auprès du roi, le pauvre nain ne la reconnut pas.
Le froid accueil que Bébé fit à sa mère ne venait pas de son ingratitude envers celle-ci, mais bien de la faiblesse de son intelligence ; ses souvenirs n’allaient pas plus loin que quinze jours dans le passé ; c’est à peine s’il se rappelait les événements de la veille. Il ne vivait que pour le moment présent ; mais alors toute la bonté de son cœur se manifestait par les plus tendres caresses envers les personnes qui prenaient soin de lui. Bébé avait vu revenir sa mère sans éprouver aucun mouvement de joie ; mais quand il fut question du départ de la bonne villageoise, il en eut un si grand chagrin, que c’est alors, vraiment, qu’on trembla pour sa vie.
Tous les moyens qu’on mit en œuvre pour lui donner un peu d’instruction n’eurent aucun résultat satisfaisant ; malgré sa bonne volonté, il ne parvint pas même à savoir complétement l’alphabet ; il ne put retenir que les voyelles ; quant aux autres lettres, elles étaient toutes pour lui un B. Le roi Stanislas, qui l’aimait beaucoup, voyant qu’on ne pouvait lui apprendre ni à lire, ni à compter, voulut profiter de son goût pour la musique, et il lui donna un maître de chant et de danse. Bébé avait la voix juste et battait la mesure avec précision ; on en fit donc un danseur ; mais tel était son peu de mémoire, que ce n’est qu’en suivant les signes de son maître qu’il parvenait à exécuter le pas qu’on lui faisait recommencer tous les jours. L’enfant ne concevait que ce qui frappait ses sens, c’est-à-dire que son intelligence n’était apte à comprendre que ce qu’il pouvait toucher avec la main, voir avec les yeux ; si bien qu’il fut toujours impossible de lui donner la plus légère notion de religion et de morale.
Le pauvre nain, inutile sur la terre, n’était bon qu’à devenir le jouet de son bienfaiteur ; aussi le roi le faisait-il servir à une foule de surprises qui devaient divertir la cour. Un jour, dans un grand dîner d’apparat, on servit un énorme pâté sur la table du roi ; les convives regardaient cette magnifique pièce avec admiration ; ils attendaient, non sans impatience, qu’on mît le couteau dans ce superbe pâté ; tout à coup la calotte qui le recouvrait est repoussée avec force, et, des flancs de ce bel ouvrage de pâtisserie, s’élance un guerrier armé de pied en cap. Ce guerrier, c’était le nain Bébé. Après avoir fait militairement le tour de la table en menaçant tous les convives de la pointe de son sabre, il retourna se mettre en sentinelle auprès de son pâté jusqu’au moment du dessert. Alors, sur un signal donné par Stanislas, on assiégea le guerrier en miniature d’une si prodigieuse grêle de dragées, que le nain disparut entièrement sous ce monceau de bonbons.
Quelques souverains de l’Europe envièrent à Stanislas le bonheur qu’il avait de posséder un tel favori ; on tenta même de le lui dérober. Un émissaire de l’impératrice de Russie fut découvert au moment où il glissait Bébé dans une poche de son manteau ; Stanislas, craignant qu’une pareille tentative d’enlèvement ne se renouvelât, donna des pages à Bébé, et il l’obligea à rester prisonnier dans le palais. Le nain s’y ennuya tant, qu’il fut atteint d’une secrète mélancolie : ce qui obligea son maître à lui fournir des moyens de distraction. On lui fit faire une maison roulante, dont les chambres et les meubles étaient proportionnés à sa taille ; on y plaça les animaux les plus petits qu’on put se procurer : il y avait une levrette moins grosse qu’un écureuil, deux tourterelles blanches comme neige et grosses comme un moineau franc.
Stanislas ayant à faire un voyage à Versailles, emmena Bébé avec lui. Toutes les dames de la cour de Louis XV se disputaient le plaisir de le tenir sur leurs genoux ; quelques-unes même cherchèrent à se l’approprier, et plus d’une fois on l’entendait dire à Stanislas : « Bon ami, voilà une dame qui voulait me mettre dans sa poche pour m’emporter. »
A son retour à Lunéville, le roi de Pologne eut la singulière fantaisie de marier Bébé ; on lui amena une paysanne des Vosges, nommée Thérèse Souvray, qui avait environ trente trois pouces de haut. Les fiançailles eurent lieu ; mais c’est la dernière fête à laquelle Bébé put prendre part. Il avait alors vingt et un ans, et déjà on voyait en lui tous les signes de la décrépitude. On le portait dans la partie du parc la mieux réchauffée par les rayons du soleil, car c’est là seulement qu’il se ranimait un peu. Son corps était courbé, sa voix tout à fait éteinte ; enfin sa raison, déjà bien faible, l’abandonna tout à fait. Il végéta ainsi pendant deux ans encore, et puis son dernier jour arriva. Par un effort extraordinaire de la nature, à ses derniers instants, Bébé vit son intelligence se manifester par des raisonnements d’un ordre supérieur.
Sa mère, qu’on avait fait venir à la cour, le tenait sur ses genoux quand il mourut. Bébé, après une longue et douloureuse agonie, retrouva assez de force dans la voix pour dire en expirant : « Je ne pourrai donc pas baiser encore une fois la main de mon bon ami ! »
On était au mois de Juillet de l’année 1508 ; la nuit commençait à tomber ; un enfant de huit ans environ, à peine vêtu et les pieds nus, descendait le coteau de Saint-Gobain, en Picardie ; il marchait lentement, suivi de quelques moutons ; mais sans le chien qui courait après ces innocents animaux, les ramenant quand ils s’écartaient, les mordant quand ils s’arrêtaient, il était aisé de voir qu’ils auraient bien pu prendre le chemin qui leur aurait convenu, sans que leur gardien fit la moindre attention à eux.
Au reste, ce gardien n’avait d’un enfant que l’âge, la petitesse de taille, et la mignardise des traits ; sa physionomie était soucieuse et grave ; une pâleur maladive avait remplacé, sur ses joues, la fraîcheur de la jeunesse ; ses mains tenaient un livre ouvert ; mais bien que l’obscurité l’empêchât d’en distinguer les caractères, il n’en tenait pas moins les yeux fixés dessus, comme s’il eut voulu deviner ce qu’il ne pouvait lire.
Une voix qui partait d’une chaumière devant laquelle il passait, l’arracha à sa préoccupation : « Eh bien, Pierre, tu passes sans dire bonsoir à la vieille Louison, lui cria une vieille femme qui filait sur le seuil de sa porte.
— Mon intention était cependant de m’arrêter chez vous, bonne Louison, reprit l’enfant en s’approchant (mais sans rien perdre de son sérieux), de vous dire bonsoir, de vous embrasser...
— Comme tu dis cela, Pierre, reprit la vieille Picarde ! on dirait que tu pars pour un voyage lointain, et que nous ne devons plus nous revoir.
— Oh ! j’espère bien vous retrouver toujours bonne, et bien portante, dit Pierre.
Ramus.

| Lith. de Cattier | |
| Où vas-tu donc comme ça, lui dit celui-ci en lui barrant le chemin? | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET. Editeur du DIMANCHE des Enfants.
— Et toujours disposée à partager mon goûter avec mon petit Pierre, qui, le dimanche, a la gentillesse de me lire l’office, moi qui suis trop vieille et trop infirme pour aller l’entendre à l’église... Tiens, Pierre, voici un petit pain blanc que le boulanger m’a donné ce matin, et des noix fraîches du noyer de mon enclos ; prends, mon enfant, régale-toi, et... mets ceci dans la pochette de ta culotte... approche donc, as-tu peur ?... c’est une pièce de douze sous... J’ai vendu ce matin le lin que j’avais filé... Allons, vas-tu pas faire des façons... suis-je pas ma maîtresse... Ai-je des héritiers pour leur donner ce que je gagne ? Mais si mon petit Pierre n’est pas mon fils, il est mon enfant d’adoption... Prends donc et ne t’arrête pas plus longtemps... tu serais grondé ; va, mon fillot, va, à demain, n’est-ce pas ?... Oh ! quels beaux yeux ça vous a, cet enfant ! et ce front, ce front !... Pierre, tu ne sais pas à quoi je pense chaque fois que je te regarde, je pense que tu n’es pas né pour garder des moutons toute ta vie... j’ai là quelque chose qui me dit que tu seras un jour un grand homme... Tu souris, c’est bon signe... Pourtant, une chose m’inquiète... c’est que, si tu ne quittes pas Saint-Gobain, je ne sais pas trop comment tu feras pour devenir un grand homme... un homme dont chacun parlera en se disant : Vous connaissez bien le petit La Ramée... le fils de La Ramée, maître charbonnier, et de la Catelinette... ce petit que nous avons tous vu pas plus haut que ça... eh bien !... il a fait son chemin...
— En effet, bonne Louison, je ne resterai peut-être pas toujours à Saint-Gobain. Qui sait !... un beau jour... comme qui dirait demain... ou après... et puis, ajouta-t-il en jetant ses bras caressants autour du cou de la vieille Picarde, si tu ne me vois pas demain, prie le bon Dieu pour moi... entends-tu ?...Bonne Louison, dis la prière qu’on fait pour les voyageurs... Adieu... je ne t’oublierai jamais.
— Heim !... quoi... que signifie cet adieu... Pierre... Pierrot... »
Mais Pierrot ne lui répondit pas ; il était déjà loin ; il avait rattrapé ses moutons qui s’en allaient sans lui, et se dirigea, comme eux, vers une ferme autour de laquelle se trouvait beau coup de charbon de terre amoncelé.
Avant d’y entrer, Pierre s’approcha d’un vieux chêne voisin de l’habitation : à l’aide de quelques nœuds formés dans l’écorce de l’arbre, Pierre grimpa jusqu’à la première branche ; et là il déposa dans un trou caché par les feuilles, le pain, les noix et la pièce de douze sous de Louison ; puis il se disposait à descendre, lorsqu’il se sentit la jambe prise par une main de fer.
— Ah ! petit dénicheur d’oiseaux, je te tiens, dit une voix rude, mais dans laquelle une inflexion joviale se faisait sentir.
— Ah ! c’est toi, Richard... dit Pierre en sautant en bas de l’arbre ; tu m’as fait peur... J’ai d’abord cru que c’était mon père.
— Ton père te croit sans doute rentré ; c’est aujourd’hui samedi ; il fait ses comptes de la semaine, le père La Ramée ; quant à ta mère, elle est allée voir à l’étable, où elle a trouvé... absence complète de brebis...
— Oh ! ma mère ! elle crie, mais elle n’est pas méchante.
— Oui, mais ce n’est pas tout, reprit Richard ; là où elle cherchait des brebis, elle a trouvé autre chos... un livre !... et il faut voir le beau sabbat qu’elle fait pour savoir à qui appartient ce livre... J’ai dit qu’il était à moi, mais, bast ! pas la plus légère poussière de charbon sur les feuillets, et comme mes mains sont toujours noires, elle a bien vu qu’elles n’y avaient pas touché...
— Pourvu qu’elle me rende mon livre, se dit Pierre, sans répondre au valet de son père. »
Comme il entrait dans la cour de l’étable, il y vit sa mère, grosse paysanne, qui, au lieu de lui donner sa pitance accoutumée, lui dit sèchement : « Entre au logis, ton père a à te parler.
— Aïe, aïe, fit Richard à l’oreille de Pierre. Ça se gâte... n’importe, accuse-moi toujours ; j’ai bon dos. »
Pierre adressa au brave paysan qui lui disait cela un charmant sourire empreint d’une tristesse résignée, et il suivit sa mère dans la première pièce de la ferme, qui servait à la fois de cuisine et de chambre à coucher au chef de la famille.
Un homme, à l’aspect rude et sérieux, était assis à une table, ayant devant lui un cahier ouvert sur lequel il écrivait, et tout à côté le livre trouvé dans l’étable.
« La Ramée, voici Pierre ! » dit la mère en précédant son fils.
Celui-ci, levant les yeux sur l’enfant, lui dit alors : « Que vous est-il donc arrivé aux champs, pour ramener si tard vos moutons du pâturage ? — Rien, mon père, répondit Pierre.
— A qui est ce livre ? répliqua La Ramée, désignant du doigt celui qu’il avait devant lui.
— A moi, dirent en même temps Pierre et Richard...
— Qui vous l’a donné ? demanda le charbonnier, s’adressant toujours à son fils, habitué qu’il était de voir toujours son valet de ferme s’interposer entre lui et l’enfant. — Moi, dit Richard — Je l’ai acheté, dit Pierre. — Acheté ! répéta La Ramée avec le plus grand étonnement ; vous avez donc de l’argent ?
— Est-ce que je n’en gagne pas, not’ maître, dit Richard, faisant à l’enfant des signes que celui-ci n’apercevait pas.
— Richard, dit le chef d’une voix sévère, si tu voulais bien te taire, quand je ne te parle pas, et laisser Pierre me répondre...
— Oui, Richard, laisse-moi répondre, reprit Pierre d’un air assez décidé.
La Ramée reprit : — J’admets que Richard t’ait donné de l’argent pour acheter ce livre, mais qu’en fais-tu ?
— Je lis, mon père, répondit Pierre sans hésiter.
— Tu lis ! s’écria le père.
— Tu lis ! s’écria la mère, qui posait en ce moment la soupe sur la table, et faillit, d’étonnement, la laisser tomber : tu lis, et comme ça t’est-il venu, bonne sainte Vierge !
— Mais en apprenant, répliqua Pierre.
— Et qui t’a appris à lire ? poursuivit la paysanne.
— Moi, dit Richard ; le petit m’avait un jour rendu un service, je lui en ai rendu un autre...
— Beau service, vraiment, et j’aurais dû m’en douter, grand bon-à-rien, cria la paysanne en colère ; si cet enfant se perd, il pourra bien t’en accuser... Lui apprendre à lire... mais a-t-on vu des inventions pareilles !... Lui aurais-tu, par hasard, appris aussi à écrire ?
— Hélas ! je ne le sais pas moi-même, maîtresse, répondit Richard.
— C’est, ma foi, bien heureux, répliqua la ménagère ; mais à quoi tout cela lui servira-t-il ? je vous le demande... sainte mère du bon Dieu.
— Ce n’est pas là la question, femme, interrompit La Ramée ; et certes, si j’avais eu du temps de reste, je lui aurais enseigné tout cela moi-même, mais la misère est une triste chose.
— Oh ! oui, bien triste, dit Pierre avec un soupir, et s’enhardissant du silence de son père : cependant, papa, si vous vouliez...
— T’envoyer à l’école, n’est-ce pas ? reprit celui-ci... est-ce que j’ai le moyen d’avoir sous mon toit des bouches inutiles... pendant que tu irais à l’école, qui est-ce qui mènerait paître les moutons ?... Il faut que chacun gagne son pain, chez moi, s’il veut manger...
— Tiens, voilà ton souper, lui dit sa mère, en lui présentant une écuelle de soupe et un morceau de pain bis.
— Je voudrais mon livre ?... dit Pierre, prenant son souper d’une main et tendant l’autre vers son père.
Celui-ci prit le livre pour le passer à son fils, mais avant, une réflexion le lui fit ouvrir.
— De qui est ce livre ? demanda-t-il.
— De Jean de Roly, répondit Pierre.
— Qu’est-ce que ce paroissien ? demanda la mère, continuant à servir le potage aux ouvriers de la ferme.
— C’est un des orateurs les plus éloquents du siècle dernier, ma mère, répondit l’enfant ; il était chancelier et archidiacre de l’église de Notre-Dame, à Paris ;... il savait lire celui-là, et écrire aussi, ajouta Pierre en poussant un gros soupir, à preuve qu’en 1461, le parlement ayant à faire des remontrances à Louis XI, c’est lui qui les rédigea ; plus tard encore, en 1483, le clergé de Paris l’envoya aux états-généraux de Tours, où il parla de la répression des abus ; Charles VIII, le fils de Louis XI et le père de notre roi actuel, Louis XII, fut si content de lui, qu’il le nomma son aumônier et le retint à sa cour.
— Ta, ta, ta, en dégoise-t-il long... s’écria la fermière, pendant que La Ramée, tout entier à ses calculs, n’écoutait pas son fils.
— C’est pourtant moi qui ai appris tout ça au petiot, dit Richard.
— Eh bien ! tu peux te vanter de lui en avoir appris de belles, répliqua la femme La Ramée... Allez vous coucher, monsieur le savant, ajouta-t-elle, donnant une poussée à son fils ; allez trouver votre Jean Joly.
— Jean de Roly, ma mère, répondit Pierre en prenant son livre, et je ne peux aller le trouver, puisqu’il est mort le 27 mars 1499, il y a de cela 13 ans...
— Sans cela, n’est-ce pas, petit ingrat, tu irais aussi trouver Louis XI, et puis Charles VIII, ou IX, ou X, et puis tu deviendrais le favori de la cour, son aumônier, son archidiacre, que sais-je, moi ? vous n’êtes qu’un ambitieux, monsieur... Comme ça va bien l’ambition au fils d’un charbonnier de la Picardie !...
— Mon père est charbonnier, oui, répliqua Pierre entre ses dents, mais il n’est né charbonnier ni Picard ; mon grand-père était noble, de Liège ; moi, je suis du Vermandois.
— Et tu te crois gentilhomme, n’est-ce pas ? interrompit la fermière.
— Oh ! mon Dieu, ce n’est ni à mon titre de gentilhomme que je tiens, répliqua Pierre, ni à la noblesse de mes grands parents ; je voudrais être savant, voilà tout.
— Voilà tout ! eh bien ! va te coucher, reprit sa mère, et rêve que tu l’es, ce sera la même chose. »
Les enfants ont un instinct qui les empêche de dire, à certaines personnes, certaines choses qu’ils savent ne pas être comprises par elles ; Pierre se tut donc ; il sortit de la cuisine, fit un signe d’amitié à Richard, et alla se coucher près de ses brebis.
Le lendemain était un dimanche. Lorsque Catelinette se leva, elle vit son fils qui se lavait le visage dans la cour de l’étable.
— Qu’est-ce que tu attends pour mener les brebis aux champs ? lui dit-elle.
— J’irai entendre le sermon de M. le curé, et je voudrais bien mettre mes beaux habits du dimanche, » lui répondit-il.
La mère remonta, et redescendit un paquet sur le bras. « Tiens, lui dit-elle.
— Vous ne m’embrassez pas ? dit Pierre en recevant le paquet.
— A quoi bon, répondit la paysanne.
— On ne sait ni qui meurt, ni qui vit, comme dit la vieille Louison, reprit l’enfant ; si vous alliez ne plus me revoir !...
— Cet enfant a toujours des idées extraordinaires, dit la mère, posant les lèvres sur le front de son fils et lui donnant une tape sur l’épaule. Allons, vite, ajouta-t-elle. »
Un moment après, Pierre, habillé des pieds à la tête, faisait un paquet de ses mauvaises hardes, qu’il attachait au bout d’un bâton ; il alla ensuite au chêne déterrer sa cachette, qui consistait en pain, en galette, en noix et en quelques menues monnaies, parmi lesquelles la pièce de douze sous de la vieille Louison, et deux ou trois livres qu’il s’était procurés on ne sait où et comment ; il joignit tout cela au paquet, et ayant fait sortir les brebis de l’étable, il les conduisit sur la montagne où il avait l’habitude de les mener. Là, il les compta une à une, en leur faisant à chaque une caresse de la main.
« Chères brebis, leur dit-il, non sans émotion, mes compagnes de jour, mes camarades de nuit, vous que depuis dix-huit mois je n’ai pas quittées, vous dont les gentils béé béé accompagnaient si monotonement les vers que j’apprenais par cœur et récitais tout haut ; adieu... adieu... toi, ma belle indifférente toute blanche... adieu, toi, ma jolie sauteuse toute tachetée... et toi, mon amoureuse, qui viens manger dans ma main, et toi, ma petite capricieuse, et toi, sauvage, qui t’enfuis quand on t’appelle... enfin, vous toutes, adieu... Hélas ! c’est mal à moi de vous quitter, je le sais : c’est bien plus mal de quitter mon père et ma mère sans leur permission ; mais que faire ?... il faut que j’apprenne, il faut que je sache ce que les hommes des villes savent ; et c’est pour ça que je m’en vais, que je vais à Paris, où il y a des écoles, où peut-être quelque savant aura pitié du pauvre enfant qui lui demandera l’aumône de ce qu’il sait... Adieu, ma belle montagne de Picardie, ajouta Pierre promenant autour de lui des regards attendris... du haut de laquelle je vois la route blanche qui conduit à Paris... Adieu, mon joli petit sentier pierreux qui conduis à la maison de mon père, et que j’ai monté aujourd’hui pour la dernière fois... Adieu, arbres à l’ombre desquels je m’asseyais pour lire... adieu tout... et toi, pauvre Loulou, ajouta-t-il en s’adressant à son chien, je te confie mes brebis, garde-les sur cette montagne jusqu’à ce soir... afin qu’on ne s’aperçoive pas tout de suite de mon absence... puis, à la nuit, tu les ramèneras au bercail... »
Puis sentant une larme qui le gagnait, Pierre détourna brusquement la tête, prit son bâton, au bout duquel était son paquet, et s’élança sur le versant de la montagne au pied de laquelle la route était tracée ; au moment où, tout joyeux, il s’élançait sur le chemin, il s’arrêta en voyant venir à lui Richard.
« Où vas-tu donc comme ça, lui dit celui-ci en lui barrant le chemin.
— Si on te le demande, Richard, dis que tu n’en sais rien, répondit Pierre essayant de passer outre...
— Je le devine, enfant, tu nous quittes, dit cet homme d’une voix émue.
— Richard, c’est le dernier service que j’exige de toi, reprit Pierre aussi ému que lui ; tu m’as appris à lire, vois-tu ? c’est comme si tu m’avais ouvert les portes d’un beau jardin ; il faut maintenant que j’entre dans ce jardin... Je vais à Paris.
— Sans la permission de ton père ?
— Sans sa permission ; si je la lui avais demandée, et qu’il me l’eût refusée, je n’aurais pu partir... Ainsi, adieu ; tu as mon secret... quand je serai grand, savant, riche, heureux, je penserai à toi, adieu... »
Et l’enfant était bien loin déjà sur la route, que le pauvre Richard était encore debout, les yeux fixes, ouvrant les yeux et les oreilles, doutant de ce qu’il voyait, de ce qu’il avait entendu.
Le soir, lorsqu’on vit revenir les brebis sous la seule garde de Loulou, toute la ferme était en émoi. « Où est Pierre ? Pierre ! criait-on de tous côtés. Le seul Richard se taisait et soupirait dans un coin, priant Dieu pour le petit voyageur.
Après bien des fatigues et des peines, Pierre La Ramée atteignit enfin Paris ; jusqu’alors il avait reçu une généreuse hospitalité dans tous les villages où il passait ; aussi n’avait-il pas encore touché à son petit trésor ; mais il n’en fut pas de même dans la grand’ville. Au premier cabaret où il s’arrêta pour manger et dormir, on lui demanda s’il avait de quoi payer ; il sortit, à regret, de sa petite escarcelle juste ce qu’il fallait pour payer une écuelle de soupe et un morceau de pain sec ; pour ce qui est d’un lit, il dormira tout aussi bien à la belle étoile ; et voilà le pauvre enfant qui, une fois son maigre repas pris, se mit à chercher un abri pour la nuit.
Le pilier des halles servait, en ce temps-là, de refuge à tous les gens sans asile, sans profession avouée ; Pierre y trouva, sous un auvent, et la tête sur une pierre, un sommeil dû autant à la fatigue, qu’à l’heureuse insouciance de son âge.
Le brouhaha de la ville, et surtout du quartier où il se trouvait, le réveilla de bonne heure ; étourdi par ce bruit qui le poursuivait de rue en rue, Pierre se joignit à une troupe d’enfants qui se rendaient à un collège, mais, arrivé devant la porte, les enfants entrèrent, et lui resta sur le seuil.
Que faire ? il n’était pas venu à Paris pour mendier un morceau de pain, de porte en porte, mais pour tâcher de se procurer un peu de science ; il frappa à la porte de ce collège.
« Qui demandes-tu ? dit le portier.
— Je demande à entrer et à écouter ce qui se dit ici, répondit naïvement le petit étranger.
— Qui es-tu ?
— Un pauvre enfant venu à pied de son village pour s’instruire, mon bon monsieur...
— Et as-tu de quoi payer ta place ici ?
— Hélas ! je ne possède rien au monde.
— Alors, reprends le chemin par où tu es venu, » répondit le portier, refermant la porte sur le nez du petit La Ramée.
Toutefois, l’enfant ne se découragea pas ; il s’assit sur une pierre. — Les enfants sont entrés, se dit-il à part lui, ils sortiront : l’un d’eux aura bien quelque pitié de moi.
Et il attendit ; son attente ne fut pas trompée ; la grande porte s’ouvrit encore, et une foule d’enfants se présenta pour sortir. Ils étaient venus, deux à deux, silencieux et réfléchis ; ils sortaient comme une bande d’oiseaux qui prennent leur volée ; à peine si notre petit bonhomme fut remarqué par eux ; et si l’un d’eux n’était pas tombé en voulant passer devant un camarade, Pierre n’aurait jamais trouvé le moyen de se faire entendre.
« Vous êtes-vous fait mal, mon petit messire, dit Pierre en l’aidant à se relever.
— Non, répondit l’enfant ; merci, petit, » et il passa outre.
On devine le désespoir de Pierre en se retrouvant seul sur la marche de ce collège, et regardant cette grande porte verte qu’il commençait à désespérer de voir s’ouvrir pour lui. Tout à coup une idée le saisit, et il fondit en larmes.
« Dieu me punit, dit-il, d’avoir affligé mes parents ; » et aussitôt il s’enquit d’une église. Le temple de Dieu ne ressemble en rien aux habitations des hommes ; les portes en sont toujours ouvertes pour tout le monde, pour le riche comme pour le pauvre, pour l’heureux comme pour l’affligé. Pierre y entra, et allant se jeter à genoux sur une dalle, il y pleura et il y pria longtemps ; puis, quand il en sortit, il alla reprendre sa place sur la marche du collège.
Cette fois, en passant près de lui, l’enfant qu’il avait relevé le matin, le salua.
« Messire... lui dit Pierre en faisant un pas en avant.
— Tiens, lui dit l’écolier, voulant lui mettre une pièce de monnaie dans la main.
— Ce n’est pas ça, dit Pierre retirant sa main.
— Quoi donc, reprit l’enfant étonné.
— Prêtez-moi un de vos livres, je vous le rendrai à la sortie.
— Que ça ? dit l’enfant de plus en plus étonné.
— Oh ! c’est beaucoup, et vous me rendrez bien heureux ! dit Pierre.
— Tiens, fit l’enfant, lui jetant au hasard le premier livre qui lui tomba sous la main. »
C’était un rudiment latin. Pierre l’ouvrit, il le tourna en tous sens, désolé qu’il était de n’y rien comprendre. Quand le petit écolier repassa, Pierre lui rendit son livre en soupirant. « Demain je t’en prêterai un en français, » lui dit l’enfant, et il tint parole.
Mais ce n’est pas tout, mes chers amis, que de lire et d’apprendre ; la première condition dans cette vie est de manger, et pour cela Pierre vendit ses beaux habits des dimanches, et reprit ses mauvais ; il n’eut d’autre lit que le banc de pierre adossé au collège. Il réduisit sa nourriture au plus strict nécessaire, mais malgré toutes ces privations que Pierre supportait avec un courage surhumain, la faim, la misère se faisaient sentir tous les jours davantage ; il était près d’y succomber.
« Tout ceci est une punition de Dieu, se disait l’enfant, qui, au fond du cœur, se reprochait sa fuite de la maison paternelle. Oh ! ma pauvre mère, je t’ai causé bien assez de chagrins, sans y ajouter celui d’apprendre un jour que ton fils est mort loin de toi ; et puis mourir sans recevoir ta bénédiction, sans m’entendre dire que tu me pardonnes : partons, partons. »
Pierre n’était pas un enfant à prendre une résolution sans l’exécuter ; il se remit donc en route une seconde fois, mais celle-ci non plus la tête basse, l’œil inquiet, en fuyant, enfin ; non, il revenait la tête haute, sentant bien qu’il avait commis une faute, résigné à en recevoir le châtiment, mais aussi plein d’espoir en la bonté paternelle.
Ce fut Richard qui, le premier, aperçut Pierre. Il le devina plutôt qu’il ne le reconnut, car le pauvre enfant était si changé, si pâle, si exténué, que ce n’était plus que l’ombre de ce gentil petit La Ramée. Richard le prit dans ses bras avec transport.
« Oh ! qu’on a pleuré ton absence, lui dit-il, et qu’il m’a fallu de courage pour taire le secret que tu m’avais confié... Eh bien, tu as vu Paris ? Paris est-il grand ? Combien y a-t-il de maisons, de personnes ? est-on mis comme ici, y parle-t-on picard, as-tu vu beaucoup de choses ? en as-tu appris beaucoup ? es-tu bien savant maintenant ? »
Pierre sourit tristement : « De tout Paris, je ne connais que le banc de pierre de la Sorbonne ; je n’ai vu que des enfants qui y entraient et en sortaient deux fois par jour ; et je reviens aussi ignorant que j’étais parti... Oh ! j’ai bien souffert, Richard, surtout de la faim... Maman, mon père ! comment se portent-ils ? »
Tout en causant, ils étaient arrivés ; les parents de Pierre voulurent faire les méchants, refuser d’embrasser leur enfant, mais cela ne dura pas ; sans s’en douter, le père essuyait une larme en disant à son fils qu’il ne l’aimait plus, et la mère l’embrassait, en jurant ses grands dieux qu’elle ne lui ferait, de sa vie, une caresse.
« Allons, bast ! dit un frère de Catelinette en entrant, c’est le retour de l’Enfant prodigue....
— Moins le pourceau et le veau gras, répondit Pierre, à qui le bonheur de se retrouver dans sa famille arracha cette saillie.
— Je ne lui pardonnerai de ma vie, répétait le père.
— Moi, je ne le reconnais plus pour mon fils, disait la mère.
— Ta, ta, ta, dit l’oncle, que tout le monde l’embrasse et soit content ; toi, beau-frère, pardonne au petit ; toi, sœur, remplis-lui son écuelle de soupe, et toi, petit, promets à tes parents que tu ne quitteras plus le pays.
— Sans leur permission, répondit Pierre.
— Quoi ! tu songes encore à retourner là-bas ?
— Oui, mon oncle.
— Malgré ce que tu y as souffert.
— Oh ! la souffrance n’est rien ; apprendre est tout. »
Étonné de cette volonté de fer, l’oncle ne put s’empêcher de dire : « Eh bien ! qu’il en soit fait comme tu le désires, neveu ; il faut croire à l’avenir d’un enfant qui a le courage de tant souffrir pour atteindre son but... Quand le père n’est pas riche, il faut que la famille se saigne un peu ; je me saignerai, moi ; je suis vieux, sans enfants... j’ai quelques liards par là qui se promènent au fond d’un bahut ; promenade pour promenade, autant-vaut-il qu’ils se promènent dans l’escarcelle du marmot : qu’en dis-tu, frère ?
— Je dis, Vincent, que si tu paies l’école au petit, je ne demande pas mieux qu’il s’instruise, et je le laisserai volontiers retourner à Paris ? »
Grande fut la joie de Pierre en entendant ces paroles ; et le voilà, mais cette fois l’âme satisfaite par la bénédiction de ses parents, et ayant en poche une lettre et de l’argent pour le principal du collège de Navarre à Paris ; le voilà, dis-je, de nouveau sur la route poudreuse qui conduit au pays des sciences.
Il y arriva et alla droit au collège indiqué. Le jour où, pour la première fois, il s’assit sur les bancs de la classe, ayant un professeur en face de lui, fut pour notre jeune héros le plus beau jour de sa vie. Il lui sembla qu’il n’avait ni assez d’yeux pour tout voir, d’oreilles pour tout entendre, de mémoire pour tout retenir ; il s’asseyait à la table de la science comme un affamé s’assied à une table couverte de mets exquis ; aussi les succès qu’il obtint, furent-ils si prodigieux, surtout en latin, que ses camarades, pour exprimer l’ardeur avec laquelle leur nouveau camarade s’adonnait à cette langue, avaient latinisé son nom, et ne l’appelaient plus que Ramus. Ce nom de collège lui resta. Mais, hélas ! ce pauvre enfant devait être éprouvé encore avant d’atteindre le but qu’il se proposait.
Son oncle, plus généreux que riche, s’aperçut un jour que l’argent lui manquait pour payer la fin des études de son neveu. Il lui fit écrire simplement par le curé du village : « Quitte le collège, petit, les fonds manquent, et reviens au pays ; tu en sauras toujours assez pour tenir la charbonnerie de ton père. »
Au reçu de cette lettre, Ramus venait précisément de causer avec le proviseur de la classe, qui lui avait dit : « Encore deux ans, et vos études seront terminées.
— Deux ans, rien que deux ans, et il faut quitter le collège. Oh ! non ; Ramus trouvera un moyen de rester..., et, au lieu de se désespérer, ainsi qu’eût fait un enfant ordinaire, Ramus se mit à chercher un moyen.
On cherchait, depuis quelques jours, un domestique pour nettoyer les souliers et les habits des élèves : occupation qui, dans un collège aussi considérable que celui de Navarre, nécessitait un travail de presque toute la nuit ; et on en trouvait peu, car ce genre de labeur était assez mal payé, lorsqu’un matin il s’en présenta un, qui excita au plus vif degré l’étonnement du principal du collège.
« Un enfant ! s’écria cet homme, presque sans regarder celui qui se présentait, dont la taille, la tournure, les traits étaient ceux d’un enfant de neuf ans environ.
— Oh ! par pitié, ne me renvoyez pas ?
— Cette voix !... s’écria le principal ; eh ! mais, c’est Ramus..., Ramus, un de mes meilleurs élèves, qui se fait domestique !
— Mon oncle ne peut plus payer ma pension, reprit l’enfant fondant en larmes, et moi je ne veux pas quitter le collège...
— Soit, mon garçon, reste comme domestique ici, reprit cet homme touché de la douleur de l’ex-écolier, reste...; mais c’est dommage ; je pense que tu aurais fait un meilleur élève qu’un bon domestique... — Combien veux-tu gagner ? — Ah ! je n’ose.
— Voyons, dis ; en faveur de ton âge et de ton désir de rester ici, n’importe à quel titre, je grossirai un peu, à cet égard, le budget du collège.
— Messire, dit Ramus de l’air désespéré de quelqu’un qui risque le tout pour le tout, je ne demande pas d’argent ; je ne voudrais que la permission de ne pas quitter le jour mon banc à la classe. Je veux continuer mes études ; à ce prix, je serai domestique toute la nuit... mais que je sois élève, tout le jour.
— Et à quelles heures dormiras-tu ? demanda le principal, ému de ce désir généreux.
— N’y a-t-il pas des heures de récréation, répondit ce noble enfant ! »
Ce que peut l’envie d’apprendre, mes jeunes lecteurs ! cette envie qui, tout petit, dévorait déjà Ramus, le faisant se livrer aux plus rudes travaux de la domesticité une partie de la nuit, et, le jour, le retrouvait le premier en classe, comme le premier de sa classe. Rien ne lui coûtait, rien ; la science était le but de tous ses travaux, et pour l’acquérir, il ne pensait pas la payer trop, en l’achetant au prix de ses veilles.
Bientôt il reçut la récompense de tant de sacrifices ; Ramus ne quitta les bancs de l’école que pour prendre les degrés et les titres qui étaient alors les brevets indispensables d’un savant.
Le roi Henri II l’ayant plus tard nommé professeur d’éloquence et de philosophie au Collège de France, il écrivit alors plusieurs traités et de nombreux ouvrages, qui attestèrent autant la largeur de ses pensées que sa science profonde. Ce fut lui qui inventa le v ; avant, on se servait de l’u dans les deux cas où il fallait l’un ou l’autre.
Parvenu enfin au comble de tous ses désirs, Ramus, mes jeunes lecteurs, n’oublia ni ses parents, auxquels il put faire du bien, ni sa vieille Louison, qui lui avait prédit qu’il serait un grand homme, ni Richard, qui, le premier, avait développé son intelligence en lui enseignant à lire.
Ramus mourut dans les massacres de la Saint-Barthélemy.

Il y a quelques années, lord Aresvood, chef de l’une des plus grandes maisons de l’Angleterre, quitta Londres pour venir se fixer en France. Le climat humide et brumeux des Iles Britanniques ne pouvait convenir à la santé chancelante de milady Aresvood ; ce fut la cause qui détermina le noble lord à abandonner sa patrie.
Les deux Pupilles.

| Lith. de Cattier | |
| O mon Dieu comme tu es pâle! s’écria Jean en... approchant de son père. | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Il s’établit dans une ravissante propriété, située sur les bords de la Loire, au milieu de ce beau pays de la Touraine, surnommé à juste titre le Jardin de la France. Lord Aresvood avait alors cinquante ans ; sa taille élevée était pleine de noblesse, et sa tournure distinguée s’alliait bien avec le caractère de dignité de sa physionomie.
Vingt-cinq ans avant l’époque où lord Aresvood vint en France, son père était mort en lui laissant, pour tout héritage, des dettes considérables. Le jeune lord sentit vivement quels devoirs lui imposait l’éclat de son nom ; et, plutôt que de le laisser souillé, il renonça à la vie folle et dissipée qu’il aurait pu mener. Son premier soin fut de réunir les créanciers de son père ; il leur abandonna tous les biens qu’il tenait de sa mère, et leur demanda un délai de dix ans pour achever de se libérer envers eux. Ceux-ci, touchés de cette noble conduite, accédèrent volontiers à cette demande. Lord Aresvood partit alors, et se mit au service de la compagnie des Indes. A force de travail et de zèle, il parvint à se faire distinguer, et mérita d’être mis à la tête d’un des principaux comptoirs de la compagnie.
Au bout de dix années, les créanciers de son père furent payés, et, par suite, son nom reçut un nouvel éclat. La compagnie des Indes, reconnaissante de tous les services qu’il lui avait rendus, lui donna une position plus importante. Lord Aresvood justifia la confiance qu’il avait inspirée. Il resta quinze années encore dans l’Inde ; puis, après ce temps, il revint à Londres. Partout il fut reçu avec les plus grandes marques d’estime et d’amitié ; mais sa noblesse et son immense fortune ne furent pour rien dans cet accueil : il le dut entièrement à sa loyauté et à sa belle conduite.
Une autre circonstance vint ajouter encore à la bonne opinion qu’on avait de lui. Lord Aresvood, l’un des plus grands personnages de l’Angleterre, par son rang et par sa fortune, pouvait prétendre à tous les partis. Il apprit qu’une famille du pays de Galles avait été ruinée par suite d’un procès que son père n’avait gagné que par l’influence qu’il exerçait dans ce pays. Il rechercha soigneusement si quelque personne de cette famille n’existait pas encore. Après de nombreuses recherches, il parvint à découvrir que la fille de l’homme que son père avait ruiné vivait misérablement au fond d’un petit village. Il se rendit auprès d’elle pour soulager sa misère.
Mistress Smithson (c’est le nom de cette dame), habitait une pauvre chaumière entourée de quelques morceaux de terre, dont le produit suffisait à peine à son existence et à celle de sa fille, miss Clara.
Lord Aresvood s’informa d’elle dans le pays, et il sut que mistress Smithson, après avoir perdu son mari, avait consacré le peu de bien qui lui restait à l’éducation de sa fille. Miss Clara, disait-on, est un ange de douceur et de bonté ; elle soigne avec une patiente résignation sa vieille mère que les infirmités rendent grondeuse et exigeante. Jamais une plainte ne s’échappe de sa bouche ; elle ne quitte sa mère que pour aller à l’église.
Lord Aresvood vit, par lui-même, que tout ce qu’on lui avait dit était conforme à la vérité. Il se sentit touché en voyant cette jeune fille si belle et si vertueuse, et ne pensa pas pouvoir réparer, d’une manière plus complète, les malheurs de cette pauvre famille, qu’en demandant la main de Clara à mistress Smithson. Mais la pauvre dame était épuisée. Les maladies cruelles qui la faisaient souffrir, les chagrins qui l’avaient accablée, avaient usé ses forces. Elle mourut, et Clara demeura seule au monde.
Cette circonstance affermit encore lord Aresvood dans ses projets. Il demanda à Clara de devenir son épouse, et le pasteur du petit village de Chestery bénit leur union.
Ce fut un an après que, suivant l’avis des médecins, lord Aresvood vint en France pour rétablir la santé de sa femme.
Vers le commencement de l’été de 182*, lord Aresvood vit avec bonheur que la santé de sa femme avait ressenti les heureuses influences du climat de sa nouvelle patrie. Milady, jusqu’alors obligée de garder la chambre, reprit ses forces et put sortir. Son premier soin fut de visiter les chaumières qui avoisinaient sa propriété, et de soulager les infortunés qu’elle y rencontrait. Sa bienfaisance inépuisable s’étendait sur tous ceux qui en étaient dignes. Elle venait s’asseoir au chevet des malades ; elle les consolait par de douces paroles, et ramenait l’espérance dans leur cœur flétri par la misère. Dans tout le pays, on l’appelait la bonne dame.
Un soir, après une journée brûlante, les deux époux sortirent du château et descendirent vers la Loire. Le fleuve, éclairé par les rayons du soleil couchant, coulait comme un ruban de feu à travers les vertes prairies. Le ciel était pur, la brise du soir apportait les mille parfums des fleurs répandues dans les champs d’alentour.
Lord Aresvood aperçut un pécheur qui serrait tristement ses filets. « Eh bien, mon brave homme, la journée a-t-elle été bonne ? lui demanda-t-il.
— Non, monsieur, le poisson n’a pas mordu.
— Cependant, père Philippe, vous êtes un habile pêcheur.
— Dam’, not’ maître, depuis vingt ans que j’ viens ici tous les jours, c’est pas étonnant. Je connais le poisson comme moi-même. Mais il y a des jours où il se cache si bien dans le sable qu’il n’y a pas moyen de l’attraper. »
Comme le père Philippe achevait ces paroles, un cri déchirant un cri de détresse se fit entendre à quelque distance. Milady Aresvood s’était avancée sur un rocher élevé qui dominait la Loire ; et, soit que son pied eût glissé, ou que la tête lui eût tourné, elle était tombée dans le fleuve.
En entendant ce cri terrible, mylord chercha des yeux sa femme ; mais déjà Philippe s’était jeté à l’eau et nageait avec force pour atteindre la bonne dame que les flots emportaient rapidement. Le danger était d’autant plus grand qu’à quelques pas de là, se trouvait un trou profond dans lequel les flots tourbillonnaient. Le courant portait rapidement milady vers ce point. Quelques pieds l’en séparaient encore, lorsque Philippe l’atteignit.
La pauvre dame était évanouie. Le pêcheur la soutint d’une main et nagea courageusement de l’autre, mais ses forces diminuaient et le courant l’entraînait vers l’abîme. Un dernier effort désespéré le sauva ; et, après des fatigues inouïes, il parvint à gagner le bord.
Quelques paysans attirés par les cris de mylord, transportèrent sa femme au château, où bientôt elle reçut tous les soins que nécessitait son état. Philippe l’accompagna lui-même jusqu’à sa demeure ; puis il reprit le chemin de sa cabane. Sa figure était d’une pâleur effrayante et sa démarche paraissait incertaine, comme celle d’un homme ivre. Ses deux enfants, Guillaume et Jean, l’attendaient pour souper.
« Oh ! mon Dieu ! comme tu es pâle ! s’écria Jean en s’approchant de son père.
— Est-ce que tu es malade ? demanda Guillaume. »
Le père Philippe ne répondit pas et tomba sur le banc de pierre placé près de la porte de sa cabane. Les deux enfants effrayés coururent chercher des voisins qui portèrent le pêcheur dans son lit.
Vers dix heures, une voiture s’arrêta à la porte de la chaumière, et lord Aresvood en descendit ; il était accompagné du médecin qui avait soigné sa femme. L’aspect de cette chambre, à peine éclairée par une chandelle de résine, le silence des personnes qui s’y trouvaient, la tristesse de leur physionomie, lui serrèrent le cœur... il craignit un affreux malheur. Guillaume et Jean, agenouillés près du lit de leur père, tenaient ses mains dans les leurs et les couvraient de larmes abondantes.
« Qu’y a-t-il, mes amis ? demanda lord Aresvood.
— Nous n’en savons rien, monsieur, dit un des paysans. Les enfants sont venus nous chercher, et nous avons trouvé le père Philippe étendu, sans forces, à l’entrée de sa chaumière ; nous l’avons transporté ici, et, depuis ce temps, il n’a pas bougé.
— Voyez, docteur, au nom du ciel ! ne négligez rien, s’écria lord Aresvood. »
Le docteur s’approcha du malade et découvrit sur sa poitrine, une plaie qui lui révéla toute la gravité du mal. Philippe, en se jetant dans la Loire, pour secourir milady Aresvood, s’était brisé la poitrine contre un piquet caché sous les flots.
Le docteur prescrivit quelques remèdes qui rappelèrent le pêcheur à la vie. Il entr’ouvrit ses yeux et aperçut mylord Aresvood. Il lui tendit la main. Le noble anglais la serra avec effusion. « Servez-leur de père, dit Philippe en montrant ses enfants, car ils sont seuls au monde. » Ce furent ses dernières paroles.
Après le malheureux événement qui priva Guillaume et Jean de leur père, lord Aresvood remplit la promesse qu’il avait faite au lit de mort de Philippe. Il prit les deux enfants chez lui et les traita comme s’ils eussent été ses fils. Guillaume avait alors huit ans ; Jean était d’une année plus jeune.
Les deux frères ne se ressemblaient en rien, ni moralement, ni physiquement. Guillaume, gros, petit, trapu, portait sur son front bas et déprimé, dans ses sourcils épais et rapprochés au-dessus des yeux, dans ses traits grossiers, dans ses mains larges et osseuses, le cachet de sa naissance. Son caractère dur et entêté, ses penchants vulgaires, sa violence, révélaient une sécheresse de cœur, une insensibilité qui annonçaient devoir influer tristement sur le reste de sa vie.
Jean, au contraire, était faible et délicat ; sa figure avait une expression pleine de douceur et de bonté. Sa taille était élancée, sa tournure élégante et ses moindres gestes décélaient une distinction qui se retrouvait dans ses pensées. Il abandonna bien vite les habitudes de sa vie passée pour se conformer aux exigences de sa nouvelle position. Loin d’imiter l’exemple de son frère, qui se montrait paresseux et indolent, il se levait de grand matin pour se mettre au travail. Aussi parvint-il à faire bientôt des progrès étonnants.
M. Aresvood, en se chargeant des deux frères, les aima d’abord tous deux d’une tendresse égale : tous deux, ils étaient les fils de celui qui n’avait perdu la vie que pour sauver celle de sa femme ; à ce titre, la même affection leur fut accordée.
Mais bientôt, en voyant la conduite des deux orphelins, lord Aresvood sentit, malgré lui, la tendresse qu’il portait à Guillaume se détacher de lui pour se reporter sur Jean. Les manières douces et affectueuses, les soins, les attentions, la conduite régulière, le travail persévérant du jeune fils de Philippe, le remplirent de joie. Il fut bien peiné, au contraire, des inclinations vicieuses de son frère. Il essaya de lui inspirer de meilleurs sentiments, mais ses efforts demeurèrent infructueux.
Après quelques mois passés à la campagne, lord Aresvood quitta la Touraine et vint à Paris. Il chercha tout d’abord une institution où il pût placer ses pupilles. La maison d’éducation de M. C*** lui parut remplir toutes les conditions désirables.
Lorsque lord Aresvood retourna près de sa femme, Guillaume le vit partir d’un œil sec et froid ; Jean sentit son cœur se déchirer, et des larmes amères coulèrent de ses yeux.
Les professeurs et les élèves de la pension surent bientôt apprécier le caractère des deux frères. Jean fut aimé de tous, tandis que Guillaume n’eut pour amis que de mauvais sujets.
En voyant son frère mieux traité que lui, le fils aîné du pêcheur ressentit les premiers tourments de la jalousie. Il fit un crime à son frère de sa bonne conduite et chercha, par tous les moyens, à le rendre comme lui ; mais il ne put y réussir. Alors sa haine ne connut plus de bornes.
Un jour, la grande porte de la pension s’ouvrit, et une charrette, lourdement chargée, entra dans la cour. Elle contenait la provision de pommes nécessaire à la consommation des élèves pendant quelques mois. Guillaume, alors en pénitence à la porte de sa classe, remarqua l’endroit où on les serrait : c’était dans une chambre au rez-de-chaussée. Le portier, après avoir rentré tous ces fruits, mit la clef dans sa poche et s’occupa d’autres travaux. Vers le soir, Guillaume pénétra furtivement dans la loge du portier et parvint à dérober la clef de la chambre où se trouvaient les pommes.
Pendant que ses camarades faisaient la prière du soir, il s’échappa pour aller commettre le vol qu’il avait prémédité depuis le matin. Afin de faire le moins de bruit possible, il met ses souliers dans sa poche et marche sur la pointe des pieds. Arrivé près de la porte, il l’ouvre doucement, retire la clef, entre dans la chambre, et cherche par quel moyen il pourra emporter le plus de pommes. D’abord, il en remplit son mouchoir et sa casquette, mais sa gloutonnerie n’est pas satisfaite ; il lui en faut encore. Il ôte ses jarretières et les attache par-dessus son pantalon à la hauteur des chevilles ; puis, tout le long de ses jambes, il fait glisser des pommes dans ce sac de nouvelle invention.
Mais la prière du soir est finie, et Guillaume entend ses camarades qui montent se coucher. La cour est déserte ; il saute par la fenêtre et va cacher dans un trou profond, qu’il a creusé d’avance, le produit de sa coupable action.
Le lendemain, dès le matin, le portier s’aperçoit du vol ; il court prévenir le chef de l’institution. Des recherches actives sont faites pour parvenir à la découverte du coupable, mais il a si bien pris ses précautions, qu’on ne peut le connaître. Cependant la clef ne se retrouve pas ; Guillaume l’a gardée pour pouvoir recommencer, quand ses provisions seront épuisées.
Un soir, il se rend de nouveau dans la chambre aux fruits et y commet un nouveau larcin. M. C*** l’aperçoit au moment où il saute par la fenêtre, mais il ne peut, à cause de l’obscurité, distinguer ses traits. Il rassemble donc les élèves dans le dortoir.
« Messieurs, leur dit-il, parmi vous il y a un voleur ; comme jusqu’ici je n’ai pu le découvrir, mes soupçons se portent sur vous tous. Si celui qui s’est rendu coupable, ne veut pas ajouter à la gravité de sa faute, il doit l’avouer.
— Oui ! oui ! s’écrièrent tous les écoliers.
— Eh bien ! dit le maître après un instant de silence, quel est le coupable ? » Personne ne répondit.
« J’aurais pu être indulgent, reprit M. C***, mais à présent je serai sans pitié : le voleur sera chassé ! Il faut que je le connaisse. La clef de la chambre où le vol a été commis ne se retrouve pas ; il doit l’avoir conservée. Je vais vous fouiller tous. »
L’instituteur s’approcha successivement des élèves et leur fit vider leurs poches. Quand il fut arrivé à Guillaume, il l’examina soigneusement, mais sans résultat. Jean était auprès de son frère et tremblait, en pensant que peut-être Guillaume était coupable. Le maître s’approcha de lui, et la malheureuse clef fut trouvée dans la poche de sa veste.
En la voyant, Jean pâlit et ne put trouver une parole pour se défendre.
« Comment, Jean ! s’écria M. C***, c’est vous qui êtes le coupable ! Oh, je ne l’aurais pas cru ! Comment avez-vous pu commettre cette action, et pourquoi, quand je promettais d’être indulgent, n’avez-vous pas avoué votre faute ? Vous êtes plus répréhensible que tout autre, car j’avais confiance en vous ; je vous croyais un bon cœur et de nobles sentiments, et vous êtes un hypocrite, un voleur ! Vous ne pouvez rester ici, je vous chasse ! »
Un silence profond s’établit parmi les élèves. Tout à coup une voix se fait entendre : « Jean n’est pas coupable ! »
Tout le monde se retourne, et l’on voit un petit garçon debout sur son lit. « Que voulez-vous dire, Charles ? demanda le maître.
— Je suis venu me coucher avant mes camarades, parce que j’avais mal à la tête. Tout à l’heure, quand ils sont entrés au dortoir, et que vous avez annoncé que vous alliez fouiller tout le monde, j’ai vu Guillaume glisser la clef dans la poche de son frère. »
Cette accusation épouvante Guillaume ; il se jette à genoux et demande pardon.
« Misérable, s’écrie le maître, non content de commettre une mauvaise action, tu veux en rejeter la faute sur un autre... et quelle est la victime que tu choisis ?... ton frère ! un noble et studieux enfant, l’orgueil de son père adoptif, la gloire de ma pension. Va, sois maudit, enfant dénaturé ! Et vous, Jean, pardonnez-moi l’erreur dans laquelle je suis tombé. Demandez-moi tout ce que vous désirez, et je vous jure ici de vous l’accorder, pour vous témoigner publiquement le regret du chagrin que je vous ai causé.
— Je vous demande la grâce de mon frère, dit Jean en se jetant aux pieds du maître.
— Noble enfant ! s’écria M. C*** en pressant le jeune fils de Philippe sur son cœur.
— A genoux, Guillaume, continua-t-il, et demandez pardon à votre frère. — Promets-moi de te corriger, dit Jean en embrassant Guillaume. »
Quelques années s’étaient écoulées... Jean, studieux et persévérant, avait obtenu d’éclatants succès au collège. Guillaume s’était fait chasser de plusieurs institutions et n’avait jamais voulu rien apprendre.
Mylord Aresvood venait, tous les ans, chercher ses pupilles pour les emmener en vacances. La mauvaise conduite de Guillaume, son ingratitude, lui avaient aliéné son cœur ; et, sans le serment qu’il avait prononcé au lit de mort de Philippe, sans cette promesse solennelle, il l’aurait abandonné.
Jean avait poursuivi rapidement ses études. Il était en philosophie. Son zèle et son travail l’avaient placé à la tête de sa classe ; aussi alla-t-il tout naturellement au concours général, avec les élèves les plus distingués de tous les collèges de Paris.
Lord Aresvood quitta la Touraine pour venir jouir du triomphe de son enfant.
Le jour de la distribution des prix est arrivé. Les parents se rendent dans la salle de la Sorbonne, où le nom des vainqueurs retentira bientôt. L’élite de la nation s’y trouve : tous ces grands noms, l’orgueil et la gloire de la France, assistent à cette cérémonie. La reine elle-même, cette femme si noble, le modèle de toutes les vertus, vient entendre proclamer le nom de ses enfants.
Oh ! comme tous les cœurs sont émus ! la joie, la crainte, l’espérance, les remplissent... C’est que, de toutes les émotions de la vie, il n’en est pas de plus grande que celle-là. Si vous saviez, mes enfants, tout ce qu’il y a de bonheur pour une mère, à voir ces regards d’envie fixés sur son enfant, à entendre ces cris, ces bravos, ces fanfares triomphales qui accueillent son nom ! Si vous saviez comme une mère est heureuse et fière de pouvoir se dire : cet enfant que vous applaudissez, c’est le mien ! cet enfant que vous couronnez, c’est mon enfant ! Si vous compreniez bien qu’il n’y a pas de bonheur plus grand sur la terre, vous travailleriez avec courage, pour que votre bonne mère puisse dire, elle aussi, en vous montrant avec orgueil : Cet enfant... C’est le mien !
Mais les élèves prennent place sur les bancs. Les grands dignitaires de l’État, les ministres, l’académie, les professeurs arrivent, la cérémonie commence, et l’on proclame le nom des lauréats : « Philosophie, prix d’honneur : Jean Philippe ! »
Le nom de Jean est répété par tout le monde, la salle entière applaudit, les fanfares résonnent, et lord Aresvood presse son pupille dans ses bras en lui disant : « Merci, mon enfant, merci, car tu m’as rendu le plus heureux des hommes. — Ces couronnes, je vous les dois, dit Jean, » et il les offre à son bienfaiteur.
Mais son nom est encore proclamé, et toutes les mères pleurent en pensant au bonheur d’avoir un pareil enfant.
Jean, chargé de couronnes et de livres, sort avec lord Aresvood. Ils prennent une voiture, car ils ne pourraient porter ces glorieux trophées. Arrivés rue Dauphine, la foule rassemblée les empêche d’avancer.
« C’est affreux ! dit une femme du peuple.
— Qu’y a-t-il donc ? demanda lord Aresvood.
— C’est un voleur qu’on vient d’arrêter. »
En effet, un homme poursuivi par les malédictions de la foule, s’avance entre quatre soldats : sa figure est pâle et ses yeux égarés ; ses vêtements en lambeaux, témoignent de la lutte qu’il a soutenue. Cet homme... c’est Guillaume... le frère de Jean... Guillaume, pris en flagrant délit de vol, au moment où Jean vient de recevoir le prix d’honneur.
Voilà où conduisent la paresse et l’ingratitude. — Voilà ce qu’on peut obtenir par le travail et la persévérance.
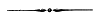
Dans un petit village, sur le bord de la mer, et près de La Rochelle, vivait une pauvre femme accablée d’infirmités ; le corps de son mari avait été retrouvé noyé sur la plage, et il ne lui restait, pour toute consolation, qu’un fils qui, simple batelier, lui apportait tous les soirs le fruit de son travail.
Ce fils n’avait pas encore quinze ans, et passait déjà pour le plus beau garçon du pays ; il était surtout renommé pour sa tendresse filiale.
Sa mère, comme toutes les mères, était fière de son enfant ; elle déplorait chaque jour la profession qu’il exerçait depuis la mort de son père, pour subvenir à leurs besoins ; et vraiment, tous ceux qui connaissaient le jeune Pierre Kilnar, étaient contraints d’avouer que la grâce de son maintien, la noblesse de ses traits qui portaient à la fois l’empreinte de la bonté et du courage, méritaient un meilleur sort.
Et puis, disait cette bonne mère à ceux qui lui parlaient de son fils, l’état de batelier est si fatigant ! il offre si peu de ressources ! à moins d’un événement extraordinaire, d’une rencontre imprévue, mon pauvre Pierre ne fera jamais que végéter sur ce sol ingrat.
Un jour qu’elle était accablée par ces réflexions, elle vit entrer dans sa cabane un homme déjà d’un certain âge, vêtu comme un riche bourgeois de La Rochelle. « La veuve Kilnar ! — C’est moi, répondit-elle avec un battement de cœur qui lui présageait quelque accident. — Vous, bonne femme ! Que je suis aise de vous rencontrer tout d’abord ! J’ai appris, en entrant dans ce village, l’événement malheureux arrivé à votre mari ; j’espérais lui payer ma dette : il m’a sauvé la vie ; je me noyais sans son secours. La reconnaissance est un besoin pour moi. Vous êtes sa veuve... et je viens vous offrir mes services ; heureux si vous voulez les accepter ! »
Quelques mots balbutiés par la veuve sont interrompus presque aussitôt par le visiteur. « On m’a dit que vous aviez un fils... Eh bien ! si vous le voulez, je me charge de son avenir ! — Mon bon fils ! — Je suis marchand de bois des îles ; je fais des affaires avec les quatre parties du monde ; mes bâtiments circulent sur toutes les mers... Au premier voyage, votre fils est mousse, car il lui faut un apprentissage ; au second et au troisième, il gagne ses grades ; au quatrième, il est capitaine. Alors je lui donne un intérêt dans mon commerce. La retraite ne tardera guère à sonner pour moi ; je n’ai point d’enfant, j’adopte votre fils ; je le mets à la tête de mes affaires, et, s’il se comporte bien, il devient mon successeur. Cela vous sourit-il ? » La pauvre mère attendrie ne sait comment répondre ; il lui semble que c’est le ciel qui exauce sa prière, et cependant son cœur est combattu par des émotions dont elle ne sait pas se rendre compte. » Où est votre fils ? — Il est probablement au rivage ; c’est demain fête, et il prépare sans doute son batelet pour les promeneurs de La Rochelle ; car, si vous saviez l’ordre, la propreté... — Il est batelier ! — Oui, mon bon monsieur. — Tant mieux, son chemin avec moi sera plus tôt fait. Quel Age ? — Bientôt quinze ans. — Allons, allons, je vais aller le voir ; je lui parlerai. Vous, la mère, pesez bien mes paroles, consultez-vous ; en attendant, veuillez recevoir cette bourse. — Mais, mon bon monsieur... — C’est comme à-compte. » Et mettant sa bourse sur la table : « Je reviendrai demain à la même heure ; et, si vous consentez, j’emmène votre fils avec moi... Bonjour ! »
Cet homme brusque, mais généreux, s’éloigne en laissant la veuve tout étourdie de ce qui venait de lui arriver.
Le bruit se répand bientôt dans le voisinage qu’un riche monsieur a fait visite à la vieille Kilnar, et, sous quelque prétexte, sa chambre en peu de temps est remplie de curieux. Parmi eux se trouve un oncle de Kilnar, pauvre et végétant aussi lui-même. Il trouve dans la proposition du marchand de bois une source de prospérités pour la famille. Son esprit se réveille : il se voit oncle d’un grand seigneur, et croit devoir, pour ne point laisser échapper l’occasion, s’offrir pour accompagner le fils de son frère, trop heureux si son expérience peut éviter quelquefois à ce jeune homme les désagréments du métier !
La bonne mère, excitée par les discours des assistants plus encore que par son ambition maternelle, voyant surtout que son fils peut avoir un appui dans cet oncle, promet d’accepter si son bon Pierre y consent.
Le fils est de retour : il a vu l’inconnu, il a consenti. Une âme jeune, ardente, courageuse, ne peut résister à une pareille proposition. Quel avenir immense s’ouvre devant lui ! capitaine ! et riche ! pour que sa mère ne puisse manquer de rien.
Il se prépare donc à la hâte. Le marchand de bois est exact au rendez-vous ; les engagements réciproques sont arrêtés de part et d’autre : l’oncle est du voyage. Seulement, comme une seule place est vacante, et que le pauvre homme sait faire un peu de cuisine, il sera le coq du navire. Les adieux sont faits... La pauvre mère a couvert son fils de baisers et de larmes... Pierre Kilnar est en route.
Le jeune Kilnar, installé mousse en partant, a fait sa première traversée à bord des Quatre-Sergents, beau navire de trois cent cinquante tonneaux. L’équipage, après une bonne route, a débarqué à Saint-Jean, île de Terre-Neuve. Quelques jours de repos ont suffi, et le vaisseau, chargé de bois précieux, est remis à la voile et cingle vers la France.
Pierre Kilnar, animé par son amour filial, remplissait ses devoirs avec une exactitude remarquable. Il avait, il est vrai, excité d’abord la jalousie des autres mousses, tous plus âgés que lui ; mais, soutenu par ses chefs, défendu par son oncle, le coq (cuisinier) du bâtiment, et protégé par sa propre force et une agilité peu commune, il avait fini par se mettre bien avec ses compagnons. Le capitaine, suivant les ordres du marchand, son patron, l’avait même prévenu qu’avant de prendre terre il voulait lui donner un grade. Le cœur du jeune Pierre était donc pénétré de sentiments de bonheur et de joie.
Depuis leur départ de l’île de Terre-Neuve, on touchait au vingtième jour d’un voyage que le temps avait favorisé. Kilnar, étendu dans son hamac, se livrait aux plus douces rêveries : il allait revoir sa mère, la presser dans ses bras ! Comme il allait être fêté ! comme sa bonne mère allait être heureuse ! Tout à coup un bruit tumultueux frappe son oreille, il écoute, et ne distinguant pas le motif d’une telle clameur, il se jette à bas du hamac, et monte sur le pont. Quel spectacle ! Le bâtiment était arrêté, et tournait le côté, sans que l’équipage pût savoir par quelle cause ; le vent s’était élevé avec la plus grande violence ; le ciel s’était obscurci, les éclairs entr’ouvraient à chaque instant cette voûte noire et épaisse qui semblait vouloir écraser le navire ; le tonnerre se faisait entendre avec des redoublements affreux ; tout se réunissait enfin pour faire de cette scène un tableau de désolation et de mort.
Le capitaine et le jeune mousse ont compris le danger, et tous deux, une hache à la main, se mettent à couper le grand mât. Leur exemple est suivi : ce mât et celui de misaine sont bientôt séparés du navire qui se redresse presque aussitôt.
Les lames couvraient la surface du pont ; une forte voie d’eau s’était déclarée, et le navire, complétement envahi par l’élément perfide, chavira ; mais la nature de son chargement l’empêcha de couler à fond : sans cela, c’en était fait à l’instant du bâtiment et de l’équipage.
Le navire était submergé, et sur le pont les malheureux naufragés qui avaient de l’eau jusqu’à mi-jambes, pour ne pas être emportés par le vent ou les vagues qui se succédaient avec une rapidité extraordinaire, se cramponnaient aux cordages, et à tout ce qui pouvait leur offrir un point de résistance. Les vivres étaient emportés par les vagues, ou bien restaient submergés au fond du bâtiment ; déjà même plusieurs matelots, descendus pour en retirer quelques parties, s’étaient noyés. La pluie tombait par torrents. Les plus faibles, après des efforts inouïs, lâchaient prise, tombaient exténués ; leurs corps étaient bientôt entraînés, et disparaissaient dans l’abîme.
Une nuit et un jour entiers se passèrent ainsi. Au milieu de cette désolation, un seul homme avait conservé son courage : c’était Pierre Kilnar. Il exhortait ses compagnons, les conjurait d’avoir confiance en la Providence ; puis il pensait à sa mère.
Le ciel devint enfin moins sombre ; le vent s’apaisa, les vagues cessèrent de mugir avec la même furie, et les malheureux purent se traîner les uns contre les autres ; puis, à l’aide de leur soutien mutuel, et corps contre corps (l’eau qui couvrait entièrement le pont ne leur permettait pas de s’étendre), ils se livrèrent à quelques instants de repos... Quel sommeil !... quel réveil !... La mer rugissait autour d’eux comme pour réclamer sa proie : une étendue d’eau que leurs yeux ne pouvaient embrasser, le ciel encore sombre et nuageux, le bruit lointain du tonnerre qui paraissait toujours les menacer, la faim, la soif, qui déchiraient leurs entrailles, le froid qui glaçait leurs membres semblaient se réunir pour leur faire éprouver la plus cruelle agonie.
Le jeune matelot, dans ce moment affreux, s’écriait : « O ma mère ! » et plusieurs d’entre eux, excités par cette invocation, répétaient les noms les plus chers à leur cœur.
Par l’ordre du capitaine, l’eau de pluie, restée dans quelques débris, est recueillie avec soin ; elle soutient quelque temps l’existence de ceux qui ont échappé à la tempête ; mais cette ressource est bientôt épuisée.
Les poissons se présentaient quelquefois à leurs regards, les oiseaux de mer voltigeaient souvent au-dessus de leurs têtes ; mais n’ayant aucun instrument, aucune arme, c’était pour eux le supplice de Tantale.
Huit jours s’écoulèrent encore dans cette horrible situation : huit jours passés en larmes, en imprécations, en cris de désespoir !
A la fin, l’exaspération s’empare de ces infortunés et chasse au loin les sentiments affectueux qui les avaient réunis dans les premiers jours de leur catastrophe ; la rage les anime presque tous ; leurs traits cadavéreux se contractent d’une manière infernale, et leurs regards farouches laissent entrevoir d’affreuses résolutions.
Pierre Kilnar, dont le caractère jusque-là ne s’était pas démenti, n’ayant plus de paroles à faire entendre, déchiré comme ses compagnons par des souffrances qu’il ne peut apaiser, au milieu des imprécations et des cris, s’était réfugié dans un coin du navire. Seul, la tête appuyée sur ses deux mains, il répétait par intervalle des mots entrecoupés, et le nom de celle qui lui avait donné la vie s’échappait encore de ses lèvres, lorsqu’il tomba comme affaissé sous le poids de ses douleurs.
Le capitaine voyant qu’ils allaient succomber, et par une inspiration dernière, sentant qu’il fallait un nouvel effort pour prolonger leur existence, rassemble, de l’autre côté du bord, le reste de son équipage. « Mes amis, leur dit-il, nous avons fait ce qui était possible à l’homme pour résister aux tortures que nous endurons. Cette position n’est plus tenable : nous devons expirer aujourd’hui si un dernier sacrifice n’est accompli. Nous mourons de soif, de faim : il faut que l’un de nous périsse pour les autres... Et jetant les yeux sur le jeune Kilnar : — Regardez Pierre, il n’a plus que quelques minutes à vivre ; c’en est fait de lui. Il est le plus jeune, il n’a ni femme, ni enfant... Il faut qu’un de vous s’approche et lui ouvre les veines.
Un murmure difficile à définir succède à ces paroles.
Il s’agissait de se nourrir de chair humaine, et les plus affamés reculaient eux-mêmes devant un semblable repas. Le capitaine croit devoir mettre la proposition aux voix... Le plus morne silence règne en ce moment... La proposition est adoptée.
« Qui se charge de l’opération ? dit le capitaine. Eh bien ! vous baissez les yeux... Mais, je n’y songeais pas, c’est l’office du cuisinier. » Le coq, qui s’était mis à l’écart, est appelé.
« Allons, tu dois remplir jusqu’au bout tes fonctions. Tu es habitué à voir couler le sang des animaux qui servent à notre nourriture : prends ton couteau et va à cet enfant.
— Quoi ! Pierre ! mon neveu !... ce jeune homme !... Oh ! capitaine, c’est une vision de l’enfer ! Moi... l’assassin du fils de mon frère, du seul enfant qui reste à la veuve Kilnar !... »
A ce nom prononcé d’une voix accentuée et déchirante, le jeune mousse relève sa tête appesantie : « Qui parle de ma mère ? — Mon cher neveu, mon cher fils, si tu savais la résolution barbare de ces cannibales qui nous entourent !... » Un murmure violent se fait entendre... « Tais-toi, dit le capitaine, tais-toi ! Si tu ne veux accomplir mon ordre, tu mourras toi-même, sans sauver Pierre, car sa mort a été résolue. Allons, vous autres... » Et il fait un signe à ceux qui l’écoutent.
« Jamais ! jamais ! capitaine, dit le pauvre cuisinier... Oh ! je vous en supplie ! » Et il tombe aux genoux de cet homme.
Le jeune mousse se lève. Sa figure, quoique celle d’un mourant, respire le calme le plus parfait ; ses yeux ont une expression indéfinissable de bonté ; sa bouche se contracte d’un sourire légèrement empreint d’amertume. « Mon oncle, ne vous affligez pas ainsi ; je vois qu’il n’y a plus rien à espérer du ciel, tout est fini pour moi, le chemin vers ma mère m’est à jamais fermé : ainsi, mon oncle, accomplissez sans crainte... sans remords... sans regret, l’acte qui vous est commandé. »
Déjà Kilnar a fait tomber une partie de ses vêtements, lorsque le second du navire jette un cri de joie : il a vu un point blanc au loin... Tous les yeux se fixent à l’horizon... « C’est un vaisseau !... Oui, nous sommes sauvés ! s’écrie à la fois l’équipage... Kilnar, tu vivras ! » On s’embrasse, on se félicite, et le capitaine, au milieu des transports d’allégresse, attache au bout d’une perche quelques lambeaux de voiles déchirées, pour servir de signal.
Le cœur du jeune mousse a palpité plus vivement. Il regarde avec anxiété la place où le vaisseau a été reconnu ; mais ses yeux cherchent en vain... tout a disparu. Un nouveau cri de rage succède aux transports de bonheur qui avaient rappelé ces êtres défigurés à des sentiments humains. La férocité se peint dans leurs yeux, et le mot de mort est prononcé d’une voix unanime.
Kilnar se met à genoux, et les mains jointes, il prie. Un des mousses, le plus âgé d’entre eux, s’est emparé d’un couteau ; il s’avance vers ce nouveau martyr, lui saisit un bras, d’un coup rapide lui fait une large ouverture, et laisse tomber l’instrument fatal, épouvanté de son horrible action. Chacun regarde la plaie avec inquiétude... le sang ne coule pas.
Kilnar, sans laisser échapper un murmure, sans faire paraître la moindre émotion, ramasse lui-même le couteau, et promenant son regard sur ceux qui l’entourent, comme pour les intéresser à ce qu’il va leur dire : « Je vais me saigner moi-même, je trouverai mieux la place ; puisse mon sang vous donner la vie !... Mais, par grâce, si quelqu’un de vous retourne en France, s’il est assez heureux pour revoir notre patrie, qu’il aille raconter à ma pauvre mère comment j’ai terminé mes jours... Qu’on lui dise surtout que ma dernière pensée a été pour elle... oh ! promettez-le-moi. — Ton dernier vœu sera exaucé, dit le capitaine. — Je meurs avec moins de regrets. » Kilnar étend son autre bras, cherche la veine la plus apparente... mais point encore de sang.
Le capitaine, hors de lui, ne pouvant supporter cette attente, et troublé peut-être par ce long supplice : « Il y a de la barbarie à faire souffrir ainsi ce jeune homme, coupez-lui donc la tête !... » Ce mot a fait frissonner tous les assistants. Kilnar lui-même en est profondément ému : ce mot lui redonne quelque énergie. Il se traîne aux pieds du capitaine : « Me couper la tête ! oh ! cette mort serait affreuse pour moi ; c’est celle d’un coupable... Oh ! laissez-moi encore un moment. Je suis épuisé par la fatigue, par le froid : laissez-moi me réchauffer à ces premiers rayons de ce soleil bienfaisant (car le soleil venait de jeter quelques pâles rayons sur cet effroyable tableau). Si je pouvais reposer un peu, je suis sûr que la circulation de mon sang reprendrait son cours, et alors... — Non, dit le capitaine d’un air farouche. — Non ! disent toutes les voix, non ! » Kilnar se relève de sa hauteur : « Quoi ! pas un moment ! Qu’ai-je donc fait pour mourir d’une mort pareille ? cruels que vous êtes ! Cette mort, je la trouve honteuse, infâme : c’est celle réservée aux assassins, aux parricides ! Oh ! ma mère, ma mère ! donne-moi la force de résister à des ennemis aussi lâches que barbares... » Et avec un rire de mépris : « Tous contre un seul !... » Et s’éloignant de quelques pas en élevant le couteau qu’il tient dans ses doigts crispés : « Non, je ne subirai pas le supplice que vous me réservez... Voici l’arme qui me protégera ! Si je meurs, d’autres périront avec moi, car je vendrai chèrement ma vie. »
A ces mots prononcés avec une exaltation étrange, on s’arrête, on se regarde. Mais aux accents du capitaine qui voit son pouvoir détruit si l’ordre qu’il a donné n’est pas exécuté, la plupart se jettent sur le jeune mousse. En vain sa main, tremblante à l’approche de ces forcenés, a-t-elle voulu intimider les premiers assaillants ; en vain il leur crie : « N’avancez pas... » Accablé par le nombre, il retombe sur le pont en ne prononçant plus que ce mot : « Ma pauvre mère ! » et il attend le coup fatal.
Mais soudain un nouveau cri de joie se fait entendre. Le vaisseau qu’on avait d’abord aperçu dans le lointain et dont on ne s’occupait plus, s’est avancé rapidement, poussé par un vent favorable et guidé par le signal qui était resté par hasard planté à la tête du navire.
L’Onguent Miton-Mitaine.

| Lith. de Cattier | |
| Monsir Ernest, il être pien malate, il avre pesoin de rebos. | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Comment peindre le transport de ces malheureux qui, un instant auparavant, se livraient à toute la violence de leur désespoir ? Les uns couraient çà et là, frappant du pied, se tordant les mains, et déchirant leurs vêtements ; les autres s’embrassaient, dansaient, chantaient et poussaient des éclats de rire comme dans un accès de folie. Ceux-ci restaient anéantis comme frappés de la foudre ; ceux-là se jetaient à genoux, remerciant le ciel et la terre, et tombaient ensuite privés de sentiment.
Un canot se présente bientôt, et reçoit ces infortunés qui sont transportés, avec les soins que réclame leur état, à bord d’un vaisseau qui fait précisément voile pour la France.
Le jeune mousse, dont l’aventure vole de bouche en bouche, devient l’objet des soins les plus empressés : on a bandé ses plaies ; et des aliments, offerts par degrés et avec la plus grande prudence, raniment peu à peu une vie près de s’éteindre.
Les naufragés ont revu leur patrie avec un sentiment inexprimable de bonheur. Pierre Kilnar et son oncle sont rentrés dans leurs foyers ; la vieille mère presse son fils dans ses bras, et après avoir laissé couler ses larmes au récit des maux qu’il a soufferts, elle s’écrie : « Mon fils, mon cher fils ! il vaut mieux rester pauvre que de courir ainsi après la fortune. »
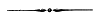

Ne laissons jamais échapper l’occasion de secourir les malheureux. Qu’un pauvre s’offre à vos yeux, mes enfants, loin de détourner la vue et de vous montrer dégoutés d’infirmités, quelquefois repoussantes, ne voyez que ses souffrances et sa misère. Dieu vous garde surtout de l’égoïsme ; car, sachez-le bien, l’égoïste est l’être le plus méprisable qui soit au monde. N’allez pas, non plus, faire le bien dans l’espoir d’en être récompensé : le seul prix que vous puissiez espérer d’un bienfait, vous le recueillerez dans cette douce satisfaction d’une âme pure et généreuse. Pratiquez donc le bien pour le seul plaisir de le faire. Quelle réciprocité d’ailleurs voudriez-vous attendre du malheureux, qui, le plus souvent, n’a rien à lui. Et pourtant il n’est pas sans exemple encore que, si le riche peut faire des aumônes, le pauvre se trouve quelquefois en position de s’acquitter d’un bienfait. En voici la preuve.
Le père Machu s’était fixé depuis environ deux ans, au Merlerault, gros bourg du département de l’Orne ; personne de l’endroit ne savait ni qui il était, ni d’où il venait ; il n’avait jamais rien révélé à cet égard ; après tout, ce vieillard était d’une humeur si franche, d’un caractère toujours si gai, malgré les infirmités qui l’accablaient, que tout le monde, au Merlerault, prenait en pitié le père Machu. En effet, le pauvre homme, privé d’un œil et d’une jambe, ne pouvait plus exister que par la charité publique, et il partageait ses aumônes avec trois petits chiens, fidèles compagnons d’infortune, qu’il faisait danser, à toute heure du jour, au son d’un tambourin ; et le soir, quand sa petite troupe harassée se reposait enfin, le père Machu, entouré d’enfants, sur la grande place du marché, leur contait encore de petites historiettes amusantes ; il n’interrompait alors la séance que pour engager ses auditeurs à ne pas tirer sans cesse ses acteurs par la queue : distraction qui leur arrivait souvent.
Une fois la semaine, le père Machu se rendait d’habitude au château de V***, situé à deux lieues du Merlerault. Ce voyage était bien long pour le pauvre vieux ; mais on était toujours si sur d’être bien reçu, que cela donnait du courage. Madame la marquise, monseigneur le pacha et M. le bailli (nos trois illustres personnages de la troupe), gambadaient alors, il fallait voir, dès qu’ils se voyaient sur la route. C’est, qu’en effet, madame de Saint-Aignan, propriétaire du château en question, était bien, grâce à Ernest, le fils de cette dame, la meilleure cliente du père Machu.
Ce cher enfant en était venu, non sans peine, à vaincre la répugnance des domestiques pour ce vilain pauvre, borgne, invalide et mal vêtu. L’empire de la vertu est si puissant, que c’était à qui désormais aiderait M. Ernest dans ses charités. Primitivement, le fils de madame de Saint-Aignan venait seul visiter le père Machu et lui remettre en cachette le fruit de ses petites économies ; mais insensiblement le cocher mettait un peu de paille à l’ombre pour que les petits chiens pussent s’y reposer ; de son côté, la cuisinière s’était bien aussi humanisée, et dès qu’elle entendait le bruit du tambourin, vite elle préparait une grosse pâtée pour les danseurs, toujours singulièrement affamés ; ensuite elle remplissait la besace du chef de la troupe, des quelques restes de la table. Enfin, avec le temps, Ernest avait obtenu de sa mère, que le père Machu dînât à la cuisine, afin de ne plus l’exposer même à entamer ses provisions. Il est vrai de dire que notre charmant Ernest se divertissait aussi beaucoup à voir danser les chiens, et qu’il en riait comme un bienheureux ; la mine barbue de Griffon produisait un si plaisant effet sous son turban de pacha ; la petite Finette était si merveilleusement coquette et prétentieuse en vieille marquise, et le gros Fox, au poil ras et noir, si grotesque en vieux bailli !! Et puis, le père Machu avait l’art d’accompagner le jeu de ses acteurs d’un dialogue si drôle et si risible !
Un jour donc, notre vieux bonhomme s’était, selon sa coutume, acheminé vers le château, avec ses chiens. Déjà même, le cœur rempli d’espoir, il approchait de la grille entr’ouverte, tout en battant du tambourin, quand le concierge (espèce de vieil Allemand), s’avance et lui barre le passage en ces termes : « Fous ne poufoir pas entrir avec ton mousic ; monsir Ernest, il être pien malate ; il avre pésoin de rebos. »
Je vous laisse à penser, mes amis, quel terrible effet cette triste nouvelle produisit sur le mendiant ; c’était la première fois qu’on lui interdisait l’entrée du château. Voyez cependant à quoi tient le sort des pauvres gens ; souvent le fil de leur existence dépendra du plus petit événement qu’ils ne sauraient prévoir. Ne sont-ils pas bien à plaindre ?
Infortuné père Machu ! s’il veut profiter d’un reste de jour pour gagner, ne fût-ce qu’un malheureux petit morceau de pain, il faut qu’il s’en retourne bien vite au Merlerault, et refasse les deux lieues qu’il a déjà si péniblement parcourues : — ce qui fera quatre, — lui infirme, mourant de faim, épuisé de fatigue, le tout sans pouvoir se reposer, sans prendre de nourriture. Comme le pauvre diable n’était pas de ces mendiants hardis comme on en voit tant, il se contenta d’essuyer furtivement une larme qui coula de ses yeux, dès qu’il vit la grille se refermer inexorablement sur lui ; et il se retira sans laisser échapper le moindre murmure, mais non sans prier en secret Dieu pour son petit bienfaiteur.
Heureusement Ernest n’avait pas la même manière de voir que le méchant concierge du château. Retenu dans son lit, et bien que souffrant, il avait tressailli d’aise rien qu’au son du tambourin.
« Maman, sont-ils entrés, demanda-t-il enfin à madame de Saint-Aignan, pieusement installée, comme une tendre mère, près de son lit. C’est singulier, je n’entends plus rien.
— Ni moi non plus, mon ami ; au reste, il ne faut pas que tu entendes le moindre bruit, cela pourrait te faire mal.
— Peut-être bien, maman ; mais cela ne saurait empêcher le pauvre père Machu de prendre ses petites provisions accoutumées, et de se reposer au château. Ah ! sans doute, il dîne en ce moment.
— Non, monsieur Ernest, reprit vivement la femme de chambre, alors présente ; je sors à l’instant même de l’office, on l’y attendait ; et déjà Marguerite avait apprêté son dîner ; mais le vieux landsman a cru faire beaucoup mieux en lui fermant au nez la grille du château.
— Ah ! pauvre homme ! murmura aussitôt madame de Saint-Aignan ; qu’on envoie vite un domestique après lui ; qu’on le ramène ; allez. »
A ces mots, un sourire de joie inexprimable brilla sur les traits du petit Ernest. De son côté, le vieux mendiant ne se le fit pas dire deux fois, ni lui, ni les siens. Quelle joie se fut pour toute la troupe !... Les chiens sautillaient, japaient en trio, et le père Machu, lui, pleurait comme un enfant ; il revint bien vite ; il ne pouvait trouver de paroles pour exprimer sa reconnaissance à Marguerite.
Mais, avant de se mettre à table, il n’eut rien de plus pressé que de questionner les domestiques qui l’entouraient sur le genre de maladie de son jeune bienfaiteur. Et quel fut son chagrin en apprenant qu’il était, lui-même, la cause innocente de l’accident arrivé à M. Ernest ; voici comment : Le major Saint-Huberty était arrivé la veille, au château ; il devait passer quelques jours près de sa sœur et de son neveu. Ernest pensait bien que son pauvre Machu viendrait, ce jour-là, comme d’habitude, avec ses petits chiens ; or, craignant que l’arrivée subite du major et de sa suite ne changeât quelque chose à l’ordre établi en faveur de ses malheureux pensionnaires, il avait eu l’attention délicate de descendre, le matin même, à la cuisine pour qu’au milieu de tout ce monde, on n’oubliât pas son père Machu ; et pendant que cet aimable enfant parlait à Marguerite (il était alors debout devant la cheminée), un tison venant à rouler, lui renversa une cafetière d’eau bouillante sur le pied ; pour comble de malheur, le chirurgien qu’on envoya chercher au Merlerault se trouvait en tournée, il ne devait rentrer que le soir bien tard.
« Charmant enfant ! s’écria soudain le vieillard, tout attendri, ne pourrais-je donc le voir ? Oh ! oui, pour l’amour de Dieu, demandez pour moi cette permission à votre bonne maîtresse, dites-lui bien d’abord que le père Machu, malgré sa faim et sa lassitude, ne s’assoiera pas, ne prendra rien, sans avoir vu ce cher petit ange, qui souffre ainsi par l’excès de sa charité envers les malheureux.
Les valets se consultèrent longtemps avant d’accéder à la demande du vieillard ; ils craignaient un refus, et nul n’osait se charger de la commission. Enfin la bonne femme de chambre consentit à lui servir d’interprète, et elle fit bien, car madame de Saint-Aignan obtempéra, de grand cœur, à un désir exprimé avec tant d’instances. Les bénédictions du pauvre ne sont-elles pas un baume consolateur pour le riche affligé ?
Ernest sourit de plaisir, et oublia un moment sa douleur en apercevant son vieux pensionnaire.
« Hélas ! dit celui-ci en entrant d’un air affligé, quoique j’éprouve bien du bonheur à vous voir, M. Ernest, ainsi que votre respectable mère, pour tout au monde je voudrais n’avoir jamais mis le pied dans ce château ; sans moi, ce malheur-là ne vous serait pas arrivé ; on m’a tout conté là-bas ; j’en ai le cœur gros, voyez-vous !... vous si bon, si charitable ! » et le pauvre vieux pleurait à chaudes larmes.
« Allons, reprit Ernest avec émotion, calmez-vous, père Machu ; ce ne sera rien, ce ne sera rien, vous dis-je, tenez, regardez plutôt...
— Il est vrai, s’écria le vieillard avec un élan subit de joie et après avoir examiné le pied, la brûlure n’est heureusement pas aussi grave que je le supposais, l’épiderme seul est attaqué. N’importe, vous devez bien souffrir. Ah ! si madame voulait... en attendant le chirurgien, et avec sa permission, je vous ôterais, moi, ce mal-là comme avec la main.
— Et comment cela, brave homme, interrompit vivement madame de Saint-Aignan ?
— Hélas, mon Dieu ! de la manière la plus simple... avec certain onguent miton-mitaine, fort connu de votre serviteur en sa qualité de vieux troupier... Oh ! pardon, excuse, noble dame.
— Eh ! quoi, vous seriez sûr, reprit la mère ?...
— Si je suis sûr ! Ah ! pour ce qui est de ça ! est-ce que je voudrais m’exposer à faire le moindre petit bobo à ce cher M. Ernest, lui qui prend si grand soin du pauvre père Machu !
— Eh bien ! alors je t’en prie, maman, laisse-le faire, dit l’enfant.
— Oui, oui, laissez-moi faire, et je vais bientôt vous avoir préparé mon onguent, vous allez voir... seulement j’aurais besoin d’une bougie allumée, d’un peu d’huile d’olive, de cire vierge et de cartes. »
Le vieux mendiant avait à peine fini de parler que déjà dix domestiques couraient de tous côtés pour chercher ce que venait de demander ce docteur improvisé.
Cependant madame de Saint-Aignan, qui doutait encore un peu des vertus de l’onguent en question, ne tarde pas à se récrier dès qu’elle voit le père Machu se mettre en devoir de trier un jeu de piquet ; et, se méprenant sur son intention. « Qu’est-ce à dire ! lit-elle, en se levant indignée, allez-vous donc tirer les cartes à mon fils ? Sachez que si j’ai des égards pour le malheur, je méprise le charlatanisme.
— Oh ! vous avez bien raison, noble dame, mais ce que je fais ici n’a rien que de fort naturel ; je l’ai pratiqué pour cent autres personnes qui s’en sont bien trouvées. »
Et, tout en disant ces mots, le pauvre homme, un peu étourdi de la vive sortie de la mère d’Ernest, avait ployé, en tremblant, une des cartes en forme de caisse à biscuit ; bientôt il y mit de l’huile d’olive et un morceau de cire, qu’il fit chauffer ensemble en tenant la carte au-dessus de la bougie.
Madame de Saint-Aignan comprit alors ce que voulait faire cet homme. Sur ces entrefaites, entre le major Saint-Huberty ; les domestiques l’avaient mis au courant de ce qui se passait. « Bravo, mon vieux, bravo, s’écria-t-il ; ce que tu prépares-là, c’est un remède de bonne femme ; il est aussi simple qu’efficace. Pour vous autres gens du monde, ajouta-t-il en s’adressant à sa sœur, le premier remède, c’est un médecin ; si ce n’est pas souvent le meilleur, c’est du moins toujours le plus cher. Mais moi, étourdi qui parle des autres, comment n’avais-je pas pensé à cette manière de faire du cérat. » Et, pendant que le major parlait ainsi, le vieux Machu, frappé d’étonnement au son de cette voix, semblait chercher à rassembler ses souvenirs.
— Je me rappelle, poursuivit le major, que n’étant encore que lieutenant de hussards et me trouvant, lors de la première campagne d’Autriche, en cantonnement dans un trou de village, je me fis une large estafilade à la jambe en voulant monter à cheval : ce qui m’arrangeait d’autant moins que le chirurgien se trouvait alors, avec l’état-major de l’escadron, à une journée de notre cantonnement. Par bonheur, un brave cantinier qui, à la suite de toutes nos bagarres, servait volontiers d’aide à nos officiers de santé, suivait ma compagnie... Eh bien ! ce fut lui qui me guérit en employant ce même cérat qui opéra merveille, ma foi, quoique fait à la grosse mordienne, car vous le savez, ma sœur, à la guerre comme à la guerre, et nous n’avions là, je vous prie de le croire, ni cire vierge, ni huile d’olive sous la main.
— Pardon, monsieur le major, reprit le père Machu, en se redressant d’une manière comique au port d’armes, ne commandiez-vous pas dans la seconde compagnie du premier escadron.
— Oui, sans doute, mon vieux ; eh ! qui donc t’en a tant appris ?
— Moi-même, major... car tel que vous me voyez, je suis ce même brave cantinier, plus connu de vous alors sous son nom de guerre de Tape-à-l’œil.
— En effet, je me rappelle, s’écria M. Saint-Huberty ; mais comment se fait-il ?... Allons, vieux ; dépêche-toi de panser le pied de ce cher enfant ; puis après tu me conteras par quelle suite d’événements je te retrouve ici borgne, invalide, et dans un pareil état de misère. »
Dès que l’appareil fut une fois appliqué sur sa brûlure, Ernest sentit une douce fraîcheur, puis un prompt soulagement, et il devint plus calme. C’est alors que le père Machu fit au major le récit de ses malheurs ; il lui apprit qu’après avoir été pillé par les Autrichiens, il s’était vu forcé de rentrer en France sans ressources, avec un œil et une jambe de moins laissés tous deux sur le champ de bataille ; et comme il n’avait été que cantinier à la suite du régiment, il n’avait pu, par ce motif, demander la retraite d’invalide, exclusivement réservée aux soldats ; « et alors, major, ajouta en marmottant dans ses dents le pauvre homme, vous comprenez... pour ne pas mourir de faim, l’ex-cantinier s’est vu réduit à la dure nécessité de demander l’aumône.
— Mon vieux Tape-à-l’œil, reprit à son tour M. Saint-Huberty, je me souviens parfaitement de tous les faits que tu me racontes ; je me remets bien maintenant ta drôle de figure, si éveillée. Oh ! il y a longtemps de cela ; tu n’étais pas alors si laid qu’aujourd’hui ; c’est qu’au fait rien ne vous change un homme comme un œil et une jambe de moins, n’importe. » Et se tournant vers madame de Saint-Aignan : « Ma sœur, lui dit-il, voulez-vous, par affection pour moi et par amitié pour notre cher Ernest, que ce château devienne désormais pour ce vieux bonhomme son Hôtel des Invalides : vous m’obligerez autant, croyez-le, que si vous m’offriez cet asile pour moi-même. »
Madame de Saint-Aignan, saisie d’émotion elle-même, ne se fit pas prier. Tout parlait en faveur du vieillard : la reconnaissance, puis l’intérêt qu’inspiraient son âge et ses infortunes. Il fut donc arrêté que, dès ce jour même, le père Machu serait installé au château. Le pauvre homme en pensa devenir fou de saisissement. Et Ernest donc ! il n’était guère moins heureux ; il en eût volontiers sauté de joie : ce qui n’était guère possible pour le moment ; mais tout à coup il songea que son père Machu n’était pas seul au monde. Et le bailli, le pacha, la marquise, que vont-ils devenir à présent, s’écria-t-il. — Ne t’inquiète pas d’eux, mon Ernest, reprit en riant sa mère ; de vrais amis sont inséparables, je leur octroie donc aussi les Invalides, : ils resteront ici pour te divertir, comme par le passé. »
Quand le chirurgien arriva, l’inflammation était si bien disparue que l’enfant ne se sentait plus de sa brûlure. Le docteur approuva l’usage du cérat qu’avait fait le vieux cantinier ; et, au bout de huit jours, à la grande satisfaction de tout le monde, Ernest faisait déjà, en riant comme un bienheureux, danser lui-même, à son tour, M. le bailli, madame la marquise et surtout le gros pacha, au son du tambourin du père Machu.

Dans un vaste salon du château de Villa Garcia, situé à peu de distance de Valladolid, plusieurs personnes écoutaient avec attention une lecture qui leur était faite par un homme dont le costume le faisait assez reconnaître pour l’aumônier de la maison. Tout annonçait, dans cette demeure, la richesse et la splendeur. Près d’une table, dans un fauteuil élevé, à dossier sculpté, est assise une femme encore jeune et belle, vêtue d’une robe de velours noir brodée d’or, boutonnée jusqu’au menton. Un peu à l’écart se tenaient les premières caméristes de la noble dame, épouse de don Luis Quixada, grand-commandeur de Castille, brave soldat, que son maître, Charles-Quint, avait invinciblement enchaîné à lui par l’ascendant de son génie. L’empereur avait trouvé, chez don Luis, un dévouement inviolable. Dona Magdalena d’Alloa, épouse de Quixada, paraissait rarement à la cour ; elle n’avait de bonheur qu’à se retrouver dans sa solitude chérie de Villa Garcia ; là, elle se livrait sans contrainte aux regrets qu’elle éprouvait d’être privée des douces joies de la maternité.
Au moment où commence cette histoire, à la fin de l’année 1546, Charles-Quint était à Ratisbonne, et l’on croyait don Luis auprès de lui. Tout à coup la cloche de la porte du château sonne avec violence ; dona Magdalena se lève avec précipitation, et s’adressant à l’aumônier : « Mon père, qui peut venir à une heure aussi avancée du soir ? Peut-être ce sont de pauvres voyageurs qui demandent l’hospitalité. Faites appeler le concierge ; recommandez-lui de les loger et de pourvoir à leurs besoins.
— Noble dame, vous serez obéie, répond le prêtre, et, fermant son livre, il quitte le salon ; peu d’instants après, dona Magdalena entend beaucoup de mouvement dans le château ; elle reconnaît la voix du grand-commandeur qui ouvre la porte du salon, et vient embrasser sa femme.
— Quoi ! c’est vous, mon cher Luis ! s’écrie-t-elle, sans m’avoir prévenue ! je vous croyais pour quelque temps avec l’empereur ?
— Ma chère Magdalena, vous allez savoir ce qui me ramène près de vous ; mais éloignez vos caméristes. » A un signe de dona Magdalena, les femmes se retirent, et, comme s’il n’eût attendu que ce moment pour se découvrir, un enfant nouveau-né, que don Luis portait enveloppé dans son manteau, poussa de faibles cris. Magdalena tressaillit. « Qu’est-ce que cela, dit-elle avec émotion...
— Ma chère Magdalena, un dépôt sacré. Nous n’avions pas d’enfants, le ciel nous en donne un à chérir, et à élever. Notre grand empereur confie à nos soins un fils bien-aimé. Des raisons d’État l’obligent à cacher encore son existence ; il passera pour notre fils, jusqu’au moment où sa majesté jugera à propos de découvrir sa noble origine. Faites donc promptement chercher une nourrice, et souvenez-vous que le plus profond secret nous est prescrit : l’enfant se nomme Juan, et la bonté de votre cœur m’est un sûr garant du bonheur de mon pupille. »
Peu d’heures après cet entretien, le seigneur Quixada était reparti au galop avant l’aube du jour ; il avait laissé tout le château dans l’étonnement de son brusque départ. On avait remarqué qu’il était arrivé sans suite, sans un seul écuyer pour l’accompagner ; son cheval était couvert d’écume ; il ne portait pas sur ses harnais les armes de la maison de Quixada. Quel beau sujet de commentaires ! Mais ce fut bien autre chose vraiment, lorsqu’on eut vu l’enfant mystérieux ; oh ! alors, on eut beau jeu pour forger mille histoires plus merveilleuses les unes que les autres ! elles se répandirent hors du château et dans les environs ; toutefois le temps les fit cesser peu à peu.
Juan fut élevé sous les yeux de dona Magdalena ; elle se mit à le cherir de tout l’amour qu’elle eut donné à son enfant ; elle prépara le développement de ses premières pensées, de son intelligence, et cultiva les hautes qualités qui le rendirent si intéressant dans la suite. Quixada ne l’aimait pas moins qu’elle ; on le vit un jour, dans un violent incendie qui menaçait de détruire le château, courir à l’enfant et ne pas s’inquiéter si les flammes dévoraient le lieu qui renfermait les tombes de ses ancêtres ; plus tard, il prit soin de former son pupille à tous les exercices faisant partie de l’éducation de la jeune noblesse.
Juan surpassa bientôt, par son adresse, tous les compagnons qu’on lui avait donnés pour exciter son émulation ; aucun ne distribuait de plus beaux coups de lance, ne savait mieux courir la bague, ou dompter un cheval. Mais il n’en était pas ainsi de l’étude ; le révérend père aumônier, chargé d’instruire Juan dans les lettres, n’avait pas, à beaucoup près, la même satisfaction. Il se plaignait fort de la légèreté de son élève. Juan voulait bien être brave comme César, mais il se souciait très-peu de sa langue. Le latin et les livres l’ennuyaient. Quixada se promettait bien de faire à Juan de sérieuses remontrances ; mais il oubliait toujours, en le voyant, ses projets de sévérité, et il se mettait à lui conter les beaux faits d’armes des hommes de guerre avec lesquels il s’était trouvé. Juan l’écoutait avec ravissement ; et Quixada se disait alors : « Après tout, il n’est pas si coupable ; a-t-il besoin de savoir le latin comme un clerc[1] ? il ne doit pas être pape. »
Il disait vrai, le bon Quixada ; dans ces temps-là, les gens de cour et de guerre étaient peu soigneux de s’instruire. On laissait l’étude à ceux qui se destinaient aux sciences, à l’état ecclésiastique ou à la magistrature ; les autres savaient à peine lire, et plus d’un illustre guerrier fut semblable au fameux connétable, Anne de Montmorency, lequel ne sachant pas écrire, signait ses lettres avec le pommeau de son épée, ornée d’une croix.
Nous avons dit que Juan avait des compagnons dans ses jeux et ses exercices ; ils étaient choisis parmi les enfants des gentilshommes du voisinage. Quixada, qui approuvait ces réunions, les organisa régulièrement et institua des prix pour récompenser le plus brave et le plus adroit. Les hommes s’intéressèrent à ces jeux d’enfants, et les principaux jours de combats devinrent des rendez-vous auxquels les dames ne manquèrent pas d’assister, parées de leurs plus beaux atours. Dans ces tournois, Juan se signalait toujours par son adresse, par sa grâce et sa générosité envers les vaincus ; et telle était sa supériorité bien reconnue, qu’on appelait encore vainqueur celui qui l’était après lui.
Pendant que Juan formait son cœur et son âme à la vertu, par les douces leçons qu’il recevait de sa mère adoptive, un grand événement, dont le retentissement remplit le monde, vint occuper tous les esprits. Charles-Quint, las de la gloire et des grandeurs, était allé chercher dans le monastère de Saint-Just, cette paix qui semble toujours fuir l’homme au faîte des honneurs : il avait abdiqué sa couronne en faveur de son fils aîné, Philippe, non sans avoir fortement recommandé Juan à sa tendresse. Mais, avant de s’ensevelir dans la retraite, il légua à Philippe, avec son immense empire, une foule de serviteurs dévoués, prêts à servir le fils comme ils avaient servi le père, de leurs bras et de leurs têtes, dans les conseils et les armées ; dans le nombre, il n’y avait pas de dévouement plus grand que celui de don Luis. Il reporta, sur le fils, toute l’idolâtrie dont il avait entouré Charles-Quint.
A quelque temps de là, Juan reçut de don Luis de Quixada, en ce moment auprès de Philippe II, une lettre qu’il ne pouvait se lasser de lire et de relire. Elle lui apprenait que lui, Juan, serait présenté, le lendemain, au roi qui devait chasser dans une forêt située entre Villa Garcia et Valladolid ; qu’il eût à se préparer à de grands événements. Il courut auprès de dona Magdalena, et lui montrant sa lettre : « Ma mère, ma bonne mère ! je crois que voilà mes rêves qui vont se réaliser.
« — Vous pensez-donc toujours à ces folies, dit Magdalena en souriant ?
« — Si j’y pense, ma bonne mère ! mais la nuit et le jour ; si vous saviez les belles choses que je vois dans mes rêves ! je vois des hommes qui me parlent à genoux comme à un prêtre ou à un roi, des hommes auxquels je commande ; ce sont des folies, sans doute, mais j’ai confiance en mon saint patron, et surtout en Dieu... Tenez, lisez ma lettre : « Juan, mon fils, il vous arrivera sans doute demain tout ce vous souhaitez, peut-être plus encore... Pour la première fois, vous verrez ce monde qui vous est inconnu, et le monde, Juan, n’est pas comme votre mère ; il sera votre ennemi. Mais vous aimerez toujours la vérité, n’est-ce pas ? Vous vous rappelerez les paroles que vous entendiez ici, et vous n’oublierez pas nos leçons ? Soyez reconnaissant, cela vous portera bonheur. Vous allez arriver à une haute fortune, puissiez-vous penser quelquefois à celle qui vous aime tant ! » Et dona Magdalena, à ces mots, fondit en larmes. Juan se précipita dans ses bras.
« Moi, ma bonne mère, vous oublier, oh ! jamais. Ne suis-je pas votre enfant bien-aimé, celui que vous avez élevé si tendrement ? Je ne sais pas encore ce qui m’arrivera, mais rien ne me séparera de vous. Si le roi me fait page ou officier, je reviendrai souvent, près de mon excellente mère, recevoir de sa main des récompenses qui me seront plus précieuses encore, données par elle. »
Et, en parlant ainsi, Juan baisait les mains de dona Magdalena, et s’efforçait, par ses caresses, de dissiper le chagrin auquel il la voyait livrée. Il fut triste ce soir-là, parce que sa mère pleurait ; et, la nuit, ses rêves ne lui présentèrent pas de foule agenouillée devant lui : il rêva tout simplement de belles plumes blanches, fines armures, et chevaux andaloux. Le lendemain, lorsqu’il s’éveilla, il se frotta les yeux, ne sachant s’il rêvait encore ; des hommes inconnus s’empressaient autour de lui pour le servir ; à la place de ses vêtements ordinaires, il trouvait un riche costume ; et, quelques instants plus tard, monté sur un beau cheval andalou, il accompagnait Quixada, et s’enfonçait avec lui dans les bois qui avoisinaient Villa Garcia.
Tous deux cheminaient en silence : le vieux seigneur préoccupé de ses idées, et Juan accablé des siennes, lorsque tout à coup Quixada descendit de cheval et dit à Juan d’en faire autant. Alors ce respectable vieillard dont la tête ne s’était courbée que devant Dieu et son roi, se mit à genoux devant le jeune homme, et, d’une voix étouffée par l’émotion, lui demanda la permission de lui baiser la main, et lui dit : Altesse.
Juan se jeta dans ses bras et couvrit de baisers ses joues et ses cheveux blancs, en l’appelant : mon père !
Quand ils remontèrent à cheval, en sortant de la forêt, ils virent devant eux les grandes plaines qui se déroulent avant Valladolid, couvertes au loin d’une grande foule. Sur un plan plus rapproché, s’avançait la belle cavalcade de la noblesse espagnole, à la suite de son roi ; des piqueurs entrèrent au grand galop dans l’allée d’où sortaient Juan et Quixada. Le grand-commandeur de Castille mit pied à terre avec son enfant adoptif et l’entraîna, tête nue, aux pieds d’un homme qui marchait en avant des seigneurs. « Le roi ! dit-il. »
Juan ne voyait ni n’entendait plus ; il lui passait devant les yeux des milliers d’étincelles ; bientôt il sentit une main qui le retenait, et se trouva en face du roi d’Espagne, lequel lui demanda, en souriant, s’il savait quel était son père.
Juan regarda, en rougissant, Quixada.
« Votre père, lui dit Philippe, était un grand homme ; c’est un saint maintenant[2]. Nous sommes tous deux fils de Charles-Quint, et il l’embrassa. Messieurs, ajouta-t-il en se retournant, je vous présente don Juan d’Autriche, notre frère. »
Les seigneurs rapprochés du roi, crièrent aussitôt : « Vive don Juan ! » et la chasse commença. Lorsqu’on eut parcouru la forêt dans tous les sens, le roi déclara que la chasse était terminée ; et en retournant à Valladolid, il interrogea son jeune frère sur sa vie passée, sur ses goûts et ses désirs.
« Grâce au ciel, sire, reprit Juan, mon ambition est celle que doit avoir votre frère. Je voudrais être soldat dans votre armée. »
Philippe II, qui voulait faire de son frère un cardinal, ne répondit pas, et, dès ce jour, commença cette jalousie qui le conduisit à mettre des entraves à ce jeune courage qui menaçait de l’éclipser, et dont il redoutait l’ascendant sur les cœurs de tous ceux auxquels sa domination dure et sanguinaire faisait regretter, chaque jour davantage, le règne de Charles-Quint.
Lorsque le roi rentra à Valladolid, Juan aperçut un de ses compagnons d’enfance ; il poussa son cheval du côté du jeune homme.
« Bonjour, Michel, lui dit-il.
— Bonjour Juan, répondit l’autre ; on dit que le fils de Charles-Quint est là, montrez-le-moi donc ?
— Michel, dit don Juan, on prétend que c’est moi : je n’en suis pas encore bien sûr.
Depuis la prise de Constantinople, le 15 mai 1453, les Turcs n’avaient cessé d’étendre leur puissance aux dépens de leurs voisins. L’île de Rhodes, conquise sur les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, par Soliman II, en 1522 ; Vienne assiégée en 1529, et, plus tard, le royaume de Chypre tombé au pouvoir de Sélim II, jetèrent l’alarme dans toute l’Europe. Le pape Pie V monta en chaire à la nouvelle de ce dernier désastre ; il fit une peinture si énergique des maux causés par l’invasion de ce peuple barbare, que tous les princes chrétiens résolurent de se liguer afin d’opposer une digue à ce torrent dévastateur. A toutes les armées rassemblées, il fallait un chef dont le nom fût assez puissant pour électriser la foule, un homme capable, digne, après Dieu, de conduire un peuple à la victoire. Le choix des princes tomba sur don Juan, illustre par la destruction des Maures de Grenade, et dont les premiers triomphes étaient d’un heureux augure pour la cause sainte qu’il allait défendre ; on lui décerna donc le titre de généralissime, avec le souverain commandement des armées navales de l’Espagne, de Rome et de Venise.
Son escadre, que montaient une foule de seigneurs de toutes les nations, se rendit d’abord à Gènes ; là, don Juan, après avoir été complimenté par le vice-roi d’Italie et par les ambassadeurs des principales puissances chrétiennes, fit aussitôt voile pour Naples, où le nonce du pape lui présenta le bâton de commandement ; il conduisit ensuite ses vaisseaux dans le port de Messine, y rallia les escadres de Rome et de Venise ; puis, le 16 septembre 1571, la flotte, composée de deux cent dix galères, vingt-cinq vaisseaux et quarante frégates, appareilla, précédée de deux brigantins que don Juan envoya pour reconnaître les forces des Turcs.
Ceux-ci, après avoir ravagé toutes les îles de l’archipel grec et Céphalonie, venaient de rentrer dans le golfe de Lépante ; ils avaient opéré une partie de leur désarmement, persuadés que les chrétiens effrayés n’ouvriraient pas la campagne, cette année. Lorsque les commandants de la flotte turque eurent appris les mouvements de l’armée chrétienne, ils s’empressèrent d’en faire porter par terre la nouvelle à Constantinople ; Sélim leur donna ordre de combattre jusqu’à la dernière extrémité.
Don Juan était arrivé, le 7 octobre, de grand matin, à la hauteur des îles Curzolari, à huit lieues de Lépante. Alors, il convoqua un conseil de guerre, auquel assistaient tous les chefs de l’armée ; et don Luis de Requesens, que Philippe II avait mis auprès de son frère afin de l’espionner et d’entraver ses actions, lui conseilla la retraite, obéissant ainsi aux ordres secrets du roi, jaloux à l’excès de la gloire de don Juan. Celui-ci, confiant dans les promesses du pape, et encouragé par la voix puissante qu’il entendait au fond de son cœur, fit ordonner l’attaque, et continua de s’avancer vers Lépante.
Bientôt on eut en vue la flotte turque, forte de trois cents navires, qui venaient à la rencontre des confédérés, étalant en ordre de bataille la ligne immense de ses voiles, poussées par un vent favorable. Don Juan partagea sa flotte en quatre divisions de front égal, distinguées chacune par la couleur de leurs enseignes, et défendit au marquis de Sainte-Croix, qui commandait la réserve, de prendre part au combat avant que tous les vaisseaux ennemis ne fussent engagés. Quand ces dispositions furent prises, don Juan invoqua pieusement Dieu et la sainte Vierge ; puis, il descendit dans un brigantin, et parcourut encore une fois son front de bataille, pour encourager ses soldats à bien faire ; une main sur son épée, il leur présentait de l’autre l’image du Christ pour la loi duquel ils allaient combattre ; il leur faisait entendre, dans les vaisseaux des barbares, les supplications de plusieurs milliers de leurs frères courbés sur la rame, et déchirés à coups de fouet, et les chants de fête des Turcs que le vent leur apportait : il leur promettait enfin la victoire, au nom de Dieu.
Les deux armées navales se rangèrent en bataille. Le soleil brillait de tout son éclat : d’un côté, les casques, les cuirasses et les boucliers polis des confédérés ; de l’autre, les couleurs vives et variées des vaisseaux et des équipages turcs, leurs fanaux d’or, leurs drapeaux de pourpre avec des inscriptions en lettres d’or et d’argent, formaient le spectacle le plus saisissant. Le silence fut interrompu par un coup de canon tiré par le vaisseau amiral turc, auquel don Juan répondit par un boulet de gros calibre ; ce fut le signal du combat. La lutte dura plus de cinq heures avec un acharnement terrible, et sans que la victoire se décidât d’aucun côté. Plusieurs fois déjà les chrétiens avaient tenté l’abordage, lorsque l’amiral turc tomba mortellement frappé par une balle. Les Espagnols sautèrent de nouveau à l’abordage, s’emparèrent de la capitane[3], et y plantèrent l’étendard de la croix, qu’ils surmontèrent de la tête sanglante de l’amiral. Bientôt la déroute fut complète parmi les vaisseaux ennemis ; la perte des Turcs fut incalculable ; trente mille d’entre eux périrent ; deux cent vingt-quatre de leurs vaisseaux furent brûlés ou se brisèrent sur les côtes. Quatre cents canons, plus de trois mille prisonniers tombèrent au pouvoir des vainqueurs, et quinze mille esclaves chrétiens, qui se trouvaient à bord de la flotte turque, recouvrèrent leur liberté ; on donna au pape les deux fils de l’amiral, qui avaient été pris au commencement du combat. Don Juan, après la bataille, parcourut tous les vaisseaux pour visiter les blessés, et leur dire de ces paroles dont les vieux soldats conservent un si doux souvenir. Cette mémorable victoire de Lépante, la plus importante qui eût été jusqu’alors remportée sur les infidèles, causa une sensation profonde chez les chrétiens, et l’Europe entière répéta l’ingénieux éloge que Pie V fit de don Juan d’Autriche, en lui appliquant ces paroles du saint Évangile : Fuit homo missus a Deo, etc. (Il était un homme envoyé de Dieu, lequel était appelé Jean.) Venise institua une fête religieuse, à la date du 7 octobre, en mémoire de cette grande journée.
Le triomphe éclatant de don Juan ranima la sombre jalousie de Philippe ; il se hâta de rappeler son frère auprès de lui, sous prétexte de l’envoyer en Flandre. Mais don Juan était déjà bien loin ; après avoir vaincu les infidèles à Lépante, il les poursuivit à Tunis, au même rivage qu’avait illustré Charles-Quint, son père. Don Juan avait vaincu les barbares plus encore par la terreur de son nom que par son épée. Tunis, Hipone et les ruines de Carthage étaient devenues chrétiennes ; mais ce n’était rien pour lui tant qu’Alger, la ville qui avait bravé son père, restait debout ; il voulait qu’elle tombât, et le héros aventureux alla, lui-même, chercher le côté faible d’Alger. Mais don Juan ne put faire avancer son armée, parce que Philippe II le rappela de Tunis, comme il l’avait rappelé de Lépante.
Petit-Pierre.

| Lith. de Cattier | |
| Petit-Pierre le soutenant par derrière, ils le transportèrent à la ferme de son père. | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Forcé d’aller en Flandre, où les mêmes persécutions le suivirent, don Juan, accablé sous le poids des défiances de son frère, en butte à la haine des Flamands, qui voyaient en lui le serviteur de l’Inquisition, se sentit pris tout à coup d’un amer découragement : la tristesse s’empara de son âme ; il voulut s’enfermer à Montferrat pour y creuser sa tombe, comme son père l’avait fait au monastère de Saint-Just, et envoya son secrétaire Escovedo, chargé de porter sa justification aux pieds de Philippe. Le roi fit assassiner Escovedo, et, dès ce moment, don Juan tomba dangereusement malade ; les médecins déclarèrent tout d’abord que sa maladie était mortelle, et, sitôt que le prince fut sûr de son état, il reprit, pour ne plus la perdre, cette confiance qu’on lisait sur son visage dans les grandes occasions. Il arrangea ses affaires du monde, et nomma son neveu, Alexandre Farnèse, gouverneur général des provinces flamandes. Par son testament, il suppliait son frère d’accorder des pensions aux officiers de sa maison, et lui demandait, comme une grâce, que ses restes mortels fussent déposés dans le tombeau de Charles-Quint. Don Juan s’acquitta de ses devoirs de chrétien, et l’aumônier, auquel il s’était confessé, partit pour l’Espagne, chargé d’une mission pour Philippe.
Le premier jour d’octobre 1578, sept ans après la glorieuse journée de Lépante, don Juan sortit d’un long assoupissement pour faire remarquer à Farnèse qui pleurait sur sa main, et aux généraux qui l’entouraient, que ce jour était l’anniversaire des célèbres victoires de Lépante et de Tunis ; puis son agonie commença. Il appelait, dans son délire, les capitaines de l’armée, ordonnait des charges, des évolutions, et remplissait sa tente de cris de guerre.
Ses dernières paroles furent le nom de Charles-Quint et de Quixada, ses deux pères, qu’il allait revoir dans un monde meilleur. Aussitôt après sa mort, qu’avaient précédée d’horribles convulsions, son cadavre se couvrit de taches livides, et on murmura le mot d’empoisonnement ; on accusa le cuisinier du prince ; quelques-uns virent un homme se glisser sous son pavillon ; d’autres, plus hardis, parlaient de bottines parfumées dont Philippe avait fait présent à son frère.
[1] On appelait ainsi ceux qui se destinaient à l’état ecclésiastique.
[2] Charles-Quint était mort depuis une année.
[3] Vaisseau qui porte l’amiral et la bannière de Mahomet.


Il est rare que le méchant ne reçoive pas tôt ou tard la punition du mal qu’il fait, et qu’un bon cœur n’ait pas un jour sa récompense.
Un pauvre laboureur de la commune de Tiffanges, département de la Vendée, habitait avec son fils, jeune enfant de neuf à dix ans, dans une misérable chaumière en torchis qu’il avait construite lui-même sur la pente d’un coteau, près de la petite rivière de la Sèvre. Le terrain qui dépendait de la maisonnette pouvait avoir une dizaine de perches carrées d’étendue. C’était bien peu pour leurs besoins ; toutefois, à l’aide de quelques journées de travail que le père consacrait de temps en temps au service des fermiers du voisinage, et du peu de grains que le fils glanait dans les champs de blé, après la moisson, et du raisin qu’il grapillait après les vendanges, ils vivaient encore heureux.
Le jeune enfant était généralement connu, dans la commune, sous le nom de Petit-Pierre, pour le distinguer de son père, qu’on appelait le Grand-Pierre, à cause de sa taille élevée. Il était doué d’une constitution robuste ; tout le monde l’aimait pour son caractère docile et officieux ; aussi les petits paysans se plaisaient beaucoup avec lui, et le recherchaient dans tous leurs jeux. Un seul d’entre eux se déclarait constamment son ennemi et ne manquait jamais l’occasion de lui faire quelque malice : c’était son cousin Jean, le fils du frère de son père, riche fermier dont les terres considérables venaient jusqu’auprès de leur humble habitation. Petit-Pierre montrait envers son cousin Jean, une patience à toute épreuve. Jamais il ne répondait à ses agressions, quoiqu’il eût sur lui, malgré deux ans de moins, l’avantage de la force physique, car son cousin était maigre, grêle, et souvent maladif. Quand les camarades de Petit-Pierre, étonnés qu’il souffrit les insultes de Jean, sans se venger, lui en faisaient l’observation : « Que voulez-vous ? leur répondait-il, son père est brouillé avec le mien, et si je battais mon cousin, je craindrais d’augmenter la haine de mon oncle Bachet contre nous. J’aime mieux ne pas faire attention à ses méchancetés. »
Le fait est que Jean passait, dans le canton, pour un enfant hargneux, vindicatif et cruel. Son plaisir, dans la saison des couvées, était de dénicher les petits oiseaux pour les faire souffrir, ou de détruire les œufs, lorsqu’ils n’étaient point éclos, pour empêcher qu’un autre se les appropriât. On l’avait, à cause de cela, surnommé le Dénicheur d’oiseaux. Autant on aimait Petit-Pierre, autant on détestait son cousin. Plus d’une fois, par excès de générosité, Petit-Pierre l’avait garanti des coups des jeunes paysans avec qui Bachet se trouvait fréquemment en querelle. Grâce à lui, et aussi par considération pour maître Bachet, qui était très-riche, on passait à Jean beaucoup de choses qu’on ne lui eût point pardonnées dans une autre position. Tel est l’empire de la richesse sur les hommes ! Aussi, bien coupables sont ceux qui abusent de la considération qu’elle donne, pour faire le mal. Cette indulgence, au lieu de rendre Jean meilleur, ne faisait qu’accroître son humeur méchante ; tous les enfants le fuyaient ; il n’avait point d’amis.
Un jour qu’au lieu d’aller à l’école il rôdait autour d’un étang, il aperçoit un nid de fauvettes dans une touffe de roseaux, sur une sèche près du rivage. La fauvette des roseaux montre, pour la conservation de ses petits, une industrie particulière très-remarquable. Dans sa prévoyance des accidents capables de leur nuire, elle isole son nid entre des tiges de roseaux espacés, et le suspend sur l’eau, après ces espèces de piliers naturels, à l’aide de longues attaches flexibles, semblables à des cordes. Par ce moyen, le nid se trouve garanti des reptiles qui pourraient dévorer la couvée, s’il touchait à la terre ; d’un autre côté, quand les eaux viennent à s’élever, il flotte à la surface, comme une nacelle, et monte avec la crue sans que le mouvement des eaux puisse l’entraîner avec lui.
Mais la prévoyance instinctive de cette pauvre mère, qui lui suggère ce moyen admirable de préserver ses petits des serpents et des eaux, ne l’a pas mise en garde contre une autre espèce d’ennemis plus redoutable : le Dénicheur d’oiseaux. Celui-là n’est arrêté par rien. Il surmonte tous les obstacles pour atteindre son but, qui est la destruction d’une pauvre famille dont la perte jette le père et la mère dans la désolation. Toutefois, si les animaux ne peuvent échapper, par leur propre instinct, au génie malfaisant de l’homme, Dieu se charge quelquefois de les protéger.
Jean, ayant découvert ce nid de fauvettes dont les petits, à peine éclos, agitaient leurs ailes sans plumes au soleil et appelaient leur mère, qui sautillait près de là sur des touffes de joncs, résolut de s’en emparer. La tentative offrait quelque péril. L’étang était profond, et le méchant enfant ne savait pas nager. Cependant Jean voulait absolument le nid ; il le désirait d’autant plus que la mère de la couvée semblait veiller sur ses oisillons avec une plus vive inquiétude. D’avance il se réjouissait du tourment qu’éprouverait cette pauvre fauvette en voyant ravir ses petits sous ses yeux.
Parmi les arbres qui croissaient sur les bords de l’étang, un vieux saule, au tronc creux, étendait ses branches vermoulues presque jusques au-dessus du nid. Jean s’imagina de couper une tige en forme de crochet, de monter sur le saule, et d’attirer à lui le nid par les liens qui le retenaient aux roseaux. Il paraissait évident que, par ce moyen, il ferait tomber les petits oiseaux dans l’eau, et qu’il ne pourrait avoir, tout au plus, que la coque du nid. Quelques jeunes pâtres qui faisaient pacager des vaches non loin de là, lui en firent l’observation : Jean n’en tint aucun compte. Il aimait encore mieux que la nichée pérît dans l’eau, que de la laisser à cette pauvre mère, qu’on voyait aller et venir d’un roseau à l’autre, voletant avec agitation, comme si elle eût pressenti le malheur dont elle était menacée. L’un des jeunes pâtres, indigné de sa persistance, lui cria d’un ton prophétique : « Que le mal que tu veux faire t’arrive, méchant ! »
Jean se moqua des propos du jeune pâtre : il grimpa sur le saule, s’avança vers l’extrémité de la branche qui surplombait au-dessus du nid, et déjà tout joyeux il tendait son crochet pour le saisir, lorsque tout à coup la branche craque, s’incline brusquement vers l’eau, et l’entraîne dans l’étang. Dans sa chute, Jean n’avait pas lâché le rameau qui adhérait encore après le tronc par quelques légers filaments de l’écorce. Grâce à cette circonstance heureuse, il se trouvait momentanément soutenu hors de l’eau ; mais les mouvements qu’il faisait pour se hisser après la branche, brisaient successivement les filaments d’écorce, et la branche s’allongeait de plus en plus dans l’eau. Mesurant avec effroi le danger auquel il était exposé, le petit Bachet poussait des cris de terreur. Soit que les jeunes pâtres ne crussent pas réellement au danger, soit qu’ils ne le jugeassent pas si imminent, ils ne répondaient au désespoir de Jean, que par des plaisanteries.
Cependant le péril était imminent ; en cet endroit, l’étang se trouvait très-profond, et la branche ne tenait plus à l’arbre que par un fil. Si ce fil cassait, le malheureux coulait infailliblement au fond de l’eau, et c’en était fait de lui, car aucun des jeunes pâtres qui le regardaient de la rive, ne savait nager. Par un hasard inespéré, Petit-Pierre, chargé d’une gerbe de blé, revenait de glaner d’un champ voisin et s’en retournait chez lui. En passant devant l’étang, il entendait les cris lamentables qui s’élevaient de derrière une oseraie, au bord de l’eau. Aussitôt, ne consultant que son bon cœur, il jette la gerbe et court vers l’endroit d’où partaient les cris. A ce moment, la branche s’était détachée tout à fait du tronc, et l’enfant avait disparu. Cette fois les petits pâtres, effrayés de la gravité de l’accident, venaient d’entrer dans l’eau en se tenant par la main pour tâcher de le secourir ; mais ils ne pouvaient atteindre jusqu’à lui, et c’est alors que Petit-Pierre arrive : « Qu’est-ce qu’il y a ? leur demande-t-il avec empressement.
— Ah ! Petit-Pierre, répond l’un d’eux, hâtez-vous, c’est votre cousin qui se noie. »
Oter ses souliers et s’élancer dans l’eau fut l’affaire d’un instant. Quelque chose remuait près des roseaux ; il s’y dirige, nage, plonge, et ramène son cousin sur le bord. Jean était évanoui. On coupa deux branches d’arbre, que deux des pâtres saisirent chacun par les bouts ; on posa Jean sur ce siége improvisé, et Petit-Pierre, le soutenant par derrière, ils le transportèrent ainsi à la ferme de son père. En le voyant dans cet état, maître Bachet crut que son fils était mort, et laissa échapper un cri d’effroi. « Ne vous alarmez pas, mon oncle, lui dit Petit-Pierre ; mon cousin n’est pas mort. »
En effet, presqu’aussitôt Jean rendit par la bouche une grande gorgée d’eau. Déjà, pendant la route, il avait donné plusieurs signes de retour à la vie. Le fermier se hâta de prodiguer des soins à son fils. Il le fit coucher la tête légèrement inclinée en bas, le frictionna avec des linges chauds sur la poitrine et sur le ventre, et dès que Jean eut repris un peu de vigueur, il questionna les jeunes pâtres sur la cause de l’accident. Ceux-ci en racontèrent alors toutes les circonstances, et surtout ils n’oublièrent point l’action généreuse de Petit-Pierre, qui s’était élancé dans l’eau tout habillé, aussitôt qu’on lui eut dit que son cousin se noyait. Jusque-là le père de Jean n’avait pas fait attention à son neveu. Mais, pendant le récit de sa belle conduite, ayant porté les yeux sur lui et voyant que ses vêtements ruisselaient encore l’eau : « Merci, Pierre, lui dit-il en lui tendant la main ; tu es un brave garçon. Déjà on me l’avait dit, je ne voulais pas le croire. Tu ne nous hais donc pas ?
— Non, mon oncle, répondit naïvement le jeune enfant. »
A ces mots, le père de Jean lui serra la main, et des larmes brillèrent à travers les longs cils de ses paupières. Toutefois cette émotion ne fut pas de longue durée. L’inimitié qui divisait depuis si longtemps les deux frères, ne pouvait être effacée en un instant.
« Pierre, dit maître Bachet au petit garçon, je te dois le prix d’un service ; tu es pauvre, je veux te le payer. » Et tirant d’une bourse en cuir quelques écus de cinq francs, il les lui tendit.
« Merci, mon oncle, répondit Pierre en repoussant l’argent ; ce que j’ai fait, je ne l’ai pas fait par intérêt. Je suis pauvre, il est vrai, mais comme ce n’est pas d’aujourd’hui, j’y suis habitué. »
Puis il salua son oncle respectueusement et prit le chemin de son humble chaumière. La délicatesse de cet enfant toucha sensiblement le fermier. Quand il le vit s’éloigner avec tant de dignité, il se sentit ému. Son cœur lui reprochait de l’avoir laissé là si longtemps, avec ses vêtements mouillés, sans lui donner une marque d’intérêt ; toute la soirée, il fut tourmenté par cette idée. Une lutte venait de s’éveiller dans ses sentiments. Pourtant, afin d’imposer silence au remords, tantôt il s’efforçait de ranimer sa haine contre le père du Petit-Pierre, pour justifier son ingratitude envers l’enfant ; tantôt la reconnaissance que lui inspirait celui-ci, diminuait la haine qu’il portait au père.
L’accident de Jean n’eut pas de suite ; le lendemain, il n’y paraissait plus ; mais, au lieu de puiser une leçon salutaire dans cet événement, ce méchant petit sujet se plaisait à raconter son aventure à tous les enfants, pour se donner un air d’intrépidité. A l’entendre, Petit-Pierre ne lui avait rendu aucun service. Il serait parvenu, disait-il, à se tirer de l’eau sans lui. D’un naturel ingrat et incorrigible, il ne cessa pas plus d’être l’ennemi de son cousin après cette circonstance, qu’il ne cessa de poursuivre les petits oiseaux. Au contraire, plus que jamais, il semblait envenimé contre Petit-Pierre ; et les malheureux petits oiseaux qui lui tombaient sous la main, subissaient mille cruautés, comme s’ils eussent été tous solidaires de la chute qu’il avait faite dans l’eau. Inspiré par la méchanceté, il retourna vers l’étang le surlendemain de l’accident, et, à coups de pierres, il fit périr les pauvres petites fauvettes, en détruisant le nid qui était resté suspendu après les roseaux.
Petit-Pierre ne s’étonna point de l’ingratitude de son cousin, et, de même qu’auparavant, il lui pardonna ses insolences. D’aussi nobles sentiments étaient remarquables chez un enfant de onze ans ; aussi jouissait-il d’une grande estime dans tous les environs ; ce n’était un enfant pour aucun des habitants du canton. Ses camarades même, quoique bien plus âgés que lui, le traitaient avec une sorte de déférence.
Un jour qu’il avait été grapiller dans les vignes d’un clos éloigné, il s’en revenait, le soir, chargé d’un grand panier de raisins. Il lui tardait d’être arrivé pour jouir de la satisfaction qu’éprouverait son père à l’aspect de cette ample récolte. Déjà la nuit se faisait obscure. Le croissant de la lune, à demi voilé par des nuages, projetait sur la terre une lueur vaporeuse qui prêtait aux objets des formes fantastiques. Pour accourcir le chemin, Petit-Pierre prit un sentier étroit et couvert, le long des bords de la Sèvre ; mais la pesanteur de son panier l’obligeant souvent à se reposer, ralentissait forcément sa marche.
Dans cette partie du pays, la Sèvre se trouve encaissée entre deux collines d’un aspect très-pittoresque ; il en résulte, pour le cours de la rivière, une grande variété d’accidents. Tantôt ses eaux se précipitent, par cascade, à travers des masses de rochers ; tantôt elles coulent paisibles en réfléchissant, comme un miroir, le paysage des environs. De grands ormes élevés sur l’une et l’autre rive, étendaient leurs branchages à demi dépouillés au-dessus de la rivière, et lui formaient, par intervalle, une espèce de berceau. A cette heure, ces masses de verdure augmentant l’obscurité de la nuit, imprimaient au paysage un caractère plein de mystère. Le sentier dans lequel marchait Petit-Pierre, n’était éclairé, çà et là, que par un léger reflet de la lune, dont la lumière, brisée en traversant le feuillage des arbres, arrivait à terre faible et douteuse. Depuis qu’il s’était engagé dans ce chemin, il ne cessait d’entendre le cri plaintif d’une chouette qui semblait s’attacher à ses pas. S’il s’arrêtait, la chouette, s’arrêtant aussi, continuait à pousser son cri lugubre au-dessus de sa tête ; s’il marchait, c’était la même chose ; toujours la chouette paraissait près de lui.
« Qu’est-ce que tu me veux donc, oiseau de malheur ? lui dit alors Petit-Pierre. Viens-tu m’annoncer quelque mauvaise nouvelle ? »
Et, en parlant ainsi, le pauvre enfant avait la chair de poule. Il commençait à avoir peur. Les idées superstitieuses du pays lui venaient en mémoire, et tout, dans ce moment, revêtait pour lui un caractère effrayant. Au milieu du silence de la nuit, le bruit de l’eau qui coulait entre les rochers, lui semblait les gémissements d’esprits invisibles. Le frôlement des feuilles que la brise agitait dans les arbres, il l’attribuait aux sorcières de l’air, secouant leurs ailes en glissant sur les rayons de la lune ; la chouette, dont le cri lent et triste ne le quittait pas, c’était la fée des nouvelles sinistres. Enfin, chaque tronc d’arbre, chaque buisson, chaque inégalité de terrain prenait la forme d’un fantôme, que son imagination faisait mouvoir. Toute la campagne se peuplait ainsi, pour lui, d’êtres surnaturels.
Petit-Pierre n’était pas poltron ; mais beaucoup trop jeune encore pour se défendre de l’influence des idées du pays, il croyait aux sorciers et aux esprits. Son cœur battait ; une sueur froide transsudait de tous les pores de son corps. Il n’osait plus ni marcher ni s’arrêter. Le bruit même de ses pas ajoutait à sa frayeur. Pourtant, en songeant qu’il se faisait tard et que son père devait être inquiet de lui, il reprit courage, chargea son panier sur son épaule, et franchit, d’un pas rapide, le reste du chemin qui le séparait encore de la chaumière.
En arrivant, il trouve la porte ouverte, sans lumière, sans feu, et la chambre déserte. Il cherche dans tous les coins, appelle son père : personne. Il parcourt en tous sens le petit champ qui dépend de la maisonnette en appelant toujours : personne. L’effroi s’empare de lui ; il crie de toutes ses forces : la chouette seule répond à ses cris. Il remarque que l’oiseau de nuit l’avait quitté en passant près d’une oseraie, et qu’il restait dans cette direction à une certaine distance. Le pauvre petit pleurait, frissonnait de tous ses membres et ne cessait d’appeler son père d’une voix déchirante, et la chouette glapissait toujours dans le lointain. Petit-Pierre s’imagina que la fée des mauvaises nouvelles s’était arrêtée en cet endroit pour l’y attirer.
« Oiseau de malheur, lui dit-il, pourquoi n’approches-tu plus maintenant ? Faut-il que j’aille à toi ?... O mon pauvre père ! où êtes-vous ? Est-ce vous qui me demandez ?... »
Alors, comme poussé par une force surnaturelle, il marche vers l’oiseau de nuit ; et chose étrange ! à mesure que l’enfant avançait, l’oiseau de nuit semblait toujours un peu plus loin. Enfin les cris de la chouette s’arrêtent dans le branchage d’un vieil osier, dont le tronc pourri penchait sur la rivière. Petit-Pierre approche en tremblant. La lune venait de se voiler derrière un gros nuage. L’obscurité, qui régnait en cet endroit, sous les arbres, l’empêchait de voir la route. Il marche, il tâtonne, avance et heurte, au pied de l’arbre où se trouvait la chouette, quelque chose d’étendu par terre en travers du chemin. Au même instant, l’oiseau de nuit s’envole en frappant bruyamment l’air de ses ailes, et un profond silence succède à ses cris. Debout devant l’objet qu’il a heurté, Petit-Pierre n’osait se baisser pour le regarder. Soudain il pousse un cri de terreur ; il a reconnu le cadavre d’un homme ; c’est celui de son père. Le pauvre enfant désespéré se jette sur ce corps inanimé, l’étreint de ses bras, l’embrasse, l’appelle, l’arrose de ses larmes ; mais le corps reste insensible et froid.
Quelques paysans qui se rendaient à Tiffanges, où d’ordinaire ils allaient, le soir, faire leur partie de cartes au cabaret, ayant entendu les cris de l’enfant, se dirigèrent vers lui. Ils le trouvèrent sanglotant près du corps de son père, qu’il venait d’asseoir contre le tronc de l’osier. L’un des paysans, après avoir regardé le cadavre, parut saisi d’une vive agitation ; il se détourne un instant pour cacher son émotion, puis il dit à Pierre, en lui prenant la main : « Pierre, tu as perdu ton père, tu es maintenant mon fils. J’avais à cœur de te payer ma dette ; Dieu m’en offre aujourd’hui l’occasion. »
Le pauvre enfant, en reconnaissant son oncle dans la personne qui lui parle, redouble de sanglots. Maître Bachet, attendri par la douleur de Petit-Pierre, et peut-être aussi par l’idée qu’il avait, là, devant les yeux, son propre frère, mort dans la misère, et à qui il n’avait jamais tendu la main, prit l’enfant dans ses bras et pleura avec lui. Cette scène émut tout le monde. Chacun connaissait Grand-Pierre, personne ne le haïssait, et l’intérêt qu’on portait à son fils, rendait sa situation touchante.
A partir de ce jour, le petit orphelin fut traité par son oncle avec une bonté toute paternelle. On eût dit que maître Bachet avait à cœur de réparer, envers le fils, les duretés qu’il avait témoignées au père. Petit-Pierre ne savait pas lire ; il l’envoya à l’école avec Jean. Les deux cousins étaient habillés, nourris, couchés de la même manière, et jamais maître Bachet n’exigeait, dans l’intérieur, plus de l’un que de l’autre.
Ce rapprochement des deux enfants finit par établir entre eux une étroite amitié dont le caractère du fils de Bachet retirait de grands avantages. L’exemple constant des vertus de son cousin exerçait sur lui une salutaire influence. Jean ne changea sans doute pas complétement de nature ; mais les conseils de Petit-Pierre le rendirent notablement meilleur. Le fermier Bachet ne fut pas longtemps à reconnaître les belles qualités de son neveu. Quoique âgé seulement de onze ans et quelques mois, celui-ci donnait des preuves d’une raison précoce et d’un noble caractère. Studieux, réfléchi, au bout de six mois d’étude, il en sut autant que son cousin Jean. Il est vrai que ce dernier oubliait volontiers, dans la saison des nids, ce qu’il avait appris dans les autres saisons. Comme il fallait faire un petit quart de lieue pour aller à l’école, et que, sur la route, on rencontrait des champs de genêts, des haies, des fourrés, il était rare que Jean ne s’égarât pas en chemin, jusqu’à la fin de la classe, et n’arrivât pas à l’école à peu près quand les autres en sortaient. Habile à mentir, il avait toujours trouvé des raisons pour justifier son absence. Une fois Petit-Pierre devenu son compagnon, il n’osa plus demeurer en route ; mais, de temps à autre, il venait à l’école avec de petits oiseaux dans le sein, dont il se préoccupait tant que durait la classe, et qu’il remportait presque toujours étouffés.
La manie de dénicher des oiseaux était un des travers que Petit-Pierre n’avait pu corriger chez son cousin. Tous les ans, à l’époque des nids, Jean se montrait animé d’une ardeur incroyable pour les dépister. Dans les champs ombragés d’arbres, il ne marchait jamais que la tête en l’air, tournant autour des troncs pour découvrir une nichée, ou furetant dans les buissons. Les dimanches et les jeudis surtout étaient pour lui des jours de bonheur. Il s’en allait alors sans Petit-Pierre, et s’en donnait à cœur joie. Seul, il errait dans les fourrés, et grimpait après les arbres.
Un jour que les deux cousins côtoyaient ensemble les bords de la Sèvre, en allant à l’école, Jean découvrit un nid dans les branches d’un ormeau. Aussitôt, poussé par ses habitudes de dénicheur, il allait grimper après l’arbre, mais son cousin, le retenant par la veste, l’en empêcha.
« Que vas-tu faire encore ? lui dit-il. Laisse donc ces petits oiseaux vivre en liberté. Allons, viens ; nous sommes déjà en retard, et si tu t’amuses encore, la classe sera commencée. »
Cette raison n’était pas d’un grand poids pour Jean. Il ne s’inquiétait guère que la classe fût ou non commencée. Mais son cousin le gênait, et il se promit de revenir seul une autre fois. L’occasion ne se fit pas attendre. Le lendemain, un peu avant l’heure de la classe, maître Bachet ayant eu besoin d’envoyer Petit-Pierre en commission dans une ferme voisine, Jean profita de cette absence pour exécuter son projet. Il dit à son père qu’il allait prendre les devants, et que son cousin viendrait le rejoindre à l’école. Quelques minutes après, il grimpait après l’ormeau, où, la veille, il avait convoité les petits oiseaux. L’arbre n’était pas gros, et, à cause de la faiblesse de ses branches, il crut un instant, à son grand regret, qu’il ne pourrait atteindre le nid. Enfin, après bien des efforts, il se hisse, s’allonge, tend le bras et peut y arriver. Enchanté de son succès, il plonge la main dedans ; aussitôt il la retire en poussant un cri de douleur : une grosse vipère venait de le mordre au poignet et s’enroulait autour de son bras. Dans sa frayeur, Jean se laisse couler au pied de l’arbre. En vain il fait des efforts pour se débarrasser du reptile, qui glisse jusqu’à son cou, et le mord de nouveau. Les cris du pauvre enfant retentissaient au loin dans le vallon.
Justement Petit-Pierre s’acheminait, en ce moment, vers l’école par le même sentier. Il entend la voix de son cousin, accourt, se hâte, et le trouve aux prises avec la vipère. Aussitôt enveloppant sa main d’un mouchoir, il saisit l’animal au-dessous de la tête, le serre fortement, et le lance de toutes ses forces contre la terre où il demeure étourdi ; puis, avec une pierre, il l’écrase.
Après avoir tué la vipère, il vint examiner les blessures de son cousin. Le sang lui coulait de plusieurs endroits. Voyant que le reptile lui avait fait de graves morsures, Petit-Pierre s’empressa de le reconduire à la ferme, où il raconta l’accident. Le père de Jean, n’ignorant pas combien certaine vipère de cette contrée était venimeuse, envoya chercher sur-le-champ un médecin à Tiffanges, pour qu’il vînt sans délai donner des secours à son fils. Cela demanda du temps : il s’écoula plusieurs heures. Quand le médecin arriva, le bras et le cou de Jean commençaient à enfler en se colorant d’une teinte verdâtre, et le pauvre enfant était déjà en proie à des spasmes violents.
A la vue de ces symptômes alarmants, le médecin prescrivit une ordonnance pour tâcher de retarder le mal ; mais ne comptant pas sur l’efficacité du remède, il attira le père de l’enfant dans un coin, et lui dit en baissant la voix : « Monsieur Bachet, je ne dois pas vous le dissimuler, votre fils n’offre guère d’espoir. Il n’y aurait qu’un moyen de le sauver : ce serait de lui sucer les blessures ; mais je dois vous dire aussi que celui qui lui rendrait ce service, serait perdu infailliblement : il mourrait. »
Le malheureux père, dans son désespoir, s’arrachait les cheveux ; il priait, suppliait le docteur de lui sauver son fils. Ému des larmes du pauvre homme désolé, le médecin ne savait que lui répondre. Enfin, pour lui complaire, il promet d’essayer d’un moyen. Comme il revenait auprès du lit du malade, il s’aperçoit que les spasmes de Jean sont calmés ; son œil était plus clair, son teint moins livide, et il respirait bien plus librement. Étonné de ce changement subit, le docteur en fait part à maître Bachet, qui, dans le transport de sa joie, se précipite vers le lit pour embrasser son fils. En approchant, il trouve Petit-Pierre, la bouche collée sur le cou de Jean ; ce généreux enfant lui suçait le venin des morsures.
« Malheureux ! s’écrie maître Bachet, en le repoussant vivement, sais-tu ce que tu faisais-là ?
— Oui, mon oncle, répond tranquillement le jeune enfant, je sauvais mon cousin.
— Mais toi, tu mourras !
— Je le sais ; mais lui vivra, laissez-moi faire. »
Et il allait recommencer, si on ne l’eût retenu. Frappé d’un dévouement si sublime, et tremblant maintenant pour Petit-Pierre, le malheureux père, tout troublé, ne sait plus distinguer lequel des deux est son fils. Ce dernier trait, de la part de son neveu, vient de le remuer jusqu’au fond des entrailles. De grosses larmes coulent de ses yeux ; partagé entre ces deux pauvres enfants également exposés, plein d’anxiété pour l’un et pour l’autre, il n’a plus de volonté, plus de préférence.
« Ah ! monsieur le docteur, dit-il au médecin en lui serrant le bras, sauvez, sauvez celui des deux que vous pourrez conserver à la vie ! »
Deux heures après, Jean rendait le dernier soupir, et Petit-Pierre se trouvait hors de danger. Désormais ce fut dans cet enfant que maître Bachet concentra toutes ses affections. Il lui donna tous les biens qu’il possédait, et ne se réserva uniquement pour lui que la petite chaumière qu’avait occupée son frère.
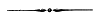

Nous avions fixé, pour la chasse des veaux marins, notre résidence au nord-est de l’Amérique septentrionale, dans la partie du Labrador qu’on nomme terre des Petits-Eskimaux. Nous nous trouvions à vingt milles de James, qui forme le prolongement de la vaste baie d’Hudson, et nous n’avions garde de nous écarter de notre poste, à moins d’être en nombreuse compagnie, de peur de rencontrer des Peaux-rouges, nomades qui nous eussent fait un mauvais parti. Un petit lac était tout près de là, dont les eaux se déchargeaient dans un autre plus étendu ; et d’épaisses forêts couvraient les campagnes environnantes.
Un après-midi, je pris ma carabine et j’allai faire un tour de promenade dans l’intention de chasser le gibier. Quoique ce fût au commencement du printemps, le lac était encore gelé, car l’hiver avait été rigoureux. Bientôt j’aperçus, dans les airs, une troupe de canards sauvages ; je m’avançai, sur le lac, à leur rencontre, avec d’autant plus d’assurance qu’une légère couche de neige, répandue sur la glace, rendait la marche très-facile. Je parvins à tirer mes canards ; deux tombèrent à la fois. J’en ramassai un, et me mis à courir après l’autre qui, légèrement blessé, sautillait devant moi. Mais, après une centaine de pas, je m’aperçus, à mon grand effroi, que la glace était couverte, en plusieurs endroits, de deux ou trois pouces d’eau. Je m’arrêtai sur-le-champ : un frisson subit avait parcouru tous mes membres : c’était le commencement du dégel, et, en Amérique, la glace cède très-promptement aux variations de la température.
Les Peaux-rouges du Labrador.

| Lith. de Cattier | |
| Je reculai en frémissant d’horreur. | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Des masses d’épais nuages commencèrent à s’amonceler ; puis bientôt une forte pluie succéda à la chute de gros flocons de neige ; je ne pus plus distinguer le rivage. Je regardais autour de moi pour retrouver mon chemin ; mais l’obscurité croissait par degrés et le silence de ces lieux solitaires était effrayant : on eût dit que toute la nature était dans l’attente de quelque événement ; je n’osais plus faire un pas ni en avant, ni en arrière, quand tout à coup éclata un bruit qui peu à peu s’approcha du lieu où j’étais resté immobile. A des explosions répétées, à de sourds murmures, succéda comme le craquement de rochers, qui viendraient à se fendre. Je frissonnai d’effroi, car je sentais la glace chanceler sous mes pieds ; quelques instants après, elle s’ouvrit avec fracas ; l’eau du lac monta écumante à travers cette large ouverture, et bientôt toute sa surface se trouva inondée.
Je me crus perdu ; je voulus alors essayer de revenir sur mes pas ; presque aussitôt je rencontrai une de ces parties faibles de glace qu’on appelle des soupiraux, et je m’arrêtai d’abord malgré moi ; puis, après avoir recouvré un peu de sang-froid, je me déterminai enfin à m’orienter pour échapper à la mort qui m’entourait ; mais, dans quelle direction m’engager ? En vain je cherchais à distinguer la terre ; le bruissement des vents dans les branches d’arbres, m’indiquait assez que le rivage n’était pas éloigné ; mais des bouffées de neige et de grésil, tourbillonnant par intervalles sur le lac, m’enveloppaient dans une obscurité complète, et me réduisaient au désespoir. Dans cette situation désespérée, je tirai plusieurs coups de fusil dans l’espoir que la détonation amènerait quelqu’un du poste à mon secours ; ce fut en vain : l’ouragan s’accrut par degrés, et les craquements de la glace parvenaient à mon oreille comme un tonnerre lointain. La peur me donna des vertiges ; je jetai mon fusil et me mis à courir contre le vent et la pluie. Partout la glace craquait sous mes pieds, et la mort m’attendait, soit que je restasse en place ou que je voulusse fuir.
Cependant la nuit vint. Épuisé par le délire qui s’était emparé de moi, je m’enveloppai dans mon manteau, et m’étendis sur la glace, sentant l’eau miner sourdement le fragile plancher sur lequel je me trouvais. Enfin, vers minuit, l’orage cessa, les nuages se dissipèrent par degrés, et la lune, se montrant à l’horizon, chassa les ténèbres qui régnaient autour de moi. Toutefois, les craquements duraient depuis plusieurs heures, lorsque tout-à-coup je sentis la glace se balancer sous moi. Je me levai avec épouvante jetant les yeux de tous côtés ; l’entière surface du lac était agitée. Alors mes yeux se troublèrent ; tous les objets environnants semblaient fuir devant moi. Le sifflement des vents, le déchirement des énormes masses de glace qui s’entrechoquaient sans cesse, étaient un spectacle horrible. Deux fragments, se rencontrant parfois, s’accrochaient et opposaient ainsi une barrière à ceux qui venaient après eux : puis, ceux-ci, poussés par d’autres, montaient sur les premiers, et formaient des pyramides de formes bizarres qui, au milieu de l’obscurité de la nuit, produisaient l’aspect le plus étrange ; puis ils disparaissaient, comme par magie, avec un effroyable fracas.
Le fragment de glace sur lequel je m’étais réfugié, était large et très-épais ; d’autres vinrent s’y attacher, de manière à former un tertre de cinq à six pieds de hauteur, au sommet duquel je me tenais debout, plus mort que vif. Bientôt le vent, soufflant avec plus de violence, poussa rapidement la glace vers la terre. Alors mes alarmes commencèrent à se calmer. Mais, une fois, mon glaçon reçut un choc si terrible que, perdant l’équilibre, je faillis être précipité dans le lac. Je remontai, avec bien de la peine, au faîte de mon îlot de glace. En cet état de perplexité, je vins à remarquer que la partie du lac qui me séparait du rivage était prise encore sur une étendue de plus de cent cinquante mètres ; après quelque hésitation, je pris le parti de m’élancer sur cette surface fragile. A peine mes pieds effleuraient la glace, tant je craignais qu’elle ne cédât sous moi ; et bientôt je me vis sain et sauf à terre. Je n’essaierai point de décrire toutes les émotions que j’éprouvai ; il faudrait, pour les comprendre, s’être trouvé en une situation pareille.
Le jour se levait, mais je ne vis la trace ni d’hommes ni d’animaux. De vastes forêts s’étendaient au loin : je n’osais y pénétrer de peur de m’égarer dans leurs détours.
Je suivis le cours de la rivière, et après une demi-heure de marche, je distinguai une colonne de fumée qui s’élevait au-dessus des arbres de la forêt. Je me dirigeai, en toute hâte, de ce côté. Que vis-je ? une troupe d’indiens assis autour d’un grand feu ; ils m’accueillirent avec un air d’indifférence fort peu rassurant ; néanmoins, m’efforçant de montrer une confiance que j’étais loin d’avoir, je pris place dans leur cercle, et leur adressai la parole dans les divers dialectes que je possédais. Je leur racontai l’aventure qui m’avait amené au milieu d’eux. Quand j’eus cessé de parler, ils ôtèrent leurs calumets de la bouche et me regardèrent avec un air d’incrédulité ; exténué que j’étais de lassitude et de faim, je leur demandai à manger : après s’être consultés, ils y consentirent, mais avec une visible répugnance.
Cette troupe de Peaux-rouges était composée de cinq hommes, deux femmes et deux enfants ; ils étaient accroupis autour du feu, dans l’attitude de l’indolence. Mais moi, je restais plongé dans de bien sombres pensées, car un des Indiens attachait sur moi un regard si scrutateur, que je finis par en tirer un sinistre augure.
Cet homme avait la peau rouge et l’accoutrement bizarre d’un naturel des bois. Son corps, presque nu, présentait un effrayant emblème de mort, tracé en blanc et en noir. Sa tête, rasée de très-près, n’offrait d’autres cheveux que cette touffe que l’Indien conserve d’habitude sur le sommet de la tête, comme pour narguer l’ennemi qui voudrait le scalper ; un tomahawk et un couteau étaient passés dans sa ceinture, et un fusil posé en travers sur ses genoux.
J’éprouvais une mortelle inquiétude. A côté de ces Indiens, se trouvait un autre Peau-rouge, plus jeune, qui ne m’inspirait pas la même crainte : il pouvait avoir vingt-cinq ans. Il était grand ; ses traits bien dessinés offraient le teint rouge de sa nation dans toute sa pureté. Cet Indien était aussi armé d’un tomahawk et d’une carabine. Il arrêtait ses yeux sur moi sans aucune expression de haine ; ses traits étaient, au contraire, animés de bienveillance : ils paraissaient me dire que je pouvais compter sur lui, au moment du danger. Cependant le silence le plus absolu ne cessait de régner.
Quelques heures s’écoulèrent de la sorte. Dans l’après-midi, un des Indiens ayant aperçu un daim à travers les broussailles, s’avança vers l’animal en rampant avec précaution. Une fois, à distance convenable, il arma son arc. Un instant après, nous entendîmes le son de la corde tendue ; une ligne blanche sillonna l’air et pénétra dans les broussailles, d’où le daim sortit en bondissant. L’Indien évita subtilement l’attaque de son ennemi rendu furieux par sa blessure, le frappa de son couteau, alors qu’il passait près de lui, et l’animal faisant un dernier bond terrible, fut lancé dans la rivière. Quelques instants après, notre Indien reparut portant le daim sur ses épaules. Plusieurs de ses compagnons se mirent aussitôt à manger de la chair crue, sans aucun apprêt ; néanmoins d’autres morceaux furent grillés au feu, et toute la troupe prit sa part du repas.
Pendant que ces choses se passaient, le silence avait toujours été le même. Enfin les Indiens se levèrent, firent leurs préparatifs de départ et se mirent en marche.
Je m’aperçus bientôt qu’ils ne se souciaient pas que je partisse avec eux. M’avançant alors vers l’Indien qui était en tête, celui-là même qui n’avait cessé de me regarder avec défiance, je lui dis résolument que j’avais l’intention de suivre sa troupe, parce que j’ignorais en quels lieux j’étais, et que je ne me souciais pas de rester seul dans les bois. Cet homme s’arrêta aussitôt, et fixant ses yeux sur moi, me dit d’un ton bref :
« Où est votre carabine ? Où est votre tomahawk ?
— Je les ai perdus dans la glace, répondis-je.
— Gardez-vous, reprit-il, d’irriter le Grand-Esprit par vos mensonges. Cet homme sait qui vous êtes, continua-t-il en me montrant le jeune Indien qui m’avait regardé avec tant de bienveillance ; vous êtes venu pour nous surprendre, et vos compagnons sont cachés non loin d’ici ; l’expérience nous a appris à nous méfier des hommes blancs ; nous ne voulons être ni trahis ni enivrés par vos liqueurs spiritueuses. Retirez-vous ; aucun de nous ne vous fera de mal. »
J’étais fort embarrassé pour répondre à un tel discours ; je protestai de la vérité de mon récit, et j’assurai que je n’avais ni compagnons, ni moyens de leur nuire. Cet Indien m’écoutait avec calme. Le jeune homme s’avança alors et dit : « Que cet étranger vienne avec nous ; l’ombre de mon père me reprocherait de l’abandonner. Suivez une fois l’avis de Thakaverente. »
Alors le premier Indien fit un geste de la main pour m’indiquer que je pouvais les suivre ; et la troupe se mit en route.
Quoiqu’il me fût impossible de découvrir aucune trace de sentier frayé, notre chef nous guida à travers les épaisses forêts, sans aucune hésitation ; quelquefois, suspendant sa course, il regardait les arbres pendant quelques moments, puis il poursuivait sa marche, comme nous, en silence, avec la même rapidité. Le bruissement des feuilles sous nos pieds était le seul bruit qui troublât le silence de ces solitudes. Bien que délivré de la crainte de mourir de faim, je ne pouvais songer, sans de vives alarmes, à ma situation ; j’étais d’ailleurs épuisé de lassitude, et pourtant je ne devais point songer à m’arrêter un seul instant, de peur de perdre de vue ces maudits Peaux-rouges.
Ce ne fut qu’après le coucher du soleil que nous fîmes halte pour la nuit. Les hommes s’empressèrent de construire une tente et les femmes d’allumer du feu. On avait abattu un chevreuil avant la chute du jour ; on s’assit autour du feu, chacun en prit sa part. Le repas terminé, les Indiens chargèrent leurs pipes d’herbes odoriférantes, et se mirent à fumer avec un imperturbable sang-froid, laissant aux femmes le soin d’étendre sur la terre les peaux destinées à leur servir de lits.
Je m’assis à quelque distance au pied d’un arbre, observant bien attentivement mes compagnons, mais, fatigué que j’étais, je finis, malgré moi, par tomber dans un profond sommeil. A une heure du matin, je fus soudain réveillé par une main qui secouait la mienne ; et en ouvrant les yeux, je distinguai, debout devant moi, le même Indien qui s’était opposé à ce que j’accompagnasse la troupe. Il s’appelait Outalissi ; posant ses doigts sur ses lèvres pour m’imposer silence, il me conduisit derrière un grand arbre, assez loin de la tente où dormaient les Indiens.
« Étranger, écoute-moi, dit-il à voix basse, je t’ai juré qu’il ne t’arriverait aucun mal, je ne trahirai pas mon serment. Thakaverente, qui a demandé que tu fisses partie de notre troupe, nous a conté que son père fut tué, il y a près d’un an, par deux des hommes que tu commandes ; l’esprit du vieillard lui est apparu cette nuit, et lui a ordonné de te faire mourir. Je t’engage à fuir, si tu veux échapper au sort qui te menace.
— Hélas ! que me proposez-vous ? que devenir ? m’écriai-je ; la mort m’attend, soit que je reste ou que je m’éloigne.
— Eh bien ! reprit l’Indien, je tâcherai de te sauver. L’ouragan a abattu, non loin d’ici, un vieux chêne dont les racines dépassent le taillis qui l’entoure. Tu peux l’apercevoir d’ici. Suis ce sentier à gauche, et va m’y attendre. » Je m’enfonçai aussitôt dans les détours de la forêt, et j’atteignis le chêne désigné ; là j’attendis Outalissi avec la plus vive anxiété ; cet Indien n’avait pas fixé l’heure de son retour. Je tombai dans une rêverie profonde qui m’eût infailliblement conduit au sommeil, lorsqu’un léger bruit se fit entendre près de moi. L’idée du cruel Thakaverente, dont l’air de bienveillance m’avait si étrangement abusé, me fit involontairement tressaillir ; jetant donc les yeux du côté d’où venait le bruit, j’aperçus à quelques pas de moi des formes qui semblaient se glisser sur le sol. Un petit nuage couvrait en ce moment la lune, et quand il fut passé, ce fut avec un sentiment de joie inexprimable, que je distinguai cinq ou six daims qui venaient se désaltérer à un petit ruisseau coulant non loin de là. Ces timides animaux me regardèrent d’un air paisible, et s’éloignèrent lentement. J’avais eu, je l’avoue, un terrible moment de frayeur.
Cependant les heures s’écoulaient toujours ; la lune commençait à descendre sur l’horizon, et Outalissi ne paraissait pas. Bientôt les astres commencèrent à pâlir ; un léger frémissement dans les arbres, et quelques petits cris, annoncèrent que les oiseaux ressentaient l’influence de l’approche du jour. Enfin le soleil parut... et toujours point d’Outalissi : « C’en est fait de moi, m’écriai-je douloureusement, le traître m’a abandonné ! »
Un brouillard épais enveloppait la terre ; le froid s’empara de mes membres. Pour me réchauffer, je marchais avec vitesse autour du chêne, sans m’apercevoir que je m’éloignais du lieu du rendez-vous. Peu à peu un vent violent s’éleva ; les arbres, agités par l’ouragan, craquaient autour de moi ; je commençai à craindre que quelque branche brisée ne me tombât sur la tête. C’est alors que je regrettai de m’être écarté du chêne, dont les racines entrelacées m’eussent offert un asile contre la tempête ; quoi qu’il en soit, je n’osais le chercher de peur de m’égarer encore davantage. Enfin, après plus de dix heures de mortelle attente, je me livrais au plus sombre désespoir, quand soudain la détonation d’une carabine parvint à mon oreille. Je n’essaierai pas de décrire ma joie, lorsqu’un second coup de feu plus rapproché se fit encore entendre. Outalissi ! Outalissi ! m’écriai-je alors ; en un instant, l’Indien était près de moi.
« Pourquoi n’êtes-vous donc pas demeuré au lieu convenu ? me dit-il. » Je lui appris comment je m’étais involontairement éloigné du chêne. — Au reste, il n’y a plus de danger pour vous maintenant, reprit-il... Thakaverente est mort.
— Mort ! répliquai-je ; serait-il possible ?
— Je ne vous trompe pas, poursuivit froidement Outalissi ; écoutez-moi : Thakaverente s’éveilla un peu après votre départ, et ne vous trouvant pas sous sa tente, il m’accusa de vous avoir prévenu du danger que vous couriez et soustrait à sa vengeance ; je dédaignai de le nier ; alors, dans sa colère, il me frappa au visage : vous savez qu’un Indien ne pardonne jamais pareille offense ; ce fut, dès ce moment, entre nous, un combat à mort... il succomba. Nos amis dormaient toujours sous la tente ; de peur qu’ils n’aperçussent son corps, je le couvris de feuilles sèches, et je m’enfonçai dans la forêt, en attendant que la troupe fût partie. Quelque temps après le lever du soleil, la petite troupe fit ses préparatifs de départ, appela Thakaverente et moi, puis enfin ne nous voyant paraître ni l’un ni l’autre, elle se mit en route, supposant alors que nous avions pris les devants. Sans le brouillard et l’ouragan, je serais venu vous rejoindre quelques heures plus tôt ; maintenant que le jour baisse, suivez-moi vite, ajouta-t-il d’un air mystérieux.
Alors, Outalissi me conduisit vers un tas de branches et de feuilles sèches qu’il écarta, et sous lesquelles j’aperçus le corps de Thakaverente. Je reculai en frémissant d’horreur.
« Que prétendez-vous faire ? lui demandai-je. — Ignorez-vous, reprit-il, que lorsqu’un Indien meurt, tout ce qu’il possède doit être enseveli avec lui ; ainsi le veut le Grand-Esprit. »
Nous portâmes donc le mort près du feu. Outalissi disposa ses vêtements avec un soin particulier, lui suspendit son tomahawk à la ceinture, et alla chercher dans la forêt, quelques écorces d’arbres pour garnir la fosse. Je restai seul ; déjà la nuit était devenue sombre. Le feu ne jetait plus que de faibles lueurs ; alors, une crainte insurmontable s’empara de mes sens. Je n’osais plus regarder autour de moi, et quand un reflet de la flamme venait à tomber sur Thakaverente, je croyais presque qu’il allait se mouvoir, et j’aurais fui si je n’avais été enchaîné à ma place par ma terreur même. Le retour d’Outalissi mit bientôt fin à mes angoisses ; je l’aidai à ensevelir l’Indien sous un grand chêne ; puis, nous nous assîmes auprès du feu jusqu’à ce que la lune vînt éclairer notre route. Outalissi consentit d’autant plus volontiers à me conduire jusqu’à notre résidence, qu’il devait, au moins pendant une saison, changer de demeure pour se soustraire à la vengeance de la famille de Thakaverente.
Nous partîmes dans la nuit ; nous nous trouvions enfoncés au milieu d’une vaste forêt, d’où seul je n’eusse jamais pu sortir ; mais Outalissi n’ayant pour guide que les étoiles ; et consultant fréquemment ces signes connus des Indiens, marchait d’un pas ferme et presque en ligne directe, sans jamais hésiter, dans cette immense forêt coupée par des vallées, des montagnes, des ruisseaux et des rivières. Que le sentier fût battu, à peine indiqué, ou qu’il disparût totalement, il n’en marchait ni avec moins de vitesse, ni d’un pas moins assuré.
Ce sauvage avait eu la précaution de se munir d’une grosse branche de pin qu’il avait allumée. Cette lueur vive, tombant en plein sur sa physionomie rouge et ses vêtements bizarres, lui donnait un aspect effroyablement étrange ; et cependant je ne pouvais m’empêcher de regarder mon sauveur avec des yeux d’admiration. Que ne peut la reconnaissance !
Marchant ainsi jusqu’au jour, nous arrivâmes enfin au bord de la rivière. Outalissi eut bientôt improvisé une espèce de canot à sa manière, et, en moins de vingt-quatre heures, nous remontions la rivière jusqu’au lac, sur les bords duquel était établi notre poste. Je n’essaierai pas de peindre tous mes transports de joie en revoyant notre camp ; mon cœur était pénétré de la plus vive gratitude envers Dieu, pour m’avoir rendu à mes compagnons d’armes, d’une manière si inespérée. Que d’actions de grâces aussi ne devais-je pas à Outalissi ! Tous mes camarades qui m’avaient cru pour le moins noyé ou dévoré par les bêtes féroces, surent bientôt tout ce que je devais à ce digne Peau-Rouge ; il fut fêté par tous, traité en frère ; et bref, il se trouve si bien parmi nous, qu’il y restera toute sa vie.
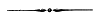

Les inclinations musicales d’Amédée Mozart, né à Salzbourg, en Autriche, le 27 janvier 1756, furent remarquées, dès les premières années de sa vie, par son père, musicien et compositeur distingué, qui se plut à les développer lui-même dans ce jeune prodige. Amédée Mozart était à peine dans sa troisième année, que déjà, lorsqu’il entendait jouer du piano par sa sœur, âgée de cinq ans seulement, et qui était aussi une enfant extraordinaire, il accourait et essayait d’exécuter des tierces avec ses petites mains. Après s’être initié aux principes de l’art, avoir appris à connaître les signes qui forment la lecture musicale, et à les rendre sur l’instrument, Amédée Mozart ne trouvait pas un seul papier réglé qu’il ne le couvrît de notes. Ce qu’il affectionnait particulièrement, c’étaient les menuets. Une fois, entre autres, lorsqu’il entrait dans sa sixième année, au moment où son père allait sortir, il courut après lui : « Papa, papa, donne-moi du papier de musique avant de t’en aller... — Qu’en veux-tu faire ? — Je veux écrire un concerto de piano, que je te montrerai à ton retour. »
Le père lui donna ce qu’il demandait, et lorsqu’il rentra, il fut fort surpris, au milieu d’une foule de choses insignifiantes et de nombreuses taches d’encre, de découvrir des pensées qui avaient de la suite et qui étaient bien au-dessus de l’âge de l’enfant. Ce que le père n’avait pas deviné jusque-là, il en tenait les preuves en main. Son fils, auquel il ne croyait encore qu’un avenir d’exécutant, devait être un grand compositeur. Il se mit au piano, et joua l’essai de son enfant en le mouillant de larmes de joie.
Malgré ce penchant si vif et si ardent pour l’étude de la musique, le petit Amédée n’était pas moins joueur que les autres enfants, et il s’amusait d’aussi bon cœur qu’il travaillait. Aussitôt que ses mains quittaient le piano, on voyait sortir de ses poches des billes qu’il lançait quelquefois sur le clavier, ou bien c’était un bilboquet ou une toupie. C’était en outre un charmant enfant, bon et affectueux. Il sautait sur les genoux de tous ceux qu’il connaissait, et enlaçant leur cou de ses petits bras, il leur demandait cent fois par jour : « M’aimes-tu bien ? » C’est à ce caractère si plein de bonté qu’il faut attribuer l’exquise sensibilité qui régna plus tard dans ses œuvres. Le jeune Mozart n’avait pas seulement de l’intelligence pour la musique : il montra, à cet égard, un goût très-prononcé pour le dessin ; et, ce qui doit paraître plus étonnant encore, c’est que ce génie précoce se sentit tout à coup une passion pour le calcul, une aptitude remarquable pour cette science si positive et si opposée aux beaux-arts, qu’il est inexplicable que le goût de l’une et des autres ait pu naître en même temps dans cette jeune tête. Il ne rêva plus que chiffres ; il en faisait sans cesse, et les murs des chambres et des escaliers, ceux même des maisons voisines de celle de son père, lui servaient de tableaux de calcul. Son père, qui voyait que sa véritable vocation était la musique, mit tout en œuvre pour le ramener à cette seule étude et lui faire quitter celle des mathématiques. Il réussit si complétement que, dès que l’enfant se fut abandonné exclusivement à la musique, on put utiliser ses talents en même temps que ceux de sa sœur.
Le père partit un beau jour pour Munich avec ses enfants, et l’accueil qu’il reçut dans cette ville l’encouragea à poursuivre son voyage. Il se rendit à Vienne, en descendant le Danube, et il s’arrêta un jour dans un des couvents qui se trouvent sur les bords de ce fleuve. Ces couvents possèdent des orgues si grandes, si magnifiques, que celles des églises de Paris ne peuvent, en aucune manière, leur être comparées. Le petit virtuose de six ans ne put résister au désir de jouer sur un de ces beaux instruments, et quand on eut exhaussé son siége, ce fut à grand’peine qu’il atteignit les pédales avec son pied. Cependant il en tira des sons si beaux, il joua avec tant de perfection, que les capucins quittèrent spontanément la table du réfectoire pour courir à l’église entendre un talent si remarquable.
Arrivés à Vienne, où leur réputation les avait précédés, le petit Mozart et sa sœur charmèrent tous ceux qui les entendirent, et l’empereur Joseph II voulut les avoir à sa cour. Le prince fut si ravi du jeune Amédée qu’il ne l’appela plus que le petit sorcier.
Une fois, dans les salons impériaux, le petit musicien se laissa glisser sur le parquet. Une jeune archiduchesse s’empressa de le relever, et lui demanda affectueusement s’il ne s’était pas fait mal. L’enfant fut si sensible à l’intérêt que la princesse lui montra que, dans l’effusion de sa reconnaissance, il lui promit de l’épouser quand il serait grand. Cette archiduchesse n’était que la belle Marie-Antoinette qui, plus tard, devint la femme infortunée de Louis XVI, et fut reine de France.
Le petit Amédée reçut en présent un violon. Il connaissait le mécanisme de cet instrument ; mais son père, voulant qu’il se consacrât entièrement au piano et à la composition, le lui avait fait laisser de côté ; aussi ce fut à son insu qu’il s’y exerça. A leur retour à Salzbourg, un jour que le père d’Amédée donnait chez lui un petit concert, il arriva qu’au moment d’exécuter un quatuor pour deux violons, alto et basse, le second violon manqua ; alors Amédée dit :
« Papa, si tu veux, je le remplacerai.
— Veux-tu bien me laisser tranquille, répondit le père ; est-ce que tu sais jouer du violon ?
— Papa, essaie, tu verras que je jouerai ma partie...
— Encore une fois, laisse-moi en repos, si tu ne veux pas que je me fâche, lui dit son père impatienté de ce qu’il prenait pour de la présomption chez l’enfant. »
Amédée insista et pressa plus vivement son père. A la fin, ses amis se joignirent à lui en disant qu’il fallait le contenter, et que même ce serait une occasion de lui donner une leçon utile ; le père, adoptant cette idée, consentit à ce que voulait le petit garçon.
Quel ne fut pas l’étonnement de tout l’auditoire, quand on vit Mozart jouer avec une perfection rare ! Le père surtout ne pouvait revenir de sa surprise ; et ce fut avec admiration et attendrissement qu’il serra son fils dans ses bras. Vers cette époque, le petit Mozart composa sa première sonate, gracieux ouvrage qui n’a pas cessé d’être estimé, et que l’on joue encore. Ce fut ainsi que lui et sa sœur étonnèrent tour à tour les grandes villes de l’Europe. Ils allèrent à Paris et à Londres. Dans cette dernière ville, Amédée excita un enthousiasme difficile à décrire : on le surnomma le roi de l’orgue. Il avait alors huit ans, et pendant une maladie qu’eut son père, il écrivit une symphonie à grand orchestre. Sa sœur, assise à côté de lui pendant qu’il composa cette symphonie, eut aussi sa part de gloire. Après les succès les plus brillants, ils quittèrent l’Angleterre et visitèrent la Hollande ; partout leur talent précoce leur valut des applaudissements et des suffrages mérités.
Amédée Mozart touchait à peine à sa douzième année, et sa sœur à sa quatorzième, que leurs progrès à l’un et à l’autre étaient devenus la seule ressource de leur père vieillissant. Il les conduisit de nouveau à Vienne. Dès ce temps, Mozart ne se contentait plus de mériter le renom d’un exécutant parfait sur le piano et le violon, il était devenu un compositeur éminent. A l’occasion de l’ouverture de la maison des orphelins de Vienne, le génie-enfant ne se borna pas à faire une composition à grand orchestre : du haut d’une estrade qu’on avait élevée pour lui, on le vit, l’archet en main, diriger seul un corps de musiciens nombreux. Son ouvrage fut trouvé si rempli de beautés et de poésie, et il sut en diriger si habilement l’exécution, que l’empereur Joseph II le chargea de faire la musique d’un grand opéra. Il se mit tout de suite à l’œuvre, et il termina, en peu de temps, une partition qui n’avait pas moins de 558 pages...
Ce qui est pénible à dire, c’est que la réputation naissante du jeune maëstro porta ombrage aux autres compositeurs ; ils craignirent qu’elle n’éclipsât la leur, et ils intriguèrent de mille manières pour empêcher la représentation de cet opéra. Enfin ils rendirent, au père Mozart, le séjour de Vienne si insupportable qu’il se décida à partir avec ses enfants, et l’opéra ne fut pas représenté, quoique, de l’avis des connaisseurs, il fut des plus remarquables.
Un an plus tard, l’électeur de Salzbourg nomma l’enfant directeur de ses concerts. En 1769, comme il entrait dans sa quatorzième année, son père le conduisit en Italie. Dans cette patrie des arts et des talents, il fut accueilli par tous les grands compositeurs de l’époque, et leurs conseils, autant que leurs œuvres, ne contribuèrent pas peu à développer ses pensées et à éveiller dans son imagination, déjà si brillante, les belles et ravissantes inspirations qu’il savait si heureusement exprimer, et qui charmeront longtemps encore tous ceux qui les entendront.
A Naples, il étonna tellement par sa merveilleuse exécution, et surtout par l’habileté avec laquelle il se servait de sa main gauche, que les Napolitains ne pouvant croire que tant de talent pût être, dans un enfant, le résultat d’un travail opiniâtre, l’attribuèrent à la puissance d’une bague qu’il portait à cette main. Mozart, informé de leur absurde supposition, n’eut pas de peine à leur prouver, en ôtant sa bague, qu’elle n’était pour rien dans la perfection de son jeu.
Il alla à Rome, et fut présenté au pape Clément XIV, qui l’invita plusieurs fois à jouer dans ses appartements. C’était au temps de Pâques. Mozart et son père avaient entendu raconter des merveilles de la musique de la chapelle du pape, et vanter beaucoup le célèbre Miserere d’Allegri, qu’on y exécute tous les ans, le jour du vendredi-saint. L’enfant ne craignit pas de demander au pape une copie de cette composition.
« Cela ne se peut pas, mon ami, lui répondit affectueusement le pape.
— Et pourquoi donc ? demanda l’enfant dans sa naïveté.
— Parce que ces ouvrages ne sont pas ma propriété, mais celle de l’église, répliqua le saint-père avec bonté... »
Mozart fut admis à la seule répétition qui eut lieu. Il écouta, avec la plus grande attention, cette fameuse composition, et aussitôt après, il courut à sa demeure écrire tout le morceau, en notant les sons qu’il avait entendus et retenus. Le soir du vendredi-saint, il alla avec son manuscrit à la Chapelle-Sistine, et, pendant qu’on exécutait le morceau, il corrigeait ce qu’il avait écrit, et remplissait les parties intermédiaires. C’est ainsi qu’il devint possesseur de l’œuvre entière, malgré la défense faite, sous peine d’excommunication, aux conservateurs de la bibliothèque papale, d’en prendre ou d’en laisser prendre copie. Le jeune musicien montra avec franchise ce qu’il avait fait, au pape. Le saint-père sourit à la vue de ce larcin, qui n’était exécutable que par un génie aussi supérieur, un talent aussi prodigieux que celui de Mozart, et il lui dit :
« Ce que tu emportes de cette façon, je ne saurais l’empêcher ; fais-en ton profit. » Et, loin d’avoir encouru la disgrâce du pape, Mozart reçut de lui l’ordre de l’Éperon d’or, dont il fut fait chevalier, malgré son extrême jeunesse.
A Milan, il fut chargé de composer un opéra. Le 26 décembre 1770, jour où s’accomplit sa quatorzième année, cet ouvrage fut représenté sous le titre de Mithridate, roi de Pont. Il produisit un enthousiasme difficile à décrire. Ce fut après ce triomphe, qu’il revint dans les montagnes du Tyrol, à Salzbourg.
Mozart avait, dès sa jeunesse, des manières fort originales, et à peine croyables de composer ; ou, pour mieux dire, c’était une composition perpétuelle, en se promenant, en mangeant, en jouant, même en causant de toute autre chose. Une célèbre virtuose d’Italie étant à Vienne, pria Mozart de lui composer un duo pour un concert qu’elle devait donner devant l’empereur, et de vouloir bien tenir le piano lui-même. Complaisant et bon toujours, Mozart lui promit l’un et l’autre, et il composa, à cette occasion, une grande sonate en si bémol, dont la célébrité est devenue européenne. Elle était composée, mais elle était encore tout entière dans la tête du jeune maëstro, qui n’avait pu trouver le temps de l’écrire. Le jour arrive, la virtuose désespérée, accourt chez Mozart, le prie, le supplie de lui donner sa partie, afin de pouvoir au moins la lire une fois avant l’exécution en public. Il se met à écrire la partie de violon ; mais ce n’était que la moitié, restait celle du piano. A l’heure du concert, la salle se remplit. Au moment de jouer le duo, l’artiste italienne se place devant son pupître ; Mozart se met au piano, mais devant lui il n’avait qu’un cahier de papier blanc, dont il tournait de temps à autre une page, pour faire semblant de lire sa partie. L’empereur qui le lorgnait, et qui voyait son papier laissé en blanc, s’approcha de Mozart, à la fin du morceau, en s’écriant plein d’enthousiasme :
« Mozart ! Mozart ! tu t’es risqué encore une fois !... »
Quand Mozart voyageait, il n’emportait pas de musique. Lorsqu’il donna des concerts à Leipsick, les musiciens étaient dans l’ébahissement de ne voir que des pages blanches, ou seulement quelques notes de basse chiffrée. Ils lui demandèrent où se trouvait la partie principale. « Elle est enfermée dans mon pupître à Vienne, » répondit-il tranquillement.
Il était obligé d’en agir ainsi dans ses voyages, parce que les musiciens et les marchands de musique lui volaient ses partitions. Lui, insouciant et plein de confiance, croyait avoir un ouvrage à vendre, que déjà il le trouvait imprimé et mis en montre dans les magasins de musique. Les théâtres ne lui payant presque rien non plus pour ses opéras, qui les enrichissaient, il resta pauvre, et avait grand’ peine à gagner assez pour satisfaire aux nécessités les plus urgentes de son existence. Quoique s’inquiétant peu de la vie matérielle pour lui-même, il en souffrait pour les autres ; il avait un père et une mère qui vieillissaient, et il aurait voulu pouvoir adoucir leurs dernières années.
Alors commencèrent pour lui des temps difficiles, une époque de privations : époque d’autant plus cruelle, que son enfance avait été heureuse, qu’il avait été fêté partout, que le nom de Mozart, admiré par toutes les nations de l’Europe, ne se prononçait qu’avec une sorte de vénération qu’inspiraient de véritables chefs-d’œuvre.
Mozart était devenu jeune homme ; il avait environ vingt ans quand, ayant la conscience de son talent, il décida de retourner à Paris. Sa bonne mère craignant qu’avec son âme si candide et si ouverte, il ne devînt, dans cette grande cité, la dupe des intrigants, voulut l’accompagner. Une immense réputation l’y avait précédé, mais seulement comme exécutant. Lorsqu’il voulut s’y faire connaître comme compositeur, il ne put trouver un auteur de quelque mérite, qui voulût bien lui confier un poëme à mettre en musique. Tous alors affluaient chez Grétry. Espérant toujours un moment plus favorable, il prolongea son séjour à Paris, et c’est avec peine qu’il obtint quelques leçons pour se procurer, ainsi qu’à sa mère, les moyens de subsister. Dans ce temps-là, d’ailleurs, le goût de la musique était loin d’être, à Paris, ce qu’il est aujourd’hui.
Ce ne fut que cinquante ans plus tard que ce beau génie fut apprécié dans cette capitale des arts, et qu’on y rendît à son talent des hommages tels qu’il n’a été donné à aucun autre d’en recevoir de semblables ; mais il était trop tard pour qu’il en jouît, car après deux années d’une longue et vaine attente, il lui fallut quitter cette ville, plus pauvre encore qu’il n’y était venu : puisqu’il y était arrivé avec sa mère, et qu’à son départ il ne l’avait plus. L’éloignement de son pays natal, de sa famille, et plus encore le peu de justice que l’on rendait au talent de son fils, avaient désolé l’excellente femme, au point qu’elle était tombée malade et ne s’en était pas relevée. La douleur du pauvre Mozart, en perdant cette mère si tendre, si bonne, fut inexprimable. Après lui avoir rendu les derniers devoirs, et avoir répandu d’abondantes larmes sur sa tombe, Mozart quitta un pays où il n’avait trouvé que déceptions, misère et chagrins, pour retourner dans sa patrie.
Là, enfin, après quelque temps, son étoile recommença à luire. Les grandes villes de l’Allemagne représentèrent successivement ses opéras. Munich donna son Idoménée, Vienne sa Flûte enchantée, Prague son inimitable Don Juan, l’opéra des opéras.
Malgré son immense talent, en dépit de tous ses succès, Mozart n’en continuait pas moins à vivre dans un état continuel de gêne voisin de l’indigence.
Une vie si laborieuse a produit, malgré sa courte durée, un tel nombre d’ouvrages, que la chose est à peine croyable. Le dernier de tous fut accompagné des circonstances les plus singulières.
Lorsque Léopold II succéda à son frère Joseph II, comme empereur d’Allemagne et roi de Bohême, il chargea Mozart d’écrire un opéra, la Clémence de Titus, pour son couronnement à Prague. Au moment où Mozart montait en voiture pour se rendre en cette ville, un étranger demanda à lui parler, se disant envoyé par quelqu’un pour commander au compositeur une messe des morts, que l’on désigne sous le nom de Requiem ; Mozart dit qu’il s’en chargerait, mais qu’il ne pourrait préciser l’époque où elle serait terminée, parce qu’il avait beaucoup d’ouvrages à finir, et que sa santé était chancelante. Le messager lui répondit qu’il n’avait pas à s’inquiéter pour le temps ; qu’on attendrait volontiers, et il lui demanda quel prix il mettrait à ce travail. Sur la réponse de Mozart qu’il lui fallait cent ducats, cette somme lui fut comptée sur-le-champ ; et l’étranger lui dit que, quand l’ouvrage serait fini, on achèverait le paiement, attendu que cela valait davantage. Il refusa de donner aucune adresse à Mozart, ajoutant que l’on viendrait prendre la partition.
Après avoir eu un succès colossal à Prague, avec une ardeur qui ressemblait à un pressentiment, le maître commença cette messe. Épuisé par tant de veilles, de fatigues, de tourments, sa santé s’altéra de plus en plus, et il était si sombre, si concentré en lui-même, que sa femme lui en demanda la cause ; il lui avoua alors qu’il croyait qu’on lui avait fait prendre un poison lent, et qu’il ne doutait pas qu’il écrivit ce Requiem pour lui-même. Elle mit tout en œuvre pour le dissuader d’une telle pensée ; elle alla même jusqu’à lui cacher son Requiem, qu’elle ne lui rendait que quand il se sentait mieux. Ce mieux, qui n’arrivait que par intervalles, était de courte durée. Mozart devint de jour en jour plus faible, et l’idée de sa fin prochaine ne le quitta plus ; il redoubla d’efforts pour terminer l’ouvrage dont il avait reçu le prix, mais il ne put y parvenir. Alité, il travaillait encore, et peu d’heures avant sa mort, il feuilletait la partition ; et alors, s’adressant à sa femme : « Ne t’avais-je pas bien dit que j’écrivais ce Requiem pour moi-même. »
Sa main affaiblie déposa la plume à la fin du Lacrymosa ; ses dernières inspirations s’arrêtèrent sur ces paroles : Seigneur, fais que ces âmes passent de la mort à la vie éternelle. Et l’âme de Mozart était passée à l’éternelle vie. C’était le 5 décembre 1791.
Quant à la sœur de Mozart, qui avait partagé les triomphes de son enfance, le souvenir de la gloire de son frère la fit devenir baronne de Sonnenburg, et elle mourut à Salzbourg, honorée et presque octogénaire.
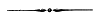
Le jour commençait à paraître ; le soleil répandait dans le ciel ses rayons de pourpre ; les gouttes de rosée scintillaient brillantes comme des diamants, sur les feuilles vertes des arbres et dans le calice des fleurs. Les oiseaux saluaient le retour de la lumière, par leurs accents mélodieux, et s’élançaient dans l’air qu’ils fendaient de leurs ailes. Tout annonçait une de ces belles journées de printemps, où la nature entière se réveille du long sommeil de l’hiver, toujours plus belle et plus admirable.
Les paysans sortaient peu à peu des fermes pour reprendre les travaux de la veille. La route de Lisieux à Givet commençait à se couvrir de voyageurs qui se rendaient à la foire.
Parmi les plus diligents, on voyait un jeune homme, qui, malgré le lourd fardeau placé sur son dos, marchait d’un pas ferme et rapide. Un énorme sac en cuir était retenu sur ses épaules par des courroies ; un bâton noueux servait à soutenir son corps penché en avant. La figure du jeune porte-balle avait un caractère de franchise et de douceur qui prévenait en sa faveur. Aussi, tous les paysans, en le voyant passer sur la route, lui adressaient-ils un bonjour plein de cordialité.
« Eh bien ! Laurent, vous voilà donc dans ce pays, lui dit un gros fermier en s’approchant.
— Oui, père Lucas, j’arrive de la Bretagne, et j’ai voulu revoir votre belle Normandie.
Le Marchand forain.
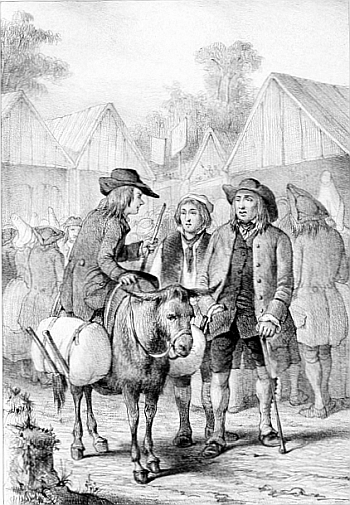
| Lith. de Cattier | |
| Oui, père Lucas adieu! allons, Luc en avant mon ami. | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.
— Et jarni, t’as bien fait, mon garçon, car on t’aime dans ce pays. Les jeunes filles ne veulent plus porter que de tes chiffons. Tiens, l’autre jour, ma petite Françoise voulait avoir une coiffe. Comme j’allais à la ville, je lui promis de lui en rapporter une. Ah bah ! me dit la petite malicieuse, celle que j’ai n’est pas encore trop mauvaise ; j’attendrai que M. Laurent passe par ici ; il a toujours de si jolies choses dans sa boutique !
— Mademoiselle Françoise est bien bonne, reprit Laurent en s’arrêtant un instant, pour essuyer la sueur qui ruisselait sur son front.
— Mais, à propos de boutique, la tienne me semble bien lourde aujourd’hui.
— Dam ! oui, père Lucas ; j’ai pas mal de marchandises dedans.
— Ah ! çà, comment as-tu fait tes affaires en Bretagne ?
— Pas trop bien... Le pays est pauvre, et puis on y parle une langue si baroque ! ça rend les affaires difficiles. Cependant, j’ai gagné un peu d’argent.
— Sais-tu ce que tu devrais en faire ?
— Dam ! j’ai bien une idée ; mais dites-moi la vôtre, peut-être bien qu’elle sera meilleure.
— Mon idée à moi, c’est que tu devrais acheter un âne pour porter ta balle ; tu te fatiguerais moins, tu pourrais aller plus vile, et augmenter tes marchandises.
— Tiens... tiens... Mais votre idée, c’est la mienne.
— Eh bien ! pourquoi ne la mets-tu pas à exécution ?
— C’est que c’est bien cher, un âne.
— Combien as-tu d’argent ?
— Cent francs, et toutes les marchandises qui sont dans ma balle.
— Eh bien ! Laurent, tu es un brave garçon. Il y a déjà quatre ans que je te connais. Je t’ai vu commencer le métier, tu étais bien jeune encore. Je me suis dit alors : Voilà un bon diable qui prend un métier bien dur, voyons comment il ira. Je me suis informé de toi partout où je suis allé, et partout j’ai entendu dire : « Laurent est un brave garçon, il travaille avec courage, il est honnête, il mérite de réussir. » Ça m’a fait plaisir, parce que j’avais deviné que tu serais un honnête homme. Tiens ! donne-moi la moitié de ce que tu as d’argent, et je me charge de l’âne en question.
— Merci, monsieur Lucas,... mais je crains... Mon travail.
— Ce n’est pas l’aumône que je te fais, Laurent... c’est de l’argent que je t’avance ; tu me le rendras, quand tu pourras.
— Oh ! merci, mon bon monsieur ; comme cela, j’accepte de grand cœur.
— En attendant l’âne, voici ma charrette que Jacquot, mon garçon de ferme, conduit en avant ; mets ta balle dedans : ça te reposera. »
Laurent détacha son gros sac de cuir et le plaça dans la charrette, puis il revint près de Lucas, qui continuait sa route.
« Eh bien ! te voilà plus léger maintenant.
— Dam ! c’est que ça n’est pas du liége ; grâce à vous, je ne me fatiguerai plus autant. Comment ai-je pu mériter tout cela ?
— Je vais te le dire, mon ami, car enfin il ne faut pas que j’aie l’air de faire de la générosité, quand je m’acquitte d’une dette. « Il y a deux ans, aux fêtes de Pâques, je m’absentai pour aller chercher un nouveau garçon de ferme, afin de remplacer Louis que j’avais renvoyé. Ma vieille mère se trouvait seule avec les enfants, car, tu le sais, j’avais déjà perdu ma femme. La nuit était froide, et les mioches s’étaient fourrés sous le manteau de la cheminée pour avoir plus chaud. Des sarments de vigne brûlaient dans le foyer. Ma vieille mère racontait aux enfants une de ces histoires qu’elle sait si bien dire. Ils écoutaient avec attention son récit, lorsque tout à coup des cris se font entendre. Ma mère court à la fenêtre. Elle voit deux hommes qui luttent avec acharnement. L’un d’eux tient à la main une branche enflammée, et veut la jeter dans le grenier à foin. L’autre essaie de lui arracher ce tison. La lutte fut terrible ; l’un des deux hommes tomba enfin. C’était l’incendiaire. L’autre jeta, dans l’eau de la mare aux canards, le tison enflammé et, relevant son adversaire, il l’entraîna vers la route.
« Ma mère reconnut Louis, notre ancien garçon de ferme. Pour se venger d’avoir été chassé, il venait mettre le feu à notre chaumière. Elle ne put distinguer les traits de l’autre individu. Quand je revins, elle m’apprit ce qui s’était passé. Je cherchai à savoir le nom de celui à qui je devais la vie de ma mère et de mes enfants, ainsi que ma fortune ; je le demandai partout, mais je ne pus le découvrir. Je sus seulement que tu étais alors dans le pays, et que tu avais disparu, la nuit même de cette tentative criminelle. Depuis ce temps, Laurent, je n’ai point passé un seul jour sans prier le ciel pour toi, et sans demander à Dieu qu’il te ramenât dans ce pays... car c’est toi, n’est-ce pas Laurent, c’est toi qui nous a sauvés ?
— Oui, père Lucas, c’est moi ; je puis le dire maintenant sans manquer à ma parole. Cette nuit-là, je revenais de Lisieux, et j’avais pris un chemin de traverse pour abréger la route. Le ciel était sombre, et je marchais avec peine, lorsque passant devant votre ferme, j’aperçus une vive clarté. Je m’avançai rapidement, et je vis un homme qui cherchait à jeter un tison ardent dans votre grenier à foin, dont une des fenêtres était restée ouverte. Dès que je compris ses intentions, je jetai bien vite ma balle sur la route, et m’élançai vers lui. Après l’avoir terrassé, je l’aidai à se relever et l’emmenai ; je lui montrai tout ce que sa conduite avait de criminel ; je l’épouvantai, en lui disant quel châtiment l’attendait ; je lui rappelai les bontés que vous aviez eues pour lui... Quand j’eus fini, sa colère avait disparu ; la honte et le repentir étaient entrés dans son âme. Il se jeta à mes genoux, me suppliant de ne pas le perdre. Je consentis à garder le silence, à condition qu’il quitterait le pays. Le lendemain, il s’engageait dans un régiment qui partait. Il y a un mois, j’ai appris qu’il était mort glorieusement, en combattant pour la France.
— Puisse Dieu lui pardonner, comme je lui pardonne ! mais toi, comment puis-je reconnaître ce que tu as fait pour moi ?
— En me donnant votre amitié, père Lucas et en me prêtant ce qu’il me faut encore pour avoir un âne.
— Je te donnerai dix ânes, si tu veux ! s’écria Lucas...
— Merci, je n’en ai besoin que d’un, dit Laurent en serrant la main du fermier. »
En arrivant à la foire de Givet, Lucas raconta à ses amis qu’il avait enfin trouvé celui qui l’avait sauvé d’une ruine certaine. Le nom de Laurent circula de bouche en bouche, accompagné d’un concert unanime d’éloges. Chacun s’empressa de lui témoigner, à sa manière, l’admiration qu’inspirait sa belle conduite. A peine eut-il étalé sur la place, les marchandises que contenait sa balle, que les acheteurs se présentèrent en foule. Bien avant la fin du jour, il n’avait plus rien dans sa boutique ; en revanche, sa poche pouvait à peine contenir tous ses écus.
Laurent devait cette vente rapide, non pas tant à la bonne qualité de ses marchandises, qu’à l’intérêt qu’avait excité en sa faveur l’histoire du père Lucas, car, bien souvent, il était venu à la foire avec des objets plus beaux et moins chers, sans avoir pu les vendre. C’est ainsi qu’une bonne action trouve toujours sa récompense. Tous les honnêtes gens s’empressent de favoriser les entreprises de celui dont ils connaissent la droiture, tandis qu’ils repoussent avec mépris ceux qui se conduisent mal.
Vers la fin de la journée, Lucas vint trouver Laurent. « Eh bien ! mon garçon, lui dit-il, j’ai fait ton affaire.
— Où donc se trouve mon nouveau compagnon de route.
— Le voilà, dit le fermier en faisant signe à son valet d’approcher avec l’âne qu’il tenait par la bride.
— Merci, père Lucas, vous êtes un brave et digne homme, et je soignerai bien cette pauvre bête, parce que je la tiens de vous.
— Fais plus encore, Laurent : donne-lui un nom qui me rappelle sans cesse à ton souvenir.
— Allons donc, y pensez vous ?
— La jeunesse est légère, oublieuse ; et je serais fâché, si tu venais à ne plus te rappeler que tu as en moi un ami dévoué. Tiens, je crois que le nom de Luc lui convient.
— Puisque vous le désirez.
— C’est convenu. Adieu, mon ami, bon voyage ; si tu as besoin de quelque chose, si les affaires ne vont pas, car dans ce misérable temps, on ne peut compter sur rien, écris-moi un mot, et tu auras de mes nouvelles.
— Oui, père Lucas, adieu !... Allons, Luc en avant, dit le porte-balle, en s’installant sur le bât de son âne ; et tous deux, l’un portant l’autre, ils prirent le chemin de Lisieux.
La nuit était venue, et la lune se montrait en plein, au milieu d’un ciel étoilé. Depuis longtemps la foire était finie, et l’on ne rencontrait plus sur la route que quelques paysans attardés, hâtant le pas pour regagner leur logis. Laurent s’en allait doucement sur son âne, et pensait à tout ce qui lui était arrivé. Involontairement il en vint à se rappeler ses premières années.
Son père, pauvre fermier des environs de Givet, était mort, laissant sa femme et son fils dans la misère. Les orages avaient détruit ses moissons, le feu avait dévoré sa grange ; et malgré son travail assidu, il était mort, laissant de grosses dettes. Sa femme le suivit de près dans la tombe, et Laurent resta seul au monde, sans ressource et sans asile.
Il alla demander de l’ouvrage aux fermiers voisins, et bientôt il put économiser quelque argent. Il avait vu souvent des marchands forains venir, dans la campagne, offrir des objets de toilette et de ménage. L’idée lui vint de faire ce métier. Il acheta des bretelles, des boutons, du fil, des aiguilles, et se mit en route. Peu à peu il gagna assez pour pouvoir augmenter sa petite pacotille.
Les fabricants, enchantés de son honnêteté, l’aidèrent en lui faisant des avances qu’il leur rendait aussitôt la vente. Avec l’argent qu’il possédait en ce moment, Laurent comprit qu’il pouvait acheter beaucoup de choses qui lui manquaient à ses autres voyages, et gagner, à force d’ordre et d’économie, la nourriture de maître Luc.
Pendant qu’il faisait ses réflexions, l’âne avançait toujours. Mais soudain il s’arrête au milieu du chemin ; Laurent, voyant la route libre, veut le forcer à marcher, mais Luc refuse obstinément. Le marchand forain descend et aperçoit à ses pieds une corbeille. Il se penche, la découvre, et voit un petit enfant qui sourit en lui tendant les bras.
« Qu’est-ce que ça veut dire ? Pourquoi cet enfant est-il là, seul, à cette heure, au milieu de la route ? Tiens !... un billet. »
Laurent détache un morceau de papier attaché sur le berceau. A la clarté de la lune, il lit ces mots écrits d’une main tremblante : « Qui que vous soyez, ayez pitié de l’enfant, secourez-le, sauvez-le d’une mort certaine ; c’est sa mère qui vous en supplie. »
« Est-ce que je rêve, dit Laurent, en passant la main sur son front, pour rappeler ses idées ; mais non, voilà la route de Givet, voilà mon âne,... voilà cet enfant... Mon Dieu, que faire ? Je ne peux pourtant pas le laisser-là ; la nuit est froide, il mourrait. Allons, puisque le ciel me l’envoie, gardons-le. Mais sa mère... comment l’a-t-elle abandonné ? Enfin, que Dieu lui pardonne. Après tout, je suis seul au monde, je n’ai plus de famille... Eh bien ! je travaillerai pour ce pauvre innocent, je l’élèverai, j’en ferai un honnête homme... N’est-ce pas, mon garçon ? »
On eût dit que l’enfant comprenait ces paroles, car il souriait avec tendresse, et ses petites mains caressaient la figure de Laurent.
« Allons, c’est bien ; tu me promets d’être sage. Mais... tiens... voilà que j’oublie le principal. Ah ! ça, mais s’il a faim, je ne puis pourtant pas lui donner une saucisse sur une croûte de pain ; ça devient embarrassant. Oh ! une idée !... le père Lucas a des enfants ; sa mère sait comment on les élève : je vais le mettre en pension chez lui. »
Laurent monta sur son âne, prit la corbeille dans ses bras, et se dirigea vers la ferme de Lucas. Après une demi-heure de marche, le marchand forain descendit à la porte du fermier. Les chiens de garde hurlèrent avec force, mais Laurent les apaisa. Ce bruit réveilla Lucas ; il mit la tête à la fenêtre : « Holà ! qui vient à cette heure ? passez votre chemin, ou je vous chasse à coup de fusils. — C’est moi, père Lucas. — Qui, toi ? — Eh bien ! Laurent, pardin’! — Attends, mon garçon, je suis à toi. »
« Qu’est-ce qu’il y a ? demanda le fermier, en ouvrant la porte.
— Il y a un petit enfant qui vient de pousser devant moi, sur la route.
— Ah bah ! voyons : raconte-moi ça. »
Laurent dit au fermier comment il avait trouvé la corbeille.
« C’est singulier, reprit Lucas, quand il eut fini. Mais enfin, le voilà, et il ne faut pas qu’il meure de faim.
— C’est ce que j’ai pensé. Je suis venu vers vous pour vous le confier, car mon genre de vie lui conviendrait peu. Si vous y consentez, votre mère l’élèvera ; mais j’entends qu’il ne soit pas à votre charge, je veux payer sa dépense.
— Allons donc ! il sera traité ici comme toi, et ne paiera rien.
— Alors, je vais l’emporter ailleurs ; je gagne assez d’argent pour nourrir mon enfant.
— Eh bien ! c’est convenu.
— Adieu, père Lucas ; soignez bien mon garçon.
— Sois tranquille ; mais il y a une chose qui m’embarrasse.
— Quoi donc ?
— Comment allons-nous l’appeler ?
— Ah ! dam’, je n’y ai pas pensé. Tiens, pardin’, donnons-lui le nom du saint dont c’est aujourd’hui la fête ?
— Mais tu sais bien qu’il n’y a plus de saints, depuis que la Convention les a destitués.
— Ah ! c’est juste. Eh bien ! il se nommera Trouvé.
— Va donc pour Trouvé.
— Adieu, petit garçon ; sois bien sage, et surtout porte-toi bien. C’est drôle, je l’aime déjà... Adieu père Lucas. »
En ce temps-là, mes enfants, la France que vous voyez aujourd’hui heureuse et tranquille, était agitée par les discordes civiles. Le peuple s’était soulevé ; et poussé par des hommes sanguinaires, il abusait de sa victoire, en se livrant aux plus horribles excès.
Demandez à vos pères, qui vécurent dans ces temps de deuil... demandez-leur ce qu’ils ont souffert, et ils vous raconteront de tristes et cruelles histoires. Alors, il suffisait de posséder quelque chose pour mériter la mort. La noblesse, la vertu, la fortune, étaient des crimes. — La religion, foulée aux pieds, voyait ses ministres poursuivis, condamnés, et ses temples profanés. — Partout les paysans se révoltaient contre leurs seigneurs, et pillaient les châteaux. C’était un triste spectacle que celui-là. Aussi, tous les honnêtes gens s’empressaient-ils de fuir.
Un soir du mois de mai 1793, trois personnes étaient réunies dans une salle basse du château de la Gartinière. L’une d’elles était un vieillard ; ses cheveux blancs couvraient à peine sa tête dégarnie ; ses yeux, affaiblis par l’âge, restaient presque constamment fermés. Il se tenait couché plutôt qu’assis dans un grand fauteuil en tapisserie.
Près de lui une femme, jeune encore, faisait à la hâte des préparatifs de départ. Sa figure ressortait pâle sous ses cheveux noirs comme le jais. Ses regards inquiets se portaient tantôt sur le vieillard, tantôt sur un berceau placé dans l’angle de la chambre. « Mon père ! mon enfant ! » dit-elle, avec une expression déchirante, et elle s’assit en pleurant.
Un coup frappé à la porte la fit sortir de l’accablement dans lequel elle se trouvait. Elle s’avança rapidement vers un homme qui se tenait sur le seuil. « Eh bien ! Pierre, dit-elle avec anxiété. — Il faut fuir, madame. — Alors, demain nous partirons au lever du soleil. — Ce soir, madame, cette nuit même, et sans attendre, car dans une heure... — Dans une heure... — Il ne sera plus temps. Les paysans révoltés ont pris les armes. Déjà, depuis ce matin, ils ont pillé plusieurs châteaux des environs, et cette nuit... — Eh bien ! cette nuit... — Ils doivent venir brûler le château de la Gartinière. — Grand Dieu ! que faire ! seule ici, avec mon père et mon enfant ! comment les sauver ? — En fuyant. — Mais je suis faible, souffrante. Mes forces épuisées ne pourront me soutenir. — Il le faut pourtant, car sans cela, madame, vous êtes perdue. Mais comptez sur moi, je ne vous abandonnerai pas ; je connais le pays, je vous servirai de guide. Tenez, voilà des vêtements que j’ai apportés ; vous allez les mettre, afin qu’on ne puisse vous reconnaître. — Merci, Pierre, merci, mon ami. — Allons, madame la comtesse, hâtez-vous ; je vais tout préparer pour votre fuite ; dans une heure je suis de retour. »
La comtesse de la Gartinière revêtit aussitôt le costume de paysanne que Pierre s’était procuré, puis elle s’approcha de son père. « Mon père, dit-elle, d’une voix émue.
— Que veux-tu, Louise ? demanda le vieillard, en se redressant un peu.
— Mon père, il faut que nous partions.
— Partir... Et pourquoi ?
— Notre vie est menacée. Les paysans des environs se sont révoltés, ils vont venir ; la fuite seule peut nous sauver.
— Pars, Fanny, pars avec ton enfant. Mes yeux affaiblis ne peuvent me conduire ; mes jambes plient sous moi... pars, ma fille ; laisse-moi seul ici ; ma vie touche à son terme ; je croyais avoir quelques jours devant moi, mais l’heure a été avancée ; je suis prêt.
— Oh ! croyez-vous que je puisse vous abandonner, quand la mort vous menace ! Si je tiens à la vie, c’est pour vous, c’est pour ce pauvre enfant qui n’a plus de père. Si vous restez, je reste avec vous et je partage votre sort. Mais, au nom du ciel... pitié pour mon fils, arrachez-le à la mort, cet enfant qui ne connaît de la vie que la tendresse d’une mère... Au nom de votre amour pour moi, sauvez mon fils.
— Je vais te suivre, ma fille, dit le vieillard en se levant ; et une larme brilla dans ses yeux.
— Madame la comtesse est-elle prête ? demanda Pierre.
— Oui, mon ami.
— Vous n’oubliez rien ?
— Non, j’ai de l’or, des bijoux. Allons, mon père... et toi, mon pauvre enfant... Je ne sais, mais un triste pressentiment m’agite... une horrible pensée glace mon cœur. Mon fils... mon fils, s’écria la comtesse en pressant l’enfant contre son sein. »
Puis, cette pauvre mère s’approcha d’un antique bureau, et, d’une main tremblante, traça quelques mots sur un papier.
« Que fais-tu donc, ma fille ? demanda le vieillard.
— J’assure le sort de mon enfant.
— Allons, madame, la nuit s’avance ; j’entends déjà des cris. » Un sourd murmure grondait, en effet, dans le lointain ; c’était comme le bruit des flots de la mer agitée.
La comtesse prit son enfant dans ses bras ; Pierre soutint le vieillard, et ils sortirent ainsi, tremblants, éplorés, de ce château dont ils étaient les maîtres.
A mesure qu’ils avançaient, les cris des paysans devenaient plus forts. Bientôt ils virent cette troupe hideuse, éclairée par des torches, se diriger vers le château. Blottis derrière un buisson, ils attendirent qu’ils fussent passés.
« Ils sont enfin partis, les scélérats, dit la comtesse en se relevant.
— Pas encore, cria une voie rude. »
Une vive lumière brilla dans la nuit obscure ; une détonation se fit entendre, et la comtesse tomba sanglante aux pieds de son père.
« Misérable ! » s’écria Pierre, et il s’élança sur les pas de l’assassin. Quelques instants après, il revint ; ses mains étaient teintes de sang.
Le vieillard, penché sur sa fille, essayait en vain de la ranimer. A la clarté de la lune, Pierre chercha à découvrir la blessure de madame de la Gartinière. La balle lui avait cassé le bras. Il déchira son mouchoir et banda la plaie afin d’arrêter l’effusion du sang. « Que faire ? se dit-il alors... Que faire avec ce vieillard épuisé, cet enfant sans force, cette femme évanouie ? Que devenir ? sauvons la mère, et confions l’enfant à la Providence. »
Pierre releva alors la corbeille, que la comtesse avait laissé tomber en perdant connaissance, et vint se placer sur le bord de la route. Il vit au loin — car la lune éclairait le chemin — Laurent qui s’avançait sur son âne. « Dieu merci, voici quelqu’un ! »
Il posa la corbeille au milieu du chemin, et revint se cacher. Quand le marchand forain eut pris l’enfant, Pierre partit en courant, et rejoignit les deux proscrits.
« Allons, monsieur le marquis, dit-il au vieillard, un peu de courage. Suivez-moi. Je vais porter madame la comtesse dans mes bras et nous la sauverons.
— Ma pauvre fille ! » murmura le vieillard qui semblait avoir perdu la raison.
Après deux heures d’une course pénible, ils arrivèrent à Lisieux. Le lendemain, dès le point du jour, Pierre se remit en route, conduisant dans une petite charrette ceux qu’il servait avec tant de zèle. La comtesse avait demandé son enfant, et Pierre lui avait dit qu’il l’avait confié à quelqu’un de sûr, qui devait en prendre soin.
La pauvre femme, occupée de son père, dont l’état lui inspirait les craintes les plus vives, épuisée elle-même par les souffrances qu’elle éprouvait, comprit l’étendue de son malheur et jeta un douloureux regard vers le ciel.
Après bien des fatigues et des dangers, les fugitifs arrivèrent sur le bord de la mer ; une barque de pêcheur les conduisit en Angleterre. Le premier soin de la comtesse fut de renvoyer Pierre en France. Elle lui donna de l’or pour faire son voyage, et le pria de ramener son fils auprès d’elle.
Le fidèle serviteur s’embarqua sur un petit navire, qu’il loua fort cher, car la guerre, qui existait entre l’Angleterre et la France, rendait l’approche de nos côtes dangereuse. L’équipage du bâtiment était composé d’hommes avides de butin, et chez lesquels n’existait aucun sentiment d’honneur. Ils crurent que Pierre possédait beaucoup d’argent. Un soir donc qu’il dormait dans son hamac, ils se précipitèrent sur lui, le poignardèrent et le jetèrent à la mer, après s’être emparé de ce qu’il possédait.
Mais ils ne profitèrent pas de leur crime, car, cette nuit-là même, le vent ayant soufflé avec violence, le navire fut entraîné vers les côtes et se brisa sur les rochers de Cherbourg. Le lendemain, on retrouva les cadavres de ces misérables sur la grève.
Plusieurs années s’étaient écoulées depuis le jour où Laurent, revenant de la foire de Givet, avait recueilli le pauvre enfant abandonné. Élevé chez Lucas, Trouvé avait été traité comme les enfants du fermier. Son père adoptif venait souvent le voir, et, chaque fois, il lui rapportait quelques souvenirs de ses voyages.
La bonne action de Laurent lui avait porté bonheur. Son commerce s’était étendu, et Luc, trop vieux pour continuer utilement son service, avait été remplacé par deux petits chevaux, qui traînaient aisément une voiture bien approvisionnée.
Lorsque Trouvé eut atteint l’âge de quatorze ans, Laurent commença à lui faire faire quelques courses avec lui. Ses forces s’accrurent, ses membres se développèrent, et il devint grand et vigoureux : le marchand forain l’aimait comme son enfant, et, chaque jour, il remerciait le ciel de le lui avoir envoyé.
La France était alors plus tranquille à l’intérieur. Un homme de génie, Napoléon, l’avait tirée de l’abîme dans lequel elle était plongée. Ses ennemis l’écrasaient de toutes parts ; il les dispersa et fit partout triompher ses armes. Mais ses succès excitèrent enfin la haine des nations. La guerre fut déclarée, et l’empereur paya ses victoires au prix du sang d’un grand nombre de soldats. Il en demanda de nouveaux à la France, et tous les hommes en état de porter les armes répondirent à son appel.
Laurent essaya de soustraire Trouvé au sort commun, mais il ne put y réussir. Son fils adoptif fut incorporé dans un des régiments de la jeune garde impériale.
Après chaque campagne, Trouvé revenait vers son père et passait auprès de lui le temps dont il pouvait disposer. Sa conduite avait été si bonne, son courage s’était montré dans tant d’occasions, qu’à vingt-trois ans il était capitaine et portait sur sa poitrine l’étoile des braves.
Mais la fortune qui, pendant quinze ans, avait favorisé l’empereur, l’abandonna tout à coup. La France, épuisée d’hommes et d’argent, ne pouvait résister aux armées de l’Europe entière : il fallut céder.
Un jour de l’année 1814, une compagnie de grenadiers de la garde se trouvait à quelques lieues de Fontainebleau. Elle occupait un poste d’avant-garde, que commandait un jeune capitaine, pour lequel tous les soldats montraient un profond respect : c’était Trouvé !
Laurent avait cessé son commerce de marchand forain, et habitait Paris. Ayant appris que son fils se trouvait dans les environs, il était venu passer quelques jours avec lui. Ils se promenaient, tous les deux, en causant des grands événements qui se passaient alors, quand ils virent venir de loin une chaise de poste, que traînaient trois chevaux maigres et poussifs ; un nuage de poussière s’élevait derrière elle et s’en approchait rapidement. Bientôt ils purent distinguer un parti de Kalmouks qui s’avançaient, bride abattue.
Trouvé devina leurs intentions. Il appela quelques-uns de ses soldats et marcha vers la chaise de poste. Au moment où il allait l’atteindre, les Kalmouks l’entourèrent ; le postillon tomba percé d’un coup de lance, les traits des chevaux furent coupés et les barbares ouvrirent la portière de la voiture. Une femme âgée s’y trouvait seule. Elle portait sur sa figure les traces que laisse une profonde douleur. Elle portait le deuil. Les Kalmouks la saisirent brusquement et la jetèrent sur la route.
A ce moment, Trouvé arrivait avec ses soldats ; il se précipita sur les pillards et, après un combat acharné, il parvint à les mettre en fuite, laissant plusieurs des leurs sur le champ de bataille.
La voyageuse attendait, résignée, l’issue du combat.
« Vous êtes blessé, monsieur, s’écria-t-elle en s’élançant vers le capitaine.
— Non, madame, ce n’est qu’une égratignure, et demain, il n’y paraîtra plus.
— Comment vous remercier, monsieur, de ce que vous avez fait pour moi !... je vous dois la vie.
— C’est bien, mon garçon, c’est bien, dit Laurent qui arrivait avec un renfort de troupes. Tu as si vite expédié ces gueux-là, que j’arrive pour le dessert. Enfin, c’est égal... je t’ai vu combattre, et je suis fier de toi, mon fils !
— C’est votre fils ! reprit la voyageuse en laissant couler une larme de ses yeux. — Oui, madame. — Oh ! vous êtes bien heureux ! — Vous pleurez, dit Trouvé avec émotion.
— Pardon, monsieur, c’est un bien triste souvenir. J’avais un fils. Il serait de votre âge, grand, fort, courageux comme vous, peut-être... mais il est mort.
— Il est mort ? demanda Laurent.
— Mort ! oh ! par pitié, ne prononcez pas ce mot, car j’espère encore. Et cependant, depuis vingt-trois ans, je ne l’ai pas vu. Je suis seule au monde, monsieur ; je n’ai plus de parents. Eh bien ! je vous demande en grâce de partager ma fortune avec vous. Je vous dois la vie. Laissez-moi acquitter une dette sacrée... Si je retrouve mon fils, je lui donnerai ce qui me restera.
— J’ai fait mon devoir, madame, et je ne puis recevoir...
— Je comprends vos scrupules, monsieur, et je vous estime encore plus. Mais au moins, faites-moi connaître votre nom, afin que je puisse bénir chaque jour mon libérateur.
— Trouvé, capitaine de la garde impériale.
— Trouvé ! dit la voyageuse, en regardant fixement le jeune officier. Puis, après quelques instants, elle continua : Si jamais vous venez en Normandie, ne passez pas devant le château de la Gartinière sans vous y arrêter.
— La Gartinière ! fit Laurent avec étonnement.
— Est-ce que vous connaissez ce pays ? demanda vivement la pauvre dame.
— Oui... oui, madame, répondit en hésitant le marchand forain.
— Et vous, monsieur Trouvé ?
— J’ai passé mon enfance à quelques lieues de là.
— Chez votre père.
— Non, madame, chez un bon fermier auquel il m’avait confié.
— Ah ! pardon, si je me montre si curieuse, mais quel âge avez-vous ?
— Vingt-trois ans, madame.
— Vingt-trois ans ! » la voyageuse tressaillit.
— Au nom du ciel, qu’avez-vous, madame ? demanda Trouvé, en soutenant la pauvre femme, que ses forces abandonnaient.
— Vingt-trois ans !... Il y a vingt-trois ans que j’ai perdu mon fils.
— Habitiez-vous alors la Normandie ? demanda Laurent.
— Vous savez, monsieur, dans quel état se trouvait alors la France. Les paysans s’étaient soulevés ; ils se dirigeaient vers notre château pour le brûler. Je partis, la nuit, avec mon père et mon fils ; un guide fidèle dirigeait notre marche. Un de ces misérables révoltés me blessa d’un coup de feu ; je tombai sans connaissance. Lorsque je revins à moi, j’étais à Lisieux, seule avec mon père ; mon enfant avait disparu. Le guide me dit qu’il l’avait confié à des mains sûres. Nous parvînmes à gagner l’Angleterre. Je renvoyai mon fidèle serviteur en France, pour me ramener mon enfant. Depuis ce temps, je n’ai plus entendu parler ni de l’un, ni de l’autre.
— Êtes-vous bien sûre que votre guide ne vous ait pas trompée ? — Je le crois.
— Peut-être a-t-il abandonné l’enfant. Mais, dans ce cas, n’avait-il aucun signe qui pût le faire reconnaître ?
— En partant du château, j’écrivis, à tout hasard, quelques mots que j’attachai sur sa corbeille.
— Grand Dieu !... Veuillez tracer quelques lignes sur ce papier, dit Laurent en présentant un crayon à la voyageuse.
— Mais pourquoi cela ?
— Écrivez, madame, au nom du ciel, écrivez ! »
Quand la voyageuse eut fait ce que Laurent désirait, il tira soigneusement de sa poche, un portefeuille rempli de papiers, et en prit un soigneusement enveloppé dans un morceau de parchemin.
« C’est cela... c’est bien cela, fit-il en comparant les deux écritures. Madame, reconnaissez-vous ce papier ?
— Ce papier... Mais c’est celui que j’attachai sur la corbeille de mon fils, en quittant le château... Oh ! dites-moi : comment l’avez-vous entre les mains ?... Parlez, monsieur... par pitié, parlez.
— Capitaine, interrompit Laurent, en appelant Trouvé, qui s’était éloigné pour donner des ordres. Capitaine, venez embrasser votre mère. — Ma mère ! — Mon fils ! »
Madame de la Gartinière et son fils tombèrent dans les bras l’un de l’autre.
« Oh ! merci, mon Dieu ! vous m’avez rendu mon fils, s’écria la comtesse en se jetant à genoux.
— Et j’ai perdu le mien, dit tristement Laurent.
— Non, mon père... je suis toujours votre enfant, et jamais je ne l’oublierai. »
Le comte de la Gartinière quitta le service après la guerre, et se retira au château que sa mère avait fait reconstruire. Laurent continua à l’appeler son fils, et resta jusqu’à la fin de sa vie auprès de ses deux amis, auxquels il racontait souvent les aventures qui lui étaient arrivées, quand il était encore marchand forain.

« C’est aujourd’hui 9 avril, de l’an de grâce 1417, le saint vendredi ; si vous m’en croyez, mes frères et mes sœurs, nous ne toucherons pas au déjeuner, nous jeûnerons, disait un enfant de sept ans, d’une figure douce et pâle, à deux garçons plus âgés que lui et deux petites filles de trois et cinq ans, qui tous venaient, en courant et l’air joyeux, prendre place à une petite table, délicatement servie, dans un pavillon du château de Bourdeille, en Périgord.
— Jeûner !... s’écrièrent à la fois les quatre enfants, jeûner ! mais tu es fou, Élie.
— Non, je ne suis pas fou, répondit tranquillement Élie, et la preuve, c’est que tous vous criez, tandis que moi je suis calme et me dis : Comment pouvons-nous penser à nous régaler de cette bonne crème et de cette galette dorée, lorsque, ce même jour, Notre-Seigneur Jésus-Christ a été méchamment mis à mort pour nous racheter de nos péchés...
— Qu’est-ce que c’est que pécher ? mon frère, demanda la plus petite des filles.
Le petit Saint.

| Lith. de Cattier | |
| Bénissez, lui dit-il, votre fils le plus jeune, Madame et chère mère. | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.
— Mariette, c’est désobéir à papa de Bourdeille, et à maman, Jeanne de Chamberlhac, répondit Élie.
— Eh bien ! papa et maman nous ont dit : « Enfants, allez déjeuner ; » donc, il faut obéir, reprit celle-ci étourdiment.
— C’est qu’ils nous traitent en enfants, répliqua Élie, car, eux, ils ne déjeunent pas ce matin.
— Et, en effet, ne sommes-nous pas des enfants, dit Mariette.
— Toi, peut-être, reprit Élie, Jeannette aussi, mais moi, j’ai sept ans sonnés...
— Et tu te crois peut-être un homme ! répliqua le plus grand des frères.
— Certes oui, ou à peu près, Claude, répondit Élie.
— Alors, que suis-je donc moi, qui ai treize ans ?... dit Claude.
— Et moi douze, ajouta le second frère.
— Toi, Claude, toi, Pierre, reprit Élie,... vous êtes... à vrai dire, je n’en sais rien ; mais à coup sûr, moi, je ne suis plus un enfant... Du reste, je crois une chose, c’est qu’on est enfant de deux manières, par l’âge et par le caractère... Eh bien ! j’ai l’âge d’un enfant... Quant au caractère...
— Est-ce que tu as du caractère, toi ?... interrompit Pierre... parce que tu nous prêches le jeûne ?... Allons donc, ne fais pas ainsi le petit saint n’y touche ; ça ne te va pas,... foi de cadet de Gascogne...
— Décidément vous ne venez pas déjeuner, monsieur Élie ? se récria une bonne vieille femme, qui, aidée de trois varlets, venait d’asseoir les enfants à table.
— C’est aujourd’hui vendredi-saint ! ma bonne, c’est jeûne ! répondit le petit Élie.
— Depuis que cet enfant est allé au château d’Agonac, il est tout changé, murmura Jacqueline...
— Il ne pense qu’à Dieu, dit Claude.
— Il voudrait toujours le prier, reprit Pierre.
— Il ne ferait pas le plus petit mensonge pour tous les bonbons du monde, ajouta Mariette.
— Et il n’est plus du tout gourmand, acheva Jeannette.
— Eh bien ! quel mal y a-t-il à tout ça ?... demanda Élie avec calme.
— Certes, il n’y a pas de mal à cela, mon enfant, dit la bonne Jacqueline, c’est même très-bien...
— Pour entrer en religion, ne faut-il pas jeûner, prier,... dit Élie.
— Entrer en religion ! tu veux entrer en religion, Élie, dit une voix douce qui fit retourner la tête à tous les enfants. »
Une jeune femme était derrière eux. Jeune et brune, elle était vêtue d’une robe de damas bleu, doublée de fourrure rose ; un bonnet de gaze, formant un croissant sur son front, descendait par derrière et couvrait presque ses épaules.
Un homme parut presqu’en même temps que cette dame à la porte du salon : au sourire timide qu’elle lui adressa, il était aisé de deviner que c’était son seigneur et maître. Son costume était celui des seigneurs de la cour de Louis XI ; il consistait en une espèce de robe, couleur laque foncée, descendant jusqu’aux genoux, dont les manches beaucoup plus longues que les bras, se terminaient par une fourrure jaune. Son chaperon, sa cornette, la bourse aumônière, pendant à sa ceinture, étaient noirs ainsi que ses souliers-bottines.
A la vue de ce second personnage, qui n’était autre que le baron Arnault de Bourdeille, sénéchal et lieutenant du roi, en Périgord, les enfants se levèrent de table et les varlets ainsi que Jacqueline se retirèrent respectueusement à l’écart.
« Que disait donc Élie, ma bonne amie, demanda le sénéchal.
— Il parle d’entrer en religion, monseigneur, répondit la baronne.
— Claude, en qualité d’aîné, héritera de mes titres et de ma fortune, reprit le baron ; Pierre servira le roi de France ; quant à Élie, il est tout simple, qu’étant le plus jeune, il entre dans les ordres.
— Mais en avoir l’idée déjà, voilà ce qui m’étonne, répliqua la baronne.
— Sans le respect que je vous dois, madame, ainsi qu’à monseigneur, balbutia la bonne vieille, si j’osais parler...
— Parlez, Jacqueline, interrompit la baronne avec bonté, et avec la permission de monseigneur, dites ce que vous savez. »
Le sénéchal ayant fait un signe de consentement tacite : « Eh bien ! ajouta Jacqueline, j’oserais dire que cette idée ne vient pas de cet enfant, qu’elle lui a été soufflée par quelqu’un.
— Qu’as-tu à répondre à cela ? demanda le baron à Élie, qui devint alors rouge jusqu’aux oreilles.
— On ne m’a pas suggéré cette idée, mon seigneur et père, répondit l’enfant.
— Enfin, objecta Jacqueline, c’est depuis votre visite au château d’Agonac, avec madame la baronne...
— Oui, dit Élie.
— C’est singulier, reprit la baronne ! j’étais avec mon fils, et je n’ai aucune souvenance qu’il y eût, ce jour-là, rien d’extraordinaire au château d’Agonac... La comtesse était seule avec le père Bertrant de Combort, de l’ordre des Frères Mineurs.
— C’est précisément ça, répondit naïvement Élie, qui m’a fait dire : Si mon seigneur et père, et si madame ma mère le veulent, j’entrerai en religion.
— Mais le père Bertrant ne t’a pas dit un mot, ce jour-là, répliqua la baronne.
— Aussi, madame ma mère, répliqua l’enfant, ce n’est pas ce qu’il m’a dit, mais ce que j’ai vu...
— Qu’as-tu donc vu ? demanda le sénéchal.
— Un homme avec une belle figure souriante, et de beaux cheveux d’argent, qui marchait, et tout le monde marchait derrière lui ; il levait ses mains blanches, et toutes les têtes des hommes, des femmes, des enfants, se baissaient sous ces mains blanches ; puis on aurait dit qu’il y avait des bénédictions dans tous les plis de son manteau, car chacun voulait toucher ce manteau, et ceux qui le touchaient, paraissaient bien heureux.
— Et sais-tu, mon fils, pourquoi cet homme était suivi, et pourquoi sa présence causait tant de plaisir à ceux qui le voyaient ? demanda son père.
— Oui, mon seigneur et père, répondit Élie sans hésiter, c’est parce que le père Bertrant est un saint.
— Eh ! tu veux être saint, toi ? demanda la baronne ; et sais-tu ce qu’il faut faire pour cela ?
— Prier, jeûner, et faire l’aumône...
— Mais pour prier, répliqua son père, il faut comprendre Dieu ; pour jeûner, il faut préférer son âme à son corps ; pour faire l’aumône, il faut aimer son prochain comme soi-même.
— Puis encore être prêtre, acheva Élie, c’est pour cela que je veux le devenir !
— Et aller se renfermer dans un couvent ? lui dit son père.
— Sans doute, reprit l’enfant.
— Et nous quitter, mon fils ? ajouta la baronne avec un tel accent de sensibilité que les larmes en vinrent aux yeux d’Élie.
— Je le sais, dit Élie, et cela me causera un grand chagrin, mais un peu plus tôt, un peu plus tard.
— Comment ? interrompit son père.
— Je ne suis pas l’aîné, moi, poursuivit Élie ; Claude sera baron de Bourdeille et sénéchal ; il portera le nom de notre père, et il aura son château, ses terres,... mais Pierre et moi, nous devons chercher fortune ailleurs...
— Serais-tu donc jaloux, mon fils ? reprit vivement son père.
— Jaloux de mon frère aîné ! oh ! non... dit Élie ; et sa petite main alla prendre et serrer la main de Claude ; non, je l’aime trop pour cela... Mais puisque je ne serai, moi, que ce que je me ferai, je me ferai saint... et ce titre-là vaut bien celui de sénéchal et baron de Bourdeille, je crois... »
En entendant ces mots, le baron et la baronne échangèrent entre eux un regard qu’Élie interpréta d’une manière défavorable. « Oh mon Dieu ! s’écria-t-il alors, quand donc aurai-je treize ans, comme mon frère aîné !
— Pourquoi ? demanda sa mère.
— C’est qu’alors on ne douterait plus de ma vocation. Et croyez-le bien, madame ma mère... ce que je veux aujourd’hui, je le voudrai encore demain, après, dans dix ans.
— Eh bien ! je t’en donne trois, moi, lui dit son père ; et si, dans trois ans, tu persistes encore dans la résolution, tu choisiras toi-même le couvent dans lequel tu voudras entrer.
— C’est dit ? demanda Élie, attachant sur le sénéchal un long et inquiet regard.
— C’est dit, reprit gravement le baron. »
Trois ans après, jour pour jour, Élie entre le matin dans la chambre du baron, qui passait ses bottes pour monter à cheval ; il y avait une grande partie de chasse dans la forêt voisine.
« Je vois à ton air, Élie, que tu as quelque chose à me demander, lui dit le sénéchal, en le voyant se tenir debout devant lui, et la tête baissée.
— L’exécution de votre promesse, mon seigneur et père, répondit Élie d’une voix ferme.
— Laquelle, reprit le baron comme paraissant chercher dans ses souvenirs.
— Celle de me permettre d’entrer dans les ordres... dit Élie, j’ai choisi le couvent de Saint-François...
— C’est juste, dit le baron d’un air convaincu, un gentilhomme n’a que sa parole... Et quand veux-tu partir ?
— Tout de suite... mon seigneur et père, dit Élie sans hésiter.
— Un moment ! reprit le baron, le fils d’un sénéchal et lieutenant du roi en Périgord, ne peut se rendre au séminaire comme ferait le fils d’un de ses vassaux ; il lui faut une suite convenable, digne de son rang. »
Élie se retira en silence, sur un signe que lui fit son père en achevant ces paroles, et alla s’agenouiller devant un Christ dans la chapelle du château.
Le baron et la baronne, s’étant consultés, se décidèrent à laisser partir Élie pour le couvent des religieux de Saint-François, à Périgueux.
Le jour du départ, toute la noblesse des environs se trouva rassemblée dans la cour du château ; une suite nombreuse d’hommes à cheval devait accompagner l’enfant à sa pieuse destination. Comme l’horloge sonnait dix heures, la baronne parut sur le perron, entourée des dames. Elle avait, à sa droite, le baron en grand costume de sénéchal.
Élie parut bientôt au milieu de ses frères et sœurs ; sa charmante petite tête était nue ; une longue robe blanche, attachée sous le menton, descendait jusqu’à ses pieds. Quand il fut en face de sa mère, il s’avança seul jusque vers la baronne, et s’agenouillant devant elle : « Bénissez, lui dit-il, votre fils le plus jeune, madame et chère mère. »
Ce que fit la baronne, puis se tournant vers sa suite, elle dit : « Qu’on amène la monture de mon fils. »
Au même instant parut un magnifique cheval harnaché richement, conduit par un seigneur.
« Un cheval, fi donc, s’écrie alors Élie, qu’on m’amène un âne.
— Vous n’y pensez pas, Élie, reprit vivement la baronne ! un âne ne convient pas au fils d’un grand seigneur.
— A dater d’aujourd’hui, madame, répondit l’enfant, je dis adieu aux honneurs, aux richesses, à tout ce qui fait la vanité de ce monde... J’appartiens à la classe des pauvres.
— Mais pourquoi un âne ? objecta la baronne...
— Parce que j’entre dans l’ordre des Frères Mineurs de saint François, madame ma mère, répondit Élie.
— Qu’a de commun un âne et saint François ? demanda la baronne.
— Cela tient à l’histoire de ce saint.
— En vérité, mon fils, reprit le baron, vous parlez avec tant de raison, que vous devriez dire à ces dames ce qu’était saint François.
— Avec plaisir, monseigneur mon père, répondit l’enfant, et se tournant vers la noble assemblée, il s’exprima en ces termes :
« Saint François d’Assise s’appelait d’abord Jean ; son nom de François[4] lui vient de ce qu’il parlait si parfaitement la langue des François, qu’on lui en donna le nom ; il naquit en 1182, à Assise, ville d’Ombrie. Son père, Pierre Bernardin, était un riche marchand dont le principal commerce se faisait avec la France ; Dieu avait mis dans l’âme du jeune Bernardin, un grand détachement des choses de ce monde, et une tendre compassion pour les pauvres... Un jour, qu’il parcourait à cheval la campagne, il rencontra un pauvre lépreux dont l’aspect lui inspira un si grand dégoût, qu’il se détourna d’abord de son chemin, mais sentant presque aussitôt qu’il avait tort, et que ce lépreux était un frère en Jésus-Christ, il revint sur ses pas, descendit de cheval, baisa cet homme affectueusement, et lui fit l’aumône. Depuis lors, il visita les hôpitaux des lépreux ; il faisait leur lit, pansait leurs plaies, nettoyait leurs ulcères, et leur parlait de Dieu. La dévotion le porta à faire le voyage de Rome pour visiter les tombeaux des saints apôtres. En sortant de l’église, il vit une foule de pauvres gens mal vêtus ; il eut honte de ses riches habits, et pria l’un de ceux qui lui semblait le plus nécessiteux, de changer de vêtement avec lui ; puis il se retira dans les bois, et, renonçant à l’héritage de son père, il ne voulut plus vivre que d’aumônes ; il quêtait donc pour vivre, et pour réparer les églises, auxquelles il travaillait en outre comme manœuvre ; il rétablit ainsi les églises de Saint-Damien et de Saint-Pierre, situées hors de la ville d’Assise. Il y avait aussi une ancienne chapelle dédiée à Sainte-Marie-des-Anges, abandonnée depuis longtemps, et tellement en ruines, qu’elle ne servait plus que de refuge aux pâtres et à leurs troupeaux ; saint François la releva.
« Un jour qu’on y disait la messe des apôtres, le jeune saint fut frappé de ces paroles de l’Évangile : « N’ayez ni or, ni argent, ni monnaie dans votre bourse ; ne portez en voyage, ni sac, ni deux tuniques, ni chaussure, ni bâton. » Il lui sembla que ces paroles venaient du ciel ; aussitôt il jeta sa bourse avec mépris, quitta sa besace, ses souliers, son bâton, et se vêtit d’une tunique d’étoffe grossière, fortement serrée autour de la taille par une grosse corde. Cette ceinture, de nouvelle espèce, fit donner plus tard aux religieux de son ordre le titre de Cordeliers.
« Saint François, qui n’eut d’abord que trois disciples, ayant fini par en avoir cent vingt-sept, leur composa une règle, qui était de n’avoir rien en propre, de ne pas rougir de mendier, de s’assujétir à un travail pénible quelconque, sans salaire autre que celui de la nourriture ; leur mission était de prêcher, et de convertir les infidèles. Il donna, à son ordre, le titre de Frères Mineurs. »
— C’est l’ordre que j’ai choisi, monseigneur et père, acheva Élie ; et c’est pour me conformer à la règle que je veux, comme saint François, la plus humble des montures pour me conduire au couvent. »
Ce fut donc ainsi monté qu’Élie se rendit au couvent des religieux de Saint-François de Périgueux, où il fit son noviciat, et où il étudia la philosophie ; de là on l’envoya en théologie dans le grand couvent de l’Ordonnance à Toloze, où, à l’âge de dix-neuf ans, il témoigna de la rareté de son esprit, en soutenant, durant huit jours, les thèses du chapitre général, célébré en ce lieu ; puis il fut conduit au couvent réformé de Mirepoix, où parurent ses premières publications. L’an 1447, l’évêché de Périgueux étant venu à vaquer par la mort de Geoffroy Berengarius, les chanoines l’élurent pour leur évêque. Élie ne voulait pas accepter, mais pour qu’il ne pût se dégager, on députa deux chanoines vers son principal, afin que celui-ci lui commandât par obéissance, de les suivre vers le pape Eugène. En dépit de de tous ses efforts, il fallut obéir ; et, le 30 août 1447, à l’âge de vingt-quatre ans seulement, il fit son entrée solennelle dans l’évêché. Le 15 novembre 1483, le pape Sixte XIV le créa cardinal prêtre sous le nom de Sainte-Luce.
Il ne survécut pas longtemps à cette dignité. Le 15 juillet de l’année suivante, étant malade au château d’Artenne, près de Tours, et se sentant mourir, il ne voulut d’autre lit que la cendre, sur laquelle il mourut, et d’autre cimetière que celui des pauvres où on l’enterra.
[4] Dans ce temps-là, on écrivait français avec un o.
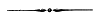
Bénissez Dieu, mes enfants, s’il vous a donné un père juste, charitable, honoré ; priez-le avec larmes qu’il le rende tel, s’il est orgueilleux, avide et haï de ses semblables ; car l’histoire est pleine de récits de pauvres enfants, sur lesquels est retombé le sang de leur père. Pardon, si je vous attriste, car je vous aime ; mais comme il faut vous attendre, en ce monde, à plus de douleurs que de joies, il est bon de familiariser de bonne heure votre âme avec la douleur, afin que si vous étiez brusquement surpris par elle au milieu de vos joies, comme elle a surpris le pauvre enfant dont vous allez entendre l’histoire, vous ne mouriez pas sur le coup sans avoir eu le temps de vous réconcilier avec Dieu. Or, il n’en sera pas ainsi si vous avez appris, de bonne heure, à vous soumettre à ses saintes volontés, à le bénir, à l’adorer ; car tous les désordres et les crimes de ce monde ne viennent que de l’oubli de Dieu et de ses commandements.
De cette riante terre du soleil qu’on appelle l’Italie, vinrent, à la suite de Marie de Médicis, quand elle épousa notre roi Henri IV, un homme et une femme qui, après la mort de ce monarque, assassiné par Ravaillac, prirent un tel ascendant sur l’esprit de la reine devenue régente, qu’elle ne voyait plus que par leurs yeux. La femme, Eleonora Galligaï, était fille de sa nourrice, et le mari, pauvre gentilhomme florentin, nommé Concini, criblé de dettes quand il vint en France, profita de ce même ascendant pour se faire combler de biens et d’honneurs. La prodigalité de la reine fut telle, qu’il marcha bientôt de pair avec les grands du royaume et même avec les princes du sang. C’est ainsi qu’au bout de quelques années, outre le gouvernement de Picardie et le marquisat d’Ancre, il fut investi de la première dignité militaire du royaume, prix ordinaire de longs et glorieux services : celle de maréchal de France. Il ne marchait dans Paris qu’escorté de nombreux cavaliers à sa solde ; sa fortune était telle, qu’il put non-seulement racheter ses biens de Florence, engagés pour plus de deux cent mille écus, mais encore en offrir six cent mille au pape pour jouir, sa vie durant, du duché de Ferrare, dont les princes étaient alliés de la couronne de France ; enfin, comme si le ciel eût pris plaisir à le combler, il eut un fils et une fille pour perpétuer les honneurs inespérés de sa maison.
Mais là s’arrêtèrent ses faveurs, et la mort de sa fille, qu’il aimait tendrement, la perte de son gouvernement d’Amiens et de sa terre d’Ancre, devenus la proie de son plus mortel ennemi, le duc de Longueville, l’exécution d’un de ses gens, pendu par la populace, à la porte Bussy[5], la dévastation d’un de ses hôtels, près du Luxembourg, par cette même populace ameutée par ses ennemis, de plus en plus irrités de sa fortune : tout dut l’avertir qu’il touchait au dernier échelon et qu’il était temps de descendre au plus vite, sous peine d’être précipité, car Dieu ramène à lui, par le malheur, les hommes que l’orgueil et la présomption ont égarés.
Le maréchal crut conjurer la fureur croissante de ses ennemis en se retirant dans son gouvernement de Normandie ; mais cette retraite ne fit que hâter sa ruine : ses ennemis en profitèrent pour aigrir contre lui le jeune roi qui, nouvellement affranchi de la tutelle de sa mère, voyait depuis longtemps, d’un œil jaloux, l’ascendant de ces étrangers sur l’esprit de Marie de Médicis. Il ne fut pas difficile, au reste, vu la faiblesse ombrageuse de Louis XIII, de l’amener aux résolutions les plus violentes contre le maréchal et sa femme. Il était dans la destinée de ce roi sans caractère, d’être le jouet de toutes les ambitions subalternes qui s’agitaient autour de lui.
Ses favoris, en tête desquels était alors le connétable de Luynes, lui proposèrent l’infâme guet-à-pens dans lequel devait succomber le maréchal. Il accepta et en pressa lui-même l’exécution avec son Tristan, le sieur de Vitry. D’autres gentilshommes, ayant à leur tête le frère dudit de Vitry, enseigne des gens-d’armes de sa majesté, devaient se tenir cachés dans une salle basse, près du pont-levis du Louvre, par où passerait Concini, et prêter main-forte au besoin. On devait tenir prêt le carrosse du roi dans la cour du Louvre, sous prétexte d’une chasse à Fontainebleau ; mais en réalité pour prendre la fuite, si le coup venait à manquer.
Ce plan arrêté, Louis XIII manda incontinent au maréchal d’Ancre, dès les premiers jours d’avril 1617, de quitter son gouvernement de Normandie, et de revenir immédiatement à Paris[6].
Celui-ci, se fiant toujours à l’empire de sa femme sur l’esprit de la reine et à sa haute position personnelle, se hâta d’obéir ; et si quelques sombres pressentiments traversèrent son esprit, ils furent bientôt dissipés par la joie de revoir, après une longue absence, son fils, le jeune comte de Pène, âgé de douze ans, sur lequel reposaient désormais tout son amour et ses espérances.
Il arriva à Paris, le 23 avril, à neuf heures du soir ; et, s’il eut été moins préoccupé du bonheur de revoir son enfant, il aurait peut-être aperçu, en entrant dans son hôtel[7], à la lueur des torches que portaient ses gens, un personnage aux traits sinistres qui, à son approche, se glissa à travers les chevaux de son escorte et disparut soudain dans les ténèbres, en se dirigeant vers le Louvre. Mais déjà son enfant, à moitié vêtu, allait se coucher en ce moment, il accourut se précipiter dans ses bras. « Poverino ! poverino ! » disait le maréchal en l’étreignant sur son cœur ; car, selon son usage, il mêlait fréquemment à ses épanchements quelques mots de sa langue maternelle. « Mais couvre-toi donc, la nuit est froide. » Et le maréchal l’enveloppait, comme ferait une tendre mère, dans son manteau.
« Vous ne me quitterez plus, mon papa, n’est-ce pas ? J’avais tant peur de ne plus vous revoir. — Non, Luigi caro, j’ai trop souffert loin de toi. »
Ils arrivèrent, ainsi causant, dans l’appartement de la maréchale qui, plus ambitieuse que son mari, et, par conséquent, plus irritée de ses échecs récents à la cour, les reçut d’un air froid et distrait. « Sortez, Luigi, dit-elle au jeune comte de Pène ; il est temps de vous coucher : j’ai besoin de m’entretenir avec votre père. »
L’enfant, qui la craignait, baissa la tête et abandonnant à regret la main de son père, qu’il tenait toujours, se disposait à obéir, quand celui-ci, le pressant de nouveau sur son cœur : « Va, Luigi caro, lui dit-il, et n’oublie pas, avant de te coucher, de prier pour ton père et pour ta mère... aussi. »
Que se passa-t-il entre les époux, quand ils furent seuls : les Mémoires du temps racontent, que, poursuivi par certains pressentiments, avant-coureurs de sa fin, le maréchal pria et conjura sa femme, presque en pleurant, au nom de leur enfant, de quitter la France immédiatement et de se retirer à Florence ; mais que celle-ci demeura inflexible, en lui reprochant son ingratitude envers la reine, qu’ils abandonneraient après avoir été comblés par elle de biens et d’honneurs.
Le lendemain, dès neuf heures du matin, la cour de l’hôtel était remplie de cavaliers richement équipés et bien armés, au nombre de cinquante, attendant le maréchal pour l’escorter jusqu’au Louvre. Ce déploiement militaire n’était pas un vain luxe, quand on songe qu’outre les motifs de défiance justifiés par de terribles précédents, Concini avait appris, le matin même, que la populace, travaillée la veille par les agents de la cour, s’agitait déjà en groupes mystérieux et menaçants, aux alentours du Louvre.
Le maréchal se disposait à descendre de sa chambre pour aller se mettre à la tête de son escorte, quand, au bruit que fit la porte timidement entr’ouverte, il se trouva en face de son fils qui, regardant de tous côtés et baissant la voix comme s’il eût craint que les murs eussent des yeux et des oreilles, s’approcha vivement de lui et lui jetant ses deux mains suppliantes autour du cou : « Mon papa ! mon papa ! lui dit-il, n’allez pas au Louvre. — Pourquoi, Luigi ! — Souvenez-vous de ce pauvre Bertrand[8], qu’ils ont tué. — Ne crains rien, Luigi ; je suis bien accompagné. — Oh ! mon papa, reprit l’enfant avec un redoublement d’effroi, si vous mouriez, je mourrais aussi... — Povero ! ne crains rien, te dis-je. — Vous ne savez pas, vous, ce qu’a dit le roi, l’autre jour ? Hier je n’ai pas osé vous en parler devant maman, qui m’aurait grondé peut-être. — Parle, et fais vite, Luigi, on m’attend. — Il a dit, en nous voyant passer, ma mère et moi, dans la galerie d’Apollon : Voilà la louve et son louveteau. Oh ! mon papa, quels yeux il faisait en disant cela... — Silence, Luigi, fit le maréchal en avançant sa main comme pour couvrir la bouche de l’enfant... Ne parle jamais de cela... Tu t’es trompé sans doute... Le roi parlait de chasse, selon son habitude, et tu auras pris pour toi et pour ta mère un propos en l’air et sans but. — Oh ! j’ai bien entendu. — Silence ! enfant, te dis-je ; le roi est bon... il est bon, mais on le trompe ; c’est encore un enfant comme toi. Adieu, mio caro, à bientôt... Silence, surtout !... »
L’enfant resta à la même place, immobile et comme anéanti ; seulement, au bruit que firent les chevaux en sortant de la cour, il courut à la croisée pour saluer son père d’un dernier adieu ; mais il n’était plus temps, et il ne put apercevoir que le dernier cheval de l’escorte franchissant la porte de l’hôtel.
« A bientôt !... Puisse-t-il dire vrai, murmura l’enfant. O mon Dieu, mort pour moi ! Sainte Vierge ! ayez pitié de mon père ! »
Cependant de sinistres rumeurs, vagues d’abord, puis plus distinctes, roulaient au loin : c’était la populace, débouchant des étroites rues de la Cité et de la place de Grève.
Il était là depuis un grand quart d’heure, le pauvre enfant, appuyé sur la croisée et prêtant l’oreille aux moindres pas de chevaux qui passaient dans la rue, espérant à tout moment revoir son père, quand une explosion voisine de plusieurs armes à feu, suivie de mille cris confus, l’arrache soudain aux angoisses de l’attente. Il court alors chez sa mère, qu’il trouve encore dans son lit, à demi soulevée, le front pâle et les yeux fixes, prêtant aussi l’oreille à ces rumeurs. « Luigi ! s’écria-t-elle en le voyant, où sont nos gens ? Je sonne depuis une heure, et personne... Ils ont tous fui, les lâches ! Voilà bien les valets, race maudite. »
Elle achevait à peine que la porte de l’hôtel, ébranlée par mille bras furieux, volait en éclats, livrant passage à la populace qui se répandait dans les appartements avec des cris de mort.
Cependant la mère et l’enfant se serraient dans les bras l’un de l’autre avec ce mutuel et puissant instinct de l’amour, la mère le couvrant de tout son corps, l’enfant s’efforçant à son tour de lui servir de rempart. Tout à coup la porte s’ouvre, et des faces hideuses apparaissent. En un clin-d’œil, la mère et l’enfant sont violemment séparés ; la mère est traînée dans la prison du Louvre, presqu’en chemise, sans que ni les cris ni les prières que lui arrachent la pudeur et l’effroi puissent les toucher. L’enfant, accablé de coups, est jeté dans une salle basse de l’hôtel dont l’unique croisée, garnie de barreaux en fer, donnait sur la rue.
C’est dans cette salle que, par une des plus froides matinées d’avril, cette pauvre créature est abandonnée à la garde d’un de ces monstres qui, après l’avoir complétement dépouillé de ses riches habits, se tient à la porte, une pique à la main, pendant que le pauvre petit, blotti et tremblant de tous ses membres, les joues pâles et violacées, et les yeux fixes, ne versait plus une larme, car la douleur brûlante les avait taries dans son cœur.
En ce moment, de nouveaux hurlements, mêlés aux pas tumultueux d’une foule faisant irruption dans la rue, attirèrent le gardien à la croisée ; un rire satanique erra sur ses lèvres. — Ohé ! les autres, fit-il à la foule, par ici. » Puis, se tournant vers son prisonnier : « Approche, petit, lui dit-il ; viens voir ton père. » A ce mot, le pauvre enfant s’accroche convulsivement aux barreaux, mais à l’instant même il rejette la tête en arrière, saisi d’horreur à la vue d’un cadavre souillé de boue et de sang, que des hommes aux bras nus, traînent de son côté. Mais son gardien, qui a prévu ce mouvement, le redresse contre les grilles, d’un violent coup de poing, et menace de le percer d’outre en outre, de sa pique, s’il fait mine de bouger, le forçant ainsi de contempler le corps de son père, car c’était lui-mème[9]. Au milieu des imprécations furieuses de ces cannibales qui, pour renchérir sur cette barbarie, dressent ce corps mutilé jusqu’à la hauteur des barreaux, la pauvre créature s’évanouit et tombe raide sur le carreau. Son geôlier, le croyant mort, court bien vite se joindre à cette horde barbare.
L’enfant resta ainsi seul, plusieurs heures, sur la dalle ; il y serait mort infailliblement, si le hasard n’eût amené, de ce côté, le comte de Fiesque, gentilhomme génois, attaché à la maison de la jeune reine[10], lequel, contemplant cette fureur populaire qui fait, en un clin-d’œil, un monceau de ruines d’un palais magnifique, fut arraché à ses réflexions par de sourds gémissements partant d’une salle basse ; il s’approche et voit, à travers les barreaux, cet infortuné qui, revenu de son évanouissement, s’était blotti machinalement dans le même coin, les yeux fixes et vitrés, comme un pauvre oiseau blessé qui va mourir. Courir dans l’hôtel sans s’inquiéter des suites de son action, saisir l’enfant dans ses bras, s’efforcer de le réchauffer pendant qu’il ordonne à un des gens de sa suite de quitter son habit pour l’en couvrir ; tout cela fut l’affaire d’une minute. « Poverino ! poverino, » disait le comte en s’efforçant de le réchauffer.
A ces mots, l’innocent soulève péniblement sa tête, puis la laisse retomber soudain en voyant que celui qui les prononçait, lui était inconnu. Ainsi déguisé, car ce n’était pas sans raison que le comte l’avait fait couvrir de sa livrée, il le fit transporter, en toute hâte, dans son appartement du Louvre, où, après l’avoir fait placer devant un grand feu, il s’efforça, mais en vain, de lui faire prendre quelque nourriture ; l’enfant resta muet à toutes ses avances ; la jeune reine elle-même instruite par le comte, voulut le voir, et son cœur se fondit aussi de pitié. En vain lui prodigua-t-elle mille caresses avec cette grâce touchante dont les femmes ont seules le secret, l’enfant resta muet comme auparavant. On voyait qu’une idée fixe s’était emparée de son esprit : celle de mourir, sans doute, car ce ne fut qu’au bout de trois jours que, sur la promesse qu’on lui fit de lui laisser revoir sa mère, il se résigna à prendre quelques aliments.
Deux mois après, pendant que, par les soins du comte de Fiesque[11], il arrivait à Florence, où restaient encore quelques débris de l’immense fortune de ses parents, un arrêt du parlement de Paris condamnait sa mère, sa pauvre mère, à avoir la tête tranchée, et lui-même était déclaré, par ce même arrêt, ignoble et incapable de tenir aucune charge en France[12].
On dit que, toujours frappé de cette grande catastrophe de sa famille, l’enfant, devenu homme, tourna toutes ses espérances vers Dieu, principe et fin de toutes les créatures intelligentes, et qu’il puisa, dans cette source éternelle de tout amour, cette sérénité de cœur que toutes les puissances du monde ne peuvent donner, et gage précurseur de la gloire future des justes.
[5] C’était une des portes de l’enceinte de Philippe-Auguste, située rue Saint-André-des-Arts, près de la rue Contrescarpe. En 1209, avant qu’elle fût achevée, elle fut vendue aux religieux de l’abbaye de Saint-Germain, et se nomma Porte-Saint-Germain. En 1350, ces religieux la cédèrent à M. de Buci, premier président au parlement de Paris, dont elle prit le nom. Elle fut abattue en 1672.
[6] Le roi n’avait alors que seize ans ; son jeune âge peut seul amoindrir la flétrissure de cet odieux guet-à-pens, dont la plus large part revient à ses infâmes conseillers.
[7] Il était situé tout près du Louvre.
[8] Le même domestique du maréchal qui avait été pendu par le peuple à la porte Bussy.
[9] Il avait été tué par de Vitry et ses cruels acolytes, sur le pont-levis du Louvre, de plusieurs coups de pistolets, et livré ensuite à la populace.
[10] Anne d’Autriche, fille de Philippe III, roi d’Espagne, que Louis XIII avait épousée depuis peu.
[11] Il y avait d’autant plus de générosité à ce seigneur d’agir ainsi, qu’il avait eu lui-mème beaucoup à se plaindre du maréchal d’Ancre.
[12] Cet arrêt fut exécuté le 8 juillet 1617. Nous ne devons pas omettre, à cette occasion, la belle réponse que fit la maréchale à ses juges, qui lui demandaient par quels sortiléges elle s’était rendue maîtresse de l’esprit de la reine. « Par le privilége, répondit-elle, qu’ont les âmes fortes sur les âmes faibles. »
Le nécessaire et le superflu.

| Lith. de Cattier | |
| Un pauvre morceau de pain mon beau Monsieur s’il vous plaît!!! | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.

« Mon cher Amédée, je suis très-fâché que tu aies fait de ton argent un tout autre emploi que celui dont nous étions convenus. Je préférerais voir, là, sous tes yeux, l’excellent livre que tu devais acheter, que d’en savoir le prix aux mains d’un pauvre. Sans doute la bienfaisance est une vertu ; mais il faut savoir la pratiquer avec discernement. Je ne prétends pas, il est vrai, qu’à ton âge on puisse distinguer toujours le mendiant vraiment honnête, du paresseux digne de mépris ; mais, dans cette circonstance, tu as commis deux fautes à la fois : d’abord tu as fait à un seul pauvre l’aumône qui eût suffi pour vingt indigents, puis enfin tu as disposé d’un argent qui n’était pas à toi ; dépense en aumônes celui que je destine à tes menus-plaisirs...rien de mieux ; ce sera là sans contredit une jouissance plus douce qu’aucune autre ; mais garde-toi désormais de faire, non-seulement le bien aux dépens d’autrui, mais aussi de le priver de ton nécessaire. A l’avenir, si tu viens à rencontrer un malheureux aux besoins de qui ta bourse ne puisse suffire, eh bien ! viens me trouver ; je me prêterai volontiers à cette bonne œuvre, et tu apprendras alors comment on peut être bienfaisant avec sagesse, afin de mieux multiplier ses dons ; mais faire le bien à tort et à travers, donner plus que son superflu, c’est s’exposer à manquer soi-même plus tard du nécessaire. Je vais, à ce propos, te conter l’histoire du petit Marcel.
Le petit Marcel était fils de la cuisinière de M. Boicervoise, l’un des vieux amis de ton grand-père ; cet enfant était si gentil, si intéressant, que M. Boicervoise, voyant sa domestique veuve, n’hésita pas à le prendre chez lui pour aider sa mère.
A l’âge de treize ans à peine, Marcel faisait déjà un excellent groom. Probe et docile, il méritait les éloges de son maître et de toutes les personnes qui fréquentaient la maison.
Un jour que M. Boicervoise avait une communication importante et très-pressée à faire à l’un de ses amis, domicilié à Chatou, il appelle sa cuisinière, et lui dit : « Tenez, Marguerite, voici une lettre pour M. Breton ; mais il ne la recevrait pas assez tôt par la poste, faites-moi le plaisir d’envoyer immédiatement à Chatou votre petit bonhomme, dès qu’il va rentrer ; donnez-lui 5 francs : je veux qu’il prenne le chemin de fer pour aller et revenir, mais recommandez-lui bien surtout de me rapporter une réponse. »
Et, dès que Marcel parut : « Allons vite, eh vite, mon ami, s’écria Marguerite ; habille-toi et va porter cette lettre à M. Breton, à Chatou ; tu y as été déjà, tu sais.
— Oui, oui, mère, donnez je serai bientôt parti.
— Un moment donc, étourdi ! tu rapporteras une réponse, entends-tu ? notre maître l’a bien recommandé. Et tiens, voici 3 francs que monsieur m’a dit aussi de te remettre ; il veut que tu prennes le chemin de fer en allant et venant... Eh bien ! qu’as-tu donc maintenant à rester là, planté devant moi, comme une statue.
— Dam’, mère, je pense que si vous vouliez me garder cet argent pour le jour de la fête de monsieur, qui est si bon, je me sentirais bien le courage de faire la route à pied.
— Oui-dà ! je n’entends pas ça, moi ; voyez donc ce beau marcheur pour faire ainsi plus de sept lieues ! Non, non, monsieur, il faut que vous preniez le chemin de fer ; ça doit être si joli un chemin de fer... peste ! à ta place, je ne me le ferais pas dire deux fois.
— Vous savez bien, mère, que M. Breton, qui ne peut supporter les voitures, et moins encore les chemins de fer, parce qu’ils lui ont, dit-il, coupé en deux sa propriété, vient quelquefois le matin de Chatou à Paris, et s’en retourne le soir à pied ; pourquoi n’en ferais-je pas autant ? Ça ne m’est-il pas arrivé déjà une fois, quand je l’ai accompagné... ce certain jour qu’il était si en colère ?...
— Oui, sans doute ; mais nous voilà en automne... et les jours sont plus courts.
— Raison de plus, mère ; la chaleur est moins forte, on marche bien mieux. » Et en disant ces mots, Marcel glisse d’un air câlin les 3 francs dans la poche du tablier de Marguerite : « Je suis bien sûr, de cette façon, de ne pas perdre mon temps à courir rue Saint-Lazare, après le chemin de fer, et je serai arrivé presqu’aussitôt ; je détale comme un petit lièvre ; monsieur ne s’apercevra seulement pas que j’aie marché, et alors à sa fête... Dieu ! que j’aurai de plaisir ! Allons, mère, donnez-moi vite une bonne miche de pain ; j’ai deux sous dans mon gousset, voilà tout ce qu’il me faut. »
La bonne Marguerite cède enfin aux instances et aux caresses du gentil Marcel ; elle coupe un gros croûton de pain, y place au milieu quelque peu de bonne chère ; l’enfant embrasse sa mère et part.
Bientôt il rencontre, dans les Champs-Élysées, un de ces petits Savoyards qui balaient les chemins et demandent aux passants, d’un ton si pitoyable, le salaire de leur peine. Marcel est crédule, confiant ; il a si bon cœur ; il ne se fait donc pas tirer l’oreille, et, sans autre réflexion, il donne un de ses sous à l’enfant qui lui tend la main. Tout à coup survient, à cent pas de là, un second petit balayeur qui, selon toute apparence, avait vu, de loin, la scène qui venait de se passer ; aussi celui-là plus rusé, plus suppliant encore que le premier, ne demande pas un petit sou, comme son camarade ; il aperçoit, sous le bras de Marcel, le gros morceau de pain appétissant et doré... et notre petit drôle s’écrie aussitôt, les mains jointes : « Un pauvre morceau de pain, mon beau monsieur, s’il vous plaît !!! »
« Oh ! oh ! murmure d’abord Marcel, un peu déconcerté de cette nouvelle supplique très-imprévue : « Qu’est-ce qui me restera donc à moi ! » et il fait quelques pas d’abord sans répondre à cet enfant... Mais celui-ci le suit, l’obsède tant et si bien de paroles caressantes, qu’enfin il s’arrête :
« Allons, voyons, dit-il alors, tout ému qu’il était, prends donc ceci... tu me fais l’effet d’avoir bien faim, plus faim que moi. »
Et voilà l’imbécile qui donne étourdiment au petit Savoyard son pain et sa viande. Tout joyeux d’en être venu à ses fins, ce dernier se confond en remercîments, et comble de bénédictions Marcel, qui déjà n’était guère moins content d’avoir fait une si bonne action, et puis il y avait bien un peu de vanité dans tout ça ; le mendiant l’avait appelé mon beau monsieur, probablement à cause de sa petite veste et de son chapeau galonné, lui qu’on n’avait jamais nommé jusqu’ici que Marcel tout court... Qui sait, peut-être bien le petit Savoyard n’avait-il dû pareille aubaine qu’à cette ruse adroite.
Défie-toi donc toujours, Amédée, des belles paroles dorées ; celui qui en fait usage a le plus souvent besoin de nous ; il ressemble à maître renard du bon La Fontaine ; c’est notre fromage qu’il convoite, et que de corbeaux hélas ! dans ce monde.
Mais revenons à Marcel qui poursuit toujours sa route après s’être ainsi niaisement dessaisi de son dîner. Voilà, diras-tu, un beau trait de charité. Eh bien ! tu te trompes. S’il l’a fait par vanité, c’est un sot ; par humanité, c’est un fou qui deviendra prodigue un jour, s’il ne reçoit, de bonne heure, une leçon sévère. Au reste, une idée vient le consoler : il dînera probablement à Chatou, chez M. Breton. En attendant, voici venir une marchande de gâteaux de Nanterre ; Marcel possède un dernier sou ; les gâteaux sont bien appétissants ; il achète donc un gâteau, le mange en courant, traverse presque aussitôt Nanterre ; sous trois petits quarts d’heure, il sera rendu à Chatou.
Midi sonnant, le voilà qui frappe à la porte de M. Breton. Il frappe... personne ; il frappe de rechef... personne encore... Ce monsieur est indubitablement sorti. N’importe. Marcel attendra, car il faut qu’il rapporte absolument une réponse à sa lettre. Pour se distraire, il va d’abord faire une station de trois quarts d’heure au débarcadère du chemin de fer... C’est un spectacle si curieux que celui de ces convois qui passent sous vos yeux, et se croisent avec la rapidité de l’éclair ; mais comme c’est toujours, après tout, la même chose, il se lasse d’avoir, pendant vingt minutes, le nez au vent, le cou tendu, pour attendre des wagons, et il se décide, pour varier ses plaisirs, à faire une petite excursion tout le long de la rivière ; et rien n’ouvre l’appétit comme une promenade au bord de l’eau.
Mais enfin trois heures ont sonné ; passablement fatigué déjà, aiguillonné d’ailleurs par la faim, notre petit promeneur rentre dans Chatou, et va de nouveau, plein d’espoir, frapper à la porte de l’ami de M. Boicervoise ; toujours personne... « Oh ! oh ! se prit à dire Marcel tout décontenancé cette fois ; voilà qui devient sérieux : est-ce que décidément M. Breton ne serait pas à Chatou ? J’ai perdu, là, trois heures bien mal à propos. Et cette lettre, et la réponse que j’attends ; que faire ? » Et il refrappe, en désespoir de cause ; et, dans l’attente, le cœur lui battait bien fort.
« Que demandez-vous donc ? s’écrie enfin une voisine qu’assourdissait évidemment ce bruit fatigant et continuel de marteau.
— M. Breton, répond Marcel avec un éclair de joie.
— Eh ! mon pauvre garçon, n’est-ce pas vous déjà qui avez frappé sur les midi ?
— Oui, madame, reprit l’enfant d’un air piteux.
— Que ne le disiez-vous plus tôt ? M. Breton venait précisément de partir il n’y avait qu’un instant, avec son domestique ; il est allé pour affaires à deux lieues d’ici ; il ne reviendra que ce soir bien tard. Si vous avez quelque chose à lui remettre, laissez-le-moi, je m’en chargerai volontiers. »
Figure-toi, s’il se peut, Amédée, le cruel désappointement du pauvre Marcel. D’abord, par sa faute, en ne se conformant pas aux ordres de son maître, il avait manqué M. Breton d’une demi-heure seulement ; ainsi le voilà obligé de laisser sa lettre sans rapporter la réponse, si impatiemment désirée ; ensuite il lui faudra revenir à Paris, sans avoir dîné, mourant de faim, car il n’oserait, pour tout au monde, demander à manger à cette femme qui ne le connaît pas.
Tout repentant surtout de ces trois mortelles heures qu’il avait perdues en vaines promenades, il prit donc le seul parti qui lui restât : celui de se remettre tristement en route.
De retour à Nanterre, — et il tombait déjà de besoin et de lassitude, — l’aspect des mille petits gâteaux qu’il voit étalés devant lui, vient éveiller cruellement ses désirs ; mais par malheur ces gâteaux sont à vendre, et Marcel n’a plus le sou. C’est alors qu’il s’écrie avec amertume : « Imprudent ! qu’ai-je fait de mon pain, de mon argent ? Au lieu de les jeter follement au premier venu, si je les avais gardés, je n’éprouverais pas ces affreux tiraillements d’estomac que j’endure ; j’aurais du moins la force de marcher, tandis qu’à chaque pas que je fais, une sueur froide glace mon front, et mes jambes fléchissent. Oh ! n’importe... le jour baisse... allons toujours. »
Et Marcel se remit péniblement en marche ; au bout d’une demi-heure, il est contraint de s’asseoir sur la grand’ route, au pied d’un arbre, et cependant la nuit vient toujours. C’est alors que l’infortuné mesure avec effroi, de l’œil et de la pensée, tout le chemin qui lui reste à faire ; puis il songe à sa pauvre mère ; doit-elle être inquiète de ne pas le voir revenir ? Et les heures s’écoulent, et la nuit est déjà sombre. — Enfin, après mille nouveaux efforts, il arrive à Neuilly.
Mais c’en est fait : le pauvre petit sent décidément ses forces l’abandonner ; sa vue se trouble... il ne voit pas même une lumière qui brille non loin de lui : « Mon Dieu ! mon Dieu ! s’écrie-t-il en pleurant, je suis perdu, si vous ne venez à mon secours. »
Au même instant, son oreille est frappée d’un grand éclat de rire, qui part d’une maison voisine. Marcel soulève sa tête appesantie ; c’est alors seulement qu’il aperçoit la lumière. Cette maison était une auberge. La porte, restée ouverte, laissait entrevoir l’aubergiste qui soupait en famille.
Je ne te peindrai pas, mon ami, l’effet terrible, étrange, qu’un pareil aspect produisit sur le petit Marcel ; il faudrait, pour t’en faire une idée, avoir éprouvé toutes les horreurs de la faim. Le malheureux enfant n’y résiste plus : d’un côté, la honte le retient ; de l’autre, l’horrible faim le pousse ; il cède enfin à ce besoin tyrannique, il entre ou plutôt, réduit à mendier à son tour, il se traîne dans la maison en criant, d’une voix déchirante : « Par pitié, un morceau de pain, pour l’amour de Dieu !
— Oh ! oh ! que fais-tu donc, à cette heure, sur le grand chemin, petit drôle ? demanda aigrement la maîtresse.
— Ne vois-tu pas que c’est ce qu’ils appellent un groom, reprend le mari... quelque mauvais sujet qui se sera fait chasser par ses maîtres... Et n’est-ce que cela encore ?...
— Oh ! non monsieur, je vous le jure, je suis un brave garçon, je... » Mais Marcel n’en peut dire davantage, il tombe de faiblesse sur une chaise, et les larmes le suffoquent.
Un honnête jeune homme.

| Lith. de Cattier | |
| Voilà ce qu’on trouva suspendu à mon cou... connaîtriez-vous cela? | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.
A ce spectacle imprévu, l’aubergiste se radoucit un peu ; il fait prendre à l’enfant un bon verre de vin qui, le rappelant à la vie, le met insensiblement en état de raconter sa triste aventure ; et son air de sincérité intéresse vivement cet homme. « Allons, allons, dit-il, puisqu’il en est ainsi, tu es un digne garçon, mais un franc étourdi. Que ceci te serve de leçon ; je ne ferai pas les choses à demi... D’abord mets-toi à table, et soupe avec nous. Après quoi, notre cocher est allé prendre des voyageurs à Courbevoie pour les mener à Paris... Eh ! bien tu partiras avec lui ; mais une autre fois, souviens-toi que charité bien ordonnée consiste à ne se dessaisir jamais que de son superflu en faveur de ceux qui manquent du nécessaire. »
Marcel soupa bien, et il revint à Paris. Dieu sait s’il fut grondé par sa mère et par son maître ! et cependant, tu le vois, Amédée, il n’avait en tout ceci, péché que par excès de délicatesse en ne dépensant pas d’abord l’argent de M. Boicervoise ; d’humanité, en donnant aux petits Savoyards, son argent et son pain ; mais c’est qu’il faut toujours prévoir le chapitre des événements, et Marcel n’avait rien prévu. Aussi, tant qu’il vivra, n’oubliera-t-il jamais le souper et la leçon de l’aubergiste ; ce qui ne l’empêchera pas, dans l’occasion, de faire toujours du bien, mais du moins avec prudence et discernement, car sa maxime est devenue désormais celle-ci : « Donner plus que son superflu, c’est s’exposer à manquer plus tard du nécessaire. »
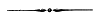
On était en 1830. Autour d’une table élégamment servie, et dans une salle à manger décorée avec goût, trois hommes d’un certain âge se reposaient d’une excursion provoquée par les doux rayons d’un beau soleil de mars. Le dîner avait lieu chez M. Duval, libraire du quartier latin. Rempli de jugement et de probité, cet homme avait vu son fonds, d’abord médiocre, prendre tout à coup un accroissement considérable, et 100,000 francs gagnés en dix ans, témoignaient de son bonheur et de son activité.
Son premier invité était un riche capitaliste, placé depuis quelque temps à la tête d’un journal quotidien ; la politique était son unique affaire ; on le nommait le baron de Fargueil. L’autre convive, le docteur Raimbault, était le meilleur, le plus humain des hommes : et, lorsqu’il se trouvait appelé en même temps auprès de deux malades, l’un riche, l’autre pauvre, il donnait toujours la préférence à ce dernier, ne se mettant même jamais en route sans avoir au préalable rempli ses poches d’argent, de sucre et de bouteilles de sirops.
C’est pourquoi M. Duval honorait beaucoup ce digne homme, et lui faisait mille éloges dont celui-ci se fâchait toujours. « Beau mérite que j’ai là ! disait le docteur Raimbault ; on voit bien que vous n’y entendez rien. Est-ce qu’on pourrait soigner des gens qui n’ont ni argent, ni feu, ni tisane, ni quoi que ce soit à mettre sous la dent, dès que leur estomac commence à avoir besoin ? On ferait de belles cures, ma foi ! et je voudrais vous y voir, vous qui parlez !
— Alors, reprit M. de Fargueil, l’ingratitude doit vous causer moins de chagrin qu’à vos confrères, car, elle est le prix le plus ordinaire du bien que vous faites.
— Comment voulez-vous qu’il en soit autrement, répliqua le docteur ; à peine guéri, le pauvre retourne à son travail ; la maladie dont on vient de le sauver n’ayant été peut-être que le moindre de ses maux, il l’oublie, avec celui qui l’en a tiré, sous l’étreinte d’un mal plus pressant contre lequel il se débat sans relâche, souvent jusqu’à sa dernière heure : la misère !
— Je voudrais penser comme vous, fit le baron, mais je ne saurais avoir une bonne opinion des hommes, moi qui vois, chaque jour, tant d’écrivains vendre, pour un peu d’or, leurs opinions et leur conscience.
— Mais s’ils les vendent, vous les achetez vous ! reprit Duval...
— Très-bien dit ! fit M. de Fargueil glissant adroitement sur l’épigramme ; mais, revenons à la question : je soutiens que la misère détruit les bons sentiments.
— Que le ciel me préserve de jamais rien penser de semblable, s’écria l’honnête docteur ; sans doute il y a une misère qui dégrade, et c’est celle de l’homme qui, n’ayant reçu aucune éducation, se jette dans quelque vice honteux pour y trouver l’oubli momentané de ses maux... celui-là, que Dieu lui pardonne !
— Mais ce que vous nommez aussi la misère, je pense, interrompit le baron, c’est la privation de toute espèce de jouissances, la nécessité de travailler sans relâche, pour sortir d’une position à laquelle on se croit supérieur.
— Eh bien ! cette misère-là, voyez-vous, répliqua M. Raimbault, c’est celle qui fait les grands hommes, les grandes vertus ; c’est une lutte qui développe l’énergie, qui grandit les facultés, et qui nous révèle à la fin ce que nous valons et ce que nous pouvons.
— Tant mieux pour ceux qui sont ainsi faits, murmura M. de Fargueil, mais en connaissez-vous beaucoup ?
— Certainement ; et, par exemple, connaissez-vous Julien de Verteuil ?
— Qui ça ? l’auteur du drame défendu ?
— Précisément ; savez-vous ce qu’il a dit quand, après la seconde représentation, on a retiré sa pièce du répertoire ?
— Pardieu ! ce qu’ils disent tous en pareil cas...
— Pas le moins du monde ; il est convenu que son ouvrage avait le grand tort d’énoncer des opinions peut-être dangereuses, et que c’était sagesse de l’avoir défendu.
— Votre M. Julien est un phénix, dit en riant le baron.
— Non, mais un honnête homme, répliqua M. Duval.
— Heureux le père d’un tel fils, ajouta, en soupirant, le docteur.
— Vous ne savez donc pas son histoire ? reprit M. Duval en baissant la voix : le pauvre Julien n’a jamais connu sa famille ; la misère l’avait jeté dans un de ces asiles ouverts, par la charité publique, aux malheureux enfants dont les parents manquent de pain ; mais il paraît que, dans cet hospice même, il a trouvé plus tard, un protecteur, un guide, un ami, presque un père ; et c’est à sa mort que ce jeune homme est venu s’établir à Paris.
— Me voici convaincu de son mérite et de son bon sens, dit le baron ; mais c’est égal, s’il n’est pas riche, on peut le séduire comme un autre ; il ne s’agit que de savoir s’y prendre.
— Essayez, dit M. Duval.
— Eh bien ! nous verrons, répliqua l’autre ; » et, là-dessus, les trois amis se séparèrent.
Quatre mois s’étaient écoulés depuis cette conversation. La révolution de 1830 venait de s’accomplir, et la secousse, par elle imprimée au commerce, entraîna à sa suite de si funestes conséquences pour M. Duval, qu’il avait été près de suspendre ses paiements. Les 100,000 francs, fruit d’une prospérité de dix ans, se trouvant perdus pour lui, il se vit obligé de demander du temps à ses créanciers, et de renoncer même à plusieurs opérations fructueuses. Un ouvrage pour lequel il avait traité avec Julien, était de ce nombre. C’était un livre sérieux, digne d’éloges, auquel ce jeune homme travaillait depuis plus de deux ans, et que M. Duval regardait comme appelé à un grand succès.
Julien avait consenti à laisser paraître, dans quelques journaux, plusieurs fragments de son ouvrage, et l’effet qu’ils y produisirent fut tel, que plusieurs éditeurs vinrent le voir, dans l’espérance d’en traiter avec lui. Un entr’autres lui écrivit qu’il lui achèterait volontiers son livre au prix de 6,000 francs.
C’était là une fortune pour Julien, et il eût pu bien loyalement accepter cette offre ; en effet, une autre lettre, venant de M. Duval, lui annonçait précisément qu’il était libre de disposer de son œuvre, comme bon lui semblerait.
Au reçu de cette dernière missive, il se rendit chez son libraire. Il ignorait encore de quel malheur venait d’être frappé celui qui l’avait aidé, encouragé, lors de ses débuts dans la carrière : « Pourquoi ne voulez-vous plus de mon livre, lui dit-il ? Est-ce que vous avez perdu l’espoir d’en tirer parti ?
— Vous ne m’avez donc pas compris, répliqua M. Duval : je suis ruiné, mon pauvre monsieur Julien. Je suis trop pauvre pour vous payer comptant, et trop honnête homme pour demander à crédit ce que je ne pourrais peut-être jamais acquitter, qui sait ?
— Est-ce là votre seule raison, reprit Julien en interrogeant fixement du regard le libraire ? Ne serait-ce pas plutôt parce que vous redoutez un non-succès que vous renoncez à notre traité ? S’il en était ainsi, je ne vous en parlerais plus, j’accepterais les offres que voici. »
Alors il lui mit sous les yeux la lettre dans laquelle on lui proposait l’achat de son travail au prix de 6,000 francs.
Ce fut au tour de M. Duval de chercher à lire dans les yeux de Julien. « Mais, nous étions convenus de moins que cela, lui dit-il ; vous ne vous en souvenez donc plus ?
— Je me souviens très-bien que c’était 4,000 francs, répliqua le jeune homme.
— En ce cas, mon cher ami, laissez-moi vous dire combien je trouve de générosité et de délicatesse dans votre insistance ; mais croyez-moi, acceptez sans scrupule, et croyez que M. H... fera encore une excellente affaire en concluant avec vous à ce prix.
— En êtes-vous bien sûr, demanda Julien ?
— Parbleu ! si j’en suis sûr ! Votre livre est appelé à servir dans toutes les éducations, à figurer dans toutes les bibliothèques. C’est un ouvrage de fonds, et qui verra sa vingtième édition. »
Alors Julien tira tout son manuscrit d’un grand portefeuille :
« Puisqu’il en est ainsi, dit-il, vous n’avez plus aucun motif raisonnable pour me refuser ; voici mon manuscrit ; imprimez-le, et, si le succès répond à vos espérances, regardez-moi toujours comme un de vos obligés. »
Une larme brilla dans les yeux de M. Duval ; Julien lui donnait pour 4,000 francs, hypothéqués seulement sur sa probité, un ouvrage dont on lui offrait 6,000 francs comptant.
En vain lui fit-il de nouvelles observations, lui redit-il encore à quelles mauvaises chances il pouvait se trouver exposé, Julien fut inébranlable. La meilleure garantie pour lui, disait-il, c’était la probité : quant à de l’argent comptant, il n’en avait pas besoin. Une suite d’articles que lui demandait un journal le mettait à même de subvenir à ses dépenses : 100 francs par mois.
« Comment pouvez-vous vivre avec si peu ? vous n’êtes pas seul ?
— Seul ! répondit le jeune homme, complétement seul depuis ma naissance ; et tant de malheurs l’ont accompagnée et suivie, que, sans les arts, qui sont devenus toute ma consolation, je n’aurais jamais goûté le moindre bonheur dans ma vie. »
Pénétré du procédé de Julien, touché de l’expression de tristesse qui s’était peinte sur son visage, lorsqu’il avait parlé de son isolement et des mauvais jours de son enfance, le bon M. Duval ouvrit ses bras au jeune homme en lui disant : « Quand votre solitude vous pèsera, quand vous sentirez le besoin d’avoir près de vous quelqu’un qui vous aime... venez ici...
Trois mois s’étaient encore écoulés ; le livre de Julien venait d’être publié et se trouvait dans toutes les mains : ce qui n’empêchait pas qu’il fût très-gêné, car il s’était brouillé tout récemment avec son journal, parce qu’il avait refusé de faire l’éloge d’une personne pour laquelle il ne se sentait aucune estime.
Tout occupé d’un ouvrage sérieux, et de fort longue haleine, Julien ne possédait plus rien qu’une faible somme qu’il venait de recevoir du journal, comme règlement de compte.
Économisée par lui au point de durer trois fois plus qu’elle n’eût fait en d’autres circonstances, cette petite rentrée le fit vivre trois mois, mais Dieu sait comment ; aussi sa santé s’altérait-elle à vue d’œil au milieu des privations de toute espèce qu’il s’imposait ; puis enfin, vint le jour qui vit finir cette mince ressource, et, quoique désolé d’être contraint de conter ses embarras au pauvre M. Duval, qui avait bien assez des siens, il se dirigea vers le domicile du bon libraire.
En entrant dans son cabinet, il vit un homme de mauvaise mine qui en sortait : c’était un huissier ; il venait demander le remboursement d’un billet que M. Duval croyait payé depuis huit jours, en sorte que celui-ci, dont la caisse était à sec, ne voyait d’autre moyen, pour sortir d’embarras, que de vendre sa montre et son argenterie, et encore tout au plus espérait-il, à l’aide de ce sacrifice, se procurer la somme dont il avait besoin.
Consterné par cette nouvelle, et ne songeant plus même à lui, Julien demanda à M. Duval pourquoi il ne se confiait pas à l’amitié du docteur. C’était une chose faite depuis longtemps. Lors de ses premiers tourments, M. Raimbault lui avait prêté 10,000 fr.; et, pour rien au monde, l’honnête libraire n’eût voulu revenir à la charge. Julien s’en retourna donc chez lui, le cœur navré. Avant de rentrer, il fut obligé, quant à lui, de changer sa dernière pièce de 5 francs, afin d’acheter de quoi faire un léger repas. Et, tout en s’asseyant près de son bureau, sur lequel il avait déposé un pain et quelques fruits, il se demanda tristement par quel moyen il pourrait attendre l’époque où son grand travail serait fini, sans parler à M. Duval de sa situation fâcheuse.
Il était assis depuis quelques instants, livré à ces tristes réflexions, et mangeant sans trop d’appétit, lorsqu’on frappa à sa porte : c’était le baron de Fargueil qui, n’étant jamais venu chez lui, avait prié le docteur de l’y accompagner. En voyant ces messieurs, Julien éprouva deux impressions toutes contraires : dans son amitié pour M. Raimbault, il y avait une grande dose de confiance, tandis qu’il se méfiait de l’esprit caustique du baron, et se sentait blessé de l’avoir pour témoin de son misérable repas.
Celui-ci parut ne pas s’en apercevoir, et tendant la main au jeune homme : « Écoutez-moi, dit-il, mon cher ami, j’ai à vous faire des offres magnifiques, et pour lesquelles il me faut une réponse immédiate. Mais d’abord rassurez mon amitié ; dites-moi, seriez-vous au régime ou bien souffrant ? Vous voilà, dînant avec du raisin, au lieu de mordre dans un bon beefteack ? »
Julien rougit légèrement. « Je ne suis pas malade, monsieur, répondit-il, mais je craignais de le devenir, et chaque fois que cette crainte me vient, deux jours de diète presque absolue sont le préservatif que j’emploie.
— Ah ! ah ! voilà de la raison, » répliqua le baron en riant, tandis que le docteur regardait, d’un air pénétré de tristesse, la pâleur sur le visage amaigri de son jeune ami.
Nous avons déjà dit, qu’obéissant à sa conscience, Julien s’était brouillé avec le directeur du journal dans lequel il écrivait. De son côté, et depuis longtemps M. de Fargueil s’était fait le patron d’une feuille anti-monarchique, dans laquelle il avait des intérêts ; il s’était donc chargé de proposer à Julien la rédaction en chef de cette feuille avec un traitement de 10,000 fr. par an ; il lui apportait même un trimestre de ses appointements à titre d’avance, lui demandant en échange, comme inauguration de son entrée en fonctions, un article qui, sous le voile de la plaisanterie, répandît le ridicule à pleines mains sur ce même ministre dont il n’avait pas voulu faire l’éloge.
Après avoir ainsi exposé le motif de sa visite, le baron tendit la main au jeune homme : « Eh bien ! cher ami, vous êtes des nôtres, dit-il, et je ne pense pas qu’aucun scrupule puisse vous arrêter dans une occasion où votre conscience se trouve d’accord avec votre intérêt ? »
Julien ne témoigna ni dédain ni colère ; il serra la main qu’on lui tendait, et fixant M. de Fargueil, d’un regard pur et candide : « Je suis pénétré de reconnaissance, dit-il, pour tout ce qu’il y a de bienveillant dans la mission dont vous vous êtes chargé près de moi ; ce sont des offres magnifiques que les vôtres, si l’on considère l’âge que j’ai, et le peu que je suis comme talent ; mais, j’en aurais cent fois moins, que je ne les accepterais pas.
— Voilà, par exemple, un refus auquel j’étais loin de m’attendre, s’écria le baron stupéfait. Mais si vous ne voulez parler ni pour ni contre les gens, que voulez-vous faire dans un journal ?
— Je veux blâmer les actes qui ne sont pas dictés par l’amour du bien public, défendre le faible contre le fort, parler en faveur de l’humanité ou de la loi ; mais, dût mon pain en dépendre, jamais je ne me dégraderai jusqu’à fouiller dans la vie privée d’un homme, quel qu’il soit, pour l’accabler d’amertume ou de ridicule, en dévoilant, aux yeux du public, les secrets de sa famille, en le blessant dans ses affections les plus intimes. La maison de tout citoyen est un sanctuaire inviolable.
— C’est là votre dernier mot, reprit M. de Fargueil ? peut-être avez-vous tort ? et la preuve, c’est que je trouverai dix hommes, pour un, qui accepteront ma proposition, avec de moins grands avantages que ceux qui vous sont offerts.
— Je n’ai rien à dire contre eux, reprit Julien ; ils agissent d’après leurs inspirations, comme moi, d’après ma conscience ; c’est par elle seule que je me laisse guider ; l’exemple d’autrui ne peut rien sur mes déterminations. »
Respectant, malgré lui, une foi si sincère, presque honteux du rôle qu’il avait joué, et de la leçon qu’il venait de recevoir, le baron prit cependant son parti en galant homme : « Voilà qui est conclu, dit-il ; vous resterez un phénix à mes yeux ; j’avais besoin de vous connaître pour croire à un désintéressement pareil, mais à présent que j’ai vu, je crois, et mon estime vous est acquise à tout jamais. » Alors se tournant vers M. Raimbault : « Partons-nous ensemble, lui dit-il ? » Celui-ci fit un signe de tête négatif ; le baron sortit.
Enfoncé dans un large fauteuil, le seul qui existât chez Julien, les mains appuyées sur sa canne, et le menton sur ses mains, le docteur avait gardé le silence, tout le temps qu’avait duré la scène précédente. Longtemps il était resté les yeux fixés sur cette douce figure où venaient de se peindre les plus nobles sentiments ; et son regard observateur n’avait pu y surprendre ni la plus faible marque d’hésitation, ni le plus léger signe de regret. Julien avait agi simplement, honnêtement, par conviction.
Rempli pour le jeune homme d’une affection profonde, guidé par un instinct de l’âme qui ne devait pas le tromper, M. Raimbault n’était pas venu là, dans la seule intention d’y amener le baron de Fargueil, mais il voulait proposer à Julien une chose à laquelle il rêvait sans cesse. C’était la réalisation d’un projet mûri depuis longtemps ; la difficulté était d’amener la conversation sur le sujet qu’il voulait traiter :
« Savez-vous bien, mon ami, dit en hésitant le docteur, que vous m’inquiétez ; je ne crois pas à votre maladie, vous seriez venu me consulter. Je ne crois pas à des craintes qui vous font suivre un régime sans qu’on vous l’ait prescrit ; ce que je crois, c’est que vous avez un cœur si bien placé, une délicatesse si exquise, que vous trouvant à court d’argent peut-être ; — pardonnez ma supposition, — vous n’avez pas voulu en demander à Duval, parce que vous le savez gêné lui-même ; voyons, parlez sincèrement, est-ce cela ? »
A cette ouverture si franche, Julien se sentit prêt à faire l’aveu que sollicitait le docteur ; mais un mouvement de vanité mal entendue l’en empêcha.
« M. Duval ne me doit rien, puisque nous avons pris terme pour une époque plus éloignée ; pourtant, s’il me supposait sans argent, je suis certain qu’il en trouverait à tout prix ; heureusement, nous n’en sommes pas là, ajouta Julien avec un rire forcé !
— Dam, mon cher ami, on peut être gêné, et moi qui vous parle, je viens vous faire une prière qui vous prouvera que j’ai peu d’amour-propre, lorsqu’il s’agit de ces matières-là. J’attendais un ami, je lui avais fait préparer un logement tout près du mien ; hier, comme un franc étourdi, sans penser que je vidais le fond du sac, j’ai acquitté la note du tapissier ; mon banquier est jusqu’à demain à la campagne, et, moins heureux que vous, il se trouve que je suis aujourd’hui sans le sou... »
Un coup de foudre eût rendu Julien moins tremblant que ne firent ces mots du docteur ; son amour-propre l’avait porté à dire un mensonge ; il n’osait plus se rétracter, et balbutia d’une voix presque inintelligible : « Tout ce que j’ai est à votre service, docteur, mais le malheur veut qu’en ce moment...
— Vous êtes un peu désargenté, n’est-ce pas... Ah ! mon Dieu ! prêtez-moi quelques écus seulement... »
C’en était trop pour le pauvre Julien ; ses larmes coulèrent ; il se laissa tomber sur un siége. A cette vue, le bon docteur ressentit en son cœur, quelque chose de si douloureux qu’il lui sembla n’avoir jamais rien éprouvé de pareil ; il se mit à pleurer aussi. « Ah ! lui dit-il, vous m’aviez donc bien mal jugé, que vous n’avez pas osé m’ouvrir votre âme ? Ne voyez-vous pas que je vous aime comme un père. »
A ces mots, Julien se jetant au cou du docteur : « Oui, j’ai senti souvent que vous m’aimiez, dit-il ; oui, je vous ai vu souvent me regarder avec un air si rempli d’affection que j’ai pensé qu’un père n’en pouvait montrer davantage ; je dis que je l’ai pensé, puisque jamais les yeux d’un père ne se sont fixés sur les miens.
— Je sais cela, dit M. Raimbault ; Duval ne m’a rien laissé ignorer de ce qui vous touche ; c’est pourquoi je veux absolument que vous m’ouvriez votre âme... J’ai conçu un projet dont j’attends toute la joie de mes vieux jours. » Julien regarda le docteur d’un air surpris ; celui-ci lui serra la main, et continua en ces termes :
« Je me suis marié de bonne heure. J’avais un état que je m’étais choisi : j’avais une femme que j’adorais ; aussi, malgré vingt ans écoulés depuis que je l’ai perdue, son image m’est encore présente, et je chéris tout ce qui me paraît avoir avec elle le moindre trait de ressemblance. » En disant ces mots, le docteur jetait un regard de tristesse sur la chevelure soyeuse de Julien.
« Elle m’avait donné un enfant, continua M. Raimbault. La mère mourut en 1813 ; l’enfant fut tué par un affreux événement en 1814. Depuis lors, j’ai vécu seul, sans intérêt dans le monde, presque sans affection. Je vous ai vu, tout a changé : vous avez toutes les vertus que j’aurais souhaitées dans un fils, toute la chaleur de cœur qu’il faut pour comprendre le mien ; enfin, vous avez dans le regard, faut-il vous le dire, mon enfant, une expression de franchise et de bonté que je n’espérais plus rencontrer sur la terre ! Devenez donc mon fils, la loi m’autorise à vous adopter ; votre position vis-à-vis d’elle vous permet d’accepter mon offre, et si ma fortune, qui est considérable, peut éveiller encore vos scrupules, songez que je porte un nom honorable, et que, si je vous le confie, c’est parce que je sais que, porté par vous, il pourra devenir plus brillant sans cesser d’être aussi pur. »
Julien croyait rêver. Devant cet homme respectable qui venait lui demander, comme une faveur, à lui pauvre enfant sans famille, de l’accepter pour son père, il eut la pensée de s’agenouiller.
M. Raimbault le devina, et lui tendit les bras. « Voyons, dit-il, nous sommes des hommes ; laissez de côté toute puérile émotion, et répondez-moi, car ceci est sérieux, c’est mon bonheur que je vous demande, Julien !
— Votre bonheur ! répéta le jeune homme.
— Oui, mon bonheur. Acceptez-vous ?
— J’accepte votre amitié. Je serai votre fils par l’affection, par le respect ; mais vous avez une famille éloignée, des collatéraux : je ne veux dépouiller personne.
— Cette difficulté est facile à aplanir. Je leur laisserai moitié de ma fortune, plus même si vous l’exigez ; vous serez le maître de ma volonté... et cela n’est-il pas naturel, puisque vous remplacerez, près de moi, l’enfant que m’a ravi le ciel : mon pauvre Raphaël !
— D’où savez-vous mon nom, dit Julien avec étonnement ?
— Vous vous appelez Raphaël !... s’écria le docteur avec un indicible transport.
— Recueilli dans une maison qui sert d’asile aux enfants abandonnés, un bon vieux prêtre m’y donna le nom de Julien, qui était le sien. Plus tard, il m’emmena chez lui, m’y éleva comme son fils, et me donna l’instruction qui m’a mis à même d’arriver où je suis ; aussi, quoique je me rappelasse bien n’avoir jamais été appelé jusque là que du nom de Raphaël, je m’estimais trop heureux de porter celui de mon bienfaiteur.
— Et, savez-vous, mon ami, par quelle malheureuse circonstance, l’asile dont vous parlez, s’ouvrit pour vous recevoir ?
— Elle est aussi triste que simple, repartit Julien ; et voici comment le directeur de l’hospice des enfants-trouvés d’Angoulême me l’a racontée : « Un pauvre carrier, habitant le village de M..., proche Barbezieux, s’était vu forcé de faire la route de Bayonne à pied, afin... Mais, qu’avez-vous ?
— Oh ! ce n’est rien, reprit le docteur ; de grâce, continuez !...
— Forcé de faire à pied la route de Bayonne, pour y recueillir un mince héritage, il revenait chez lui, et traversait alors le village de ****, lorsqu’un rassemblement frappa ses yeux. La cause de ce rassemblement était un petit garçon qui, vu son extrême jeunesse, ne répondait aux nombreuses questions qui lui étaient adressées, que par un déluge de pleurs ; il disait que, pour avoir suivi d’autres enfants chargés de fleurs ou de fruits, il s’était séparé de son guide ; et, de cela, il devait y avoir longtemps déjà, car le malheureux pleurait de faim plus encore que de peur.
« Vous devinez quel était cet enfant ! L’ouvrier me prit dans ses bras, il m’embrassa et pleura sur moi, car il était père. Le résultat de la pitié que je lui inspirais, fut de l’engager à mille recherches, qui durèrent huit jours, et furent toutes infructueuses. Mais, ces huit jours passés, il ne se sentit plus le courage de m’abandonner ; il m’avait pris en affection, et son bon cœur lui inspira la pensée de m’adopter, et d’ajouter ce nouveau fardeau à celui d’une nombreuse famille.
« La femme de l’ouvrier était aussi bonne que son mari ; elle me reçut comme un présent du ciel, mais le faible héritage une fois mangé, la misère revint au logis, et le pauvre Étienne Bidon se vit, le désespoir dans l’âme, forcé de me conduire dans l’asile que je vous ai dit, avec la pensée plus terrible encore, qu’il lui faudrait peut-être un jour reprendre le même chemin pour conduire ses pauvres enfants dans cette fatale maison. C’était le 1er mars 1814 qu’Étienne m’avait recueilli ; ce fut le 20 janvier 1815 qu’il se sépara de moi. »
Tout le temps qu’avait duré le récit de Julien, M. Raimbault était parvenu à maîtriser son émotion, mais lorsqu’il entendit nommer le jour où avait été trouvé Julien, il lui fut impossible de se contenir davantage : « Oh ! Providence ! Providence ! murmura-t-il, vas-tu me rendre mon bonheur perdu ! »
Julien était muet d’étonnement. Il pressentait bien un mystère, mais il était si effrayé de l’agitation violente à laquelle M. Raimbault semblait en proie, que son effroi l’empêchait de se livrer aux vagues espérances qui germaient dans son cœur.
« Et n’avez-vous aucun papier qui puisse... balbutia le docteur.
— Aucun, répondit le jeune homme en baissant la tête.
— Oh ! Marie ! ma chère Marie ! fit le vieillard avec un geste de prière et de désespoir tout à la fois !... du haut du ciel, si tu m’entends, ne peux-tu me dire si c’est là notre enfant ? »
Raphaël semblait absorbé par une idée qui se faisait lentement jour dans son esprit. « Vous avez dit, Marie, demanda-t-il, et vous vous nommez Raimbault... — Michel Maurice Raimbault. »
Ces mots étaient à peine achevés que le jeune homme, se précipitant vers un meuble à demi ouvert, en tirait un médaillon dans lequel on voyait deux M. entrelacées. L’une était faite de cheveux blonds, l’autre de cheveux noirs.
« Tenez, dit-il, vous m’avez demandé si je ne possédais rien qui pût aider à découvrir qui je suis, — voilà ce qu’on trouva suspendu à mon cou... connaîtriez-vous cela ? »
D’une main tremblante, le docteur prit le médaillon ; il y jeta un rapide coup-d’œil, puis y collant ses lèvres, comme s’il eût senti que le premier acte de sa reconnaissance envers Dieu devait s’adresser au gage précieux, au souvenir jadis donné par lui à une femme chérie : « Oh ! merci, mille fois merci, s’écria-t-il presque en délire, à toi qui arrives là entre nous deux, comme une réponse de celle que j’invoquais tout à l’heure. »
Julien le regardait sans oser l’interrompre ; son tour était venu et le bon docteur lui tendit les bras en s’écriant : « Raphaël ! oh ! mon Raphaël, tu ne sais donc pas ! Je te conterai... J’étais en Espagne ; ne pouvant plus vivre sans toi, j’avais chargé un domestique, dont j’étais sûr, de te ramener près de moi. Le malheureux t’aura perdu... tu l’auras quitté, pauvre enfant ! et lui, n’osant plus revenir... Oui, c’est cela. Mon Dieu ! pardonnez-lui, car sa douleur aura sans doute payé sa faute... Tu ne dis rien ? N’est-ce pas que c’est bien affreux... dix ans de recherches !
Enfin ! enfin ! te voilà ! — te voilà ! s’écrièrent ensemble le père et le fils, en se jetant dans les bras l’un de l’autre.
Éclairé par le récit de Julien, M. Raimbault découvrit la demeure du pauvre ouvrier qui, par un élan d’humanité, avait ramené chez lui l’enfant abandonné.
En acquérant la certitude de sa triste position, le bon docteur, pour le récompenser de sa bonne action à laquelle la misère était venue mettre obstacle, se chargea des frais nécessaires à l’éducation de chacun des enfants d’Étienne Bidon.
Quant au vieux prêtre qui avait élevé Julien ; qui, par ses exemples et ses préceptes, en avait fait ce qu’il y a de plus beau dans le monde : un honnête homme, depuis déjà quatre ans il priait dans le ciel pour son fils adoptif. Le seul hommage que pût lui offrir M. Raimbault, fut donc adressé à sa mémoire ; et, chaque année, au jour anniversaire de sa mort, le pieux docteur entreprenait le voyage de Verteuil, pour aller déposer une couronne sur la dépouille mortelle du bienfaiteur de Julien.
Nous ne croyons pas avoir besoin d’ajouter quel contentement ressentit le bon Duval, lorsqu’il apprit l’aventure de son jeune ami. Quant au docteur, lorsqu’une fois les premiers instants passés, il se fut accoutumé à son bonheur, dès qu’il avait une heure de loisir, il l’employait à contempler Julien, à caresser du regard les cheveux blonds de son cher Raphaël, et quand celui-ci tournait vers lui les yeux pour le remercier de sa muette et affectueuse contemplation par un sourire, le pauvre père ne pouvait échapper à une pensée incessante, qui était celle-ci : « Voilà donc pourquoi j’aimais tant à le voir ! »

Quels sont ces monts superbes dont les cimes recouvertes de neige brillent au loin de la blancheur de l’albâtre, et dont les pics crenelés comme les tours d’une antique citadelle se projetent là-bas sur l’azur pâle du ciel ?
Dans ce vaste panorama de golfes, de villages et de montagnes, j’aperçois une végétation d’un vert glauque et des broussailles impénétrables : on dirait les terres vierges de l’Amérique... C’est la Corse ; oui, je la reconnais à cet aspect âpre et sauvage. Voilà le Monte-Rotondo, le Monte-Grosso, le Pic de Niole : ici Bastia, là Ajaccio, ville à jamais célébré par l’immortalité de l’homme dont elle fut le berceau.
S’il faut en croire le témoignage de Pline, cette île était très-florissante lors de la domination de Rome ; elle comptait alors trente-sept villes et une nombreuse population. Après la chute de l’empire romain, elle fut occupée successivement par les Goths, les Sarrasins, enfin par les Génois qui, pendant neuf cents ans, firent peser sur elle leur joug cruel et tyrannique.
Vers le milieu du dernier siècle, un de ses enfants, Pascal Paoli, voulut lui donner la liberté et des lois ; il attaqua les Génois et les chassa de presque tous les points de l’île. La république de Gênes, réduite à n’occuper que quelques villes du littoral, céda son droit de souveraineté à la France : les Corses se soumirent volontairement à leurs nouveaux maîtres, et une campagne suffit pour détruire le reste du parti indépendant. Paoli se retira en Angleterre ; mais à l’apparition de la Révolution Française, il crut l’occasion favorable et il retourna dans son pays. Après des chances diverses, il fut forcé de s’expatrier de nouveau, et la Corse devint une province française.
Ajaccio, sa capitale, est placée au fond d’un golfe, dans un site qui, vu de la mer, est pittoresque et varié. Quelques palais habités par les familles nobles de la Corse, quelques édifices publics bien bâtis et de bon goût, tels sont les principaux monuments de cette ville peuplée à peine de huit mille habitants. Mais le plus beau titre d’Ajaccio à la célébrité, c’est sa petite rue Saint-Charles. Venez, mes amis, venez la visiter avec moi. Ici, à droite, est la modeste maison où naquit Napoléon ; voici les murs bâtis par l’humble médiocrité, à l’ombre desquels a été bercé l’enfant qui devait aspirer, un jour, au trône du monde. Voilà la petite chambre où il reçut le jour : ce portrait que vous voyez suspendu au mur, en face de la porte, c’est le sien : ces yeux pénétrants, ce regard d’aigle font éprouver, en entrant, une émotion involontaire. Que cette tête est frappante de vérité et de ressemblance ! Le héros est représenté au temps de sa grandeur ; il est revêtu de la pourpre impériale et son front est ceint du laurier des Césars. C’est ici la place du lit où il jeta son premier cri : ces chaises, ces fauteuils sont ceux où il s’asseyait aux jours de son enfance... Dieu ! quels sentiments saisissent l’âme au souvenir de cette étrange destinée !... regardez là-bas ce point qui se détache à peine des côtes d’Italie : c’est l’île d’Elbe. Un jour que l’étoile du grand homme avait pâli, l’Europe coalisée contre lui, le força d’accepter ce coin de terre, en échange du plus grand empire qui eût été fondé depuis Charlemagne. Trop resserré dans cette étroite enceinte, Napoléon alla bientôt ressaisir le sceptre qu’on avait arraché de ses mains. Mais la fortune lui fut encore infidèle, et celui qui s’était trouvé assez puissant pour oser dire : L’univers c’est moi, fut condamné à aller mourir sur un rocher stérile.
La Corse est restée stationnaire au milieu de la civilisation ; le paysan est vindicatif, et les haines se transmettent comme les héritages ; mais si ces vengeances font naître très-fréquemment des crimes, vous allez voir qu’il est encore dans celle île, un peu sauvage, de sublimes dévouements et de nobles vertus.
Dans les derniers jours du mois de septembre 183..., le brick la Jeune Émilie, le plus fin voilier du port de Cette, revenait d’Ostende avec un chargement considérable. Après avoir franchi le détroit de Gibraltar, il avait pénétré dans la Méditerranée et, secondé par une bonne brise du sud-sud-est, il s’avançait rapidement vers le port. L’équipage, composé de gais enfants de la Provence, se livrait déjà à la joie du retour : chacun pensait aux amis qu’il allait revoir, aux parents qu’il allait embrasser. Mais la destinée, qui se joue de nos projets et de nos espérances, leur préparait une cruelle épreuve. Tandis que le brick, plus léger que la flèche, vogue à pleines voiles, des nuages sinistres s’amoncèlent à l’horizon ; déjà le vent siffle, bientôt l’obscurité succède au jour et la tempête éclate, horrible, furieuse, menaçant de tout dévorer. Pauvre brick ! en vain tu luttes contre elle, en vain ton équipage infatigable se multiplie pour te diriger, ses efforts sont impuissants. La mer bat avec rage les flancs délicats du navire, ses mâts sont brisés, ses embarcations enlevées par les lames : le vaisseau en travers n’obéit plus à la barre, et, pour comble de fatalité, une énorme voie d’eau se déclare. Les matelots épuisés ne peuvent suffire à la fois aux pompes et à la manœuvre ; c’en est fait, ils vont couler à fond !...
Tout cela se passait à une petite distance du port d’Ajaccio, car le brick, battu par un vent furieux, avait été jeté bien loin de sa route. Des marins réunis sur le rivage apercevaient ses signaux de détresse, mais nul n’était assez hardi pour lui porter secours, nul n’osait affronter une mort presque certaine. Infortunés ! j’entends vos cris de douleur et de désespoir : suspendez un instant vos alarmes, invoquez la patronne des matelots, priez-la de vous venir en aide : sa protection ne vous manquera pas...
Leurs prières ont été exaucées, car je vois accourir sur la plage le brave Pietri. « A moi, enfants, s’écrie-t-il, allons chercher ces malheureux ; » et aussitôt il se précipite dans une chaloupe. Mais aucun d’eux ne répond à son appel, le danger a paralysé tous les cœurs. « Eh quoi ! reprend-il, vous restez immobiles ; personne n’a le courage de me suivre ! Je saurai bien les sauver sans vous ; » et déjà la chaloupe a quitté le rivage. Avec quelle ardeur elle lutte contre les flots ? avec quelle vivacité elle s’élance sur le dos des vagues !... mais la tempête devient plus terrible, on dirait que la mer a reconnu son homme et qu’elle redouble de fureur pour conserver sa proie. Dix fois l’embarcation est repoussée vers le rivage, dix fois Pietri la ramène vers le navire ; enfin, après les plus pénibles efforts, il arrive près du brick : les matelots l’attendaient avec anxiété, il leur lance une corde et parvient à attirer dans sa chaloupe les huit hommes qui composaient l’équipage. Le capitaine seul refuse de descendre, les plus pressantes sollicitations ne peuvent le déterminer à abandonner son bord.
Pietri regagne la côte, mais sa tâche n’est pas finie. Le capitaine s’aperçoit bientôt que son obstination expose inutilement ses jours, et il fait des signaux de détresse. Pietri, quoique épuisé de fatigue, n’hésite pas à braver de nouveaux dangers ; cette fois, trois marins se joignent à lui, et ils sont assez heureux pour ramener le dernier des naufragés. Il était temps ; à peine avait-il mis le pied dans la chaloupe, que le brick disparut sous les flots. « Oh ! mon libérateur, s’écria-t-il, reçois cette bourse, c’est tout ce qui me reste ; mais je te la donne de grand cœur. » Pietri repousse la main du capitaine ; en vain on le presse, il est inflexible : il ne peut souffrir qu’on mette un prix à son dévouement : sa récompense, à lui, c’est le bonheur d’avoir arraché quelques victimes à la mer.
Quel est donc cet homme, aussi intrépide que généreux, qui affronte les périls et la mort avec tant de désintéressement ? c’est un pauvre pêcheur d’Ajaccio, qui ne possède pour tout bien que sa chaloupe, quelques filets et une chaumière.
Il y a peu d’années, il avait un fils, sa joie et son espérance, un fils qui l’aurait aidé dans ses travaux, et eût consolé ses vieux ans. Mais, un jour que Pietri était retenu dans son lit par une fièvre cruelle, ce jeune enfant s’aventura au loin dans un canot avec quelques-uns de ses compagnons. Une rafale fit chavirer la frêle embarcation, et les imprudents qui la montaient, furent engloutis. Pietri déplora la mort de ce fils chéri, et il jura sur sa tombe de secourir tous ceux qu’il verrait près de périr dans les flots : serment sublime qu’il ne trahit jamais.
Mais vous allez voir que le courage n’est pas la seule vertu de notre brave pêcheur. Un matin, la porte de sa chaumière s’ouvre, et un de ses voisins se présente conduisant par la main une jeune fille de trois ans, et portant dans ses bras un petit garçon de dix-huit mois. « Pietri, dit-il, une affaire urgente me force de me rendre sans délai sur le continent : ces enfants n’ont plus de mère, je te les confie, garde-les jusqu’à mon retour. » Pietri s’en charge volontiers. Mais les années s’écoulent, et le père ne revient pas. Il n’y a plus de doute : ces enfants sont abandonnés. Pietri ne balance pas, il les adopte ; il est bien pauvre ; mais qu’importe ? il redoublera de travail pour pourvoir à leur subsistance ; sa femme aussi le secondera pour que les pauvres orphelins ne manquent de rien.
Tant de vertus ne pouvaient rester ignorées. Le préfet de la Corse en fut informé ; mais telle était la modeste simplicité de Pietri que, pour obtenir quelques détails de sa bouche, il fallut procéder à un véritable interrogatoire, et employer, pour savoir de lui la vérité, les moyens en usage pour découvrir le crime.
Or, vous savez que M. de Montyon, cet homme généreux qui, pendant sa vie, s’est signalé par des œuvres si nombreuses de bienfaisance, a légué en mourant des sommes considérables destinées à fonder des institutions philanthropiques. Parmi ces legs, il en est un consacré à récompenser les actes de courage et de dévouement. L’Académie Française a reçu, du fondateur, la mission honorable et difficile à la fois de distribuer, chaque année, ces récompenses, connues sous le nom de Prix de vertu.
Le jour fixé pour cette touchante solennité, il y avait grande foule au palais de l’Institut. Un académicien, interprète des sentiments de ses collègues, prononça un discours plein d’éloquence et de sensibilité. Après avoir exprimé l’embarras de l’académie pour faire un choix parmi tant d’actes de vertus, dont nous sommes témoins chaque jour, il proclama les noms de ceux que l’académie avait couronnés ; celui de Pietri était en tête de cette liste honorable. L’orateur cita les traits admirables de vertu modeste et de courage héroïque qui avaient honoré la vie du pêcheur d’Ajaccio ; puis il annonça que l’académie lui avait décerné un prix de 6,000 francs. Ce récit, qui fit couler quelques larmes, fut accueilli par d’unanimes applaudissements.
A quelques jours de là, Pietri reçut une lettre qui l’invitait à se rendre à l’hôtel de la préfecture de la Corse. « Qu’est-ce cela, se dit-il, et que peut vouloir le préfet à un pauvre diable comme moi ? » Cependant, au jour et à l’heure indiqués, il se rend à l’invitation qu’il a reçue. On l’introduit dans un salon, où déjà quelques personnes étaient réunies. Le préfet lui explique la mission dont il est chargé et qu’il est si heureux de remplir ; il lui fait part de la distinction si flatteuse dont il a été l’objet, et il lui montre le prix qui lui a été décerné : « Brave homme, lui dit-il, prends cet or, il est à toi. » A l’aspect de cette somme étalée sur une table, Pietri promène autour de lui des regards étonnés, il lui semble rêver, il ne peut en croire ses yeux. « Eh ! quoi, tu hésites, reprend le préfet ; n’as-tu pas une femme, des enfants adoptifs ? Prends, te dis-je, jamais récompense ne fut mieux méritée. »
Pietri emporte son or et court à sa chaumière. « Femme, enfants, s’écrie-t-il de loin, plus de misère, plus de craintes de l’avenir » : et il leur montre ses richesses, et il leur apprend, dans son langage, comment cette fortune lui est venue. A cette nouvelle, il faut les voir, au milieu de leur joie naïve, sauter, courir ; on dirait qu’ils sont devenus fous. « Femme, cours à la ville, va vite acheter des habits neufs à ces pauvres enfants ; il y a longtemps que cela ne leur est arrivé. » — Homme simple et bon, tu ne t’occupes pas de toi, tu ne songes qu’au bien-être des enfants que la Providence a confiés à tes soins !
André le savoyard.

| Lith. de Cattier | |
| Alors celui-ci s’approchant poliment, chapeau bas, reçoit l’offrande de la jeune fille. | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Pietri vit heureux au sein de sa famille, et sa nouvelle aisance n’a rien changé à ses habitudes de travail et de dévouement. Chaque fois que la mer mugit, que la tempête éclate, il est là, sur la plage, observant avec anxiété tout ce qui se passe dans la rade d’Ajaccio. Un bâtiment est-il en péril, voit-il quelques signaux de détresse ? il accourt avec sa chaloupe ; et tel est le nombre des malheureux sauvés par son intrépidité, que ses concitoyens l’ont surnommé : la Providence des naufragés.
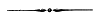

Je ne sais rien de plus réellement saisissant pour une âme bonne et généreuse que l’aspect de tous ces petits Savoyards qui, partis à pied du sein de leurs montagnes, viennent se réfugier à Paris, pour trouver, là, un asile et du pain. Vous les voyez partout, sur vos pas, vous poursuivant de leurs éternelles et caressantes suppliques. Et comment résister à leur voix touchante, à leur regard doux et pur... ils vous sourient si gracieusement ! Le croiriez-vous, mes enfants ? alors que vous voyez ce sourire qui fait mal, ces pauvres petits ont dit un adieu souvent éternel à leur famille, à la cabane qui les vit naître.
Et les voilà devenus tout à fait orphelins à Paris. Les pauvres petits demandent l’aumône ; mais c’est en attendant qu’ils puissent gagner autrement leur pain, car, ne vous y trompez pas, ces enfants-là sont nés actifs et laborieux. Aussi, comment ne pas s’intéresser à de petits êtres qui n’ont d’autre appui que la Providence ? Voyez-les, à moitié nus, tremblottant de froid, mourant de faim ; et pourtant que de petites gentillesses, de supplications enfantines ! ce sera toujours le rire sur les lèvres qu’ils vous diront : « Mon bon monsieur ! ma bonne dame ! un pauvre petit sou, s’il vous plaît ! »
Devenus plus grands, ils cesseront de mendier ; les uns feront alors voir des singes ou danser des poupées ; ceux-là balaieront les chemins ou ramoneront des cheminées ; d’autres enfin promèneront au besoin, dans Paris, de petites orgues mécaniques ; et, sur quelques-unes de nos places, ce spectacle excite parfois encore la curiosité des petits enfants.
Un jour donc, il y a de cela dix ans, madame Brémond sortait du Luxembourg avec sa fille Maria, bien charmante enfant, je vous jure. A peine cette dame avait dépassé la grille qui mène à la rue de Fleurus, que les oreilles de Maria sont frappées des sons d’un orgue mécanique. Un Savoyard placé là, près d’un mur, s’efforçait tristement, à l’aide de cet orgue, d’attirer les regards des passants ; mais, pauvre petit ! tout le monde s’éloignait, sans faire attention à lui.
« Ah ! petite maman, s’écrie alors Maria d’un air câlin, si tu voulais me faire bien plaisir, nous nous arrêterions un moment ; vois donc... comme c’est gentil ! »
Madame Brémond consent à faire la petite pause que sollicitait sa fille... Oh ! alors, à l’aspect de cette belle dame qui s’arrête devant son orgue, notre jeune Savoyard, dont le cœur bondit secrètement de joie, fait défiler aussitôt toute sa série de marionnettes, en accompagnant d’un gai commentaire leurs pantomimes grotesques. Tantôt c’est un régiment de cavalerie qu’il passe fièrement en revue, tantôt un intérieur de cuisine où la broche tourne, puis des femmes qui valsent, que sais-je !... et Maria de rire de si bon cœur !!! ce spectacle était en effet tout nouveau pour elle.
Quand sa curiosité fut une fois satisfaite, elle demande tout bas à sa mère quelque monnaie pour donner au Savoyard. Alors celui-ci s’approchant poliment, chapeau bas, reçoit l’offrande de la jeune fille, mais d’un air si reconnaissant ; il la remercie même en des termes si peu ordinaires chez les enfants de la Savoie, que madame Brémond en demeure tout étonnée. « Voilà, se dit-elle, un pauvre enfant qui a reçu une éducation trop supérieure au triste métier qu’il fait pour que ceci ne cache pas un mystère que je suis curieuse d’approfondir. » Se tournant donc vers son protégé : « Mon ami, si je vous priais de venir, avec cet orgue, demain soir, chez moi, y consentiriez-vous ? Je réunis quelques petites amies de ma fille ; ce spectacle les distrairait ; voici mon adresse, ajouta-t-elle, en lui tendant une belle carte glacée or.
Le Savoyard, tout confus d’une offre si bienveillante, s’empressa de remercier madame Brémond de la manière la plus touchante, et lui promit bien de se trouver, le lendemain chez elle, à l’heure indiquée.
André (c’était son nom), fut en effet très-exact au rendez-vous. Il y avait nombreuse compagnie chez madame Brémond. Comme on avait annoncé d’avance, aux enfants qui faisaient partie de cette brillante réunion, le divertissement dont ils devaient jouir, dès qu’André fut arrivé, il n’y eut pas moyen pour madame Brémond de satisfaire sa curiosité, quoiqu’elle ne se fût, en réalité, servie du prétexte de sa soirée, que pour connaître l’histoire du Savoyard, dont la jolie figure, les manières et le langage l’avaient si fort intéressée.
Le spectacle fut trouvé charmant. Lorsqu’André eut, jusqu’à satiété, fait défiler et danser ses marionnettes, madame Brémond prenant la parole : « Bien, très-bien, mon ami... c’est assez... Comment vous nomme-t-on ? — André, ma belle dame. — Eh bien ! André, suivez ce domestique à l’office ; après quoi, vous remonterez... j’ai à vous parler. »
André refusa d’abord par timidité, mais il finit par accepter en assurant madame Brémond de toute sa reconnaissance. Dès qu’il fut sorti, cette dame confia aux personnes de sa société, au nombre desquelles était son frère, riche négociant, le sentiment tout particulier d’intérêt que lui avait inspiré la vue de cet enfant, et l’espèce d’éducation qu’il semblait avoir reçue. Chacun des assistants partagea sa sympathie et sa curiosité.
Au bout de dix minutes, le jeune Savoyard reparut à la porte du salon ; il s’y tenait humblement blotti, son bonnet à la main.
« Ah ! ah ! vous voilà, dit madame Brémond dès qu’elle l’aperçut ; avancez donc, André ; soyez sans crainte. »
Et le jeune Savoyard d’approcher timidement, les yeux baissés. « Mon ami, reprit sa protectrice, ces messieurs et ces dames désirent, ainsi que moi, connaître toutes les particularités de votre enfance. J’ai cru deviner à votre langage que vous n’aviez pas été destiné d’abord au triste métier que vous faites.
— Hélas ! madame, murmura l’enfant en poussant un gros soupir.
— Tenez, asseyez-vous près de moi, et ne nous cachez rien. »
André, que l’aspect d’un superbe salon éclairé de cent bougies, et d’un si brillant cercle de beaux messieurs et de belles dames, ayant, tous, les yeux fixés sur lui, avait intimidé d’abord au-delà de toute expression, reprenant enfin quelque assurance, grâce au ton de bonté de madame Brémond, promena ses grands yeux bleus, autour de lui, puis commença, d’une voix tremblante, son histoire en ces termes :
« Je suis né dans un petit hameau du Chablais, en Savoie ; j’avais deux ans, quand j’eus le malheur de perdre mon père, et de me trouver à jamais privé de ses embrassements. Ma pauvre mère faillit succomber à sa douleur ; elle restait seule, avec moi, sans pain, sans moyens d’existence. Hélas ! nous avions perdu notre unique appui. Cependant, m’a-t-on dit, — car j’étais trop jeune alors pour rien comprendre à notre infortune, — loin de se laisser abattre par l’horreur de sa position, ma bonne mère fit tant par son travail qu’elle parvint à m’élever jusqu’à l’âge de six ans ; mais alors ses dernières ressources se trouvant épuisées, elle me dit un jour les larmes aux yeux : « André... mon cher André... — Ah ! ma bonne dame, je crois l’entendre encore, — il est, sais-tu bien, une Providence pour l’enfant du Savoyard ; demain, quatre jeunes gars de nos montagnes font route pour la France, cette patrie adoptive des fils de la Savoie... Eh bien ! pars avec eux, petit, pars ; laisse-moi seule ici... Va à Paris gagner le pain qu’on y offre à l’indigence. » En entendant ces paroles terribles, je me jette dans les bras de la pauvre mère, et je m’écrie : « Non, non ; moi, vous abandonner ! jamais. — Il le faut, André, reprit-elle en pleurant à sanglots, il le faut... Hélas ! je ne puis plus te nourrir... moi... Veux-tu donc, cher petit, mourir de faim sous mes yeux ? Pars, te dis-je, reçois ma bénédiction ; puisse le ciel accompagner tes pas et te ramener un jour dans mes bras ! » La pauvre mère et moi nous fondions en larmes... Et pourtant le lendemain, il fallut partir, la quitter, dire un éternel adieu à mon hameau, à notre cabane. »
Ici, le petit Savoyard fit une pause involontaire, leva tristement, comme de souvenir et les mains jointes, ses yeux vers le ciel ; sa voix s’était éteinte. Cette première partie de son récit avait déjà ému l’auditoire. Il se fit un moment de silence, que madame Brémond interrompit par ces mots, prononcés de sa voix la plus douce : « Poursuivez... nous vous écoutons.
— Eh bien ! donc, reprit André en poussant un soupir, les cinq petits enfants de la Savoie se mirent en route ; quant à moi, j’étais si faible qu’il m’était impossible de marcher ; mes camarades me portaient tour à tour sur leur dos, et c’est ainsi qu’après bien des privations et des fatigues, nous nous acheminâmes enfin jusqu’à Paris. Presque en arrivant, l’un de mes compagnons de voyage me fit entrer au service d’un maître, j’appris à ramoner les cheminées ; parfois je trouvais à travailler ; le plus souvent je ne vivais que d’aumônes. Il me fallait pourtant rapporter, chaque soir, vingt sous au maître. Quand je lui rendais moins, cet homme cruel refusait de me donner à manger ; puis, il me frappait à grands coups de fouet jusqu’au sang. »
A peine André venait d’achever ces mots qu’un sentiment unanime de pitié se manifesta chez toutes les jolies petites filles qui entouraient le jeune Savoyard, par cette exclamation subite : « Ah ! mon Dieu !... pauvre enfant ! »
Ce noble élan de sensibilité alla droit au cœur d’André. Après avoir remercié, d’un regard triste et doux, Maria et toutes ses jeunes amies, si compatissantes au malheur, il poursuivit ainsi : « Sans les quelques morceaux de pain que je recevais des âmes charitables, je serais inévitablement mort de faim ; enfin, un soir, que je n’avais pu, même en mendiant, ramasser plus de huit sous dans ma journée, je rentrais en tremblant au gîte. Cette fois, sans écouter tout ce que je pus lui dire pour l’attendrir, sans pitié pour mes larmes, le maître saisit un bâton, m’en frappa avec furie ; et, après m’avoir pris mes petits sous, me jeta d’un coup de pied à la porte. J’avais sept ans alors... Jugez de ma terreur, de mon désespoir ! j’eus beau embrasser ses genoux, le supplier de me donner au moins un pauvre petit morceau de pain, car je n’avais rien mangé de la journée... Le barbare fut inexorable et me repoussa dans la rue.
« C’était au mois de décembre ; j’étais sans bas, sans souliers, à peine vêtu ; il faisait un froid mortel, et je tombais de besoin. Je me traînai, en pleurant, le long du faubourg Saint-Antoine ; je ne savais où porter mes pas, où passer la nuit. J’étais enfin parvenu à l’entrée du boulevard, quand je sentis tout à coup mes jambes fléchir sous moi... Alors je m’agenouille contre une borne et m’écrie avec douleur : « Ma mère ! ma pauvre mère ! c’en est donc fait... je ne te verrai plus... Tu m’avais cependant bien dit : André, sois sage, laborieux, honnête, la Providence ne t’abandonnera pas ; le ciel veille sur les malheureux... et pourtant je me meurs... »
« J’achevais ces mots, et déjà mes yeux se fermaient à la lumière, lorsqu’une main me frappe soudain l’épaule : « Petit, petit, que fais-tu là, dit en même temps une voix d’homme ; » mais moi, j’étais si faible que je ne pus que soulever à demi ma tête qui posait contre le mur : « Hélas ! balbutiai-je, mon bon monsieur, je meurs de faim. — Juste ciel, pauvre enfant, reprend vivement l’inconnu, » et il me soulève par les bras, m’assied sur la borne, vole à un café qui se trouvait en face. En moins d’une minute, il revient, me fait respirer des sels, me donne à boire un petit verre de je ne sais quoi qui ranime aussitôt mes sens. Mon premier mouvement fut de saisir sa main, de la lui baiser : « Ah ! bon monsieur, vous m’avez sauvé la vie, m’écriai-je. — Pauvre petit ! j’espère bien faire plus encore, repartit mon généreux bienfaiteur ; mais déjà des curieux nous entourent. Il faut nous éloigner, suis-moi. » Je fis de vains efforts pour me lever et lui obéir. « Allons, allons, tu es trop faible pour marcher, je le vois... » En disant ces mots, il arrête un fiacre au passage ; nous y montons.
« Chemin faisant, il me questionne ; je lui raconte naïvement mon départ du Chablais, mon aventure chez mon méchant maître ; il gardait le silence, mais il paraissait visiblement ému. Une fois arrivés chez lui, il me fait souper près d’un bon feu, et c’est alors qu’il m’adresse ces mots que je n’oublierai de ma vie... (Ici André s’arrêta pour essuyer quelques larmes qui venaient mouiller sa paupière.) « Mon petit André, dit il, tu es du Chablais, et moi aussi je suis Savoyard ; moi aussi je suis venu à Paris bien malheureux, mendiant mon pain ; j’ai dû à l’humanité d’une âme compatissante d’avoir été recueilli comme je te recueille aujourd’hui ; mon bienfaiteur m’a servi de père... Eh bien ! je prétends à mon tour t’en tenir lieu ; il m’a fait donner de l’éducation... je me charge de la tienne ; bref, j’ai fait fortune, je suis sans enfants : il est juste que je rende, à un petit pays, une partie du bien qu’on m’a fait. C’est le ciel qui a dirigé mes pas vers toi... Voyons, parle... veux-tu rester avec moi, me devoir ton bonheur ? » J’étais si troublé, je suffoquais tant de joie, que je ne pus que me jeter dans ses bras, sans dire un mot ; il m’embrassa et me fit coucher dans un bon lit.
« Ce qui venait de m’arriver était un songe pour moi ; je ne fis, toute la nuit, que penser à ma pauvre mère et remercier Dieu de l’appui inespéré qu’il venait de m’envoyer... Mais peut-être, belle dame, dit en s’interrompant ici tout à coup André, et interrogeant madame Brémond, d’un regard timide, peut-être abuse-je de votre indulgence et de celle de l’honorable compagnie... et ce récit...
— Poursuis, poursuis, mon ami ; tu vois avec quel intérêt chacun de nous t’écoute, et surtout ces chers enfants qui t’entourent.
— Oh ! oui, monsieur André, répéta tout d’une voix, le petit auditoire.
— Puisque vous daignez le permettre... Au bout de quelques jours, j’étais déjà placé au collège, vêtu comme un petit prince, ne manquant de rien, travaillant de tout cœur. Ah ! dam’, il fallait voir ! aussi j’appris bientôt à lire, à écrire, à calculer. Mon vénéré protecteur m’envoyait chercher régulièrement, tous les quinze jours, pour mieux juger de mes progrès. J’étais heureux alors, bien heureux sans doute... et pourtant quelque chose encore manquait à mon bonheur : c’était d’avoir des nouvelles de ma pauvre mère.
« Un jour que je venais, comme de coutume, chez mon père adoptif : « André, me dit-il dès qu’il me vit, tu écris déjà comme un homme ; eh bien ! mon garçon, tu peux maintenant te procurer une jouissance bien grande, celle d’écrire au pays — Ah ! mon cher bienfaiteur, m’écriai-je en lui sautant au cou, voilà précisément la faveur que j’ambitionnais, et si je travaille avec tant d’ardeur... — C’est bien, reprit-il, je vois que nous avions, sans le savoir, tous deux la même idée ; cependant, réflexion faite, comme tu serais naturellement assez embarrassé pour expliquer à ta mère, les conséquences de ta position nouvelle, je me charge, pour cette fois, de lui écrire en ton nom ; seulement tu lui joindras deux lignes de ton écriture, en post-scriptum, pour l’embrasser et la prévenir que tu lui envoies 100 francs à toucher au pays, et que tu lui feras pareil envoi, tous les trois mois.
« Je vous laisse à juger de ma surprise et de ma joie. Tous les trois mois, j’écrivais à ma pauvre mère ; j’en recevais, deux fois l’an, des nouvelles ; elle se portait bien, elle était heureuse... Que manquait-il à mon bonheur ?
« Trois ans s’étaient écoulés ainsi ; je faisais des progrès rapides ; j’avais remporté bien des prix ; j’entrais dans ma onzième année. Vers les derniers temps, mon père adoptif avait pris l’habitude de venir me chercher lui-même, chaque dimanche, au collège ; nous passions la journée ensemble en promenade, il me reconduisait le soir. Un jour donc, jour à jamais fatal ! que je l’attendais, même de bonne heure, car il me l’avait bien promis, la matinée se passe,... je ne le vois pas venir ; tout d’abord je crus qu’une affaire importante lui avait fait oublier son petit André, mais la journée s’écoule... et toujours personne. Une inquiétude mortelle s’empare de moi ; c’était comme un pressentiment funeste. Je me décide à lui faire part du profond chagrin que j’éprouvais, en le conjurant de venir me voir, le dimanche suivant. Hélas ! cette lettre, il ne la devait pas recevoir.
« Je charge de mon message le concierge du collège, et j’en attends avec anxiété la réponse. Quelle réponse, grand Dieu ! j’apprends que mon bienfaiteur, mon seul appui, mon sauveur, était mort !... Oui, mesdames, mort subitement depuis cinq jours... et j’étais resté là, moi, cloué entre quatre murs, sans le moindre avis, dans la sécurité la plus profonde... et je n’avais pu même le presser dans mes bras à ses derniers moments. Ce coup était affreux ; je tombai sans connaissance, comme frappé de la foudre, et je ne revins à la vie que pour déplorer plus amèrement encore la perte de l’homme vénéré qui m’avait comblé de tant de bienfaits.
« J’étais, depuis ce jour cruel, demeuré dans l’ignorance la plus complète sur mon propre avenir. Mon père adoptif avait des parents éloignés ; après l’avoir jadis brutalement repoussé dans sa misère, ces méchantes gens s’étaient, depuis, fixés en secret à Paris pour couver, de plus près de l’œil, son immense héritage. Sans méfiance aucune et de leur existence et de leurs projets, mon bien-aimé protecteur avait fait préparer, pour le jour même de sa fête très-prochaine, ce qu’il appelait mon acte d’adoption. Il s’en réjouissait tant !... Il était si heureux !... Et dire que la mort, une mort subite, étrange... (Et la voix d’André vint encore ici s’éteindre dans les larmes.) Enfin, M. le principal du collège voulut bien tenter, en ma faveur, quelques démarches auprès de ces héritiers, peut-être bien coupables... Alors ils déclarèrent froidement que j’étais un étranger pour eux ; que le défunt avait bien pu me recueillir par pitié, selon son bon plaisir, mais qu’ils n’avaient point à se charger des enfants d’autrui ; ils eurent toutefois la générosité de remettre, pour moi, à ce respectable monsieur, la somme de 60 fr. à titre d’aumône, en ajoutant, avec une cruelle ironie, que bien des Savoyards, vivant à Paris, n’avaient jamais eu pareille fortune à leur disposition... Et pourtant j’eus, faut-il l’avouer, le courage de recevoir cette humiliante aumône, car cet argent, voyez-vous, devenait un trésor pour moi : il était destiné à ma pauvre mère ; il devait l’aider à soulager, quelque temps encore, sa misère. Celle idée consolante vint adoucir un peu l’amertume de mon chagrin ; mon cœur éprouvait un autre besoin non moins impérieux : celui d’aller arroser de mes larmes, la tombe de mon bienfaiteur. « Au moins, me disais-je, les barbares qui m’ont repoussé, ne me raviront pas cette consolation dernière ; je pourrai, tous les jours, le voir, lui parler demander à son ombre qu’elle veille toujours sur moi ; du haut du ciel, il contemplera lui le pauvre Savoyard agenouillé sur son tombeau : il exaucera ses vœux. »
« Il m’avait fallu quitter le collège ; je me retrouvais, une fois encore, seul et sans appui. Qu’allais-je faire ? Trop jeune pour occuper un emploi ; devenu trop fier pour mendier, j’étais décidé à apprendre un métier, lorsqu’un de mes pays me rencontre un matin, triste, abattu... Je lui raconte mes malheurs ; il en est touché ; avec le fruit de bien longues épargnes, il avait acheté le petit orgue que vous venez de voir ; il m’offre généreusement de me le louer pour m’aider au moins à vivre, en attendant que je puisse faire quelque chose de mieux ; un gros négociant venait de l’attacher à sa maison en qualité d’homme de peine ; j’accepte avec reconnaissance sa proposition,... et voilà, enfin, depuis trois mois, le pauvre commerce que je fais ; tous mes petits gains, je les partage en frère avec ce digne pays. Je pourrais être plus heureux sans doute, mais j’attends, pour un meilleur sort, tout de l’âge, de mon travail, et surtout de la Providence. »
Ainsi finit le récit d’André le Savoyard. Madame Brémond et sa compagnie l’avaient écouté avec un intérêt si constant et si vif qu’à peine l’enfant eut achevé de parler et se fut aussitôt levé d’un air modestement timide, toutes les dames et les petites demoiselles elles-mêmes, d’un mouvement spontané, avaient fait, à la dérobée, entre elles, une collecte qui produisit une somme de 120 francs.
Les deux frères.
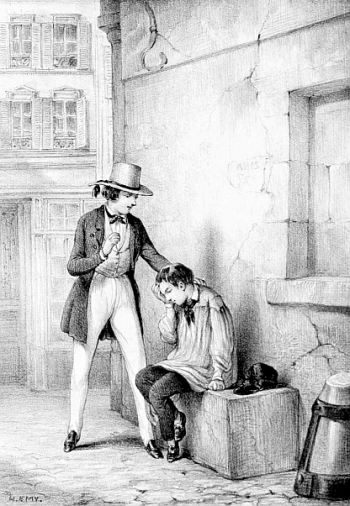
| Lith. de Cattier | |
| Adrien... dit Jules. | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Déjà madame Brémond allait remettre cet argent au pauvre André qui, tristement retiré en un coin du salon, n’attendait plus, pour prendre décemment congé de l’assemblée, que quelqu’un au moins tournât les yeux de son côté, lorsque le frère de cette dame, silencieux jusque-là, fait soudain signe à l’enfant de demeurer, et dit d’une voix élevée : « C’est très-bien, ma sœur et mesdames ; vous venez de payer votre tribut à l’humanité, à la piété filiale ; mais je leur dois aussi le mien. » Puis, interpellant André, et lui tendant cordialement la main : « Mon ami, vous vous êtes montré bon fils, reconnaissant et digne envers votre protecteur ; vous n’avez surtout jamais désespéré de la Providence... Eh bien ! l’avenir qui vous était réservé s’accomplira ; j’achèverai, moi, l’œuvre de votre père adoptif. Dès ce jour, vous m’appartenez, vous entrez dans mes bureaux ... — Ah ! monsieur, interrompit l’enfant, en se précipitant aux genoux du frère de madame Brémond. ». Mais celui-ci le relevant et pressant ses deux mains dans les siennes, ajoute alors d’un ton plus pénétré, plus affectueux encore : « André, mon ami, sois sage, laborieux, honnête homme, et je ferai de toi un commerçant estimable. J’ajoute, pour commencer, 180 francs à la généreuse offrande de ces dames ; cela fera cent écus ; tu les enverras à ta mère, André, pour qu’elle ne cesse de te bénir ; car rien, vois-tu, ne porte bonheur aux enfants, comme la bénédiction d’une mère. »
Un dénoûment si imprévu remplit André d’un saisissement inexprimable. Il fallait voir, mes amis, la joie, les larmes, l’effusion de reconnaissance de cet excellent petit Savoyard, pour madame Brémond, pour son frère, pour toutes les dames et les jeunes filles, surtout pour la charmante petite Maria, qui était, à ses yeux, la cause première de tant de félicités. André pleurait, s’agenouillait, baisait avec ivresse les mains de toutes ses bienfaitrices... Non, jamais scène ne fut plus attendrissante.
M. André ***, — le petit André le Savoyard d’autrefois, — est, aujourd’hui, l’associé de l’un des plus honorables fabricants de la Capitale.
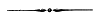

Dans une des chambres d’un modeste hôtel garni des quartiers retirés de Paris, se trouvaient réunis, vers deux heures de la journée, une femme et deux enfants. Cette femme, jeune encore, paraissait malade ou malheureuse. Assise dans un large fauteuil, le seul de l’appartement, elle semblait absorbée par de tristes préoccupations. Ses yeux cernés accusaient des chagrins intérieurs ; la pâleur de son teint et l’extrême maigreur de toute sa personne prouvaient sa souffrance. A quelques pas loin d’elle, l’aîné de ses fils, — car ces deux enfants lui appartenaient, — debout, derrière les vitres de la fenêtre, semblait attendre impatiemment quelque chose ; il pouvait avoir quinze ans ; il était brun, fort et grand pour son âge.
Quant au plus jeune, âgé d’environ huit ans, ses cheveux étaient blonds et flottants sur ses épaules ; sa fraîcheur et sa délicatesse le faisaient ressembler à une fille ; il était doux et aimant ; il s’approcha de sa mère et l’embrassa.
« Maman, dit-il, je vais aller voir en bas si le facteur est arrivé, » et il sortit.
Le malheur était venu, tout à coup, accabler cette pauvre famille, naguère riche et fortunée, aujourd’hui isolée et misérable. La mère avait épousé (il y a de cela seize ans), un riche négociant de Rouen ; elle avait eu de ce mariage deux fils, Adrien et Jules : les deux enfants dont nous venons de parler. M. Davenne, qui croyait pouvoir laisser un jour à ses fils une grande fortune, les faisait brillamment élever. Mais, au milieu de ce bonheur, un événement imprévu vint les atteindre tous. M. Davenne se brisa la tête dans une chute et mourut sur le coup, sans avoir pu se reconnaître. Cette catastrophe ne fut pas la seule que cette infortunée famille eût à déplorer. Leur fortune leur fut disputée, et lorsqu’il fallut faire valoir les droits des héritiers de M. Davenne, un papier important manqua, ce papier, qui seul pouvait les envoyer en possession, avait été soustrait ; mais qui était l’auteur de cette soustraction ? on l’ignorait. L’associé du défunt, M. Armestrong, en accusa M. Davenne et refusa tout partage ; il fallut avoir recours aux tribunaux. Madame Davenne perdit son procès. On lui conseilla d’aller se fixer à Paris, et de le suivre elle-même en appel. Déjà cinq mois s’étaient écoulés depuis son arrivée à Paris, et le jour même où ce récit commence, la pauvre veuve n’avait obtenu encore aucune décision relative à ce procès, qui semblait au contraire se prolonger indéfiniment.
Éprouvée par tant de revers, seule, sans appui, sans ressources, vendant au fur et à mesure, pour vivre, le peu qui lui restait de son ancien luxe, madame Davenne, minée par le chagrin, tombe en un état de langueur : la poitrine était attaquée ; bientôt elle comprit que la mort la menaçait ; que deviendraient alors Adrien et Jules ? Pouvait-elle les abandonner ainsi, ces chers enfants, si nobles et si tendres pour elle dans ses malheurs ! qu’au moins, se disait-elle alors, la sollicitude de leur mère leur soit un dernier aide dans cette vie ! Elle se décida donc à écrire pour eux à un parent éloigné, le seul qui lui restât ; elle lui fit part de sa position cruelle, de l’état de sa santé, de ses justes terreurs de laisser ainsi ses deux fils orphelins ; enfin elle lui demanda un conseil et un appui pour eux.
Cette lettre écrite, madame Davenne fut plus tranquille. M. Dormont, le parent en question, gros marchand d’une des provinces du nord, avait fait sa fortune lui-même ; il était honnête homme, et sans doute il viendrait à leur aide. — C’est cette réponse qu’elle attendait le jour même où commence cette histoire. Jules, assez grand déjà pour être le confident de sa mère, attendait aussi cette réponse avec une vive impatience, non pour lui, mais pour cette pauvre mère qu’il voyait mourir sous ses yeux, et pour laquelle il ne pouvait rien.
Un pas léger se fit entendre. Adrien rentra en courant : « Maman, maman, voilà la lettre, dit-il avec joie. » Madame Davenne la prit avec anxiété ; Jules se rapprocha d’elle vivement ; Adrien se tapit sur un tabouret auprès de sa mère.
M. Dormont écrivait à sa parente qu’il était affligé de ses malheurs ; il lui offrait de se charger de son jeune fils Adrien, de le faire élever avec le sien, qui était à peu près du même âge, et plus tard, de l’associer à son commerce : il lui assurait ainsi un état pour l’avenir. Quant à Jules, il envoyait une lettre de recommandation pour le placer chez un libraire de sa connaissance, où, avec de la conduite, il gagnerait quelque chose.
« Eh bien, ma mère, dit Jules, que vous mande mon oncle ? »
Madame Davenne donna la lettre à son fils : « Tiens, lui dit-elle.
— Ma mère, dit Jules après avoir parcouru la lettre de son oncle ; ma mère, j’accepte, j’accepte de grand cœur : il n’est pas de métier que je ne fisse pour l’amour de vous ; quand je pense que je ne puis rien pour vous soulager !
— Jules !... mon Jules ! mon fils, dit-elle avec attendrissement ; viens sur mon cœur. » Elle le pressa dans ses bras.
« Adieu, ma mère, reprit l’enfant ; je vais me présenter immédiatement chez ce M. Plesque, le libraire. »
Ce libraire était établi à quinze lieues de Paris. Grâce à la recommandation de son oncle, Jules fut agréé tout de suite par lui et mis en fonctions comme petit commis. Au bout de dix jours, il écrivait déjà à sa mère, en lui envoyant l’argent de sa première semaine ; et, pour la consoler, il se disait heureux et content.
Mais le départ de Jules avait encore éprouvé bien cruellement la pauvre veuve. Se sentant toujours de plus en plus faible, elle se décida à aller enfin conduire elle-même son plus jeune fils chez son oncle, voulant ainsi, avant de mourir, les voir placés tous deux.
Elle partit donc avec Adrien et arriva, le lendemain fort tard, dans la petite ville de V***, où demeurait M. Dormont ; elle le fit prévenir ; il était dix heures du soir, lorsqu’il vint.
« Mon oncle, lui dit-elle, voilà mon fils, je vous l’ai amené ; c’est une grande peine pour moi de m’en séparer, une bien grande. Mais, la volonté de Dieu soit faite ! » ajoute-t-elle.
M. Dormont passa ses mains sur ses yeux ; la vue de l’enfant et de la pauvre mère l’attendrissait.
« Vous serez bon pour lui, n’est-ce pas, mon oncle ; vous me le promettez ? — Je vous le promets, ma nièce. »
M. Dormont était un honnête homme ; sa parole avait de la valeur ; elle rassura un peu madame Davenne ; toutefois, le moment de la séparation fut bien triste ; elle aimait particulièrement cet enfant ; il était le plus jeune ; ses soins lui étaient plus nécessaires qu’à Jules ; mais elle ne pouvait demeurer près de lui ; des soucis cuisants la rappelaient à Paris ; dans sa pensée, peu de jours lui restaient à vivre.
La fatigue du pénible voyage que venait de faire madame Davenne, avait accéléré son mal. Quand elle rentra chez elle, à Paris, et qu’elle vit sa chambre silencieuse et solitaire, Adrien parti, parti pour toujours, ainsi que Jules, il lui sembla qu’elle n’avait plus rien à faire en ce monde ; elle appela le médecin, et écrivit à son fils aîné de venir la voir, qu’elle allait mourir.
Lorsque Jules reçut cette lettre, il fut accablé de douleur ; il courut à son maître, lui demanda de lui avancer son premier trimestre, pour le porter à sa mère, qui se mourait ; mais celui-ci, se demandant si Jules reviendrait bien réellement, et d’ailleurs, n’étant pas dans l’usage de payer d’avance ses commis, lui refusa cette avance. Jules, irrité et malheureux, se révolta contre ce qu’il appelait de l’inhumanité... Furieux à son tour d’une telle insulte, son patron le chassa.
Jules, au désespoir, arriva chez sa mère le soir même ; elle était mourante : il n’eut que le temps de l’embrasser une dernière fois encore, et de lui jurer d’être le protecteur de son jeune frère, de ne le quitter jamais. Cette assurance consola un peu la pauvre mère, qui mourut en bénissant son enfant.
Après avoir pieusement et tristement rendu les derniers devoirs à sa mère, Jules pensa à son frère, aux promesses qu’il lui avait faites à son lit de mort, de ne pas le quitter ; il réalisa donc ce qui lui restait de leur petite fortune, et se mit immédiatement en route pour aller voir Adrien et son oncle.
Adrien, après le départ de sa mère, avait été amené chez son oncle, et confié aux soins d’une vieille servante, qui élevait aussi Ernest, le fils de M. Dormont. Bien chagrin d’être séparé de sa mère, l’enfant fut longtemps à pouvoir se consoler ; mais peu à peu il se calma. Ernest, un peu plus âgé que lui, heureux d’avoir un petit camarade, lui montra tous ses jeux, tous ses plaisirs, et les lui fit partager ; d’ailleurs M. Dormont, excellent homme au fond, touché de la position du pauvre Adrien, fut pour lui plein de bontés. Mais, dans cette maison, chacun travaillait ; avec le temps, il lui fallut aussi régler sa vie, étudier, prendre des habitudes. Adrien avait été gâté par sa mère ; il n’était point accoutumé à se soumettre ; de son côté, Ernest, enfant d’un méchant naturel, mutin et grandeur, querellait souvent Adrien. M. Dormont, occupé qu’il était d’affaires, se contentait d’interroger chaque matin Marthe, sur la conduite des deux enfants ; et alors il distribuait les punitions ou les récompenses, selon que les enfants le méritaient, car il croyait de son devoir d’être sévère pour eux. Adrien, timide et craintif, habitué à plus d’indulgence, ne pouvait donc se faire à sa nouvelle existence. Il devenait caché vis-à-vis de la vieille Marthe, parce qu’il la craignait. Celle-ci s’en plaignait et reprochait souvent à l’enfant cette dissimulation. « Il deviendra menteur, disait-elle sans cesse à son maître.
— Menteur ! mais c’est un affreux défaut ; il faut l’en corriger.
— L’autre jour, je l’ai vu casser une vitre de la boutique ; et, quand je lui reprochai ce fait, il le nia, et avec un front...
— Je ne puis souffrir les menteurs ; que je sache le premier mensonge qu’il fera, je le guérirai de cette manie, moi, dit M. Dormont d’un ton sévère ; avertissez-moi, Marthe.
Quelques jours après cette remontrance, M. Dormont, un peu malade, déjeunait, plus tard que de coutume, avec du thé et des petits pains beurrés ; il était alors dans son arrière-boutique ; on vint lui dire qu’une dame le demandait au magasin. Cette dame était une de ses meilleures pratiques. M. Dormont quitta tout pour aller lui parler.
Ernest et Adrien, assis tous deux sur des tabourets dans le bureau, étaient occupés à apprendre leurs leçons du jour. Aussitôt que M. Dormont fut parti, les yeux d’Ernest quittèrent l’ardoise, sur laquelle il faisait des chiffres, et se portèrent sur le petit pain beurré, que son père avait laissé entamé ; l’envie lui en prit ; il soupira en le regardant, puis se tourna et retourna sur son tabouret ; ensuite, il se leva, contempla le gâteau à une distance respectueuse, puis se rapprocha graduellement. Après avoir regardé à travers la porte vitrée, il vit son père occupé avec la dame ; alors il réfléchit, fit diverses conjectures : son père avait peut-être fini de déjeuner... Il se pourrait qu’il ne revînt pas... ou s’il revenait, qu’il ne s’aperçût pas de l’absence du morceau de pain... et s’il s’en apercevait à tout hasard, pourquoi Ernest serait-il soupçonné de l’avoir pris ? Tout en raisonnant de la sorte en lui-même, il approchait de plus en plus du fatal gâteau ; enfin, par un mouvement désespéré, il saisit l’objet de sa convoitise.
Adrien, troublé dans ses études par l’agitation de son compagnon, observait tous les mouvements de celui-ci avec une alarme consciencieuse et profonde. « Ernest, murmura-t-il, que va dire votre papa ? Voyez-vous ça ! dit Ernest en mettant son poing sous le nez d’Adrien ; si mon père demande ce qu’est devenu le gâteau, tu diras que le chat l’a mangé, sinon gare à toi ; quels coups de fouet je te singlerai ! compte là-dessus. »
En ce moment, ils entendirent M. Dormont souhaitant le bonjour à la dame ; et Ernest, jugeant plus prudent de laisser l’honneur de l’invention à Adrien, ajouta tout bas à son petit camarade effrayé : « Dis que je suis allé chercher mon mouchoir de poche là-haut, » et il s’esquiva au plus vite.
M. Dormont, déjà de très-mauvaise humeur, parce qu’il avait été dérangé de son déjeuner, rentra dans l’arrière-boutique, fort mécontent ; son thé versé était froid ; il se tourna du côté de la beurrée, et ne la trouva pas. « Qui a touché à mon petit pain ? cria-t-il d’une voix telle qu’Adrien en fut épouvanté. Est-ce vous, Adrien ? Répondez-donc.
— Non, monsieur, non... Oh !... non vraiment, monsieur !
— Alors c’est Ernest. Ernest, où est-il ?
— Il est allé chercher son mouchoir là-haut, monsieur.
— A-t-il pris la beurrée ? Dites la vérité.
— Non, monsieur ; c’est... c’est le... le chat.
— Oh ! méchant, indigne enfant, s’écria Marthe, qui venait d’entrer dans le bureau ; la chatte a fait ses petits cette nuit ; elle est enfermée dans la cave au charbon.
— Venez ici, Adrien... venez, reprit M. Dormont en s’éloignant du buffet, avec un petit fouet qu’il venait d’y prendre ; venez, je vais vous apprendre à dire la vérité, moi...
— Monsieur, pardonnez-moi, Ernest m’a fait mentir.
— Quoi ! vous dites cela... quand le pauvre Ernest est là-haut, ne se doutant de rien ; mais c’est de pis en pis, s’écria Marthe en levant les yeux au ciel. La petite vipère !
— Quelle honte, quelle honte !... Tenez, tenez, ajouta M. Dormont en donnant le fouet au pauvre enfant. — Maman ! maman ! criait celui-ci. Oh ! pourquoi m’avez-vous quitté ? »
A ces mots, M. Dormont s’arrêta ; le fouet tomba sur le plancher ; il croyait avoir agi pour le bien de l’enfant. « J’espère maintenant, reprit-il, que c’est la dernière fois que je suis forcé de vous corriger... Ne pleurez plus ainsi.
— Il va jeter l’alarme dans le quartier, interrompit Marthe ; jamais je n’ai vu pareil enfant. Allez porter ce paquet chez M. Perdriel... Vous connaissez la maison ; allez, cela vous rafraîchira le sang. Sortez par l’allée. » Et elle accompagna l’enfant, dont les sanglots l’étonnaient, à travers le passage jusque dans la rue.
Pour aller retrouver son frère, Jules avait pris la diligence, qui conduisait de Paris à V***; il voyagea toute la nuit, et vers deux heures il arriva à V***; s’étant fait indiquer la demeure de son oncle, il s’y achemina. Déjà il apercevait sa grande boutique, au-dessus de laquelle se lisait, en lettres d’or, le nom respectable de Dormont, quand tout à coup, à la jonction d’un passage avec la grand’rue, des sanglots étouffés et douloureux frappent son oreille. Jules se retourne, et sous un portique saillant, il découvre un enfant assis sur la pierre, et qui pleurait ; un frisson saisit Jules ; il avait reconnu cette voix... Il s’arrête, et pose la main sur l’épaule de l’enfant : « Oh !... non, non, je vous en prie... J’y vais... je pars à l’instant, se mit à crier alors le pauvre petit, en se courbant de frayeur, et tenant toujours ses mains sur son visage.
— Adrien ! dit Jules. » L’enfant se relève, pousse un cri de ravissement, et tombe dans les bras de son frère.
« Oh Jules ! mon cher Jules,... vous venez me chercher, n’est-ce pas ? pour me ramener à ma bonne mère... Je serai bien sage ; je ne la tourmenterai jamais, jamais... emmenez-moi.
— Asseyons-nous d’abord et dis-moi ce qu’ils t’ont fait, dit Jules, tâchant de comprimer l’émotion qui souleva sa poitrine au nom de sa mère. »
Assis tous deux sur la pierre, sous le porche d’une maison inconnue, les orphelins se serraient l’un contre l’autre. Adrien, appuyé sur l’épaule de Jules, lui racontait, avec une exagération pardonnable à son âge, les souffrances qu’il avait endurées ; mais, quand il en vint à la punition du matin, et qu’il montra les marques du fouet sur ses petites mains qu’il avait vainement tendues pour implorer la pitié, Jules trembla de colère ; l’indignation qu’il montra, encouragea Adrien à colorer plus vivement l’histoire de ses griefs. Et quand il eut fini, il dit : « N’y pensons plus, Jules ; allons bien vite retrouver maman.
— Écoute, reprit celui-ci, nous ne pouvons retrouver ma mère : je te dirai pourquoi dans un autre moment. Nous sommes seuls au monde, toi et moi. Si tu veux me suivre, Dieu nous viendra en aide, car il nous faudra travailler pour gagner notre vie ; nous aurons peut-être bien faim, nous souffrirons de grandes fatigues. Penses-y bien, Adrien, ne regretteras-tu jamais les douceurs dont tu jouis maintenant ?
— Des douceurs !... répéta le pauvre petit d’un ton piteux, et regardant ses mains meurtries. Oh ! laissez-moi m’en aller avec vous ; si je reste ici, je mourrai, j’en suis sûr.
— C’est arrangé, dit alors Jules d’une voix ferme ; viens sur-le-champ avec moi. Nous avons bien du chemin à faire jusqu’à ce soir.
Ils partirent aussitôt à pied, pour retourner à Paris, où Jules espérait trouver un travail qui les nourrirait tous deux, et bien résolu à tout faire pour servir de protecteur à son frère. C’est en chemin qu’il lui apprit la mort de leur pauvre mère. L’air était embaumé, la journée magnifique ; les deux enfants marchaient hardiment ; ils voyaient les bois, les prés, fuir devant eux.
Le soir, ils soupèrent, et craignant d’être poursuivis, ils se remirent en route avant la nuit ; mais le temps devint bientôt lourd et chaud. Et, soit que Jules eût été mal informé ou qu’il eût oublié la route qu’on lui avait indiquée, il ne voyait point l’auberge où il se proposait de passer la nuit.
Les nuages s’épaissirent. Pas un vestige d’habitation humaine n’était visible. Adrien, fatigué, les pieds meurtris, se mit à pleurer, et déclara qu’il n’irait pas plus loin. Tandis que Jules, dont le corps de fer bravait la fatigue, s’arrêtait pour laisser reposer son frère, un roulement de tonnerre éclata.
« Nous allons avoir de l’orage, dit Jules avec anxiété ; viens, avançons. — Je ne peux plus marcher... reprit celui-ci en sanglotant. » Un éclair soudain vient illuminer, éclairer le visage des deux enfants. Alors Jules, pour rassurer son frère, le prit dans ses bras et poursuivit sa route ainsi quelque temps. Après quoi, Adrien consentit à reprendre sa marche. Mais l’orage se rapprochait de plus en plus, les ténèbres devenaient plus épaisses, la pluie tombait à torrents... Jules perdit courage.
Comment engager maintenant Adrien à marcher, alors que lui-même avait peine à voir à deux pas devant lui. Il n’y avait plus d’autre parti à prendre que de gagner la grand’ route, et d’attendre le passage de quelque voiture. Il prit de nouveau son frère dans ses bras, et l’y conduisit ; mais, arrivé là, il le déposa sans pouvoir aller plus loin.
Jules avait quitté sa veste, sa cravate, son gilet, pour en couvrir Adrien ; celui-ci s’était couché sur l’herbe mouillée, en disant qu’il allait mourir à genoux, sur la terre. Jules levait vers le ciel des regards qui imploraient la pitié : il lui demandait un secours pour son frère.
Bientôt le ciel semble exaucer sa prière, l’orage s’apaise, et le bruit d’une voiture se fait entendre au loin. Jules parvient à la distinguer dans l’obscurité, elle venait de son côté. Merci, mon Dieu ! s’écrie-t-il, et, courant à la voiture, il arrête les chevaux. « Qu’est-ce, demanda le postillon ? — Au nom du ciel, laissez-moi parler aux voyageurs que vous conduisez.
La voiture s’arrêta ; elle contenait deux hommes et une femme d’un certain âge. Jules s’approcha, conta aux inconnus l’état de détresse où son frère et lui se trouvaient réduits, perdus qu’ils étaient ; et il finit par les supplier de se charger de son jeune frère jusqu’à la ville voisine ; vous le laisserez à l’hôtel de la poste, leur dit-il, et j’irai le chercher demain... sinon le pauvre petit va mourir. »
Un des messieurs voulut d’abord le faire chasser, croyant avoir affaire à un vagabond. Mais la dame qui avait observé Jules pendant qu’il parlait, touché de son récit, consentit à se charger d’Adrien. « Allez chercher votre frère, dit-elle. »
L’enfant fut placé vis-à-vis de la dame, sur le devant de la voiture, et il ne tarda pas à s’endormir, accablé qu’il était de fatigue. Jules, heureux d’avoir sauvé son frère, reprit sa course ; il arriva, dans la nuit, à l’hôtel de la poste ; il apprit que son frère dormait dans un cabinet voisin de l’appartement de la dame qui l’avait amené, et qui paraissait, disait-on, en avoir grand soin.
Le lendemain matin, il se disposait à aller chercher son frère, et à remercier les généreux étrangers qui leur avaient prêté si généreusement secours, lorsqu’on vint le demander de leur part. En entrant chez eux, il les trouva tous à table avec Adrien, qui vint sauter à son cou, dès qu’il l’aperçut ; il paraissait content.
Les trois personnes de la veille se composaient de la vieille dame, d’un homme, encore jeune, et d’un autre plus âgé ; la figure de ce dernier frappa Jules, il crut le reconnaître, sans pouvoir encore bien fixer ses souvenirs... Il l’observait.
« Est-il vrai, lui dit ce monsieur, que cet enfant et vous-mêmes soyez les deux fils de Charles Davenne ? — Oui, monsieur, reprit Jules — L’associé de M. Armestrong ?
— Lui-même. — Mais vous, monsieur, n’êtes-vous pas, ce même associé ? » Et les traits de Jules prirent, à cet instant, une expression sombre, car cet homme lui rappelait tous leurs malheurs.
« Écoutez-moi, lui dit M. Armestrong ; oui, c’est moi qui fus l’associé de votre père ; et si j’ai de grands torts à me reprocher envers vous, ces torts furent involontaires.
— Mais, monsieur, dit Jules, notre fortune ?...
— Tenait à des papiers perdus ; et ces papiers, mon premier commis que voilà, dit-il en montrant l’autre monsieur, les a retrouvés ces jours-ci en faisant un nouvel inventaire. Ces papiers, en me donnant la preuve de l’innocence de votre père, m’ont rendu coupable à mes propres yeux, et j’allais...
— Ma pauvre mère ! s’écria Jules.
— J’allais, reprit M. Armestrong, à Paris, chez elle, lui porter ces papiers, reconnaître mes torts, et lui offrir telle réparation qu’elle jugerait convenable.
— Il est trop tard, dit Jules. — Quoi ! vous seriez... — Oui, monsieur, orphelins !...
— Oh ! mon Dieu, s’écria M. Armestrong, je te remercie. Tu as conduit sur mes pas ces deux enfants pour me dicter ma conduite. Jules, Adrien, mes deux enfants, mes amis, pardonnez-moi, et venez avec moi... soyez mes fils ; oublions le passé... je vous servirai de père.
— Et moi, dit la dame, qui n’était autre que la mère de M. Armestrong, moi, je tâcherai de remplacer près de vous votre bonne mère ; je ne veux plus vous quitter, à force de soins et de tendresse, j’acquitterai, si je le puis, la dette de mon fils envers vous.
— Venez Jules, venez avec moi, reprit M. Armestrong, votre fortune vous sera rendue, et la mienne deviendra la vôtre, car je n’ai pas d’enfants ; vous achèverez votre éducation et, à dater de ce jour, il ne tiendra qu’à vous d’avoir un avenir heureux. »
Les deux enfants, surpris et touchés, acceptèrent les excuses et les offres de M. Armestrong ; et, comme ils remerciaient Dieu de l’appui qu’il venait de leur envoyer, un quatrième personnage entra, tout à coup et fort brusquement, dans l’appartement. Il courut à Adrien, et l’embrassa cordialement. C’était M. Dormont. Inquiet, la veille, de ne pas voir revenir l’enfant, et instruit par Marthe, qui venait de découvrir la culpabilité d’Ernest et l’innocence d’Adrien, il le fit demander bien vite chez M. Perdriel ; mais personne ne l’y avait vu venir. Deux heures se passèrent ainsi en vaines recherches. De plus en plus tourmenté, M. Dormont apprit enfin que deux enfants avaient pris la route de Paris. Le bon oncle était donc parti immédiatement à la poursuite des fugitifs. En les retrouvant aussi miraculeusement, sa joie fut grande. On s’expliqua... M. Dormont consentit à céder à M. Armestrong tous ses droits sur Adrien ; et, à dater de ce jour, les deux frères trouvèrent le bonheur qu’ils avaient cru perdu sans retour. Jules resta le protecteur de son frère ; il marcha dans une noble voie, fut un homme de bien, afin de lui mieux servir d’exemple.
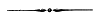

Le seul point où des relations de commerce existent entre la Chine et la Russie est, d’une part, Kiachta, ville située sur les frontières de la Sibérie, où résident les agents des plus riches marchands de St-Petersbourg ; de l’autre, Maimatchin, cité construite sur la frontière correspondante de l’empire chinois. Une esplanade fermée sépare les deux villes. Du côté russe, se trouve une porte européenne avec un corps de garde ; du côté chinois, s’élève une entrée magnifique chargée d’inscriptions et de figures mythologiques.
Maimatchin a toute la physionomie d’une ville chinoise ; ses rues sont bien percées, mais étroites. En les parcourant, on n’aperçoit que de longs murs tout nus, interrompus seulement de loin en loin par une porte qui reste toujours close ; car en Chine, mes enfants, il est de devoir rigoureux de se renfermer très-soigneusement chez soi, et de ne laisser rien paraître en dehors de ce qui se passe dans l’intérieur des maisons ; il n’en est assurément pas de même en France.
C’est derrière ces tristes murs que sont placées les habitations particulières. Chacune d’elles forme une cour ouverte, autour de laquelle sont rangées les chambres à l’usage de la famille, ainsi que les boutiques où se fait le commerce. Ces demeures sont meublées généralement avec beaucoup de luxe ; on y voit des tables en laque, des glaces, des tableaux ; les planchers sont recouverts de nattes. Leur principal meuble est le divan, espèce de grand sofa placé dans le salon, sur lequel les Chinois s’asseyent, les jambes croisées, à la mode des Orientaux.
Chaque maison a son parterre de fleurs, dont la culture fut, de tout temps, l’une des occupations favorites de ce peuple. Mais la particularité la plus frappante de cette ville chinoise, c’est une absence totale de femmes. Nulle personne du sexe ne peut obtenir la permission d’y résider. Maimatchin est peut-être ainsi le seul point de la terre où pareille singularité ait lieu.
Je veux vous raconter les détails d’une visite de cérémonie que fit assez récemment un officier général russe au principal agent (dzargoutschey) du Céleste Empire, résidant à Maimatchin. Celui-ci se nommait Tzin-Hoé ; c’était un Chinois de distinction.
« Il avait été convenu, dit le voyageur russe, que j’accepterais une invitation à dîner de Tzin-Hoé pour le lendemain ; la veille, j’envoyai donc un aide-de-camp lui faire les compliments d’usage. Le jour dit, je me rendis à Maimatchin, accompagné de plusieurs fonctionnaires publics de Kiachta et d’un détachement de Cosaques. Notre amphytrion nous reçut à la porte extérieure de son appartement ; après nous avoir serré la main à l’anglaise, il nous conduisit dans son salon, et s’y assit sur le divan.
« Alors on nous présenta du thé dans des vases de porcelaine, avec des soucoupes en forme de bateau ; puis on servit des fruits secs avec des confitures. Dès ce moment, la conversation s’engagea sur des lieux communs relatifs aux mœurs et aux coutumes de nos deux nations ; à cette occasion, le Chinois curieux s’efforça, par mille questions évasives, de découvrir le but de mon voyage. Je m’amusais infiniment des détours ingénieux que je lui voyais prendre ; et, comme je n’avais aucun motif pour lui en faire un mystère, je lui dis donc franchement qu’allant inspecter, par l’ordre de l’empereur des Russies, mon maître, les établissements de Netschinsy, la curiosité m’avait poussé à visiter Maimatchin, ce point si intéressant de notre frontière. Tzin-Hoé parut très-satisfait de ma confidence. Notre entretien avait lieu à l’aide d’un interprète.
« Mais bientôt on vint annoncer que le dîner était servi ; Tzin-Hoé et moi nous passâmes dans la salle à manger, en nous tenant par la main. Les convives étaient au nombre de cinq, et la table n’était cependant guère plus grande qu’une table de jeu ordinaire. On avait placé, devant chacun de nous, deux soucoupes de porcelaine : l’une vide, et l’autre à moitié remplie de vinaigre.
« Nous avions eu le soin de nous munir de couteaux et de fourchettes, les Chinois ne se servant que de petites brochettes qu’ils manient fort adroitement avec les trois premiers doigts de la main droite, et à l’aide desquelles ils parviennent à manger des aliments même liquides.
« La table était couverte de mets servis dans des soucoupes pareilles aux deux qui tenaient, à chacun de nous, lieu d’assiettes ; ils consistaient en petits morceaux de porc, de mouton, de volaille, de gibier frits dans la graisse. Chaque portion est placée d’abord sur la première soucoupe vide qu’on a devant soi, puis trempée dans le vinaigre que contient la seconde ; après quoi, l’on mange. Des viandes, des légumes, des choux, des concombres, des pâtisseries sucrées nous furent présentés tour à tour. Cinquante-deux soucoupes se succédèrent ainsi sans interruption... c’était à n’en pas finir. Je goûtai de plusieurs d’entre elles, d’abord par curiosité, puis ensuite parce que, d’après les règles de la politesse chinoise, Tzin-Hoé ne cessait de nous offrir tous les morceaux les plus délicats.
« Je croyais le dîner fini... mais voici qu’on nous sert tout à coup huit espèces de potages gras ; et ce nombre forme le maximum de l’étiquette chinoise, qui veut que la quantité de plats soit proportionnée à la considération qu’on a pour la personne invitée.
« Nous avions eu la précaution d’apporter notre pain, car les Chinois ne s’en servent jamais. De petits carrés de papier d’argent nous étaient à tout instant présentés pour nous essuyer la bouche. On ne but, tout le temps du repas, qu’une espèce d’eau-de-vie de riz, d’un goût détestable ; on ne nous offrit point d’eau ; et les verres ressemblaient à ceux dans lesquels on verse la liqueur en France.
« Ce festin dura une heure environ ; la conversation fut gaie, animée ; elle roula sur la manière de vivre des dames chinoises. Pour conclusion, on nous donna du thé et des confitures excellentes ; et pendant que nous étions au dessert, notre amphytrion se retira pour changer de costume ; c’est une marque de politesse, en Chine, que de faire sa toilette après le dîner. Notre hôte avait revêtu une robe de belle soie brune, et sa veste était de satin bleu broché. Nous retournâmes au salon ; c’est alors que Tzin-Hoé nous fit voir plusieurs curiosités, telles que des livres et des armes, et offrit de nous conduire au principal temple de Maimatchin, en attendant l’heure du spectacle.
« Ce temple, qui ressemble à ces pavillons chinois que tout le monde connaît, est carré, avec une large corniche décorée d’une étrange quantité de peintures et d’ornements, appuyée elle-même sur des colonnes dorées et couvertes d’inscriptions, entourant l’édifice. L’intérieur de ce temple est divisé en trois parties. Les idoles se trouvent placées dans des niches ; devant chacune d’elles sont des tables chargées de cierges allumés, de vases remplis d’eau, de parfums et de fleurs. Des draperies pendent au-dessus des tables, et dérobent la vue des idoles aux regards des spectateurs. Les murs sont peints à fresque en couleurs brillantes et en or. Ces tableaux représentent les principaux événements de la vie des diverses divinités auxquelles le temple est dédié.
« En arrivant auprès des niches qui renferment les idoles, qu’on n’aperçoit pas en entrant, il est impossible de ne pas tressaillir de surprise et presque d’effroi, à l’aspect de ces étranges figures d’environ 7 mètres de haut, dont les traits sont horribles. Leur costume est aussi étrange que leur visage ; tous les objets qui les entourent, sont sculptés et peints avec un talent qui décèle des artistes du plus haut mérite.
« Je comptai, dans ce temple, neuf divinités, partagées en trois groupes. Au milieu se trouvait Fo, divinité principale ; aux bas côtés, les dieux de la guerre, de la justice, du commerce, de l’agriculture, avec quelques idoles d’un rang inférieur. Le dieu Fo était seul vêtu de satin jaune, couleur sacrée aux yeux des Chinois, et que l’empereur a seul aussi droit de porter. Le temple de Maimatchin est, en un mot, l’un des objets les plus curieux qu’il soit possible de voir.
« L’heure du spectacle étant venue, nous nous y rendîmes dans la loge du dzargoutschey. Le théâtre ressemblait à ceux qu’on élève dans les Champs-Élysées à Paris, lors des réjouissances publiques. Il était décoré avec beaucoup de goût, à la manière chinoise. Les rôles de femmes sont joués par des jeunes gens d’une jolie figure, âgés d’environ quinze ans. Les spectateurs sont placés en plein air, à l’exception des personnages de distinction qui ont des loges en face du théâtre.
« La pièce qu’on représentait était une espèce de mélodrame, dont les entr’actes étaient remplis par des éclats étourdissants d’orchestre. Il faut avoir entendu cette horrible musique pour se faire une idée des sons discordants que peuvent produire d’énormes clairons et des flûtes longues de cinq mètres, accompagnés encore de cymbales, de tamtams et d’une espèce de tambour qu’on pourrait entendre de plus d’une lieue. Le sujet de la pièce était on ne peut plus grotesque ; et tout cela mêlé de jeux et de combats bien autrement ridicules que ceux des petits théâtres des capitales de l’Europe.
« Les Chinois de Maimatchin, même du rang le plus élevé, paraissent fort ignorants de tout qui ne les intéresse pas personnellement. Ils se regardent comme supérieurs aux autres nations de la terre ; en d’autres termes, tous les autres peuples ne sont à leurs yeux que des barbares, à peine supérieurs à des chiens. C’est ainsi que Tzin-Hoé ignorait même jusqu’à l’existence de la nation française.
« Au reste, les Chinois ont, en général, un tact infini qui remplace, pour eux, l’instruction ; ils ne seraient pas fâchés que le monde leur fût ouvert ; mais les lois du Céleste Empire les tiennent inexorablement renfermés, et leur refusent toute espèce de communication extérieure. Aussi n’est-ce qu’en tremblant qu’un petit nombre d’entre eux osent risquer sur ce sujet quelques confidences vis-à-vis d’un étranger, car ils savent que les châtiments les plus cruels sont réservés à quiconque aurait l’audace d’exprimer un pareil désir ; et pourtant il est fort généralement répandu. »
Un jour viendra peut-être où, grâce aux Anglais dont les rapports de commerce avec la Chine deviennent un besoin toujours plus impérieux, le peuple chinois finira par être enfin un peu mieux connu des Européens.
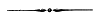

« Tu es, depuis huit jours, bien gentil, bien sage, mon petit Félix ; je veux te récompenser... voyons... que désires-tu ? » Ainsi parlait M. Derville à son fils.
« Cher papa, répond celui-ci, je voudrais alors posséder, rien qu’un jour, ce joli cornet d’ivoire que vous m’avez montré si souvent.
— Oh ! oh ! mon cornet ! Mais sais-tu bien que c’est un bijou précieux, celui-là, puisqu’il sert à me faire comprendre des animaux, à les entendre parler.
— En vérité ! est-ce que les animaux parlent ?
— Eh ! sans doute, mon enfant ! ils se parlent entre eux ; il est vrai qu’il ne nous est pas donné de les entendre ; mais ils expriment, comme nous, les diverses sensations qu’ils éprouvent ; comme nous, ils sont accessibles à la joie, à la douleur ; ils ont leur instinct, leurs mœurs, leurs lois, leurs habitudes, leur langage. N’as-tu pas vu déjà des hirondelles bâtir des nids autour de nos fenêtres, y élever leur famille, et, sur la fin des beaux jours, se réunir, à jour fixe, pour passer en d’autres climats ? Feraient-elles tout cela, si elles n’avaient la faculté de se communiquer leurs idées ?
— Ah ! ce doit être bien curieux vraiment d’entendre parler des bêtes ! Oh ! mon petit père, prêtez-moi votre cornet, je vous en prie...
— Tu le veux absolument... En ce cas, le voici ; mais prends-y garde ; tu es bien jeune, tu as trop peu d’expérience pour tenter pareille épreuve ; tu entendras sans doute d’étranges choses, et comme tu n’es pas en état de discerner le vrai du faux, le mal du bien, tu te repentiras de ta curiosité.
— Eh quoi ! vous croyez ?
— Je t’attends à ce soir ; tu m’en diras des nouvelles. »
Les animaux qui parlent.

| Lith. de Cattier | |
| Tout beau, cria-t-il vivement au chien qui s’avançait vers lui. | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Félix embrassa tendrement M. Derville ; il était si heureux ! Muni donc du précieux cornet et d’un petit panier rempli de pain et de cerises, il prit joyeusement le chemin de la campagne ; — cette scène se passait aux environs de la jolie ville de Mantes.
Comme l’enfant traversait la cour, il aperçut le chat de la maison qui tenait une souris en arrêt ; celle-ci cherchait en vain à se sauver, car à peine s’éloignait-elle de quelques pas que Raton faisait lui, tout aussitôt, deux bonds en avant. Félix s’arrêta un instant, impatient qu’il était de faire l’essai du fameux cornet ; il le place donc à son oreille. Quelle est déjà sa surprise d’entendre le petit dialogue suivant entre le chat et la souris :
« Ah ! vous n’êtes pas généreux, M. Raton, disait celle-ci ; vous avez de si grandes pattes, et moi je suis si jeune encore ; allons, soyez gentil ; laissez-moi prendre un peu d’écart...
— Je le ferais très-volontiers, répliqua le bonhomme de chat ; mais, si tu venais à m’échapper, je serais battu... ah ! ah !
— Battu ! vous me faites rire... mais personne ne nous voit !... Vous n’auriez qu’à fermer un peu les yeux... et j’irais porter cette pauvre petite miette de pain à mon vieux père aveugle, qui n’a pas mangé d’aujourd’hui ; après quoi, je reviendrais, parole de souris.
— Tu me fais peine, en vérité, chère amie... je le voudrais de tout mon cœur, foi de Raton ; mais, vois-tu bien, mon devoir...
— Votre devoir ! cruel ! Ah ! que vous ressemblez bien aux domestiques de cette maison, qui, sous prétexte de leur devoir, ne songent qu’à leurs intérêts ; vous voulez me punir d’avoir ramassé cette misérable miette de pain, tandis qu’à leur exemple vous volez impunément le maître. »
Et la petite souris, poussée au désespoir, allait continuer sur ce ton amer, quand Raton, hors de lui, saute aussitôt sur elle, et la croque.
« Voilà qui est bien fâcheux pour le vieux père de cette petite souris, se dit Félix en s’en allant ; mais elle était aussi par trop impertinente. Ah ! si Baptiste et Marianne savaient les vilaines choses qu’elle disait d’eux !... Allons, décidément, je crois que Raton n’a pas eu tort... On ne doit jamais, pour faire le mal, s’autoriser de l’exemple des autres. »
En raisonnant ainsi, l’enfant traversait précisément l’enclos d’une ferme voisine ; il entend caqueter près de lui : c’était une poule qui venait déposer ses œufs au pied d’un buisson : « Poulette, dit aussitôt Félix, ce n’est pas bien de cacher ainsi vos œufs ; vous faites du tort au fermier ; il ira dans le poulailler pour chercher votre ponte, il n’y trouvera rien.
— Le grand dommage, en vérité ! réplique ingénument Poulette... Eh ! depuis quand ces œufs sont-ils plus à lui qu’à moi ? Est-ce donc pour l’unique intérêt d’un maître barbare que la nature m’a rendue mère ? et ne me sera-t-il jamais permis de garder mes enfants autour de moi, de les réchauffer sous mon aile ? Jusqu’ici ni mes cris, ni mes pleurs n’ont pu garantir mes chères couvées de la main de cet homme. Cette fois, au moins, je verrai mes petits s’élever sous mes yeux ; je les conduirai moi-même aux champs ; je resterai constamment autour de ma petite famille... on ne me l’enlèvera plus.
— Eh bien ! eh bien ! mais, à ce compte, si toutes les poules en faisaient autant... on ne mangerait donc plus de fricassées de poulets », se prit à penser tout d’abord Félix ? Au reste, Poulette était si visiblement attendrie, de si grosses larmes roulaient dans ses yeux, que le pauvre garçon en fut tout ému à son tour ; il rompit donc un morceau de son pain, et le donna à la couveuse en prenant tristement congé d’elle.
Bientôt il rencontre une ânesse qu’un paysan battait pour l’obliger à marcher :
« Ah ! çà, dites donc : pourquoi battez-vous ainsi cette pauvre bête ? demanda l’enfant.
— Ne voyez-vous pas, petit imbécile, répondit grossièrement le rustre, que cette mauvaise bourrique ne veut pas marcher ! Il y a trois quarts d’heure que nous devrions être arrivés chez une grande dame qui est réduite au lait d’ânesse. » Félix engagea alors très-poliment la bête rétive à montrer un peu plus de complaisance.
« Le fourbe, reprit celle-ci, ne vous a pas tout dit ; s’il ne me menait que chez cette pauvre grande dame dont il parle, je ne me ferais certes pas tant prier ; mais il me conduit en cachette chez bien d’autres malades dont il garde l’argent, et mon pauvre maître n’en sait rien ; c’est ainsi que ce malheureux m’épuise pour satisfaire sa cupidité.
— Ça n’est pas possible, répliqua Félix ; » et il répéta naïvement au paysan ce que l’ânesse venait de lui dire. Celui-ci ne devinant pas comment un enfant qu’il n’avait jamais vu, pouvait être instruit d’un pareil secret, le traita de sorcier, lui dit encore bien d’autres injures, puis finit par s’éloigner, mais en battant sa bourrique de plus belle.
Alors Félix commença à comprendre que la pauvre bête pouvait bien avoir raison comme la petite souris : « Eh ! quoi, se disait-il, les hommes seraient si méchants ! je ne l’aurais jamais cru. »
Presque aussitôt un bourdonnement étrange retentit à ses oreilles ; il aperçoit une guêpe et une abeille sur une fleur d’ortie. L’abeille, arrivée la dernière, parlait ainsi à sa voisine : « De grâce, laissez-moi donc un peu de place sur cette fleur ; vous envahissez tout, et je ne vois pas d’ailleurs à quoi cela vous sert, car paresseuse comme vous l’êtes, cela ne vous empêchera pas, ma mie, de mourir de faim cet hiver...
— Oui-dà, reprit ironiquement la guêpe ; mais vous, prévoyante personne, vous croiriez-vous par hasard plus sage que moi ? Quand vous aurez bien amassé cire et miel dans votre ruche, votre reine empêchera-t-elle l’homme insatiable de vous chasser, de s’emparer de vos richesses ? Folles que vous êtes c’est bien la peine en vérité de vous donner tant de mal... Adieu. »
L’abeille, demeurée seule, sembla réfléchir un peu ; après quoi elle s’achemina vers sa ruche. Félix, qu’une pareille scène avait singulièrement intéressé, la suit de l’œil en courant, et vient se placer tout près de la porte de la ruche, son cornet à l’oreille, dès que l’abeille fut entrée. Tout le peuple ailé était alors en grande rumeur ; l’abeille demanda ce qui se passait. Félix entendit plusieurs voix répondre qu’on menait au supplice une paresseuse que les lois condamnaient à mort ; alors il se prit involontairement à frémir en pensant qu’il s’était, lui, bien souvent rendu aussi coupable que la pauvre victime.
« Arrêtez, s’écrie soudain la nouvelle venue, arrêtez... j’ai quelque chose à dire en faveur de l’accusée. » On la conduit sur-le-champ près de la reine, à qui elle fait part des réflexions de la guêpe. Mais celle-ci jetant sur l’orateur un regard des plus sévères, lui répond ce qui suit avec dignité : « Gardez-vous, madame, de répandre dans notre société de semblables doctrines, à l’usage des fainéants. Sans doute autrefois des êtres mal appris incendiaient nos ruches pour nous en chasser, et les livrer ensuite au pillage. Mais aujourd’hui, mieux conseillé, l’homme a reconnu les avantages qu’il tire de son alliance avec nous ; il nous témoigne toutes sortes d’égards ; et, si vous considériez vous-même tout le fruit que l’homme recueille de notre industrie, vous comprendriez un peu mieux l’intérêt immense qu’il a de veiller à notre conservation. Au surplus, comme rien ne saurait excuser la paresse, j’ordonne que ma sentence reçoive, sans délai, son exécution. Puisse-t-elle servir d’exemple à tous les fainéants ! »
Félix, bien qu’émerveillé d’un aussi beau discours, ne s’en sauva pas moins bien vite. On eût dit qu’il était atteint personnellement par la loi des abeilles ; c’est que ce cher enfant avait appris à ne jamais demeurer sourd à la voix de sa conscience : or, comme celle-ci lui reprochait bien quelques moments d’oisiveté, il lui faisait mal de penser que, dans l’empire des abeilles, on pouvait être mis à mort pour si peu de chose.
Mais tout à coup Félix suspend sa marche précipitée en entendant les cris aigus que poussaient, non loin de là, de petits oiseaux. A l’aide de son cornet, il comprit aussitôt qu’il s’agissait d’un nid de pinsons que le vent avait jeté au bas d’un arbre. La mère poussait des sanglots à fendre des rochers : « Mes chers voisins, mes bons amis, exclamait-elle ; aidez-moi, je vous supplie, à sauver mon nid ; voyez-vous déjà ce vilain enfant qui s’avance... il va m’enlever mes pauvres petits... De grâce, ne m’abandonnez pas. »
Elle dit, et tous les bons petits oiseaux du voisinage d’accourir à cette voix lamentable et d’essayer, en réunissant leurs efforts, à soulever le nid : « Allons, bien décidément, s’écrie enfin brusquement un vieux pierrot, cela est impossible, et nous nous perdrions nous-mêmes sans le sauver... fuyons », et tous s’envolent avec effroi.
Ce fut bien alors que la pauvre mère-pinson remplit l’air de ses cris ; en effet Félix venait de s’emparer du nid : « Tout est donc perdu, disait-elle avec l’accent du désespoir ? Ah ! par pitié, cruel ravisseur, si vous leur ôtez la vie, prenez donc aussi la mienne ; car jamais je ne pourrai survivre à mes enfants. »
Cette infortunée mère jugeait bien mal Félix : « Calmez-vous, interrompit-il, calmez-vous ; mon intention n’est pas du tout de vous enlever vos petits ; au contraire, ma chère dame ; cet arbre n’est pas très-élevé, et je veux y replacer moi-même votre couvée bien-aimée. » Effectivement il pose son panier sur l’herbe, grimpe à l’arbre et y replace le nid tout doucement. Ah ! il fallait voir comme, de plaisir, la pauvre mère battait des ailes !
Déjà notre enfant, tout ému, sortait du verger, quand un essaim d’oiseaux de toute espèce se mit à le suivre, à l’accompagner de mille chants d’allégresse..., c’était un charivari de gazouillements à n’y rien entendre. Félix prit son cornet pour chercher à distinguer le sens de plusieurs cris confus qui dominaient ce singulier concert. Quelle fut sa surprise en reconnaissant que ces honnêtes oiseaux lui criaient qu’il avait oublié son panier au pied de l’arbre. Vite il court pour le reprendre ; mais, jugez de son nouvel étonnement ! il retrouve tout son déjeuner intact, et gardé, qui plus est, par des pierrots, race essentiellement voleuse et gloutonne. Pour le coup, il ne put s’empêcher d’admirer la rare probité de ces messieurs ; et, comme il faut toujours récompenser la vertu, il leur fit une large distribution de miettes de pain et de cerises.
Bref, voilà notre héros qui se retrouve sur la grand’route. Il était évidemment destiné à plus d’une autre aventure... Vous allez en juger. Là, que voit-il ? un gros cochon et un bœuf arrêtés de compagnie devant la porte d’une auberge. Le cochon, en vrai sans souci, mangeait à s’en donner jusqu’aux oreilles, alors que le bœuf, refusant, lui, tout aliment, semblait absorbé dans les réflexions les plus noires. « Sommes-nous encore bien éloignés de la ville, demanda enfin, d’un air gaillard, le gros habillé de soie ?
— A quoi bon cette question ? Ne voyez-vous pas d’ici les clochers, répliqua brusquement la bête à cornes ?... Quoi vous presse tant d’arriver ?
— C’est, qu’à vous dire vrai, je commence à me lasser un peu ; puis, entre nous, je ne serais pas trop fâché de voir une ville, au moins une fois dans ma vie : je suis si peu citadin de mon naturel ; ce doit être superbe !
— En ce cas, dépêchez-vous d’admirer bien vite, car vous n’avez, je pense, plus grand temps à vivre...
— Comment ! je ne comprends pas.
— Vous ne comprenez pas que les malotrus qui nous mènent, vont nous vendre à la ville voisine, et qu’on va vous griller !...
— Pas possible ! vous me faites frémir. Eh ! quoi... il n’était pas mon ami cet homme qui prenait tant de soins de moi, qui m’engraissait si bien à ne rien faire.
— Eh ! sans doute, gros lourdaud ; l’homme connaît-il des amis, même parmi ceux de son espèce ! l’intérêt, voilà le seul mobile de ses actions. Quel cas voulez-vous alors qu’il fasse d’animaux comme nous, qu’il croit nés pour ses plaisirs ou pour ses besoins ? Au reste, pour vous plaindre, quels services avez-vous donc déjà rendus à votre maître, tandis que moi — c’est bien différent — je lui étais attaché dès l’enfance ; j’ai toujours partagé ses travaux, labouré ses champs, voyez pourtant... la mort !... voilà le prix que l’ingrat réserve à mes services... »
En ce moment, le bouvier et son compère ayant fini de déjeuner, sortaient précisément de l’auberge. Un coup de bâton, rudement appliqué sur les jarrets du bœuf, interrompit le fil de son discours, et l’avertit qu’il était temps de se remettre en route. Pareil avis fut donné au cochon qui, pétrifié cette fois de tout ce qu’il venait d’entendre, n’éprouvait plus du tout le désir de voir aucune ville ; aussi grognait-il sourdement sans se décider à faire un seul pas en avant ; quand son maître se mit en devoir de l’inviter, à grands coups de fouet, à marcher bon gré, mal gré. C’est ainsi que les deux pauvres bêtes s’éloignèrent : l’une, criant de toutes ses forces à la trahison ; l’autre, poussant de douloureux gémissements : ce à quoi nos deux bouviers, pris de boisson, répondaient par une pluie de jurons et de coups de trique.
Le cœur encore tout serré de cette scène affreuse, Félix était resté muet, immobile devant l’auberge et suivant, avec anxiété des yeux, les deux malheureuses victimes ; enfin, comme il n’entendait plus qu’un bruit lointain de lamentations, il quitta tristement la route pour s’enfoncer à travers champs. Il avait toujours présentes à l’esprit les paroles du bœuf, il gémissait en secret sur le destin de cet animal... Bon Félix !
Depuis cinq minutes environ il marchait, quand il aperçoit à distance un laboureur couché à l’ombre d’un orme, et qui buvait bien tranquillement à même une grosse gourde, tandis qu’il laissait exposés à toute l’ardeur du soleil les deux chevaux attelés à sa charrue. Ces malheureuses bêtes se plaignaient en ces termes :
« Le vilain ivrogne ! disait l’un, il ne cesse de boire, et il nous laisse mourir de soif.
— Triste métier que celui de cheval de ferme, ajoutait l’autre ; tous les gens qui passent sur la route, s’arrêtent au moins à l’auberge pour faire rafraîchir leurs chevaux ; et nous, qui sommes là depuis le lever du soleil, il ne nous est pas encore entré une goutte d’eau dans le corps. Jeune homme, poursuivit-il en s’adressant à Félix, ne pourriez-vous donc nous mener à cet abreuvoir, là-bas, au bout du champ ?
— Mon ami, je le voudrais de tout mon cœur, reprit celui-ci ; mais je ne saurais ni conduire votre charrue, ni vous dételer...
— Eh bien ! alors qu’avez-vous donc appris, pour un garçon de votre âge, interrompit sèchement le quadrupède, si vous n’êtes pas même capable de faire ce que tout le monde sait aux champs ?
— Allons, allons, cela ne te regarde pas, répliqua vivement son camarade ; puis, s’adressant à Félix : Excusez, je vous prie, la mauvaise humeur de mon ami ; il est si souffrant ! Ne sauriez-vous du moins avertir ce misérable garçon de ferme que nous mourons de soif, et que s’il n’y prend garde, son maître pourra bien nous perdre un jour, par sa négligence. »
Félix courut avec joie s’acquitter de la commission ; mais il fut très-mal reçu par le paysan, qui trouva fort mauvais qu’un étranger se mêlât de ses affaires... Toutefois il se leva en grommelant ; les chevaux eurent à boire, et l’expression de reconnaissance des deux pauvres bêtes fit bien vite oublier au généreux enfant les grossièretés de cet homme.
Tout en s’éloignant, Félix se retournait de temps à autre pour voir encore ses protégés qui revenaient de l’abreuvoir. Soudain son pied s’accroche à une racine d’arbre, ou à je ne sais quoi, il perd l’équilibre, tombe sur le nez ; puis, en se relevant, il s’aperçoit qu’il a tout bouleversé une fourmilière.
Quel affreux tumulte s’élève alors sous ses pas ! quelle agitation indéfinissable !... ce sont partout les cris d’un peuple épouvanté. Cependant Félix demeure à genoux pour mieux voir et mieux entendre. Celui-ci pleurait de vieux parents ; celui-là cherchait une épouse ; cette autre appelait vainement un fils. C’était à qui sauverait les victimes perdues sous les décombres, et les transporterait en lieu sûr pour les rappeler à la vie.
Dès que les premiers soins eurent été prodigués aux blessés, on s’empressa de déblayer les greniers d’abondance. Félix s’amusait beaucoup à voir, ici, de courageux citoyens réunir leurs efforts pour traîner des fardeaux plus pesants que dix fourmis ensemble ; plus loin, à entendre les chefs donner tour à tour leurs ordres pour débarrasser la voie publique et réédifier les remparts de la ville. « Relevez vite ce bastion, disait l’un, — dégagez cette poterne, ajoutait l’autre, » et tout le monde de mettre la main à l’œuvre.
Une fois les fortifications remises en état, Félix vit tout à coup, à son grand étonnement, s’avancer vers lui un véritable corps d’armée, mais terrible et menaçant... « Vous riez, mes amis ; je ne plaisante pourtant pas. » A l’aide de son cornet, et tout incrédule qu’il fût d’abord, il ne put bientôt plus se méprendre sur le caractère de pareilles démonstrations. Ces soldats de la fourmilière marchaient en colonnes, chantant des hymnes de guerre, et jurant de punir l’auteur de tous leurs maux... Et c’était si peu un badinage, que le chef de la troupe s’élança, tout le premier, à l’assaut, sur la main de l’enfant, et la lui piqua même si bien, que Félix en fit la grimace. D’abord il eut la pensée d’écraser son ennemi ; mais il avait si bon cœur ! son doigt levé s’arrêta. L’intrépide général avait suivi ce geste. Or, en présence du danger imminent qui le menaçait, il apostrophe son adversaire en ces termes :
« Qui te retient ? je suis en ton pouvoir, et tu peux m’ôter la vie ; mais je mourrai content, puisque j’aurai vengé mes concitoyens.
— O dévouement sublime ! pensa subitement Félix ; puis s’adressant à son prisonnier : Je ne suis pas, dit-il, si cruel que tu te l’imagines ; d’ailleurs, vos soupçons à tous sont souverainement injustes ; je n’ai point fait exprès de tomber pour vous détruire... c’est un accident involontaire... Voyez plutôt mon nez : il est tout écorché !...
— Ton nez ! répliqua le guerrier, belle chose, ma foi ! n’entends-tu pas les cris de ces malheureux expirants ? Voilà comme vous êtes, vous autres hommes, vous ne vous souvenez jamais que des maux qui vous arrivent. Sans toi, ces citoyens vertueux ne seraient pas aujourd’hui plongés dans le deuil et la désolation.
— Au fait, il a raison, se dit Félix à lui-même, c’est ma faute ; j’aurais dû prendre garde où je marchais ; on fait souvent bien du mal sans s’en douter. » Sur ce, il reposa à terre son prisonnier ; mais, bien qu’il le prit, du bout des doigts, avec des précautions infinies, il ne l’en laissa pas moins sans connaissance et presque étouffé, pendant quelques instants.
Dès qu’il eut enfin repris l’usage de ses sens, ce chef d’armée remercia son généreux vainqueur, en le suppliant toutefois de faire à l’avenir un peu plus d’attention, attendu, disait-il, que les petits n’étaient pas faits pour être de la sorte foulés aux pieds des grands. En somme, à son nez écorché près, Félix ne regretta pas de s’être ainsi laissé choir sur une fourmilière. Quelle utile leçon il tira de l’exemple de ces fourmis laborieuses, économes, actives, et surtout si charitables entre elles !
Tandis qu’il s’éloignait tout en réfléchissant à l’aventure qui venait de lui arriver, une brebis qu’un chien poursuivait vint se jeter tout à coup entre ses jambes, et faillit le renverser. « Ah ! çà, mais, se dit-il tout effrayé, si ça continue ainsi, qu’est ce qui va donc m’arriver aujourd’hui ? Tout beau ! tout beau ! cria-t-il vivement au chien qui s’avançait vers lui. Mais en même temps, soit que la brebis se trouvât enhardie par la présence d’un tiers, ou quelle vît la bonté peinte sur les traits de Félix — par suite de cet instinct admirable qu’ont les animaux de reconnaître ceux qui ne leur veulent pas de mal, — elle s’arrête tout court elle-même, et se met à apostropher son persécuteur de la sorte :
« Je vous le répète pour la dernière fois, monsieur Pataut ; vos mauvais traitements me révoltent et j’ai résolu de ne les plus souffrir.
— Ta, ta, ta, la belle ! fit celui-ci en ricanant ; te voilà bien brave ; d’abord, pour te plaindre ainsi, quel mal t’ai-je donc fait ? Je te mords souvent, il est vrai, jusqu’au sang... mais c’est pour ton bien, chétive pécore ; tu es la brebis la plus indolente du troupeau ; tu ne veux jamais suivre tes compagnes...
— Oui-dà ! parce qu’il prendra fantaisie à votre berger d’aller jouer, avec ses camarades, sur un rocher aride, il faudra, pour lui plaire, quitter une prairie où nous broutions à loisir. Mais vous, monsieur Pataut, qui traitez si bien les autres de pécore, vous l’êtes encore plus que nous. Vous savez par expérience que, dans tous ces jeux de bergers, il ne vous revient jamais rien de bon ; vous êtes obligé de veiller sur nous nuit et jour, sous peine d’être battu...
— Et c’est pour cela que tu t’éloignes toujours... vilaine sournoise... mais prends-y garde ; un jour, tu t’égareras et tu seras surprise par quelque gros loup qui te croquera.
— Eh bien ! tant mieux, reprit la brebis du ton le plus résolu ; aussi bien, tous les ans, je vois disparaître la plupart de mes compagnes... Est-ce donc le loup qui les mange ? A d’autres, à d’autres, monsieur Pataut ; il y a, pour nous, moins de loups aux bois qu’à la ville. En définitive, si j’avais été croquée par un loup... eh bien ! je n’y penserais déjà plus, tandis que je pense, chaque jour, à la perfidie des hommes qui, abusant de notre douceur, ne nous élèvent que pour s’enrichir de nos toisons et nous manger... Ainsi donc loup pour loup... »
Félix se hâta d’interrompre ce fier discours, qui ne tendait pas à ramener la brebis imprudente au bercail, et puis déjà Pataut grognait dans sa barbe, agitait sa queue ; il perdait évidemment patience. Peu s’en fallut d’abord que notre enfant, déjà si prévenu contre l’espèce humaine, ne prît fait et cause pour la brebis ; mais il se rappela fort à propos l’aventure de la pauvre ânesse dont il avait trop bien pris la défense ; or, jugeant qu’il pourrait aussi mal réussir en cette occurrence, il trouva plus prudent de chercher à réconcilier les deux bêtes ; et il y parvint, non sans peine et les amena même à se donner cordialement la patte comme deux vrais amis. Et c’est dans ces dispositions bienveillantes qu’il les reconduisit jusqu’au bout de la prairie.
Tout content qu’il était d’une si belle prouesse, — car rien ne donne de la joie au cœur comme une bonne action, — Félix prit enfin le parti de se reposer un peu sur l’herbe. Il avait gagné, à toutes ses courses, un appétit dévorant. Le voilà donc qui mord dans son pain, et il en faisait sauter les miettes... dam’, fallait voir ! Les cerises furent également expédiées en un clin-d’œil.
« Maintenant, se dit-il, que vais-je encore faire ? Poursuivrai-je mes excursions ? Non, décidément non, ajouta-t-il après un moment de réflexion pénible ; j’en ai assez vu, trop entendu même... ça m’attriste l’âme, et je vais aller tout conter à mon père. Il avait bien raison, lui, quand il me disait en me confiant ce maudit cornet, tu m’en diras des nouvelles ! Aurais-je jamais pu croire aussi que les hommes étaient si méchants envers les animaux ? Ah ! mon Dieu !... » Et c’est au milieu de toutes ces exclamations que Félix retourna au logis.
Dès qu’il aperçut son père, il courut, les larmes aux yeux, se jeter dans ses bras, et lui rendant bien vite le fatal cornet : « Ah ! papa, s’écria-t-il, les vilains hommes ! Si vous saviez... » et, le cœur tout gros, il lui raconta ses diverses aventures.
M. Derville, en l’écoutant, partit d’abord, à plusieurs reprises, d’un très-grand éclat de rire dont Félix se trouvait intérieurement assez scandalisé ; mais le récit de l’enfant une fois achevé, sa figure prit tout à coup une expression d’indulgente bonté, quoique un peu grave.
« Viens t’asseoir ici, mon fils, et écoute-moi. Tu te repens, je le vois, d’avoir fait usage de ce beau cornet d’ivoire. Eh bien ! tant mieux, mon ami ; que ce soit là une première leçon pour toi : ne cherche donc plus désormais, dans l’ignorance complète où tu es des plus simples lois qui régissent la nature, à vouloir t’initier trop tôt aux secrets de certains faits dont tu ne peux, faute d’intelligence et de raison, comprendre ni la haute portée, ni le but ; c’est ainsi, vois-tu, qu’on s’expose toujours à subir des impressions ridicules ou dangereuses, et qu’on se fait des idées fausses de toutes choses. Ensuite, le voilà tout attristé sur le sort d’une souris, d’une ânesse, d’une poule, d’un cochon, d’un bœuf, d’une brebis, que sais je !... Voilà, dis-tu, d’innocentes victimes de la cruauté des hommes ; tu as entendu leurs plaintes, et tu en as bien vite conclu que l’espèce humaine était méchante à plaisir. Pauvre innocent ! si tu avais d’abord bien réfléchi que tout ce qui est sur la terre a été exclusivement créé pour l’homme ; que Dieu, par son admirable et infinie providence, a placé sous notre main, tout ce qui nous entoure, pour nos besoins les plus absolus : la terre et l’eau, l’air et la lumière avant tout, sans lesquels nous ne saurions exister ; puis les végétaux, les animaux, qui deviennent aussi pour nous l’aliment indispensable et quotidien, qui seul nous fait vivre ;... tu comprendrais assurément que c’est là, mon enfant, la plus impérieuse des lois de la nature, commune à tout ce qui respire, aux animaux, aux végétaux eux-mêmes, comme à l’homme ; qu’à ces conditions seules le monde existe depuis des milliers d’ans ; que, sans elles, tout périrait en vingt-quatre heures sur la surface de la terre... Et s’il en était ainsi, que dirais-tu donc alors ?
— Dam’, mon père... balbutia Félix tout stupéfait d’un si terrible argument, je dirais que ce serait là un bien grand malheur : ne plus pouvoir manger, et puis mourir à cause de ça...
— Hum ! hum ! gourmand que tu es, fit en souriant M. Derville... Eh bien donc ! ne t’apitoie donc plus, comme un fou, sur de vaines doléances. Les animaux se plaignent, suivant toi, de leur sort... Au fait, rien de plus naturel, de plus excusable au fond ; l’homme, en faveur de qui se déploient toutes les merveilles de la création, se plaint bien lui-même ; il accuse bien aussi le sort quand il n’est pas heureux, alors qu’il ne devrait s’en prendre le plus souvent qu’à ses vices, à ses mauvais penchants, à sa paresse. Chez les animaux comme chez l’homme, il n’y a donc que bien et mal ; tu trouveras des animaux bons ou mauvais, comme tu rencontreras, dans le cours de la vie, des hommes méchants, cruels, égoïstes ; comme, en revanche, tu en verras d’autres dont le bon cœur et les vertus honorent l’humanité... de là, le bien ou le mal que l’homme fait à tout ce qui l’approche.
— Oui, oui, interrompit étourdiment Félix, c’est donc pour cela que ces vilains bouviers...
— Allons, encore !... il paraît que tu y tiens décidément, reprit avec ironie M. Derville. — En ce cas, puisqu’il ne faut pas faire le moindre mal aux bœufs, à plus forte raison ne doit-on pas les tuer ; or, dès aujourd’hui, je te supprime la soupe et le bœuf. — Tu aimes aussi passionnément les œufs à la coque ; eh bien ! mon ami, on ne t’en donnera plus... Cette pauvre poule ! comment donc ! il y aurait conscience à la priver de ses œufs. — Tu es fou surtout de poulet ; nous le retrancherons encore, toujours par suite du même raisonnement : on ne saurait enlever aussi cruellement de pauvres poulets à leur mère... — Plus de côtelettes non plus, puisqu’on ne doit pas tuer de moutons ; de jambon dont tu te régales si bien, pas davantage, du moment que les cochons trouvent mauvais qu’on les mange. Bref, mon cher Félix, en raisonnant ainsi, petit à petit nous supprimerons tout. »
Et à chaque nouvelle apostrophe de son père, l’enfant désappointé, de s’écrier : « Mais non, mais non, pas du tout... Ah ! pour le coup... qu’est-ce que nous mangerions donc alors ?
— Ce que tu mangerais ! il faut être conséquent avec soi-même ; et je te vois à peu près, jusqu’à la fin de tes jours, réduit au pain et à l’eau... Au reste c’est là un régime comme un autre.
— Assez, assez ; c’est trop te moquer de moi, papa ; je vois bien que j’avais perdu la tête ; je déraisonnais comme un étourdi ; va, tu peux y compter : une autre fois, je ne serai pas si confiant, je ne croirai plus à tout ce que diront les animaux.
— Tu aurais tort encore, car il en est qui te tiendraient un bien autre langage ; ceux-là te vanteraient alors, à juste titre, la sage prévoyance, la sollicitude, les soins infinis dont l’homme les entoure, dès leur naissance, dans leurs besoins comme dans leurs maladies ; ils t’énuméreraient tous les bienfaits dont ils lui sont redevables... et tu te montrerais peut-être alors aussi enthousiaste de l’espèce humaine que tu témoignais aujourd’hui d’aversion pour elle. Mais cette nouvelle épreuve... tu ne saurais la tenter désormais qu’avec un guide infiniment sage, éminemment éclairé que tu n’as que trop négligé jusqu’ici. Ce guide-là vaudra mille fois mieux pour toi que tous les plus beaux cornets d’ivoire du monde ; du moins, avec lui, tu pourras toujours, sans danger pour ta raison et pour ton cœur, étudier les mœurs, les habitudes, le langage des animaux, car il est lui, mon fils, l’immortel flambeau de tous les âges...
— Ah ! n’achève pas : je devine papa, s’écrie Félix... tu veux parler du bon La Fontaine.
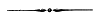

C’était par un après-midi du mois d’octobre 1605. Il faisait un temps affreux ; les arbres des jardins élevés en spirales autour de Lyon, se courbaient et craquaient sous la furie des vents ; la pluie, tombant à torrents, grossissait les eaux vertes du Rhône, qui venaient en bouillonnant se joindre aux eaux jaunâtres de la Saône, à la pointe de Perrache, petite langue de terre qui s’avance entre ces deux fleuves, et forme une des plus jolies promenades de la ville.
Le conducteur de l’Aveugle.

| Lith. de Cattier | |
| Nous voici sur la route de Rome dit Goldoni. | |
Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Précisément à cette même pointe de Perrache, un jeune enfant de quatorze ans environ, debout et immobile sous cette tempête, semblait contempler les eaux des deux fleuves qui, sans confondre leur couleur, continuent de faire rouler de front quelque temps encore, l’un ses eaux jaunâtres, l’autre ses vagues vertes et terribles. Puis, des yeux bleus de cet enfant s’échappaient de temps à autre quelques larmes ; mais du reste il semblait insensible à tout ce bouleversement de la nature.
Une heure s’était passée ainsi, la tempête se calmait, la pluie avait cessé, et l’enfant n’avait changé de place ni d’attitude, quand soudain une voix lamentable, et dont le timbre avait un accent étranger, vint l’arracher à sa préoccupation ; il leva la tête, la tourna lentement vers l’endroit d’où partait cette voix, et ne tarda pas à remarquer un vieillard assis sur une pierre, et un jeune garçon debout devant lui ; les livrées de la misère les couvraient l’un et l’autre.
« Tu es un méchant enfant, Martin, et Dieu t’en punira, disait d’une voix cassée ce vieillard. J’ai soixante-dix ans, je suis aveugle, et, bien que je ne puisse plus voir le soleil de Rome, ma patrie, je veux encore me réchauffer à ses rayons ; pourquoi ne pas vouloir m’accompagner ? qui te retient ici : puisque tu n’as ni père, ni mère, ni parents ?
— Mon soleil à moi, reprit l’enfant d’un ton goguenard !
— Ingrat, répliqua le vieillard : ton père et ta mère étaient morts de misère ; tu allais toi-même périr de froid, il y a de cela treize ans ; je te pris, je te soignai, je t’élevai ; rien ne t’a manqué depuis ce jour ; je ne te demande aujourd’hui que de me servir de guide jusqu’à Rome, et tu me refuses.
— Vous ne me demandez que ça, papa Goldoni, et vous voulez me forcera apprendre un métier...
— Je ne veux pas élever un fainéant.
— Et vous voulez que je prie Dieu soir et matin pour vous.
— Un enfant qui n’aime pas Dieu, n’aime rien.
— Pouvez-vous dire ça ! j’aime beaucoup de choses.
— Oui, le jeu et l’oisiveté ; tu es aussi menteur, gourmand...
— Bref, interrompit vivement le petit Martin, il s’agit que je ne veux pas aller à Rome, et que je n’irai pas... à moins que vous ne me donniez dix sols parisis par mois.
— Tu sais bien que je ne les ai pas, Martin ; ce que je gagne, nous le partageons en frères.
— Oui, les repas, la couchée.
— Eh bien ! que faut-il de plus pour vivre ?
— De l’argent, père Goldoni.
— Je n’en ai pas.
— Alors, au revoir.
— Tu ne m’abandonneras pas ainsi, Martin, dit alors le vieillard d’une voix pitoyable.
— Si vraiment, bel et bien, répartit Martin ; j’ai trouvé un autre aveugle, pas un vrai, celui-là ; au moins, quand j’aurai demandé l’aumône pour lui toute la matinée, le reste du jour, nous jouerons et ferons bombance.
— Mais, c’est affreux ce que tu dis là, s’écria l’aveugle.
— C’est comme ça, répondit le petit en s’éloignant ; — adieu, père Goldoni, bien le bonjour chez vous... mes amitiés à mesdemoiselles vos sœurs...
— Martin !... Martin ! cria le vieillard avec un sentiment de terreur impossible à décrire, ne me laisse pas seul ici, entre deux fleuves, la place est dangereuse pour qui ne voit pas où poser son pied ; conduis-moi au moins hors d’ici.
— Je ne demande pas mieux, dit le mauvais garnement en se rapprochant du vieillard ; mais à une condition.
— Laquelle ? répondit Goldoni.
— Vous me donnerez la croix d’argent que vous portez, nuit et jour, suspendue à votre cou...
— Jamais ! ah ! jamais ! s’écria avec explosion le pauvre homme.
— Alors, bonsoir, père Goldoni.
— Mais, malheureux, reprit celui-ci en pleurant, cette croix ne vaut pas vingt deniers, et c’est le seul gage qui me reste d’une fille que j’ai perdue ; elle est morte en priant Dieu, sur cette croix... Je veux aussi mourir, les lèvres où elle a posé les siennes... Allons, ramène-moi chez moi ; demain je mendierai tout le jour, et, le soir, je te donnerai ce que j’aurai ramassé.
— Un tiens vaut mieux que deux tu auras ; bonsoir, père Goldoni.
— Martin... Martin... cria encore le vieillard ; et, comme le méchant enfant s’en allait en chantant, le malheureux aveugle tira, en pleurant, la croix d’argent de son sein, et collant sa bouche sur l’image de Jésus-Christ qui y était grossièrement sculptée, il rappela ce petit misérable...
— Reviens, lui dit-il, reviens, la voilà. »
Martin revint en courant, pour prendre ce bijou que le pauvre homme embrassait sans pouvoir se décider à s’en séparer ; mais au moment où il tendait le bras pour s’en saisir, une main plus alerte que la sienne le prit et le rendit à l’aveugle.
C’était la main de l’enfant qui, depuis si longtemps, regardait couler les deux fleuves ; il avait tout vu, tout entendu, et, avec cet instinct d’observation qui distingue les âmes intelligentes des âmes vulgaires, il avait voulu s’assurer jusqu’où le mauvais naturel pouvait conduire une créature humaine. Après un premier moment de silence causé par son intervention imprévue, il dit, en remettant la croix dans les mains de l’aveugle ; « Gardez votre trésor, bon vieillard, et dites-moi où vous demeurez, je vous y conduirai, moi.
— Oh ! mon enfant ! car, au son de votre voix pure et argentine, je juge que vous devez être bien jeune, répondit le vieillard, pleurant encore, mais, cette fois, d’attendrissement, que Dieu qui vous a placé comme un ange sur ma route, en mette toujours un sur la vôtre pour vous conduire à bon port. »
Un soupir du jeune inconnu fut toute sa réponse.
« Ne restez pas plus longtemps à l’humidité, brave homme, se contenta-t-il de dire à l’aveugle, en l’aidant à se lever. Éloignons-nous d’ici ; en route, je vous demanderai un conseil.
— Celui qui demande un conseil à la vieillesse est déjà sage, » répliqua l’aveugle, s’appuyant sur le bras de son nouveau guide.
En ce moment, la voix de Martin se fit encore entendre ; cet enfant venait de se joindre à une troupe de mauvais garnements de son espèce, et montrant du doigt à ses camarades son ancien maître, auquel un jeune homme bien mis donnait le bras, il s’écria : « Oh ! hé ! il lui faut des seigneurs pour conducteur à l’aveugle... Dis-donc, vieux sans yeux, prends garde de le perdre, celui-là ; il ne s’en trouve pas neuf à la douzaine sous les pas d’un âne... oh ! hé ! oh ! hé !
— Ne faites pas attention à ces injures, brave homme, dit le jeune inconnu, lisant sur la figure du vieillard tout le chagrin qu’il en ressentait ; elles ne peuvent m’atteindre !...
— Si j’ai du chagrin, ce n’est pas pour vous, généreux enfant, reprit Goldoni, mais bien à cause de cet ingrat que j’ai élevé... Celui qui ne respecte pas les cheveux blancs, ne vivra pas assez pour voir blanchir les siens !... Mais, parlons de vous, qui êtes-vous ? et en quoi mes conseils peuvent-ils vous être utiles ?
— Voici, dit l’inconnu tout en marchant et s’acheminant vers une petite ruelle du côté de Fourvières, où le vieillard avait dit demeurer. — Je me nomme François Perrier ; mon père tient une boutique d’orfévrerie à Mâcon, et il aurait voulu que je continuasse son état ; mais j’ai une vocation, voyez-vous, une vocation qui m’empêchera toujours de faire autre chose ; j’adore la peinture, je veux être peintre... Un homme, comme mon père, élevé et vieilli dans le commerce, n’entendait guère de cette oreille-là : or, chaque fois qu’il était question entre nous de peinture : « Tu es mon seul fils, me disait-il, je n’ai que des filles ; juge de mon chagrin, s’il fallait qu’après ma mort cette boutique passât en des mains étrangères, et qu’au lieu d’y voir écrit sur son enseigne : François Perrier, argentier, successeur de son père, on y lût le premier nom venu... Enfin, j’ai tant prié, qu’il y a un an, mon père s’est décidé à m’envoyer ici en apprentissage chez un peintre... Mais, hélas ! savez-vous à quoi mon maître m’employait depuis tout ce temps ?... à broyer des couleurs ; mais, pour ce qui est de toucher un pinceau, une palette, de mettre enfin de la couleur sur une toile !... il prétend, le barbare, que je suis trop jeune... Il y a trois jours, nous nous sommes donc pris de querelle, et je l’ai quitté... et me voilà seul ; jugez de mon embarras !... Que faire ?... que faire ?... retourner chez mon père !... pas plus avancé que le jour où je l’ai quitté... lui demander un autre maître... m’exposer à ses reproches, au spectacle de sa douleur ; non, non, donnez-moi un conseil, bon vieillard...
— Hélas ! dit l’aveugle, après un moment de réflexion, j’en ai bien un à vous donner... mais je n’ose... vous êtes bien mis, il me semble, le drap de votre pourpoint est doux au toucher.
— Hélas ! c’est mon seul et unique ; j’ai vendu l’autre pour me procurer un peu d’argent.
— Et aujourd’hui que vous reste-t-il de cet argent ?
— Pas un seul liard... reprit Perrier.
— Quel âge avez-vous ?
— Quinze ans, à la Noël.
— Voulez-vous aller à Rome ? jeune homme.
— Oh ! Rome, le berceau des arts ! oh ! oui, je veux y aller, s’écrie l’enfant avec l’enthousiasme du génie et de la jeunesse, oui, je veux y aller, oh ! dussé-je vous servir de guide et mendier pour vous tout le long de la route...
— C’est précisément ce que j’allais vous proposer, dit froidement le vieillard.
— Et pourquoi hésiter ? demanda Perrier.
— Je voulais que la proposition vînt de vous, dit Goldoni... comme aussi avant de nous mettre en route, je veux que vous répondiez à ceci : une fois arrivé à Rome, que deviendrez-vous ?... Songez que je ne puis plus rien.
— Dieu est grand ! s’écria François Perrier avec un accent qui avait fait deviner à l’aveugle qu’en parlant le jeune homme levait les yeux au ciel.
— Vous avez confiance en Dieu ! je ne doute plus de vous, répondit le pieux Italien ; demain, nous partirons.
Le lendemain, en effet, Goldoni et son conducteur quittaient le modeste gîte de l’aveugle pour prendre la route d’Italie. En passant sur la place Bellecour qu’il fallait traverser pour sortir de Lyon, François Perrier remarque un rassemblement. Soit curiosité, soit instinct de ce qu’il allait voir, il abandonne un moment le bras de l’aveugle pour s’approcher du groupe, au milieu duquel il aperçoit un enfant étendu par terre et mort qu’il ne reconnaît pas d’abord.
« Qu’est-ce ? demanda-t-il à la personne qui se trouvait plus près de lui.
— C’est un mauvais drôle de moins, lui fut-il répondu ; c’est le petit conducteur de l’aveugle Goldoni ; il se sera pris hier de querelle sans doute avec quelques garnements de sa trempe, on l’aura poussé dans le Rhône ; on vient de retrouver son corps à la pointe de Perrache...
— Et il est mort ? demanda François Perrier, le cœur glacé par l’idée que ce méchant enfant avait péri à l’endroit même où il s’était montré si inhumain envers celui qui lui avait tenu lieu de père ;... il était resté sourd aux prières de ce vieillard, se dit-il, et Dieu a été sourd à ses prières à lui. François, tout absorbé par cette pensée, retourna trouver Goldoni ; il reprit son bras, et évitant de le faire passer devant le groupe qui entourait Martin, dans la crainte qu’il n’entendît quelques mots susceptibles d’éveiller ses soupçons, il le conduisit hors des portes de Lyon.
— Nous voici sur la route de Rome, dit Goldoni serrant avec reconnaissance la main de son conducteur.
— Et sur celle de la gloire, je l’espère, reprit le jeune Bourguignon.
— Celle de la gloire mène à la fortune, répliqua l’aveugle en souriant. »
En arrivant à Rome, Goldoni et Perrier n’étaient plus de nouvelles connaissances, mais bien de bons amis, de braves compagnons, car la gaieté précieuse de l’aveugle avait souvent égayé la sombre mélancolie de l’enfant ; plus ce dernier voyait approcher le moment de sa séparation avec l’aveugle et plus il frémissait ; il allait donc encore une fois se trouver seul, et cette fois, sur une terre étrangère : cette solitude l’effrayait.
« Il doit y avoir derrière le Capitole, dit Goldoni à son jeune conducteur, un vieux marchand de tableaux nommé Paolo Broggi ; peut-être bien pourra-t-il vous être utile, allons le voir, mon enfant. »
Et prenant le bras du jeune François, Goldoni se fit conduire par lui, sur une petite place située derrière le Capitole.
« Voyez-vous ici, à votre gauche, une petite boutique noire ? demanda Goldoni.
— Non, mais je vois un beau magasin.
— Avec de méchantes croûtes d’au moins trois cents ans.
— Au contraire, avec des tableaux qui me paraissent appartenir à de grands maîtres.
— Cela aura changé, reprit le vieux mendiant, mais le propriétaire n’aura pas changé du moins, comme sa boutique et ses tableaux ; c’est un petit homme, laid, chauve, mal vêtu...
— Celui que j’aperçois, et qui me paraît être le maître du magasin, répondit François Perrier, est un grand beau jeune homme.
— Oh ! pour le coup, c’est trop fort, répliqua Goldoni... Il faut que je m’assure... Avançons, ne sommes-nous point ici chez le signor Paolo Broggi ? demanda le vieillard, quand il sentit sous son pied la première marche de la boutique.
— Si signor ; qu’y a-t-il pour votre service ? répondit le beau jeune homme en saluant les nouveaux venus.
— C’est la voix de mon vieux Broggi, mais rajeuni, dit Goldoni.
— Je suis son fils, répliqua le marchand de tableaux. Mon père, retiré aux environs de Rome, m’a cédé sa boutique et ses tableaux ; mais, puisque vous êtes un ami de mon père, venez, reposez-vous, parlons de lui. »
Pendant que le vieillard entré dans la boutique, causait avec le jeune homme de son vieil ami, François Perrier, de son côté, parcourait le magasin où il se trouvait, examinant, un à un, chaque tableau.
« Ah ! ceci est un Giotto : il date de l’époque de la mort de ce peintre en 1336, dit-il arrêté devant une toile représentant la barque de saint Pierre agitée par la tempête.
— Vous êtes artiste, dit le marchand en se retournant vers Perrier.
— Je voudrais le devenir, reprit celui-ci.
— Je vois que vous connaissez les maîtres, dit le marchand.
— Ah ! voici un Bonamico Bufalmaco, ajouta bientôt François ; c’était bien l’homme le plus gai, le plus facétieux de son temps » ; et comme il se vit écouté non-seulement par le marchand et le vieil aveugle, mais encore par quelques étrangers entrés pour acheter, il continua de la sorte : « c’est à lui qu’on doit l’une des charges les plus ridicules de certains peintres du quatorzième siècle ; un de ses amis, nommé Bruno, qui peignait fort mal, vint un jour le trouver : « Je suis très-embarrassé pour peindre mes personnages avec l’expression que je veux leur donner, lui dit-il ; un homme qui prie, je lui fais la figure en colère ; une femme qui pleure, je la fais rire ; indique-moi, je t’en prie, un moyen pour que celui qui regarde un tableau, sache tout de suite de quoi il est question. — C’est bien simple, lui répondit Bufalmaco : tu leur fais sortir de la bouche une espèce de ruban sur lequel se trouvera écrit tout ce que tu voudras faire dire à tes personnages. — C’est ma foi vrai, répondit Bruno. Ah ! que je suis bête de n’avoir pas trouvé ça tout seul ! » Cet avis, donné en plaisantant, fut suivi par Bruno ; quelques peintres, après lui, renchérirent encore en ajoutant des réponses aux demandes : ce qui produisait à l’œil l’effet le plus singulièrement grotesque. Bufalmaco mourut en 1340, je crois. »
L’érudition du jeune étranger ayant plu au marchand, celui-ci lui demanda s’il savait peindre, et s’il saurait copier quelques-uns des tableaux dont il connaissait si bien les auteurs.
« J’essaierai, répondit modestement François Perrier. »
Effectivement, il commença par copier les tableaux des anciens maîtres pour le marchand de tableaux, puis il se mit à retoucher les dessins de quelques jeunes gens ; Laufranc, qui fit sa rencontre chez Broggi, prit en amitié le jeune François et lui donna d’excellents conseils.
Après un assez long séjour à Rome, François Perrier reprit le chemin de sa patrie ; il s’arrêta à Lyon, où il peignit le petit cloître des Chartreux d’une manière savante et facile.
On voit, au château de Versailles, un tableau de ce maître ; c’est la fable d’Acis et Galatée.

Nous commençâmes notre excursion au village d’Yverness. La route, ombragée par des pins et des cityses, était charmante ; et notre vue se trouvait, par intervalles, récréée, d’un côté, par la perspective de la vallée du Rhône, de l’autre, par les montagnes du Valais, couronnées d’une neige éternelle.
Après avoir monté pendant plus de deux heures, nous arrivâmes à un endroit appelé les ruines, et à fort juste titre, car ici le chemin devient perpendiculaire : vous ne voyez de toutes parts que masses de rochers à pic se dominant les uns les autres.
A peine eûmes-nous traversé ce désert, que nous entrâmes dans une plaine, d’où le lac de Genève nous apparut tout à coup dans toute son étendue et à une immense profondeur. Un pâtre nous accueillit dans sa cabane (sennhutte) avec beaucoup d’hospitalité ; après quoi, nous gagnâmes le gîte où nous devions passer la nuit.
C’était une autre sennhutte, située au pied de deux rochers majestueux : l’un desquels avait la forme exacte d’une coupole aplatie ; on lui donnait le nom de Tour de Mayenne, par allusion à certain fait historique que notre bon montagnard ne put nous expliquer.
Dévoré du désir d’atteindre le sommet de cette tour, d’où je me promettais une perspective magnifique et une riche collection de plantes, je pris, le lendemain matin, congé de mon compagnon de voyage, et muni d’un petit panier contenant du pain et du vin, je commençai mon ascension à la Tour de Mayenne. Mon hôte m’avait assuré que l’entreprise n’offrait aucune difficulté ; en effet, je parvins jusqu’au sommet du rocher sans le moindre accident. La beauté du tableau qui s’offrit à mes regards, surpassa même de beaucoup mon attente ; j’étais heureux, ivre de joie, dans l’extase ; j’avais fait d’ailleurs une riche moisson de plantes les plus rares.
J’étais loin de m’attendre à ce qui devait m’arriver. Ma curiosité une fois satisfaite, il ne me restait plus qu’à revenir tranquillement à la sennhutte, par le sentier commode que j’avais suivi en montant ; mais, pour mon malheur, je ne sais quel démon me suggéra l’idée qu’en tournant le côté oriental de la Tour de Mayenne, je trouverais un autre sentier par lequel j’aurais la faculté de descendre aussi facilement ; ainsi, disais-je, j’aurai parcouru, dans tous les sens, cette magnifique perspective. Imprudent ! j’ignorais que la chaîne de rochers au milieu desquels je croyais me frayer un passage, régnait à pic au-dessus d’un horrible précipice.
Après m’être ainsi promené quelque temps d’abord le long d’une vallée, avoir gravi ensuite une colline, j’arrivai insensiblement au pied d’un rocher très-escarpé ; il s’agissait d’en atteindre le sommet : ce qui n’était pas facile ; cependant, à l’aide d’efforts inouïs et surtout de buissons qui sortaient des fentes du roc et auxquels je me cramponnais avec force, j’atteignis enfin sa crête. Oui, mais excédé de fatigue, je tombai la face contre terre et le soleil dardait à plomb sur ma tête.
C’est alors que de tristes réflexions vinrent m’assaillir ; je me pris à maudire la fatale curiosité qui m’avait amené jusque sur ce rocher ; ainsi j’étais égaré dans des lieux inconnus où l’on ne voyait pas même la trace d’un pied humain. Je me crus perdu sans ressource, quand soudain un rayon d’espérance vint luire à mes yeux : « mais, cette Tour de Mayenne que j’aperçois encore, m’écriai-je, n’est-elle pas pour moi un phare, un guide naturel ? elle s’élève directement à l’est de notre sennhutte ; en m’orientant bien et ne la perdant jamais de vue, je suis indubitablement sauvé. » Cette heureuse pensée me ranima ; plein de confiance, je me mets à suivre la pente douce qui s’ouvrait devant moi, la joie précipitait mes pas ! j’en atteins enfin l’extrémité....
Que vois-je ? un désert immense, couvert de neige, entrecoupé de pointes de rochers et de gouffres effroyables. Je tressaille d’effroi, car, lors même que mes forces n’eussent pas été épuisées, pouvais-je concevoir l’insensé projet de traverser ces régions désolées. Je demeure un moment anéanti... Il ne me reste donc plus, selon moi, qu’un seul parti désespéré : celui de revenir sur mes pas et d’essayer, au risque de ma vie, de reprendre la route même par laquelle j’étais venu.
Me voilà finalement de retour sur ce fatal rocher que j’avais eu tant de peine à escalader ; je me penche vers sa base pour me rendre compte de sa hauteur ! De quelle épouvante ne suis-je pas saisi en trouvant sous mes pieds un précipice infranchissable, à l’endroit même où je n’avais vu sur ma tête qu’un roc à pic. Cet effet, auquel on ne réfléchit pas assez, est cependant tout naturel ; il est tel escarpement qu’on gravira sans trop de difficultés, et qu’on ne pourra descendre ensuite sans le plus grand danger. Or, dans ma cruelle position, il me devenait impossible de ne pas être englouti dans l’abîme, à moins de poser mes pieds, l’un après l’autre et très-précisément, sur chaque petit buisson qui m’avait si bien aidé à monter ; mais, pour cela faire, il eût fallu avoir des yeux à la plante des pieds.
« Ah ! mon Dieu, exclamai-je alors en levant mes mains suppliantes au ciel, que faire ! que faire ! inspirez-moi, mon Dieu ! »
Et le sang me montait à la tête, et mes dents claquaient d’effroi. C’en était donc fait : il ne me restait plus maintenant d’autre ressource, pour ma délivrance, que de tenter un passage à travers l’horrible désert dont l’aspect seul m’avait terrifié... C’était là sans doute braver mille morts pour une..., mais demeurer sur ce rocher, c’était mourir aussi d’une manière non moins cruelle, c’est-à-dire de faim, de froid, de désespoir...
Il n y avait point à balancer ; je retourne une deuxième fois sur mes pas ; j’ai franchi la pente, atteint son extrémité..., et là, en présence de cet effrayant chaos de neiges, de gouffres, de rochers qui s’étendent sous mes pieds, que j’ose contempler à peine, au sein desquels il faut cependant que je m’aventure en désespoir de cause, j’abandonne solennellement mon âme à Dieu ; puis je me signe et me confie à l’abîme...
Je tenterais vainement de décrire tout ce que j’eus à souffrir d’angoisses et de tortures au milieu des périls sans nom qui accompagnaient chacun de mes pas... C’était une lutte de chaque instant contre la mort, qui ne cessait de m’apparaître sous mille formes nouvelles et toujours plus horribles. A n’en pas douter, Dieu avait jeté un regard de miséricorde sur sa créature..., car il ne serait donné ni au cœur ni aux forces de l’homme de pouvoir supporter, pendant quatre heures entières, tous les supplices que j’endurai.
Tantôt je me trouvais précipité dans de profondes crevasses remplies de neige, d’où je ne me tirais ensuite qu’avec des efforts surhumains ; ou bien c’étaient des chutes réitérées sur des pointes de rochers qui me brisaient le corps ; les os de mes chevilles, mes genoux, mes mains, étaient déchirés, tout sanglants ; car il me fallait, à chaque minute, m’accrocher et me cramponner après des rocs aigus.
Enfin, comme je l’ai dit, il y avait déjà quatre heures et plus que je me débattais ainsi, dans une agonie désespérée contre la mort..., et je n’avais pas gagné encore dix mètres de terrain en ligne directe, et mes forces étaient totalement épuisées, et l’horrible désert semblait s’étendre encore aussi loin devant moi qu’au premier pas que j’avais fait. Résigné à périr, j’avalai ma dernière goutte de vin, mangeai le reste de mon pain, — ce devait être là mon dernier repas ; — et, m’étendant sur le roc qui allait me servir de linceul, je tombai malgré moi dans un profond assoupissement.
Mon existence ne tenait donc plus qu’à un fil ; car ce sommeil, qui venait de succéder à mon état de stupeur, c’était la mort ; il devait inévitablement se prolonger au-delà du coucher du soleil ; alors la nuit m’enveloppait de son manteau de glace, et je ne me réveillais plus.
Eh bien ! à quelle circonstance miraculeuse ai-je dû pourtant ma délivrance ? vous ne le croiriez jamais ; c’est là, en effet, l’événement le plus extraordinaire qui soit jamais arrivé à une créature humaine. Voici :
Un aigle avait probablement son nid placé près du roc où je m’étais endormi. Il en sort tout à coup, et poussant à ma vue les cris les plus aigus, il passe sur ma tête et me froisse si violemment que je m’éveille en sursaut, malgré le sommeil de plomb dans lequel j’étais déjà plongé ; j’ouvre les yeux, je reviens à moi... D’abord je frémis, rien qu’à l’idée du péril auquel je viens d’échapper ; puis, ma première pensée est de remercier le ciel de l’avertissement inespéré qu’il a daigné m’envoyer.
Il était alors six heures, mes forces étaient revenues : « Allons, m’écriai-je, une dernière tentative encore pour m’arracher à ce séjour d’horreur... Il est écrit là-haut que je n’y dois pas mourir. » Et poussé par ce pressentiment indéfinissable qui centuple mes forces et mon courage, voilà que je me remets à lutter contre les mille obstacles qui se dressent devant moi, et, pendant plus d’une heure, je m’efforce de nouveau de me frayer une voie à travers la neige et les crevasses... Une dernière fois enfin je m’élance sur une pointe de roc, mon pied glisse, et je vais rouler, tout étourdi de cette horrible secousse, de chute en chute, jusqu’au beau milieu du lit d’un torrent.
Je fus près de dix minutes à reprendre l’usage de mes sens... J’avais d’affreux éblouissements, tout tournait autour de moi.... Enfin, je pus fixer mes regards sur l’endroit où je me trouvais et m’en rendre compte.
« Un torrent ! » ce fut là ma seule exclamation ; — c’était pour moi un ineffable trait de lumière. — J’accueille avec ivresse ce fortuné présage de ma délivrance ; car, puisqu’il servait, dans une saison plus douce, à conduire les eaux dans les plaines du bas, il devait m’y conduire aussi ; il était à sec, seulement il était çà et là obstrué de neige. Je me mets à descendre, en suivant les sinuosités de deux masses de rochers qui se trouvaient alternativement unies ou rudes, selon l’impétuosité plus ou moins grande du torrent qui se précipite dessus.
Après deux heures de cette marche pénible, j’entends tout à coup au loin les clochettes des troupeaux et le chant des bergers. Ah ! jamais les notes de la musique la plus délicieuse n’avaient frappé mon oreille d’un tel charme que ces sons discordants. Ne devenaient-ils pas un chant de salut pour moi ? Peu d’instants après, la fumée d’une sennhutte qui s’élevait au-dessus d’une forêt de sapins, me servait de guide ; je dirigeai mes pas vers un asile hospitalier ; quand j’y entrai, il était huit heures du soir.
A mon aspect, tous les habitants de la sennhutte se levèrent effrayés. Ils croyaient voir un spectre ; j’étais en effet dans un état si déplorable, les vêtements en lambeaux, les membres en sang, les yeux hagards, les traits bouleversés. Mais, à peine eus-je fait le récit de mon aventure, que ces bons montagnards prirent l’intérêt le plus vif à mes souffrances et me prodiguèrent les soins les plus empressés. Ils ne revenaient pas de leur surprise que j’eusse échappé à la mort, surtout quand je leur eus fait la description du glacier par lequel j’étais descendu. « Mais, s’écriaient-ils à l’envi, sur mille voyageurs, pas un ne s’en fût tiré ; nos chasseurs de chamois eux-mêmes n’oseraient s’y aventurer. »
Je me le tins pour dit. De compte fait, j’étais resté quatorze heures entre la vie et la mort, perdu dans les Alpes... C’était plus qu’il n’en fallait pour être assuré de n’oublier jamais, tant que je vivrai, la Tour de Mayenne.
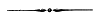

Il était une fois, en un pays bien loin, bien loin de la France, un grand seigneur ayant nom Zorab, ministre favori du roi. Quoiqu’il tint le premier rang à la cour par son crédit auprès du prince, on ne lui connaissait cependant aucun ennemi : — ce n’était pas, mes enfants, un ministre comme un autre ; — il est vrai qu’il savait n’user de son pouvoir qu’avec modération, et que sa sagesse égalait ses talents.
Zorab n’avait qu’un fils, et cet enfant avait, en naissant, coûté la vie à sa mère. Privé de la surveillance maternelle, Alidor contracta de bonne heure une foule de mauvaises habitudes, qui, bien que rachetées par un excellent cœur, le rendaient le plus souvent à charge à ceux qui l’entouraient. Zorab, détourné des soins de son éducation par l’embarras des affaires publiques, voyait avec peine les funestes inclinations de son fils, et il ne savait comment y remédier. Il avait cependant placé déjà près de lui, pour l’instruire, plusieurs précepteurs habiles ; mais l’indocile enfant n’avait jamais voulu profiter de leurs leçons. Ne s’imaginait-il pas que le fils d’un grand seigneur comme lui, ne devait rien apprendre ! Aussi, qu’arriva-t-il ? c’est qu’il était d’une ignorance à faire pitié, et notez qu’il entrait dans sa quinzième année.
Un jour, Zorab se promenait tout pensif au milieu des jardins du palais, cherchant dans sa tête un dernier moyen de rendre son fils digne un jour de le remplacer près du roi ; mais il fallait, pour en venir là, qu’Alidor fût totalement changé ; or, ce n’était pas une petite affaire ; et comme monsieur ne voulait pas, le moins du monde, entendre parler d’études, comme il jetait sans façon tous ses livres au nez de ses maîtres, et leur faisait mille autres espiègleries tout aussi peu aimables, le moyen, après cela, d’en faire jamais un homme d’état ?
Zorab se désolait ; il en était déjà venu, en désespoir de cause, à l’idée de se démettre des fonctions qu’il exerçait à la cour pour se consacrer tout entier lui-même à l’éducation d’Alidor. Il ne voyait que ce parti extrême pour tirer le malheureux jeune homme de l’état de nullité où il croupissait. Il s’était donc arrêté bien définitivement à ce moyen rigoureux, lorsqu’il entend soudain un léger bruit derrière lui ; il se retourne, et voit à sa grande stupéfaction s’ouvrir en deux un arbre près duquel il se trouvait. Et qui est-ce qui sort du creux de cet arbre ? un vieillard vénérable vêtu d’une robe blanche comme neige, la tête ceinte d’une couronne de diamants, et tenant à la main une baguette d’or ; le vieillard s’avance vers Zorab ; celui-ci, saisi de terreur, s’incline profondément : « Vertueux mortel, lui dit le génie, — car c’était un génie ; au temps des fées, ces messieurs n’étaient pas rares. — Je viens à ton secours, cesse donc tes plaintes, ton fils sera digne de toi, grâce à ce petit talisman dont la vertu est infaillible... » En disant ces mots, le génie présente en effet à Zorab une bague en or surmontée d’un diamant d’une beauté incomparable. « Tu vois cette bague, ajouta-t-il ; quand Alidor l’aura une fois passée à son doigt, et il en sera bien tenté, elle est assez belle pour cela, il faudra bon gré, mal gré qu’il change et devienne studieux ; une noble émulation s’emparera de lui, et il se dévouera sans relâche à la pratique du bien ; car voici la vertu bizarre de cette bague : ce sera de rester toujours pure et brillante, telle qu’elle est maintenant, tant que ton fils se conduira d’une manière irréprochable ; mais de transformer immédiatement son or en plomb, son diamant en pierre informe, à la moindre faute qu’il aura commise. Et qu’il ne croie pas se pouvoir soustraire jamais à la surveillance de ce témoin accusateur ; une fois à son doigt, aucune puissance humaine ne l’en saurait tirer. Quant à toi, ministre sage et vertueux, garde-toi bien de quitter le roi, il a toujours besoin de tes conseils et de ton expérience pour gouverner ses sujets. » A ces mots le génie disparut.
Surpris au dernier point de la scène qui venait de se passer, Zorab eût vraiment été tenté de croire que tout cela n’était qu’une vision, qu’un vain rêve, si la bague enchantée qu’il tenait encore à la main ne lui eût bientôt prouvé que rien n’était plus réel ; il se prit à l’examiner ; le diamant brillait d’un éclat étrange ; il n’eut guère été possible d’en trouver un pareil dans tout le royaume ; et il le contemplait encore, quand son fils vint à sa rencontre.
Dès qu’Alidor aperçut la bague dont l’éclat l’éblouit tout d’abord, il poussa un cri d’admiration, et supplia son bon père de la lui donner, selon la louable habitude, au reste, qu’ont les enfants de désirer toujours ce qu’ils voient dans les mains de leurs parents. « Si elle peut vous faire plaisir, mon fils, répartit avec douceur Zorab, je ne demande pas mieux que de vous en faire présent ; mais, avant tout, je dois vous prévenir que cette bague a une propriété fort singulière : elle se change en anneau de plomb à chaque mauvaise action que commet celui qui la porte. Voyez alors si à cette condition... »
Notre jeune homme croyant que son père voulait se moquer de lui, et ne lui tenait ce langage que pour ne pas lui donner la bague, n’en persista qu’avec plus d’instances dans sa prière : or, Zorab, qui ne demandait pas mieux que de tenter la curieuse épreuve que lui avait annoncée le génie, puisque le bonheur de son fils s’y trouvait attaché, consentit bien volontiers à lui confier le précieux talisman.
Alidor s’en empare donc, l’essaie, elle lui allait à merveille... Oh ! alors il est tout fier, il ne se sent plus de joie, et veut aller bien vite montrer ce magnifique joyau à un jeune seigneur de son âge, avec lequel il était intimement lié. En traversant le jardin, il rencontre un de ses précepteurs qui courait après lui depuis une demi-heure pour lui donner sa leçon. « Ma leçon, reprend Alidor d’un air dédaigneux ; ah ! j’ai bien autre chose vraiment qui m’occupe, que vos sottes leçons ; je n’ai pas le temps, ajouta-t-il d’un ton sec, » et, passant brusquement devant lui sans s’arrêter : « ce sera pour une autre fois ; » et le voilà qui poursuit son chemin, toujours courant ; il arrive enfin, tout hors d’haleine, près de son ami.
« Regarde, mon cher Astolfe, lui dit-il, en tendant la main d’un air glorieux, regarde la bague superbe que vient de me donner mon père ! quel beau diamant ! quels feux ! il n’y en a pas, je gage, un pareil à la cour. »
Alidor allait poursuivre lorsqu’un grand éclat de rire d’Astolfe lui coupa soudain la parole. « Je t’en fais mon compliment, mon cher ami, lui répond-il d’un air goguenard, tu es un fin connaisseur en joyaux ; celui-ci est de fait admirable, » et il se prit à rire de plus belle à gorge déployée.
Alidor, stupéfait d’une réception si singulière, porte aussitôt les yeux sur son doigt ; mais jugez, mes enfants, de toute sa confusion, lorsqu’en place de la bague dont il était si fier, il ne voit plus qu’un anneau de plomb, tout noir, surmonté d’une pierre de grès. Humilié, confus de sa mésaventure, il se rappelle alors les paroles de son père, la réception brutale qu’il avait faite à son précepteur ; et, sans oser lever les yeux sur Astolfe, il sort tout honteux.
Une fois seul, son premier mouvement, d’ailleurs si naturel, fut d’essayer à retirer de son doigt la funeste bague ; mais vaines tentatives ! elle y tenait si fort, qu’il se serait plutôt enlevé la peau que de la faire bouger. Ainsi donc le pauvre jeune homme eut beau dire et beau faire, le désespoir dans l’âme, le voilà forcé de prendre son parti et de garder à son doigt ce vilain anneau, tout horrible à voir qu’il fût.
Cependant ce moment de colère une fois passé, Alidor commença à réfléchir très-sérieusement à la nécessité pour lui de n’être plus exposé à rougir ainsi devant tout le monde : « Après tout, se disait-il, que faire de mes mains ? je ne puis toujours les avoir dans mes poches, c’est bon pour un moment ; et ce maudit anneau de plomb saute tout de suite aux yeux... et alors... ce seraient des questions à n’en plus finir, je deviendrais un éternel sujet de risée pour le premier venu. Ah ! mon père m’avait trop bien dit la vérité. Fatal présent qu’il m’a fait là !... Au reste, ce qui vient de m’arriver n’est que la juste punition de mon impolitesse envers mon précepteur. » Comme vous le voyez, mes enfants, Alidor ne raisonnait pas trop mal ; il avait d’ailleurs un bon cœur ; il se repentit donc bien vite de sa faute, et n’avisa plus qu’au moyen de l’aller réparer.
Aucune expression ne saurait vous rendre la surprise du précepteur d’Alidor, quand il vit celui-ci revenir près de lui d’un air tout contrit, repentant ; et ce fut bien autre chose vraiment, lorsqu’il l’entendit lui faire d’humbles excuses pour son impolitesse et son manque de respect. Touché d’une conversion si heureuse, et surtout si imprévue, ce digne homme en profita pour faire à son jeune élève de douces remontrances sur la honteuse oisiveté à laquelle il s’était livré jusqu’alors ; il lui fit sentir que l’étude lui devenait d’autant plus nécessaire à lui, que, se trouvant placé par son rang au-dessus des autres, il devait leur être également supérieur par l’instruction et le mérite.
Alidor, pour la première fois de sa vie, écouta son maître avec une docilité surprenante. Dès ce jour-là même, il commença de mettre ses leçons en pratique ; aussi le soir, avant de se coucher, et tout aussitôt qu’il se trouva seul, fut-il bien curieux de vérifier s’il ne s’était pas déjà opéré un petit changement dans sa bague. De quelle joie son âme fut saisie, en remarquant avec des peines infinies, il est vrai, — car c’était si peu de chose, — que son vilain anneau était un petit peu moins noir : « Ah ! courage, courage, se dit-il ; allons, je vois qu’avec le temps nous y viendrons. Hélas ! que le mal est prompt à faire et lent à réparer !... »
Dès le lendemain, armé d’une résolution bien autrement forte et généreuse, il s’appliqua à l’étude avec plus d’ardeur encore, et ainsi de suite tous les jours, si bien qu’au bout d’un mois à peine, il avait appris déjà ce que tout autre n’eût pas su même en l’espace d’une année. « Ce que c’est pourtant, direz-vous, que la protection d’un génie ; malheureusement on n’en trouve plus de nos jours... » mais, en disant cela, vous auriez tort, mes amis : il y aura toujours pour les enfants un bon génie qui les guidera vers le bien ; et ce bon génie-là, c’est leur propre cœur, c’est le véritable amour qu’ils auront pour leurs parents, convaincus qu’ils seront de les rendre heureux de leurs succès, de leurs vertus et de leur propre bonheur.
Mais revenons à ce cher Alidor. C’était donc, chaque jour, de sa part, un zèle toujours plus ardent pour l’étude, et cependant, malgré les précautions infinies qu’il avait prises durant ce long temps d’épreuve, il avait eu bien de la peine à dérober à certains yeux clairvoyants le ridicule anneau qu’il portait au doigt ; il avait suffi d’une minute pour changer son or en plomb, son diamant en grès, et il fallait bien du temps pour que la bague inexorable revînt à son état primitif ; la métamorphose ne s’opérait toujours que très-lentement.
Alidor n’avait confié son chagrin qu’à son père : or, celui-ci était en secret trop heureux de voir son fils réparer ses torts passés avec une si admirable persévérance, pour ne pas lui venir aussi en aide en soutenant son courage. « Bien, très-bien, mon enfant, lui disait-il, poursuis, poursuis toujours, ne te lasse pas, crois-moi ; à force de sagesse et de travail, tu parviendras à désarmer enfin le courroux du génie. »
Tous les jours, dès qu’Alidor s’éveillait, son premier mouvement était de porter les yeux sur le fatal anneau pour examiner avec soin le moindre petit changement qui s’y était opéré depuis la veille. Un beau matin, le voilà tout à coup plongé dans une extase indéfinissable ; c’est qu’il avait enfin revu sa bague aussi brillante, aussi pure que le jour où il l’avait reçue ; le diamant semblait même étinceler de feux plus éclatants. Ah ! de combien de baisers il couvrit cette bague, alors devenue si précieuse : « Voilà donc enfin, s’écria-t-il transporté de joie, voilà le prix de tous mes efforts, de ma constance ! je suis beaucoup trop heureux de ma victoire pour m’exposer à ce que jamais cette bague subisse à mon doigt une seconde métamorphose ! Je sais ce qu’il en coûte maintenant pour réparer même la plus petite faute. »
Et Alidor persévéra en effet si bien dans ces excellentes dispositions, qu’au bout de l’année suivante il était devenu un jeune homme accompli. Pendant ce long espace de temps, il n’avait pas vu, même une seule fois, son diamant pâlir le moins du monde.
C’est ainsi que le fils de Zorab atteignit enfin l’âge de dix-huit ans. Obligé de suivre alors le roi dans une guerre lointaine, il se signala par des prodiges de valeur ; il eut même la gloire de lui sauver la vie. Aussi le monarque, appréciant chez Alidor tant de vertus, de mérite et de nobles qualités, le nomma-t-il plus tard généralissime de ses armées.
Le sage Zorab vit donc ainsi tous ses vœux comblés. Si complétement récompensé, par la joie qu’il ressentait de l’élévation de son fils, de tous les sacrifices qu’il s’était imposés pour en faire un être accompli, « tout pour une bague, se répétait-il chaque jour ; » Alidor lui a tout immolé : nonchalance, paresse, inclinations mauvaises ; devant ce Mentor rigide, constamment placé sous ses yeux, qui l’accusait et le poursuivait sans cesse comme un remords, il a senti la honte lui monter au front : honte salutaire qui l’a sauvé de lui-même, l’a ramené au sentiment de ses devoirs, à la dignité de sa position, pour faire enfin de lui un homme honorable. Ah ! le beau talisman ! »
Eh bien ! mes enfants, ce beau talisman que le génie de Zorab mettait si ingénieusement au doigt d’Alidor, pour frapper ses yeux à toute heure du jour, vous le portez aussi tous avec vous ; il est même beaucoup mieux placé que la bague d’Alidor, car il est au fond de votre cœur : c’est votre conscience.
FIN DU VOLUME.
Note de Transcription
Les mots mal orthographiés et les erreurs d’impression ont été corrigées. Lorsque plusieurs orthographes se produisent, l’utilisation de la majorité a été employé.
Ponctuation a été maintenue sauf si évidente erreurs d’impression se produisent.
Certaines illustrations ont été déplacées pour faciliter la mise en page.
Une couverture a été créée pour ce livre électronique et est placée dans le domaine public.
Une table des matières a été créée pour la commodité du lecteur.
[Fin de Le Dimanche des Enfants-Tome 7, par Various.]