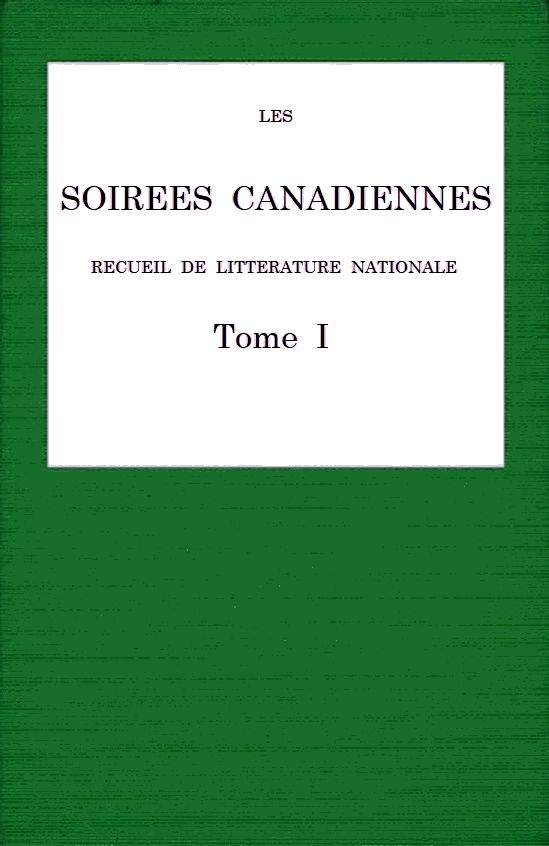
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: Les Soirées canadiennes Tome I
Date of first publication: 1861
Editor: Joseph-Charles Taché (1820-1894)
Author: Various
Date first posted: January 9, 2026
Date last updated: January 9, 2026
Faded Page eBook #20260115
This eBook was produced by: John Routh, Cindy Beyer & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
This file was produced from images generously made available by Internet Archive.
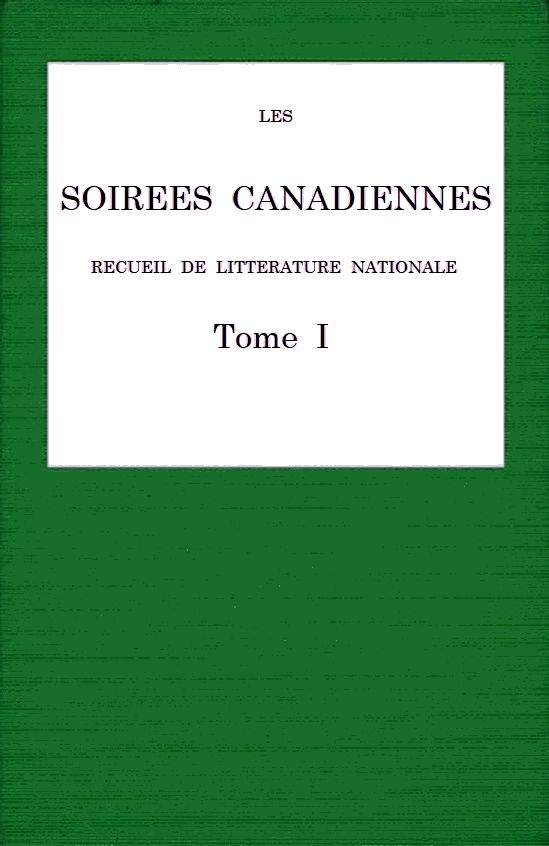
LES
SOIRÉES CANADIENNES,
RECUEIL DE LITTÉRATURE NATIONALE.
———
QUÉBEC.—BROUSSEAU FRÈRES, ÉDITEURS.
———
LES
SOIRÉES CANADIENNES
RECUEIL DE LITTÉRATURE NATIONALE.
“Hâtons-nous de raconter les délicieuses
histoires du peuple avant qu’il les ait
oubliées.”
Charles Nodier.
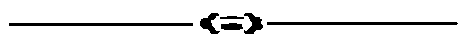
QUÉBEC
BROUSSEAU FRÈRES, ÉDITEURS,
RUE DUADE, HAUTE-VILLE.
——
1861.
LES
SOIRÉES CANADIENNES
RECUEIL DE LITTÉRATURE NATIONALE.
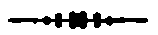
QUÉBEC,
BROUSSEAU & FRÈRES, Éditeurs,
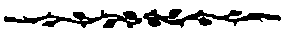
Prospectus des Éditeurs.
——
Sur la proposition d’un certain nombre d’amis des lettres, nous avons entrepris la publication d’un Recueil de littérature nationale.
Ce recueil sera surtout consacré à soustraire nos belles légendes canadiennes à un oubli dont elles sont plus que jamais menacées, à perpétuer ainsi les souvenirs conservés dans la mémoire de nos vieux narrateurs, et à vulgariser la connaissance de certains épisodes peu connus de l’histoire de notre pays. Il contiendra, en outre, des œuvres littéraires d’autres genres, mais dans lesquelles les discussions politiques, sous une forme ou sons une autre, ne devront jamais trouver accès; une dernière partie sera destinée à recueillir les morceaux de littérature les plus remarquables, publiés depuis un certain nombre d’années, et dont le souvenir va se perdant.
Les Soirées Canadiennes seront publiées par livraison mensuelle, d’environ 32 pages in 8, formant ainsi, au bout de l’année, un joli volume de pas moins de 384 pages.
Tout en faisant appel à tous les talents, à toutes les plumes exercées, nous nous sommes, par avance, assurés du patronage d’écrivains connus: le public apprendra sans doute avec bonheur que ce recueil comptera parmi ses contributeurs, à divers titres, les messieurs dont les noms suivent:
MM. E. Parent,
L’Abbé J. B. A. Ferland,
F. X. Garneau,
P. J. O. Chauveau,
J. C. Taché,
L’Abbé C. Trudel,
L. J. C. Fiset,
O. Crémazie,
A. Gérin-Lajoie,
J. Lenoir,
N. Bourassa,
L’Abbé H. R. Casgrain,
F. A. H. LaRue,
L’Abbé C. Legaré,
L. H. Fréchette.
Nous aurions voulu nous procurer beaucoup d’autres noms aussi bien connus; mais on comprendra qu’il nous eût été impossible de consulter tous ceux dont les lettres canadiennes s’honorent:—les circonstances nous ont fourni les noms qui précèdent.
L’abonnement datera du 1er Janvier de chaque année. Les deux premiers numéros de Janvier et de Février, 1861, paraîtront incessamment ensemble. Le prix de l’abonnement sera d’une piastre, payable d’avance.
Comme garantie de la qualité de cette œuvre, nous offrons les noms que nous avons donnés plus haut:—comme garantie d’exécution des conditions matérielles, l’honorabilité de notre maison.
Nous enverrons les numéros des Soirées Canadiennes à toute personne qui nous aura fait tenir la somme d’une piastre, avec son adresse, dans une lettre franche de port.
BROUSSEAU & FRÈRES,
7, Rue Buade.
Québec, 21 Février, 1861.

LES
SOIRÉES CANADIENNES,
RECUEIL DE LITTÉRATURE NATIONALE.
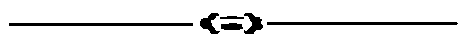
—
A. M. OCTAVE CRÉMAZIE.
—
Fée aux voiles de soies,
Qui, rêveuse, déploies
Ta chevelure d’or,
Et, d’une aile éperdue,
T’élances vers la nue
Pour suivre le Condor!
Divine poésie,
O coupe d’ambroisie,
De nectar et de miel!
Voix pleine de mystère,
N’es-tu pas sur la terre
L’écho des chants du ciel?
N’es-tu pas, sous tes voiles,
O fille des étoiles,
Le cadeau précieux
Qu’une bonté profonde
Daigna donner au monde
En souvenir des cieux?
Quand ta voix solennelle
Résonne, et que ton aile
Vient le toucher au front,
L’homme devient un ange,
Et dans son vol étrange,
Il s’élance plus prompt.
Que l’éclair qui serpente
Et gronde sur la pente
De l’antique Sina;
Tandis que son délire
Prête une âme à la lyre
Que ta main lui donna.
Les accents du poète
Dominent la tempête,
Fille des fiers Autans,
Et son audace achève
Le plus sublime rêve
Des orgueilleux Titans.
Mais, loin des lieux immondes,
Sur les routes des mondes
Que l’Éternel traça,
Quand il franchit l’espace
Jamais sa main n’entasse
Pélion sur Ossa.
Sa course solennelle,
D’un seul coup de son aile,
Le porte aux cieux ravis;
Son luth divin résonne,
Et sa voix d’ange étonne
Les célestes parvis.
Dans des flots de lumière,
Secouant la poussière
De ce monde pervers,
Il plane sur la foule,
Et sous lui se déroule
Un nouvel univers.
Et là-haut son génie
Dérobe l’harmonie
Aux chœurs de Gabriel,
Et, nouveau Prométhée,
Sous la voûte enchantée,
Ravit le feu du ciel.
———
ENVOI.
O poète, j’aimais, aux jours de mon enfance,
Enfant aux blonds cheveux, au cœur plein d’espérance,
A lire tes récits ou navrants ou joyeux;
Quand ton génie épris de notre jeune histoire,
Par ses mâles accents, d’un frais bandeau de gloire
Ceignait le front de nos aïeux!
Avec toi je pleurai sur le champ de bataille
Où le vieux Canadien qu’épargna la mitraille
Mourait enveloppé de son vieux drapeau blanc;
Avec toi je rêvai sous le vert sycomore
Où le farouche Sagamore
Scalpait son ennemi sanglant!
Avec toi j’admirai les bords sacrés du Gange,
Et les riants pays où se cueille l’orange;
Puis, quittant l’ancien monde et ses coupoles d’or,
Je revins avec toi sur nos plages fertiles,
Ecouter ce que dit aux roses des Mille-Iles
Le flot palpitant qui s’endort!
Je te suivis partout, des rives du Bosphore,
Où ta muse suivait le drapeau tricolore,
Jusqu’aux sables brûlants de l’île de Java;
Puis je vis dans ta strophe harmonieuse et fière,
Derrière le trône de Pierre,
Briller le front de Jéhova!
Et je voulus aussi, cédant a mon délire,
Animer sons mes doigts les cordes d’une lyre,
Et, quoique faible encor, ma muse de vingt ans
Peut te dire aujourd’hui de sa voix enfantine,
Comme autrefois Reboul au divin Lamartine:
“Mes chants naquirent de tes chants!”
Louis-Honoré FRÉCHETTE.
OU
L’ÉVANGILE IGNORÉ, L’ÉVANGILE PRÊCHÉ, L’ÉVANGILE ACCEPTÉ.
———
“Hâtons-nous de raconter les délicieuses
histoires du peuple avant qu’il les ait
oubliées.”
CHARLES NODIER.
Tantôt je parcourais les rives de notre Grand Fleuve, conversant avec les pêcheurs sur la grève;
—Tantôt je m’enfonçais dans l’antique forêt, campant le soir avec les chasseurs;
—Tantôt, j’allais m’asseoir au foyer des vieux diseurs, au sein de nos belles paroisses agricoles;
Et je retenais dans ma mémoire ce que ces hommes me racontaient.
De retour au logis je consultais nos vieilles chroniques,—ces discours de voyages, comme parlait Cartier,—ces admirables relations,—ces intéressantes histoires de la Nouvelle France:
Puis je me disais:—Ah! s’il m’était donné de partager avec d’autres les charmes de ces heures délicieuses!...
Voilà pourquoi je me suis mis à conter... Puissiez-vous, ami lecteur, prendre plaisir à mes récits!
———
Les trois légendes qui suivent,—indépendamment de la forme qu’elles revêtent ici,—constituent les trois parties d’un drame moral, dans la manière des trilogies grecques: chacun de ces récits caractérise une de ces grandes situations qui, en se dégageant, font époque dans l’histoire religieuse et sociale des races aborigènes de notre Canada.
—L’histoire de L’Ilet au Massacre, la première par ordre de temps, nous montre, touchant à son paroxysme, l’état de féroce barbarie dans lequel étaient plongés les aborigènes de l’Amérique du Nord, avant l’arrivée des missionnaires.
—Le Sagamo du Kapskouk nous fait assister à cette lutte tempêtueuse qui se fit dans la nature insoumise des Sauvages, lorsque leur fut exposée la doctrine catholique, avec l’alternative de ses promesses magnifiques et de ses menaces terribles.
—Le Géant des Méchins c’est la dernière étreinte de l’erreur aux prises avec la conscience, et le triomphe final de la Religion.
Cet enchaînement si naturel d’idées n’avait point échappé, d’ailleurs, à l’esprit tant juste des narrateurs qui nous ont transmis ces souvenirs.—Voici comme s’exprimait, à cet égard, un vieux Sauvage à qui je parlais de ces choses (je conserve aux paroles de mon interlocuteur cette forme pittoresque qu’on connaît si bien au pays et qu’on aime toujours):
—“Dans c’temps là.... tu vois ben.... les Sauvages pas la R’ligion.... toujours, toujours du sang.... pas la chalité....
—“Quand les patliaches venir.... nos gens surpris.... pas accoutumés.... malaisé pour comprendre.... fâchés quasiment.
—“Aujoud’hui.... Ah! Ah!.... pas la même chose en toute.... nous autes comprend tout.... la R’ligion tu vois ben!”....
C’est pour conformer tout mon travail à cet ordre de pensées que, fidèle en cela du reste avec les coutumes légendaires, j’ai donné à chaque récit un second titre qui en est comme le sens moral:—ces trois légendes s’appelleront donc encore: L’Évangile ignoré, L’Évangile prêché, L’Évangile accepté.
Pour initier le lecteur aux choses qui, à titre essentiel ou de pur intérêt, se lient à ces histoires, il est bon de donner quelques explications trouvant naturellement ici leur place; parce que, rejetées plus loin, ces arguments feraient languir la narration à laquelle je veux conserver toute la rapidité originale.
⁂
Toutes les localités dont il sera question sont situées dans les comtés actuels de Témiscouata et de Rimouski, et dans cette partie de la Province du Nouveau-Brunswick qu’on appelle le Moyen Saint-Jean, à cause de la position qu’elle occupe par rapport à la belle rivière qui porte ce nom, mais que souvent j’appellerai, dans le cours du récit, de son nom sauvage, Aloustouc.
Les lieux auxquels se rattachent spécialement les souvenirs qui font le sujet de ces trois légendes sont:—le Bic et les Ilets Méchins, situés sur le fleuve Saint-Laurent presqu’aux deux extrémités du comté actuel de Rimouski:—le Grand Saut sur la rivière ou fleuve Saint-Jean, à environ quarante lieues au-dessus de la ville de Frédéricton, capitale du Nouveau-Brunswick. Ici encore je remplacerai le nom de Grand Saut, donné à cette chûte, que forment les eaux puissantes du Saint-Jean, se précipitant d’une élévation de soixante-quinze pieds à travers des encaissements de rochers d’un aspect grandiose et terrible, par le mot sauvage de Kapskouk, qui sert aux aborigènes à désigner et la chûte et les gros rapides qui la complètent.
⁂
Les deux tribus sauvages qui jouent le principal rôle dans ces trois traditions, les tribus Micmac et Maléchite, faisaient alors partie de la nation Souriquoise (appartenant à la race Algonquine). Cette nation habitait toute l’étendue de pays naguères appelée l’Acadie, comprise aujourd’hui dans la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, l’extrémité Est du Bas-Canada et une petite partie de l’Etat du Maine. Le peuple Souriquois, dont nos chroniqueurs font tant d’éloges, le premier que connurent Jacques-Cartier et ses intrépides compagnons, a toujours été,—n’oublions pas de le dire,—l’ami fidèle des Français, des Acadiens et des Canadiens; ce qui ajoute pour nous un intérêt de plus à tout ce qui a rapport à cette belle et intelligente race.
Les Micmacs habitaient le littoral de la mer, du Golfe Saint-Laurent et de la Baie de Fundy (autrefois Baie Française).
Les Maléchites occupaient l’intérieur de la partie continentale de l’Acadie. De leur pays, ils se rendaient par les rivières Trois-Pistoles, Ristigouche, Miramichi et Saint-Jean, vers leurs frères des eaux salées, établis sur les bords du Saint-Laurent, dans la Gaspésie, la Baie-des-Chaleurs, les Iles du Golfe et la péninsule actuellement nommée la Nouvelle-Ecosse.
Aujourd’hui les restes de ces deux tribus sont épars dans ces vastes régions, jadis leur domaine. Les deux principaux centres de réunion pour eux sont, maintenant, le village de Ristigouche pour les Micmacs, et la Réserve des Sauvages, en arrière des paroisses de l’Ile Verte et de Kakouna, pour les Maléchites.
Le nom de Micmac, aujourd’hui commun à tous les Sauvages du littoral acadien, ne dut dans l’origine appartenir qu’aux Souriquois habitant la partie Ouest de la Baie des Chaleurs et la rive du Saint-Laurent comprise de nos jours dans le comté de Rimouski.[1] Ce mot parait être la transformation du mot Micouâk, composé de deux racines algonquines: Micoua qui veut dire couchant, crépuscule, et de ak, na ou nâk, terminaison variable équivalant aux mots terre, pays, demeure.
Micouâk ou Micoua-nâk signifierait donc terre du couchant:—appliquée à une peuplade, selon les habitudes de langage des Sauvages, cette locution pourrait se traduire par la phrase suivante: nos frères du couchant. C’est, en toute probabilité, le nom que donnaient, aux Souriquois de l’Ouest Acadien, leurs frères de Miscou, de Miramichi, de l’Ile Saint-Jean (Prince Edouard) et du Cap Breton, qui voyaient coucher le soleil dans la direction du territoire de la Ristigouche et de la Métapédiac.
Je ne sache pas qu’on ait jusqu’ici donné d’explication sur l’origine de ce nom de Micmac; celle que je hazarde ici a paru plausible à des connaisseurs.
Le mot Maléchite me parait être un dérivé du mot Almouchiche, composé du substantif Almouts ou Animouts, chien, et de la particule diminutive chiche ou shish:—pareille appellation, attribuée à une tribu amie, ne peut dire autre chose que: la nation aux petits chiens, qui a des petits chiens.[2]
Mais pourquoi distinguer ainsi une tribu; car toutes les tribus sauvages entretenaient des chiens, presque tous de petite taille? Ah! c’est que ces petits chiens, de race particulière, qu’on retrouve encore, mais en petit nombre, chez les Maléchites et les Micmacs de Ristigouche, possèdent des qualités instinctives qui ne se rencontrent par chez les autres races:—ils chassent le porc-épic avec un succès infaillible et libre d’accidents.
Or dans un pays où abondait le porc-épic, comme au pays dont est question, ce n’était pas un petit mérite que celui qui distinguait ces gentils animaux. Les chasseurs savent quels dangers l’on court de perdre ses chiens, lorsque ceux-ci tombent sur la piste fraîche d’un porc-épic:—c’est au point que les admirables relations des Jésuites font mention de ces dangers.
Pour les almouchiches, point de périls dans cette chasse.—Il fait beau voir ces fines bêtes, au lieu de se ruer sur les piquans sans nombre d’un porc-épic surpris dans sa marche paresseuse et pelotonné pour sa défense, il fait beau les voir tomber en arrêt, le nez à deux pouces de l’animal, japper d’abord pour avertir le chasseur, puis, si le maître tarde à venir, se taire, retenir leur haleine jusqu’à ce que le gibier hérissé, n’entendant plus de bruit, se croyant seul, lève la tête et découvre sa gorge aux poils doux, sous laquelle l’almouchiche plonge le museau, pour tourner sur le dos le porc-épic qu’alors il étrangle.
Il évite ainsi de se bourrer la tête, les yeux, la bouche et le col de piquans, comme font les autres chiens, qui souvent meurent de ces blessures, lesquelles, toujours et pour le moins, causent à ces animaux des abeès affreux.
⁂
Un mot présentement des sources où j’ai puisé la matière de ces légendes, dont la tradition se conserve encore, bien que le souvenir en soit de moins en moins vivace, au sein des tribus dont je viens de parler et parmi les vieux conteurs de la côte.
Il a fallu recueillir, pièce à pièce, les précieux lambeaux de ces histoires intéressantes, pour les reconstituer dans leur ensemble et les arracher à l’oubli qui les menace.
Car, dans quelques années, alors que la famille aura vu se relâcher les liens qui en unissent les membres, alors qu’on ne voyagera plus qu’en bateau à vapeur et en chemin de fer, prosaïquement entouré de ballots de cotons et de boîtes de ferrailles, qui se sentira l’envie de conter et le désir d’entendre conter ces délicieuses choses, dont le cercle du foyer domestique ou le groupement du bivouac sont la mise en train de rigueur?
Oh! Bon et charmant vieux temps qui t’envoles, je te salue! Tant que tu n’auras pas disparu dessous l’horizon, mes yeux humides ne cesseront de te contempler et, après, quand même tous t’oublieraient, pour moi je ne t’oublierai jamais!
⁂
Il n’est peut-être pas, en Canada, un nom légendaire plus connu que celui de L’Ilet au Massacre;—mais combien de ceux qui ont appris ce nom ignorent encore le point précis qu’occupe cet ilot sur la carte de notre pays, et, combien peu connaissent les événements qui ont valu à ce petit rocher une renommée si généralement répandue, une appellation à la fois si saisissante et si terrible!
Le fond de la légende de l’Islet au Massacre repose sur un fait de l’histoire, qui constitue le premier événement important des annales aborigènes dont il soit fait mention dans nos chroniques et le seul, antérieur à la découverte du pays, auquel il soit assigné une date à peu près précise.
C’est au grand pilote de Saint Malo, à l’intrépide marin, à l’intelligent découvreur, à celui qui le premier planta la Croix du Christ et le drapeau blanc de la France sur ce sol de notre Canada, que nous devons la mention de cet événement aujourd’hui passé dans le domaine légendaire.
On lit, en effet, au neuvième chapitre de la SECONDE NAVIGATION de Jacques Cartier, le passage suivant:
—“Et fut par le dit Donnacona montré au dit Capitaine les peaux de cinq tètes d’hommes estendues sur des bois, comme peaux de parchemins; et nous dit que c’étaient des Toudamens de devers le Su qui leur menaient continuellement la guerre. Outre nous fut dit, qu’il y a deux ans passés que les dits Toudamens les vinrent assaillir jusques dedans le dit fleuve à une Isle qui est le travers du Saguenay où ils étaient à passer la nuit, tendans aller à Honguedo leur mener guerre avecque environ deux cents personnes, tant hommes, femmes, qu’enfans, lesquels furent surpris en dormant dedans un fort qu’ils avaient fait, ou mirent les dits Toudamens le feu tout à l’entour et comme ils sortaient les tuèrent tous, réserve cinq qui échappèrent. De laquelle destrouse se plaignaient encore fort, nous montrant qu’ils en auraient vengeance.”
Il y a dans ce passage,—à part les obscurités du style de cette époque,—des confusions et des méprises, qui n’ont point lieu d’étonner quand on songe aux circonstances dans lesquelles se trouvait alors le narrateur. On sait en effet combien il était difficile, en dehors de la nécessité de se servir d’interprêtes—(qui pour Cartier, n’étaient autres que les deux Souriquois Taiguragny et Domagaya)—d’obtenir des renseignements exacts des Sauvages.
Les traditions conservées nous ont depuis donné les corrections de ces méprises et les explications de ces obscurités, dont le lecteur aura l’intelligence à mesure qu’il suivra le développement de ce récit.
Quoiqu’il en soit, le fait principal avec ses accessoires les plus importants reste tel que Cartier le recueillait, il y a plus de trois siècles, de la bouche du Sachem de Stadaconé, à l’endroit même qu’occupe aujourd’hui la ville de Québec.
⁂
Je tiens les détails de la seconde légende, Le Sagamo du Kapskouk, de mon vieil et bon ami Louis Thomas le Maléchite, chef de sa tribu, digne vieillard maintenant dans sa quatre-vingt-treizième année.
Je me rappelle ce jour comme si c’était hier, cependant il y a déjà plusieurs années de cela. Mon vieil ami avait placé pour quelques jours ses ouigouams, car il était avec plusieurs des siens, sur les bords de la Rivière Rimouski.—J’allai le voir.
Quand j’approchai de sa cabane il était debout en plein air: sa grande et belle stature se dessinait dans le ciel bleu, sur le rebord du coteau qu’occupait le campement: sa noble tête était nue à la brise et sa longue chevelure, encore noire, malgré son âge, flottait avec majesté sur ses larges épaules: il portait un ample capot de drap bleu, noué sous la gorge avec ces larges agrafes d’argent tant aimées des Sauvages: ses jambes, encore solides alors, étaient enveloppées de mitasses blanches et noires, tombant avec une grâce sévère sur ses mocassins brodés.
Il portait, affectueusement pendu à son col, un grand chapelet aux grains d’ébène, dont la croix blanche ornait sa poitrine. Heureux prince, qui marche fièrement au milieu de son peuple, honoré des couleurs de la chatelaine du Ciel!
Je m’assis près de lui sur le tertre, en face de cette belle anse de Rimouski, et ce fut là que j’entendis raconter, pour la première fois, la légende du Kapskouk.
⁂
Je descendais un jour le Saint-Laurent, dans une de ces rapides embarcations que les pêcheurs appellent demi-berges. Le soir nous avions fait halte aux Ilets Méchins.
Déjà notre léger esquif était tiré sur le sable, déjà nous faisions les préparatifs du campement, par un soir magnifique du mois d’août, lorsque nous entendîmes des voix, venant d’en bas, chanter le refrain:
Vogue, marinier vogue!
La mer a traversé!
Vogue beau marinier!
C’était deux berges pêcheuses qui remontaient des Cloridomes, et venaient passer la nuit au rendez-vous accoutumé des Ilets. Quelle bonne fortune!
Nous étions là réunis une quinzaine d’hommes, il fallait faire un grand feu!.... Ce ne fut pas long, et bientôt un bûcher digne de brûler la dépouille mortelle d’un Hector ou d’un Ajax était allumé, illuminant au loin la mer, comme on appelle ici le fleuve qui a près de vingt lieues de large.
Quand l’ardeur de ce vaste brâsier se fut un peu appaisée, qu’autour d’un feu moins violent chacun eut pris sa place sur le sable du rivage, un vieux pêcheur, à sa trentième pêche, nous raconta tout ce qui s’était dit avant lui, et probablement tout ce qu’on a pu dire depuis, sur le géant des Méchins, dont déjà j’avais entendu parler.
Depuis, j’en ai conversé avec les Sauvages, et c’est à ce concours de circonstances que je dois de connaître la dernière de ces trois légendes.
⁂
Encore un mot de dissertation, puis nous prendrons la clef des bois, pour suivre, à travers le sombre dédale de la forêt primitive, les partis de guerre iroquois, micmacs et maléchites.
On vient de voir dans le récit de Cartier les mots de Toudamens et d’Honguedo qu’on ne retrouve plus dans les relations et chroniques d’une date un peu plus récente. Les Toudamens n’étaient autres que les Iroquois, ennemis des nombreuses tribus algiques ou algonquines, répandues dans toute l’étendue de la vallée du Saint-Laurent et sur les bords des rivières St. Jean, Pénobscot et Kennébec.
Par le mot Honguedo, Cartier désigne la péninsule gaspésienne, à l’extrême nord de l’ancien pays souriquois ou acadien. Lescarbot précise encore ce renseignement. Le Routier de Jean Alphonse Xanetoigne appelle la baie de Gaspé Oguedoc: c’est évidemment un même mot différemment dit et écrit.
Le langage de toutes nos tribus sauvages a subi et subit encore—dans les mots, mais dans les mots seulement, car la construction grammaticale ne varie point—de profondes modifications; à ce point qu’on compte au moins quinze à vingt dialectes, se rattachant tous à la langue-mère, qu’on croit être (c’est une question) la langue des Algonquins proprement dits.
Dès le temps des commencements de Port Royal d’Acadie, (qui n’a rien à démêler avec Port-Royal des Champs, malgré qu’en ait pu rêver l’imagination fertile d’un romancier moderne) Lescarbot, parlant de quelques mots et phrases sauvages transmis par Cartier, disait des Souriquois, dont il avait appris la langue:—“Aujourd’hui ils ne parlent plus ainsi.”
De ces modifications successives et rapidement produites, sont venues des difficultés d’interprétation et des divergences d’opinion qui forcent à adopter certaines appellations génériques, maintenant consacrées par l’usage, sans tenir compte des périodes de temps et des différences de langage.
Pour la même raison, on se sert des noms de lieux et d’objets qui ont prévalu, et cela sans toujours se préoccuper des concordances chronologiques et ethnologiques. Je suivrai cette méthode. C’est ainsi que j’emploierai les mots Micmac et Maléchite, bien que, dans leur forme actuelle, ils fussent inconnus aux chroniqueurs des époques dont il est question dans ces histoires.
Il suffit, pour le pittoresque du récit, et pour conserver à notre littérature nationale le caractère d’originalité que lui ont imprimé nos premiers écrivains, de ne pas perdre cette couleur locale canadienne si vive et si chatoyante, cette senteur du terroir laurentien, dont la perte ne serait compensée par aucune des plus précieuses qualités du style.
Nous sommes nés, comme peuple, du catholicisme, du dix-septième siècle et de nos luttes avec une nature sauvage et indomptée, nous ne sommes point fils de la révolution et nous n’avons pas besoin des expédients du romantisme moderne pour intéresser des esprits qui croient et des cœurs encore purs. Notre langage national doit donc être comme un écho de la saine littérature française d’autrefois, repercuté par nos montagnes, aux bords de nos lacs et de nos rivières, dans les mystérieuses profondeurs de nos grands bois.
[1] Champlain, parlant des Sauvages de la Baie-des-Chaleurs, dit qu’ils se rendaient par le moyen de rivières et d’un portage à un endroit nommé Mantane. C’est encore ce que font quelquefois les Micmacs. En remontant la Ristigouche au départ, puis la Métapédiac et le grand lac du même nom, on s’engage dans une rivière appelée la Petite Matane d’où, par le moyen d’un portage, on tombe dans la grande rivière Matane, dans le comté de Rimouski.
[2] Je crois devoir faire remarquer que, dans cette question d’étymologie, je n’entends nullement m’occuper de cette autre question historique, si obscure, qui a trait à la tribu que certaines chroniques ont désignée par le nom d’Almouchiquois, mot auquel M. l’abbé Moreau, missionnaire des Abénaquis, donne exactement la même signification que je donne au mot Maléchite:
M. l’abbé Laflèche, ancien missionnaire du diocèse de Saint Boniface, dans un fort intéressant article publié dans le No du 27 Mai 1857 du Courrier du Canada, rattache l’origine du mot Maléchite à deux mots du dialecte Cris: Mayi, qui veut dire difforme et Shit pied.—Il m’est impossible de croire que mes amis les Maléchites, si parfaits de formes, si magnifiquement développés, des plus beaux parmi les plus beaux Sauvages, aient jamais pu recevoir le nom de Pieds difformes; eux qui pourraient, surtout pour les mains et pour les pieds, servir de modèles aux artistes.
OU
L’ÉVANGILE IGNORÉ.
———
C’était un an avant le premier voyage qui fit connaître à la France l’existence du fleuve Saint-Laurent. Les choses se passaient dans cette contrée giboyeuse et poissonneuse qui s’étend du Témiscouata au Métis, et depuis les hauteurs des terres jusqu’à la rive du Grand Fleuve.
Ce territoire faisait partie du pays des Micmacs, et les cent cinquante lieues de terrain comprises dans l’espace indiqué étaient échues en partage, comme endroit de pêche et de chasse, à une cinquantaine de familles de la tribu propriétaire.
Ces familles vivaient dans l’abondance de tout ce que les Sauvages d’alors concevaient de meilleur pour l’homme.
Partout de l’orignal, du caribou, du castor, de l’ours, du loup-cervier, du vison, de la marte, de la loutre, du porc-épic.
Les bois fourmillaient de lièvres et de perdrix.
L’anguille, la truite, le touladi faisaient grouiller les lacs et les rivières.
Puis, dans la belle saison, les eaux salées du Saint-Laurent fournissaient l’éperlan, le capelan, le hareng, la morue, le saumon, et donnaient encore le loup-marin et la pourcie.
Enfin, comme le disaient, quelques années plus tard, dans le style naïf du temps, les Relations:—“Jamais Salomon n’eut son hostel mieux ordonné et policé en vivandiers”....
Le bouleau, dont l’écorce est la seule propre à la construction des canots et à la fabrication de certains ustensiles, le sapin, cet edredon des chasseurs, et l’érable, à la sève sans pareille, abondaient dans toutes les parties de la forêt.
L’intelligente et vigoureuse race des Micmacs était bien capable de comprendre ces avantages et d’en profiter, pour mener vie insouciante et commode, au sein de cette nature grande et généreuse.
⁂
Déjà, depuis quelque temps, la chasse d’hiver était finie et déjà le poisson de mer avait fait son apparition. Les cinquante familles, dont nous avons parlé, avaient abandonné les sentiers plaqués des bois, emportant les peaux des animaux tués, la graisse et la viande boucannée d’orignal.
Selon l’usage, toutes s’étaient dirigées vers la Baie du Bic, pour y vivre quelques jours en commun de la vie de bourgade, avant de se disperser sur le littoral, le long duquel chaque petit groupe avait son poste désigné pour la durée de la belle saison.
Cette belle saison était décidément arrivée.... Les trembles, les ormes, les érables et autres arbres à feuilles caduques commençaient à mêler la couleur glauque de leur feuillage miroitant, à la couleur plus sombre des sapins toujours verts.
La Baie du Bic, sous l’influence du soleil et des grandes marées du printemps, s’était débarrassée de la glace qui, pendant l’hiver, avait enchaîné ses eaux et couvert son sein. Dans ce moment elle apparaissait toute belle, aux yeux contemplatifs des Sauvages, dans sa toilette printannière.
Aussi bien, est-ce un endroit d’un pittoresque ravissant que le Bic!—Un Bassin assez vaste pour être majestueux; assez petit pour pouvoir être embrassé d’un coup-d’œil:—une plage coupée de dentelures profondes, accidentée de platins, de caps et de falaises: un arrière-plan de montagnes taillé profusément, comme tous les paysages de notre Canada, dans l’étoffe du globe.
Deux belles rivières, descendant en cascades et en rapides des gorges voisines, viennent verser leurs eaux aux deux extrémités de la baie.
Puis, du côté du large, une entrée rétrécie, bornée par deux caps élevés, rendue plus étroite encore par la présence de deux îlets escarpés et sauvages, se dessinant sur les grandes eaux du fleuve Saint-Laurent:—pour horizon, partie de l’île du Bic, à près de deux lieues au large, et la côte nord du fleuve, distante de neuf lieues.
C’était en face de cette nappe d’eau, sur un des plateaux qui bordent le rivage, au milieu d’un bois de sapins et de merisiers, qu’étaient fixés, comme jetées à l’aventure, les cabanes en forme de pyramides arrondies des Micmacs.
De petits chemins circulaient au sein de la bourgade, et des sentiers, bordés de collets à lièvres, s’enfonçaient de distance en distance dans le bois.
On ne se pressait point à la bourgade du Bic! On partageait les heures, entre la délicieuse nonchalance méditative des Sauvages et le travail du passage des peaux, de la confection des ustensiles et des articles de toilette.
On allait, cependant, avoir bientôt besoin de canots; et la sève, forçant dans les veines des arbres, avait déjà rendu le bouleau facile à pleumer, depuis quelque temps.
Les jeunes hommes reprirent donc le chemin des grands bois, pour aller enlever aux énormes arbres les écorces propres à la confection de ces jolies barques sauvages si coquettes, véritables chefs-d’œuvre d’élégance et d’utilité.
⁂
On était au Bic depuis près d’un mois:—c’était par une matinée magnifique;—le calme était partout dans l’air;—un soleil de la fin de Mai réchauffait la nature, faisait scintiller les eaux et gazouiller les oiseaux dans la feuillée.
Au campement micmac on jouissait comme la nature, les eaux et les oiseaux.—Aux portes des cabanes, les hommes s’occupaient nonchalamment à préparer le bois de cèdre des canots; les enfants jouaient, en se roulant sans bruit sur le tapis des bois; les femmes et les jeunes filles, paresseusement assises au milieu des peaux soyeuses, confectionnaient des mocassins, des mitasses, des manteaux, ou brodaient des matachias[3]: les jeunes mères, ayant suspendu les nâganes[4] de leurs nourrissons à des branches d’arbres, détachaient de temps à autre l’œil et la main des racines qu’elles préparaient pour coudre les écorces, afin de donner un regard d’amour à leur progéniture et une impulsion de balancement à la nâgane.
Il n’y a rien de charmant comme cette vie de lézard au soleil: rien de gracieux comme les poses naturelles que prennent les torses et les membres flexibles de ces enfants de la nature.
C’est chez les races primitives, ou chez les peuples qui ont conservé quelque chose de leur simplicité première, que les artistes vont chercher le mystérieux secret de ces lignes et de ces contours qui distinguent le dessin des maîtres.
[3] Les matachias sont des ceintures et colliers, ornements des Sauvagesses.
[4] Les nâganes sont de jolies planchettes munies de lacets, de cerceaux et d’une courroie de porteur, sur lesquelles on emmaillotte les enfants à la mamelle: espèces de bottes élégantes qui sont les berceaux des petits Sauvages.
———
On se laissait vivre ainsi, demi-rêvant à part soi, demi-jasant de ce ton lent et tranquille qui caractérise la causerie de famille chez les Sauvages, lorsque deux des jeunes hommes du parti des écorces, arrivant de la forêt, jetèrent, au milieu de ce calme et de ce bonheur, la fatale nouvelle que, la veille au soir, un parti ennemi n’était qu’à une journée de marche de la bourgade!....
Les guerriers, se redressant dans leur force et leur dignité sauvages et maîtrisant leur émotion, se contentèrent de répondre avec dédain:—Almouts!.... Les chiens!
La troupe des faibles poussa un cri de terreur!
Les femmes et les jeunes filles, entourées des enfants qui se pressaient sur elles, les jeunes mères, serrant sur leur sein les petits des nâganes, se précipitèrent, en pleurant, dans les cabanes, comme pour y chercher un refuge.
Pendant que ces frêles demeures, un instant auparavant si calmes, retentissaient des sanglots de ces malheureux, les guerriers, auxquels incombait la tâche de les défendre, ayant à leur tête les anciens, se consultaient sur ce qu’il y avait à faire en une telle conjoncture.
Le parti ennemi avait semblé nombreux; il suivait un grand chemin de plaques conduisant directement au village; c’était une route commune et constamment fréquentée. Selon les calculs des courriers il devait atteindre, le soir même et de bonne heure, la Baie du Bic.
Les gens des écorces étaient restés dans les bois, pour surveiller les envahisseurs et donner avis de leur approche quelques heures à l’avance.
Que faire?—Huit heures à peine séparaient le moment actuel de celui où le cri de combat devait retentir!
L’ennemi venait à travers bois:—un expédient eût donc été certain; c’eût été de descendre le fleuve en canot, et d’aller rejoindre les frères de Matane; mais pour exécuter ce plan, il eût fallu une embarcation pour chaque famille, et toute la bourgade ne possédait, en ce moment, que cinq vieux canots, réparés pour l’usage journalier d’une situation comme celle dans laquelle se trouvaient les Micmacs une heure auparavant. La fuite par terre, avec les vieillards, les femmes et les enfants, en présence d’un parti de guerre, était impossible.
La première chose que l’on fit, sans perdre de temps, fut d’équiper les cinq canots et d’expédier, avec des provisions abondantes, vers le bas du fleuve, sous la conduite de quelques vieillards, les femmes enceintes, les petits enfants à la mamelle et leurs mères: en tout à peu près trente personnes, les plus faibles et les plus dignes de pitié, qu’on soustrayait ainsi aux angoisses du moment et aux dangers de l’avenir.
Cela fait, il ne restait plus qu’à prendre la résolution de vaincre, ou de mourir en vendant chèrement sa vie. Telle fut aussi la détermination prise, à la suite de laquelle on se mit à imaginer les préparatifs d’une résistance désespérée.
Pendant que ceci se passait au sein de la malheureuse population, l’ennemi s’avançait, avec précaution, mais avec rapidité, à travers une route bien frayée, traversant un pays accidenté, mais de facile accès, ne présentant sur le trajet suivi ni lac, ni rivière considérable capables de causer de graves embarras.
Le plus difficile du chemin se rencontrait dans le voisinage immédiat de la Baie; mais là, des sentiers, circulant dans les coulées des montagnes et convergeant vers la bourgade, sentiers que suivaient tous les jours les Micmacs allant au bois quérir ce qui leur était nécessaire, offraient à l’ennemi, non seulement un facile moyen d’arriver, mais encore des avantages incalculables pour les combinaisons d’une attaque comme celle qu’il méditait.
———
Les Micmacs, restés dans le bois pour observer, avaient pu, faisant usage de leur intime connaissance des lieux et profitant de la confiance des ennemis, qui ne soupçonnaient aucunement la présence de batteurs d’estrade autour d’eux, se rendre un compte parfait de tout ce qu’il importait de savoir.
Dans la nuit du départ des deux courriers envoyés à la bourgade du Bic, les éclaireurs avaient facilement découvert que le parti qu’on avait sur les bras était un parti d’Iroquois, composé d’environ cent guerriers d’élite, ayant livré leur âme au carnage et à la dévastation.
Ces guerriers formaient, en toute probabilité, un groupe détaché d’une de ces grandes expéditions qu’à cette époque, et longtemps après encore, les nations Iroquoises envoyaient dans toute la vallée du Saint-Laurent.
Bien rarement les Iroquois prenaient une autre route que celle du fleuve, quand ils venaient porter leurs armes jusqu’en ces endroits, pour la raison qu’ils ne connaissaient pas l’intérieur de la vaste étendue de pays qu’il leur aurait été nécessaire de parcourir et que, de plus, il eût fallu traverser le territoire des Abénaquis, tribu vaillante et aguerrie de la nation algonquine, qui ne laissait pas sur ses terres un facile passage aux ennemis de sa race.
Mais très souvent les Iroquois, après avoir côtoyé les rives du Saint-Laurent, s’engageaient dans le cours des grandes rivières, afin d’aller giboyer, quand les provisions manquaient, ou attaquer les petites bourgades de l’intérieur, et même les familles distribuées par groupes au sein des pays de chasse.
Les Micmacs comprirent que les ennemis qu’ils avaient devant eux avaient dû prendre le haut pays par la grande rivière qu’on appelle aujourd’hui des Trois-Pistoles, puis s’engager dans cette autre rivière tributaire de la première et qui a nom Bouabouscache, jusqu’à ce que, voyant se multiplier les portages et trouvant sur les bords de la Bouabouscache le chemin plaqué[5] et récemment fréquenté des Micmacs, ils eussent laissé leurs canots, pour se mettre sur les pistes des familles dont le voisinage était, de cette sorte, clairement démontré.
Pour qui connaît l’intelligente faculté d’observation et l’acuité d’intuition des sauvages, il y a dans tout cela quelque chose de si naturel qu’on ne concevrait pas que les coureurs n’eussent pas de suite tout deviné.
Ces reconnaissances faites, les Micmacs se divisèrent en deux petites bandes.—L’une devait suivre les Iroquois sans se laisser découvrir, afin de prendre les devants à temps pour donner quelques heures d’avertissement, aux habitants des cabanes, de l’arrivée des ennemis, et se joindre aux autres guerriers, chargés de la défense du village.—L’autre bande, composée de cinq hommes choisis parmi les plus intelligents et les plus vigoureux, devait tourner l’ennemi, observer ses brisées, prendre, si possible, préalable indemnité de vengeance, et assurer les moyens de rendre cette vengeance complète.
Suivons un peu ces derniers dans leur mission, aussi délicate et difficile que dangereuse.
⁂
Après une demi-journée de marche forcée dans le chemin parcouru par les ennemis, les cinq Micmacs arrivèrent sur le bord de la rivière Bouabouscache, dans un endroit où les pistes des Iroquois s’arrêtaient tout-à-coup.
Les sauvages s’attendaient à cela; aussi ne furent-ils nullement surpris.—Puis, ils connaissaient si bien cette forêt de leur pays qu’il n’était presque pas possible, pour homme ou bête, d’en remuer une branche sans qu’ils s’en aperçussent.
A la suite d’un examen minutieux des bords de la rivière, ils avaient découvert les traces défigurées d’une descente sur la rive sud de la Bouabouscache, d’où les Iroquois, marchant dans l’eau, avaient atteint un gué de rocailles conduisant au chemin pris par eux pour aller au Bic.
D’autres pistes, rendues méconnaissables pour tous autres que des sauvages, menèrent les Micmacs à un amas de branchages, masqué par des arrachis, au pied d’un petit rocher, sous lequel ils trouvèrent entassés vingt canots iroquois, bien différents par la forme des embarcations de la contrée.
Ces canots étaient là, avec les perches et les avirons; mais il n’y avait rien autre chose.—Cependant, il était impossible que les Iroquois eussent emporté au Bic avec eux tout le bagage et surtout les provisions nécessaires à une expédition lointaine en pays inconnu.—On les avait observés, du reste, et ils n’étaient point surchargés.
C’est la coutume des sauvages, quand ils sont obligés de laisser dans les bois les objets qui leur sont d’une utilité première, de ne pas tout mettre dans le même endroit:—c’est ce qu’on appelle faire plusieurs caches ou cachettes.
Les Micmacs continuèrent donc leurs recherches et finirent par découvrir le lieu d’une autre descente, sur la rive nord de la Bouabouscache, à une assez grande distance de l’endroit occupé par les canots, et par trouver la cache des provisions et bagages des Iroquois.
On a tout vu!
Le conseil maintenant!
Puis de suite l’action!
Les sauvages,—comme tous les hommes contemplatifs,—possèdent cette faculté précieuse de concentration, nécessaire à l’unité de but et à la fermeté d’exécution, qu’on appelle le caractère. Cette qualité se développe chez l’homme qui se recueille, et voilà pourquoi nos sociétés modernes, les moins recueillies, les plus avides de bruit et de frivolités, les plus répandues au dehors, sont aussi, de toute l’histoire, les plus pauvres en grands caractères.
Mettant à profit, dans ce moment, cette qualité si développée chez le sauvage, nos Micmacs firent taire toutes les inquiétudes qu’ils ressentaient pour tant d’êtres si chers laissés derrière eux, et devisèrent des moyens à prendre, tout comme s’il n’y avait eu au Bic rien autre chose qu’un parti d’ennemis exécrés à détruire.
⁂
A deux journées de canot se trouvait une bourgade amie de la tribu maléchite.
La Bouabouscache se décharge, connue on l’a vu, dans la Rivière Trois-Pistoles:—en remontant cette dernière rivière, on arrive à un petit lac, d’où, par un portage de quelques centaines de pas, on tombe dans la chaîne des lacs Acheberache d’un aspect si curieux. De ces lacs, au moyen de la rivière du même nom, on descend dans le grand lac Témiscouata, qui décharge ses eaux dans l’Aloustouc par la belle rivière Madaouaska.
A part la navigation, peu longue mais portageuse, de l’Acheberache, la route indiquée se parcourt en canot avec la plus grande aisance: à peine quelques courts et faciles portages viennent-ils interrompre l’action de la perche et de l’aviron: plus de la moitié du trajet se fait à travers les eaux dormantes des lacs. C’est la communication naturelle entre les deux vallées du Saint-Laurent et de l’Aloustouc.
C’était à l’embouchure de la Madaouaska, à l’endroit aujourd’hui nommé le Petit Saut, qu’était situé en ce moment le village maléchite dont on vient de dire un mot.
On sait que les Maléchites sont frères des Micmacs, dont ils diffèrent cependant par le dialecte, et un peu par les usages. Ils ont aussi une manière particulière de confectionner les articles à leur usage:—encore aujourd’hui, on reconnaît de loin les canots maléchites, par la forme qui les distingue des canots des autres tribus.
Les Maléchites, comme tous les Algonquins, avaient une haine profonde pour les Iroquois; cette haine, richement payée de retour, aurait amené de bien plus fréquentes rencontres entre ces sauvages, si les Iroquois, si nombreux, avaient mieux connu le pays des Maléchites.
Les cinq Micmacs, en prenant la résolution d’aller demander du secours aux guerriers de la Madaouaska, étaient donc certains de leur fait.
Sans perdre un instant, deux d’entre eux partirent sur un des canots iroquois, pour aller convier leurs frères à une chasse aux ennemis.
Les trois autres restaient sur les bords de la Bouabouscache pour accomplir la triple mission—de détruire les canots et les provisions des Iroquois,—de préparer des embuscades et des sentiers de retraite,—d’effacer les traces de leur passage et de leur présence en ces lieux, et de surveiller le retour de l’ennemi, afin de prévenir toute surprise.
[5] On sait que le mot plaque signifie, dans le langage des forêts, une marque particulière faite sur les arbres et servant d’indication: un chemin plaqué est un sentier marqué de plaques.
———
Retournons présentement au Bic.
Les Iroquois arrivèrent dans le voisinage immédiat de la Bourgade, le jour même dont on vient de lire en partie l’histoire, un peu avant le coucher du soleil.
Ils ne se croyaient pas découverts et s’attendaient, d’après tous les signes observés par eux, à surprendre les Micmacs dans l’abandon de la sécurité la plus parfaite.
C’était l’heure où, sur les bords de la mer, les goëlands redoublent leurs cris, comme pour saluer d’avance la fin du jour; l’heure où les corneilles se réunissent au haut des airs et prennent, dans une ronde bruyante et fantasque, leurs derniers ébats, avant de s’aller brancher pour la nuit!
Arrivés à une courte distance du rivage de la Baie, les Iroquois avaient examiné les petits chemins convergeant vers le village; puis ils avaient partagé leur troupe en plusieurs bandes.
Altérés de sang, marchant à pas de loup, retenant leur haleine, le corps penché en avant, plongeant leurs regards de chats-sauvages à travers les interstices de la forêt, l’oreille tendue à tous les bruits, le casse-tête à la main..... ils s’avançaient, dans les divers sentiers qui conduisaient aux cabanes, resserrant à chaque instant le cercle formé par leur ordre d’attaque.
Ils arrivent!
Mais, à leur rage, ils ne trouvent plus que les vestiges d’un campement, qu’on aurait cru délaissé déjà depuis plusieurs jours.
Mettant à profit ce qui reste de la lumière du jour, ils cherchent la lisière du bois, les rivages de la Baie!
—Rien!
Ils écoutent!....
—Nul autre bruit que celui de la lame d’une mer calme qui caresse le rivage;—que ces murmures, concert du soir d’un beau jour, dans les bois au bord des eaux!
Réunis sur la plage, après des recherches qui leur font croire à une méprise complète, ils jettent un regard distrait, mais frappé néanmoins, sur la belle nappe d’eau qui emplit le bassin du Bic, et qu’éclairent en ce moment les derniers reflets du crépuscule.
Ils hument, dans leurs poitrines fatiguées et haletantes, cet air vivifiant des bords de la mer chargé des émanations du salange et des varechs.
Puis, rentrant dans le bois, ils vont s’emparer de la clairière qu’occupaient le matin les cabanes de Micmacs, pour préparer la sagamité du soir, et se livrer aux réflexions inspirées par leur mésaventure, avant de prendre leur repos de la nuit.
⁂
Cette nuit fut calme!
Les sentinelles, que les Iroquois avaient toujours le soin d’entretenir au guet, n’entendirent rien,.... que les cris lugubres du hibou attiré par l’odeur de la fumée du campement:—elles ne virent rien,...... que l’aurore boréale, si belle en ces endroits, quand elle fait jouer ses marionnettes dans l’azur du ciel.
Elle parut longue, cette belle nuit, aux gens qu’elle voyait réunis autour de la baie du Bic, et le sommeil de ceux-ci ne se ressentit guère de la douce paix répandue dans la nature.
Enfin l’aurore parut, promettant un jour pur et serein; mais elle fut saluée par un hurlement horrible, parti du côté du large, auquel répondirent des hurlements semblables répétés par les échos des montagnes d’alentour.
C’était le cri de guerre des Iroquois!
Un de leurs chefs avait, au point du jour, laissé sa couche, rendue brûlante par l’agitation de son esprit, pour aller respirer le frais sur le rivage de la Baie.
Il avait trouvé le bassin à sec:—la mer était basse!—La basse marée, dans un endroit comme celui-ci, est un phénomène qui toujours surprend ceux qui vivent loin des bords de la mer.
Le sauvage, en s’avançant sur la batture que la veille au soir il avait vue couverte d’eau, crut découvrir aux premiers rayons de la clarté matinale, des empreintes que le flot n’avait point tout à fait effacées.
Il put même suivre une espèce de battue se dirigeant vers le large.—Il eut un soupçon!
Se couchant à plat ventre sur les galets, il darda son regard perçant dans la direction des traces imprimées sur le sable et la vase.
Grâce si la froidure du matin, il vit comme une vapeur qui s’élevait de l’extrémité escarpée d’un des îlets du large qu’on pouvait atteindre en ce moment à pied sec.
Plus de doute!.... Ces pistes, c’étaient celles des gens de la bourgade abandonnée!.... Cette vapeur, c’était l’effet de la respiration d’un grand nombre d’êtres animés réunis dans un étroit espace!
Les Micmacs étaient là!—Il était clair dès lors qu’ils n’avaient point de canots!—Donc il était impossible pour eux d’échapper!
C’est alors que l’Iroquois avait poussé ce hurlement qu’avaient répété les autres Iroquois, en saisissant leurs armes.
Aucun cri ne répondit de l’Ilet que le chef, un instant plus tard, indiquait à ses gens accourus en armes autour de lui.
Mais qui eût alors plongé ses regards dans la caverne, que l’on voit encore dans le flanc escarpé du rocher, aurait été témoin d’un spectacle déchirant.
Dans un étroit espace, bordé de gros blocs détachés et s’enfonçant dans le roc, des femmes et des enfants, pressés les uns contre les autres, étouffaient des sanglots que comprimaient sur leurs lèvres le regard et le geste d’hommes de guerre prêts au combat.
⁂
Les Iroquois employèrent quelque temps à se préparer, et dans l’intervalle la marée, cette porteuse d’eau qui ne s’arrête jamais, s’était mise à monter.
C’était une circonstance dont les guerriers micmacs comptaient bien profiter; parce qu’elle diminuait pour leurs ennemis les avantages d’un nombre beaucoup plus que double.
Quand les Iroquois, en ordre de bataille, prirent le chemin de l’Ilet, assez éloigné de terre ferme, tous les Micmacs en état de porter les armes, les guerriers en tête, sortirent des rochers et, poussant le cri de leur nation, vinrent se placer sur la petite batture qui forme l’atterrage de l’Ilet, appuyés des deux côtés sur la marée montante.
Les Iroquois, bien que certains de la victoire, sentaient néanmoins que des hommes braves, ayant derrière eux leurs femmes et leurs enfants, n’étaient point un ennemi dont on put se promettre d’avoir bon marché.
Aussi marchaient-ils en bon ordre et lentement, et mirent-ils un temps assez long à parcourir la distance de plusieurs centaines de pas qui les séparait de leurs adversaires.
Les deux partis sont maintenant à portée d’arc:—les flèches se croisent dans l’espace qui les sépare:—le sang commence à couler:—des combattants tombent gravement blessés:—d’autres s’arrêtent pour arracher, de leurs membres nus, les pointes acérées qui en mordent les chairs!
L’avantage est aux Micmacs qui attendent, de pied ferme et dans la meilleure position possible pour mesurer leurs coups, un ennemi qui marche sur un sol inégal et mouvant.
Le flot, qui monte toujours, empêche d’ailleurs les Iroquois de se déployer:—alors, jetant leurs arcs aux hommes des derniers rangs, ils saisissent leurs tomahàks et s’élancent en hurlant sur leurs ennemis.
Ceux-ci leur font beaucoup de mal par une dernière volée de flèches tirées de près, puis les reçoivent, en poussant leur cri de guerre, le casse-tête au poing.
Ce fut un choc terrible.... On eût entendu le bruit des tomahàks se heurtant, brisant les crânes et fracturant les os.... On eût vu les affreuses blessures produites par les horribles armes de ces sauvages, dans cette lutte, la millième répétition de celles qui, tous les ans, à cette époque et longtemps encore après, ensanglantaient le sol de notre pays.
Les Iroquois ne purent pas entamer la phalange des Micmacs, qui se battaient avec un courage et un sang-froid admirables.
Alors les premiers, sentant l’impossibilité d’une prompte victoire et voyant la marée prête à boucler derrière eux, se retirèrent en bon ordre; mais poursuivis par les flèches et les moqueries de ceux qu’ils venaient attaquer de si loin.
Il y avait, de chaque côté, quelques morts et beaucoup de blessés: les deux partis étaient du reste presqu’épuisés de fatigue; car ces luttes, corps à corps, avec des armes dont l’effet dépendait de l’impulsion donnée à force de muscles, étaient bien autrement fatigantes que les exercices de nos combats d’aujourd’hui.
Chacun emporta ses blessés.... Les cadavres restèrent sur le fond, pour rouler et disparaître sous l’eau montante et reparaître, livides et maculés, à la prochaine marée basse!
⁂
Les Iroquois, confus, mais comptant sur leurs forces, n’avaient qu’à se reposer et se refaire: il n’en était point ainsi des Micmacs.
Les pertes de ceux-ci, bien que moins nombreuses, étaient, cependant, relativement plus considérables et avaient, naturellement, porté sur les meilleurs hommes de leur troupe composée de toutes gens.
Les Micmacs comprenaient que les Iroquois se garderaient bien de commettre, une seconde fois, la faute d’attaquer à la marée montante. Ils ne se sentaient plus de force à rencontrer leur implacable ennemi à poitrine découverte.
Après un court conseil tenu par les guerriers, on ordonna aux femmes d’élever, en avant de la caverne, une espèce de retranchement.
L’endroit était assez propice à l’érection de travaux de ce genre.—En face et en côté de la grotte étaient rangés, comme circonscrivant une étroite enceinte, de gros blocs de rochers qu’on dirait autant de menhirs druidiques.
Il s’agissait de barricader les espaces laissés entre ces blocs de pierre et de rehausser le tout, à la manière adoptée par les sauvages pour ces sortes de fortifications.
Les perches de ouigouams, certains ustensiles et le bois qu’on put se procurer, en dépouillant les flancs de l’Ilet des petits sapins qui s’élevaient ça et là des crevasses des rochers, servirent à construire une double palissade, dans l’interstice de laquelle on empila des cailloux, du sable, des peaux, et jusqu’aux bagages et provisions des familles.
Les heures de répit, données par le fluxet le reflux de la mer, furent si bien mises à profit, que la nouvelle marée basse trouva les Micmacs entourés d’un rempart qui leur permettait d’employer à la défense les blessés, les femmes et même les enfants d’un certain âge,.... qui derrière la palissade,.... qui sur les escarpements des rochers,.... les plus forts défendant les abords du côté de l’eau.
Les Iroquois, ayant vu de loin exécuter ces préparatifs, et ne connaissant pas les lieux, ne s’imaginaient pas qu’ils pussent être aussi effectifs qu’ils l’étaient en effet.
⁂
Profitant de la première occasion offerte par le jusant, ils reprirent sur la batture le chemin de l’Ilet.
L’attaque fut plus savante et plus longue; mais on se battait contre des adversaires retranchés, et, cette fois encore, elle demeura infructueuse.
Il y eut inévitablement des tués et des blessés de chaque côté. Comme la première fois, les pertes des Micmacs, plus faibles numériquement, les laissèrent dans une position de plus en plus désespérée.
Les Iroquois avaient trop compté sur leur supériorité, et n’avaient point eu recours à tous les moyens qui auraient pu les rendre promptement victorieux. A cause de la nature des lieux, on ne pouvait combattre qu’à la marée: car l’Ilet escarpé baigne ses pieds dans l’eau dont il reste environné toujours et partout, à l’exception d’un espace assez limité qui assèche en dos d’âne à mer basse, et fait suite alors à la batture de la Baie.
Le jour allait finir:—il ne pouvait être question d’une attaque de nuit,—et la crainte des assaillants était, maintenant, que les Micmacs, qu’ils savaient hors d’état de résister, ne voulussent tenter de s’échapper de l’Ilet, à la faveur des ténèbres, pour se répandre dans les montagnes voisines de la Baie, afin de courir, chacun pour soi, les chances d’échapper aux dangers auxquels ils étaient tous certains de succomber, en restant ensemble.
Dans cette préoccupation, les Iroquois passèrent une partie de la nuit à suivre la marée sur la batture. En voyant, à pareille heure et dans pareil lieu, leurs silhouettes étranges aller et venir, courir et s’arrêter, on eût cru assister au sabbat et voir une de ces réunions infernales des sorciers et de leurs compères des vieilles légendes d’Europe.
⁂
Le jour parut, et avec le jour un nouveau jusant, dont se hâtèrent de profiter les Iroquois.
Leur troupe, arrivée à la distance d’un peu plus qu’un trait de flèche du rempart micmac, s’arrêta. Alors les malheureux habitants de la caverne, désormais défendue par des vieillards, des femmes, des enfants et quelques guerriers blessés, virent un certain nombre d’Iroquois allumer d’énormes flambeaux d’écorce, puis, toute la bande s’avancer vers les retranchements, à la course et dans un ordre particulier.
Les portes-flambeau étaient accompagnés chacun de deux guerriers, tenant au-devant d’eux des claies en guise de boucliers: ils étaient soutenus par le reste de leurs frères qui, armés d’arcs, balayaient le rempart.
Bientôt après, la faible palissade était en feu!.... Les Iroquois, retirés à une centaine de pas, le tomahàk levé, poussant des ricanements de démons, attendaient que leurs victimes sortissent du milieu des flammes pour les immoler.
La chose ne se fit pas longtemps attendre; tous ceux d’entre les Micmacs, hommes et femmes, que la faiblesse, la terreur ou des blessures graves ne condamnaient point à être suffoqués, s’élancèrent avec l’énergie du désespoir contre les Iroquois: ceux-ci n’eurent point de peine à vaincre, mais là encore, ils perdirent quelques-uns des leurs et eurent plusieurs blessés.
Tous les Micmacs, sans distinction d’âge et de sexe, périrent, étouffés dans la caverne ou massacrés par les Iroquois. Leurs cadavres, mutilés et privés de chevelures, restèrent là pour être la pâture des renards et des corbeaux, sur l’étroite rive et dans le creux de ce rocher qui reçut de cet événement le nom d’Ilet au Massacre, qu’il conserve encore aujourd’hui.
———
Au fond, les Iroquois n’étaient qu’à demi satisfaits du résultat de cette expédition.
Ils avaient cru surprendre une bourgade sans défense, comme cela leur arrivait si souvent, et ils avaient rencontré une résistance obstinée.
Leurs pertes, du reste, étaient considérables: vingt des leurs étaient morts ou mourants: ils comptaient de plus une trentaine de blessés, dont plusieurs grièvement.
Soixante hommes seulement restaient parfaitement valides, sur cent guerriers qu’ils étaient à leur arrivée, et on était loin, bien loin du pays natal.
On employa le reste de ce jour et la journée suivante à se reposer, tout en faisant les préparatifs du retour.
Trois jours s’étaient écoulés depuis l’arrivée des Iroquois au Bic; le matin du quatrième, ils reprirent le chemin de la Bouabouscache, comptant bien terminer là leur expédition et revoir bientôt les bois, les rivières et les lacs du pays d’Agné.
La forêt était tranquille; nulle trace d’ennemis ne se laissait voir, et les Iroquois se croyaient bien assurés d’avoir détruit toute la population de cette partie du territoire micmac. A mesure qu’ils avançaient, leur assurance redoublait, comme il arrive toujours, surtout aux sauvages, si peu prévoyants dans la pratique habituelle de la vie.
Dans la matinée du jour où l’on devait atteindre les bords de la Bouabouscache, les Iroquois se partagèrent en deux troupes, afin de hâter les procédés du voyage.
Trente hommes, les plus dispos et les plus vigoureux, prirent les devants pour aller quérir les canots et préparer le campement du soir; les cinquante autres, blessés et porteurs, restèrent en arrière, marchant plus lentement.
⁂
C’est ici le moment de parler d’un autre retour, celui des deux messagers micmacs, expédiés vers les Maléchites cinq jours auparavant.
Ils avaient heureusement et promptement accompli leur mission, et, la veille au matin, étaient arrivés vers leurs gens, accompagnés de vingt-cinq guerriers maléchites.
Ils étaient donc là trente hommes.... C’était peu; mais tous frais, alertes, parfaitement instruits des lieux, et connaissant les forces de leurs ennemis.
D’ailleurs, les trois Micmacs restés à la Bouabouscache n’étaient point demeurés inactifs: après avoir détruit, sans altérer l’aspect extérieur des lieux, les canots et les provisions des Iroquois, ils avaient battu le pays voisin, ménagé des embuscades et préparé des sentiers dérobés de retraite.
Aussitôt après l’arrivée des alliés, un petit nombre d’entre eux avaient pris la route du Bic, en suivant des chemins détournés et parfaitement connus des guides micmacs, pour aller attendre les Iroquois au retour, épier leurs démarches et se mettre au fait de l’état actuel de leurs forces.
Le reste des trente apprenaient, des deux Micmacs restés avec eux, tout ce qu’il importait de savoir sur la situation et mûrissaient les projets d’attaque.
Les éclaireurs revinrent vers leurs amis de bonne heure dans l’après-midi du lendemain; c’est-à-dire plusieurs heures avant le retour des Iroquois à la Bouabouscache.
Ils apportaient un compte exact du nombre total des ennemis, du chiffre des blessés, de l’ordre de marche et du partage de la troupe en deux bandes; d’où l’on conclut, avec certitude, que les Iroquois avaient l’intention de venir, ce jour là même, retirer les canots de leur cachette.
Pendant que ceci se passait chez les alliés, les deux troupes Iroquoises s’approchaient de la rivière, à environ deux heures de marche de distance l’une de l’autre, sans se douter le moins du monde que quelqu’un s’occupait d’eux, au sein de cette forêt en apparence si calme.
———
Vers la mi-relevée, l’avant garde des Iroquois s’était engagée dans le gué de rocailles de la Bouabouscache.
Après avoir traversé la rivière, ils s’étaient avancés, comme la première fois, dans l’eau, le long de la berge sud du courant.
Arrivés vis-à-vis de l’endroit où étaient leurs canots, ils avaient pénétré dans le bois; déjà ils allaient saisir les premiers branchages qui obstruaient l’abord de leur cache, lorsque, tout-à-coup, une grêle de flèches, sortant presqu’à bout portant et de tous les côtés des fourrés voisins, porta dans leurs rangs la consternation et la mort.
L’attaque était si subite, si imprévue, la position des Iroquois était si mauvaise, ils se sentaient en ce moment si faibles, que, saisis de panique, ils lâchèrent pied et se mirent à fuir en désordre, retournant sur leurs pas, par la route difficile qu’ils venaient de parcourir.
Les alliés, profitant de cet avantage décidé, les suivirent, la hache dans le dos, jusqu’au gué où ils s’arrêtèrent; car là ils entendirent le cri de guerre des Iroquois de la seconde bande, qui répondait déjà aux cris de terreur des fuyards.
Le parti micmac-maléchite recueillit dix chevelures, de ce premier succès, qui ne lui avait pas coûté un seul homme et qui augmentait de plus le nombre des blessés parmi les Iroquois.
Ceux-ci, une fois réunis sur la rive nord de la Bouabouscache, tinrent un court conseil; car il n’y avait pas de temps à perdre.
⁂
La situation était affreuse. La troupe ne comptait plus que soixante-dix hommes, dont la moitié étaient atteints de blessures plus ou moins graves!
On ne connaissait rien du nombre ni des moyens de l’ennemi.
On n’avait plus de canots!.... Il aurait fallu n’être pas sauvage, pour en douter un instant.
Les provisions emportées pour le voyage du Bic, étaient à peu près épuisées. Il était probable que la cache aux approvisionnements avait subi le même sort que la cache des embarcations. Il était également probable qu’une embuscade avait été aussi là dressée!
Mais il n’y avait point à choisir: le seul espoir du moment reposait sur la conservation possible des provisions; il fallait profiter des deux heures de jour qui restaient pour aller arracher à l’ennemi, s’il en était temps encore, le seul moyen assuré d’existence dans ces tristes conjonctures.
On pensait avoir à livrer un combat à mort, on s’y attendait même comme à une chose certaine. Il fallait donc aller en force, préparé à toute éventualité.
Tous les hommes encore capables de combattre, au nombre de cinquante, devaient faire partie de l’expédition: les vingt autres, tous sérieusement blessés, restaient au campement dont ils devaient commencer les petits travaux.
La cache aux provisions était située à une demi-heure de marche et sur la rive nord qu’on occupait en ce moment. Elle se trouvait placée sur une pointe formée par un détour subit et demi-circulaire de la rivière; cette pointe était basse et couverte d’une aunaie touffue; mais, dans le voisinage, la forêt était formée par un de ces grands bois clairs qu’on appelle des fonds d’ormes.
La première fois, les Iroquois y avaient abordé en canot; mais ils avaient pris une exacte connaissance des lieux et marqué des amets; ils ne pouvaient se méprendre de ce côté là.
Prenant à travers les bois, en suivant le cours de l’eau, ils marchèrent avec toutes sortes de précautions, furetant du l’œil et de la main toutes les broussailles.
Parvenus à leur cache, ils ne trouvèrent point d’ennemis, bien qu’ils purent examiner les travaux assez considérables d’une embuscade parfaitement dressée.... Il n’y avait pas de provisions; il n’en restait pas même de vestiges, non plus que des bagages de guerre qu’on avait en même temps déposés dans ce lieu.
Les Iroquois regardent, examinent, puis examinent encore, comme dans l’impuissance de se pouvoir convaincre de l’épouvantable vérité.
Enfin ils reprennent tristes et désoles la route de leur campement.
⁂
Il commençait à brunir, et déjà ils apercevaient, à travers les grands arbres, au-dessus des taillis, le reflet des feux allumés par leurs gens[6], lorsque, d’un embarras[7], en forme de haie de chasse, qu’ils n’avaient point observé au départ, sortit un cri de mort avec une nouvelle volée de flèches, immédiatement suivis de ce bruit que font des hommes ou des animaux fuyant à toute vitesse à travers la forêt.
Les Iroquois s’élancèrent à la poursuite; mais, retardés par les embarras, ils sentirent bientôt que la chose était inutile et, se ralliant, ils continuèrent leur marche vers les feux du camp.
Encore des blessés!.... Toujours cet ennemi insaisissable, invisible!.... Des embûches qu’on ne soupçonnait même pas!.... Ce n’était plus une guerre: c’était une chasse!
On arrive enfin!.... Mais quel horrible spectacle éclairent les feux dont on a vu de loin la lueur! Il ne reste pas un homme vivant des vingt blessés laissés là, deux heures auparavant! Des vingt cadavres qui gisent en ce moment sur la terre, à la lumière blafarde des brâsiers, pas un ne garde sa chevelure!
Les Iroquois se tordent dans des accès indicibles de rage et de désespoir,... et ne reviennent à eux-mêmes que pour constater le fait que le peu de provisions, tous les ustensiles et les petits bagages laissés au camp ont été détruits ou enlevés!
[6] Champlain, décrivant sa première expédition contre les Iroquois dit, que les sauvages en marche de guerre n’allumaient point de feu; cela doit s’entendre de partis voulant faire surprise ou se soustraire la découverte; mais lorsqu’ils se savaient observés ils allumaient du feu pour éclairer leurs gardes et diminuer les dangers de la nuit.
[7] Ce mot, dans le langage des bois, signifie des entassements d’arbres et de branches, faits pour obstruer le passage.
———
Epuisés de fatigues, sentant déjà les préludes de la faim, les Iroquois voyaient commencer pour eux une nuit terrible, avant-coureuse de journées et de nuits plus affreuses encore.
Il n’y avait pas deux avis à ouvrir dans le conseil, qui fut tenu autour des feux de bivouac, auquel semblaient assister, de leurs couches sanglantes, les cadavres des compagnons égorgés, et que troublaient, sans doute, les visions et les spectres de la caverne de l’Ilet au Massacre.
Il fallait vivre de chasse et de pêche; il fallait viser à construire des canots, pour retourner au pays qu’il était impossible de jamais atteindre sans ce moyen.
Tout cela devait se faire en présence d’un ennemi toujours sur pied, au sein d’une contrée inconnue, au milieu d’une forêt battue d’estrades, alors qu’on comptait des blessés en grand nombre et qu’on était dépourvu de tout instrument ou ustensile autres que des armes de guerre.
C’était poser un problème difficile à résoudre.
⁂
Le parti micmac-maléchite, de son côté, avait arrêté ses projets d’une façon irrévocable. Il était bien sûr d’en poursuivre l’exécution, avec ce caractère de fatalité qu’on donnait jadis au destin, et qui distingue les actes des hommes accoutumés à vouloir et à se commander.
Les alliés ne voulaient ni sacrifier, ni compromettre une vengeance qu’ils pouvaient savourer à loisir.
Ne s’exposer que dans le cas d’urgente nécessité: ôter à l’ennemi tout moyen de sortir de sa triste situation, le poursuivre, le traquer sans cesse, l’immoler en détail:—telle était la résolution prise par les cinq Micmacs et leurs frères d’armes les vingt-cinq Maléchites.
Pendant la première partie de cette nuit que les Iroquois avaient passée dans l’insomnie, les alliés, gardés par des sentinelles vigilantes et bien postées, s’étaient reposés d’un sommeil tranquille et profond.
Et lorsque, un peu avant le jour, les Iroquois, cédant à l’épuisement, se furent endormis, dans cette espèce d’insouciance qui est fille du désespoir, ne laissant debout que quelques hommes lassés et étourdis par les événements de la terrible veille, les alliés étaient là, se glissant sous le couvert, profitant du vent qui venait à point remplir les bois du bruit des grands arbres agités et frottant les unes contre les autres les branches de leurs têtes touffues.
Une sentinelle du camp, croyant avoir entendu quelque bruit insolite, élevait au-dessus de sa tête un petit flambeau d’écorce promptement allumé pour éclairer ses recherches, lorsqu’un sifflement,—aigu comme le cri de l’émerillon,—se fit entendre: au même instant, les gardes iroquoises tombaient blessées, chacune de plusieurs flèches, en poussant un cri de douleur et d’alarme.
Les dormeurs, éveillés en sursaut, se lèvent en désordre; mais, avant qu’ils aient pu se rendre compte de ce qui se passe et recueillir leurs esprits, une nuée de flèches s’est abattue sur eux.
Puis les flèches cessent de voler:—la solitude se fait, de nouveau et dans un instant, autour du campement des Iroquois affaiblis encore par de nouvelles blessures graves et nombreuses.
⁂
Le jour venu, les Iroquois se préparèrent à laisser ce lieu néfaste, entouré de périls incessants, déserté par le gibier, où, de plus, la vue des cadavres des frères, avec la perspective de la famine, déjà commençait à tourmenter d’horribles tentations des imaginations rendues maladives.
Les sauvages mangeaient quelquefois leurs ennemis: mais c’était un pur acte de vengeance, et, par cela même, c’eût été pour eux comme un sacrilège de se nourrir de la chair de leurs compagnons.
On résolut de se diriger vers la rivière Trois-Pistoles, en suivant les détours de la Bouabouscache, pour éviter tout danger de mécompte. La distance, en droite ligne, n’était pas très considérable; la route en canot se parcourait en peu d’heures, mais, à travers bois, taillis, rochers, savanes et ruisseaux, c’était tout autre chose.
Ceux qui ont la pratique de la forêt savent quel travail épuisant et interminable c’est que de parcourir les bords d’une rivière.—Quand, pour la première fois, on se livre à cet exercice, on croit avoir parcouru des lieues, alors qu’on n’a parcouru que des arpents.
A toutes les difficultés ordinaires de pareille marche, venaient s’adjoindre, pour les Iroquois, la nécessité de vivre de chasse et de pêche et les privations d’une situation trois fois exceptionnelle et désastreuse.
⁂
Quand il fallut partir,—parmi les cinquante survivants des luttes des derniers jours,—douze blessés se déclarèrent incapables d’entreprendre le voyage, et, selon la coutume des guerriers sauvages, demandèrent d’être achevés.
On leur cassa la tête; puis, jettant leurs cadavres en travers des brâsiers attisés à cet effet, on fit brûler leurs chevelures, afin qu’elles ne servissent pas de trophées et d’ornements dans les fêtes des ennemis.
⁂
Le parti pris par les Micmacs-Maléchites, de n’offrir le combat qu’en dernier ressort, n’était pas uniquement le fruit d’un calcul et d’un raffinement de vengeance; mais c’était encore une loi imposée par la nécessité.
Les alliés, en effet, étaient moins nombreux que leurs ennemis: puis, s’il était vrai qu’ils eussent jusqu’à ce moment opéré presqu’en masse, l’instant était arrivé pour eux de se partager en deux bandes.
Il était essentiel de tenir hors de toute atteinte possible et loin du théâtre des attaques, les canots sur lesquels on avait embarqué les provisions, les bagages, les ustensiles, les ammunitions de flèches et les armes de rechange.—Il fallait une dizaine d’hommes pour conduire et garder les cinq canots de guerre ainsi employés.
C’était donc avec environ vingt guerriers,—mais sains, mais se relèvant à tour de rôle,—qu’on avait à pourchasser et à détruire trente-huit Iroquois affaiblis, mais redoutables jusqu’au dernier moment.
Ceux-ci, avant de quitter le débarcadère de la Bouabouscache, avaient examiné et analysé les traces laissés par leurs assaillants, la veille au soir et le matin du même jour: ils avaient acquis la certitude que le parti ennemi n’était pas très nombreux.
Une dernière lueur d’espoir brillait encore à leurs yeux, lorsqu’ils se mirent en route, par un temps d’une pluie d’averse qui promettait, cependant, de n’être pas de longue durée.
⁂
On n’avait pas fait quatre heures d’une marche tortueuse et pénible, équivalant au plus à une lieue de chemin droit, que, déjà, quelques blessés traînards avaient été tués et scalpés par les alliés.
Les sauvages ignoraient l’art de couvrir une retraite. En temps ordinaires, ils prenaient quelque soin de leurs blessés; mais en cas de désastre, c’était à peu près un sauve qui peut général. Il fallait alors accepter de l’ennemi les conséquences de l’axiome, “malheur aux vaincus;” on y ajoutait dans la pratique, que, pour les siens, la maxime, malheur aux faibles!
Sur le midi, on s’arrêta dans un endroit qui parut favorable pour la chasse au petit gibier et pour la pêche: car on jeûnait depuis un jour.
Une chasse, menée avec soin tout le reste du jour, produisit des lièvres, des porcs-épics et quelques perdrix. On dressa des collets, et une tenture de pêche à la nasse fut placée dans un endroit propice, immédiatement voisin du campement où l’on devait passer la nuit.
Un peu de gibier et une assez abondante prise de poissons permirent aux Iroquois de continuer le lendemain leur route.—Il en fut ainsi des deux jours suivants; mais, dans ces trois jours de marche et de chasses pénibles, les onze plus faibles d’entre les blessés Iroquois avaient payé à leurs implacables poursuivants la dette du sang, récemment contractée dans la Baie du Bic.
On avait, sur la fin du troisième jour, non loin de la rivière Trois-Pistoles, atteint un endroit couvert de grands bois francs, entouré de coteaux, où l’on observait à chaque pas et partout du bois frais mangé d’orignal.
C’était la planche de salut dans un naufrage complet. Tuer un ou deux orignaux, prendre aux grands bouleaux du voisinage des écorces pour construire à la hâte quatre ou cinq canots, avec lesquels, dans quelques heures, on atteignait le Grand Fleuve,.... voilà l’espérance à laquelle les vingt-sept Iroquois, encore debout à la suite des victoires et des désastres d’un grand parti de guerre, s’attachèrent avec toute l’ardeur d’âmes vigoureuses revenant d’un cruel abattement.
⁂
En examinant les lieux on découvrit, à l’embouchure d’une petite rivière, une de ces îles dénudées, ou plutôt une de ces battures de cailloux amoncelés par le charroie des grosses eaux du printemps. Un mince filet d’eau, coulant dans une expansion du lit de ce courant, isolait cet îlot des rives voisines sans en empêcher le facile accès à gué.
Là, dans cet endroit déserté, les Iroquois, après la chasse, pouvaient passer quelques jours à construire leurs embarcations, sans crainte des surprises subites. On y campa le soir même.
Dès l’aurore du lendemain les Iroquois se mirent à la recherche de pistes récentes d’orignaux.
Bientôt on tomba sur les voies toutes fraiches d’une femelle accompagnée de son petit.
Les deux animaux suivaient, en le contournant, un long coteau boisé d’érables: ils marchaient de cette allure qui dénote l’absence de toute inquiétude.
Les Iroquois s’arrêtèrent pour convenir des détails de la chasse; car, s’il importait de s’emparer des orignaux, ce qui ne pouvait se faire en marchant tous ensemble, il importait également de ne pas trop se séparer, à cause des ennemis.
Il fut convenu que les deux meilleurs traqueurs de la troupe prendraient les devants, sur les traces des deux bêtes, et que tout le parti suivrait sans bruit d’un peu loin, pour les soutenir au besoin.
Il y avait un peu plus d’une heure qu’on allait dans cet ordre, avec toutes sortes de soins et de précautions; lorsque les affuteurs, de leur oreille vigilante et exercée, entendirent, à distance, dans la direction d’un détour du coteau d’érable, le bramement sourd et plaintif du jeune orignal:—Ti-am—ti-am—ti-am.
Autant la chasse de l’orignal, ce roi magnifique de nos forêts canadiennes, est facile à travers les neiges dures et profondes des mois de Février et de Mars, autant l’affutage de ces animaux est difficile dans la saison d’été.
Ici, néanmoins, l’endroit était propice, les affuteurs habiles et le succès une question de vie ou de mort.
Les deux chasseurs, pour ne pas être dérangé, dans les soins de l’approche du gibier, élevèrent, sur leurs propres pistes, quelques branches enfourchées de travers sur la voie, afin d’avertir leurs gens de s’arrêter là et de redoubler d’attention, pour ne pas troubler l’affut.
Voyez avec quelles peines infinies ils commencent l’approche: directement, car le vent vient du fourré où les bêtes se sont rembuchées.
Voyez les faire timidement un pas, en s’abritant sous les futaies.... se redresser sans bruit pour regarder en avant.... prêter l’oreille au moindre son .... s’arrêter tout-à-coup, puis se traîner sur les genoux et les mains.... éviter de rompre les branches sèches qui gisent sur le sol.... contourner les petites clairières.... profiter des plis du terrain.... mettre à contribution, en un mot, tout ce que l’intelligence des forêts et des habitudes de leurs habitants, unie à une patience à toute épreuve, peuvent fournir de moyens.
Le petit orignal était couché, le dos aux chasseurs, à demi caché par un gros arbre renversé et recouvert de broussailles de mascouabina[8] et de bois barré;[9] la femelle, à deux pas de son petit, paraissait comme ensevelie dans l’épaisse feuillée.
Après avoir rampé sur le tapis de la forêt, s’être arrêtés maintes fois, les affuteurs enfin sont parvenus à portée d’arc des deux orignaux.
La femelle ne bouge pas,—elle rumine sans doute:—le petit brame et se remue de temps à autre sur sa couche.
Les chasseurs se redressent alors avec précaution, mettent un genou en terre; ils tendent leurs arcs, et, choisissant le défaut des branches du fourré, décochent à chacune des deux bêtes une flèche poussée d’un bras vigoureux, à distance de quelques pas seulement. Puis, sans perdre un instant, ils s’élancent vers leur proie pour assurer leur conquête.
D’un bond ils sont sur les corps des deux orignaux; mais au moment où ils vont enfoncer leur arme dans les chaire palpitantes, ils tombent, eux-mêmes, percés de flèches et s’agitant, sans pouvoir proférer un cri, dans le râle de la mort!
Les Micmacs-Maléchites avaient, avant eux, tué l’orignal femelle et lié près d’elle son petit.—Ils avaient appâté les Iroquois, comme on appâte les ours, les loups-cerviers et autres bêtes carnassières.
Mais la chasse n’était pas finie!
Ils se hâtèrent de fixer contre l’arbre renversé, près des dépouilles des deux animaux, les cadavres des deux affuteurs iroquois;—puis, poussant un double cri d’appel, ils attendirent dans leur embuscade l’arrivée de toute la troupe des ennemis.
Les Iroquois, croyant avoir entendu la voix des leurs, arrivent pleins d’une joie qui redouble à la vue de leurs deux compagnons penchés sur les corps des orignaux tués. Mais au lieu d’une heureuse curée, ce sont encore des traits meurtriers qui les accueillent. Faibles et découragés les malheureux n’essaient point de résistance: ils reprennent à la hâte le chemin de l’Ilet, laissant sur place neuf des leurs pour être scalpés par les chasseurs d’hommes.
Réunis sur ce lit de cailloux au milieu de l’eau, les dix-huit infortunés n’attendaient plus que la mort.
Les alliés, tous assemblés quelques heures après autour de leurs canots tirés sur la rive, résolurent d’en finir avec leurs ennemis. D’ailleurs, il fallait faire quelques prisonniers pour les joies du triomphe qui devait suivre la victoire.
Bientôt après, tous les Micmacs-Maléchites, divisés en deux troupes, abordaient, par les deux côtés, la batture occupée par les derniers des meurtriers de leurs frères du Bic.
Le combat ne fut pas long: tous les Iroquois, à l’exception de six prisonniers, furent tués et scalpés.
Les alliés perdirent néanmoins, dans ce combat inégal, trois Maléchites tués et comptèrent de plus plusieurs blessés.
[8] Le mot mascouabina veut dire graine à ours: c’est le cormier, dont les orignaux mangent l’écorce qu’ils aiment beaucoup.
[9] L’arbuste qu’on appelle bois barré est une espèce petite de sycomore, qui sert aussi de nourriture aux orignaux.
———
Le lendemain fut un jour de triomphe pour les Micmacs-Maléchites. On mit au feu les quartiers frais et tendres du jeune orignal.
Un prisonnier, lié au fatal poteau, servit de jouet à la cruauté des vainqueurs. Les insultes et les tourments infligés à la victime firent intermèdes aux chants, aux danses et aux repas de la victoire, jusqu’à ce que le malheureux, expirant, fut scalpé en présence des cinq autres prisonniers iroquois, témoins de toute cette scène.
On partagea le butin composé de soixante-trois chevelures; et les cinq prisonniers restant furent divisés entre les Micmacs et les Maléchites.
Le jour suivant les alliés se séparèrent, en se jurant alliance et vouant une haine éternelle aux Iroquois.
Chacun reprit la route de son pays; les Maléchites sur leurs canots, le chemin de la Madaouaska; les cinq Micmacs, avec leurs deux prisonniers, à travers bois, celui du Bic.
De retour à la Baie, les cinq Micmacs trouvèrent plusieurs canots de leur nation, venus à l’appel des vieillards et des femmes envoyés dans le bas du fleuve, à la nouvelle de l’arrivée des Iroquois.
Ils visitèrent ensemble les lieux témoins du massacre des leurs: ils virent, gisant sur les rochers et dans la caverne, les cadavres en décomposition de ceux qu’ils avaient aimés.
Avant de quitter ces lieux pour toujours (encore aujourd’hui on dit que les Micmacs ne campent jamais au Bic), on dressa deux poteaux sur l’emplacement de la bourgade. On y attacha les deux prisonniers, la face tournée vers l’Ilet au Massacre, après les avoir préalablement scalpés; puis là, on leur fit subir tous les tourments que la vengeance la plus sauvage peut inventer.
Enfin, quand on vit ces infortunés prêts à rendre l’âme, ou amoncela des écorces autour d’eux et on y mit le feu, pour couronner le supplice.
⁂
Longtemps, disent les récits populaires, on a observé les ombres des massacrés errer le soir autour de l’Ilet et mêler leurs gémissements aux bruits de la mer!
Souvent on a vu, au sein de nuits sombres, des fantômes armés de pâles flambeaux danser, avec des contorsions horribles, sur les galets de la Baie!
C’est en harmonie avec ces traditions qu’on a désigné les deux caps, qui limitent l’entrée de la Baie du Bic, par les noms lugubres de Cap enragé et de Cap aux corbeaux.
Il n’y a pas encore bien des années que les restes des os blanchis des Micmacs tapissaient le fond de la caverne au massacre!
Encore aujourd’hui, ce n’est pas le premier venu qui s’en irait visiter ces lieux, par une nuit obscure, alors que le vent gémit à travers les sapins et les crevasses des rochers, comme une âme en peine!
———
Voilà comment se traitaient entre elles les nations aborigènes du Canada, avant la prédication de l’Évangile!
Marchant à tâtons dans la vie et dans la mort, elles allaient, se ruant les unes sur les autres, comme au milieu d’une orgie de sang.
Spectacle affreux qui navrait le cœur de nos glorieux missionnaires, et les fit se dévouer aux privations de tous les genres, au martyre enduré dans les conditions les plus épouvantables.
“O Dieu de miséricorde! s’écriait le Père Biard, dans son style simple et naïf, n’aurez-vous point pitié de ce désastre? Ne jetterez-vous point vos yeux de douceur sur ce pauvre désert?”
Quelle belle race, cependant, que celle des nations sauvages du Canada!
Quelle sève et quel caractère, au milieu de cette sauvagerie!
Races fières, s’il en fut jamais, qui, aujourd’hui devant l’action énervante du commerce, comme autrefois devant le casse-tête ennemi, savent mourir sans se rendre!
———
OU
L’ÉVANGILE PRÊCHÉ.
———
Reportons-nous, maintenant, à environ quatre-vingts ans après l’époque marquée par les événements qui ont fait le sujet du chapitre précédent.
Des missionnaires de la Sainte Eglise Romaine étaient venus travailler à la vigne du Seigneur, dans les champs du nouveau monde couverts des ronces de l’idolâtrie.
Ils savaient, ces hommes bénis de Dieu, quelles privations, quelles souffrances, quels dangers, quels déboires, quelles déceptions même ils devaient rencontrer, au milieu de ces tribus sauvages des forêts; mais, dans les combats du Christ et de son Eglise, on ne compte pas avec tout cela: l’effort est de l’homme, le succès est de Dieu.
Déjà les travaux d’évangélisation étaient commencés. Déjà des enfants baptisés de ces pauvres peuples étaient allés recueillir au ciel le prix de la rédemption du Verbe. Ces chères petites créatures, régénérées et étincelantes de gloire, aidaient, en déposant l’encens de leurs prières aux pieds de l’agneau, à la conversion de leurs frères laissés sur la terre entourés des ombres de la mort.
Deux soldats de cette milice d’élite qui est comme la garde-du-corps du Vicaire de Jésus-Christ, deux Jésuites étaient venus se vouer aux missions de cette partie de l’Amérique du Nord dont la France venait de prendre possession sous le nom d’Acadie.
Ils avaient déjà visité une partie du littoral, lorsque bientôt, voulant embrasser dans leur zèle toutes les tribus sauvages dont l’existence leur était révélée, les deux apôtres, les Pères Biard et Masse,—comme autrefois les douze choisis par le Sauveur,—se séparèrent: Le Père Biard demeura sur le littoral de la mer, et le Père Masse, jugé plus propre à cela par la “commune voix de la communauté,” comme disent les relations, prit par l’intérieur, en suivant le cours de la rivière Saint-Jean.[10]
Sur les bords de la Rivière Saint-Jean, à environ soixante-quinze lieues de son embouchure, au pied du Kapskouk s’élevait un village maléchite assez considérable.
⁂
Les Maléchites obéissaient alors aux ordres d’un vieux chef qui exerçait sur ses peuples une autorité aussi absolue que cordialement acceptée.
Là où existe le principe de l’autorité, là repose un élément de bien, que les vices de celui qui commande peuvent bien pour un temps neutraliser ou exploiter à l’appoint du mal, mais qui ne laisse jamais que de produire en définitive de bons fruits.
Les Maléchites, certes, n’avaient point à se plaindre de leur vieux chef, dont la sagesse et le dévouement aux intérêts de sa tribu était célèbres chez les nations voisines: vertus du reste qu’il tenait traditionnellement de ses ancêtres.
Cependant, ces vertus naturelles ne laissaient pas moins subsister, chez le Sagamo, toutes les passions indomptées du sauvage.
Le Père avait pris tous ces renseignements, pendant son séjour chez Louis Membertou, sachem de l’embouchure du Saint-Jean, fils de cet autre chef Henri Membertou, une des plus belles intelligences de l’intelligente nation souriquoise, et l’une des plus grandes figures aborigènes de toutes nos vieilles annales.
⁂
Le voyage du Kapskouk, que le missionnaire avait tant désiré, se fit enfin. Le Père, conduit par des sujets de Membertou, remonta le cours du Saint-Jean, et, après une navigation de huit jours, il arriva au village maléchite.
Muni des recommandations de leurs frères des eaux salées, le Père fut bien reçu du Sagamo et de ses gens de l’intérieur, qui ne furent pas peu étonnés de cette visite, bien qu’ils eussent appris beaucoup de choses de l’arrivée d’hommes étranges, venus sur d’immenses canots de bois du grand l’autre côté.
Après avoir fait quelques jours de connaissance avec ces sauvages, et avoir satisfait à toutes les questions d’une curiosité bien naturelle, le missionnaire, qui se faisait “tout à tous pour les gagner tous,” se mit à leur parler du Dieu Trinité et du Dieu fait homme pour le bonheur des hommes.
Les Maléchites écoutaient, dans l’admiration, le développement de la doctrine chrétienne.
Un Dieu couronné d’épines, cloué au bois, expirant en priant pour ses bourreaux: c’est en effet quelque chose de saisissant! C’était pour ces hommes quelque chose d’une étrange nouveauté. Ils voyaient dans ce courage sublime un dévouement qu’ils croyaient comprendre, un sentiment qui les agitait profondément.
Puis, quand le Père leur déroulait la partie historique de l’ancien et du nouveau testament, appuyant surtout sur les grands tableaux de ce drame du monde, l’imagination de ces hommes, ne vivant encore intellectuellement que par l’imagination, s’exaltait.... Ils avaient peine à maîtriser leur surprise, pour rester dans cette impassible gravité que devaient garder, selon leurs idées, des hommes traitant de choses sérieuses.
C’était la première fois qu’ils entendaient donner une explication de ces lambeaux qu’ils possédaient des traditions originelles, que nul peuple n’a jamais perdues tout entières.
⁂
Les sauvages n’avaient, des révélations premières faites à l’humanité et conservées intactes par le seul peuple de Dieu, que des idées on ne peut plus vagues, confuses et extravagantes. Cependant, les notions de l’Étre Suprême, de la Création, de la Faute originelle, du Déluge, des Migrations des peuples, de l’Existence des bons et des mauvais esprits n’étaient pas tout à fait éteintes chez eux.
Un homme, qui venait leur donner sur ces sujets des renseignements capables de satisfaire leur esprit, revêtait de suite à leurs yeux un caractère dont, jusque là, ils ne s’étaient jamais fait d’idée. Cherchant un nom qui pût convenir à cet envoyé, et n’en trouvant point dans leur langue, ils empruntèrent aux récits mêmes de l’homme de la prière un mot pour le désigner.
Ils avaient admiré, comme des hommes considérables et amis du Grand Esprit, ces chefs des premiers ouigouams, dépositaires de la triple autorité de Pontife, de Père et de Roi: ils donnèrent au missionnaire le titre que portaient ces hommes, et le nommèrent Patlialche.
[10] La relation de 1611-12 parle d’un voyage du père Masse, en 1612, à la rivière St. Jean, où il passa l’année, sans dire jusqu’où il se rendit; mais il était parti pour “aller et demeurer avec les naturels, errans et courans avec eux par monts et par vallées et vivans à leur mode quant au civil et corporel.”
———
Sous le masque du stoïcisme sauvage, on eût pu voir se rembrumir le front des plus intrépides guerriers, quand le missionnaire s’efforçait de donner à ces peuples une idée des peines éternelles de l’Enfer.
Une voix intérieure, qui parle au fond de la conscience de tous les hommes, leur disait:—Cet abîme existe! Il est quelque part cet étang de feu!
On eût pu voir ces mêmes fronts se dérider et rayonner, quand le Père peignait, avec une onction séraphique, les joies indescriptibles du Paradis.
Tout leur être disait alors:—Oui, il n’y a qu’un pareil bonheur qui puisse satisfaire les désirs du cœur de l’homme!
Le missionnaire avait fait, en peu de temps, une telle impression sur ce peuple qu’il était déjà convaincu de la vérité des paroles de cet homme, chez qui tout respirait la vérité.
Aussi, lorsque le Père se mit à leur parler du baptême, comme moyen indispensable de salut, beaucoup voulurent être baptisés; mais il leur dit alors:—“Ce n’est pas tout de croire à ces vérités! Il faut sans doute y soumettre et son intelligence et sa volonté; mais il y a de plus des choses à faire et, surtout, il y a des choses à bannir de son cœur et de sa pensée. Il faut purifier l’un de ses affections mauvaises, l’autre des idées de superbe et d’orgueil, qui sont le propre de notre nature déchue.—Avant que cela soit fait, point de part aux mérites du Crucifié:—avant cela point de baptême:—excepté pour ces petits, ajouta le missionnaire en montrant les enfants, à cause de la simplicité de leur cœur!”
L’apôtre touchait au point difficile de la doctrine de la Croix,—“scandale pour les Juifs et folie pour les gentils,”—le point difficile de la morale et de la pratique.
Tout le monde croirait facilement,—parce que la vérité a des accents qui lui sont propres,—s’il ne fallait pas sacrifier, soit les rêves creux d’une intelligence bouffie d’orgueil, soit les liens traditionnels des affections terrestres, soit les coupables désirs du cœur, soit les tristes habitudes du mal.
Tout le monde croirait, sans contestation, si la foi pouvait aller sans les œuvres et n’obligeait pas à des sacrifices, à l’immolation du moi humain, à des luttes continuelles avec son propre cœur et contre une chair rebelle.
Lisons l’histoire des résistances opposées à la promulgation du catholicisme dans le monde, et lisons l’histoire des schismes et des hérésies; toujours on verra la résistance, la rébellion ou l’apostasie tirer leur origine des intérêts sordides ou des affections criminelles.
Tant que le missionnaire n’avait proposé aux Maléchites que des vérités à croire, tant qu’il s’était renfermé dans la simple exposition du dogme, la chose allait de soi:—les sauvages se croyaient déjà chrétiens!
Mais quand il leur parlait des vertus à pratiquer,—des pénitences à faire,—de la confession des péchés,—de la réparation,—du pardon des injures ... oh! alors, toute la sauvagerie de la nature se révoltait!
Le sauvage sentait en lui comme deux natures qui se combattent: deux lois s’offraient à son choix, celle de la chair et celle de l’esprit.
Une voix violente et agitée semblait lui crier: “Cette parole est dure et qui pourrait l’entendre!”
C’était surtout le pardon des injures, la loi d’aimer ses ennemis, que les Maléchites et surtout leur chef ne pouvaient comprendre, ou plutôt ne voulaient point accepter.
Il se faisait en eux une lutte terrible! Déjà convaincus, dans leurs intelligences vierges de toutes les fabrications de l’orgueil philosophique, ils sentaient, tout bonnement, qu’ils avaient à choisir entre le Ciel et l’Enfer.
Les relations disent: “Les sauvages se rendent aisément à la raison; ce n’est pas qu’ils la suivent toujours, mais ordinairement ils ne repartent rien contre une raison qui leur convainc l’esprit.”
Ils n’avaient encore ni méprisé, ni abandonné l’Eglise, enseignant de par autorité divine:—ils étaient encore possesseurs de cette lumière qui éclaire tout homme venant au monde.
Ils n’avaient point appris l’art de se tromper soi-même!
Pas assez corrompus, dans le fond du cœur, pour nier la vérité à cause de leurs passions:—ils hésitaient cependant à en accepter les conséquences!
⁂
Chaque fois que le Patlialche pressait le Sagamo, auquel il s’attachait surtout, parcequ’il comprenait que de lui dépendait pour beaucoup, humainement parlant, le succès de sa mission, il y avait comme une vision qui se fixait dans l’esprit du sauvage.
Il regardait fixement dans la direction de l’Aloustouc et parlait, dans un langage mystérieux, des traditions de sa race et des ombres de ses frères.
Alors sa nature semblait en proie à des agitations semblables au bouillonnement des eaux de son grand fleuve, quand elles se précipitent, à travers les rochers, dans les profondeurs du Kapskouk.
Un jour qu’ils étaient là tous deux, assis seuls au bord de la chute, l’homme de paix et le sauvage farouche, et que celui-là parlait à celui-ci de la nécessité de pardonner à ses ennemis, le Sagamo interrompit tout-à-coup le missionnaire, et lui dit:
—Sais-tu ce que c’est que la vengeance pour un sauvage?
Puis, sans attendre de réponse, il ajouta:
—Ecoute!
———
“J’ai soixante-six hivers, et c’était treize hivers avant que je fusse né.
“Mon père, chef de ma nation, alors dans la maturité et la vigueur de l’âge, avait établi ses cabanes au bord de la Madaouaska.
“Il avait, de deux de ses femmes, trois fils, beaux et forts jeunes hommes reçus depuis peu au nombre des guerriers.
“Un jour, arrivèrent à la Bourgade deux Micmacs du Bic.
“Ils venaient demander à mon père des secours contre un parti d’Iroquois, descendus pour attaquer leurs familles.
“Les Micmacs sont nos frères.... les Iroquois sont des chiens!
“Mon père partit avec ses guerriers, parmi lesquels étaient ses trois fils, qui marchaient pour la première fois dans les sentiers de la guerre.
“L’expédition ne fut pas longue: en moins de douze soleils, nos gens revenaient chargés des chevelures ennemies, amenant avec eux trois prisonniers.
“Mais les Maléchites avaient perdu trois guerriers, et de leur nombre était le plus jeune des trois fils de mon père.
“Deux des prisonniers furent mis à mort dans les fêtes célébrées à l’occasion de cette victoire. Le troisième demanda grâce, avoua que les Iroquois sont des chiens et fut adopté comme esclave, pour servir dans la bourgade.
“Le printemps suivant, vinrent aux bords de la Madaouaska,—car on n’avait pas cessé d’habiter ces lieux,—des messagers du Sagamo de Stadaconé.
“Ce chef voulait organiser une grande expédition, afin d’aller attaquer les Iroquois dans leur pays, et il demandait à toutes les nations de nos frères, de fournir des guerriers pour y prendre part.
“Mon père assembla les anciens auxquels il avait confiance et tint conseil.
“Le lendemain il répondit aux envoyés de Canada, en présence des Maléchites réunis, que la proposition était agréée et qu’on allait, en conséquence des événements qui se préparaient, lever les ouigouams, pour recueillir selon l’usage, toute la tribu sur les bords du Kapskouk.
“En effet, c’était ici, que se réunissaient dans ces temps là toutes les familles de ma nation, quand on avait lieu de croire à la proximité d’une guerre longue et acharnée.
“Pour la première fois, quelqu’un osa élever, au sein de la tribu, la voix contre les décisions du Sagamo et du conseil des anciens.
“Ce furent les deux fils de mon père qui se rendirent coupables de ce crime, dont l’audace étonna tout le monde.
“Ils prétendirent que les Maléchites avaient fait,—l’été d’auparavant,—plus que leur part contre les ennemis communs.
“Mon père écouta sans s’émouvoir ces discours audacieux; puis se levant, avec calme et majesté, il dit d’un ton lent et solennel:
—“J’ai perdu, l’an dernier, mon fils!.... Je n’ai plus de guerriers dans ma famille!.... Ceux qui viennent de parler sont de faibles femmes; ils resteront à coudre les peaux dans les cabanes.... Pour moi, je conduirai des hommes contre les Iroquois, lorsque mon frère du Canada sera prêt à partir. C’est tout.”
“Les deux jeunes gens, honteux et frémissant de rage, se retirèrent poursuivis par les moqueries des guerriers.
“Les femmes et les enfants s’éloignaient d’eux, comme d’animaux dégoûtants.
“Le soir on les mit à coucher avec l’esclave iroquois!
⁂
“Le lendemain il y avait un canot de moins sur le rivage de la Madaouaska: les deux fils de mon père étaient disparus avec l’esclave iroquois.
“Mon père prit la coutume de se retirer, tous les soirs, seul à l’écart dans les bois où il passait des heures entières.
“Les Maléchites se disaient:—Le Sagamo a le cœur malade.... jamais le bonheur n’habitera de nouveau sa cabane!
“Vingt lunes s’étalent écoulées, pendant lesquelles un canot, monté de trois hommes, s’était rendu de la Madaouaska aux sources de la Rivière des Iroquois.
“Tu as entendu parler de ce voyage, long, bien long, puisque pour l’accomplir il faut nager et nager sans cesse, pendant le cours de vingt soleils.
“Depuis notre pays jusqu’au Grand Fleuve et de là jusqu’à l’embouchure de la rivière des Iroquois, on marche en pays ami:—de l’embouchure de cette rivière jusqu’au grand lac qui en est la source, c’est un pays occupé, tour à tour, par nos frères et par nos ennemis, c’est un chemin de sang. Au-delà, c’est le pays des Iroquois.
“Les trois échappés, vigoureux et bien munis, n’eurent pas de peine à parcourir cette distance, à travers une navigation facile.—Leur nombre ne pouvait inspirer de crainte à aucune des nations dont les partis de guerre suivaient souvent cette route: au cas de surprise, la présence parmi eux d’un Iroquois et de deux Maléchites pouvait offrir des moyens de se tirer d’affaire.
“Ce qui leur advint, pendant le voyage, peu importe!—ce qui se passa chez les Iroquois, à l’arrivée de ce canot, on le devine aisément!
⁂
“Quarante lunes après le jour qui avait vu mon père flétrir ses deux fils, devant les siens et en présence d’amis étrangers, trente grands canots de guerre iroquois, montés de cent quatre-vingts guerriers et guidés par deux Maléchites, étaient arrivés à la tête du lac Témiscouata.
“Ils venaient surprendre et détruire nos familles.
“Ils avaient pu, en remontant la rivière qui conduit au lac, nourrir leur haine et leur désir de vengeance par la vue des lieux, témoins de la destruction des dernières bandes de leurs frères, immolés l’année précédente sur les bords de la Bouabouscache!
“Instruits par les récits de l’esclave évadé, profitant des conseils et des services des deux traîtres, il n’y avait pas de danger qu’ils vinssent à commettre les fautes qui avaient perdu leurs devanciers.
“Arrivés au lac, la navigation devenait pour eux aussi délicate, à cause des surprises possibles, qu’elle était facile d’ailleurs, à travers les grandes et belles eaux du Témiscouata, de la Madaouaska et de l’Aloustouc.
“Sur l’avis des Maléchites, on demeura là tout un jour,—les canots et le gros du parti soigneusement cachés dans le sombre et étroit enfoncement, entouré d’ajoncs et de foin d’eau, qui forme l’embouchure tortueuse de l’Acheberache,—le reste des hommes, avec les deux traîtres, répandus dans les bois voisins, pour examiner les lieux.
“A partir de cet endroit on adopta un nouvel ordre de marche, toujours suivi en pareil cas:—on ne voyagea plus que la nuit.
“Le jour, on se tenait sous le couvert, et on n’allumait jamais de feu, si ce n’est lorsqu’il était possible d’en cacher entièrement la flamme et la fumée.
“Le soir, on attachait solidement les canots ensemble; et sans bruit, à la faveur des ténèbres, sur les eaux dormantes du lac, sur les doux courants de la Madaouaska, on descendait pour arriver au but de ce long voyage.
“Il n’y avait pas de lune, les nuits étaient sombres. En partie par suite des dispositions prises, en partie par pure faveur des chances, tout secondait les ennemis de mon père, dans l’exécution de leurs projets.
“Le matin de la seconde nuit de marche, on s’arrêta de bonne heure, à quelque distance du lieu qu’occupait, lors du départ des trois fugitifs, la bourgade de la Madaouaska.
“Il fallait voir si, selon la détermination prise par mon père, on avait transporté les ouigouams maléchites sur les bords de l’Aloustouc;—car les Iroquois avaient été mis au fait de tout ce qui s’était passé avant le départ de leurs guides.
“La bourgade n’était plus là, comme on s’y attendait.—“C’est ici, dirent les deux Maléchites aux Iroquois, en leur montrant l’emplacement des cabanes, c’est ici qu’on nous a chassés du milieu des hommes pour nous reléguer avec les chiens!.... C’est encore ici, ajoutèrent-ils, que deux des vôtres ont été liés au poteau, déchirés et scalpés.”
“L’examen des alentours démontra que l’éloignement des familles avait suivi de près le départ des transfuges. Rien n’indiquait dans ces lieux le passage récent de l’homme. Les fougères, les quatre-temps, les buis, qui tapissaient la forêt, n’avaient point été foulés récemment. Tout respirait le calme de la désertion la plus complète.
“En conséquence, on profita de la fin du jour pour opérer le passage du court et seul portage qu’on eût à faire, à l’embouchure de la Madaouaska.
“Les précautions devaient ici redoubler; il fallait faire petites nuits et journées vigilantes, de peur d’être aperçus—et pour une autre raison encore.
“Ah! si tu connaissais les émotions d’une situation semblable; quand la vengeance approche et qu’on a peur que la chevelure ennemie échappe à la main prête à la saisir?.... Moments de joie, de crainte, d’espoir, de doute, de je ne sais quoi!...... Le moindre son frappe l’oreille: un arbre qui tombe, le murmure d’un ruisseau, les rapides d’une petite rivière qui débouche sur des galets, le vol d’une perdrix réveillée par la peur, les coups de bec d’un pivart, tous ces bruits qu’on entend quand on descend de nuit, en suivant la rive, le cours d’une grande rivière, on les perçoit en pays ennemi d’abord aussi clairement que tu m’entends parler; puis ils grossissent, puis il semble qu’on les entend sans interruption, puis tous à la fois, puis ils se confondent en un bourdonnement qui monte, descend, prend tous les tons et finit par ne plus permettre de rien distinguer;—alors gronderait le tonnerre lointain qu’on ne le reconnaîtrait pas!—Ah! il faut des guides solides, va, dans de pareils moments, et encore ne doit-on pas prolonger ces heures d’épreuve.—Voilà pourquoi, surtout, les canots iroquois faisaient petites marches.
“Ce n’était que vers le milieu de la troisième nuit après le portage du Petit Saut, qu’on se promettait d’arriver dans le voisinage de la bourgade.
“Le soir de cette dernière nuit, on sortit d’une petite anse, formée par la décharge d’un ruisseau profond, où l’on s’était soigneusement tenu caché pendant le jour.
“Les canots étaient fortement liés ensemble, cinq de front sur six de profondeur:—les armes étaient préparées:—le débarquement devait avoir lieu dans un détour subit de l’Aloustouc, au milieu d’un endroit bien boisé, à quelques centaines de pas du village.
“L’attaque devait se faire au milieu des ténèbres, et trois heures seulement séparaient les exécuteurs et les victimes du moment du carnage.
⁂
“Les canots glissaient sur un courant plus rapide.
“On était au plus obscur de la nuit.
“Dans ce moment, deux hommes de l’expédition, se levant de toute leur hauteur dans les canots, frappent, à petits coups redoublés, leur bouche de leur main, en poussant ce cri strident et saccadé que tu connais sans doute.
“Des cris semblables et prolongés répondent du rivage, et vont éveiller les esprits endormis dans les montagnes.
“Aussitôt des flambeaux, élevés des deux côtés de la rivière, se détachant en langues ardentes sur le sombre bandeau de la nuit, illuminent les eaux.
“Les Iroquois étonnés, se redressent et jettent un regard ébahi sur cette scène étrange!
“Rappelés à leurs sens par le choc de cette émotion, ils ont bientôt compris ce que signifie ce spectacle. Alors, s’enveloppant avec calme de leurs couvertures, ils reprennent les bras croisés leurs sièges dans les embarcations.
“Moins d’une minute après, les trente canots et les cent quatre-vingts guerriers allaient s’engouffrer dans les abîmes du Kapskouk,—salués dans cette descente par les cris de centaines de Maléchites, hommes, femmes et enfants, qui, perchés sur les rochers des deux côtés du précipice, se penchaient vers eux, accrochés d’une main aux sapins du rivage et agitant de l’autre les torches allumées pour le sacrifice.”
—Vision d’Enfer!—s’écria, en joignant les mains, le pauvre missionnaire, dès que le Chef eut prononcé le dernier mot de son récit.
—Spectacle sublime!—répliqua le Maléchite.
—Tu comprends, reprit le sauvage après une pose, que mon père savait tout.... Tu comprends que la prétendue rebellion de mes deux frères n’était qu’une feinte, imaginée pour exécuter un chef-d’œuvre de vengeance.—Mais tu ne saurais comprendre ce qu’eût à souffrir mon père, pour contribuer à l’exécution de leur dessein.
“Quand, le soir de l’événement, il lui fut permis de tout révéler et de s’écrier en présence de la peuplade assemblée: “Mes fils sont des hommes!” il lui sembla, m’a-t-il dit souvent, longtemps après, que les montagnes des Chigdos descendaient de dessus sa poitrine.”
Il y eut ensuite un long silence entre les deux interlocuteurs qu’agitaient de bien graves pensées.
———
Le Sagamo, reprenant le premier la parole, dit au missionnaire:
—Mon père, qui comme presque tous ceux de ma race, vécut très vieux, me racontait souvent cette histoire. Chaque fois il me disait:—“Les cent quatre-vingts Iroquois ne valaient pas mes deux fils!”
Quand il fut près de mourir, il m’appela près de lui et me dit:—“Jure-moi que tu seras toujours l’ennemi irréconciliable des Iroquois. Jure-moi, de plus, que tu remettras à tes enfants cet héritage de ma vengeance!”
Je le jurai;—et tu me parles de pardonner à mes ennemis!
Mais feras-tu que les ombres de mes deux frères, que je n’ai pas connus, ne se balancent souvent le soir au-dessus des eaux bouillonnantes et des âpres rochers du Kapskouk?
Feras-tu que je ne sente pas la présence des esprits de mes pères, errant la nuit autour de mon ouigouam?
M’empêcheras-tu d’entendre ces voix intérieures qui me parlent sans cesse de haine et de vengeance?
—Oui, répondit le missionnaire; non pas moi, cependant, mais le Dieu que je t’annonce. Quand on sent la présence incessante de ce Dieu qui remplit l’univers, tous les spectres et les fantômes du jour et de la nuit se dissipent, comme ces vapeurs légères du matin, que le soleil disperse, avant qu’on en ait pu saisir les formes trompeuses.
Quand on écoute toujours en soi la grande voix de ce Dieu qui nous parle sans cesse, toutes les voix et les tourmentes intérieures se taisent, et il se fait un grand calme.
—Peut-être as-tu raison, reprit le sauvage: il fait bon d’entendre parler ainsi!
Puis, après s’être un instant recueilli, il ajouta:—J’ai toujours nourri l’espoir d’être un jour uni à mes pères dans le pays de chasse des esprits; c’est pour cela que, dans les dernières cabanes des nôtres, nous mettons les armes et autres objets qui leur ont servi pendant la vie. Si ce que tu nous dis est vrai, où sont donc les âmes de mes ancêtres?
—Je ne juge pas tes ancêtres, répondit le missionnaire: la miséricorde de Dieu, tombant sur un cœur droit, peut opérer des miracles. Tes pères n’ont point eu l’occasion de s’instruire; dans ces cas d’ignorance invincible, l’obéissance à la loi naturelle accompagnée d’intentions pures peut faire entrer, à leur insu, des âmes candides dans le sein de l’Eglise. Mais il n’en pourrait être ainsi de toi et de ceux qui m’ont entendu, parce que vous avez reçu l’exposition de la doctrine, et que l’occasion vous est fournie de choisir entre le vrai et le faux, le bien et le mal, l’Eglise et ce qui n’est pas l’Eglise, le Ciel et l’Enfer.
—Tu peux continuer à exercer en paix ta parole au milieu de mon peuple, dit en soupirant le Sagamo, je n’y mettrai aucun obstacle. Pour moi, car je ne veux pas te tromper, je ne suis pas encore prêt à me faire chrétien.... Je verrai!
Le missionnaire fit peu de conversions.
Le Sagamo ne reçut pas le baptême, ni lui ni ses enfants; mais eux et tous ceux qui résistèrent ne laissèrent pas d’être profondément travaillés intérieurement, par la prédication de l’apôtre et les exemples des néophytes.
La glace était rompue; il ne fallait plus que le vent de la grâce pour en disperser les fragments.
“Plusieurs n’attendaient rien des vieilles souches sauvages, écrivaient plus tard les Jésuites, toute l’espérance n’était que dans la jeunesse; mais l’expérience nous apprend qu’il n’y a bois si sec, que Dieu ne fasse reverdir, quand il luy plaist!”
———
OU
L’ÉVANGILE ACCEPTÉ.
———
Il s’était écoulé un peu plus d’un demi siècle, depuis la première prédication de l’Évangile chez les Maléchites.
Cette période avait été pour l’Eglise de la Nouvelle France, pour les missions des Jésuites, pour les colons canadiens et acadiens, une période de travaux, de luttes, de souffrances et d’angoisses; mais aussi de foi, de courage, de dévouement et d’héroïsme.
Des guerres continuelles avaient porté la dévastation et le carnage dans toute l’étendue des colonies françaises. Les Iroquois, armés et soutenus par les Hollandais, semblaient devoir éteindre la religion catholique et le nom français dans cette partie du nouveau monde. Une nation alliée, la nation huronne, avait disparu presqu’en entier dans ces luttes. Le martyre de plusieurs missionnaires avait laissé des troupeaux sans pasteurs, des églises sans apôtres.
Il y a ceci de remarquable dans l’histoire du catholicisme, c’est que les époques qui paraissent les plus pénibles et les plus désespérantes, pour ceux qui doivent en supporter le fardeau, sont justement les époques qui, aux yeux de l’histoire et de la postérité, demeurent comme les plus belles et les plus glorieuses.
Aussi cette terrible période de l’histoire de l’Église du Canada a-t-elle reçue le glorieux titre de temps héroïques.
Beaucoup de tribus sauvages, chez qui les missionnaires étaient allés porter la semence de l’Évangile, avaient été forcément délaissées depuis.—Les ouvriers manquaient à la vigne.
Cependant, ces premières prédications n’avaient point été sans fruits durables, et la bonne nouvelle se propageait, en dépit des efforts de l’enfer.
“Vous demanderez, disent les Relations, comment il est possible que le Christianisme puisse subsister dans les forêts parmi des peuples errants.... Les sauvages qui ont eu la connaissance de Dieu et de son Évangile, par le ministère de nos pères, ont eux-mêmes le soin de communiquer aux autres sauvages de leur nation, cette connaissance qu’ils ont reçue, et deviennent ainsi eux-mêmes des Apôtres.... et ceux mêmes qui sont encore infidèles, ne laissent pas de venir présenter leurs enfants au “Baptesme”....
Parmi les tribus, ainsi forcément laissées à elles mêmes, étaient les tribus micmac et maléchite.
Une partie de cette dernière, et notamment les descendants du Sagamo du Kapskouk, fréquentaient alors la rive sud du Grand Fleuve.
Encore aujourd’hui le principal village maléchite occupe, en arrière des paroisses de Kakouna et de l’Ile-Verte, un étroit lambeau de terre parcimonieusement découpé dans le vaste pays qui jadis leur appartenait tout entier.
Les Maléchites, comme les Abénaquis leurs voisins de l’Est, comme les Montagnais leurs voisins du Nord, avaient, “sans aucun maistre, ny aucun Docteur pour cultiver cette première graine et cette première semence, conservé et augmenté leur foi.” Malgré cela, comme on peut facilement se l’imaginer, il y avait encore bien des infidèles parmi ces sauvages, mais il n’y avait guère d’incrédules.
⁂
Au moment où nous reprenons notre récit, une ère nouvelle commençait à luire sur le Canada.
Depuis quelques années déjà, était arrivé à Québec le premier Évêque de notre pays, Monseigneur de Laval-Montmorency, du titre de Pétrée, Vicaire apostolique de la Nouvelle-France.
D’autre côté, le grand Roi, désireux de mettre un terme aux incursions des Iroquois, avait envoyé dans la colonie, sous les ordres d’officiers braves et distingués, ce noble et vaillant régiment de Carignan-Salières, si digne de continuer, dans les forêts de l’Amérique, le rôle commencé par Clovis et ses Francs sur l’antique sol des Gaules.
Les Iroquois avaient fui devant les cohortes de la France, puis avaient demandé la paix et, avec la paix, le baptême.
L’Église canadienne était dans l’allégresse! L’hymne de triomphe, entonné par son premier pasteur, avait été chanté par tout le peuple fidèle.
C’était une nouvelle consécration de cette promesse faite à l’Église: “Et les portes de l’Enfer ne prévaudront jamais contre elle!”
Le Dieu fort, qui veut que son Église soit constamment attaquée et maltraitée, finit toujours, cependant, à cause de cette promesse, par lui donner la victoire. Il se moque pas mal de la puissance et du nombre de ses ennemis. Il est “patient parce qu’il est éternel,” et il sait bien, à son heure, renverser les complots des méchants, qu’ils se nomment Iroquois ou de tout autre nom!
———
Profitant de ces jours heureux de victoire et de paix, les missionnaires se multipliaient pour aller mettre partout l’ordre et l’abondance, dans le champ du Père de Famille.
Deux de ces ouvriers évangéliques étaient partis de Québec pour Tadoussac[11];—l’un était destiné aux missions montagnaises de la côte du Nord; l’autre devait, traversant le fleuve, aller reconstituer les missions de la Gaspésie.
Sans suivre jusqu’au bout ce dernier dans son voyage, accompagnons-le du moins jusqu’à cet endroit célèbre, qui s’appelait alors et qui s’appelle encore aujourd’hui Les Ilets Méchins.
Ce mot de Méchin n’est que la corruption populaire du mot sauvage Matsi ou du nom français Méchant qui sont, du reste, la traduction l’un de l’autre.
Le Missionnaire, accompagné d’un voyageur canadien, s’était fait conduire à Kakouna, sur la rive sud, par les montagnais de Tadoussac. Là, il prit un canot maléchite qui devait le mener à Gaspé.
Des deux Maléchites qui guidaient l’embarcation, l’un était chrétien et l’autre infidèle.
Ce dernier n’ignorait pas les vérités essentielles du salut, il y croyait même; mais il n’avait point été baptisé et, comme bien des gens qui ne sont point sauvages et qui sont baptisés, il avait peur des obligations qu’impose le vrai christianisme. Il remettait le moment de sa conversion!
Pendant le voyage, le missionnaire perfectionnait l’éducation religieuse de ses compagnons. L’infidèle écoutait, avec autant d’attention que les autres, les instructions de l’apôtre. Jamais il ne s’absentait des exercices de piété que le Père ne manquait pas de faire soir et matin, à la lumière du feu de campement.
Mais quand le prêtre lui demandait de se rendre et d’accepter de bonne foi le baptême, il disait:—“Pas tout de suite, un autre tantôt.”
⁂
On était en route depuis cinq jours d’un temps magnifique. Sur le soir du cinquième jour, le ciel, jusque-là serein, se rembrunit tout-à-coup et se chargea de nuages: tout annonçait un de ces coups de vent d’été, aussi prompts à disparaître qu’à venir, mais qui n’en sont, pour cela même, que plus dangereux.
Les voyageurs venaient de parcourir, en serrant le rivage, ce qu’on appelle aujourd’hui le Passage des Crapeaux, à cause de la forme des rochers singuliers qui bordent la côte et qui semblent autant de batraciens rangés sur la rive, pour coasser à leur aise.
On atteignait en ce moment les Ilets Méchins, endroit délicieux, autrefois redouté des sauvages, et depuis aimé des pêcheurs, auxquels il sert de lien favori d’étape.
Les Ilets sont deux petits rochers, situés à une très faible distance du rivage, dont ils sont séparés par un étroit chenal, assez profond pour servir de hâvre aux petites embarcations.
La plage en face forme une anse sablonneuse, d’où le terrain s’élève graduellement en amphithéâtre vers l’intérieur, jusqu’au sommet d’une montagne immédiatement voisine des bords du fleuve. Un faible ruisseau, descendant des hauteurs, apporte en ce lieu l’eau la plus pure et la plus fraîche qu’il soit possible de désirer.
Nos voyageurs s’arrêtèrent en cet endroit.
[11] On lit dans la Relation de 1668: “Deux autres Pères descendent à Tadoussac, l’un pour y hiverner et cultiver cette Eglise qui s’est accrue de quarante Néophytes, et l’autre pour donner commencement à celle des Gaspésiens qui se réunissent pour la commodité que leur en donne la paix.”
———
Malgré l’aspect invitant du local, malgré l’approche de la nuit et la menace d’un coup de vent, le sauvage infidèle ne s’était arrêté là qu’avec la plus grande répugnance et à son corps défendant.
—Qu’a-t-il, demanda le missionnaire au sauvage chrétien, en mettant le pied sur le sable du rivage?
—Il a peur d’Outikou!
Pauvre malheureux, se dit en lui-même le missionnaire, il craint ce Géant fantastique et n’a point peur de ce véritable Géant de l’abîme qui rôde sans cesse autour de lui comme un lion rugissant cherchant qui dévorer!
—Toi, reprit le Père, as-tu peur d’Outikou?
—Oh! non, Outikou ne mange pas les sauvages qui ont reçu le baptême et qui prient.
—Mais pourquoi a-t-il plus peur ici d’Outikou que partout ailleurs?
—Outikou reste là, dans la montagne.
—Ah! c’est donc ici sa demeure favorite; c’est ici qu’il chasse de la voix, pour emporter dans les antres les sauvages qui l’ont entendu. Tu peux en effet te moquer d’Outikou, toi, car c’est en vain qu’il s’épuiserait à crier, je le défie bien de se faire entendre d’un sauvage baptisé.
⁂
Tous les peuples ont conservé, des traditions premières du genre humain, le souvenir de cette lutte gigantesque qui eut lieu dans le ciel, au commencement du temps, et se continue sur la terre entre le bien et le mal.
On retrouve ces histoires de Géants, réminiscence de Satan et de ses anges, comme symbole typique du principe du mal, dans les récits populaires et les poésies premières de toutes les races de la grande famille des hommes.
Outikou, s’appuyant sur un pin rugueux violemment arraché, c’est le Génie du mal fait aux mœurs de la forêt.—Mauvais-Pasteur du noir troupeau des méchants, qui laisse errer ses malheureuses brebis dans les affreux sentiers de la perdition, et ne leur fait entendre sa voix terrible qu’au moment de la consommation du sacrifice.
⁂
Le canot monté sur le rivage était renversé sur ses pinces. Des pièces pesantes de bois d’attérage chargeaient sa légère structure, pour la soustraire à l’action du vent.
L’éclat d’un bon feu projetait sur les eaux du fleuve et sur les îlots une lumière vive, qui marquait, avec un effet grandiose, sur les ombres profondes d’un ciel sans étoiles.
Le groupe des quatre personnages de ce tableau, assis sur le sable, se détachait en clair-obscur dans la pénombre de la montagne.
On causait, en prenant le sobre repas du soir, lorsque le vent, commençant à faire rage, éteignit le feu, dispersant en gerbes étincelantes les tisons ardents du brasier. Cet accident, en laissant nos voyageurs dans une complète obscurité, vint augmenter encore les terreurs du sauvage infidèle.
Il fallait cependant en prendre son parti: on fit la prière, puis chacun s’étendit sur le sable à l’abri du canot, mais fouetté cependant par l’orage et mouillé par les grosses gouttes de pluies qu’il portait dans son sein.
Le vent et la pluie ne furent pas de longue durée; ils cessèrent bientôt pour laisser l’empire exclusif des airs à l’une de ces nuits sombres mais calmes d’été.
On dormait sur le rivage, comme on y dort à la suite d’une journée de fatigue, quand, tout-à-coup, un cri de terreur vint tirer subitement nos voyageurs de leur profond sommeil.
Au même instant, le sauvage rebelle à sa conscience se précipitait aux pieds du missionnaire, en criant de toutes ses forces:—“Le baptême, Patlialche, le baptême!”
—Mais qu’as-tu donc, demanda le Père, avec inquiétude?
—J’ai entendu le cri d’Outikou, et ce cri fait mourir!....
Je l’ai vu descendre de la montagne; grand, grand comme les Chikcháks....
J’ai vu le bâton qui lui sert de soutien, c’est un grand pin sec arraché de sa propre main....
—Calme-toi, dit le Père rassuré; car le malheureux infidèle étouffait.
—Il avait senti du sauvage non baptisé.... il est venu rôder autour du campement.... il se penchait vers moi pour me saisir; mais j’avais placé ton crucifix sur ma poitrine.... En voyant cette image, il a poussé un nouveau cri qui semble encore m’ouvrir la tête;.... puis, il s’est enfui vers la montagne, en laissant tomber son bâton à quelques pas d’ici!
Il écrasait sous ses pieds les sapins et faisait rouler les rochers sous ses pas en se sauvant.
Mais j’en mourrai, ajoutait le sauvage, en s’attachant avec frénésie à la soutane du missionnaire, et je ne veux pas mourir sans baptême!
—Ne crains rien, dit le Père, tu ne mourras pas sans être baptisé. Dieu ne le permettra point; mais en ce moment, tu n’es pas disposé à recevoir ce sacrement auguste. Prions en attendant et repens-toi de la résistance que jusqu’ici tu as opposé aux efforts de la grâce.
⁂
Quand le jour parut, le sauvage, un peu calmé mais encore sous l’effet de l’épouvantable vision de la nuit, entraîna plutôt qu’il ne conduisit le missionnaire à l’entrée du bois, où, montrant un pin sec étendu sur le sol, il lui dit:
—Vois-tu le bâton d’Outikou?
—De ce bâton, dit l’homme de Dieu en souriant, nous allons, avant de quitter les Méchins, construire une Croix que nous élèverons dans ce lieu en signe de la rédemption du monde,—afin qu’Outikou ne revienne plus!
Le bâton du Géant, transformé en symbole de salut, s’éleva bientôt à la pointe de l’Anse des Méchins.
De ce moment, on n’a jamais revu le Géant aux Ilets.—Les Montagnais, qui le nomment Atshen[12], disent qu’il s’est retiré dans les environs du lac Mistassini, dans le grand-nord, où sont les Nashkapiouts ou sauvages qui ne prient point.
C’est en souvenir de cette histoire, mais par suite d’une confusion de lieux, qu’on appelle aujourd’hui du nom d’Anse à la Croix une localité située à quelques lieues en haut des Ilets Méchins.
[12] Cette tradition du Géant mangeur d’hommes est commune à presque toutes les tribus sauvages, avec des variantes.—La relation de 1636 en parle comme “d’une espèce de Loup-Garou” et le nomme Atchen.
Le Révérend Père Durocher, Oblat de Marie Immaculée, qui a longtemps été missionnaire chez les sauvages, m’écrivait dernièrement: “Le géant fabuleux des sauvages est appelé par les algonquins Uindiko, par les Têtes de Boule Uitiko, par les montagnais Atshen. Telle est la prononciation actuelle de ces mots. Elle a pu varier, et de fait, o final se prononçait ou bref.”
———
Espérons qu’Outikou sera chassé de son dernier repaire.
Alors si, comme tout semble le présager, ces belles races primitives du Canada sont destinées à disparaître des rangs de la famille humaine, elles iront finir et se perdre dans le sein de Dieu.
Pauvres, mais heureuses nations!
J. C. TACHÉ.
—
REGRETS.
—
Ma sœur, te souvient-il de ces jours pleins de charmes
Que nous passions, enfants, au foyer paternel?
Nos jeunes ans coulaient sans crainte et sans alarmes,
Sous les rayons bénis du regard maternel.
Mais comme une onde bleue, au front pur et sans rides,
Quand s’élève soudain l’aile des noirs antans,
Nos yeux se sont voilés et nos âmes limpides
Ont vu ternir, ma sœur, leurs miroirs éclatants.
Je ne goûterai plus, un seul instant, peut-être
Ces intimes bonheurs, ces jours délicieux;
Je ne sourirai plus aux lieux qui m’ont vu naître:
Celle qui nous aimait, notre mère est aux cieux!
Ah! gardons dans nos cœurs, de sa sainte parole
Le souvenir vivant et le gage éternel,
Et quand viendra le soir de ce jour qui s’envole,
Ses mains recueilleront notre souffle immortel!
Pourquoi faut-il, hélas! dans cette vie amère,
Compter nos jours passés par autant de douleurs?
Pourquoi le vent du ciel courbe-t-il vers la terre
L’enfance au front candide et les tiges en fleurs?
Au sentier de la vie où notre pied chancelle,
Dieu sema pour nous deux plus d’ombre que de jour,
Mais il mit dans nos cœurs une pure étincelle,
Un saint rayon d’espoir qu’on appelle: l’amour.
A. A. BOUCHER.
———
“Nous irons sur l’eau,
Nous y prom...... promener
Nous irons jouer dans l’Ile.”
—“Après tout, dit-il, le temps pourrait bien se remettre au beau. La lune est dans son déclin.... les grandes mers sont passées.... les nuages ont le dos au vent.... qui sait si le ciel ne va pas se percer sur le coup du midi? Enfin, faut espérer.... on aura peut-être une petite ondée au soleil couchant, mais tant mieux! çà ne ferait pas de mal si le temps s’égouttait un peu.”
Or donc, c’était par un matin de l’été de 185..... veille de la fête de la Reine,—j’aurais dû le dire plus tôt peut-être. Je descendais la côte de la Basse-Ville, et, à dire le vrai, j’aurais pu tout aussi bien la remonter, a l’exemple de ce marin de mes connaissances, qui, louvoyant en sens contraire, fit à une de mes questions la réponse que je viens de rapporter textuellement. La question, comme la réponse, était du reste parfaitement motivée, d’abord par une pluie battante qui, depuis deux jours, menaçait de tout submerger et de tout engloutir; et en second lieu, par la vue d’une annonce pleine d’intérêt, affichée en gros caractères sur la porte de la Basse-Ville, et dont suit mot pour mot la teneur:
VOYAGE DE PLAISIR.
LE bateau à vapeur Orléans laissera le quai de La Place demain à une heure P. M. pour une excursion au bout de l’Ile. Il y aura à bord musique et rafraîchissements.
Prix du Passage:—7½d.
Enfants—moitié prix.
De l’air, de l’eau, de la verdure, des rafraîchissements surtout! c’est si rare dans une ville! Aussi, mon parti fut-il bientôt pris; et, me confiant pleinement aux prédictions météorologiques de mon ami,—vieux loup de mer, s’il en fut jamais—le lendemain même, à une heure moins le quart, je me trouvais en personne, et bien contre mes habitudes, sur le quai de La Place.
Dix minutes s’écoulent.... La vapeur siffle et bouillonne, et le noble bateau, tout pavoisé et orné comme pour les jours de fête, s’élance en se creusant un large sillon dans les eaux limpides de ce grand fleuve, dont le cours est indiqué en lettres majuscules sur les cartes géographiques, sous le nom de.... FLEUVE ST. LAURENT.
La Basse-Ville fuit derrière nous, avec ses quais et ses vastes hangars encombrés, et la Haute-Ville s’élève au-dessus de nos têtes, avec sa citadelle, sa terrasse St. Louis, ses clochers, son Université, etc., etc.
Pascal qui avait contracté la bonne habitude, bien passée de mode aujourd’hui, de dire tant de choses en si peu de mots, Pascal a dit quelque part: “Les fleuves sont des chemins qui marchent, et mènent où l’on veut.”—A coup sûr, ce n’est pas à tous les fleuves qu’il peut être permis de s’approprier une semblable définition.
Et en effet, des fleuves,—j’entends des fleuves véritables et de bon aloi, larges comme la mer, profonds comme l’abîme, qui se frayent un passage de centaines de lieues à travers les terres, et qui, par conséquent, mènent où l’on veut:—eh bien! des fleuves de cette catégorie, on ne les rencontre pas partout.
Franchement, sont-ils bien dignes d’une semblable appellation tous ces fleuves lilliputiens d’outre-mer, dont les eaux sales et bourbeuses, ni douces ni salées, ont été décorées de noms si pompeux et si sonores, et dont la vieille Europe, malgré tout, croit devoir se faire un légitime sujet d’orgueil?
Aussi bien, l’océan, et avec beaucoup de raison, n’a pas l’air de prendre grand souci de tous ces filets d’eau si minces, si dignes de pitié, et que le gascon, avec autant d’à-propos que de bonne humeur, voulait mettre en bouteilles tout uniment. Pour comble de disgrâce, ajoutons que le plus souvent, bien longtemps même avant que d’arriver à la mer, ces fleuves, malgré leur grand renom, vont se perdre et expirer tout prosaïquement dans le sable qu’ils mouillent à peine....
Le St.-Laurent! voilà notre fleuve à nous Canadiens.
Certes, la mer a grandement le droit de se rengorger, en recevant un tribut comme celui du St. Laurent; aussi, ne dédaigne-t-elle nullement de se détourner de son chemin, et de venir à sa rencontre avec une grâce et une complaisance infinies.
Ce tribut d’hommages une fois payé à la Majesté du Roi des Fleuves, passons.
Encore quelques minutes, et nous sommes entre les deux églises: lieu périlleux s’il en fut jamais, et redouté bien justement de tous les marins, en général, et de ceux de l’Ile d’Orléans en particulier. C’est qu’en cet endroit, les courants du chenal du nord, et ceux du chenal du sud venant à se rencontrer, il advient maintes fois que la mer qui pouvait être assez doucereuse et paisible au départ, devient tout-à-coup très furieuse, surtout par les gros vents de nord-est.
En ce temps-là donc, quand la vague, avec un redoublement de fureur, vient à se heurter avec encore plus de violence contre la chaloupe si frêle et si petite; quand le mât ploie comme un roseau, et menace de se rompre en éclats; quand les voiles toutes trempées d’eau et bien pesantes sont sur le point de se déchirer en lambeaux, sous les efforts de la brise; quand le pilote, devenu plus attentif, a cessé toute conversation avec ses voisins, et que, les deux mains appuyées sur la barre du gouvernail, il cherche à deviner avec son œil noir et perçant de quel côté il doit prendre ou éviter la lame,.... alors, un silence absolu se fait dans l’embarcation. Les pipes se mettent de côté, personne ne bouge, personne ne parle, et l’on interrompt même l’histoire pourtant si palpitante d’intérêt et toujours si pleine d’actualité, d’un sorcier ou d’un loup-garou dont personne n’avait encore entendu parler. Et les femmes, accroupies au fond de la chaloupe, relèvent la tête, et l’une d’elles commence à réciter bien haut et bien dévotement le saint rosaire ou le De profondis pour les bonnes âmes des trépassés. Hélas! il est si grand le nombre des malheureux qui ont vu sonner ici leur dernière heure....
La prière finie, on recommence à causer, non pas sans éprouver quelques craintes encore, mais avec beaucoup plus d’assurance néanmoins, parcequ’on vient d’invoquer le nom de la vierge Marie, et d’implorer le secours de celle qui s’appelle ici, entre les deux églises, comme partout ailleurs, l’Etoile de la mer, Stella maris.
Et alors, un jeune apprenti pilote, revenu tout dernièrement d’Angleterre, fait, sans y être invité du tout, le récit éloquent de quelqu’une de ses nombreuses aventures nautiques; là où lui et son maître, par exemple, ont bien failli périr, vû que filant sur les quatre voiles, par une grande brise de vent d’est, la chaloupe s’était à moitié engloutie ou avait chaviré presque; tellement, que si, lui, l’apprenti n’avait pas été bien prompt à lâcher l’écoute de la misaine, c’en était fini d’eux à tout jamais. Surtout, il ne manque jamais d’élever bien haut les tempêtes et les vagues du golfe ou d’en bas, en comparaison desquelles,—on le devine bien,—la mer des deux Eglises n’est que fleurs et bagatelles.
Et ensuite, un des anciens vous fait part à son tour de ses souvenirs, et de ses impressions d’autrefois.
C’est lui qui sait vous raconter, (et avec quelle éloquence!) l’histoire d’un de ces naufrages nombreux et à jamais célèbres dans les fastes de l’Ile. Ainsi, par exemple, c’est, par ordre de temps, le naufrage bien triste de ces Beaudoins de St.-François, qui périrent d’une manière si tragique, au retour d’une noce, qu’ils étaient allés célébrer bien joyeusement, pourtant, à la côte de Beaupré.
Cet événement eut lieu en l’an 1786; et il inspira, dans le temps, à une muse dont l’histoire, me semble-t-il, aurait dû conserver le nom, une complainte en quarante ou cinquante couplets, destinée à perpétuer le souvenir de cette lugubre histoire. L’air de cette complainte, strictement en mineure, se chante sur un ton plaintif et lamentable, comme il convient du reste, à toute bonne complainte.
Dans ces couplets, on ne reconnaîtra pas certainement la facture de nos grands poètes; et comme le Lac de M. de Lamartine n’aura nullement, à redouter, non plus, les dangers de la compétition, je ne me fais aucun scrupule d’en passer quelques strophes au lecteur.
Peuple chrétien, écoutez la complainte
D’un honnête homm’ qui vient de s’marier;
Par un dimanch’ la veille de ses noces
A la grand’ messe on l’a vu communier.
...........................................
Son frère aîné, arrivant à sa porte,
Le cœur lui crève, il se met à pleurer:
Ah! mon cher frèr’, je déplor’ votre sort
Que le malheur vous soit pas comme à moi!
Voilà onze ans que je suis en ménage
Jamais la paix n’a pu régner chez moi.
La remontrance, comme on le voit, était forte; de plus, elle venait d’un frère aîné; pourtant le cadet (et avec beaucoup de raison, à mon avis) n’en tint aucun compte, et n’en persista pas moins dans sa résolution. On se rendit donc à la côte de Beaupré, le mariage et les noces eurent lieu; et voici quel fut le retour:
Sont rembarqués tous avec allégresse,
Quinz’ se sont mis dans la chaloupe à Louis.
...............................................
Ce cher Louison, manièr’ de complaisance,
Laiss’ gouverner par un novicier.
En déboutant la pointe à Porte-Lance
S’étant mal pris, la chaloupe a viré.
...............................................
Joseph Paré, Giguère aussi bien d’autres,
Sont v’nus chercher tous ces pauvres noyés.
La table est mis’ qu’on l’ôte en diligence,
Les draps seront pour les ensevelir.
Cette complainte a eu autrefois les honneurs d’une grande vogue; on la chantait jusqu’à Montréal.
Enfin, parmi tous ces naufrages justement célèbres, qui pourrait donc jamais oublier cette épouvantable catastrophe de la goëlette La St. Laurent, qui se perdit en bas, corps et biens,—il y a déjà bien des années de cela!—engloutissant avec elle, plus de 20 pilotes de la seule paroisse de St. Jean. Jamais on n’a eu ni vent ni nouvelles de cette goëlette, jamais non plus on n’a retrouvé aucun des cadavres. Il est bien vrai que quelques navigateurs ont rapporté avoir vu des feux, des lumières courir sur l’eau, près du Bic, ou quelque part par là: on en a auguré bien pieusement que c’étaient quelques-unes des bonnes âmes de ces pauvres trépassés, qui réclamaient le secours de quelques prières...... et leurs vœux ont toujours été bien fidèlement exaucés.
Pour en revenir à nous, la mer des deux Eglises se montra d’une douceur vraiment incomparable; et un air de musique vint tout-à-coup, et fort à propos, me rappeler un des articles du programme, auquel je ne pensais guère plus: “Il y aura musique à bord.” Au caquet interminable de quelques passagers, je ne tardai pas à m’apercevoir que le programme n’avait pas menti non plus à l’article des rafraîchissements; c’était le temps, ou jamais, me sembla-t-il, de pousser une reconnaissance, et de jeter un coup-d’œil sur les allures et les façons d’être de mes co-passagers.
Parmi la foule innombrable des enfants d’Adam qui n’avaient pas craint de confier leurs destinées au bateau à vapeur Orléans—et Dieu sait s’il y en avait de ces enfants d’Adam qui avaient poussé le courage jusque là!—j’aperçus d’abord un quidam, Ecuyer, Avocat, Procureur de mes connaissances, vengeur des droits de la société en général, et de bien d’autres en particulier.
Debout sur le pont du bateau, notre homme était là, entouré d’un cercle de sept à huit individus. Il portait comme enseigne une cravate d’une blancheur éclatante, il frappait du pied, gesticulait de la main gauche, gesticulait de la main droite, gesticulait des deux mains à la fois: à tous ces signes infaillibles, je compris, je devinai parfaitement, et vos honneurs saurez, vos honneurs comprendrez qu’il plaidait! Et cela, avec une gravité à laquelle n’auraient pu rien ajouter ni la présence des juges, ni le rabat officiel, ni le regard imposant et redoutable de cet huissier, dont la besogne triste et ingrate au-delà de toute expression, consiste à crier du matin jusqu’au soir: “Silence! Silence!!”....; et cela dans une cour de justice remplie d’avocats!
“Le vase est imprégné, l’étoffe a pris son pli”
me dis-je à moi-même. Effectivement, je me trouvais en présence d’un avocat irrémédiable.
Je pris mon carnet, et j’écrivis—Axiome: “L’homme est partout ce qu’il est; en vain l’homme cherche à se fuir lui-même, il se suit toujours, il s’accompagne partout.”
Et en effet, un avocat va-t-il cesser d’être ce qu’il est, et de plaider, par cela seulement qu’il est à dix lieues, à cent lieues d’une cour de Justice ou d’une prison, par cela seulement qu’il vogue sur le plus beau fleuve du monde, et qu’il a devant les yeux l’aspect des champs, de la verdure, d’une nature incomparable? Oh non! il faut que le malheureux porte son boulet, l’arrêt en est porté, et quelque part qu’il courre ou galope,
“Le dossier monte en croupe et galope avec lui.”
Un peu plus loin, j’aperçois deux médecins se livrant à une conversation des plus récréatives. Il est question de tous les beaux cas qu’on a en la bonne fortune de contempler et de savourer à longs traits durant la semaine écoulée; et d’avance, on fait le calcul de tous les cas intéressants qui, suivant toutes les chances probables, devront surgir presque infailliblement durant la semaine à venir.
Des écrasements, des fractures, des dislocations de toutes les espèces, et à tous les degrés de l’échelle chirurgicale, réduites ou à réduire; des amputations, des extirpations déjà faites ou à faire; des tumeurs, des difformités, considérablement embellies à grand renfort de noms grecs et latins; le tout assaisonné des détails les plus circonstanciés sur quelque mort subite ou autre, intéressante à plus d’un titre: voilà, en peu de mots, le catalogue des beaux cas dont ces dignes personnages voulaient bien se régaler.
Ici, à gauche, j’aperçois deux dames critiquant la robe de leur voisine; cette voisine trouve mille choses à redire au chapeau d’une troisième; cette troisième n’aime pas du tout la mantille d’une quatrième; et cette quatrième ne voudrait certainement pas se montrer devant le monde, avec un parasol comme celui d’une cinquième; cette cinquième.... (le lecteur est prié de suppléer).
Toutes ces observations, malgré leur importance majeure, n’étaient pas de force, assurément, à arrêter la course du bateau, aussi filions-nous toujours à tire-d’ailes.
⁂
Nous nous trouvions en ce moment un peu plus bas que les deux églises; et de ce point, le panorama qui s’offre aux regards est bien certainement un des plus pittoresques et des plus grandioses qui se puissent concevoir.
En arrière, Québec, avec ses batteries, sa fière citadelle qui semble un nid d’aigle perché au sommet d’un rocher, et avec ses maisons en amphithéâtre, dont les toits de ferblanc frappés par les rayons d’un soleil ardent, font rejaillir des gerbes de lumière.
Québec, du haut de ce promontoire, où il est fièrement assis, avec ses embrasures et ses centaines de canons, Québec paraît se complaire à élever sa tête orgueilleuse et sublime en face de ces montagnes bleuâtres que l’on voit apparaître de tous côtés, puis s’éloigner, puis se rapprocher encore, et enfin disparaître, mais à regret toujours, et en élevant jusqu’au dernier instant, leurs cîmes au-dessus des autres montagnes, afin de jouir encore une fois au moins de cet incomparable chef-d’œuvre de la nature.
Avec cela, Québec est fier à juste titre, et semble n’avoir rien de mieux à faire que de contempler sa propre image dans les eaux du grand fleuve qui se déroule au bas, et dont les flots viennent baiser ses pieds avec amour et respect.
Au sud, la Pointe-Lévis, qui, né d’hier, relève déjà la tête orgueilleusement, et pousse la condescendance jusqu’à vouloir bien donner le nom par trop modeste de rivale à sa sœur aînée.
Au nord, les côtes de Charlesbourg et de Beauport, dont les maisons se déroulent en ligne onduleuse, comme un long ruban blanc sur un immense tapis de gazon.
En face, l’Ile d’Orléans—sentinelle avancée, qui, orgueilleuse et jalouse de son noble privilège, fait tant, par ses tours et ses détours multipliés, qu’elle ne permet à l’œil avide de l’étranger d’embrasser ce grand spectacle de la nature, qu’au dernier moment seulement, et quand sa dernière pointe a été dépassée.
On compare souvent pour la beauté du site et des environs, Québec à Naples, à Constantinople, à Gibraltar. Et l’un dit: “Naples est plus beau que Québec!” et l’autre: “Moi je préfère Québec à Naples!”—comme si ces comparaisons et ces préférences toutes gratuites pouvaient ajouter la moindre teinte au ciel bleu de la Méditerranée, comme ni tout cela devait exhausser d’un millième de ligne seulement le vieux rocher de Québec!
Devant nous viennent de défiler de vastes chantiers et une forêt de mâts de navires. Cet endroit, connu depuis longtemps sous le nom d’Anse-des-Sauvages, a été pendant bien des années le rendez-vous favori de quelques familles errantes qui y venaient régulièrement passer l’époque de la belle saison. Aujourd’hui, plus de sauvages! et les échos de cette belle plage ne sont troublés que par le choc monotone des madriers qu’on empile les uns sur les autres, ou par les chansons bachiques et les g....d.. des matelots anglais.—Evidemment, l’anse des sauvages s’est civilisée.
A notre gauche, se dessine le quai Bowen et la jolie villa de cet entreprenant compatriote, qui a tant fait déjà pour l’Ile d’Orléans. Ce quai se trouve justement situé à l’Anse du Fort, là où se réfugièrent les Hurons, en 1651, après la destruction de leurs bourgades par les Iroquois.
Hélas! les temps sont bien changés!.... Le frêle canot d’écorce ne repose plus sur la grève; la cabane du sauvage, elle aussi, a disparu, et le sable du rivage, léger et mobile comme elle, n’en a conservé aucune trace. Le cri de guerre de l’Iroquois ne se fait plus entendre; et ce féroce guerrier, civilisé comme nous aujourd’hui, jouit des douceurs de la paix et de la tranquillité aux jolis villages de Caughnaouaga, de St. Régis et des deux-Montagnes.
Le Huron aussi a déposé le tomahawk, et ne calcule plus orgueilleusement le nombre des chevelures ennemies suspendues autour de sa cabane; et le charmant village de Lorette où résident les faibles restes de sa tribu, à trois lieues seulement de Québec, est bien assurément un des plus industrieux de la Province. “Quel désappointement pour mes compatriotes, disait, l’automne dernier, un touriste français, quand je leur dirai, qu’étant allé visiter les sauvages du Canada, une demoiselle huronne a bien voulu me chanter une jolie chanson française en s’accompagnant elle-même sur le piano!”
Seulement, quand Décembre ayant ramené les frimas et les neiges, permet à l’œil de mieux suivre dans la forêt les traces de l’orignal ou du caribou: ah! alors, en dépit de tout, l’instinct du sauvage, le goût du chasseur se réveillent encore. Il faut partir, et, le fusil sur l’épaule, les raquettes aux pieds, il s’élance au milieu de ces bois tant aimés de ses ancêtres, et dont les échos répétèrent si souvent les cris de chasse et les chants de guerre.
Au bout de l’Ile, le fleuve dévie un peu de sa course, et se dirige vers l’est; de sorte que l’Anse-du-Fort est à peu-près le premier point d’où les navires qui remontent le St. Laurent commencent entrevoir les nombreux clochers de la ville. C’est vers ce point encore que se portent les regards avides du Québécois, lorsqu’au printemps, quand les neiges et les glaces ont disparu, il attend avec impatience la première voile dont l’arrivée signale la réouverture des transactions et du commerce.
Que de fois aussi les yeux de nos ancêtres ne se sont-ils pas fixés sur ce point du fleuve que sillonne à l’instant même notre bateau! Mais alors, c’était la flotte ennemie qu’on attendait; ou bien, ces navires de France, toujours en retard, toujours lents à venir, et qui apportaient enfin des vivres et des secours à cette poignée de nobles martyrs, décimée par les guerres, par la famine et par les maladies.
Ainsi c’était en 1629, par exemple. Une disette affreuse régnait à Québec, et les habitants de la ville couraient les bois, pour y cueillir des racines. Pourtant, encouragé par Champlain qui donnait l’exemple du dévouement et de la patience, on ne perdait pas encore tout espoir.
Le printemps se passe, l’été s’écoule; et enfin, par un beau matin du mois de juillet, trois voiles font leur apparition au bout de l’Ile. Quelle joie! quel triomphe! mais aussi, quel désappointement, quand, au lieu du drapeau blanc, on reconnaît le pavillon anglais qui flotte au haut des mâts!
Soixante un ans plus tard, dans l’été de 1690, une escadre doublait encore la pointe du bout de l’Ile. Cette fois, c’étaient nos bien-aimés voisins, les habitants de la Nouvelle-Angleterre, qui, irrités de toutes les défaites que nous leur avions fait subir, prenaient sur eux la tâche un peu difficile de châtier et de conquérir la Nouvelle-France. A cet effet, ils avaient équippé trente-cinq bâtiments de guerre, et enrégimenté plusieurs milliers d’hommes; mais c’était encore trop peu pour s’emparer d’un pays défendu par quelques centaines de braves comme ceux que nourrissait alors le sol de notre patrie!
En 1759, une nouvelle flotte, la plus considérable qui eût jusque là sillonné les eaux du St. Laurent, apparaissait encore au bout de l’Ile d’Orléans. Cette dernière amenait Wolfe et ses soldats, qu’attendaient à Québec le Marquis de Vaudreuil, Montcalm et ses miliciens.
Et des mois s’écoulent, et des années bien nombreuses se passent.... assez nombreuses pour remplir le cadre d’un siècle entier; et un soir de l’été de 1855, vers quatre heures de l’après-midi, les Québécois, pressés on foule sur la terrasse St. Louis, dirigeaient encore une fois des regards bien avides du côté de l’Ile.
Tout-à-coup, une voile apparut, c’était une voile française!.... Elle fut saluée de vingt et un coups de canon.... le drapeau tricolore fut arboré sur la citadelle de Québec.... toute la population des campagnes, ivre de joie, accourut à la ville, pour saluer des marins qu’ils appelaient nos gens!.... Il y eut des bals publics, des fêtes brillantes; le tout, en l’honneur de nos alliés.... les Français!
Hélas! que les temps sont changés!
Pendant que je me livrais à toutes ces réflexions, le bateau touchait au quai.
Il était alors, une heure et demie; de sorte que ce fut après une demi-heure environ de la plus heureuse des navigations possibles que le débarquement eut lieu. Quel débarquement prosaïque! Pas de vigie pour nous annoncer d’avance que nous allions toucher au terme de notre course; pas une seule bouche, chargée de faire entendre à nos oreilles ce mot magique: “Terre! Terre!” mot trois fois béni qui caresse si délicieusement l’oreille de tout navigateur. Parmi cette foule de voyageurs qui encombraient le bateau, pas un seul individu n’eut l’air de se rappeler qu’il allait fouler le sol privilégié de l’Ile de Bacchus, de vénérable mémoire; pas un, non plus, qui fit mine seulement de craindre l’apparition soudaine d’un de ces redoutables loups-garous ou feux-follets traditionnels, dont la patrie de ces fiers insulaires a été de temps immémorial, la terre de prédilection.
Au sortir du bateau, ma première visite fut pour les ruines de l’ancien fort des Hurons.
Ces ruines furent découvertes en 1856, par M. N. H. Bowen, à une petite distance seulement du quai. C’est un mur de cinq pieds d’épaisseur, recouvert, lorsqu’on fit les excavations, d’un pied de terre, où poussaient à l’envi les unes des autres, les ronces et les jeunes érables.
Ainsi que je l’ai déjà mentionné en passant, ce fut en l’an 1651 qu’un assez fort parti de Hurons vint se réfugier à l’Anse du Fort; ce parti était composé de cinq à six cents personnes environ.
Aidés de leurs missionnaires, ils se mirent à défricher la terre et à cultiver. Pendant la première année néanmoins, ils vécurent de la charité et des aumônes des Français, auxquels ils témoignèrent toujours la plus vive reconnaissance et rattachement le plus sincère.
L’année 1652 fut encore pour ces infortunés une année de tristesse et de deuil. Six hommes de leur bourgade avec trois enfants se rendaient dans un grand canot à Tadoussac, où ils allaient vendre leur farine de blé-d’inde aux Montagnais. Une tempête les surprit dans le fleuve, et engloutit la frêle embarcation avec ses neuf passagers.
En 1653, il y eut une grande assemblée de Sauvages au bout de l’Ile. Une des cinq nations iroquoises, celle des Onnontagués,—se sentant d’humeur à faire la paix, envoya à cet effet une députation aux Hurons de l’Anse-du-Fort. Le Gouverneur, M. de Lauzon, assista officiellement à cette réunion. Il y eut de part et d’autre des discours et des promesses; le traité fut scellé par l’échange de présents, et le tout se termina par des fêtes et des réjouissances.
Outre le fort dont je viens de parler, et outre les wigwams hurons, le voyageur, à cette époque, aurait pu voir encore s’élançant du milieu des sapins et des érables qui recouvraient la plage, le clocher d’une petite chapelle construite avec les économies des Français, et avec des peines infinies, pour le service de ces pauvres sauvages.
Rien ne saurait égaler la piété toute primitive de ces fidèles chrétiens ainsi que la vivacité de leur foi. A diverses reprises durant le jour, la cloche faisait entendre ses joyeuses volées au milieu des airs, et conviait les fidèles à l’église. On y récitait des prières publiques; puis, un chœur de jeunes Huronnes chantaient en leur langue, des cantiques composés par leurs dévoués missionnaires. “La beauté de leurs voix est rare par excellence, disent les Relations, elles chantent à ravir!.... C’est une sainte consolation qui n’a rien de la barbarie, que d’entendre les champs et les bois résonner si mélodieusement des louanges de Dieu, au milieu d’un pays qu’il n’y a pas longtemps qu’on appelait barbare.”
Les missionnaires avaient eu l’excellente idée d’établir parmi eux une Congrégation de la Ste. Vierge, dans laquelle n’étaient admis que ceux dont la conduite était tout-à-fait exemplaire, et exempte de tout reproche.
Or, un jour, il arriva que ces bons Hurons reçurent une charité de leurs bien-aimés confrères, Messieurs les congréganistes de Paris. Sur ce, une assemblée fut convoquée, et il fut décidé qu’on enverrait aux confrères d’outre-mer, en retour de leurs présents, un collier de porcelaine noire, portant ces mots en porcelaine blanche: Ave, Maria gratiâ plena.
Ce présent était accompagné d’une lettre, écrite en leur nom, sur une écorce de bouleau.
Voici quelques passages de cette lettre si remarquable à tant d’égards.
“Mes frères, nous vous honorons sans feintise.... La mère de Jésus qui regarde les pauvres vous a poussés à ne les pas mépriser; depuis plusieurs années, vous nous avez envoyé de riches présents. Nous nous sommes assemblés, et nous avons dit: Qu’envoierons-nous à ces grands serviteurs de la Vierge? Nous avons dit: Ils n’ont en rien besoin de nous, car ils sont riches; mais ils aiment la mère de Jésus, envoyons-leur un collier de notre porcelaine, où est écrit le salut qu’un ange du ciel apporta à la Vierge. Nous avons dit autant de chapelets, en l’espace de deux lunes, qu’il y a de grains dans le collier”....
Tel était donc le genre de vie, telle était la conduite des Hurons de l’Anse-du-Fort, lorsqu’un samedi matin, le 20e jour du mois de mai 1656, un parti de ces sauvages, après avoir assisté à la messe selon la coutume, et la plupart s’étant confessés, se répandit dans les champs pour ensemencer le blé d’inde. Tout-à-coup, un cri de guerre se fait entendre; mille cris féroces y répondent, et un gros d’Iroquois, caché en embuscade, se précipite hors du bois, et tombe sur les Hurons, le tomahawk à la main.
Partie fut massacrée sur place, partie emmenée en captivité; le reste ne dut son salut qu’en se sauvant dans le fort. La perte des Hurons, en cette fatale circonstance, fut de soixante-onze personnes, parmi lesquelles on comptait un grand nombre de femmes. Jacques Oachouk, Préfet de la Congrégation, fut au nombre des prisonniers et mourut en chrétien, au milieu des supplices les plus atroces.
⁂
Quatre années se sont écoulées depuis l’événement que je viens de raconter, et si le lecteur veut bien se reporter à l’année 1660, voici le drame qui va se dérouler à ses yeux.
Un parti d’Algonquins arrive à Québec, conduisant en triomphe cinq Hurons qui viennent de tomber entre leurs mains.
Autrefois, ces malheureux furent baptisés, autrefois ils furent chrétiens exemplaires. Mais, de même que pour un certain nombre de leurs compatriotes, un séjour de quelques années au milieu des Iroquois a été plus que suffisant pour leur faire trahir leur nationalité, et oublier les promesses de leur baptême.
Descendus secrètement à Québec, pour tirer vengeance d’un affront que l’un d’eux prétendait avoir reçu, ils sont parvenus, sans être inquiétés, jusqu’à la côte de Beaupré: là, ils ont enlevé une femme avec ses enfants.
Mais ces forbans comptaient sans les nombreux postes établis par les Français sur la rive sud du fleuve, et sans la vigilance des sentinelles commises à leur garde. Aussi, en passant avec leur prise près du rivage de la Pointe-Lévy, et bien qu’ils fussent favorisés par l’obscurité de la nuit, ils furent reconnus et arrêtés.
Dans la bagarre, trois des leurs furent noyés—ils étaient huit en tout. La pauvre femme eut un de ses enfants tué entre ses bras, et elle-même reçut un coup de feu mortel.
Elle fut conduite à l’hôpital où elle mourut au bout de quelques jours, ne cessant de prier tout le temps, pour ces barbares, à qui elle devait sa mort prématurée, et dont elle était devenue, sans le savoir, la cause de salut.
Revenons aux captifs.
Ils sont là, au nombre de cinq, attachés aux fatals poteaux.
En face du danger, et d’une mort inévitable, ces malheureux n’ont pas tardé à rouvrir les yeux, à abjurer leurs erreurs récentes, et à revenir à leurs bons sentiments d’autrefois.
De ces cinq prisonniers, deux surtout méritent de fixer l’attention: l’un, aïeul, âgé d’une soixantaine d’années; l’autre, petit-fils du premier, âgé de dix-sept à dix-huit ans, et d’une complexion très-délicate.
Par manière de divertissement, les enfants s’amusent d’abord à leur arracher les ongles avec leurs dents: puis ils leur coupent les doigts, et les brûlent à petit feu. Et tout cela, pourtant, n’est que le prélude de tortures bien autrement cruelles auxquelles ils vont être soumis bientôt; car, après tout, que pourrait l’imagination encore si peu inventive de ces enfants, comparée à celle de ces adultes, de ces guerriers sauvages, lorsqu’il s’agit de faire souffrir à un ennemi juré tous les tourments de l’enfer et de savourer à longs traits, dans les cris et les plaintes que lui arrache la douleur, les indicibles émotions de la vengeance!
Le missionnaire, le prêtre est là: cet ami des Hurons et de tout le monde, le seul qui ne manque jamais, le seul toujours fidèle, quand tous les autres vous renient.
Toutes les sollicitations possibles, tous les efforts imaginables ont été épuisés pour soustraire ces malheureux à leur affreux martyre; mais en vain. Le cri de la vengeance, chez ces barbares, faisait taire tous les sentiments humains; et il ne restait plus au missionnaire que la triste et suprême consolation de pouvoir assister comme spectateur à ce drame terrible; au moins, il n’y devait pas être spectateur oisif et inutile.
Il court de l’un à l’autre, les exhorte à tourner leurs regards vers le ciel, et à réciter ces prières qu’on leur a enseignées, dans des temps meilleurs, et que, par bonheur, ils n’ont pas encore oubliées.
“Jésus, ayez pitié de moi! Marie, fortifiez-moi!” répète sans cesse le vieux Huron, au milieu des flammes.—Pas un cri, pas une plainte ne lui échappe, pendant un jour et une nuit que durent ces terribles épreuves.
De temps à autre, on le voit se tourner vers son petit-fils, à qui les douleurs les plus inconcevables arrachent involontairement des cris plaintifs, et il lui dit: “Courage, mon fils, prions incessamment... Les brasiers nous séparent maintenant l’un de l’autre, et les fumées qui s’exhalent de nos corps rôtis nous empêchent de nous voir; mais nous nous reverrons bientôt dans le ciel.”
Malgré tous ses efforts pour imiter le courage stoïque de son aïeul, ce pauvre jeune homme, pourtant, ne peut s’empêcher de crier et de pleurer. Et comme on se dispose à lui percer un pied avec un fer rouge, pendant qu’on brûle l’autre, en le serrant entre des pierres ardentes, le vieillard, touché de ses cris lamentables, narguant ses bourreaux:
“Hé! que ne laissez-vous cet enfant? ne suis-je pas seul capable de rassasier votre cruauté, sans l’exercer sur cet innocent?”
A ces mots, on se jette avec une nouvelle fureur sur le malheureux vieillard, on lui taille les chairs, avec des couteaux rougis au feu; on lui applique un collier de haches embrasées sur les épaules, on répand des cendres brûlantes sur sa tête, qu’on a eu le soin de dépouiller de sa chevelure, on le brûle à petit feu avec des tisons ardents; enfin on n’omet rien de ce qu’une rage infernale peut suggérer à l’imagination de ces barbares, si fertile à inventer des tourments; et cela, dans l’unique dessein de lui arracher au moins un cri, une plainte.
Peine perdue; le prisonnier parait insensible au milieu des flammes.
Enfin, après quarante-huit heures de ces cruautés inouïes, comme ce vieux sauvage parait complètement épuisé, et sur le point de rendre l’âme, on le jette dans un brasier pour l’achever.
Mais, quel n’est pas l’étonnement de tous les spectateurs, lorsque cet intrépide vieillard, se relevant soudainement du milieu des flammes, se fraie un passage dans la foule, et prend sa course à travers les bois, “paraissant, disent les Relations, comme un démon en feu sans peau à la tête, et presque en tout le corps;—” et bien qu’il ait la plante des pieds et les jambes toutes rôties, il court si vite qu’on a peine à le rejoindre.
Cependant, on parvient à le ratrapper, et on le jette de nouveau dans le brasier où il ne tarde pas à expirer.
Les autres captifs endurèrent les mêmes supplices, avec la même résignation, et dans les mêmes sentiments de foi et de piété.
Tels furent, en peu de mots, les événements les plus remarquables qui signalèrent le séjour des Hurons à l’Anse-du-Fort; tel fut aussi un des nombreux épisodes qui suivirent la dispersion de cette nation, autrefois si populeuse et si puissante.
Dans des temps plus rapprochés, l’Anse-du-Fort se recommande encore à l’observation du voyageur, comme étant le lieu où furent construits le Columbus et le Baron Renfrew, les deux plus gros navires dont l’histoire maritime fasse mention, avant le Great Eastern.
Le premier, de la capacité de 6000 tonneaux, fut lancé le 28 juillet 1824; le second, pouvant porter 10,000 tonneaux, fut construit l’année suivante.
La mise à l’eau de ces deux bâtiments monstres créa une véritable sensation dans tout le pays, et les journaux de l’époque consacrèrent de longs articles à la narration de ces deux événements.
Avant d’abandonner définitivement ces lieux, je crus devoir m’avancer un peu plus loin, et pénétrer dans ces magnifiques bocages qui bordent la rive sud du Bout de l’Isle. Certes, si j’étais un des heureux de ce monde, et que je pusse me passer la fantaisie d’avoir ma maison de ville et ma maison des champs, de tous les environs pourtant si pittoresques de la ville de Québec, aucun endroit ne siérait autant que celui-ci à mes goûts et à mes inclinations.
A mon retour, un cocher vint fort à-propos, m’offrir ses services, avec ensemble ceux de sa bête attelée à la calèche classique. J’acceptai son offre bienveillante, et nous partîmes au grand trot.
Le soleil avait déjà baissé à l’horizon, et grâce à de gros et épais nuages blancs qui voilaient les rayons d’un soleil beaucoup trop vif, grâce aussi à cette brise si agréable et si fraîche qui semble avoir établi son domicile perpétuel sur l’Ile d’Orléans, je me laissai aller, avec une complaisance à nulle autre pareille au doux bercement de la calèche, et me pris à songer:
Car que faire en calèche à moins que l’on ne songe!
Oui, disais-je à part moi, la création fut bien faite dès le commencement du monde, et bien difficile est celui qui peut y trouver à redire! Ce n’est pas pour aller en chemin de fer que l’homme a été créé avec des jambes, et que le cheval, lors du grand naufrage, a été sauvé dans l’Arche de Noé. Aussi, du moment que l’homme ne voyage pas à pied, en calèche ou de quelque autre manière aussi primitive, il ne voyage pas!
Jadis, le trajet de Québec à Montréal se faisait en canot d’écorce, ou par les sentiers pratiqués à travers la forêt, et on y gagnait de toutes manières. Il y avait des incidents sur la route, des périls à affronter, des émotions de toutes sortes: c’était à donner envie de vivre!
On versait des larmes sincères à votre départ, on se faisait de côté et d’autre les adieux les plus touchants, toutes sortes de bons souhaits vous accompagnaient dans votre voyage. Aujourd’hui, plus d’adieux; plus de souhaits! plus de larmes! Les larmes sont changées en vapeur.
Rendu à Montréal, vous étiez l’objet de la curiosité, de la sympathie de tout le monde. On s’arrêtait dans les rues, on se penchait aux balcons pour vous regarder passer; les mères disaient à leurs petits enfants: “Voilà un Québécois!” Aujourd’hui, un Québécois n’est pas plus drôle à Montréal, qu’un Montréaliste à Québec.
Le voyage, par hasard, avait-il une issue fatale, une bourrasque soudaine vous livrait-elle en pâture aux poissons, ou bien prenait-il fantaisie à quelque Sagamo iroquois de jouer du tomahawk sur votre chef, eh bien! alors, vous aviez joui d’une bonne tempête au moins, vous aviez l’honneur d’être scalpé et rôti.
Espérons pourtant! Un jour viendra peut-être où le monde, fatigué de progresser, aura le bon sens de se déciviliser; et alors, on en reviendra tout naturellement au cocher, au cheval, et à la calèche, ces trois phénomènes de la création.
Le chemin que je parcourais en ce moment, n’aurait pas manqué d’intérêt, sans doute, aux yeux d’un étranger. Car, de quelque côté que les regards se tournent, ils tombent invariablement sur les plus beaux points de vue qu’il soit possible à un amateur de rêver. Mais pour un Québécois, habitué dès sa plus tendre enfance à de semblables spectacles, et qui peut à peine faire un seul pas hors de chez lui ou tourner ses regards vers sa fenêtre, sans que la nature vienne dérouler à ses yeux un de ses plus riches panoramas, tout cela devient d’un intérêt tout-à-fait secondaire.
⁂
St. Pierre, tel est le nom de la première paroisse de l’Ile d’Orléans, qui en compte cinq en tout; les quatre autres sont: St. Laurent, St. Jean, St. François et Ste. Famille.
L’Ile d’Orléans n’a pas toujours porté ce nom historique sous lequel elle est connue aujourd’hui; elle s’appelait autrefois l’Ile de Bacchus. Les vignes nombreuses dont elle était couverte, lors du premier voyage de Jacques Cartier, lui firent donner par ce marin cette dénomination toute olympique.
Depuis longtemps, pampres et Bacchus ont disparu, et pour cause; car les habitants de l’Ile sont d’une sobriété tout-à-fait exemplaire. A peine rencontrez-vous une seule auberge dans tout le pays d’Orléans; et, en quelque maison que vous pénétriez, le premier objet qui frappe vos regards est une grande croix noire suspendue à la muraille, témoin toujours présent qui rappelle à chaque famille la promesse solennelle formulée au pied même des autels, de ne jamais prendre un seul verre de boissons enivrantes, sans une extrême nécessité.
Pendant quelques années, l’Ile fut érigée en comté, et porta le nom d’Ile et Comté de St. Laurent.
Les Hurons, durant leur séjour à l’Anse du Fort, l’avaient mise sous la protection de la Ste. Vierge, et lui avaient donné le nom d’Ile de Ste. Marie.—Mais revenons aux temps modernes.
En maints endroits du pays, et à cent lieues à la ronde au moins, une particularité toute gastronomique dans les habitudes de mes concitoyens leur a valu un surnom que je ne saurais taire, me semble-t-il, sans m’attirer de leur part de bien graves reproches: .... Mangeurs de crêpes!
Cette dénomination est certainement bien méritée, vû que la confection de ce mets succulent et tout-à-fait recherché a atteint ici le summum de la perfectibilité. Le progrès aura beau faire, il n’ira jamais au-delà! O vous tous, qui avez eu le bonheur de faire un séjour de quelques heures seulement dans mon heureuse patrie, élevez ici vos voix, et dites franchement si quelque part vous avez goûté un mets plus finement apprêté que les crêpes de l’Ile, avec le délicieux accompagnement de sucre ou de sirop d’érable!
De toutes les paroisses, villages et cantons du Canada qui obéissent au Gouvernement de Sa Très Gracieuse Majesté Britannique, St. Roch de Québec seul serait digne peut-être de concourir et de disputer cette palme glorieuse à l’Ile d’Orléans. Mais, St. Roch de Québec, après tout, n’est-il pas une colonie de l’Ile?
Comme on le voit, les noms et les titres de noblesse n’ont jamais fait défaut à ce coin de terre privilégié; et pourtant, il en est encore un, et des plus beaux, dont l’étymologie semble se perdre dans la nuit des temps. L’Ile des Sorciers! d’où vient celui-ci? Trois explications se présentent à l’esprit des curieux: il ne reste que l’embarras du choix.
Première explication.—Un nombre vraiment prodigieux de sources d’eau vive se rencontre dans l’Ile, et l’eau qu’elles fournissent est incomparable, sous le double rapport de la pureté et de la fraîcheur. Il s’ensuivrait donc que du mot source on aurait fait le mot sourciers, d’où par corruption, sorciers; explication pas mal à l’eau claire, comme dirait un philosophe.
Deuxièmement.—Environnés d’eau de toutes parts, ne pouvant communiquer avec la ville ou avec les paroisses voisines que par le moyen de canots ou de chaloupes, les habitants de l’Ile ont toujours été marins, comme ils le sont aujourd’hui; pour eux, c’est affaire de nécessité. Or, il fut un temps,—et ce temps n’est pas encore bien éloigné,—où le spacieux port de Québec ne s’enorgueillissait pas, comme aujourd’hui, de compter ses navires par centaines et par milliers; une voile dans le cours de l’année, parfois deux, et c’était tout. Il fut un temps encore où, de l’arrivée de ce seul navire, dépendait l’existence de la colonie entière, et on peut juger avec quelle impatience toute fébrile, on en attendait le signalement. Dans cette cruelle perplexité, on s’adressait donc tout naturellement aux gens de l’Ile, les plus expérimentés en fait de navigation, pour apprendre d’eux le jour approximatif de l’arrivée du bâtiment tant désiré. Ces derniers, fiers de l’importance qu’on voulait bien attacher à leurs présages, ne se faisaient pas prier longtemps pour donner une réponse quelconque; et comme parfois l’événement vint, fort à propos, confirmer leurs prédictions, il s’ensuivit tout naturellement qu’on leur décerna le glorieux surnom de sorciers.
Troisièmement.—Autrefois,—et les anciens de l’endroit se rappellent encore cet heureux temps!—la pêche à l’anguille était des plus abondantes sur nos côtes. Or, à cause du flux et du reflux de la marée, dont l’heure varie de jour en jour, il arrivait bien souvent que nos gens allaient faire la visite de leurs pêches au beau milieu de la nuit. Pour ce, on se rendait en grand nombre sur la grève, chacun portant à la main, pour s’éclairer dans sa marche et dans ses opérations, un falot de sapin enflammé.
Assurément, c’était un spectacle tout-à-fait curieux et féerique que de voir surgir à peu près au même instant, et à une heure assez avancée de la nuit, tous ces feux, allant, venant, se croisant les uns les autres, parfois se réunissant, pour s’éloigner et s’éparpiller encore.
Les gens de la côte du sud, connus sous le sobriquet peu aristocratique de Calumets,—lesquels calumets, au dire des habitants de l’Ile, n’ont jamais été sorciers—les gens de la côte du Sud ne tardèrent pas à voir du merveilleux et du surnaturel dans la présence de tous ces feux qui venaient ainsi sur la grève, et à une heure aussi indue, danser une ronde infernale sans doute. Bientôt ils s’en effrayèrent, bientôt même ils n’osèrent plus sortir de leurs maisons après une certaine heure de la soirée. Bref, il n’y eut plus moyen d’entretenir aucun doute à cet égard, et nos insulaires furent déclarés à l’unanimité possédés du mauvais esprit, coureurs de loups-garous, feux-follets, sorciers, etc, etc.
C’était un moyen comme un autre de se rehausser dans l’esprit de ces braves gens; il va sans dire que les gens de l’Ile ne furent pas assez sots que d’aller les désabuser.
Telles sont les trois explications de ce surnom d’Ile des Sorciers que l’Ile d’Orléans porte, et avec beaucoup d’honneur, depuis nombre d’années déjà. Je les transmets au lecteur telles qu’on me les a données, et d’avance, si besoin est, j’amène pavillon, et renonce à toutes chicanes que pourraient me susciter les érudits et les étymologistes, classe de personnages avec lesquels je ne veux avoir rien à démêler.
Quoiqu’il en soit, c’est un fait parfaitement avéré et des mieux établis que nulle contrée, en ce vaste univers, n’a eu d’aussi fréquents rapports avec les revenants et les esprits, que nulle terre n’a engendré autant de feux-follets, vu courir autant de loups-garous que l’Ile d’Orléans. Délicieuses histoires! contes charmants qui me rappellent si bien les précieux souvenirs de mon enfance, pourquoi donc vous laisserais-je dans l’oubli? Pourquoi ma plume se refuserait-elle à retracer ces légendes naïves qui peignent si bien la bonne foi de nos ancêtres, leur esprit si éminemment religieux, en même temps qu’elles rappellent leur noble origine.
Ceux qui nous ont légué ces contes qui, depuis quelques années, commencent à se perdre dans la mémoire du peuple, et que certains esprits forts pourront traiter peut-être de fables ridicules et surannées, ceux là, dis-je, les racontaient au bivac, au milieu de la forêt, à la belle étoile, entre le combat du jour et celui du lendemain. Et ces héros, soldats aussi fiers sur le champ de bataille que citoyens paisibles et honnêtes à la chaumière, versaient des larmes en les transmettant à leurs enfants: car, pour eux, c’était le souvenir de leur belle Normandie, de leur noble Bretagne qui se retraçait à leur esprit. Ainsi donc pourquoi ne les pas rappeler?
“C’est bien drôle tout de même, me disait dernièrement un de mes vieux amis de l’Ile, qu’on n’entend plus parler de ces choses là aujourd’hui. Dans le temps passé, c’est à peine si vous auriez pu rencontrer une seule personne dans nos endroits, qui n’eût délivré son loup-garou et conversé deux ou trois fois au moins avec les morts. Aujourd’hui, plus rien; mais aussi les temps sont bien changés!”
“Ainsi, par exemple, pour ne parler que d’une chose, les Demoiselles de mon temps ne portaient que des robes bien simples, des chapeaux bien unis, confectionnés de leurs propres mains; et pourtant, elles trouvaient toutes des épouseurs, même celles qui n’avaient pas de fortune, même celles qui ne comptaient sur la venue prochaine d’aucun héritage. Bon pied, bon bras, bon œil, avec des joues roses et une bouche toujours souriante, signe infaillible d’une santé irréprochable, telle était la dot de nos filles. De l’or! pourtant il y en avait, mais on le portait dans le gousset. Aujourd’hui, tous les goussets sont vides, et l’or ne se trouve plus que dans la toilette des dames. Aussi, elles en portent partout: sur les chapeaux, sur les gants, sur les mantilles, “sur les pieds, sur les mains, sur la tête,” comme dans la chanson de Malbrough. Encore, si c’était de l’or pur!”
“A part cela, on faisait des noces, et puis, en donnait-on de ces repas? Sur la table, pas de nappes, et pourtant tout le monde avait bon appétit; personne non plus ne se plaignait jamais de maux d’estomac.”
⁂
Les feux-follets, paraît-il, se manifestent aux mortels sous l’apparence de flammes dont la couleur est bien loin d’être uniforme, suivant le témoignage des connaisseurs;—les uns la disant bleue, d’autres, rouge, d’autres, verte. Peu importe, du reste, la couleur; c’est un détail qui regarde les feux-follets, et personne n’a le droit de leur imposer des règles touchant cette question de pure formalité.
Mais il est un point sur lequel tout le monde est parfaitement unanime, point important que personne n’a encore songé à contester sérieusement: c’est que le feu-follet, dont le vol est fort rapide et les zigzags très nombreux, n’a d’autre ambition, d’autre désir que d’attirer les gens dans les précipices. Triste prérogative que possède la lumière du feu-follet, en commun avec bien d’autres lumières du siècle, moins brillantes peut-être, mais dont les dangers de séduction ne sont pas moins à redouter.
Rien qu’à cette particularité, qui pourrait douter encore que le feu-follet ne soit autre chose que le malin esprit? Aussi, la présence de ces diablotins enflammés aurait-elle été pour les habitants de l’Ile une source bien amère de soucis et de desagréments, si leur esprit éminemment inventif n’eût découvert, depuis longtemps déjà, deux moyens aussi simples qu’infaillibles de se débarrasser de leur présence importune.
C’est un secret cela,.... et à titre d’initié, mon indiscrétion me sera-t-elle jamais pardonnée? Pourtant, divulguer ces arcanes, n’est-ce pas rendre un service éminent à la société, dont quelques-uns des membres peuvent bien aussi, un jour ou l’autre, venir en contact avec les feux-follets?
A tout risque, voici la recette: Piquez une aiguille ou votre couteau sur la clôture, et le feu-follet s’arrête tout court, comme par un charme. Alors, de deux choses, l’une: ou bien le feu-follet se déchire sur le couteau, et par là même, se délivre; ou bien, il s’épuise en efforts interminables pour passer par le trou de l’aiguille—tour de force aussi difficile à exécuter pour le feu-follet que pour le commun des mortels,—et dans l’intervalle, vous avez le temps de regagner votre demeure et de vous mettre à l’abri.
Mais, ce n’est pas tout; et le diable trouvait bien d’autres moyens encore de s’immiscer dans les affaires des gens de l’Ile.
C’est ainsi, par exemple, qu’on le rencontrait parfois au bal, sous l’apparence d’un beau Monsieur, tout habillé de drap fin, des pieds à la tête. Dans cette circonstance, il gardait toujours ses gants pour cacher ses griffes, et son chapeau, pour dissimuler ses cornes; et d’ordinaire, il dansait avec la plus fringante des filles de la compagnie. Puis, au beau milieu d’une danse, voici ce qui arrivait: tout-à-coup, un cri perçant se faisait entendre, et le beau Monsieur passait comme un éclair à travers une des fenêtres, emportant avec lui quelque menu détail du ménage, comme le four, par exemple. Quant à la demoiselle, elle en était quitte pour un coup de griffe. Il ne sera pas sans intérêt d’ajouter que la présence accidentelle d’un enfant au milieu de l’appartement ne manquait jamais de trahir la présence du diable, tant le pauvre innocent criait et pleurait.
C’était surtout quand on allait quérir le prêtre pour quelque malade, durant la nuit, que le diable en faisait de ces efforts—j’allais dire surhumains—pour retarder l’arrivée du ministre de Dieu. Comme de raison, il jouait gros jeu alors, puisqu’il s’agissait pour lui ni plus ni moins que du gain ou de la perte d’une âme.
Ainsi, c’étaient les chevaux, qui, tout-à-coup, et sans aucun à-propos, se trouvaient dételés; ou bien, le harnais se retournait et de lui-même, bout pour bout; ou bien encore c’étaient des chandelles tout allumées qui apparaissaient sur la tête du cheval.
Aussi, en prévision de toutes ces aventures diaboliques, ne devait-on jamais aller quérir le curé, qu’avec deux voitures: si quelque accident survenait à l’une, l’autre, au moins, était encore disponible.
Combien de fois encore n’est-il pas arrivé qu’en allant à l’écurie, le matin, pour faire son train, on ait été tout surpris de trouver son cheval harassé, épuisé, blanc d’écume, avec le crin du cou et de la queue tout tressé. Il aurait fallu être bien naïf et bien sot pour ne pas reconnaître encore là un de ces tours du Lutin, qui profitait de la nuit et de l’absence des gens pour se promener à leurs dépens. Néanmoins, il est consolant d’ajouter que pour lui faire passer cette fantaisie, il suffisait de verser un minot de son à la porte de l’écurie. Le fait est que le Lutin, homme d’ordre avant tout, avait le soin, en prenant congé du cheval, de remettre chaque chose en sa place, comme il l’avait trouvée: tâche dont il s’acquittait, du reste à merveille, et en homme tout-à-fait scrupuleux. Or, pour parvenir à l’écurie, désormais, il lui fallait bien mettre le pied sur le son dont les grains se trouvaient par là dérangés. Force lui était donc de remettre, un à un, tous ces milliers de grains en leur place, comme ci-devant; durant ce temps, l’aurore venait, et adieu la promenade!
Heureusement pour les sorciers de l’Ile, qu’une occasion, comme il ne s’en présente guère, pas même dans la vie des sorciers, s’offrit un jour à eux, pour faire expier au diable une partie au moins des mécomptes dont il s’était rendu coupable à leur égard.
Dans ce temps-là, on construisait l’Eglise de St. Laurent. Or, près de cette église, se trouvent les côteaux de St. Laurent dont la pente est abrupte et la montée difficile. Les chevaux ordinaires en avaient tout leur roide à charroyer la pierre en ces endroits, et les habitants se plaignaient amèrement.
Le constructeur, fin matois, et homme bien éduqué, leur annonça donc un jour, pour faire cesser leurs plaintes, qu’il allait leur procurer un cheval bien fort, si fort qu’il pourrait traîner, à lui seul, la charge de quatre chevaux ordinaires.
Aussitôt dit, aussitôt fait: voilà notre homme qui s’enferme pendant quelque temps à l’écart, sans doute pour lire un passage du petit Albert. C’est un livre bien extraordinaire que celui-là, et qui contient choses fort merveilleuses, entre autres, un chapitre pour commander et faire venir le diable; ce chapitre, paraît-il, est écrit avec des croix!
Peu de temps après, l’entrepreneur revint, conduisant par la bride, un cheval si beau, si beau qu’on n’en avait jamais vu de pareil. Et alors, il dit aux habitants: “Or ça, faites-le travailler sans pitié; mais pour aucune raison au monde, il ne faut le débrider. Qu’il piaffe, qu’il rue, qu’il hennisse, n’importe! ne lui ôtez pas sa bride, pas même pour le faire boire.”
Et alors, le cheval fut confié aux mains d’un jeune homme, qui se mit à charroyer la pierre; et tout allait à merveille.
Mais, pendant tout ce temps, le pauvre animal avait l’air si fatigué, si exténué, il paraissait tant souffrir du besoin de boire, que, vers le soir, son conducteur—jeune gars inexpérimenté comme tous ceux d’alors, et probablement ceux d’aujourd’hui—se laissa toucher de pitié, et le conduisit au ruisseau voisin pour le faire boire. Jusque-là, ce n’était pas mal; mais comme le pauvre animal faisait mine de ne pouvoir avaler avec sa bride, voilà notre étourdi qui la lui enlève; et aussitôt, plus de cheval! il se précipite dans le ruisseau voisin, transformé en anguille, et........ cours après.
Heureusement qu’à cette heure, les pierres étaient déjà toutes charroyées, à l’exception d’une seule qui depuis lors, dit-on, a toujours manqué à l’édifice.
La lecture de ces contes n’aura pas manqué, sans doute, d’attirer un sourire de pitié sur les lèvres de plusieurs.—Les superstitions sont condamnables, c’est vrai; mais, après tout, chacun son goût.
Mieux vaut un peuple qui croit trop qu’un peuple qui ne croit pas assez; et à tout prendre, je préfère les feux-follets et les loups-garous du peuple, aux mediums et aux tables tournantes des philosophes du siècle et des gens d’esprit. Dans les premiers, au moins, je trouve une certaine poésie, et en les examinant de près, un certain fond de moralité; dans les seconds, je ne sais trop ce que j’y trouve.
Nous venons de laisser à notre droite le Trou de St. Patrice, hâvre spacieux, où les navires qui remontent ou descendent le fleuve, viennent chercher un abri sûr et commode dans les tempêtes. Sur une carte de 1689, que je dois à l’obligeance de M. l’Abbé Ferland, je vois ce hâvre indiqué sous le même nom qu’il porte aujourd’hui. Quand et pourquoi ce nom lui fut-il donné? C’est ce qu’on ignore complètement.
Pas un navigateur auquel le Trou de St. Patrice ne soit parfaitement connu; et il y a là plus d’une réunion bruyante de ces hardis marins, à l’hôtel tant renommé de Mme Cookson, cette seconde providence des navigateurs canadiens, et des matelots anglais: aujourd’hui, cette maison n’est qu’une mâsure.
A propos, j’ai omis d’avertir que depuis quelques temps déjà nous avons laissé St. Pierre derrière nous, et que nous foulons maintenant le sol de St. Laurent,—Halte ici, gastronomes et gourmets! Inclinez-vous et saluez.
Au doux parfum qui s’exhale des bois, des côteaux, des prairies; aux suaves émanations qui semblent s’échapper des portes entrebâillées, n’avez-vous pas deviné, n’avez-vous pas pressenti que nous sommes en pleine patrie du fromage raffiné?—Soyons juste, pourtant, et hâtons-nous d’ajouter que la paroisse de St. Laurent ne possède pas exclusivement ce privilège, cet honneur, mais qu’elle les partage amplement avec St. Pierre.
Dûssent les habitants de ces deux paroisses en crever de dépit; dût l’Ile d’Orléans tout entière se lever comme un seul homme, me déclarer une guerre acharnée, me renier comme un de ses enfants, avant tout, je dois la vérité; et, quoiqu’il m’en coûte, il est un fait que je ne saurais taire, et que je ne tairai point.
Bien qu’il paraisse extraordinaire, tout-à-fait incroyable, ce fait n’en est pas moins un fait réel,...... en un mot, c’est un fait accompli!
Qu’il soit donc notoire que cette merveille de la cuisine humaine, (le fromage raffiné!) a, d’une manière ou d’une autre, jugé à propos de franchir les mers, et qu’elle a établi son domicile à Lyon même, au beau milieu de la Belle-France.
Seulement, en se naturalisant français, le délicieux produit de l’Ile d’Orléans a cru devoir s’anoblir, et assumer un nom tout-à-fait aristocratique: Mondor!
Et ce mondor, ce n’est pas une imitation, une simple contre-façon, c’est le fromage raffiné lui-même, tout pur, et avec tous ses attributs, tels que: odeur.... sui generis; croûte légèrement jaunâtre, tant recherchée des véritables amateurs; plus, ces nombreux petits sillons, laissés à la surface par les linges si proprets dans lesquels on le tient soigneusement enveloppé.
C’était un riche souvenir de la patrie absente que celui-là: aussi, pas n’est besoin de dire que je sus le mettre à profit.
⁂
St. Laurent portait autrefois le nom de St. Paul de l’Arbre sec, et ne formait qu’une seule et même paroisse avec St. Pierre, qui, pour cette raison, était désignée sous le nom de St. Pierre et St. Paul. D’après cette carte de 1689, dont j’ai parlé plus haut, l’église n’occupait pas alors l’emplacement où on la voit aujourd’hui: elle était située sur les côteaux.
Cette carte, due au crayon du Sieur de Villeneuve, Ingénieur du Roy, est intéressante à plus d’un titre. Non seulement les rivières un peu considérables, mais encore tous les ruisseaux de l’Ile, jusqu’aux plus petits, sans exception, y sont marqués avec une rare fidélité. Les noms de chaque habitant, avec la terre qu’ils occupaient, sont aussi scrupuleusement indiqués; et plusieurs de ces terres, fidèlement transmises de père en fils, sont encore en la possession des descendants de ces premiers propriétaires.
Quant aux noms, ce sont la plupart de ceux que l’on y remarque encore de nos jours, à l’exception de quelques-uns qui ont disparu complètement, et sont transportés ailleurs. D’autres, au contraire, très-répandus aujourd’hui dans l’Ile, comme ceux des Lachance et des Blouin, y étaient très-rares, à cette époque.
St. Laurent est séparé de St. Jean par la Rivière Maheux, nom que je vois encore indiqué sur cette même carte de 1689. C’est un habitant de l’Ile, établi autrefois sur les bords de cette rivière, qui lui a donné son nom.
Un événement sanglant, et d’une bien grande importance pour la colonie, s’est passé autrefois en cet endroit même: en voici les détails.
On était alors en 1661, année d’épreuves pour la Nonvelle-France, s’il en fut jamais. Les Iroquois étaient partout, depuis Tadoussac jusqu’à Montréal, pillant, brûlant, massacrant tout ce qui leur tombait sous la main. Treize Français d’abord sont enlevés à Montréal, au milieu de leurs travaux. Un peu plus tard, dix autres citoyens de la même ville disparaissent, et ce dernier enlèvement est suivi, coup sur coup, de plusieurs autres.
Aux Trois-Rivières, quatorze Français furent pris en une seule fois; et les Relations nous donnent le récit de trente Algonquins et de deux Français, qui, allant en traite, se battirent pendant quarante-huit heures contre quatre-vingts Iroquois.
Quant aux habitants de Québec, l’Ile d’Orléans devait être, surtout, le théâtre de leurs désastres; et leur épreuve fut bien sensible puisqu’ils perdirent M. de Lauzon, Sénéchal de la Nouvelle France, et fils du Gouverneur.
Ce brave jeune homme, rompu aux guerres du pays, irrité de la conduite des Iroquois, se décide à leur donner la chasse, et se dévoue pour le salut de la colonie.
Il part de Québec, en chaloupe, avec huit compagnons seulement, et va prendre terre à la Rivière Maheux.
Un parti d’Iroquois était caché en embuscade en cet endroit même, et bientôt il fallut en venir aux mains.
Sur la grève se trouvait un rocher. Les Iroquois parviennent à s’y rendre, et s’en servent comme d’un rempart, d’où ils peuvent tirer à leur aise sur les Français, sans aucun danger pour eux-mêmes.
Pour comble de malheur, la chaloupe de M. de Lauzon s’échoue, de sorte que les Français se trouvent ainsi exposés à tous les coups, sans aucun abri.
Dans cette cruelle position, il ne restait qu’un parti à prendre: se faire tuer sur place.
Les Français commencent par faire une prière en commun, prière qu’ils répètent trois fois. Durant ce temps, leurs ennemis, toujours à l’abri derrière leur rocher, les somment par trois fois de se rendre, leur faisant mille et mille promesses. Mais on sait depuis longtemps ce que valent leurs promesses; on n’en tient aucun compte, et on leur riposte à coups de fusil.
M. de Lauzon fut tué le premier, et ses compagnons eurent la même bonne fortune, à l’exception d’un seul qui, blessé au bras et à l’épaule seulement, fut emmené en captivité où on le fit mourir au milieu des tourments.
Un Français captif, échappé miraculeusement des mains des Iroquois, apprit plus tard toutes ces nouvelles à la colonie.
Les contours de la Rivière Maheux, comme ceux de la Rivière Lafleur, de St. Jean, sont bordés d’arbres et présentent un aspect des plus pittoresques.
Au bas de la première côte se trouve un pont jeté sur la rivière; c’est le trait d’union entre St.-Laurent et St. Jean.
⁂
St. Jean! Pourquoi donc, à ce seul nom, mon cœur a-t-il tressailli? Pourquoi donc, depuis longtemps déjà, mes regards cherchaient-ils avec tant d’avidité ces maisons à la toiture blanche et aux pignons rouges, sur lesquelles mes yeux se reposent maintenant avec une si délicieuse volupté? Quelle influence secrète, quelle puissance invisible se révèle donc dans ces quelques grains de sable que l’on appelle son village, sa paroisse, sa patrie! Je ne le sais pas; mais je le sens, je le comprends, et c’est assez.
Voilà, voilà la grève où jeune enfant, j’aimais tant à prendre mes ébats, au milieu d’une troupe de compagnons mutins; tantôt, passant des heures entières à compter les nombreux ricochets qu’une pierre, lancée d’un bras souple et nerveux, décrivait sur la surface paisible et dormante du grand fleuve; tantôt, marchands improvisés, établissant des comptoirs, où s’échangeaient avec une gravité imperturbable, sous la forme présumée de sucre, de thé, de café, ou autres articles précieux, le sable fin d’une plage sans pareille, enfermé dans de blanches coquilles; tantôt, navigateurs intrépides, nous confiant imprudemment, dans de frêles embarcations, aux flots de la mer qui toujours semble reconnaître le léger fardeau qu’elle porte, et se refuse à engloutir les petits enfants.
Ils sont encore là, debout, au pied du côteau, ces grands érables, où dénicheurs barbares, nous allions dérober ces nids d’oiseaux, si légers, si soyeux, avec toutes leurs richesses, douces espérances d’une mère aux abois, que d’un œil stoïque, nous regardions voltiger au-dessus de nos têtes, en poussant des cris plaintifs et prolongés!
Là bas, sur la côte—la Côte de l’Eglise—je l’entrevois cette maison d’école, où tant de fois, écolier indocile, je me suis déclaré en révolte ouverte contre les règles de la grammaire et du silence—du silence surtout, cet ennemi implacable, avec lequel, depuis même, je n’ai jamais pu composer ni me réconcilier.
Voici l’Eglise où ma bonne et pieuse mère, aux temps de Noël, m’amena si souvent, pour voir l’enfant Jésus, et lui offrir une légère aumône; voici le sanctuaire, où plus tard, revêtu du blanc surplis, je pris place avec les autres enfants de mon âge autour des saints autels. C’était un beau jour que celui-là: jour de Pâques 1841! comment donc aurais-je pu oublier une semblable date?
A dix pas de l’Eglise.... le cimetière! Comme elle s’est accrue, depuis quelques années, cette poussière noire et humide du vieux cimetière! Comme elles sont toujours luxuriantes et pleines de vie ces herbes, ces fleurs amies du champ des morts, et dans lesquelles renaissent sans doute, et se vivifient les cendres de ceux qui nous furent chers. Comme elles sont nombreuses et serrées, ces petites croix noires, ces planches funèbres, où se dresse toujours à mes yeux, ce mot inexorable consacré exclusivement aux morts: Ci gît!
La maison natale! l’Eglise! le cimetière!.... le cimetière surtout, voilà la patrie!
Un assez grand nombre des habitants de la rive sud de l’Ile sont unis avec ceux de la Côte du Sud par les liens de la parenté ou de l’amitié; et cette union a donné origine à une cérémonie bien touchante qui se renouvelle régulièrement, au jour de l’an de chaque année, entre les deux rives opposées.
Ce jour là, vers cinq heures et demie ou six heures du matin, vous voyez apparaître sur les grèves de St. Valier, de St. Michel et de Beaumont, un grand nombre de feux, auxquels correspondent également d’autres feux allumés à St. Jean et à St. Laurent.
Toutes communications, entre les deux rives, étant interrompues durant la rude saison de l’hiver, c’est par le moyen de ces feux que les parents et les amis font l’échange des souhaits du jour de l’an. C’est par ce moyen encore que les enfants demandent la bénédiction à leurs parents, et que ces derniers accordent leur bénédiction à leurs enfants.
La bénédiction paternelle! touchante pratique devenue bien rare aujourd’hui, mais à laquelle le Bas-Canada français reste encore fidèle. Tâchons de la conserver longtemps.
C’est aux enfants de la maison qu’est confié ordinairement le soin de transporter sur la grève la paille destinée au signal, c’est sur eux aussi que l’on se repose pour l’allumer. Inutile d’ajouter qu’ils s’acquittent de cette tâche à merveille, et que cette cérémonie n’est pas pour eux un des souvenirs les moins agréables du jour de l’an.
Avant de franchir la limite qui sépare St. Jean de St. François, une troisième rivière se présente à notre observation. Elle est généralement connue sous le nom de Rivière Belle-fine; son véritable nom est Dauphine.
En face de St. François, se dessine l’Ile Madame, où tant de pauvres gens ont perdu un temps si précieux à la recherche de trésors introuvables, avec l’aide de chandelles de mort, achetées à grand prix chez quelque médecin nécessiteux, ou avec le secours tout-puissant de branches de coudrier, qui paraît-il, ont la manie de s’incliner sur le terrain qui recèle un trésor. Comme s’il n’y avait que les coudriers qui s’inclinent devant une semblable majesté!
Non loin de l’Eglise, on peut voir les restes d’anciennes fortifications, qui furent construites, paraît-il, en 1759.
Pendant bien des années, suivant les récits populaires, des bruits étranges se sont fait entendre en ces lieux, au milieu des airs, et par les nuits sombres; c’étaient des cliquetis d’armes, des hennissements de chevaux, des coups de canon et de fusil; enfin, tout le tintamarre qui constitue une chasse-galerie dans toutes les règles.
Le fait est que l’Ile d’Orléans a été assez malmenée dans les diverses expéditions que les Anglais ont tentées contre la colonie. Les habitants se sauvaient alors dans les bois, et livraient leurs maisons à la merci de l’ennemi qui ne se faisait pas faute de les piller et de les brûler. Une maison de St. Jean, entre autres, le manoir seigneurial, a porté longtemps les traces des boulets ennemis. Ce fut près de l’Eglise de St. Laurent que Wolfe débarqua le 27 juin 1759. On raconte à ce propos un trait qui fait le plus grand honneur à nos vainqueurs; et comme les traits de cette espèce ne se rencontrent pas à chaque page de leur histoire, hâtons-nous de recueillir celui-ci.
En arrivant près de l’Eglise, Wolfe et ses officiers trouvèrent un placard qui priait les Anglais de respecter l’édifice. Et...... les Anglais le respectèrent! sachons-leur en gré.
Une jeune fille de St. François s’est rendue tristement célèbre autrefois dans l’histoire de la colonie.
On était alors en 1695 ou 1696, et le gouverneur de la Nouvelle France, M. de Frontenac, se préparait à une expédition contre les Iroquois.
A cet effet, les miliciens avaient été convoqués, et parmi ces derniers, se trouvaient plusieurs jeunes hommes de St. François, entre autres le frère et l’amant de notre héroïne.
Cette jeune fille était âgée de seize ans. Les idées belliqueuses du gouverneur étaient donc loin d’être partagées par cette Philaminte, et voici le stratagème qu’elle crut devoir adopter pour faire avorter le projet du gouverneur, et empêcher, par là, le départ de son amant.
Après avoir échangé son habillement de femme pour les vêtements de son frère, et s’être travestie en homme, elle se rend à pied au bout de l’Ile.
Là, elle trouve un canotier qui consent à la traverser, en vue des nouvelles importantes qu’elle prétend avoir à communiquer au gouverneur.
Durant le trajet, elle raconte au canotier qu’elle vient des prisons de Boston, où elle a été détenue pendant trois ans, et d’où elle est parvenue à s’échapper. Elle lui dit qu’elle a passé par chez le sieur de St. Castin, lequel lui a remis un paquet de lettres à l’adresse du gouverneur, et a bien voulu mettre à sa disposition un canot et un sauvage pour la conduire à Québec; qu’elle a passé la nuit en bas de l’Ile, où son canot lui a été enlevé, et que dans l’espoir de le retrouver, elle a monté par le nord de l’Ile, le sauvage, par le côté opposé.
A tous ces détails, elle ajoute que le Sieur de Villebon est mort de maladie, que d’Iberville étant allé se battre devant Boston même, avec ses deux bâtiments, a été fait prisonnier et brûlé, et qu’elle-même a été forcée de prêter la main à cette barbare exécution. Surtout, elle ne manque pas de faire sonner bien haut que les Anglais, au nombre de 10,000 à 11,000, se dirigent vers le Canada; qu’en passant à la Rivière du Loup, elle a vu quatre frégates anglaises à la hauteur de Tadoussac, et que quarante autres doivent partir incessamment de Boston.—En faisant redouter une attaque du côté de Québec, il était clair, pour la jeune fille, que le gouverneur renoncerait à son projet, et qu’elle, de son côté, ne serait pas séparée de son amant.
Rendue à Québec, elle n’a rien de plus pressé que de répandre toutes ces nouvelles qui ne manquent pas de jeter le plus grand émoi dans toute la ville.
Elle se rend ensuite chez le gouverneur pour y débiter les mêmes sornettes; mais heureusement qu’ici, on ne tarda pas à découvrir son stratagème. Elle fut conduite en prison; et les détails manuscrits de ce curieux procès sont en la possession de la Société Historique de Québec, où je les ai puisés.
De même que la paroisse de St. Pierre, St. François est divisée en deux parties, sud et nord; cette dernière est connue sous le nom d’Argentenay.
Argentenay est peut-être le coin du Canada où se sont le mieux conservés les us et coutumes du bon vieux temps passé; il suffit de pénétrer dans une seule maison pour s’en convaincre. Tout y respire un parfum d’antiquité, qui, vraiment, fait du bien au cœur et réjouit l’âme.
Les maisons sont généralement divisées à l’intérieur en deux grands compartiments d’abord; le premier sert de cuisine, de salle à manger, de chambre et de séjour ordinaire.
Dans un coin de cette première salle se voient le métier et les navettes qui servent à tisser le lin ou la laine, et à fabriquer l’étoffe ou la toile du pays; dans un autre coin, la buche, ce pétrin du laboureur canadien.
Plus loin, un ou deux coffres de bois, rouges ou bleus; puis une table et des chaises.
Au plafond, et au-dessus du poële, en hiver, quelques planches ou autres pièces de bois suspendues sur des tringles, ou à l’aide de courroies, et qui sont mises là pour sécher. Car, le cultivateur d’Argentenay, comme celui de tout le Bas-Canada, est un factotum général, et peut faire honneur à tous les métiers: menuisier, cordonnier, charron, sellier, et, au besoin, le meilleur soldat du monde.
A une des poutres du plafond, vieilles poutres noircies par le temps, se voient d’ordinaire retenus par de grands clous, un ou deux fusils de chasse.
Sur le foyer, la marmite et autres ustensiles de cuisine; dans la cheminée, la crémaillère, qu’on appelle ici brinbale.
Les fenêtres sont presque invariablement garnies de petits rideaux blancs.
Du reste, la propreté la plus exquise règne dans tout l’appartement; et la grande ambition de la maîtresse de céans ou de la grande fille du logis, est de tenir le plancher toujours net, toujours luisant, toujours jaune, suivant l’expression reconnue.
L’autre pièce est ordinairement divisée en trois: une grande salle d’abord, la chambre de compagnie, qui n’est ouverte que dans les grandes circonstances, comme pour recevoir Monsieur le Curé, lors de la quête de l’enfant Jésus, ou lorsque la demoiselle de la maison, aux grandes fêtes, se met en frais de recevoir, avec beaucoup d’éclat, son cavalier. C’est toujours dans cette salle, encore, la principale pièce de la maison, que les morts sont exposés, en attendant l’heure suprême du départ pour le service funèbre.
Dans un des angles de cette chambre, vous remarquez l’horloge antique, rigoureusement couronnée de ses trois boules de cuivre, et sur la muraille, blanchie à la chaux, quelques anciennes gravures, représentant, par exemple, toute la scène de l’enfant prodigue, ou autres.
Deux chambres plus petites s’ouvrent ordinairement sur ce dernier appartement: ce sont des chambres à coucher, des cabinets.
A Argentenay, pas plus tard qu’en 1852, j’ai entendu appeler du nom de Bastonnais les Anglais du pays, et un vieillard me parla du roi, comme si Louis XIV eut été encore en parfait état de santé!
Avec tout cela, le bonheur règne à Argentenay; et je souhaite de tout mon cœur à ces braves gens de rester longtemps encore ce qu’ils sont. Mieux vaut cent fois cette naïve simplicité qui les distingue, que cette prétention ridicule et de mauvais aloi, importée dans certaines paroisses, par le contact trop fréquemment répété des habitants, avec ce qui compose la lie des villes.
⁂
Ste. Famille est la cinquième et dernière paroisse de l’Ile. Elle possède un des plus anciens couvents qui aient été fondés dans le pays par les Sœurs de la Congrégation. Ce couvent fut établi par la Sœur Marguerite Bourgeois elle-même, en 1685; et les deux premières religieuses qui y commencèrent l’enseignement, furent les sœurs Anne Hioux et Marie Barbier.
Comme il n’y avait aucune maison préparée pour les recevoir, ces bonnes religieuses établirent d’abord leur domicile dans une maison particulière, à une assez grande distance de l’Eglise. Elles eurent beaucoup à souffrir du froid et du mauvais temps, surtout durant les premières années de leur séjour dans l’Ile. Mais, comme disent les Relations, “des filles tendres et délicates qui craignent un brin de neige en France, ne s’étonnent pas ici d’en voir des montagnes. Un frimas les enrhumait dans leurs maisons bien fermées, et un gros et grand et bien long hiver, armé de neiges et de glaces, depuis les pieds jusqu’à la tête, ne leur fait quasi autre chose que de les tenir en bon appétit.”
La maison de pierre, voisine du presbytère, où sont établies aujourd’hui les Sœurs de la Congrégation, fut bâtie vers la fin du 17e siècle par M. Lamy, premier curé de Ste. Famille, qui consacra à cette bonne œuvre toute sa fortune et ses économies.
N’oublions pas de mentionner que c’est surtout sur les grèves de la Sainte Famille et du Château-Richer que tant de disciples de Nemrod viennent donner cours à leur humeur sanguinaire.
Pourtant, d’après les rapports qui nous en arrivent de temps à autres, la chasse s’y fait, paraît-il, d’une manière très-pacifique et très-humaine, et le gibier n’a qu’à se louer des bons procédés des chasseurs Québécois.
On dit que les effusions de sang y sont aussi rares que dans le fort Sumter; d’aucuns vont même jusqu’à prétendre que c’est toujours le même canard, toujours la même sarcelle, toujours la même bécassine, qui vient régulièrement, à la même époque, servir de but aux coups inoffensifs de nos chasseurs. C’est fort bien.
Ste. Famille, comme St. Pierre et St. François, est habitée presque exclusivement par des cultivateurs. A St. Jean et à St Laurent, au contraire, on compte un très-grand nombre de pilotes; il y en a plus de trente dans la première de ces deux paroisses.
L’étranger, qui parcourt nos campagnes canadiennes, peut toujours, et de lui-même, reconnaître le domicile du Capitaine de Milice de l’arrondissement; car, ce dernier, à l’exclusion de tous autres, a le droit de posséder un mai en face de sa maison, comme marque distinctive. Mais, si l’on appliquait cette règle à St. Jean de l’Ile, on tomberait inévitablement dans une grande erreur; car, devant presque chaque maison de pilotes, se voit également un mât qui sert à hisser un pavillon, en réponse au salut que ces marins font à leurs femmes et à leurs enfants lorsqu’ils descendent ou remontent le fleuve.
Il n’est donné qu’à un bien petit nombre de pilotes de mourir au sein de leurs familles, entourés des soins ordinaires de leurs parents et de leurs amis, et munis de ces consolations de la religion qui retrempent l’âme si fortement, à l’instant suprême du départ pour le grand voyage de l’éternité. Ainsi, sur à-peu-près trente-neuf pilotes de St. Jean, qui ont été moissonnés dans l’espace des trente-deux dernières années, huit seulement sont morts dans leurs lits; tous les autres se sont noyés.
Ce serait à n’en plus finir que de rapporter tous les naufrages qui, à diverses époques, sont venus jeter la tristesse et le deuil dans nos paroisses de l’Ile. J’en ai déjà rapporté deux; il en est encore un très célèbre qui eut lieu entre les deux Eglises, en 1792, et fut occasionné par le chavirement d’une chaloupe de St. Jean. Sur treize passagers, onze se noyèrent, parmi lesquels se trouvait M. Hubert, curé de Québec.
M. Hubert devait être bien populaire parmi nos habitants de la campagne, si l’on en juge par le grand nombre de ses portraits que l’on voit encore dans les maisons de l’Ile et de la côte du Sud.
⁂
Après Ste. Famille, vient St. Pierre, qui comprend dans sa circonscription, l’Anse-du-fort et le Bout de l’Ile, dont j’ai déjà parlé.
St. Pierre communique avec St. Laurent, au moyen de la route dite des Prêtres, nom sous lequel elle est désignée sur cette carte de 1689.
Cette route a été témoin autrefois d’un épisode assez intéressant, dont les détails sont consignés dans les archives de St. Pierre, et que je dois, ainsi que bien d’autres renseignements rapportés dans ce travail, à l’obligeance de M. l’Abbé Ferland, professeur d’Histoire du Canada, à l’Université-Laval.
Ainsi que je l’ai déjà mentionné, St. Laurent portait autrefois le nom de St. Paul. Un jour, Monseigneur de St. Valier fit présent à cette paroisse d’une relique précieuse enfermée dans un reliquaire d’argent: cette relique consistait en un petit morceau de l’os du bras de l’apôtre St. Paul.
Quelques années plus tard, St. Paul ayant pris le nom de St. Laurent, St. Pierre prit celui de St. Pierre et St. Paul. Alors, à la demande de M. Daurie, curé de cette dernière paroisse, le curé de St. Laurent échangea la relique de St. Paul pour une autre que M. Daurie lui donna.
Cet échange, fait contre le gré des habitants de St. Laurent, était loin de leur plaire. Aussi, à quelques temps de là, certains habitants de St. Laurent jugèrent-ils à propos d’aller enlever, de nuit, leur précieuse relique, tout en reportant à St. Pierre celle que leur curé avait reçue en échange.
De là, grande chicane entre les deux partis. La question fut enfin décidée par l’Evêque, qui ordonna que les deux paroisses fussent mises en possession de leurs reliques respectives. Pour cela, les habitants de ces deux paroisses devaient se rendre en procession, chacun de leur côté, jusqu’au milieu de la Route des Prêtres, où l’échange devait avoir lieu; c’est ce qu’on fit; et la grande croix noire que l’on voit aujourd’hui au milieu de cette route, indique l’endroit où l’échange a eu lieu.
⁂
Il n’est peut-être aucune partie du pays dont l’histoire particulière se lie aussi intimement à l’histoire générale du Canada que l’Ile d’Orléans et la côte de Beaupré.
A cause de leur proximité de Québec, ces deux localités se peuplèrent les premières, et se développèrent très-rapidement. “Elles fournirent de fort bonne heure, dit M. Rameau, des émigrants pour le reste du Canada, et peuvent être considérées comme les pépinières de la colonie.”
Pendant bien des années, la population de l’Ile l’emporta de beaucoup sur celle de Québec; ainsi, en 1681, l’Ile comptait 1081 habitants, Québec, 880 seulement; la population totale du pays étant alors de 9710. Aussi tard qu’en 1706, les populations de Québec et de l’Ile étaient dans le rapport suivant: Québec, 1771, l’Ile, 1091. D’après le recensement de 1861, la population de l’Ile d’Orléans est de 4802.
L’Ile peut se vanter avec raison d’avoir pris une part large, et bien large, dans tous ces hauts faits d’armes dont les Canadiens-Français ont si justement le droit de s’enorgueillir. Ainsi, sur 6621 miliciens qu’a fournis la Province de Québec en 1750, 624 étaient de l’Ile; et avant cette époque, le nombre des miliciens fournis par l’Ile d’Orléans a dû être, proportionnellement, beaucoup plus considérable encore.
———
CONCLUSION.
Plusieurs des faits que je viens de rapporter sont éparpillés çà et là, et comme noyés dans les détails si nombreux que contiennent les Relations des Jésuites ou autres documents importants de l’Histoire du Canada. D’autres sont extraits de manuscrits très rares, et même uniques, qui, un jour ou l’autre, peuvent bien se perdre, comme on n’en a eu déjà malheureusement que trop d’exemples. D’autres enfin ne sont consignés nulle part, la tradition seule s’étant chargée de nous les transmettre. En groupant les uns, et en recueillant les autres, j’ai cru qu’un tel travail pourrait ne pas manquer d’une certaine utilité. Puissé-je ne m’être pas trompé!
F. A. H. LaRUE.
OU
LES MALHEURS DE L’ÉMIGRATION CANADIENNE.
———
La nuit tombait, tiède et sereine,
Sur les rives du Saguenay:
Dans ses cavernes enchaîné,
Le vent retenait son haleine;
Endormant son bruissement,
Sur le bord des grottes profondes,
Se jouant dans les algues blondes,
Le flot se berçait mollement;
Et, du haut de la berge immense,
Les ombres, planant en silence
Sur le gouffre, en vastes arceaux,
A la voûte d’azur sans voiles,
A la lumière des étoiles
Disputaient le miroir des eaux.
C’était l’heure où le daim timide
Vient savourer l’onde et s’enfuit;
Où le pluvier, d’un vol rapide,
Cherche son gîte pour la nuit;
Où Philomèle, solitaire,
Charme l’écho qui lui répond;
Où le loup-cervier vagabond
Va s’élancer de son repaire....
Mais qu’importe aux hôtes des bois
Tout l’éclat que ton sein recèle,
Oh! nuit pleine de douces voix?
Ce n’est pas pour eux qu’étincelle
Ton œil grave et tendre à la fois....
C’est pour attirer sur le fleuve
Deux enfans que l’Amour conduit
Vers cette source, loin du bruit,
Où le trop faible cœur s’abreuve:
Jude appareillant le bateau
Où sourit l’ange qu’il adore:
Brune fleur sur le point d’éclore,
Grazia, l’orgueil du hameau!....
Jude avec son calme sourire,
Ses yeux bleus dont l’éclat respire
La douceur et la fermeté,
Sa pensive et mâle figure
Et cet air fier dont la nature,
A son insu, l’avait doté:
Grazia, frêle sensitive,
Où l’amour s’allie au devoir,
Epanchant son âme naïve
Dans le feu de son grand œil noir:
Beauté suave et sans mélange
Qu’un Raphaël, qu’un Michel-Ange
Seraient jaloux de concevoir.
On aime à les voir dans la mise
Si chère à nos bons paysans;
Lui, sous l’habit de laine grise
Aux boutons de corne luisants;
Elle, avec son chapeau de paille
Si coquettement décoré,
Son simple fichu bigarré,
Son mantelet juste à sa taille,
Son jupon de droguet rayé
Et la légère mocassine
Où l’œil ravi cherche et devine
Un pied petit, mignon, choyé....
Chaste rose dont l’éclat brille
Sans d’inutiles ornemens,
Cent fois plus belle et plus gentille,
Sous ces modestes vêtemens,
Que la superbe paysanne
Si commune, hélas! de nos jours,
Dont la vanité se pavane,
Singeant les modèles des cours,
Sous la toilette flamboyante
Et les ridicules atours
Du sot démon qui la tourmente!
Jude est le fils d’un vieux marin
Qui sommeille sous l’onde amère,
Et Grazia, soir et matin,
Regrette encor sa bonne mère.
Peindrai-je, en quelques mots concis,
De l’un la jeunesse rêveuse,
Son âme vive, aventureuse,
Ses projets longtemps indécis?
Ou bien de l’autre qui s’ignore
L’enjoûment, l’aimable gaîté,
Reflet de la sincérité
Qui l’embellit et qui l’honore?
Dirai-je le cœur généreux
Qui sut enrichir leur enfance
Des vertus qui rendent heureux,
Des premiers dons de la science?
Tous deux ont grandi sous les lois
D’un bon curé du voisinage,
Venu sur cet âpre rivage
Pour y faire adorer la croix.
Son toit, où la pauvreté brille,
N’offre pas les traits séduisants
D’une épouse, de beaux enfants:
Les orphelins sont sa famille!
Dieu seul son maître! et la forêt,
Témoin de son œuvre féconde,
Pour ses yeux a bien plus d’attrait
Que tous les palais de ce monde!
Déjà de ses deux protégés—
Dans sa vive sollicitude,—
Les destins par lui sont jugés:
Au sacerdoce il donne Jude;
Et la sensible Grazia,
Ceignant le bandeau des Vestales,
Fuira les passions fatales
Où plus d’une âme s’oublia.
Il voit,—se livrant à son zèle,
Le vénérable Père André,—
Dans ses vœux un gage assuré
Du bon effet de sa tutelle!....
Ainsi, dans les vastes pampas,
Par le prestige du mirage,
Le voyageur croît voir l’image
De mille objets qui n’y sont pas.
O puissance mystérieuse!
Amour qui perdis Abélard,
C’est toi qui du noble vieillard
Vas tromper l’espérance heureuse!
C’est toi qu’écoutent ces enfants
Dans le murmure du feuillage,
Dans les bruits divers de la plage
Et dans leurs rêves séduisants!
C’est toi qui, de la solitude
Bannissant les tristes ennuis,
Leur fais chercher l’ombre des nuits
Pleins d’une vague inquiétude!
Ah! pourquoi déranger le cours
De leur existence tranquille?
Ah! pourquoi leur ange docile
Ne vient-il pas à leur secours?
Du sein des missions voisines
Où le devoir retient ses pas,
André ne reviendra-t-il pas
Briser les plans que tu combines
Et les soustraire à tes appâts?
Non, déjà la barque rapide,
Déjà le zéphyr qui la guide
Les entraînent le long du bord,
Pareils à ces fleurs fugitives
Que le vent fait tomber des rives,
Pour les livrer au flot qui dort.
———
De Roméo, de Juliette
Vous qui gardez le souvenir;
Vous qui dévorez en cachette
La page où Chactas veut mourir;
Qui pleurez Paul et Virginie,
Atala, Réné, nobles cœurs,
Doux fantômes que le génie
Para des plus vives couleurs!
Ce n’est pas pour vous que je trace
Un tableau par ma main pâli,
Et qui ne pourra trouver place
Que dans l’abîme de l’oubli;...
A vous les plantes luxueuses,
Les essences voluptueuses
Qui viennent de climats lointains:
Laissez-moi les mûres sauvages
Qui se perdent sur nos rivages,
Que je trouve au bord des chemins,
Fragmens épars de l’humble histoire
De deux êtres faits pour s’aimer
Dont je me plais à ranimer
Et les cendres et la mémoire!
Souvent je crois ouïr encor,
Au pied de la falaise sombre,
Plus tendres que des lyres d’or,
Leurs voix qui résonnent dans l’ombre.
—“Grazia, partage avec moi
Le charme d’une nuit si pure!
Il me semble que la nature,
Lorsque je suis auprès de toi,
Revêt sa plus belle parure!
L’air est toujours plus embaumé,
D’un reflet plus gai l’onde brille,
Et l’étoile du soir scintille
Dans un azur plus animé.
Jouissons des courtes délices
Que chaque instant va nous ravir!
Le passé n’est qu’un souvenir:
Qui sait les affreux sacrifices
Que peut nous coûter l’avenir?
L’avenir! c’est l’onde perfide
Où glisse notre frêle esquif:
Son sein que nul souffle ne ride
N’offre à nos yeux aucun rescif:
Calme trompeur qui nous égare,
Ou ne promet rien de certain!
Qui sait les dangers qu’il prépare
Pour ceux qui passeront demain!
Hâtons-nous! car le temps nous presse:
Déjà, l’astre des nuits nous laisse
Pour sourire à d’autres amours!...
Du jour te souvient-il encore
Où, sous l’ombre du sycomore,[13]
Je promis de t’aimer toujours?”....
—“Jude regagnons le rivage!
Que dirait le bon Père André
S’il me savait loin du village
Quand le soleil s’est retiré?
Ah! je fais vœu d’être plus sage!....
A des souvenirs superflus
Pourquoi veux-tu que je réponde?
L’espoir où notre âme se fonde
Vaut bien les jours qui ne sont plus!
Va demander à l’hirondelle
Que le cruel hiver bannit,
Si son pauvre cœur se rappelle
Les lieux où repose son nid!....
Tu le sais, ô douteur étrange!
L’oiseau ne saura plus voler,
Cette eau cessera de couler
Avant que mon beau rêve change!...
Et c’est toi qui me fais souffrir!
Pourquoi, dans tes vaines alarmes,
Parler ainsi de l’avenir?
Est-ce pour m’arracher des larmes?
Non, je n’aurais pas dû venir!...
Partons! regagnons le rivage!
S’il me savait loin du village
Quand le soleil s’est retiré,
Que dirait le bon Père André?”
—“Partir! déjà partir! écoute!
—Mon cœur palpite à se briser!—
Ce prompt retour—Dieu! qu’il m’en coûte!—
J’oserai te le refuser!
Va, ne crains rien: la nuit sereine
Pour toi ne cache aucun danger:
Mon Dieu, qui sait mieux me juger,
Des cieux l’aimable Souveraine
M’ont appris à te protéger!
Vois: je suis calme, et, dans mon âme,
L’espoir remplace la douleur:
De toi seule je le réclame!
Je crois, je veux croire au bonheur!
Grazia, comme l’hirondelle
A ses amours toujours fidèle,
Fuyons! au delà de ces monts,
Il est une terre féconde
Où les déshérités du monde
S’aiment comme nous nous aimons!
Deux familles du voisinage
S’en vont aux lointains Illinois:
Demain commence leur voyage;
A les suivre tout nous engage:
Fuyons ces rochers et ces bois,
Nos longs hivers, la dépendance
Où se traîne notre existence!
Partons! le sort en est jeté!
Là-bas, des prés riants, fertiles,
Nous offrent des travaux utiles,
La fortune et la liberté!...
Viens! que perdons-nous? la chapelle
Où le bon curé nous appelle
A l’angelus matin et soir?
Les champs aimés de la patrie?
Le presbytère et la prairie
Où paît ta génisse au front noir?
Viens! Dieu remplit la terre entière!
D’André la fervente prière
Va nous assurer sa faveur;
Viens! la patrie est où la terre
Donne à l’homme, son tributaire,
Sa part d’aisance et de bonheur!”
—“Assez, Jude, assez: je refuse;
A ce rêve il faut renoncer,
Car Dieu ne saurait exaucer
Des vœux que le devoir accuse!
Quoi! tu veux partager le sort
De ces Canadiens, nos frères,
Qui vont, aux rives étrangères,
Braver la misère et la mort!
Loin des bords où dorment leurs pères!
Loin des grands sites consacrés
Par les beaux jours de leur enfance,
Les vertus, l’heureuse innocence
Et les souvenirs vénérés!
Loin du clocher qui les vit naître
Dont la voix aux pieux accents
Semble pleurer sur les absents
Que ne bénira plus le prêtre!...
Que d’autres, moins sages que toi,
Perdent leur âme avec leur foi
Au sein de ces peuples avides
Dont les croyances déicides
Ne connaissent plus d’autre loi
Que celle de leurs gains sordides!
Plaignons-les! ne les suivons pas!
Ne fuyons pas notre bon Père,
Notre meilleur ami sur terre!
Nous lui devons—tu l’avoûras—
Et notre paisible existence
Et le pain de l’intelligence!
Soyons pauvres: jamais ingrats!
Restons! et si la Providence,
Dans sa divine prévoyance,
Nous refuse les vains hochets
Des prétendus heureux du monde,
Dans l’asile de nos forêts,
Loin de la passion qui gronde,
Goûtons, ami, la paix profonde
Que la vertu ne perd jamais!”
—“Grazia, j’envie et j’admire
Les trésors de ton noble cœur;
Que ne puis-je, sous son empire,
Atteindre ce calme bonheur,
Onde limpide où, blanche fleur,
Ton âme adorable se mire!
Idéal plein de majesté!
Trop grand pour le commun des hommes,
Fragiles jouets que nous sommes
Aux mains de la réalité!
Mais André courbe vers la tombe,
Et l’âge a blanchi ses cheveux:
Que deviendrons-nous?”
—“S’il succombe?
Au moins, pour lui fermer les yeux,
Nous serons là, Jude, et son âme,
Nous souriant du haut des cieux,
Veillera sur nous dans ces lieux!
Exempts de remords et de blâme,
Les paisibles travaux des champs
Rempliront notre vie heureuse,
Loin des embûches des méchants,
Loin de l’ambition trompeuse!”
—“J’aime, enfant, les riants tableaux
Dont s’embellît ton espérance!
Comme toi, j’aime nos coteaux,
Nos lacs, nos horizons si beaux,
Et la forêt qui se balance,
En murmurant, au bord des eaux!
J’aime nos sublimes montagnes
Dont les lignes font ressortir
L’éclat de nos vertes campagnes
Où je voudrais vivre et mourir!...
Mais au milieu de ces richesses,
Du sol convoitant les largesses,
Le colon, presque sans espoir,
Au fond des mornes solitudes,
Rongé de mille inquiétudes,
De sueurs arrose son pain noir!
De son introuvable chaumine
Nul sentier n’indique le lieu;
Nul être humain ne le voisine!
Eloigné des temples de Dieu,
Perdu dans le désert immense,
Il vit dans l’horreur du silence
Auquel il se voit condamné!
Semblable au forçat enchaîné,
Son labeur n’aura pas de trêve,
Ou bien, si sa tâche s’achève,
Si sa hache a vaincu le sort,
Si la Providence attendrie
Par son amour pour sa patrie,
Couronne enfin son noble effort,
Tandis qu’une heureuse vieillesse
Déjà succède à sa jeunesse,
Un jour, quel sera son effroi,
Lorsque, riant de son martyre,
Un étranger viendra lui dire:
“Allez: tous ces champs sont à moi!”
Du colon telle est l’existence,
Tels sont les succès incertains!
Tels seront nos tristes destins
Si je cède à ton insistance!...
Pour toi, je braverais la mort,
Grazia: mon cœur n’est pas lâche;
Mais je veux agrandir ma tâche
Pour t’assurer un meilleur sort!
Ah! Dieu le sait combien je t’aime!”
—“Eh! nous allons nous séparer!”
—“Oui, la raison, le devoir même
M’ordonnent de persévérer!
Toi, faible enfant, douce colombe,
D’André sur le bord de la tombe
Tu charmeras les derniers jours;
Moi, loin de la route commune,
J’irai contraindre la Fortune
A doter nos chastes amours!”
—“En vain ma voix est importune,
Non, non, tu ne partiras pas!
Dieu qui condamne les ingrats,
Les souvenirs de notre enfance,
Les sermons que tu prononças,
Mes vœux, mes pleurs, mon espérance
Triompheront: tu resteras!”
—“Grazia, calme ta souffrance!
Rien n’est encor désespéré:
Avant un an, je reviendrai”...
—“Dieu!—je le vois—il m’abandonne!
Ah! Jude, tu ne m’aimes plus!
Sois heureux! mon cœur te pardonne
Les beaux rêves que j’ai perdus!
Va; mais exauce ma prière!
Jude, crois-moi, c’est la dernière:
Avant de fuir loin de ce lieu,
Pour nous dire un suprême adieu,
Attends le retour du bon Père!”
—“Grazia, la brise fraîchit;
Il est tard: gagnons le village!
Nous parlerons de mon voyage
Demain, si ton cœur ne fléchit;
Mais demain tu seras plus sage!”...
.....................................
.....................................
Les voix s’éloignent dans la nuit
Et s’éteignent dans le silence,
L’on n’entend plus même le bruit
Du flot mourant qui se balance....
Ainsi de nos rapides jours
Le riant prestige s’efface;
Ainsi le calme oubli remplace
Douleurs, regrets, plaisirs, amours!
[13] Nom vulgaire d’une espèce d’érable.
———
Grazia, ton doux stratagème
Te rit encor dans ton sommeil;
Dors: car celui que ton cœur aime
Ne charmera pas ton réveil!
Il est parti ton pauvre Jude;
Il va grossir la multitude
Des exilés que nous pleurons!
Que ton souvenir le soutienne!
Prions, prions Dieu qu’il revienne
Pur des torts qui courbent leurs fronts!
Il est parti!—Toi, ma patrie,
Mère qui reçus dans tes flancs
Le beau sang de la Normandie,
Rends-nous compte de tes enfans!
Toi qui ceins le bandeau des reines
Sous le soleil américain,
Tu jettes aux hydres lointaines
Ceux que devrait nourrir ton sein!
Semblable à ce monstre romain
Vouant aux voraces murènes
L’esclave immolé par sa main!
Mais où s’égare mon délire?
Mère, pardonne à ma douleur!
Ce n’est pas toi qu’il faut maudire,
Mais la main de fer du malheur,
Hideux vampire qui t’enlève
Tes fils: ton orgueil et ta sève,
Et les dévore palpitants;
Eveille-toi pour le combattre!
Arme-toi! ton bras peut l’abattre:
Bientôt, il ne sera plus temps!
Il est parti!—De cette histoire
Ne puis-je ici borner le cours!
Des jours de deuil que je parcours
Ne puis-je perdre la mémoire!
Je n’aurais pas à retracer
Avec des couleurs fugitives
Des maux, des souffrances si vives!
J’ose à peine les esquisser!
Des devoirs de son ministère
André, ce jour là, libre enfin,
Pressant le pas de son roussin,
De son modeste presbytère
Gaîment reprenait le chemin.
Comme tous ceux dont l’âme est pure,
Le vieillard, tout en cheminant,
Des richesses de la nature
Goûtait le charme renaîssant.
Juin des plus suaves arômes
Embaumait l’asile des bois;
Les oiseaux remplissaient leurs dômes
De mille concerts à la fois:
Enviant leurs doux idiomes,
De sa vieille et tremblante voix
Le bon André chantait des psaumes.
La charité rit dans son cœur:
Des deux enfans que tant il aime
Il veut assurer, ce jour même,
Et l’avenir et le bonheur;
Il veut leur confier d’avance
Le secret de son espérance,
Le projet qu’il nourrit pour eux,
Le saint emploi qu’il leur destine;
Sûr de son succès, il combine
Les moyens de les rendre heureux.
Ainsi méditant, plus rapides
Les heures légères ont fui,
Et déjà, près des eaux limpides,
Il voit s’étendre devant lui
La verte et riante vallée
D’un réseau de vapeurs voilée,
Son toit ombragé de bouleaux,
Sa chapelle au bord du rivage,
Les maisonnettes du village
Toutes blanches sur les coteaux.
Il approche, puis il s’étonne
Qu’enfin au-devant de ses pas
Les deux enfans n’accourent pas:
Pour cette fois, il les pardonne;
Mais qu’on juge de sa terreur
Lorsque, non loin du presbytère,
De Grazia, gisante à terre,
Les traits mourants et la pâleur
Frappèrent les yeux du bon Père!
Comment exprimer sa stupeur,
Quand Josephte, sa ménagère,
—Elle qui leur servit de mère!—
A ses pleurs donnant libre cours,
Attrista son âme attentive
Par l’histoire simple et naïve
De leurs chagrins, de leurs amours?
Peindrai-je son inquiétude,
Ses regrets d’avoir perdu Jude,
Les soins et la sollicitude
Dont il entoure Grazia
Qui, dans la fièvre du délire,
Parle tout haut de son martyre,
Des sermens que Jude oublia?
Ainsi la semaine se passe,
Puis, la douleur enfin se lasse
A tourmenter un corps si beau;
Et la mort, déployant ses ailes,
Fuit vers les ombres éternelles
Sans creuser un nouveau tombeau.
Elle vit; mais, pour la pauvrette,
Songeant aux temps qu’elle regrette,
A l’impénétrable avenir,
Qu’une année est lente à courir!
....................................
....................................
....................................
Un an s’écoule, et de son Jude
Rien n’annonce encor le retour!
Ce silence de jour en jour
Assombrit son incertitude.
Enfant, si rieuse autrefois,
Quand l’espoir lui prêtait ses charmes!
On n’entend plus son chant, sa voix,
Et ses yeux n’ont plus que des larmes!
Par mille essais ingénieux,
En vain, pour calmer sa détresse,
Josephte, André, de la vieillesse
Dépouillant l’aspect ennuyeux,
Lui font partager tous les jeux,
Vieux souvenirs de leur jeunesse:
Les fleurs des bois dont elle aimait
A former sa seule parure,
Tous les trésors de la nature
N’égayent plus son front distrait;
Et si, parfois, sa rêverie
L’attire au sein de la prairie,
C’est pour consulter en secret
La marguerite complaisante
Dont le capricieux décret
Tour à tour l’afflige ou l’enchante.
En vain, au pied de l’humble autel,
Dans la chapelle solitaire,
Sa vive et touchante prière,
Montant au séjour éternel,
Invoque le Dieu du Calvaire:
Jude toujours remplit son cœur!
Dans les combats qu’elle lui livre,
Son amour est toujours vainqueur!
Ainsi, par l’attrait qui l’enivre,
Dieu veut éprouver sa ferveur!
Souvent, pendant la longue veille,
Tandis que Josephte sommeille,
A ses vieux ans payant tribut,
Tout en rêvant à son salut;
Tandis que, d’une voix débile,
André lit tout haut l’Évangile,
Assise au pied du vieux bahut,
Lorsque sa main industrieuse
Vole active sur son tricot,
Nul ne sait le profond sanglot
Que couvre la leçon pieuse,
Ni la larme silencieuse
Que l’enfant dévore aussitôt
Dans sa douleur mystérieuse!
Puis l’espoir renaît dans les cœurs
Quand, faible encore et chancelante,
Plus tard, sous les pommiers en fleurs,
Aspirant la brise odorante
Qui lui rend ses fraîches couleurs,
Elle essaie en vain de sourire
Aux enfants des bons villageois,
Lui rapportant, du fond des bois,
Les rayons de miel et de cire,
Fruits de leurs plus joyeux exploits.
Mais bientôt la mélancolie,
Voilant ces timides efforts,
Comme un inflexible remords,
Réveille en son âme affaiblie
La douleur dont elle est remplie.
Ainsi, dans la saison d’été,
Quand le ciel se couvre d’orages,
Parfois, déchirant les nuages,
Le soleil répand la gaîté;
Ainsi, sous des voiles plus sombres,
Au jour pur succèdent les ombres,
Au temps qui fuit, l’éternité.
———
Voici le jour des Morts: la bise
Mugit dans l’empire des airs:
On dirait qu’au fond des déserts,
L’ange du malheur agonise!
Le sein des grands bois agités
Retentit de plaintes sans nombre:
Les hôtes de la rive sombre,
Innombrables, épouvantés,
Y cherchent le repos et l’ombre!
C’est Novembre qui hurle ainsi,
Guidant ce funèbre cortège
A travers la pluie et la neige
Dont le soleil est obscurci....
L’éclair sillonne le nuage,
Le flot tourmente le rivage,
De grands arbres sont renversés;
Seul, sur la route du village,
Un voyageur, à pas pressés,
Brave la fureur de l’orage!
C’est lui! c’est Jude enfin guéri
De son humeur aventureuse:
Il revient à la vie heureuse;
Mais il revient le cœur flétri.
Hélas! sur la rive étrangère,
Errant de cités en cités,
En vain poursuivant sa chimère,
L’or, la Fortune mensongère:
Malgré ses importunités,
Il n’a trouvé que la misère!
Souvent, dans ses chagrins cuisants,
Le souvenir de sa patrie,
De Grazia, toujours chérie,
Par mille rêves séduisants
A charmé son âme attendrie!
Souvent, écoutant son amour,
Emu, sa main saisit la plume
Qui doit annoncer son retour;
Mais, ô penser plein d’amertume!
L’orgueil qui troubla son bonheur,
L’orgueil qui triompha des anges!
A ses exigences étranges
Asservissait encor son cœur!
Il se taira!—de son mécompte
Il rougit de tracer l’aveu!
Il attendra, formant le vœu
De réparer bientôt sa honte!
Joueur! le malheur qu’il affronte
Dévore son dernier enjeu!
Puis, tombant d’abîme en abîme,
En proie au morne désespoir,
Des passions faible victime,
Bientôt, on le verra s’asseoir
Au fond de la caverne infime
Où l’ivresse, au front avili,
Verse à flots la mort et le crime
Au lâche qui cherche l’oubli!
Errant sous la zone torride,
Ainsi, parfois, le voyageur,
Epuisé par sa course aride,
Du sommeil cherche la douceur
Sous l’arbre au feuillage perfide,
Dont la bienfaisance homicide
En une éternelle torpeur
Va bientôt changer sa langueur,
A moins qu’une main secourable,
L’arrachant au charme effroyable,
N’éveille l’imprudent dormeur.
Ainsi, dans la coupe infernale
Croyant assoupir ses regrets,
Le pauvre enfant puise à longs traits
L’ivresse à tant d’autres fatale;
Lorsque, sur le bord du tombeau,
Dissipant son affreux délire,
La grande voix de Dieu l’inspire!
Trouvant un courage nouveau,
A peine sauvé du naufrage,
Faible, il se remet en voyage
Le souvenir de son erreur
Le suit encore et le désole;
Mais, parfois, l’espoir le console:
Qu’importe la mer en fureur?
Il va retrouver sa boussole:
André, Grazia, le bonheur!
Avec quelle ardeur anxieuse
Sur la route longue, épineuse,
Bravant les affronts, le dégoût,
Il poursuit sa tâche féconde!
Seul, chancelant, manquant de tout!
Enfin, sous l’orage qui gronde,
Il a retrouvé son hameau,
Les champs aimés qui l’ont vu naître
Et la chapelle au bord de l’eau.
Il croit déjà voir apparaître
Ceux qui lui gardent le pardon!
Il court, il vole au presbytère;
Tremblant, il tire le cordon:
Il est entré dans la chaumière;
Mais seul, lisant son bréviaire,
Un jeune prêtre, en ce logis,
Se présente à ses yeux surpris.
—“André?”—dit-il. De sa lecture
Le prêtre interrompant le cours:
—“Il est parti. Dans ses vieux jours,
Des chagrins de sombre nature
L’étrange et douloureux concours
D’ici l’éloigna pour toujours!...
Il fut chargé d’une autre cure;
Et Josephte, au fond des grands bois,
Du bon vieillard, comme autrefois,
Partage au loin la vie obscure.”
—“Et Grazia?”
—“Longtemps, hélas!
Pareille à l’humble primevère
Dont la froidure meurtrière
A terni les frêles appas,
Languissant dans la solitude,
Elle attendit son amant, Jude;
Mais son amant ne revint pas!
Un soir, après un long silence,
—“Père,” dit-elle au vieil abbé,
“Lorsque nous aurons succombé
Sous le fardeau de l’existence,
Lorsque, dans les jardins du ciel,
Nous goûterons la récompense
Que promet le maître éternel,
Plongés dans le bonheur suprême,
Nous sera-t-il encor permis
De revoir là-haut nos amis,
Ceux qu’ici-bas notre cœur aime?”
Et le vieillard, voyant ses pleurs,
Par ces mots calma ses douleurs:
—“Oui, ma fille, avec foi j’espère
Que dans le sein de Dieu, là-haut,
Cette grâce pour nous s’opère!”
—“Puissé-je l’obtenir bientôt!”
Reprit-elle moins désolée;
“De Jude l’âme consolée,
Depuis longtemps m’attend aux cieux!
Elle m’attire.... A vous, bon Père,
De répondre à mes derniers vœux,
D’exaucer mon humble prière!
Lorsqu’auront fui mes tristes jours,
Je veux reposer sur la plage,
Sous les ormes dont le feuillage
Abrita nos douces amours,
Et dont le bienfaisant ombrage
Protégera, sur le coteau,
Ceux qui viendront à mon tombeau!....
C’est là que souvent, à la brune,
Avec Jude j’allais m’asseoir
Pour goûter la brise du soir,
Ou pour y voir poindre la lune
Sur le bord de l’horizon noir.”....
......................................
“Bientôt après, de l’orpheline
S’accomplit le vœu solennel:
Son âme, s’envolant au ciel,
Laissa son corps sur la colline!”
Il dit:—le pâle voyageur,
Poussant un long cri de souffrance,
Vers la plage sombre s’élance
Dans une inexprimable horreur!....
Longtemps, sur la tombe isolée,
Sous le vent et la giboulée,
Il pleura ses beaux jours perdus;
Puis, fuyant le long du rivage,
En proie aux fureurs de l’orage,
Jude, hélas! ne reparut plus.
LOUIS J. C. FISET.
Mai, 1861.
LÉGENDE HISTORIQUE.
———
PROLOGUE.
La Légende de la Jongleuse est une vieille histoire du temps passé, que l’auteur a recueillie, il y a bien des années, sur les lèvres des anciens conteurs de sa paroisse natale.
Elle retrace un de ces actes d’atrocité incroyables que les Sauvages d’Amérique commirent si souvent contre les Pionniers de la Foi et de la Civilisation, et qui semblent avoir attiré sur toutes les races indiennes cette malédiction qui plane encore sur leur tête.
Le Sauvage, a dit le Comte de Maistre, n’est et ne peut être que le descendant d’un homme détaché du grand arbre de la civilisation par une prévarication quelconque.[14]
Cette hypothèse expliquerait la disparition si prompte des nations indiennes à l’approche des peuples civilisés.
Mais, sans recourir à ce problème, nous n’hésitons pas à attribuer leur anéantissement à ces inqualifiables barbaries dont ils se rendirent tant de fois coupables envers les Missionnaires et les premiers colons qui venaient leur apporter le flambeau de la Vérité.
La Légende de la Jongleuse se mêle aux premiers souvenirs d’enfance de l’auteur; et il se rappellera toujours l’effet prodigieux que produisit sur sa jeune imagination le récit de ce drame que l’amour du merveilleux, inné dans le peuple, enveloppait de tout le prestige de l’inconnu.
Aussi a-t-il essayé, dans sa narration, de faire ressortir, en le poétisant, ce caractère fantastique, afin de conserver à la légende toute son originalité.
Ne vous êtes-vous pas extasié parfois devant le sublime panorama de notre Grand Fleuve, quand, par un beau soir d’été, bien calme, il reflète, dans le miroir limpide ses grandes eaux, le superbe turban des Laurentides?
Telle est l’idée que nous nous formons de la Légende.
C’est le mirage du passé dans le flot impressionnable de l’imagination populaire; les grandes ombres de l’histoire n’apparaissent dans toute leur richesse qu’ainsi répercutées dans la naïve mémoire du peuple.
Telle est aussi l’idée que nous avons essayé d’exploiter en esquissant la Légende de la Jongleuse:—d’un côté, le tableau historique, conservé sur des monuments encore existants,—de l’autre l’image féerique, reflétée dans l’onde populaire.
Comme preuve historique,—outre le nom de la paroisse de la Rivière-Ouelle[15] qui tire son origine du nom des deux principaux personnages de ce drame,—nous indiquerons les traces évidentes, laissées sur les lieux mêmes de l’événement, dans les noms qui les désignent encore aujourd’hui.
Quant à la partie légendaire, il suffira d’un seul coup d’œil du lecteur pour faire la part du merveilleux.
[14] Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Vol. 1. Deuxième Entretien, page 75.
[15] On écrivait autrefois: Rivière-Houel.
———
Lorsque déjà notre vie s’en va vers son déclin souvent dans cette ombre que projette devant nous toute vie dont le soleil descend, nous croyons voir s’élever couronnée d’une pure lumière une image que les années embellissent à mesure qu’elles l’éloignent de nous; et sous le charme d’un souvenir toujours jeune, nous nous surprenons à nous écrier dans le secret de notre cœur: “Ma mère! Ah! oui, c’est ma mère!”
R. P. Félix.
I
C’était une nuit d’automne, sombre et brumeuse.
Un canot d’écorce se détachait silencieusement du rivage de Québec à quelques pas de l’endroit où s’élève la vieille église de la Basse-Ville.
Sur le sable de la grève, un homme était debout tenant à la main une lanterne sourde dont le cône lumineux dirigé vers les flots éclairait le canot monté par quatre personnes.
A la lueur fauve que projetait la lanterne, il était facile de voir que celui qui se tenait à l’arrière du canot était un chasseur canadien.
Il était vêtu d’une chemise à raies bleues, et de pantalons d’étoffe grise, et portait sur la tête un bonnet de peau de castor.
Selon l’invariable coutume des voyageurs, il avait eu le soin, avant de prendre place sur la pince du canot, de placer sous lui son capot d’étoffe plié avec précaution.
Une ceinture rouge, dont les franges flottaient sur sa jambe gauche, s’enroulait autour de ses reins.
Ses pieds étaient chaussés de bottes sauvages, dont les hausses de cuir de mouton, enveloppaient le bas de ses pantalons et se rattachaient au-dessous du genoux par des lanières de peau d’anguille.[16]
C’était un homme d’un tempérament sec, mais d’une charpente osseuse et d’une taille très-élevée.
Les manches de son gilet, retroussées jusqu’au coude, découvraient des muscles d’acier qui révélaient une force peu commune.
Ses bras, d’une longueur démesurée, étaient couverts de tatouages représentant divers objets parmi lesquels on remarquait la figure d’un canot.
Les traits de son visage, hâlés par le soleil, et d’une remarquable régularité, semblaient avoir été taillés dans un bloc de bronze florentin.
Sa barbe était noire, tandis que ses cheveux, qu’il laissait croître depuis longtemps et qui retombaient négligemment sur ses épaules, étaient d’un blond châtain.
Un grand air de bonté se reflétait sur toute sa physionomie.
Ses yeux, qu’il tenait habituellement à demi-fermés, lui donnaient au premier abord une apparence engourdie; mais ils étincelaient d’une rare intelligence, enchâssés sous leurs sourcils noirs et épais, lorsqu’il était sous l’influence d’une émotion un peu vive.
Du reste, dans sa personne, rien n’était remarquable, si ce n’est un air d’apathie et d’insouciance, que l’extrême lenteur de ses mouvements laissait naturellement supposer.
Son habileté extraordinaire à conduire un canot lui avait fait donner le surnom de Canotier.
⁂
La lumière vacillante de la lanterne éclairait, par intervalles, un autre personnage assis à la tête du canot que son accoutrement désignait suffisamment comme appartenant à la race des Peaux-Rouges.
C’était un homme superbe, à l’œil d’aigle, aux lèvres fines et fièrement arquées, au front élevé rayonnant d’intelligence et de loyauté, et d’un galbe si irréprochable que Phidias ou Canova l’eussent copié avec amour, comme le type de l’homme à l’état de nature.
Selon la coutume indienne, ses cheveux étaient rasés, à l’exception d’une touffe attachée au sommet de la tête avec des plumes de faucons, d’outardes et d’oies sauvages, qui formaient comme le cimier d’un casque antique.
Il portait une espèce de manteau, bordé d’une frange rose et lilas, fait avec ces peaux de caribou couleur orange,[17] que les Sauvages seuls savent rendre si soyeuses et si molles.
Des mocassins ornés de rassades et de poils de porc-épic, teints en rouge et bleu, couvraient ses pieds.
Les guerriers de sa tribu l’appelaient Misti Tshinépik’,[18] c’est-à-dire la Grande Couleuvre, soit à cause de sa souplesse extraordinaire, soit à cause de la figure de ce reptile tatouée sur sa poitrine.
Les reflets de pourpre de la lanterne dessinaient encore la silhouette de deux autres personnages assis au centre du canot.
C’était celle d’une jeune femme et d’un enfant de huit à dix ans.
Une profonde mélancolie mêlée d’inquiétude se reflétait sur la figure pleine d’énergie de Madame Houel.
Ainsi se nommait la jeune femme.[19]
La noblesse de ses traits et l’élégance de ses vêtements révélaient une personne de distinction.
Au moment où le canot franchissait la pénombre projetée par la lumière, elle était occupée à étendre un châle sur les épaules de son enfant pour le préserver de l’humidité de la nuit.
Quand le canot eut entièrement disparu dans les ténèbres, l’homme à la lanterne remonta lentement la berge:
—Diantre! murmurait-il à part lui en s’éloignant, il faut que Madame ait bien du courage pour s’embarquer par une pareille nuit.
Je veux bien croire que Monsieur Houel a été gravement blessé.
Mais qu’était-il besoin de tant se hâter et de s’exposer, par là, à un danger évident?
Ne pouvait-elle au moins attendre jusqu’à demain matin?
Mais à peine a-t-elle appris la fatale nouvelle qu’elle n’a pas même pris le temps de faire ses malles.
Ah! je crains fort qu’il ne lui arrive quelque malheur.
Et puis ce massacre de trois hommes par un parti d’Iroquois qui a fait une descente avant-hier dans l’île d’Orléans, et qui a enlevé une femme et quatre enfants......
Ils seront fort heureux s’ils ne font pas la rencontre de quelques-uns de ces démons enragés.
En faisant ces réflexions, il disparut derrière l’angle d’une maison, et tout rentra dans les ténèbres.
[16] De la babiche, mot sauvage encore employé dans nos campagnes pour désigner ces lanières.
[17] Les Sauvages obtiennent cette couleur en passant les peaux à la boucane, au-dessus de la fumée des cabanes; et la couleur blanche en les passant avec la cervelle des animaux.
[18] Cette expression, ainsi que les autres mots que nous emploierons dans le cours de ce récit, appartiennent au dialecte montagnais, qui dérive de la langue algonquine.
[19] Parmi les membres de la Compagnie des Cent Associés figure le nom de M. Houel. Nous lisons dans le cours d’Histoire de M. l’abbé Ferland: “Richelieu trouva des auxiliaires de bonne volonté dans les Sieurs de Roquemont, Houel, contrôleur général des Salines en Brouages, de Latteignant etc, etc.” M. Houel se donna beaucoup de peine pour faire venir les Pères Récollets en Canada. “Les principaux bienfaiteurs qu’ils ont eus ont esté sa Majesté, M. de Pisieux, M. de Ramsay, grand vicaire de Pontoise et syndic des Récollets en Quanada, M. Ouel contrôleur général des Salines de Brouages, et quelques autres.” Mémoire des Récollets présenté au Roi en 1637.
———
Une fée apparut, mais presque imperceptible:
Les œillets dépassaient son petit corps flexible;
Son char frêle, où brillaient des perles pour essieux,
Allait glissant dans l’air, conduit par deux phalènes;
Une araignée avait, pour leur servir de rênes,
Tissu deux fils soyeux.
Anaïs Ségalas.
II
Cependant le frêle esquif, poussé par deux vigoureux avirons, descendait le fleuve avec rapidité.
Léger comme une écume, il glissait sans bruit sur les flots, laissant à peine un pâle sillage derrière sa proue.
Les voyageurs gardèrent le silence pendant quelque temps; et rien ne troublait le sommeil de la nature autour d’eux, si ce n’est le bruissement des flots sur les flancs de la légère pirogue, et le chant monotone et cadencé de la vague sous les avirons.
Bientôt l’obscurité de la nuit confondit les teintes indécises des divers édifices de la ville dans une nuance uniforme, et ils ne distinguèrent plus derrière eux qu’une ligne onduleuse découpant en noir, sur le ciel, les contours du Cap Diamant.
De fois à autres, le clapotis de la vague sur les galets de la rive, ou le grincement d’une girouette, agitée par le passage subit d’une brise nocturne, parvenaient encore à leurs oreilles.
Mais bientôt tous ces bruits s’éteignirent.
C’était l’heure solennelle de la nuit où tout repose dans la nature, et les bêtes carnassières revenues de leurs chasses nocturnes, et l’oiseau caché sous la feuillée, et l’homme fatigué des soucis et des travaux du jour.
Le torrent lointain même semble voiler ses sanglots, et, sous la brise expirante de la nuit, la forêt exhale à peine de son orgue immense un faible soupir.
Cependant la jeune femme, les yeux tournés vers la ville endormie, contemplait attentivement une lueur presqu’imperceptible et immobile sur la côte.
On eût dit qu’elle redoutait le moment où elle allait la voir disparaître entièrement, tant il y avait d’anxiété dans ses regards.
Ce n’était pas la lumière de la lanterne qui depuis longtemps avait disparu.
Cette faible étincelle, qui venait scintiller au bord de sa paupière où tremblait une larme, jaillissait d’un foyer autrement mystérieux, autrement consolant:
C’était la pâle clarté de la lampe du sanctuaire de la vieille église,—holocauste virginal, emblème touchant de l’éternelle prière.
Pendant qu’elle contemplait cette chaste étoile, sa bouche murmurait une fervente prière.
La prière! invisible vestale qui veille incessamment, une étoile au front, dans le temple sans tache de l’âme pieuse.
Toute son âme semblait avoir passé dans ses yeux, tant il y avait d’ardeur dans son regard;—et le mystique rayon, venant effleurer sa prunelle de sa baguette d’or, semblait le regard de Dieu, caché sous les adorables voiles, exauçant sa plainte et versant un reflet d’espoir dans son âme en deuil.
Oh! la pauvre femme, elle avait en effet grand besoin d’un céleste soutien, au moment d’affronter tant de dangers parmi les embûches de la nuit!
Enfin, les ténèbres l’envahissant de toutes parts, le frêle sillon de lumière s’éteignit sous un linceul d’obscurité.
⁂
—Oh! il fait bien noir, dit tout bas l’enfant à sa mère après un long silence, je ne puis pas même voir votre visage.
Si je n’étais pas si près de vous, ma chère petite maman, je crois que j’aurais bien peur.
Pourquoi sommes-nous partis si promptement?.....
Je dormais si bien dans mon lit quand vous êtes venue me réveiller.
Allons-nous arriver bien vite?....
Et l’enfant, saisi d’un frisson involontaire, se rapprochait instinctivement de sa mère, comme pour chercher une protection contre les fantômes que la nuit fait sautiller devant l’imagination de l’enfance.
La jeune femme poussa un soupir, et sans répondre à ses questions:
—Couche-toi sur mes genoux, Harold, lui dit-elle, tu as encore besoin de dormir. Fais un bon somme tandis qu’il fait noir;—je te réveillerai quand il sera jour, et tu verras se lever le beau soleil.
Alors tu n’auras plus de peur.
L’enfant obéit sans rien dire et posa sa tête sur les genoux de sa mère.
—Maman, murmura-t-il à voix basse après quelques minutes, voyez-vous là-bas cette grande femme blanche qui marche sur l’eau? Elle s’avance vers nous,—elle me regarde,—elle me fait signe d’aller vers elle.
Entendez-vous, maman, comme elle chante?.....
Comprenez-vous ce qu’elle dit?....
Et l’enfant indiquait du doigt le fantôme qu’il croyait apercevoir.
—Maman! continua-t-il d’une voix tremblante, j’ai peur! j’ai peur!... Retournons-nous en chez nous. Elle va venir me prendre.
Et il cachait sa figure sur les genoux de sa mère en étouffant un sanglot.
—Dors donc, enfant, ne crains rien; il n’y a point de danger.
Cette grande tache blanche que tu vois là-bas, ce n’est pas un fantôme:—c’est la chute de Montmorency.
Le bruit que tu entends, c’est celui de l’eau qui tombe de la montagne.
Dors tranquillement; ta maman veille auprès de toi.
⁂
—Ho-hou!—interrompit tout à coup le Sauvage, tirant de sa poitrine cette exclamation gutturale ordinaire aux Indiens pour exprimer la surprise et l’étonnement,—Matshi Skouéou!
Ces paroles en langue sauvage, prononcées à demi-voix, semblèrent paralyser les bras du chasseur canadien.
Pendant quelques instants, son aviron demeura immobile entre ses mains.
Puis, sur un signe du Sauvage, ils se remirent tous deux à ramer vigoureusement, mais avec le moins de bruit possible.
———
C’est la blancheur de la vague écumante que j’aperçois sur le rocher, quand le brouillard s’élève autour d’une ombre errante et fait flotter sa robe grisâtre dans les airs.
Ossian.
III
—Votre enfant dort-il maintenant, demanda enfin le chasseur après un long silence.
—Oui, répondit Madame Houel; il est si fatigué d’avoir été dérangé cette nuit qu’il s’est endormi en quelques secondes.
—Eh bien! Madame,—reprit-il d’un ton solennel, avec sa lenteur habituelle, et en se penchant vers le centre du canot, afin de pouvoir parler plus bas et se faire entendre,—maintenant que je crois le danger passé, je dois vous dire que nous venons d’échapper, par un heureux hasard, ou plutôt par une protection spéciale de la Providence, à un ennemi autrement dangereux que les partis d’Iroquois qui rôdent depuis quelques semaines sur nos rivages.
Si j’avais eu affaire à tout autre qu’à vous, j’aurais soigneusement évité de révéler cet incident; mais je connais la fermeté de votre caractère et votre désir que rien ne vous soit caché.
—Vous faites bien, le Canotier; continuez.
—Vous avez peut-être pu croire un instant que votre enfant était le jouet d’un rêve, lorsqu’il vous indiquait cette forme étrange dont nous n’avons pu entrevoir que l’ombre;—mais soyez bien sûre que ce n’était pas une illusion. Les enfants pénètrent parfois des secrets que nous autres, hommes, nous sommes incapables de percer.
L’innocence de cet âge le rapproche du monde des esprits, et lui révèle souvent des dangers impénétrables à nos regards.
Si j’avais connu, il y a quelques heures, ce que le bon ange de cet enfant lui a fait voir et entendre, je ne me serais jamais hasardé à partir cette nuit.
—Comment! le Canotier! répondit Madame Houel, est-il possible que vous vous laissiez entrainer par de misérables superstitions, vous, un vieux chasseur, qui avez passé toute votre vie dans les bois et qui avez bravé tant de dangers au milieu des Sauvages.
Vraiment, je ne vous reconnais plus;—jamais je ne vous aurais cru capable d’une telle faiblesse.
Ce prétendu fantôme n’a-t-il pas une cause toute naturelle?
—Madame, répondit le chasseur d’un ton grave, avez-vous pu croire un instant que cette apparition n’était que le reflet de la chute à travers l’ombre?
Croyez-vous qu’à la distance où nous étions, cette nappe d’eau pouvait être visible par une nuit aussi noire?
Ah! fiez-vous à l’expérience d’un vieux coureur de bois à qui la solitude et le désert ont appris une science qui ne se trouve pas dans les livres.
Depuis tantôt vingt ans que je mène la vie des bois, j’ai dû acquérir quelque connaissance des phénomènes de la nature.
Il n’est pas un bruit des eaux, des vents ou des animaux sauvages qui me soit inconnu;—les mille voix du désert me sont familières, et je puis toutes les imiter au besoin.
Bien souvent pendant les nuits, au sein des forêts, près des lacs, ou des rivières, tantôt au milieu des camps indiens, tantôt durant les chasses d’hiver, j’ai passé de longues heures à étudier les divers aspects de l’ombre et de la lumière, à la lueur incertaine des étoiles, à la flamme du bûcher, ou par un beau clair de lune, ou bien par une nuit sombre et brumeuse, comme celle-ci.
Il est peu d’objets qui, soit le jour, soit la nuit, puissent longtemps tromper ma vue exercée par une longue habitude.
Eh bien! Madame, je vous dis que cette vague lueur ne vient ni du ciel ni de la terre.
—Ne serait-ce pas peut-être la flamme de quelque bivouac indien voilé par la brume?
—Vous n’avez jamais confondu les rayons de votre lampe avec la clarté de la lune, n’est-ce pas, Madame?
Eh bien, il serait aussi difficile pour moi de confondre cette étrange lueur avec le feu d’un bivouac indien.
—Une crainte superstitieuse vous aura troublé la vue,—reprit Madame Houel avec un mouvement d’impatience et d’incrédulité.
⁂
Ce reproche piqua au vif le hardi Canotier qui garda un moment le silence.
Puis d’une voix émue:
—Madame, un homme qui a passé la moitié de sa vie exposé chaque jour à se voir attaqué et scalpé par de féroces ennemis,—qui a servi de guide pendant une dizaine d’expéditions contre les Cinq-Cantons,—qui a tué de sa main plus de soixante Iroquois,—qui, pour sauver son ami Misti-Tshinépik’, s’est vu deux fois, sans trembler, attaché au poteau, prêt à être brûlé vif,—qui entonnait la chanson de guerre pendant qu’on lui arrachait les phalanges de deux doigts, après les lui avoir fumés dans le calumet,—qui riait des tourments quand on lui mettait autour du cou un collier de haches rougies dont il conserve encore les cicatrices, cet homme doit avoir le droit de se croire peu accessible à la crainte.
Mais puisque vous doutez de mes paroles, interrogez Tshinépik’.
Vous avez entendu l’exclamation de cet Indien au moment où votre enfant indiquait du doigt cet objet mystérieux qui ne paraissait à nos yeux qu’une pâle vapeur.
Les paroles de l’enfant ont été pour lui un trait de lumière; et si vous eussiez compris la langue sauvage, les mots: Matshi Skouéou, qui lui ont échappé, vous auraient tout révélé, sans que j’eusse eu besoin de proférer une parole; car vous avez sans doute entendu parler de celle que les Blancs appellent: La Dame aux Glaïeuls, et que les Sauvages connaissent sous le nom de Matshi Skouéou, c’est-à-dire la Mauvaise Femme ou la Jongleuse.
⁂
A ce nom trop connu, Madame Houel, quoique douée d’une rare énergie de caractère, ne put réprimer un tressaillement involontaire.
Car on était à une époque où la superstition était encore si répandue et si vivace, que les personnes instruites mêmes, qui n’ajoutaient aucune foi aux contes populaires, ne pouvaient, en les écoutant, se défendre d’une secrète terreur.
Et dans un pays comme était alors le Canada, couvert d’immenses forêts inexplorées, peuplées de races étranges et à peine connues, tout était propre à entretenir et à fomenter les idées superstitieuses.
—En effet, pensa-t-elle, j’ai entendu parler de cette célèbre Jongleuse qui est parvenue à acquérir une si grande influence parmi les tribus iroquoises, et dont les Pères Missionnaires ont rapporté des choses si merveilleuses.
Ils ne doutent pas qu’elle n’ait des communications avec le mauvais esprit, et qu’elle n’opère par son influence des prodiges incroyables.[20]
On dit qu’elle est parvenue à soulever les Cinq-Nations contre la colonie,—que l’ambassade, envoyée dernièrement au gouverneur sous prétexte de conclure la paix, n’est qu’une infâme trahison ourdie pour endormir les colons,—et qu’ils trament, pendant ce temps, le projet de massacrer jusqu’au dernier Français.
Serait-il vrai, comme on le dit, qu’à la tête d’un parti d’Iroquois, elle rôde autour de nos habitations pour se saisir de quelque prisonnier important, afin de l’immoler à leur dieu Areskoui, et se le rendre ainsi propice dans la nouvelle guerre?
[20] Il n’y a aucun doute que la jonglerie pratiquée chez les Sauvages n’ait un caractère diabolique. C’est un fait qui a souvent été constaté par des témoins oculaires dignes de foi. Voici comment s’exprime à ce sujet le R. P. Arnaud, missionnaire du Labrador. “Par la force de leur volonté, dit-il, la cabane (des jongleurs) se met en mouvement comme une table tournante, et répond par des coups ou par sauts aux demandes qui lui sont faites. Eh bien! les voilà vaincus, tous les inventeurs des tables tournantes et des spiritual rappings! les jongleurs des Indiens infidèles peuvent leur servir de maîtres et leur montrer des choses plus surprenantes que celles qu’ils ont jamais connues. Tous nos grands magnétiseurs seraient également surpris de voir avec quelle facilité ces jongleurs manient le fluide magnétique; auquel je donnerai volontiers ici le nom de fluide diabolique.”
———
O mères!...........................................
Vous appuyez vos cœurs sur l’enfant qui chancelle;
Un souffle en l’effleurant le brise en son berceau.
...................................................
Le bonheur a toujours une forme fragile:
Le malheur est de fer, la joie est de roseau.
Anaïs Ségalas.
IV
Après avoir roulé quelques instants ces réflexions dans son esprit:
—Canawish![21]—dit-elle en s’adressant à l’impassible Indien qui avait écouté la conversation précédente sans prononcer une parole,—que dis-tu des présages du Canotier?
Le Sauvage sembla ne pas faire attention à cette demande et ne fit aucune réponse.
—Pourquoi la Grande Couleuvre ne répond-elle pas quand la fille des Visages Pâles lui adresse la parole?
Il y eut encore un moment de silence.
⁂
Enfin le Sauvage, dans son langage rempli de figures:
—Le Mirage du Lac qui dort sur les genoux de la Fleur des Neiges est plus beau que le nénuphar blanc des grandes eaux.
Le lac où se mirent la folle avoine et les roseaux du rivage est moins limpide que ses yeux, et son regard est plus brillant que l’étoile du soir.
Ses lèvres sont deux grappes de fraises mûres et ses dents sont des flocons de neige.
Les lianes au printemps sont moins flexibles que sa chevelure.
Aussi, quand la Fleur des Neiges contemple le jeune Visage Pâle, le sourire est-il sur ses lèvres et ses yeux sont-ils pleins de larmes de tendresse.
La Fleur des Neiges serait-elle donc aujourd’hui lasse de la vie de son enfant?
Ne sait-elle pas que pour évoquer celle que la jeune oreille du Mirage du Lac a entendue et que ses yeux ont vue, il suffit de prononcer son nom?
—Oh! s’il n’y a que cela à craindre, reprit Madame Houel en souriant, tu peux parler; la Dame aux Glaïeuls n’est pas un esprit pour entendre du fond des bois la voix de la Grande Couleuvre, quand ses paroles parviennent à peine à l’oreille de la Fleur des Neiges.
—Puisque ma sœur le demande, reprit l’Indien la Grande Couleuvre parlera;—mais si ses paroles évoquent la Matshi Skouéou, la Fleur des Neiges ne pourra s’en prendre qu’à elle seule.
—La fille des Visages Pâles ne craint rien; son cœur est fort comme celui du Tshinépik’!
—Quand la Fleur des Neiges saura que la Matshi Skouéou serait prête à mettre en liberté toutes les Peaux-Blanches captives chez les Iroquois pour pouvoir mettre la main sur l’enfant d’un chef des Visages Pâles, tel que le Mirage du Lac, son cœur sera-t-il aussi fort?
⁂
A cette terrible menace, Madame Houel tressaillit et pressa instinctivement contre son cœur le charmant enfant qui, insoucieux du danger, dormait tranquillement sur ses genoux.
Il ne parut pas même s’apercevoir de ce brusque mouvement; car le contact de cette douce main lui était connu.
Et que peut craindre en effet l’enfant dans ce sanctuaire de l’amour maternel?
L’hirondelle dans son nid redoute-t-elle le vent ou l’orage?
L’enfant entre les bras de sa mère, n’est-ce pas la fraîche goutte de rosée dans la virginale corolle du lis?
Tant d’innocence et de pureté ne semblent-elles pas devoir échapper au malheur?
[21] Expression sauvage qui répond au mot: Camarade.
———
Elle allume sa chevelure au feu des météores, et se promène sur les ombres de la nuit.
Ossian.
V
A peine Madame Houel eut-elle cédé à ce premier mouvement qu’elle rougit de sa faiblesse.
Honteuse d’avoir un moment reculé devant une idée superstitieuse, elle ajouta d’un ton ferme:
—Auprès de la Grande Couleuvre et du Canotier, la Fleur des Neiges ne tremble point pour les jours de son enfant. Mon frère peut parler.
—Tes deux amis sont prêts à donner leur vie pour toi, répondit l’Indien;—ils seront morts avant qu’aucun ennemi n’ose approcher de ton enfant;—mais qui peut lutter contre celle qui commande aux esprits?...
Le Sauvage lui fit alors le récit de tout le merveilleux dont l’imagination indienne entourait la célèbre Jongleuse.
Souvent le Canotier, entraîné par son habitude de causer, l’interrompait pour raconter quelques nouveaux prodiges dont les Blancs enrichissaient la légende sauvage.
⁂
La Matshi Skouéou,—disaient les récits populaires,—est en rapport avec le Mauvais Esprit.
Sa puissance égale celle de la Sirène aux cheveux tordus qui révèle sur les rivages des mers du Sud, les gisements des placers d’or et des bancs de perles.
Jamais on ne l’a vue de jour.
On dit que dans les ténèbres ses prunelles d’un vert glauque, étincellent comme la braise et que les lueurs sinistres et blafardes qu’elles lancent, fascinent comme le serpent ou l’abîme.
Une rivière de cheveux, noirs comme l’aile des huards, inonde sa tête toujours couronnée de fleurs de glaïeuls, et jaillit en cascades jusque sur ses épaules.
Son teint de cuivre, sa peau écailleuse, le rire sardonique qui crispe sa lèvre violette fait frissonner jusqu’à la moelle des os.
Elle soulève à chaque pas une poussière d’étincelles bleuâtres qui voltigent autour d’elle, profilant dans l’ombre d’étranges silhouettes.
Salamandre incombustible, elle marche impunément à travers la flamme des brasiers, sans que les tisons osent mordre même les pans de sa robe.
La brise nocturne,—le nuage qui passe lui apportent,—messagers fidèles,—le son de la voix de ceux qui l’invoquent.
A son cri, les hibous éveillés, écarquillant leurs fauves prunelles, sortent des crevasses des rochers et des ruines et répondent à son appel.
A l’heure de minuit, elle descend sur une étoile filante, ou sur un rayon de la lune et apparaît dans la nappe des cascades, à l’ombre des noirs rochers, sur le sable silencieux des dunes, ou parmi les vapeurs des vallées.
C’est l’heure qu’elle choisit pour accomplir ses mystères, car c’est l’heure où la brise s’endort dans la cime des arbres, et où tout repose dans la nature;—c’est l’heure où les feux-follets dansent sur le gazon pâle des prairies, dans les clairières, ou sur les eaux verdâtres des marécages;—c’est l’heure où les chauves-souris effleurent les flots unis de leurs ailes diaphanes, et se cramponnent, de leurs ongles grêles, à l’angle des rochers;—c’est l’heure où l’on n’entend pour tout bruit que le coassement des grenouilles et des crapeaux à l’œil roux, et le hou hou funèbre des oiseaux de nuit.
C’est aussi l’heure où la Dame aux Glaïeuls descend parmi les roseaux du fleuve, au bord des lagunes, pour cueillir les fleurs de glaïeuls dont elle couronne sa tête et pour faire ses invocations au Grand Manitou.
Quoiqu’aucun souffle n’agite l’air, on voit alors frissonner les tiges des algues et des aulnes qu’elle écarte pour se plonger dans les eaux du fleuve; et bientôt on voit sa tête apparaître, comme un météore, parmi les joncs et les nénuphars.
⁂
Au moment où la nouvelle lune se lève, de vagues et lointaines rumeurs, mêlées au coassement monotone des grenouilles, s’élèvent du sein des plantes aquatiques.
Voix surnaturelles qui semblent surgir du fond des eaux;—incantations mystérieuses, d’abord indécises, puis s’élevant peu à peu, et se prolongeant sur les flots en mélodie tour à tour suave comme des voix d’enfants, ou voilée comme la brise du soir parmi les halliers;—mais parfois aussi, éclatante et terrible, comme le rugissement de l’ours blessé, ou comme le roulement du tonnerre ou des cataractes.
Quelquefois aussi, quand l’ouragan des équinoxes rugit et tord la forêt par les cheveux, elle pose son pied, plus léger que celui des vaporeuses ossianides, sur l’écharpe des brumes dont la montagne enveloppe alors son épaule de pierre.
On dit que pendant ces délires de la nature, on la voit voltiger sur la crête d’argent des vagues en écume, et qu’alors les éclairs déchirent les flancs des nuages en colère pour venir se tresser en auréoles sur sa tête.
⁂
Enfants, disent les vieillards, n’allez pas le soir au lever de la nouvelle lune, sur les bords du fleuve.
Tapie derrière la verte frange des roseaux, la Dame aux Glaïeuls guette les petits enfants, et ses chants fascinent et entraînent comme le regard du reptile attaché à sa proie.
Oh! malheur à celui qui tombe entre ses mains!
Le sort qu’elle lui réserve est plus affreux que celui du prisonnier garrotté au poteau du supplice.
Les tortures du feu, les éclats de bois enfoncés dans la chair, la cendre brûlante sur la tête scalpée, les colliers de haches rougies n’effrayent pas le guerrier au cœur fort.
Il entonne son chant de mort quand ses ennemis déchirent sa chair en lambeaux.
Mais la Matshi Skouéou invente des supplices autrement atroces:
C’est au milieu d’horribles agonies de frayeur et d’épouvante qu’elle fait mourir sa proie.
Et quand le cœur de la victime tremble et bat comme celui du lièvre timide,—que ses cheveux se dressent sur sa tête,—que ses yeux se dilatent de terreur,—que ses lèvres livides frémissent comme la feuille du tremble,—que ses dents s’entre-choquent dans sa bouche,—que ses os craquent d’horreur,—que ses membres frissonnent comme les lianes tordues par la tempête,—alors la Dame aux Glaïeuls est dans l’ivresse et elle savoure, comme un chant, ces lamentables gémissements; car elle entend la voix du Noir Esprit qui lui révèle ses secrets à travers les râles d’agonie et de désespoir.
———
......................Cette plainte,
Qu’on écoute avec crainte
Gémir dans les roseaux;
——
Voix lentes et plaintives
Qu’on entend sur les rives
Quand les ombres du soir
Epaississant leur voile
Font briller chaque étoile
Comme un riche ostensoir.
Oct. Cremazie.
VI
Après ce récit prononcé d’une voix émue par une sorte d’enthousiasme religieux, le Sauvage et le Canotier gardèrent un moment de silence.
—C’est bien là, au fond, ce que rapportent les Missionnaires, pensa Madame Houel avec inquiétude........
Ciel! si jamais mon cher Harold venait à......
O mon Dieu! protégez mon enfant!
—Eh bien! reprit l’Indien, le cœur de la Fleur des Neiges est-il aussi fort maintenant?
—J’ajouterai foi à tous ces mystères quand j’en aurai été témoin, répondit Madame Houel d’une voix qu’elle cherchait en vain à rassurer.
Vous ne l’avez jamais vue, ni toi, ni le Canotier, n’est-ce pas!
—Madame,—repartit le chasseur canadien avec sa lenteur habituelle et un ton solennel qui dénotait une profonde conviction;—un soir que je remontais le Saguenay, je rencont....
Il s’arrêta tout à coup.
Un sourd ronflement, pareil au souffle profond du marsouin lorsqu’il vient respirer à la surface de l’eau, se fit entendre à l’avant du canot.
Un homme, qui n’aurait pas été habitué à la vie sauvage, n’aurait prêté aucune attention à ce bruit.
Mais l’oreille exercée du Canotier ne pouvait s’y méprendre.
C’était bien la voix du Tshinépik’ qui, pour lui signaler quelque danger sans donner l’éveil, imitait la respiration du marsouin.
Le chasseur prêta l’oreille un instant et crut entendre, dans le lointain, un son étrange et vague; d’abord à peine perceptible, puis se rapprochant, devenant plus distinct, et se prolongeant sur les flots en molles ondulations, pour s’éloigner, osciller encore et s’évanouir un instant après.
Longtemps ces mystérieuses vibrations, qui semblaient tantôt descendre des nuages, tantôt remonter du fond des cavernes de la mer, ou s’échapper d’une conque marine, ou filtrer à travers le treillis des bois, voltigèrent en notes intermittentes parmi le silence solennel de la nuit; ne parvenant à son oreille qu’à de longs intervalles, et par frêles lambeaux.
Il crut d’abord être le jouet d’une illusion; mais après quelques minutes de silence, la même mélodie bizarre; mais plus distincte et plus rapprochée.
—Eh bien! Madame, chuchota le Canotier, entendez-vous?... Croirez-vous maintenant aux paroles d’un homme qui n’a pas appris ce qu’il sait dans les livres?....
Et continuant comme s’il se fût parlé à lui-même:
....—Minuit!.... Ce soir la nouvelle lune et la........
—Bah! repartit Madame Houel, la plainte de quelque loup-marin sur les rochers.[22]
Le Canotier haussa les épaules, et attendit sans répondre.
—Vous aviez raison.—reprit enfin Madame Houel après quelque temps de silence,—j’entends maintenant très-clairement une voix; mais est-ce une voix humaine?.... Jamais je n’ai rien entendu de si extraordinaire.
Je sais que les Sauvages sont renommés pour la beauté de leur voix; mais ces magiques accents n’ont rien d’humain, tant ils captivent et entraînent avec un irrésistible attrait.
En effet, c’était une sorte d’incantation fantastique qui empruntait à la sombre majesté de ces heures solennelles et à son origine inconnue un singulier caractère de merveilleux et de surnaturel;—sorte de mélopée, tantôt plaintive et rêveuse, noyée de mystère et de mélancolie, ondulant sur la lame, flottant dans l’atmosphère et se perdant dans les plis de la brume,—soupirs infinis,—échos de voix d’anges,—rêves d’enfants au berceau,—chant des courlis;—ou bien, vive et légère, découpée en frileuses dentelles de sons, montant et descendant en spirales aériennes,—groupes de notes folâtres se tenant par la main;—et puis tout à coup, triste et morne, comme le vent d’automne qui brame dans les ramées, comme l’hymne funèbre sur les tombes;—ou, fanfare inouïe, vibrant comme un cuivre.
—Je distingue bien des paroles, dit tout bas Madame Houel au Canotier, mais d’une langue qui m’est inconnue.
—Je les comprends, mais il m’est impossible de vous les traduire: le sens en est plus dans le chant que dans les paroles.
....................................................
....................................................
Deux éclairs soudains, suivis d’une double détonation, interrompirent tout à coup les magiques évocations de la sibylle inconnue; et en même temps deux balles, venant du côté opposé à celui d’où l’on entendait cette mystérieuse musique, et dont une entama la pince du canot à quelques pouces du Canotier, sifflèrent aux oreilles des voyageurs.
Un souffle de terreur sembla rouler dans l’atmosphère avec l’écho de la double explosion répercutée par les nuages et les deux rives du fleuve.
Et puis tout rentra dans un silence si profond qu’il semblait que le fleuve eût toujours été entièrement désert.
[22] On sait que les cris du loup-marin imitent, à s’y méprendre, les plaintes d’un enfant.
———
Tout à coup, vite comme la pierre lancée par la fronde, la barque s’éleva sur la cime d’une vague, puis elle redescendit avec non moins de rapidité et glissa dans un gouffre, d’où, par un élan suprême, elle remonta encore.
Hyppolite Violeau.
VII
—Sept Iroquois dans le canot, chuchota le Tshinépik’; j’ai eu le temps de les compter à la lueur de l’explosion.
Camarade, nous allons être pris entre deux feux.
A droite, les Iroquois; à gauche, la Matshi Skouéou et ses compagnons.
—Il n’y a qu’un moyen,—reprit le Canotier avec la présence d’esprit et la promptitude de décision que donnent le calme et le sang-froid, fruit d’une longue habitude de vie au milieu des dangers,—c’est de dérouter nos ennemis.
Scie,[23] Tshinépik’, nous allons reculer quelque temps; puis nous gagnerons le rivage à force d’avirons.
Madame, retenez les pleurs de votre enfant; il faut du silence pour cacher notre marche.
Couchez-vous au fond du canot, vous courrez ainsi moins de risque d’être atteinte par les balles.
Ah! chiens d’Iroquois! murmura-t-il entre ses dents, vous êtes fort heureux que la vie de ces deux êtres faibles ait été confiée à ma garde; vous ne me verriez pas reculer ainsi devant vous: une cruelle expérience a dû vous apprendre que ce n’est pas ma coutume.
Que j’aurais de plaisir à loger du plomb dans quelques uns de vos crânes pour me refaire un peu la main. Vraiment le cœur m’en dit, car il y a déjà longtemps que je n’ai pas essayé mon fusil contre une peau rouge. Mais laissez faire, vous ne perdez rien pour attendre.
Tout en faisant ces réflexions, le Canotier, après avoir imprimé au canot un mouvement retrograde en nageant à reculons pendant quelque temps, avait tourné la proue de la légère nacelle vers le rivage, et pagayait vigoureusement dans cette direction.
—Nagez, nagez maintenant tant que vous voudrez, imbéciles d’Iroquois, reprit-il tout bas avec ironie, vous serez quelque temps, je pense, sans nous atteindre, si vous continuez de ce côté.
Vous croyez donc qu’un blanc est aussi bête que vous, et qu’il.....
Le cri d’un huard, qui s’éleva à quelque distance en avant du canot, éveilla son inquiétude et interrompit le cours des invectives qu’il ne ménageait jamais à ses ennemis dans ces moments de dangers.
—Je me trompe fort si c’est là le cri d’un huard, ..... il y a là des inflexions qui ne sont pas celles du huard.
Les infâmes coquins! auraient-ils prévu notre mouvement par hasard?....
A peine eut-il achevé ces mots, que deux raies de feu déchirèrent le voile des ténèbres en avant d’eux.
Heureusement pour nos voyageurs que la nuit était si obscure que l’ennemi ne pouvait viser qu’à peu près.
Les balles, dirigées d’une main incertaine, ricochèrent sur l’eau à quelques pieds du canot.
—Notre ruse est déjouée! s’écria le Canotier avec amertume.
Et, d’un coup d’aviron faisant décrire un angle à la proue du canot pour lui faire reprendre sa première position:
—Il est inutile de songer à atteindre le rivage, continua-t-il. C’est maintenant, Tshinépik’, qu’il nous faut montrer si nous entendons quelque chose à manier un aviron.
Ils sont sept contre deux; mais leur canot m’a l’air plus pesant que le nôtre et je doute qu’ils aient tous des avirons.
Madame, nous allons être obligés de jeter vos malles à l’eau, afin d’alléger notre canot autant que possible et de ne pas ralentir notre marche; car ce sera une course désespérée.
—Faites, faites tout ce que vous voudrez pourvu que vous arrachiez mon enfant des griffes de ces tigres, s’écria avec angoisse Madame Houel.
En un clin d’œil le canot fut débarrassé de tout ce qui pouvait l’allourdir.
—Maintenant, Tshinépik’, hardi sur l’aviron, et ensemble! Mais auparavant poussons notre cri de guerre pour montrer à ces mécréants que nous ne les redoutons pas plus que les poissons qui nagent sous nos pieds.
Deux cris horribles, capables de faire tressaillir les cœurs les plus intrépides, s’échappèrent à la fois de la poitrine des deux guerriers, et se prolongèrent au loin sur les flots.
Madame Houel se boucha les oreilles de terreur.
Le Canotier! La Grande Couleuvre!—répétèrent en chœur les Iroquois reconnaissant la voix des deux héros qui avaient acquis une si terrible célébrité en immolant un nombre effrayant de leurs plus braves guerriers; et d’épouvantables hurlements répondirent à leur cri.
Puis à cette infernale harmonie succéda un morne et lugubre silence, comme si la nature entière, glacée d’épouvante, avait suspendu tous ses bruits.
On n’entendit plus que le bouillonnement de l’eau sous les coups des avirons, et le clapotement de la vague sur les flancs de la légère pirogue qui bondissait sous les énormes brassées du Canotier, aidé du Tshinépik’, et volait sur la nappe du fleuve, comme ces légères plumes détachées de l’aile des oiseaux et qu’emportent en se jouant, sur les flots, les grandes brises des mers.
Le salut des fugitifs ne dépendait plus que de la vigueur des nerfs des deux rameurs.
Que la lassitude vint, un moment, à amollir et à détendre l’acier de leurs muscles, c’en était fait d’eux; et leurs chevelures scalpées séchaient à la ceinture des Iroquois.
Le Tshinépik’, il est vrai, était un habile et vigoureux rameur; et la supériorité du Canotier à conduire un canot et à manier l’aviron était sans égale.
Son habileté, en ce genre, était si bien connue dans toute la colonie et même parmi les tribus indiennes qu’elle lui avait valu le surnom de Canotier.
Outre une longue habitude, acquise pendant toute une existence consacrée à la vie sauvage, la nature, en le douant d’une force musculaire exceptionnelle et en développant ses deux longs bras d’une manière démesurée, semblait l’avoir formé tout exprès pour ce genre d’exercice.
D’ailleurs, c’est un fait digne de remarque que les blancs une fois accoutumés aux mœurs et aux arts indiens les surpassent bientôt, non seulement en adresse, mais même en vigueur.
Car, sans parler de leur supériorité intellectuelle, ils paraissent encore jouir d’une constitution plus robuste.
Mais, quelque fussent les avantages personnels des deux rameurs, ils étaient trop inférieurs en nombre pour pouvoir, ce semble, lutter longtemps avec chance d’échapper.
Et puis, une balle perdue pouvait, d’un moment à l’autre, casser un bras, ou fendre un aviron.
Cependant ces dangers si éminents ne faisaient rien perdre au Canotier de son admirable sang-froid, et paraissaient n’avoir d’autre effet que de délier sa langue:
—Il faut montrer à ces chiens d’Iroquois que nous nous connaissons en écorce de bouleau, Tshinépik’.
Je ne nie pas qu’ils ne possèdent quelqu’habileté à fabriquer un canot; mais ils ne savent pas comme nous choisir la véritable écorce.
Et puis, ont-ils jamais eu le tour de relever avec grâce les deux pinces d’un canot de manière à lui donner cette forme svelte qui prête aux nôtres un air si coquet quand ils dansent sur la lame?
Ah! je reconnaîtrais un des miens parmi toute une flotte de canots iroquois. Ne me parlez pas non plus d’un canot mal gommé; il faut pour qu’il glisse bien sur l’eau que l’enduit de gomme soit posé avec tant de soin que les flancs soient polis et glacés comme la lame d’un rasoir.
Alors ce n’est plus un canot;—c’est une plume, c’est une aile d’oiseau qui nage dans l’air;—c’est un nuage chassé par l’ouragan;—c’est quelque chose d’aérien, d’ailé, qui vole sur l’eau comme... comme nous maintenant.
Le Canotier disait vrai; car la légère pirogue, obéissant à ses gigantesques coups d’aviron, semblait à peine effleurer les flots.
On eût dit une sarcelle, effrayée par le chasseur, rasant la cime des vagues à tire d’aile.
—Camarade, voici encore deux balles à notre adresse,—interrompit le Tshinépik’, qui jusque-là s’était renfermé dans ce silence flegmatique qui caractérise la race indienne, et que les Sauvages affectent surtout au moment du danger, afin de cacher toute émotion;—l’Iroquois s’imagine déjà nous avoir devancés, car ses coups ont porté en arrière de notre canot.
Mais mon frère s’aperçoit-il que nous n’avons rien gagné et qu’ils sont toujours en ligne avec nous?
—Ça ne peut pas durer, tu as raison, reprit le Canotier en secouant la tête; nous ne sommes jamais capables de les dégrader. Ils sont trop nombreux contre nous.
———
Quelques uns,......... furent immédiatement tués, d’autres ne savaient pas nager, et après une lutte frénétique, épuisés, sans espoir ils se laissèrent engloutir.
Hyppolite Violeau.
VIII
Il se fit un moment de silence lugubre et plein d’une terrible anxiété.
Le Canotier cherchait en vain une issue pour sortir de ce mauvais pas.
—Promettons une messe en l’honneur de la bonne Sainte Anne,—dit Madame Houel qui n’avait pas cessé de prier depuis le commencement de la lutte,—et je suis sûre que le bon Dieu nous sauvera.
—Je le veux bien, Madame.... Il n’y a que Dieu qui puisse nous faire échapper.... Pour moi, j’ai épuisé toutes mes ressources.... Mais toi, Tshinépik’, as-tu quelqu’expédient à suggérer?
L’Indien réfléchit.
—Mon frère est un grand rameur;—le saumon qui remonte les rapides n’est pas plus habile avec sa queue que mon frère avec son aviron.
A chacun de ses coups, le Tshinépik’ sent le canot se soulever sous lui.
Mais mon frère a-t-il le bras assez fort pour ramer à lui seul comme nous deux ensemble, tandis que le Tshinépik’ va essayer de déplanter un Iroquois?
—J’essayerai bien tout ce qu’il est donné à l’homme de faire avec deux bons bras, repartit le Canotier; mais je crois que ce serait à peu près inutile, car tu ne pourras que tirer au hasard par la nuit qu’il fait; et puis un coup de fusil nous trahirait en révélant au juste notre position.
—Une flèche ne laisse pas d’éclair derrière elle, répliqua froidement l’Indien—et le Tshinépik’ attendra le moment où l’Iroquois va tirer, et visera sur la lueur de l’amorce.
—Bien pensé!—fit le Canotier avec enthousiasme, en se mettant à ramer avec une vigueur si prodigieuse qu’il semblait que jusque là il n’eût fait que tremper son aviron dans l’eau;—j’ai toujours soutenu, avec raison, qu’il y a souvent plus de cervelle dans la tête d’un Sauvage que dans bien des têtes européennes....
Appareille-toi, Tshinépik’; je viens d’entendre un bruit sec comme celui d’un fusil qu’on bande; je crois qu’ils vont tirer.
Une détonation lui coupa la parole.
Un instant après, un cri de mort retentit vers le canot ennemi, et prouva que la flèche de l’habile Indien n’avait pas manqué son but.
Mais, en même temps, un autre cri, un cri de rage lui répondit.
C’était la voix du Canotier.
Une balle venait de fendre son aviron en deux.
Il est, dans la vie, des instants de souffrance morale que nulle torture, nul supplice corporel, la mort même ne sauraient égaler.
C’est l’instant fatal où l’on voit se dresser devant soi le fantôme implacable d’une mort certaine; où l’on sent l’étreinte mortelle vous saisir d’une main assurée.
C’est là le paroxysme de la souffrance.
L’héroïsme seul est capable de l’envisager de sang-froid.
Telle était cependant la position en face de laquelle se trouvaient les fugitifs.
Le Canotier avait épuisé toutes les ressources que le génie sauvage et une longue expérience avaient pu lui inspirer.
Il ne restait plus qu’à attendre la mort.
Déjà on entendait à quelques pas en avant du canot le bouillonnement de l’eau sous les avirons d’un des canots ennemis.
—Mon frère est-il prêt à mourir, dit le Canotier d’un ton calme.
—Le Tshinépik’ l’a toujours été....
Et comme si un éclair subit eût traversé son cerveau, il ajouta quelques mots en langue sauvage et passa son aviron au Canotier.
On aurait pu le voir alors se pencher doucement sur la pince du canot, s’y glisser sans bruit pour se jeter à la nage et disparaître.
La légère pirogue, soulagée tout à coup, se releva de l’avant, pendant que le Canotier lui imprimait un mouvement rétrograde, afin d’éviter une collision avec le canot ennemi.
En ce moment, la lune filtra un de ses rayons à travers le roulis des brumes; et ce pâle cil d’argent, venant effleurer la frange d’un nuage moins opaque, permit d’entrevoir, pendant un instant, la scène du combat.
Tout à coup le canot iroquois chavira au milieu de hurlements épouvantables. Ce fut alors une scène de confusion indescriptible.
On vit, pendant quelques instants, un bras armé du tomahawk asséner des coups terribles sur la tête des Iroquois qui se débattaient au milieu des flots.
L’attention du Canotier qui se tenait à une légère distance afin d’empêcher les Iroquois naufragés de saisir son canot, et qui suivait les diverses phases de la lutte pour recueillir à temps son audacieux ami, fut alors détournée par un cri déchirant poussé par Madame Houel:
—La Jongleuse!!
En même temps, il entrevit comme une forme noire qui semblait surgir des flots à côté du canot et étendre la main comme pour saisir le jeune enfant.
Décharger un vigoureux coup d’aviron sur l’objet indécis qu’il croyait apercevoir dans l’ombre, fut pour lui l’affaire d’un instant;—mais son coup porta dans le vide, et fit seulement jaillir une poussière d’eau.
Le cri d’un pirouys[24] se fit alors entendre, et le Canotier, reconnaissant le signal convenu avec le Sauvage, tourna son canot dans la direction d’où venait le cri, et un instant après le Tshinépik’ triomphant embarquait habilement dans la légère nacelle, tenant d’une main un aviron.
Avec cette présence d’esprit qui distingue si éminemment les Sauvages, et qu’ils conservent au milieu des plus grands dangers, l’Indien, pendant le combat, avait arraché des mains d’un Iroquois cet aviron dont ils avaient absolument besoin pour leur fuite.
Pendant que l’autre canot iroquois se hâtait de venir au secours des naufragés, que le tomahawk du Tshinépik’ n’avait pu atteindre, les fugitifs profitèrent de l’obscurité profonde que faisaient alors d’épais nuages qui se roulaient pesamment dans le ciel, et gagnèrent le rivage sans que leurs ennemis eussent pu remarquer la direction qu’ils avaient prise.
[23] En terme de marine, scier veut dire ramer à reculons.
[24] Espèce de gibier connu aussi sous le nom de chevalier. Le surnom de pirouys, que lui donnent les chasseurs, est une imitation de son cri.
———
Oh! que ne suis-je tombé dans la bataille!...... La gloire de Duthona a passé comme le rayon silencieux du soleil d’automne, lorsqu’il tombe sur les boucliers à travers l’ombre des brouillards.
Ossian.
IX
Le lendemain, le Canotier aperçut, en s’éveillant aux premières lueurs de l’aube, l’Indien occupé à panser une large balafre qu’il avait reçue au visage dans le combat de la veille, et deux profondes blessures, l’une à la poitrine, et l’autre au bras gauche.
Le Sauvage n’avait pas même pris la peine d’en dire un mot à son ami.
—Mon frère s’est bien battu hier, dit le Canotier;—cinq cadavres iroquois s’en vont maintenant à la dérive, et vont servir de pâture aux poissons. Mais mon frère a été blessé.
—Ce n’est rien;—l’Iroquois est une femme;—il ne fait que de petites égratignures.
—Mon frère a perdu beaucoup de sang: il a besoin de se reposer. Moi, je vais aller dans le bois tuer quelques gibiers pour notre déjeuner.
⁂
A son retour, le Canotier fut saisi d’horreur en apercevant sur le rivage qu’il venait de quitter une mare de sang et trois cadavres étendus sans vie.
L’un d’eux avait la tête scalpée; et il reconnut en lui, avec une indicible douleur, son fidèle compagnon que les Iroquois avaient surpris et massacré pendant son absence.
Les deux cadavres iroquois couchés à ses côtés, et deux longues traînées de sang, qui se perdaient sur le seuil du rivage, témoignaient qu’il avait vendu chèrement sa vie.
Madame Houel et son enfant avaient disparu;—et nulle trace sur le sable n’indiquait qu’ils avaient pris la fuite.
En levant les yeux vers l’horizon, le Canotier aperçut dans le lointain deux canots chargés d’Iroquois qui descendaient le fleuve à force d’avirons.
Anéanti de désespoir, il demeura longtemps immobile, les yeux cloués sur le cadavre de son fidèle ami, comme si la douleur eût pétrifié tous ses membres.
Les premiers rayons du soleil levant, qui tombaient alors sur la figure de l’Indien, et l’illuminaient d’une auréole d’opale, dissimulaient pour un instant l’horrible fixité du regard qu’imprime la dernière agonie.
Et ce dernier reflet de ses yeux semblait lui dire un adieu suprême.
⁂
S’arrachant enfin de sa léthargie, le Canotier se baissa lentement sur le cadavre de celui qu’il avait tant aimé, et qui avait partagé, pendant tant d’années, toutes ses joies et toutes ses tristesses, tous ses triomphes et tous ses périls,—et le soulevant doucement entre ses bras, dans l’ivresse de son désespoir, il le pressa sur sa poitrine, comme s’il eût voulu par cette suprême étreinte faire passer toute son âme dans cette dépouille inanimée.
Un immense soupir s’échappa enfin de sa poitrine, qui se soulevait comme une montagne.
Cet homme de fer, que ni les dangers, ni les tortures n’avaient jamais fait sourciller, succombait sous le poids de la douleur.
Des torrents de larmes inondaient ses joues.
⁂
—O mon ami! mon bien-aimé ami!—s’écria-t-il enfin parmi ses sanglots—je t’ai donc perdu pour jamais! C’en est donc fait; seul désormais, il me faudra errer à travers ces forêts et ces fleuves que nous avons parcourus tant de fois ensemble!
Désormais solitaire, je cheminerai à travers les sentiers de la vie, sans que jamais ta voix amie retentisse à mon oreille!
Heureux si la mort m’eût enlevé le premier!
Toi du moins, tu as un ami pour te rendre les derniers devoirs; mais moi, personne à ma dernière heure ne viendra jeter un peu de sable sur ma dépouille.
.... O Tshinépik’!.... Tshinépik’! adieu!....
L’écho de la montagne répéta au loin: adieu!
A cette voix le Canotier tressaillit, comme s’il eût entendu celle de son fidèle compagnon, lui jetant une dernière parole de reconnaissance.
Déposant enfin son précieux fardeau, il creusa une fosse dans le sable du rivage et y coucha le cadavre.
Après l’avoir recouvert, il ébrancha un jeune sapin qui croissait à la tête de la tombe; et, fixant sur le tronc une branche transversale, il en fit une croix.
Puis, scalpant les deux cadavres iroquois gisant sur la plage, il planta, avec le couteau du Tshinépik’, leurs chevelures au centre de la croix.
Etrange et terrible trophée, mais digne de ce héros des bois.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.
———
Tout était d’or ou de rose dans la solitude.
Chateaubriand.
I
[25]De longues années ont passé sur les événements que nous venons de raconter.
C’est encore un jour d’automne; une de ces belles matinées, roses et vermeilles, que l’été laisse tomber de sa couronne en fuyant devant le vent frileux qui déjà commence à souffler sur le soleil.
Déjà les rosées du matin, si tièdes en juillet, se crystallisent en givre sur les toits, et sur les pointes des herbes qui jaunissent.
C’est la saison d’octobre, la mélancolique saison des feuilles mortes!
Accoudée là-bas sur la montagne, elle jette un dernier sourire plein d’enivrante langueur au moissonneur qui se hâte de cueillir sa gerbe dans les prés.
Au ciel, quelques nuages gris dans l’azur plus terne;—dans l’air calme, les divins silences de la nature qui s’endort;—sur le dôme des bois, les nuances les plus riches et les plus variées:—rouges et sanglantes sur le feuillage des érables,—jaune paille sur les trembles, les bouleaux, les noisetiers,—d’un vert dur et foncé sur les épinettes,—plus tendre sur les mélèzes et sur les aiguilles luisantes des sapins.
C’est aussi la saison des labours d’automne.
Dans les champs barbelés de chaume doré, on voit de toutes parts les robustes habitants tracer ferme leur sillon.
Une voix éclatante s’élève de fois à autres dans l’air sonore:—hue! dia! c’est le cri de l’enfant qui touche pendant que son père tient les manchons de la charrue.
Tandis que les hommes sont occupés aux travaux des champs, les femmes ne demeurent pas inactives, car c’est aussi le temps de brayer le lin,[26] et il faut se hâter de profiter des derniers beaux jours.
La vie canadienne n’offre pas d’aperçus plus attrayants, de scènes champêtres plus fraîches et plus pittoresques; mais, hélas! les chemins de fer, les bateaux à vapeur, la civilisation nous auront bientôt enlevé jusqu’aux derniers vestiges de ces délicieuses scènes de mœurs qui donnent à notre peuple sa physionomie caractéristique.
Hâtons-nous donc d’en recueillir et d’en peindre les riants tableaux, afin qu’au moins ces souvenirs du passé poétisent un peu notre avenir.
⁂
Vous souvient-il de ces groupes de femmes que l’on voit quelquefois, en octobre, réunis sur la lisière du bois, au flanc de quelque rocher?
Ce sont les brayeuses de lin.
Elles choisissent ordinairement ces endroits, afin de se mettre à l’abri du vent.
Deux petits murs en pierre de trois ou quatre pieds de hauteur sont adossés au flanc du rocher de manière à former une espèce de cheminée sur laquelle on dispose transversalement quatre on cinq perches de bois dur, qui servent de séchoir pour le lin.
Une grosse buche posée à terre à l’entrée de la cheminée empêche le feu de s’étendre et protège la chauffeuse qui doit concentrer toute son attention sur le lin pour l’empêcher de s’enflammer.
Car malheur à elle s’il lui arrive de faire une grillade. Les rires et les moqueries de ses compagnes l’attendent pour lui faire expier sa maladresse.
Aussitôt que le lin est suffisamment séché, chaque personne en saisit une poignée et la broye vigoureusement, tandis qu’elle est chaude, entre les deux bois de la braye, afin de débarrasser le lin de son écorce.
Rien de gai, rien de poétique alors comme d’entendre le bruit sec et éclatant des brayes qui frappent, se relèvent et retombent en cadence au milieu des cris et des joyeux éclats de rires des enfans qui folâtrent sous la colonnade du bocage.[27]
C’est auprès d’un de ces groupes, réuni au pied d’un rocher encadré de bouquets d’arbres et situé à peu de distance de la Pointe de la Rivière-Ouelle, que vient se renouer le fil de notre légende.
[25] On sait que les derniers beaux jours de l’automne sont connus généralement en Canada sous le nom de l’Eté des Sauvages.
[26] Le mot brayer est évidemment une corruption du verbe broyer.
[27] Le braye est un instrument composé de deux bois, retenus par une de leurs extrémités, et s’enclavant l’un dans l’autre à la manière d’une mortaise.
———
Cette apathie terrible, cette funeste résignation pénétrait mon âme de je ne sais quelle épouvante et me glaçait le cœur.
Ballanche.
II
—Pierre, disait une des femmes à son enfant, va dire à ton père de venir dîner; il s’en va midi.
Les sonores et lointaines volées de l’angelus tombaient en vibrantes cascades du vieux clocher de la Rivière-Ouelle, et versaient leurs joyeuses ondulations entre les deux rives de la vallée pour annoncer l’heure de midi, quand le laboureur arriva au milieu de sa famille.
—L’angelus! mes enfants, dit-il d’un ton grave en se tournant vers l’église et en ôtant son bonnet de laine.
Puis, les yeux au ciel, il récita lentement la pieuse invocation.
Nulle part le rayon de la divinité n’est plus visible que sur la figure simple et sereine de l’homme des champs, quand l’ange de la piété vient ainsi le toucher de son aile.
—Papa! s’écria le petit Pierre en terminant son signe de croix, il y a deux hommes, là-bas, qui viennent de débarquer d’un canot au bout de la Pointe.
—Quelques bourgeois de la compagnie de la pêche à marsouin qui viennent faire leur tournée[28].... Pourtant non, ils ne sont rien que deux....
As-tu de quoi leur donner à dîner, ma femme?
Nous allons les inviter.
⁂
—Bonjour, messieurs,—ajoutait-il, un instant après, à l’arrivée des deux voyageurs qui s’étaient dirigés en droite ligne vers le rocher comme s’ils eussent parfaitement connu les lieux qu’ils parcouraient.
Souhaitez-vous prendre quelque chose?
Vous avez encore joliment loin avant d’arriver aux maisons....
Un morceau de pain ne fait pas dommage quand on a ramé une demi journée de temps.
—Puisque vous êtes si obligeant, nous ne vous refuserons pas,...... d’autant plus que nous n’allons pas plus loin qu’ici.
—Comment? Est-ce que vous ne descendez pas aux maisons,—fit le brave habitant tout intrigué, jetant vainement les yeux autour de lui pour chercher quel pouvait être le but de leur visite à ce rocher isolé?
Les voyageurs se regardèrent sans répondre, et l’un d’eux, à l’air triste et abattu, ne put réprimer un soupir.
Pendant le frugal repas, ils répondirent poliment aux questions qui leur étaient faites; mais furent peu communicatifs.
Le plus âgé était un grand vieillard chauve qui semblait entourer son compagnon de cette respectueuse protection qu’autorise chez un inférieur un long dévouement.
Des manières aisées et un air de dignité décelaient, dans celui qui l’accompagnait, une origine plus relevée; et, sous la simplicité de ses vêtements, perçait une éducation soignée.
La fraîcheur de sa figure indiquait un homme dans la vigueur de l’âge, et cependant, ses cheveux étaient entièrement blancs.
Mais, pour un œil observateur, il était facile de voir que le malheur plus que l’âge avait neigé sur son front.
On remarquait aussi, sur sa physionomie, cet affaissement particulier des muscles qui se produit à la longue, quand au fond de l’âme se reflète sans cesse une image toujours triste; et, dans son regard, ce voile mélancolique dont enveloppe et ternit la prunelle une douloureuse pensée qui monte incessamment du cœur aux yeux.
Ce regard attristé donnait froid, et glaçait le sourire sur toutes les lèvres.
Cependant l’incarnation de la tristesse sur cette figure n’avait rien de répulsif; au contraire, cette douleur toute sympathique n’excitait que la compatissance.
C’était le crêpe d’un noble deuil, et non le sinistre nuage du remord.
Peu à peu les bruyantes causeries des enfants s’étaient évanouies devant cette paupière qui se soulevait lentement sur eux, triste et morne comme le couvercle entr’ouvert d’un cercueil; et d’où s’échappait un rayon qui se posait sur leurs lèvres comme le doigt d’un mort.
Les traits de l’étranger paraissaient s’être encore visiblement rembrunis depuis son arrivée, et son œil hagard se fixait avec une telle apreté sur le sol autour de lui, qu’un eût dit que chaque parcelle de ce terrain lui rappelait quelque navrant souvenir.
Un silence gênant avait succédé à la gaieté naguère si vive de la famille.
Le brave laboureur avait grandement envie de connaître l’objet de leur voyage; mais les deux inconnus ne paraissaient pas vouloir aborder volontiers ce sujet. Enfin il se hasarda à leur faire quelques questions.
—Vous allez me trouver peut-être un peu curieux, dit-il en se tournant vers le vieillard; mais me permettriez-vous de vous demander votre nom?
—Il vous serait à peu près inutile de le savoir; car on me connaît à peine sous mon nom de famille.
Mes oreilles mêmes l’ont oublié.
Depuis bien des années, je n’ai jamais été nommé autrement que le Canotier.
C’était, en effet, notre fidèle guide.
Mais le brave chasseur avait bien vieilli depuis le jour où il avait couché dans la tombe une part de lui-même avec le cadavre de celui qu’il avait aimé plus que la vie.
Le vent des jours mauvais avait dépouillé sa tête, et n’avait laissé sur ses tempes que de rares touffes de cheveux blancs.
Hélas! le front perd bien vite sa couronne quand sur le cœur pèse le poids d’un cercueil! Les rides, qui vieillissent la figure, ne sont pas toujours creusées par le sillage des années; plus souvent elles sont les tombes de ceux qui nous furent chers!
⁂
Le lecteur soupçonne maintenant le nom du second personnage.
Ce n’était autre que le fils de Madame Houel, arrivé au sommet de la vie.
—Serais-je indiscret en vous demandant le motif de votre visite en ce lieu, continua le laboureur en s’adressant toujours au Canotier?
Celui-ci ne répondit pas, et se contenta de jeter un coup d’œil interrogateur sur son compagnon.
—Un bien triste devoir,—reprit enfin le fils de Madame Houel d’une voix dont le timbre mélancolique était en harmonie avec la tristesse de son regard.
N’avez-vous jamais entendu parler d’un événement tragique qui s’est passé ici autrefois?
—J’ai bien entendu parler de quelque chose; mais il faut vous dire qu’il n’y a pas longtemps que j’ai acheté une terre par ici, et je n’ai jamais eu l’occasion de me faire raconter cette histoire.
Cédant alors aux instances de ses hôtes, le fils de Madame Houel fit le récit des événements que le lecteur connaît déjà.
[28] Autrefois la pêche à marsouin de la Rivière-Ouelle était exploitée par une société de riches commerçants de Québec.
———
Mais, disais-je tristement, c’en est donc fait, hélas! et voilà qu’au milieu de ma force, au seuil de mon avenir, tout à coup, par la porte des humiliations, j’entre dans la vieillesse du corps et du cœur.
Louis Veuillot.
III
“Après que les Iroquois nous eurent fait prisonniers, continua-t-il, ils nous lièrent fortement les mains et les pieds, nous jetèrent au fond d’un de leurs canots et s’éloignèrent avec précipitation.”
Pendant plusieurs jours, ils descendirent le fleuve en côtoyant toujours le rivage.
Dieu seul connaît les tourments inouïs qu’ils nous firent souffrir durant cet interminable trajet.
Les courroies, composées d’écorces très-dures, qui liaient nos membres étaient si serrées que nos pieds et nos mains en devenaient tout bleus.
De temps en temps, ils se donnaient le féroce plaisir de les arroser d’eau, afin d’augmenter nos souffrances.
Alors les liens se resserrant de plus en plus, nos douleurs devenaient intolérables.
Je ne cessais de pousser de lamentables gémissements qui déchiraient l’âme de ma pauvre mère.
Quant à elle, insensible à ses propres tourments, elle n’avait de larmes que pour moi.
Hélas! quel supplice pour le cœur d’une mère! sentir son enfant près de soi, voir couler ses pleurs, entendre ses douloureuses plaintes, le voir se tordre dans l’agonie du désespoir, et ne pouvoir le soulager! Oh! pour l’âme d’une mère, quel glaive! quel martyre!
Lorsque les Iroquois étaient fatigués, ils nous déliaient les mains, et, sans égard pour la fragilité de ma mère, ni pour la faiblesse de mon âge (j’avais à peine dix ans à cette époque,) ils nous forçaient de ramer à leur place.
A peine pouvions-nous tenir les avirons, tant nos doigts étaient engourdis par les cordes.
Alors, ils nous accablaient de coups, jusqu’à ce qu’enfin, surexcités par l’excès de la douleur, nous redoublions de pénibles efforts, rendus encore plus accablants par le manque d’habitude.
Quelques restes de gibiers, ou quelques lambeaux infectes de chair d’orignal, que nous jetait une féroce pitié, formaient toute notre nourriture.
Pendant ce long voyage, nous ne vîmes pas une seule fois la Jongleuse qui se tenait (du moins telle était ma conviction) dans l’autre canot toujours bien en avant du nôtre.
Tous les ordres semblaient émaner d’elle; d’elle venaient toutes les évolutions de la petite armée.
Chaque soir, à la tombée de la nuit, après avoir allumé leur feu sur le rivage et terminé leur repas, ils se divertissaient à inventer contre nous de nouvelles tortures; et quand nous étions entièrement épuisés, ils nous laissaient, demi-morts,—étendus, enchaînés, sur le sol,—et exposés à l’humidité glaciale de la nuit.
La fièvre, que nous causaient nos meurtrissures, nous rendait bien plus sensibles au froid; et nous passions les nuits entières, tout transis, sans pouvoir fermer l’œil.
Un autre sujet d’angoisse venait encore accroître l’horreur de ces heures éternelles qui formaient les longs anneaux de ces nuits sans fin: c’était la peur.
Au milieu de l’engourdissement et du sommeil agité qu’amenait enfin la prostration des forces de la nature, mille éblouissements, mille lumières fauves, mille fantômes grimaçants, aux yeux livides, et grinçant des dents, que l’excitation nerveuse, causée par la fièvre, élançait de mon cerveau en feu, me faisaient tressaillir sur ma couche glacée.
Et puis, cette invisible Jongleuse, attachée à nos pas comme un mauvais génie, dressait sans cesse son spectre de vampire devant mon imagination enflammée.
Alors, pendant qu’une sueur froide ruisselait sur mon front, que mes cheveux se hérissaient sur ma tête, qu’un frisson d’effroi courait sur ma peau, que mes dents claquaient dans ma bouche, je me soulevais à demi, et, les yeux fixes et béants, j’essayais de repousser d’une main frémissante les gestes et les contorsions menaçantes de ces êtres impalpables que suscitait l’infernale vision.
Une nuit, pendant un de ces cauchemars, j’éprouvai à la figure une sensation horrible; quelque chose de froid et d’humide se frôlait le long de ma joue.
Etait-ce le doigt sépulcral de la diabolique Jongleuse?....
Je bondis sur le sol en poussant un cri qui réveilla tout le camp....
C’était le corps gluant et glacé d’une couleuvre qui venait de glisser près de moi et de passer sur ma figure!
———
Ma mère! avez-vous su comme je vous aimais?
........ ...... .................................
............... ....... .......... ..............
Tel que je l’ai senti, je ne l’ai dit jamais.
Victor de la Prade,
Poèmes Evangéliques.
IV
Enfin nous débarquâmes, un soir, sur les crans que vous voyez là-bas, et où vous nous avez vus aborder, il y a quelques instants.
Le trajet que nous venions de parcourir aurait pu se faire en assez peu de temps; mais notre marche avait été beaucoup retardée par de fortes brises de vent de nord-est.
Les Iroquois nous firent porter leurs canots à terre, et vinrent camper, ici, au pied de ce rocher.
Quoiqu’il ne fût pas encore bien tard, l’ombre du soir avait déjà pénétré sous la voûte du bocage; car on était en automne.
Après nous avoir fait amasser, auprès de leur feu, une provision de bois pour la nuit, et s’être étendus quelque temps sur l’herbe pour se reposer à la suite de leur repas, ils se levèrent soudain ensemble, sans proférer une parole et se réunirent en conseil sous cette touffe d’arbres qui s’élève encore à quelques pas d’ici.
Ce mouvement spontané me fit croire à un ordre de l’invisible Jongleuse, dont chaque soir, soit hallucination, soit réalité, je croyais apercevoir la démarche légère comme celle d’un esprit, au bord de la pénombre projetée par la flamme du bûcher.
L’air mystérieux qu’ils avaient affecté durant tout le jour, les préparatifs de la soirée, ce conseil extraordinaire nous faisaient pressentir que l’heure formidable était venue, où notre sort allait enfin se décider.
Agenouillé, avec ma mère, auprès d’un érable au tronc duquel elle avait accroché une petite statue de la Sainte Vierge qu’elle portait toujours sur elle, j’unissais ma tremblante prière à la sienne en suivant son regard ardemment fixé sur l’image sacrée qu’un reflet du brasier enchâssait d’une auréole de pourpre;—symbole ineffable du rayon céleste qui versait, en ce moment, une dernière étincelle d’espoir au milieu des agonies de nos cœurs.
Par intervalles, mes yeux inquiets se reportaient involontairement sur le groupe des Sauvages dont nous pouvions entendre les paroles inintelligibles, apportées par les bouffées nocturnes, et entrevoir confusément la pantomime expressive à travers les ténèbres.
Après qu’ils eurent tous parlé, et se furent assis, chacun à son tour, une ombre se dressa au centre du conseil et profila, sur le voile opaque de la nuit, sa vacillante silhouette que léchaient au loin les sanglantes rougeurs intermittentes du foyer; et une voix, dont mon oreille effrayée crut reconnaître le timbre étrange, retentit dans le silence.
C’était (du moins je le crus alors), c’était la voix de la Jongleuse.
Longtemps elle parla et gesticula comme si elle eût voulu faire prévaloir un avis qui trouvait peu d’écho dans l’esprit de ses farouches auditeurs.
Enfin, la main de l’être inconnu indiqua d’un geste les deux prisonniers, et le conseil se termina.
Tous les Sauvages se levèrent ensemble.
C’était l’heure fatale!
A cette pensée seule, tous mes membres frémissent encore d’épouvante!.... Ma respiration s’arrête!.... J’étouffe d’horreur!....
—O mon Dieu!—murmura tout bas ma mère, pensant que je ne l’entendais pas et me pressant sur son cœur de ses deux mains qui ne tremblaient que pour moi,—O mon Dieu!.... Mon enfant!... Qu’ils fassent de moi ce qu’ils voudront! Je suis prête à endurer toutes leurs tortures; mais, mon cher Harold! ah! pitié, mon Dieu!.... Pitié pour ce tendre agneau!.... Pitié pour mon pauvre enfant!....
Et, toute sanglotante, elle me pressait avec cette étreinte désespérée de l’amour maternel transfiguré par les navrantes extases du sacrifice et de l’immolation suprême.
Elle ne songeait pas même à implorer la pitié de ces monstres sans entrailles.
Le tigre attendri épargne-t-il jamais l’innocente brebis?
Son âme fermée à tout espoir ne se tournait plus que vers Dieu d’où seul le secours pouvait venir.
Ah! ma mère! Le ciel entendit votre prière, et votre sacrifice fut accepté; mais à quel prix, grand Dieu!....
L’un des Iroquois, tenant à la main un long éclat de bois effilé, s’approcha de moi, et le mettant entre mes mains, il me fit signe, avec cet air caressant et ironique que les Sauvages aiment à prendre en exerçant leurs cruautés, de l’enfoncer dans le bras de ma mère qu’il venait de saisir par le poignet.
Pétrifié d’horreur à cette atroce proposition, je feignis de ne pas comprendre; mais, après quelques tentatives, voyant ma persistance, il me menaça de son casse-tête.
Alors, afin d’échapper à l’horrible supplice d’être moi-même le bourreau de ma mère, je jetai la baguette loin de moi, dans l’espoir de me faire tuer.
Hélas! que n’ai-je eu le bonheur de terminer alors ma malheureuse carrière?
Je n’aurais pas été condamné à souffrir à la fois toutes les agonies sans mourir.
—Maman! Maman!—m’écriai-je en me rejetant dans ses bras pendant que le Sauvage irrité levait son tomahawk pour en asséner un coup sur ma tête,—maman! qu’il me tue, s’il le veut; j’aime mieux la mort que de vous faire souffrir.
Pendant tout ce temps, celle que j’aimais, heureuse de voir se tourner contre elle la fureur de nos ennemis, était demeurée immobile prête à subir tous les tourments.
Elle se pencha au-dessus de moi, afin de me couvrir de son corps.
Le Sauvage brandissait son arme pour frapper, quand une main le retint.
Etait-ce celle de la Jongleuse?....
Hélas! loin d’être inspiré par la pitié, ce mouvement ne provenait que d’une féroce pensée.
Je ne m’en aperçus que trop quelques instants plus tard.
L’horreur que je montrai à l’idée d’être moi-même l’auteur du supplice de ma mère, fut un éclair qui parut révéler, à la férocité sauvage, un raffinement de cruauté diabolique.
⁂
L’Indien jeta de côté son tomahawk, m’arracha violemment des bras de ma mère, et me lia à un arbre.
Ensuite, agissant toujours sous l’inspiration de la Jongleuse, il monta sur un de ces gros pins que vous voyez encore ici, et se laissa glisser le long d’une des branches, à l’extrémité de laquelle il attacha deux longues courroies qu’il tenait entre ses mains.
Un autre Sauvage, au-dessous de lui, saisit alors une des cordes, et la raidissant, il en fit faire un tour sur le tronc d’un arbre voisin, pendant que son compagnon faisait plier la branche par la pesanteur de son corps.
Il suffisait d’un léger effort pour empêcher la corde, ainsi enroulée autour de l’arbre, de glisser et de laisser échapper la branche.
Plein d’anxiété, et tout tremblant, je suivais de l’œil ces préparatifs sans en pouvoir comprendre le but.
L’Indien s’approcha de moi, me mit entre les mains l’extrémité de la corde roulée autour de l’arbre, et m’ordonna de ne pas la lâcher.
L’autre Iroquois descendit alors de son arbre, et, après avoir entraîné ma mère sous la branche pliée, il se mit en devoir de lui attacher l’autre courroie autour du cou....
Un cri d’épouvante et de désespoir s’échappa de ma poitrine, et je lâchai la corde.
Je venais de comprendre leur horrible dessein!
Mon Dieu! être moi-même l’assassin de ma mère!
Ecumant de rage, un des Iroquois me lança sa hache, qui malheureusement ne fit que m’ensanglanter la tête en effleurant la peau du crâne, et resta enfoncée dans l’arbre.
Me croyant blessé à mort, ma mère s’arrache des mains de son bourreau et se précipite vers moi.
—Harold!—s’écrie-t-elle d’une voix étouffée.
—Maman!.... ce n’est rien!
Et je fonds en larmes.
Elle saisit ma tête entre ses deux mains et presse ses lèvres sur mon front couvert de sang.
Ses pleurs inondent mon visage.
—O ma mère! ce fut votre dernière caresse à votre pauvre enfant!
Ah! qu’ils ont été amers, depuis ce moment, les jours de votre infortuné fils!....
Malheur à l’enfant orphelin des caresses de sa mère!
Il ne vit plus!
Son cœur est toujours de l’autre côté de la tombe avec sa mère!....
Ah! si vous l’eussiez connue!.... Un ange sous une forme mortelle! Le ciel était au fond de son regard, tabernacle de son âme, et son âme était plus belle que son regard.
Tous les trésors de la tendresse chrétienne! une sérénité séraphique! un courage, un dévouement, une abnégation incomparables!....
Et je l’embrassais pour la dernière fois!.... Et je ne devais plus jamais la serrer dans mes bras!
———
Si l’homme droit et pur qui lira cette page
Essuie, en la tournant, une larme à ses yeux;
S’il trouve là son cœur de fils, et s’il sent mieux
Ce qu’il doit à sa mère et l’aime d’avantage:
J’aurai vécu! ma vie aura porté son fruit;
Je ne me plaindrai plus de la flamme qui m’use,
Des biens communs à tous que le ciel me refuse;
Je saurai le secret de mon repos détruit.
Victor de la Prade,
Poèmes Evangéliques.
V
En un instant, la branche est pliée de nouveau, et la corde enroulée autour de l’arbre; mais, cette fois, les scélérats! avant de la mettre entre mes mains, ont le soin d’attacher l’autre courroie autour du cou de ma pauvre mère, après lui avoir lié les mains derrière le dos.
Alors ils me présentent la corde.
Je refuse de la saisir, et ils la laissent glisser tout doucement, avec un rire diabolique, jusqu’à ce qu’enfin, voyant la branche se relever et raidir la courroie qui retient ma mère, de désespoir, je suis obligé de m’en emparer.
Supplice inspiré par tous les génies de l’enfer!
Abîme de férocité et de barbarie!
Les monstres savourent d’avance, avec ivresse, toutes les horreurs des tourments qu’ils viennent d’inventer.
Exténué de fatigue et de lassitude après de longs jours de souffrances inouïes, il est impossible que je puisse résister longtemps.
Les barbares l’ont bien prévu.
Ils savent que la nature sera bientôt vaincue, et le crime consommé.
Quelle nuit! quelles heures! Lutte sans espoir contre toutes les défaillances de la nature!
Quel gouffre d’atrocités! Toutes les angoisses, tous les épouvantements, toutes les détresses de l’âme et du corps! Toutes les affres de la mort sans la perspective du dernier repos!
La bande infernale s’éloigne de quelques pas, et, avec des cris, des éclats de voix, des hurlements, des contorsions de démons, exécute, sur le sable du rivage, des danses insensées, préludes de la jonglerie.
Leurs membres nus, rougis par les sanglantes langues de feu que le vent de nuit fait jaillir de l’âtre, les feraient prendre pour une troupe de sorciers ou de nécromants échappés de l’enfer.
Leur ronde flamboyante tourbillonne comme un ouragan.
Au milieu de leurs vociférations, une voix,—toujours la même,—glas funèbre qui tinte encore à mon oreille,—se distingue et règle leurs pas.
Les hibous, les chouettes, et les autres oiseaux de nuit, attirés par la flamme et par ces clameurs insolites qui troublent le silence de leur veille, voltigent d’arbre en arbre, mêlant leurs cris effrayants aux bruissements de la forêt, au ressac de la mer sur les vertèbres des falaises, et aux ricanements de l’orgie.
Adieu au dernier espoir!
Tout est fini!
C’est l’enfer!
Autour de moi, un réseau de sang;—l’abîme sous mes pieds;—sur ma tête les mugissements de la tempête;—le deuil et les funérailles dans mon âme;—partout, au dedans comme au dehors, le vertige, les ténèbres, le désespoir, la mort!....
Seule!.... seule!.... une lueur, un rayon!... la douce voix de ma mère; les soupirs de son cœur à travers lequel j’entrevois encore le ciel.... Quoi! le ciel!.... si près de l’enfer! L’ange à côté des démons!
D’une voix vibrante et calme..... calme comme son âme qui n’appartient plus à la terre:
—Harold! mon enfant, pourquoi pleurer!... Arrête tes sanglots!
Il faut nous quitter; Dieu m’appelle à lui; mes maux vont finir!.... Sois heureux!.... Là-haut je prierai Dieu pour toi.... Au ciel je t’aimerai mieux que sur la terre!....
—Maman! Maman!... Oh!..... non vous ne mourrez pas!
—Non, mon enfant, on ne meurt pas quand on va au ciel!....
J’ai offert ma vie pour toi, Dieu l’a acceptée. Tu vivras, mon fils; mais quand je ne serai plus près de toi, souviens-toi toujours des leçons de ta mère!...
Ah! quand tu sentiras ta foi près de défaillir, pense bien au bon Dieu et.... un peu à ta mère....
Harold! prions ensemble; prions pour nos ennemis, prions pour la pécheresse!
—Maman! que leur avons-nous donc fait... qu’ils nous font tant souffrir!
Le bon Dieu nous a-t-il donc abandonnés!
—Oh! non, mon enfant; c’est l’heure des ténèbres; regarde le ciel et prie avec moi!....
Les malheureux! ils ne savent ce qu’ils font.
Seigneur, jetez un regard de pitié sur ces pauvres tribus assises à l’ombre de la mort.
Ne verront-elles donc jamais luire sur elles la lumière de votre Saint Evangile?
Le sang de nos apôtres martyrs crie vers vous.
Ecoutez les gémissements de ces victimes immolées qui s’élèvent du pied de votre trône.....
O mère des douleurs! par le glaive qui transperça ton âme sur le Calvaire, abaisse un regard de pitié sur mon pauvre enfant cloué, comme le tien, sur la croix.
Contemple l’affliction et les angoisses d’une mère et sauve mon enfant!....
Harold!.... je te bénis!.... Adieu!....
—A moi! à moi! au secours! Je sens déjà mon bras qui s’engourdit, et mes doigts se raidir!.... Maman! ah.... je vais vous tuer!... Me pardonnerez-vous?... Je veux mourir, je veux mourir!.... Pourrai-je vivre sans remords? Mon Dieu! un nuage passe sur ma vue!.... je ne vois plus.... je n’entends plus... rien!.... Je meurs!....
Tout à coup au milieu de mon évanouissement, je crois sentir mes doigts engourdis s’entr’ouvrir; la corde fatale glisse entre mes mains, elle grince autour de l’arbre et... m’échappe!
Un tressaillement suprême m’éveille de mon évanouissement; je m’élance et, par bonheur, je viens à bout de la ressaisir.
Mais c’est en vain; la nature est épuisée; je lutte quelque temps encore; mes forces m’abandonnent; ma tête retombe lourdement sur ma poitrine. Une nouvelle défaillance....
Soudain d’épouvantables hurlements m’arrachent de ma léthargie; mes cheveux se dressent sur ma tête:—Mon Dieu! j’ai tué ma mère!....
Un râle d’horreur s’exhale de ma poitrine.
Entre la terre et la voûte des branches le cadavre est là qui se balance au gré du vent.
Le vertige, la stupeur glacent mon sang dans mes veines.
Tous les objets semblent tourner autour de moi.
Un crêpe funèbre s’étend sur ma vue.
Je sens l’ongle de la mort me mordre au cœur.
⁂
Depuis cet instant, jusqu’au moment de perdre tout sentiment d’existence, toutes mes idées se troublent et deviennent confuses dans ma mémoire.
Quelques pâles souvenirs entrevus comme à travers un rêve:—le grincement de la corde sur la branche fatale;—le vent qui pleure tristement sur ma tête et soupire le chant de la mort;—aux approches de l’aube, le croassement d’une corneille qui vient se poser sur la branche.
Elle s’approche, s’approche encore pour flairer le cadavre, l’effleure de son aile en voltigeant, puis tout à coup s’envole en criant.
A travers le voile du trépas qui couvre mes yeux, je crois entrevoir, ô horreur!... une face effroyable et deux prunelles vertes et étincelantes,—sphinx teint de sang,—qui passe et repasse à deux doigts de mon visage avec un ricanement d’enfer!... Le spectre de la Jongleuse!...
Vient-elle savourer sa proie? insulter à sa victime? ... Oh! elle m’enfonce ses griffes dans le cœur!!...
Un tremblement convulsif,... un froid mortel court dans tous mes membres,... le sang reflue vers la tête,... des étincelles sautillent dans mon cerveau,... un bourdonnement dans mes oreilles,... une dernière impression vague, terne, sans horizon,... une dernière crispation, puis, tout s’éclipse et va se perdre dans le lac morne du néant.
———
J’irai à elle, mais elle ne reviendra point à moi.
Andro a lei, ma ella non ritornera a me.
Epitaphe.
La nuit s’est faite en moi depuis cette heure affreuse
La source de mon sang me semble avoir tari,
Je cherche une espérance en mon cœur appauvri;
Vous seule et Dieu savez l’abîme qui s’y creuse.
Mère!.......................................
............................................
............................................
Puisque Dieu vous a prise et vous garde en sa sphère,
Je veux aller à Dieu pour m’approcher de vous.
Victor de la Prade,
Poèmes Evangéliques.
VI
En m’éveillant de mon long évanouissement, j’étais étendu sur un lit de branches de sapin, au milieu d’une forêt d’érables.
Un jour pâle filtrait à travers le treillis du feuillage, et de gros nuages sombres, entrevus par une échappée des arbres, dans un pan du ciel, distillaient une pluie froide.
Qu’elles étaient tristes ces nombreuses gouttes de pluie qui tombaient, avec un petit bruit monotone, sur chaque feuille rougie, et tremblaient à leur pointe en larmes de sang qui dégouttaient jusqu’à terre!
Et cependant il y avait encore plus de tristesse et de larmes dans mon cœur!
Hélas! pourquoi me suis-je éveillé de cette longue insensibilité?
Je dormirais en paix mon sommeil, au fond de la tombe, à côté de celle que je ne reverrai plus!
Depuis ce jour néfaste, le soleil intérieur s’est voilé pour jamais.
Le ressac des années, en se brisant sur mon cœur, m’apporte toujours les débris d’un cercueil; pour moi, la terre est devenue la vallée de l’absinthe où je traîne sous la croix une vie couronnée d’épines.
⁂
A genoux, à mes côtés, sous l’abri qu’il avait dressé au-dessus de moi, le brave Canotier soutenait d’une main ma tête, et de l’autre arrosait mes tempes d’une eau fraîche.
Tu t’en souviens, mon bien-aimé ami;—avec quelle inexprimable étreinte j’enlaçai mes bras enfants autour de ton cou, quand je te reconnus et que je vis de grosses larmes ruisseler le long de tes joues!
Combien de temps nous restâmes embrassés dans ce muet épanchement de notre douleur!....
Dis-nous maintenant par quelle intrépide audace, tu parvins à opérer ma délivrance.
Le Canotier ne répondit pas; suffoquée par ses sanglots, la parole expirait sur ses lèvres.
Le fils de Madame Houel ne put alors contenir l’océan d’amertume dont son âme était abreuvée.
Plusieurs fois pendant ce lamentable récit, les témoins de cette scène, attendris de tant de souffrances et d’infortunes, mêlèrent des larmes aux leurs.
Mais ce fut alors une explosion d’émotion indicible à laquelle succéda un de ces silences solennels qu’impose la majesté d’une grande douleur, et dont aucune parole humaine ne saurait égaler la muette éloquence: langage inouï d’âmes qui sympathisent et de cœurs qui se comprennent!
⁂
Après une longue pause, le Canotier prit la parole:
“Lorsque j’eus rendu les derniers devoirs au Tshinépik,—l’incomparable ami que je ne cesserai jamais de pleurer,—je me hâtai de raccommoder le canot que les Iroquois, avant de quitter le rivage, avaient eu le soin de percer de plusieurs coups de hache, et je me mis à leur poursuite.
Malheureusement la nacelle avait été fort endommagée et ce ne fut qu’après plusieurs heures de travail que je pus la remettre à flots.
Ce retard donna sur moi une grande avance aux Iroquois, et fut cause que, malgré toute ma diligence, je ne parvins à les rejoindre que plusieurs jours plus tard, lorsqu’ils vinrent camper ici.
Exténué de fatigue après ces longues journées d’efforts surhumains, je commençais, cette nuit là même, à désespérer de pouvoir les rattraper, lorsqu’à travers les ténèbres j’aperçus leur feu sur la grève.
Il était déjà très-tard quand je mis pied à terre au bout de la Pointe; mais le vacarme épouvantable de leur jonglerie me rendit très-facile l’approche de leur camp.
En vain je cherchai pendant longtemps à apercevoir les deux prisonniers; les taillis qui croissaient à l’orée du bois interceptaient ma vue.
Je me glissai, en rampant, jusqu’à leurs canots renversés sur le sable; et j’y trouvai tous leurs fusils chargés, prêts à tirer.
Après avoir introduit une seconde balle dans chacun des fusils, et renouvelé les amorces, je remontai de quelques pas le rivage et m’abritai derrière une roche plats sur laquelle je disposai à la file les fusils tous bandés.
Les Iroquois étaient au nombre de huit; j’avais, par conséquent, besoin de mettre à profit toute mon habileté afin de ne perdre aucune chance; car si j’avais le malheur de commettre la moindre maladresse, j’étais perdu.
Il me fallut donc attendre un moment de calme.
Longtemps, le doigt sur la détente, je suivis, du bout de mon fusil, les frénétiques évolutions de l’orgie, sans pouvoir viser avec sûreté.
Enfin, je pus coucher en joue deux têtes d’Iroquois; le coup partit, et les deux Iroquois tombèrent raide morts.
Profitant aussitôt du moment, de trouble et de stupeur que produisit parmi eux cette attaque inattendue, je saisis un second fusil et tirai.
Un troisième Sauvage tomba pour ne plus se relever, et un autre grièvement blessé, après avoir fait trois ou quatre culbutes sur le sable, prit la fuite vers la lisière du bois.
Les quatre autres Iroquois se précipitèrent vers les canots dans l’espoir d’y trouver leurs armes; mais, prévoyant d’avance ce mouvement, j’avais eu la précaution de m’éloigner de quelques pas des embarcations.
Pendant qu’ils se penchaient autour des canots pour chercher leurs fusils, j’eus le temps d’en abattre encore deux autres.
Hurlant et écumant de rage, les deux derniers s’élancèrent à la course vers moi, le tomahawk à la main.
J’espérais pouvoir en terrasser encore un avant qu’ils pussent me rejoindre; mais, par malheur, mon fusil rata.
La lutte devenait inégale; les deux assaillants n’étaient plus qu’à quelques pas.
Sans perdre un instant, je jetai le fusil de côté, et, saisissant mon poignard par la lame, je le lançai, de toute la force de mon bras, au cœur d’un des Iroquois.
L’arme meurtrière l’atteignit en pleine poitrine, et l’Indien, blessé à mort, bondit en poussant son cri de guerre et s’affaissa sur lui-même.
Au même instant, le dernier Iroquois abattait son tomahawk sur ma tête.
C’était un colosse dont le désespoir et la rage centuplaient les forces et l’audace.
Je n’eus que le temps de parer le coup avec ma hache qui se brisa contre celle du Sauvage et vola en éclats.
La violence du choc fut telle que le tomahawk de l’Iroquois glissa entre ses doigts et alla tomber à plusieurs pieds de distance.
Me voilà, sans arme, en face de ce géant.
Un seul moyen de salut s’offre encore: c’est de m’emparer du couteau qui pend à son côté.
D’une main, j’empoigne l’Iroquois à la gorge, et de l’autre, j’essaie de saisir son couteau.
Nos mains se rencontrent à sa ceinture; la sienne tient déjà l’extrémité du manche, et j’ai à peine le temps de serrer le milieu du couteau à la jonction de la poignée et de la lame.
Une lutte terrible s’engage.
Nous roulons tous deux sur le sable.
Malheureusement le couteau me blesse la main:
Il va m’échapper.
Par un effort suprême, je lui enfonce mes doigts dans la gorge, afin de l’étouffer, mais il ne faiblit pas.
Enfin, après une dernière secousse, le couteau lui tombe des mains.
Un instant, je fouillai dans sa poitrine avec l’arme fatale, et il ne bougea plus.
Les deux prisonniers étaient donc sauvés.
Je me hâte d’accourir vers le bûcher; j’entre au bord du bois.
Hélas! quel horrible spectacle s’offre à ma vue!
Le cadavre de Madame Houel est suspendu au bout d’une courroie, la figure violette, et les membres pendants dans l’immobilité de la mort.
Un seul mouvement agite encore le cadavre: c’est celui de la branche, secouée par le vent, qui le fait monter et descendre en imprimant une légère ondulation à ses vêtements.
A quelques pas plus loin le corps de l’enfant, attaché au tronc d’un arbre, la tête ensanglantée penchée sur la poitrine, s’affaisse sur lui-même privé de sentiments.
Je le crus sans vie.
Pauvre petite fleur à peine détachée de la tige maternelle, et déjà mûre pour la mort!
Je demeurai attéré, comme frappé par la foudre.
Après avoir coupé les cordes, j’étendis les deux cadavres l’un à côté de l’autre, l’enfant à côté de sa mère!
Je remarquai alors, avec épouvante, que les cheveux de l’enfant, dont les boucles luisaient naguère d’un si beau noir, étaient devenus entièrement blancs!
Etait-il donc mort de frayeur plutôt que de ses blessures?
Je croisai ses deux bras inertes sur sa poitrine, et après avoir entouré son cou d’un des bras de Madame Houel, j’appuyai sa figure, pâle et blanche comme l’ivoire, sur le cœur de sa mère:
Vous avez veillé sur lui dans la vie, ô mère tendre et infortunée, veillez encore sur lui dans la mort!
Avant de songer à confier à la terre ces restes inanimés, je me souvins que plusieurs des Iroquois n’avaient été que blessés; et, afin de me rassurer, j’allumai un flambeau d’écorce, et j’allai les examiner attentivement.
Tous étaient morts à l’exception de deux qui respiraient à peine et n’avaient plus que quelques heures à vivre. Mais le principal auteur de tant de crimes et de désastres n’était pas au nombre des victimes.
La Jongleuse avait disparu!
Etait-ce elle qui, blessée par une de mes balles, s’était enfuie vers le bois?
Je suivis pendant quelque temps des traces de sang à travers la forêt, mais bientôt tout vestige disparut, et il me fallut abandonner une poursuite inutile.
De retour au lieu de la catastrophe, je m’aperçus que la blessure de l’enfant n’était que légère, et qu’il respirait encore.
Je lui prodiguai alors tous les soins dont j’étais capable; mais il ne revint à la vie et au sentiment de l’existence que plusieurs heures plus tard.
Ce fut dans cet intervalle que je le transportai sous l’abri de l’érablière voisine, après avoir creusé la tombe de son infortunée mère.
C’est ici même, sous ce tertre, qu’elle repose, et le but de notre voyage, longtemps retardé par l’absence de Monsieur Houel de la colonie, est de ramener sa dépouille et de la réunir aux cendres de sa famille.”
⁂
Le soir du même jour, le brave habitant, seul auprès du rocher, se tenait debout, appuyé sur une bêche, à quelques pas d’un monceau de terre fraîchement remuée, et regardait d’un œil pensif un canot qui se détachait lentement de la plage.
C’était le fils de Madame Houel, accompagné du fidèle Canotier, qui emportait la dépouille sacrée de sa mère.
Les deux voyageurs jetèrent de la main un dernier signe d’adieu à leur hôte auquel celui-ci répondit en essuyant, du revers de sa rude main, une larme qui glissait, malgré lui, sur sa joue.
Ses regards émus suivirent le canot sans s’en détacher un instant jusqu’à ce qu’enfin il eût disparu en doublant l’extrémité de la Pointe de la Rivière-Ouelle.
———
Et chacun de ces noms dit assez son histoire.
A. Brizeux,
Les Bretons.
Or, cette voix, c’était la Crieuse de Nuit.
....... ........ ..................................
Dans la lande elle est là qui de loin vous regarde.
A. Brizeux,
Les Bretons.
VII
Le souvenir de cette tragique légende n’est pas encore effacé de la mémoire des vieux narrateurs de la côte,—bien que les détails qui s’altèrent, et les variantes qui se multiplient, la menacent, ainsi que toutes nos autres légendes, du linceul et de l’oubli.
Déjà le crépuscule se fait autour de toutes ces vieilles souvenances, les contours s’évanouissent, et bientôt l’ombre va les envahir de toutes parts, si nous ne nous hâtons d’allumer le flambeau et de les arracher des ténèbres où elles s’enfoncent.
⁂
La légende de la Jongleuse nous a été racontée pour la première fois par un chasseur canadien ancien pêcheur du golfe, vieil érudit très-superstitieux, versé dans toutes les traditions de la contrée.
Comme monument historique qui consacre cet événement, une pointe, située à peu de distance du rocher témoin de la sanglante tragédie, porte encore le nom de “Pointe aux Iroquois.”
Du reste, cette plage a de tout temps été mal famée et le nom de “Cap au Diable” donné à un promontoire qui s’avance dans la mer à quelques milles plus bas, n’est pas étranger au souvenir de la terrible Jongleuse.
Le prestige et le merveilleux dont la superstition populaire avait entouré cet être mystérieux ne sont pas encore éteints et plusieurs prétendent que les pistes de raquettes, qui se voient incrustées sur un des rochers du rivage, ont été imprimées par ses pas.[29]
Les gens de la Pointe de la Rivière-Ouelle, dont le penchant pour les histoires merveilleuses est fort connu, affirment avoir souvent vu, le soir, des lumières courir çà et là sur la grève, et de grands fantômes blancs, qui ne sont pas du tout le revolin de la mer, errer pendant les gros temps sur les rochers au bord de l’eau.
D’ailleurs ils sont bien sûrs d’avoir entendu des plaintes et des gémissements pendant les nuits d’orages;—si bien qu’il n’est pas un homme parmi eux qui voudrait se hasarder à aller coucher seul au bout de la Pointe dans la vieille maison qui sert d’abri aux gens de la pêche à marsouin.
⁂
Quant au lieu et aux circonstances de la mort de la terrible héroïne, on ne connaît rien de positif.
Les uns prétendent qu’elle a été brûlée par un parti de Sauvages ennemis.
D’autres disent qu’un Missionnaire fut un jour appelé auprès du lit de mort d’une Jongleuse iroquoise qu’on prétendit être elle.
Ce qui s’est passé alors entre l’homme de Dieu et la farouche Indienne, nul ne le sait.
Dieu avait-il exaucé la prière mourante de Madame Houel?
Toujours est-il, ajoutent les chroniqueurs, que ces voix lugubres qu’on entend dans les ténèbres, fascinent ou glacent d’épouvante, comme ses incantations d’autrefois.
Chacun alors se tait et écoute en tremblant.
Ce sont les plaintes de la Jongleuse, disent-ils tout bas, qui demande des prières. Disons-lui un ave maria.
Québec, mai, 1861.
L’Abbé M. RAYMOND CASGRAIN.
[29] Ces empreintes singulières sont encore parfaitement distinctes, quoique l’eau de mer et la pluie les altèrent et les effacent peu à peu. Ces pistes de raquettes sont creusées sur le flanc incliné d’un rocher que baignent les flots pendant les grands vents et les hautes marées. On voyait encore, il y a quelques années, sur le même rocher, l’empreinte très-visible de la partie antérieure de deux pieds, ainsi que les extrémités de deux mains, disposées à peu près comme les traces que laisserait sur le sable un homme appuyé sur ses mains et sur ses pieds. Mais aujourd’hui les pistes de raquettes sont seules visibles.
———
I
Stadacona donnait sur son fier promontoire;
Ormes et pins, forêt silencieuse et noire,
Protégeaient son sommeil.
Le roi Donnacona dans son palais d’écorce
Attendait méditant sur sa gloire et sa force
Le retour du soleil.
La guerre avait cessé d’affliger ses domaines,
Il venait de soumettre à ses lois souveraines,
Douze errantes tribus.
Ses sujets poursuivaient en paix dans les savanes,
Le lièvre ou la perdrix; autour de leurs cabanes,
Les ours ne rôdaient plus.
Cependant il avait la menace à la bouche,
Ils se tournait fiévreux sur sa brûlante couche,
Le roi Donnacona!
Dans un demi-sommeil, péniblement écloses,
Voici, toute la nuit, les fatidiques choses,
Que le vieux roi parla:
[30] L’auteur a puisé cette inspiration dans le récit du second voyage de Jacques Cartier.—Il nous représente, d’abord, Donnacona, agohanna ou chef de la bourgade de Stadacona, dormant dans son ouigouam: son sommeil est agité, il rêve aux conséquences qu’auront, pour sa race et pour son pays de forêts, l’arrivée des terribles étrangers; conséquences que ses jongleurs et ses interprètes lui ont décrites sous des couleurs bien sombres.—Puis on assiste au départ du vieil Agohanna sur les navires du découvreur; départ qui demeura sans retour, excepté pour l’ombre du vieux Sachem que le poète fait planer au-dessus des promontoires, des clochers et des dômes de Québec, évoquant les âmes des chefs et des guerriers dans une ronde des esprits. Les mots sauvages et presque tous les détails sont fidèlement reproduits du texte même de Cartier.—(Note de l’Editeur.)
II
“Que veut-il l’étranger à la barbe touffue?
Quels esprits ont guidé cette race velue,
En deçà du grand lac?
Pour le savoir, hélas, dans leurs fureurs divines,
Nos jongleurs ont brûlé toutes les médecines,
Que renfermait leur sac!
“Cudoagny se tait; les âmes des ancêtres
Ne parlent plus la nuit; car nos bois ont pour maîtres,
Les dieux de l’étranger;
Chaque jour verra-t-il s’augmenter leur puissance?
J’aurais pu cependant, avec plus de vaillance,
Conjurer ce danger.
“J’aurais pu repousser, loin, bien loin du rivage
Le chef et son escorte, et châtier l’outrage
Par leur audace offert.
Mais de Cahir-coubat ils ont toute la grève,
Et déjà l’on y voit un poteau qui s’élève,
D’étranges fleurs couvert.
“Ils ont dû tressaillir dans la forêt sacrée
Les os de nos aïeux! Ma poussière exécrée
N’y reposera pas.
Les fils de nos enfans, bien loin d’ici peut-être,
Dispersés, malheureux maudiront un roi traître,
Qu’on nommera tout bas.
“Taiguragny l’a dit: l’étranger est perfide,
Ses présents sont trompeurs, et la main est avide
Qui nous donne aujourd’hui:
Elle prendra demain mille fois davantage,
Mon peuple n’aura plus bientôt, sur ce rivage,
Une forêt à lui.
“Taiguragny l’a dit: de ses riches demeures,
Où, dans les voluptés, il voit couler ses heures
Leur roi n’est pas content.
Il lui faudrait encore et mes bosquets d’érables,
Et l’or qu’il veut trouver caché parmi les sables
De mon fleuve géant.
“Jeunes gens, levez-vous et déterrez la hache,
La hache des combats! Que nulle peur n’arrache,
A vos cœurs un soupir!
Comme un troupeau d’élans ou de chevreuils timides,
Tous ces fiers étrangers sous vos flèches rapides,
Vous les verrez courir.
“Mais inutile espoir! Leur magie est plus forte,
Et son pouvoir partout sur le nôtre l’emporte,
Leur Dieu, c’est un Dieu fort!
Quand il fut homme, un jour, dans un bien long supplice
De ceux dont il venait expier la malice,
Ce Dieu reçut la mort.
“Domagaya l’a dit: les tribus de l’aurore,
Ni celles du couchant, plus savantes encore,
N’ont jamais inventé
De tourments plus cruels; mais, chef plein de vaillance,
Le Dieu des étrangers a souffert en silence,
Puis au ciel est monté.”
III
Ainsi parlait le roi dans son âme ingénue;
Et lui-même bientôt sur la flotte inconnue,
Il partait entraîné.
Ses femmes, ses sujets hurlèrent sur la rive,
Criant Agohanna! De leur clameur plaintive,
Cartier fut étonné.
Et prenant en pitié leur bruyante infortune,
Le marin leur promit qu’à la douzième lune,
Ils reverraient leur roi.
Des colliers d’ésurgni scellèrent la promesse,
Cartier les accepta; puis ils firent liesse;
Car il jura sa foi.
Douze lunes et vingt, et bien plus se passèrent,
Cinq hivers, cinq étés lentement s’écoulèrent;....
Le chef ne revint pas.
L’étranger de retour, au soin de la bourgade,
Du roi que chérissait la naïve peuplade
Raconta le trépas.
IV
Vieille Stadacona! sur ton fier promontoire,
Il n’est plus de forêt silencieuse et noire;
Le fer a tout détruit.
Mais sur les hauts clochers, sur les blanches murailles,
Sur le roc escarpé, témoin de cent batailles,
Plane une Ombre la nuit.
Elle vient de bien loin, d’un vieux château de France,
A moitié démoli, grand par la souvenance
Du roi François premier.
Elle crut au Dieu fort qui souffrit en silence
Au grand chef dont le cœur fut percé d’une lance,
Elle crut au guerrier!
Donnacona ramène au pays des ancêtres,
Domagaya lassé de servir d’autres maîtres,
Aussi Taiguragni.
Les vieux chefs tout parés laissent leur sépulture,
On entend cliqueter partout comme une armure,
Les colliers d’ésurgni.
Puis ce sont dans les airs mille clameurs joyeuses,
Des voix chantent en chœur sur nos rives heureuses,
Comme un long hosanna.
Et l’on voit voltiger des spectres diaphanes,
Et l’écho sur les monts, dans les bois, les savanes,
Répète: Agohanna!
P. J. O. CHAUVEAU.
EXTRAIT D’UN ALBUM.
——
ENVOI.
Dans ce livre où je vois chaque page remplie
De fleurs, de compliments, de souhaits, de soupirs,
Vous voulez que ma muse, un instant recueillie,
Ajoute quelque chose à tous ces souvenirs.
Le parterre, en effet, n’est jamais si garni
Qu’on ne puisse y trouver un tout petit espace
Pour la modeste fleur qui, cherchant un abri,
Se contente aisément de la dernière place.
La fontaine qui dort dans la forêt tranquille
Et mire dans ses eaux la tige du nopal,
Jamais n’a dédaigné d’offrir un humble asile
A la goutte qui tombe et trouble son cristal.
La branche qui gémit sous le fardeau des fleurs,
Jusqu’ici n’a jamais, au moment de l’orage,
De son moëlleux duvet refusé les douceurs
A l’oiseau fatigué qui revient du nuage......
———
——
J’aime la fleur des champs dont la fraîche corolle
Se dérobe aux regards à l’ombre des forêts,
Quand le souffle embaumé du zéphyr qui s’envole,
De son réduit obscur vient trahir les secrets.
J’aime le mont abrupt dont la superbe cîme
S’élance avec orgueil et menace les cieux,
Les grandes voix des vents qui roulent sur l’abîme
Et courbent des grands pins les fronts audacieux.
J’aime le lac uni quand un léger murmure
D’un doux frémissement fait trembler les roseaux,
Quand il vient expirer sur un lit de verdure,
Se ride avec amour sous l’aile des oiseaux.
J’aime le fier courroux de la mer en délire,
Le flot précipité qui se choque avec bruit
Quand venant se heurter au roc qui le déchire
Il jette mille éclairs au flot noir qui le suit.
J’aime l’astre des nuits luttant contre les ombres
Qui va, se balançant dans un ciel pur et bleu,
Quand son éclat pâlit sur les collines sombres
Se réfléchit sur l’onde en brillants traits de feu.
J’aime encor les combats, les grands bruits de la guerre
Le choc retentissant du bronze et de l’acier,
Les lugubres éclats des grands coups de tonnerre
Que fait jaillir le ciel ou la main du guerrier.
F. A. H. LaRUE.
———
Vers inscrits sur l’album de Madame H.... et adressés à son jeune enfant. Ces strophes ont été composées à l’occasion des portraits de l’enfant et de son grand-père, M. F........, peints par M. H....
I
Il fut un jour, mon ange, où pour plaire à ta mère,
Dans ce livre on mettait maint compliment flatteur,
Maintenant qu’elle marche au bras de qui sut plaire
C’est par toi, bel enfant, qu’on arrive à son cœur!
II
Tu souris, à ses yeux, dans tout ce qui t’entoure,
Dans ce coussin moelleux qui sert à tes ébats,
Dans ces fruits succulents que ta bouche savoure,
Dans ces frêles jouets que tu mets en éclats!
III
Et puis, t’es si gentil, quand auprès du grand-père
Tu prêtes à l’automne un rayon de printemps,
Que tous ont exigé du talent de ton père,
De soustraire vos traits aux ravages du temps!
J. C. TACHÉ.
SUR LES
CÔTES DE LA GASPÉSIE.
———
C’était en 1836; et nous voguons à pleines voiles sur ’61.—Il y a donc vingt-cinq ans! et vingt-cinq ans ne forment-ils pas un quart de siècle?—Eh bien, soit; disons-le bravement: il y a vingt-cinq ans, j’étais invité par monseigneur Turgeon, évêque de Sidyme, à l’accompagner, avec deux de mes confrères, durant le cours de la visite épiscopale, qu’il allait faire dans le district de Gaspé. Alors curé de Saint-Isidore de Lauson, paroisse nouvellement née et resserrée de toute part par la forêt, je profitai avec joie de l’occasion, pour visiter les côtes du golfe Saint-Laurent.
Durant le cours du voyage, je jetai sur le papier des notes, que je mis en ordre à mon retour, et qui depuis sont restées dans mes cartons. Elles présentent quelque intérêt, au moment où cette belle partie du Canada semble attirer l’attention toute particulière de nos législateurs, des spéculateurs sur les terres, et des agents de l’émigration norvégienne. Elles peuvent aussi servir à faire comprendre les grands changements qui s’y sont opérés depuis vingt-cinq ans; car la Gaspésie de 1861 aura peine à se reconnaître dans la description de la Gaspésie de 1836.
Puisqu’il en est ainsi, ami lecteur, voici ces notes, que je vous offre telles quelles, après les avoir éventées, époussetées et vernies.
J. B. A. FERLAND, Ptre.
Le départ—Un canot sauvage—La Sara, ses passagers et son équipage—Le Pot-à-l’Eau-de-Vie—Le Bic et ses souvenirs—Le sauveur de la patrie—Navigation des mouettes—Le cap Chates.
Juin, 15.—“Hisse la misaine!... Envoie la barre pour qu’elle arrive... Largue les amarres de l’avant.” Une voix brève et accentuant fortement les mots avait jeté ces ordres, et la manœuvre s’était faite au gré du commandant; l’avant de la goélette s’éloignait lentement du quai, au souffle de vent qui donnait dans la seule voile déployée.—“Capitaine!... capitaine!” répète le même officier, le second.—“Le capitaine est allé dire adieu à sa femme.”—“C’est bien le temps d’y aller quand on va partir. Jette une amarre sur le quai.”—L’amarre lancée tombe à mi-chemin; mais un bras plus nerveux et plus expert la pousse jusques à terre, où elle est arrêtée; l’avant de la goélette se rapproche du débarcadère, et enfin le capitaine Constant V., la joue encore humide du dernier baiser de sa chère épouse, foule du pied le pont de sa bien-aimée Sara, de sa troisième moitié, comme le dirait un enfant de l’Irlande. Le cœur du brave homme est, en effet, a peu près partagé entre sa femme et ses deux goélettes. Qui oserait lui en faire un crime? Une goélette obéit à son maître et garde le silence; c’est ce que le marin n’obtient pas toujours de sa femme.
Le capitaine V. prend avec dignité le commandement de son bâtiment; les amarres se détachent de nouveau; un léger souffle du sud-ouest soulève à peine les voiles, et la Sara s’ébranle.
“Adieu! adieu! envoyez-nous de vos nouvelles—Nous attendrons vos lettres à Percé—Bon voyage—Que le Seigneur vous garde jusqu’à votre retour.”—Ces adieux s’échangent entre un groupe de personnages sur le quai et les passagers réunis sur le pont. Quelques coups de canon retentissent sur la rivière Saint-Charles; trois hourrahs sont poussés par les nombreux spectateurs; trois autres par les matelots... et tout se tait.
La Sara glisse silencieusement sur la surface unie du bassin de Québec. Le soleil vient de se cacher derrière les montagnes de Charlesbourg; aux premiers jours de son croissant, la lune répand une lumière faible et incertaine. La conversation a cessé parmi les passagers; leurs regards demeurent attachés sur la vieille cité de Champlain. Les toits brillants de la Haute-Ville reflètent encore les dernières lueurs du crépuscule, tandis que des masses d’ombres se projettent sur la Basse-Ville et sur la longue ligne de ses quais, que bordent de nombreux navires. Au pied des monts laurentins, sur la rive gauche, s’étendent les habitations de Beauport, qui se déroulent comme un cordon blanchâtre sur un fond obscur; à droite, la côte escarpée du sud se dresse, présentant un rideau noir, au-dessus duquel scintille le clocher de la Pointe-Lévis.
Quelques-uns des voyageurs laissent, sans doute, errer leurs pensées sur les amis qu’ils viennent de quitter. Aspirant après le moment, où, entourés d’un triple cercle d’auditeurs, ils pourront jouir du privilège accordé aux touristes, tout bas ils répètent le refrain d’une vieille chanson des pays hauts:
“Quand je viendrai de mon voyage,
Chez moi viendront les curieux;
Je mentirai selon l’usage,
Et l’on ne m’en croira que mieux.”
Mais un devoir les appelle: partant pour une mission évangélique, ils ont besoin que l’ange du Seigneur les accompagne. Ils s’agenouillent tous ensemble sur le pont, et prient le Dieu des consolations de les avoir en sa sainte garde et de faire fructifier le bon grain qu’ils vont semer.
En ce moment passe, sous la proue du vaisseau, un canot d’écorce, portant toute une famille sauvage. Le père et la mère conduisent cette frêle embarcation, dont les bords s’élèvent de quelques doigts seulement au-dessus de l’eau; les enfants et les chiens, couchés pêle-mêle, dorment dans la plus profonde sécurité, au milieu des ustensiles de ménage, des couvertures, des peaux et des pièces de la tente. Comment celui qui protège et qui soutient sur les eaux cette faible écorce, pourrait-il oublier les hommes qui placent en lui toute leur confiance?
Le vent fraîchit; le saut de Montmorency gronde; nous voici entrés dans le chenal qui sépare l’île d’Orléans de la côte du sud; il est déjà dix heures du soir. A demain!
Juin, 16.—Voulez-vous connaître la Sara, ses passagers et son équipage? Suivez-moi.—Voyez cette gentille goélette, à la coupe gracieuse: élancée, svelte, on la dirait impatiente de courir ses quatorze nœuds devant une brise fraîche. Ses longs mâts portent chacun une seule voile; mais quelle voile! cent quatre-vingts verges de toile sont entrées dans celle du grand mât. Trois fortes ancres, dont les chaînes sont soigneusement roulées à l’avant, pourront dompter la légèreté de la Sara, même par les plus gros temps. Derrière son couronnement est suspendue une petite chaloupe; sur le pont, en est une plus lourde et plus solide, qui servira au débarquement des passagers, et au transport du bois nécessaire pour alimenter le foyer de la cambuse. Près du beaupré, un canon allonge la tête par-dessus le plat-bord, prêt à proclamer notre arrivée ou notre passage, et à lancer au loin nos adieux.
Descendons cet escalier. Voici la chambre dite du capitaine, quoiqu’il n’y doive point paraître pendant le voyage: elle renferme un lit à bâbord, et un à stribord. Sur l’un, est étendu le rubicond curé de L., occupé à voyager dans le pays des rêves; sur l’autre gît en paix un honnête vicaire de Québec, M. N., hibernien de nation. Des rideaux protègent leur sommeil contre la lumière, que deux vitraux laissent pénétrer dans cette demeure soporifique.
Par une porte à droite, vous entrez dans un petit salon, enlevé pour la circonstance à la cale, dont il est séparé par une cloison temporaire. Passez à l’intérieur, et ne craignez point d’éveiller les dormeurs, car, dans cette pièce comme dans la précédente, les planches du parquet sont cachées sous des tapis, qui étouffent le bruit des pas. Une lampe, suspendue au lambris, jette encore assez de lumière pour que vous puissiez examiner l’appartement. Ici reposent, Mgr. l’évêque de Sidyme, son secrétaire M. T., et le curé de Saint-Isidore; un quatrième lit, dressé d’avance, servira dans les occasions où il faudra exercer l’hospitalité.
Au milieu de cette chambre et solidement fixée au plancher par des écrous, est une table préparée pour les repas, pour l’étude et la toilette; c’est en un mot, une table universelle, à laquelle, dans les gros temps, on adaptera un cadre mobile, destiné à tenir dans l’ordre les plats, les assiettes et les bols, lorsque la Sara s’avisera de pirouetter. De côté et d’autre, ont été pratiquées des armoires, où pourront se ranger, sans confusion, les provisions de voyage et les articles qui appartiennent au domaine du maître-d’hôtel.—Voilà pour la topographie, pour le personnel et le matériel du quartier aristocratique de la Sara.
Remontons sur le pont.—Ces deux cages renferment des poules; jadis paisibles tenancières d’une basse-cour, elles sont aujourd’hui ballottées sur les flots de la mer. Trop heureuses, si un jour elles pouvaient rentrer au poulailler maternel, pour raconter à leurs compagnes d’enfance ce qu’elles ont vu et souffert sur la terre et sur la mer! Vain espoir! Avant la fin du voyage elles auront ignominieusement terminé leur carrière dans une cambuse.
Nous voici enfin rendus au panneau qui ouvre sur la cale. Ami lecteur, en descendant, prenez garde aux barreaux de l’échelle, et baissez la tête quand vous serez descendu. Comme vous désirez connaître tous les habitants de la Sara, marchons. En nous éloignant de la lumière, nous nous avançons vers les ténèbres intérieures; coffres, caisses, barils, voilà les matériaux qui ont servi à construire le chemin qui mène à la chambre de l’équipage: le capitaine V., ayant entendu parler des chemins à la macadam, a établi une route selon ce système, au fond de cale de la Sara. Une lampe éclaire l’appartement, dont le sous-sol est formé de trois cents minots de sel. Ici règne le capitaine Constant V.; viennent ensuite Benne V., son fils, second de la goélette; Louis F. et Moyse L., matelots; Jacquot, surintendant de la cambuse de l’équipage; Mathieu, engagé par Mgr. l’évêque de Sidyme, comme maître-d’hôtel, cuisinier, économe, servant de messe; et enfin Hector, chargé de prêter main-forte au dernier personnage, tant au spirituel qu’au temporel.
Il est cinq heures et demie du matin; aux sons d’une clochette, hors du lit culbutent les habitants des deux chambres de l’arrière.—“Où en sommes-nous?”—“Beau temps. Le vent a été faible toute la nuit; il commence à fraîchir. Voilà l’île aux Grues. Voyez à droite le village de Saint-Thomas avec sa grande église. Trente voiles! nous sommes au milieu d’une flotte partie avant nous, et nous lui apportons une brise favorable.”
Les belles et riches campagnes du sud s’étendent à notre droite, tandis que sur l’autre bord nous cotoyons l’île aux Grues et l’île aux Oies, au-dessus desquelles apparaissent les montagnes du nord. Plus bas, sont quelques îlots nommés les Piliers Boisés; l’on voit des milliers de taches blanches s’élever alentour, tournoyer et s’abattre; ce sont, nous dit-on, des pigeons de mer, dont les évolutions rapides semblent prêter la vie et le mouvement à ces rochers arides.
La Sara poursuit gaîment sa course, laissant derrière elle les bâtiments qu’elle a facilement rejoints. Un point brillant parait bien loin en avant; il grossit: des voiles se détachent de la masse; une coque de bâtiment s’arrondit, s’élargit, et bientôt nous avons dépassé quelque lourd navire, un brick aux flancs noirs, ou une légère goélette faisant la même route que nous.
Vis-à-vis de la Rivière-Ouelle, des marsouins commencent à se montrer; on dirait une grande roue de moulin faisant un demi-tour hors de l’eau et s’enfonçant subitement. Par un mouvement de rotation, cet animal déploie successivement à l’air toutes les parties de son dos, depuis la tête jusqu’à la queue. Quelques loups marins, véritables tritons de la fable, dressent leur tête de chien, nous considèrent avec une curiosité mêlée d’une légère dose d’impertinence, et disparaissent, après avoir à loisir examiné les passants. Cependant M. F. est là, le fusil à l’épaule, prêt à les punir de leur impudence, si seulement ils voulaient se mettre dans la direction du plomb qu’il lance contre eux. Leur nombre s’accroît à mesure que nous approchons de l’île aux Lièvres, près de laquelle des brassées de loups marins font mille évolutions. Quelques centaines d’individus s’avancent à notre rencontre, avec rapidité et sur une seule ligne, comme pour défendre leur domaine. Puis les rangs se brisent, des escouades de vingt et de trente se forment, tournent, se croisent, se poursuivent, s’évitent. Semblables à de nouvelles levées, ils défient l’ennemi, tout en ayant le soin de se tenir à une distance respectueuse de ses coups. Leurs bravades excitent l’ardeur de M. F.; le plomb vole sur les eaux; les loups marins plongent, reparaissent un peu plus loin et font le pied-de-nez à leur persécuteur. Dans la chaleur du combat, quelques coups de fusil sont dirigés vers une goélette voisine, dont les matelots, peu désireux de tomber sous un plomb adressé à de vils animaux, prennent la liberté de réclamer.—“Goélette, ahoy!”—“Qui vive!”—“Voudriez-vous, s’il vous plaît, avoir la bonté de ne pas tirer sur nous autres.”—La demande était raisonnable et polie; nos voisins s’étaient montrés neutres dans la question; il fallait respecter leur neutralité pour notre propre intérêt, car, en se joignant à la partie adverse, ils auraient fait pencher contre nous les plateaux de la balance.
7½ h. P. M.—Le vent est tombé; nous mouillons à quelques arpents de terre, au-dessus du Pot-à-l’Eau-de-Vie.—Le Pot-à-l’Eau-de-Vie est un rocher élevé, portant peu de traces de végétation; il était autrefois couronné par un télégraphe, dont les longs bras s’agitaient fréquemment pour signaler le passage des navires de commerce. Nous sommes bientôt environnés des bâtiments que nous avons devancés dans le cours de la journée; les uns après les autres, ils viennent se réfugier au mouillage, pour attendre un vent favorable. Au silence qui régnait en ce lieu, il y a quelques heures, ont succédé des bruits confus: la chute des ancres à l’eau, le cliquetis des chaînes se déroulant sur le pont, les sifflets du commandement, les cris des matelots, en voilà assez pour jeter l’épouvante parmi les loups marins, et pour troubler la paix des canards sauvages, qui se lèvent en nombreuses volées et vont chercher un gîte ailleurs.
9 heures du soir.—La lune est à l’horizon, prête à se coucher; le mouvement et le bruit ont cessé; l’on n’entend plus que le pas mesuré du matelot de quart, le murmure de la vague qui caresse mollement le flanc de la goélette, et, au loin, le souffle sourd des marsouins.
Des flottes nombreuses se rassemblent souvent dans ce hâvre; retenus par les vents contraires et les courants, les bâtiments de commerce, les navires chargés d’immigrants viennent, l’un après l’autre, se réfugier entre ces îles. Alors que de scènes bruyantes se passent en ces lieux! Combien de fois ces rochers ont retenti des cris de la discorde et de l’ivresse! Combien de malheureux, forcés d’abandonner les pays de l’Europe, pour se créer un établissement au sein des forêts vierges de l’Amérique, ont, à leur arrivée sur ces bords étrangers, versé des larmes amères, en se rappelant la patrie abandonnée pour toujours! Que d’infortunes, que de crimes se sont reposés à l’abri de ces rochers! Un vent favorable venait-il à passer sur ces eaux, les voiles se déployaient, les folles joies et les profondes tristesses s’envolaient; et le hâvre du Pot-à-l’Eau-de-vie rentrait dans la solitude et le silence ordinaires.
Juin 17.—Située à trente-six lieues de Québec, l’île aux Lièvres est étroite, longue, et encore couverte de bois. Elle ne renferme point d’autres habitants que les hôtes aux longues oreilles qui lui ont imposé leur nom. Un amateur de la retraite, de la chasse ou de la pêche y trouverait un asile bien agréable pendant l’été.
Nous profitons d’un souffle de vent pour aller mouiller près du haut de l’île Verte. S’il faut en juger par les apparences, nous approchons du domaine du vieux Neptune.
Hier et aujourd’hui nous avons traversé des ras de marée couverts de capelans. Les capelans, pour la taille et la forme, ressemblent un peu aux éperlans, et exhalent une forte odeur de concombre. Au temps du frai, ils sont jetés au rivage par les vagues; la mer, en se retirant, les reporte au large, mais dans un tel état d’engourdissement qu’on les croirait morts. Veut-on alors les prendre dans la main, on s’aperçoit à leurs frétillements et à leurs efforts pour s’échapper, qu’ils sont encore fortement attachés à la vie.
Autrefois la morue remontait jusqu’au-dessus de l’île Verte[31]. Les temps sont changés; nos pêcheurs jettent à l’eau plusieurs lignes, qui sont soigneusement surveillées, mais inutilement, car toute la pêche se borne à un concombre de mer. Les savants ont probablement donné au concombre de mer quelque nom grec, que les matelots ignorent; quoiqu’il en soit, l’être lui-même n’en est pas moins curieux. Il semble appartenir et au règne végétal et au règne animal, étant composé d’une longue tige, attachée par ses racines à un petit caillou, et d’un corps qui a la forme d’un œuf avec la couleur d’un champignon, et qui renferme du sang et des intestins.
Pendant que les passagers s’occupent de la pêche, les matelots ne perdent pas leur temps. Les uns mettent de l’ordre sur le pont; d’autres dressent et peinturent un mât de hune, qui ne servira qu’à porter le pavillon. Comme la Sara paraît pour la première fois sur les eaux du Saint-Laurent, elle n’a pas encore eu l’occasion de mettre sa toilette au complet. L’équipage s’occupe de la gréer en plein. Bâtie à Saint-Grégoire pendant le cours de l’hiver et lancée ce printemps, elle était descendue pour prendre un chargement à Québec, où elle a été nolisée pour le voyage de la Baie des Chaleurs, par Mgr. l’évêque de Sidyme.
Juin, 18 (6 h. A. M.)—Un faible vent nous a, pendant la nuit, portés vis-à-vis de l’île aux Basques, ainsi nommée parce qu’autrefois les Basques avaient, en ce lieu, formé des établissements pour la pêche, pour l’exploitation des huiles de poisson, et surtout pour faire la traite des pelleteries avec les sauvages de Tadoussac. Durant la première partie du dix-septième siècle, la compagnie de la Nouvelle-France eut plusieurs fois à se plaindre du commerce de contrebande que faisaient les Basques, les Hollandais et aussi les Anglais, quand ils en trouvaient l’occasion.
Jusqu’ici le bulletin sanitaire n’a eu à enregistrer que des rapports favorables: la santé publique était bonne dans la petite communauté, l’appétit était encore meilleur. Aujourd’hui, il y a perte d’appétit chez M. T.; puis chez Hector et enfin chez Jacquot. Ce n’est pas tout; une maladie se déclare, et c’est bien le terrible mal de mer. Tous trois pâlissent, s’agitent et font de violents efforts. Autour d’eux se rassemble un groupe de spectateurs; personne, cependant, ne s’apitoie sur le sort des malheureuses victimes. Qu’elle est affligeante la situation d’un pauvre malade, étendu sur les planches du pont, la face dans la poussière, et ne levant les yeux que pour contempler des visages riants! Prête-t-il l’oreille aux chuchotements des assistants, dans l’espérance de saisir quelques mots d’encouragement? Il reconnaît qu’il est l’objet de leurs mauvaises plaisanteries. Veut-il se lever pour faire face aux railleurs? Ses jambes ploient sous le poids de son corps et le laissent tomber, exposé à de nouvelles insultes. Une seule consolation lui reste: c’est l’espérance de pouvoir un jour rire à son aise de ses persécuteurs, lorsqu’ils auront eux-mêmes été abattus et désarmés par la maladie. Les désastres de la journée sont causés par un fort vent du nord-est, en face duquel la Sara s’agite avec violence.
Nous cotoyons la rive méridionale du fleuve, bordée de montagnes dans cette partie. En aval, les hauteurs sont taillées perpendiculairement et prennent le nom de murailles du Bic. Jadis le chemin entre les Trois-Pistoles et le Bic suivait les bords du fleuve. Dans cette distance de vingt-sept milles, un seul lieu de repos s’offrait au voyageur; c’était la maison de la veuve Petit, dont le nom est longtemps resté célèbre dans ces parages. Le vent continuant d’être contraire, nous jetons l’ancre près de l’île du Bic, qui est séparée de la terre ferme, par un chenal d’environ une lieue de largeur.
Autrefois M. D’Avaugour, gouverneur du Canada, avait formé le projet d’ouvrir un port et d’établir un entrepôt pour le commerce, dans la baie qui est vis-à-vis de l’île du Bic. Les navires venant de France se seraient arrêtés en ce lieu, y auraient déposé leurs marchandises, et pris pour le retour les fourrures et autres articles d’exportation fournis par le Canada. Ce projet, alors abandonné comme beaucoup d’autres, a depuis été remis sur le tapis et finira peut-être par se réaliser.
Près d’une des pointes qui protégent le mouillage à l’entrée de la baie du Bic, est un îlot nommé l’Ilet-au-Massacre; ce nom lui vient de ce qu’on y a découvert, dans une caverne, des squelettes d’hommes, de femmes et d’enfants. La tradition rapporte que des Micmacs s’y réfugièrent un jour pour éviter la poursuite d’une bande de guerriers iroquois, et furent massacrés par leurs féroces ennemis.[32]
Nous voici tranquillement à l’ancre, et tous les malades sont déjà sur pied. Comme il est midi, nous allons dîner; puis nous irons visiter la belle île du Bic. Quel plaisir de marcher sur un sol ferme, quand on a été durant trois longues journées à battre le pont étroit d’une goélette! La mer est si calme, et le dîner durera si peu de temps, qu’il n’est point nécessaire d’attacher à la table le cadre protecteur! Triste destinée des projets de l’homme! A peine a commencé le cliquetis des couteaux et des fourchettes, que voici bien une autre fête: “Le plus terrible des enfants que le sud eût porté, jusques-là dans ses flancs,” se rue contre nous, sifflant, rageant, hurlant. Comme il souffle dans la direction favorable, le capitaine se décide à profiter de sa mauvaise humeur; on lève l’ancre, les voiles sont tendues; la Sara a senti l’éperon, elle tremble dans tous ses membres, elle se penche et s’élance. De la salle à dîner, un cri de détresse s’est fait entendre; ce n’est pourtant rien de sérieux, car il est suivi de rires homériques. Potage, assiettes, verres, pain, plats, se précipitent, dans une admirable confusion, sur les genoux de M. F., qui.... mais non! jamais il n’a reculé devant de tels ennemis. Sa vaste poitrine affronte la tempête; elle offre une digue, contre laquelle viennent se briser les flots tumultueux de biftek et de potage. D’une main il saisit un plateau qui s’agite sur sa base, de l’autre il arrête la soupière renversée; il cherche encore s’il n’aurait pas une troisième main, pour achever de mériter le titre de sauveur de la patrie.
Pendant ce vacarme, dolente est la figure des convives placés de l’autre côté de la table; nouveaux Tantales, ils restent l’arme au poing, tandis que leurs assiettes sont allées grossir les dons que la fortune entasse sur leur courageux confrère. La nécessité stimule enfin les plus lâches; un prompt secours est porté à M. F.; les fuyards sont ramenés à leur poste; l’ordre se rétablit sur la table, pendant que l’insouciante Sara, sans s’occuper de ces commotions intestines, file ses douze nœuds à l’heure, entre l’île du Bic et Rimouski.
Mais ce vent enragé ne peut durer longtemps; en moins de deux heures après notre départ, nous avons dépassé l’île Saint-Barnabé. Le vent tombe; la goélette n’obéit plus au gouvernail; une forte houle fait trébucher ceux qui n’ont pas la jambe marine; aussi le malaise des estomacs se développe d’une façon alarmante. L’heure du souper est arrivée sans que l’appétit se manifeste; l’un prend un léger repas sur le pont, pendant que d’autres préfèrent sommeiller à jeun. Cependant la maladie ne se déclare franchement que chez M. T., déjà atteint dans le cours de la journée.
Juin, 19, dimanche.—Pendant toute la nuit dernière, la goélette a été agitée par le roulis; les craquements continuels des cloisons ne nous ont guères permis de dormir. Aujourd’hui la mer est encore très-grosse, quoique l’air soit parfaitement calme. La Sara éprouve le supplice d’Ixion attaché à la roue; lorsqu’elle roule au bas d’une vague, l’on dirait que toutes les pièces de sa charpente se disloquent. Les mouvements saccadés des manœuvres rappellent les convulsions d’un épileptique; tandis que le frottement des guis contre les mats produit des sons déchirants, comme les râlements de la mort. Quand arrive quelque énorme vague, soulevant la goélette et la laissant brusquement retomber, chacun de nous sent son cœur voler et prêt à lui sauter dans la bouche.
Vers 8 heures du matin, un vent frais du nord-ouest nous arrache à notre situation désagréable; car, une fois sous voile, le bâtiment prend une allure plus convenable et moins fatigante pour ceux qu’il porte.
A huit lieues de Rimouski se trouve la rivière de Métis, où M. Price a établi de grandes scieries. Ces moulins, dit-on, ont éloigné de la rivière les saumons qui la fréquentaient.
De ces nombreuses scieries, s’échappent des bouts de planches et des rognures de madriers, qui sont portés au large par les vents et les courants, et qui, pour certains oiseaux de mer, deviennent autant de navires improvisés. Deux ou trois mouettes s’établissent sur un de ces bâtiments, dont le pont n’a guères que quelques pouces en superficie, et s’abandonnent au gré des flots. Pendant le cours de la journée, nous rencontrons plusieurs de ces navires lilliputiens, que l’équipage abandonne au moment où le fusil du chasseur se lève menaçant. Sans avoir recours aux sociétés d’assurance, la mouette a bientôt réparé sa perte; car, à quelques brasses plus loin, elle trouve une autre nacelle, sur laquelle elle se livre de nouveau aux agréments et aux peines de la navigation. Une forte vague vient-elle su dérouler sur le petit vaisseau? d’un coup d’aile, la mouette s’élève au-dessus et retombe avec une adresse admirable sur son gaillard, dès que le danger s’est éloigné.
Vers 4 heures du soir, nous passons vis-à-vis du cap Chates, hauteur que l’on peut apercevoir de fort loin en mer; c’est un énorme jalon, qui sert de borne entre le district de Québec et celui de Gaspé. A quelques lieues en arrière s’élèvent les hautes cimes des Chikcháks; sur leur pente d’un bleu foncé, se détachent de longues lisières blanches, qu’à cette distance l’on serait tenté de prendre pour des couches de neige. Cette chaîne de montagnes appartient au système des Alleghanies, et se relie aux montagnes Vertes du Vermont; elle court presque parallèlement au Saint-Laurent, et va se terminer par le Fourillon, près du cap des Rosiers.
Au nord du fleuve, et environ à dix lieues du cap Chates, est un phare, placé à la Pointe-des-Monts; les montagnes qui s’élèvent en arrière de cette pointe basse sont les dernières terres du nord que l’on aperçoive de la rive méridionale du grand fleuve, les deux côtes s’éloignant ensuite rapidement, à mesure qu’on s’avance vers le nord-est. A une lieue du cap Chates, près de la rivière du même nom, est un établissement renfermant six familles. Une chapelle, qui y avait autrefois été érigée, est maintenant en ruines, et les habitants de ce lieu assistent à la mission qui se donne annuellement à Sainte-Anne des Monts[33].
[31] Depuis 1856, la morue a reparu, non-seulement à l’île Verte, mais encore à quelques lieues plus haut, vis-à-vis de la Rivière-du-Loup, où des pêcheurs en ont pris plusieurs.
[32] Dans les premières livraisons des Soirées Canadiennes, monsieur J. C. Taché a développé avec succès les incidents de ce massacre.
[33] La mission du Cap Chates est aujourd’hui florissante; elle renfermait en 1860 une population de 523 âmes.
———
Sainte-Anne des Monts—Un village de pêcheurs—Le Mont-Louis—Le braillard de la Madeleine—La Rivière-au-Renard—Les pêcheries—Une chasse à la poursille, suivie de réflexions—Un loup marin qui cause en anglais—Le beaupré, et une heure de méditation sur le passé, le futur et le présent.
Vers 6 heures du soir, poussés par un fort vent de nord-ouest, nous doublons la pointe de Sainte-Anne des Monts située à un peu plus de trois lieues, du cap Chates. Comme le capitaine V. ne connaît point l’entrée de la rivière, nous mouillons à une demi-lieue de terre. Quelques coups de canon annoncent aux habitants de Sainte-Anne l’arrivée de l’évêque, qui est attendu depuis quelques jours. Une berge se détache aussitôt du rivage; elle nous amène un pilote, qui, pour éviter des cayes dangereuses, jette la goélette sur un banc de sable, à cinquante pieds de l’entrée du petit port. Par bonheur la mer est presque basse; nous pourrons facilement nous remettre à flot, quand elle montera.
A peine avons-nous eu le temps de rire de notre malheur, que nous voyons arriver une berge, expédiée pour transporter les passagers à terre. M. B. missionnaire de Sainte-Anne, et M. LeM., ancien seigneur du lieu, chez qui nous devons être reçus, viennent prier Mgr. de Sidyme et ses compagnons de débarquer de suite. Cette invitation est reçue avec grand plaisir, car depuis notre départ de Québec nous n’avons pu encore descendre au rivage.
Le mouvement de la mer nous suit sur la terre; lorsque nous entrons dans la maison de notre hôte, le plancher semble s’élever et s’abaisser, le pied est mal assuré, et le corps conserve un balancement qui serait compromettant à la suite d’un dîner à l’anglaise.
Mais c’est du souper qu’il s’agit; il est déjà huit heures, et, après quelques jours passés à la mer, il n’est rien pour aiguiser l’appétit, comme des murailles qui ne vacillent point et une table qu’il n’est pas nécessaire de retenir avec les pieds et avec les mains. Sur leur demande, on sert aux voyageurs des mets qu’ils ont entendu vanter, mais qu’ils n’ont encore jamais rencontrés; ce sont des ralingues de flétan et des morues toutes fraîches. Les morues qu’on nous présente ont été prises, il y a vingt-quatre heures, non à la ligne, mais avec le pied. Hier soir, à deux pas du banc sur lequel nous nous sommes échoués, une vingtaine de morues, entraînées au rivage en poursuivant le capelan, sont restées sur le sable et ont été assommées à coups de pied.
Le vent du nord-ouest nous a fait parcourir depuis le matin environ trente lieues, dont dix-huit, depuis Matane, ne nous ont coûté que cinq heures et demie de navigation. Ce jour étant un dimanche, il a fallu suppléer aux offices de l’église par les prières de la messe, la récitation du chapelet et quelques lectures de piété. Comme le temps était magnifique, ces exercices se sont faits sur le pont, afin que tout l’équipage y pût assister. Se brisant contre les flancs du vaisseau, la mer élevait sa grande voix pour louer avec nous le Seigneur, et bénir celui qui a creusé son bassin et tracé ses limites.
Nous retournons à bord pour la nuit. La goélette a été laissée sur le flanc lorsque la mer s’est retirée, et elle a donné à la bande de telle sorte, que deux d’entre nous doivent renoncer à se coucher sur leurs lits, où ils ne peuvent s’aventurer qu’en risquant de rouler sur le plancher. Force leur est donc de s’étendre in plano, afin de se maintenir la tête au-dessus des pieds. Mais ils ont compté sans leur hôtesse: lassée d’être étendue sur le côté droit, la Sara pendant la nuit s’est soulevée avec la marée montante, et, en reprenant sa position sur le banc de sable, s’est étendue sur le flanc gauche. Par suite du demi-tour, les deux malheureux de la veille se trouvent, ce matin, dans la position de Gulliver entre les mains du géant de Brobdignag: ils ont les pieds levés au ciel et la tête penchée vers le banc de sable.
Juin, 20.—Sainte-Anne des Monts est un poste agréable et salubre, offrant, pour les mois de l’été, une retraite confortable à un valétudinaire qui aurait conservé assez de santé pour aller respirer l’air pur et frais, en se livrant aux amusements de la pêche et de la chasse. A cette époque, les bords de la mer sont couverts de bandes de gibiers noirs: au printemps et à l’automne, les canards et les outardes abondent; outre cela, dans les bois voisins des habitations, l’on trouve en tout temps des perdrix et des porcs-épics.
Dans les eaux limpides de la Sainte-Anne, l’œil du pêcheur peut suivre les mouvements des truites, câlinant derrière une pierre, ou se poursuivant et se disputant entre elles les entrailles de morue qui leur sont jetées. Vers le commencement de juin arrive le capelan, qui remonte le Saint-Laurent pour déposer son frai. Ce petit poisson voyage en masses si denses, qu’elles opposent quelquefois de la résistance aux rames plongées à l’eau. Leurs colonnes mouvantes sont poursuivies par les morues, qui arrivent vers le même temps dans ces parages. Pendant que le capelan reste près de terre, la morue est abondante, et deux bons pêcheurs peuvent alors en prendre de trois cents à six cents par marée.
La chapelle et la maison du seigneur sont bâties sur une presqu’île sablonneuse, formée par un barachois et l’embouchure de la rivière Sainte-Anne. Les habitations s’étendent le long du fleuve, jusqu’à une demi-lieue de chaque côté de ce point central. N’ayant rien de mieux à faire avant les exercices de la mission, je consacre une heure à visiter le premier endroit de pêche que j’aie encore rencontré. Le soleil vient de se lever; la brise du matin repand une délicieuse fraîcheur et porte au loin cette odeur, moitié saline et moitié sulfureuse, qui s’échappe des tas de varech déposés au rivage. Une grève de sable blanc, ferme et unie, s’étend autour de l’anse. Vers l’intérieur, à quelque distance du fleuve, le terrain s’élève, et les collines s’étagent les unes au-dessus des autres, jusqu’à ce qu’elles se terminent par les Chikcháks, dont quelques cimes, dans les environs, ont plus de trois mille cinq cents pieds de hauteur. Près de chaque maison de pêcheur est le vignot, échafaud long, étroit, couvert de claies sur lesquelles sèche la morue. Des bandes de chiens et de pourceaux, dans la jouissance d’une indépendance illimitée, errent de côté et d’autre, grognant, aboyant, se querellant autour des débris de poissons amoncelés sur le sable.
Sainte-Anne des Monts ne renferme que trente-sept familles, dont la plus ancienne y est établie depuis vingt ans, les autres y sont venues depuis.[34] Il n’y a pas encore bien longtemps que ceux qui naviguaient sur cette côte craignaient de s’y arrêter; ils aimaient mieux essuyer les plus rudes tempêtes au large que de venir mouiller dans ce port, car les habitants passaient alors pour des pillards déterminés. Aujourd’hui les choses ont bien changé; les pêcheurs du lieu gagnent leur vie honnêtement, se contentant de faire la guerre à la morue et au saumon. Ils prouvent leurs bonnes dispositions pendant la visite épiscopale, car tous se rendent aux exercices et s’empressent d’approcher des sacrements.
La seigneurie de Sainte-Anne des Monts appartient maintenant à M. Buteau, marchand de Québec, ainsi que celle de la Petite-Sainte-Anne, acquise de la famille Vallée. Le sol est sablonneux près du fleuve, mais devient meilleur à mesure que l’on s’approche des montagnes. Quoique la température soit froide, le blé mûrit très-bien; jusqu’à présent, cependant, les habitants ont négligé la terre pour s’occuper presque entièrement de la mer.
6 h. P. M.—Après les exercices de la mission, nous allons essayer notre chance à la pêche. Près du banc de sable, placé à l’entrée de la petite rivière, un grand nombre de pêcheurs, les uns marchant dans l’eau, les autres montés sur des flettes, s’occupent à prendre du capelan, qui sert de bouette ou d’appât pour la morue; à chaque coup de verveux, ils retirent plus d’un demi-minot de ce poisson. Aussi notre provision de capelans se fait dans un instant, et nous mouillons sur un fond, où il y a cinq ou six brasses d’eau. Au bout de trois quarts d’heure, seize grosses morues, étendues au fond de la chaloupe, témoignent leur mauvaise humeur, en ouvrant les ouïes, balançant les nageoires et battant de la queue. Il faut savoir s’arrêter à temps dans les voies de la bonne fortune; le soleil vient de se coucher, le canon de la pointe nous appelle; on nous attend pour le souper.—“Ramons, amis, vivement, vigoureusement; qu’importe la fatigue du moment, nous pourrons ce soir dormir en paix, sans craindre les soubresauts de la Sara.”
La goélette est en effet entrée dans la petite rivière, où, à l’abri des vents et des flots, elle nous promet une nuit plus tranquille que la dernière. Cependant, Morphée a beau entasser ses pavots sur nos paupières, il nous coûte de laisser le pont pour la chambre. Le temps est si calme; la lumière de la lune tombe si mollement sur les masses obscures des montagnes! Voyez au large ces feux glissant silencieusement sur la mer; une lueur rougeâtre s’attache aux canots, et aux figures fantastiques qui les guident; elle se répand au loin et s’étend sur les eaux, comme un vaste linceul ensanglanté. Armés de flambeaux, les pêcheurs sont en quête du saumon, qui ordinairement remonte pour frayer dans la rivière, vers le milieu du mois de juin. Le temps de son arrivée est passé, et il n’en a pas encore été pris. Aussi on s’inquiète de cette circonstance, et, chaque soir depuis quelques jours, les pêcheurs viennent sonder de l’œil les fonds, où il a coutume de s’arrêter avant d’entrer dans la rivière Sainte-Anne.
Juin, 21.—Hier, nous devions laisser ce lieu; mais comme plusieurs des habitants éloignés n’avaient pu encore se rendre afin de recevoir la confirmation, Mgr. de Sidyme est resté pour l’avantage des retardataires; à l’issue de la messe, il a adressé aux pêcheurs et à leurs familles des recommandations, qui ont été écoutées avec beaucoup d’attention.
La goélette nous attend au large: la plus belle berge du port, choisie pour nous y transporter, est suivie de nombreuses embarcations. Du gaillard d’arrière, l’évêque renouvelle ses adieux, auxquels les braves gens de Sainte-Anne répondent par une fusillade prolongée. Vers sept heures du matin, nous partons avec le secours d’un très-faible vent, qui, après nous avoir taquinés pendant une couple d’heures, nous abandonne complètement à la merci de la mer et du courant.
Aussi avons-nous le temps d’examiner les cheminées, rochers ainsi nommés à cause de leur forme, et d’admirer plusieurs gentilles cascades de cinquante à soixante pieds de hauteur, dont la blancheur contraste avec la teinte sombre des arbres voisins. Toute cette côte, depuis Sainte-Anne, est haute, escarpée, coupée par de profondes ravines. Dans l’intérieur, les terres sont bonnes, nous dit-on, et pourraient nourrir un grand nombre de familles. En ouvrant des chemins pour lier cette portion du pays avec le district de Québec, la législature encouragerait à s’y établir les cultivateurs peu fortunés des anciennes paroisses.
Pendant que la France possédait le Canada, on maintenait sur cette côte quelques établissements de pêche; un des plus florissants, selon Charlevoix, fut celui de la compagnie du sieur Riverin au Mont-Louis. Cet endroit, dans les environs duquel l’on avait découvert du cuivre, promettait alors beaucoup, par l’abondance de la pêche, la fertilité des terres de la vallée, et les avantages du port pour les petits bâtiments employés aux pêcheries. Il est à remarquer que le blé mûrit ici, aussi bien que dans les environs de Québec. Le poste du Mont-Louis est à douze lieues de Sainte-Anne des Monts; il ne renferme plus aujourd’hui que trois familles, dont les habitations, placées sur les bords de la rivière, sont abritées contre les vents par l’éperon d’une haute montagne. Une famille habite le Grand-Etang, à sept lieues au-dessus de la Rivière-au-Renard; et voilà les seuls habitants, qu’après avoir laissé Sainte-Anne, l’on trouve sur une étendue de trente lieues de côtes.[35]
Juin, 22.—Le vent nous a aidés pendant la nuit; nous sommes par le travers de la rivière de la Madeleine, célèbre dans les chroniques du pays par les histoires de revenants qui s’y rattachent. Et quel est le matelot canadien qui a fréquenté ces parages, sans avoir entendu pendant la nuit les accents plaintifs, les cris lugubres du braillard de la Madeleine? Quel marin de la côte consentirait à passer quelques jours, seul dans ce lieu, où un esprit tourmenté cherche à faire comprendre sa peine? Est-ce l’âme d’un naufragé, qui demande la sépulture chrétienne pour son corps et les prières de l’église pour elle-même? Est-ce la voix du meurtrier, condamné à expier son crime au lieu même où il l’a commis? Les écumeurs de mer qui ont rôdé sur ces côtes ne se sont pas toujours bornés à dépouiller les naufragés; ils ont essayé quelquefois de s’assurer l’impunité par l’homicide, convaincus que la tombe est muette et ne révèle point de secrets. Serait-ce la célèbre terre des Démons, dont parle le cosmographe Thevet, terre où il prétend que Roberval abandonna sa nièce, la demoiselle Marguerite, avec son amant et une vieille duègne normande. Le vieux conteur place cette terre sur quelque point des côtes du golfe Saint-Laurent, et rapporte qu’après la mort de ses deux compagnons, la demoiselle eut longtemps à lutter contre les démons, qui, sous la forme d’ours blancs, cherchaient à l’effrayer par leurs cris et par leurs griffes. Thevet aurait pu tenir tête à un des matelots de la Sara, qui ne connaît pas l’histoire de la demoiselle Marguerite, mais qui en sait bien d’autres sur le compte du braillard de la Madeleine. Aussi, se sentant mal à l’aise dans ce quartier, il brasse vigoureusement les voiles pour appeler le vent, fut-ce même un vent contraire; peu lui importe le moyen, pourvu qu’il s’éloigne du braillard de la Madeleine.
Juin, 23.—A une heure après midi, s’ouvre devant nous la baie de la grande rivière au Renard; la petite rivière du même nom se trouve à quelques milles au-dessus. Cette baie forme un demi-cercle, dont le diamètre peut être d’un mille. L’entrée est entre deux caps, sans cesse minés par les flots; autour du bassin, le terrain présente un amphithéâtre couvert de verdure et couronné de bois francs. Vers le fond de la baie et au-dessus de l’embouchure de la rivière au Renard, se déploie un barachois[36], bordé de belles prairies. Des maisons éparses, habitées par dix-huit familles[37]; quarante berges à l’ancre autour du bassin; un cul-de-poule[38] de l’île Jersey; au rivage, des vignots, des chafauds; sur le penchant du côteau, une chapelle, qui a vingt pieds de longueur et ressemble à une chambre de vaisseau: voilà un petit monde riant, animé, où tout annonce que nous sommes dans un pays uniquement occupé de la pêche.
M. Edouard Montminy, prêtre, dont la mission s’étend sur plus de cinquante lieues de côtes, depuis la Pointe au Maquereau jusqu’au Mont-Louis, est bientôt rendu auprès de nous; depuis quinze jours, il attend en ce lieu l’arrivée de Mgr. Turgeon.
Le débarquement se fait sur une belle grève de sable et de gravier; mais quelle puanteur s’exhale de ces monceaux de têtes et d’entrailles de morues, qui pourissent sous un soleil brûlant!—Que voulez-vous, c’est le pays de la morue! Par les yeux et par les narines, par la langue et par la gorge, aussi bien que par les oreilles, vous vous convaincrez bientôt que, dans la péninsule gaspésienne, la morue forme la base de la nourriture et des amusements, des affaires et des conversations, des regrets et des espérances, de la fortune et de la vie, j’oserais dire, de la société elle-même.
Autour de la rivière au Renard, le sol est excellent et naturellement couvert d’une herbe longue, propre à la nourriture des bestiaux; il produit d’assez bon blé, de l’orge, de l’avoine, des pommes de terre qui viennent à merveille; mais qu’est-ce que cela? La mer n’est-elle pas là avec ses trésors inépuisables? Au printemps les travaux de la terre se font à la hâte, et l’on se livre avec fureur aux préparatifs de la pêche. Du district de Québec arrivent beaucoup de jeunes gens, qui s’engagent comme moitiés de ligne, chez un maître de grave[39]. Celui-ci fournit lignes, hameçons, filets, berges et sel; il reçoit la morue au rivage; il la décolle, la tranche, la sale, la met sécher sur les vignots, la pile, la travaille, et enfin loge ses employés dans une coquerie, ou, suivant le langage du pays, un cook-room, qui leur sert de cuisine et de logis. Chaque berge est conduite par deux moitiés de ligne; ceux-ci fournissent la bouette, et, pour s’en pourvoir, ils passent une partie de la nuit à draguer. Ils pêchent pendant la journée, et viennent le soir déposer le produit de leur travail sur la grève, où le maître prend le poisson et le prépare. Lorsque la morue est sèche, une moitié appartient au patron et l’autre moitié aux pêcheurs, qui, à cause de cette clause dans les marchés, ont reçu le nom de moitiés de ligne.
Vers le commencement de juin, arrive la morue poursuivant le capelan. Pendant une couple de semaines, elle remonte en très-grande quantité; alors les pêcheurs prennent à peine deux heures de repos, sur les vingt-quatre heures de la journée.
Lorsque le capelan s’éloigne des rivages pour remonter le fleuve, l’abondance de la pêche diminue considérablement; il faut appâter la morue avec du hareng, et une berge ne rapporte plus guères que deux ou trois cents poissons par jour. C’est, suivant le vocabulaire des Gaspésiens, le temps de la faillette.
Vient ensuite la saison du maquereau, qui, dans ces parages, n’est pas aussi importante que celle de la morue. Il arrivera aussi qu’un flétan sera retenu prisonnier à la ligne du pêcheur. Ce poisson plat ressemble à la plie, par la forme et par les nageoires; mais il est de dimensions bien plus grandes, car on en trouve qui pèsent de deux cents à deux cent cinquante livres, et qui ont, de longueur, six pieds et même davantage. Doué d’une force prodigieuse, le flétan cause souvent de l’embarras aux pêcheurs; c’est ce que déclare ingénument devant nous un brave homme, qui, en ayant arrêté un et ayant voulu l’amener trop vite à sa berge, faillit être emporté à la mer par sa proie.
Les habitants de la Rivière-au-Renard sont bons et religieux; plusieurs d’entre eux sont d’origine britannique, et parlent aussi mal l’anglais que le français; par leurs manières et leurs habitudes, ils sont canadiens. La pêche leur fournit les moyens de vivre à l’aise, quoique les provisions s’y vendent fort cher. L’élévation des prix vient en partie, de ce que les maîtres des goélettes qui font le cabotage craignent de fréquenter cette partie de la Gaspésie, rendue célèbre par beaucoup de naufrages. L’anse de la Rivière-au-Renard est cependant assez sûre; les bâtiments y mouillent sur un bon fond et à l’abri de tous les vents, si l’on excepte ceux qui viennent du nord.
Suivis d’un cortège grotesquement mélangé d’hommes, de femmes et d’enfants en costume négligé, nous montons à la chapelle, en espérant nous délivrer de l’odeur infecte, qui, au débarquement, a salué nos narines. A mesure en effet que nous nous élevons vers le sommet du côteau, nous éprouvons un changement remarquable pour le mieux; l’atmosphère est moins imprégnée d’odeurs méphitiques, et l’air se balance plus pur et plus frais; de verts sapins, plantés autour de la chapelle, nous font déjà rêver aux bocages de l’Arcadie. Les portes de la chapelle s’ouvrent. “Pouah!” s’écrie M. N., en s’écrasant le nez, “pouah! comme ça sent encore la morue!”—“M. le missionnaire,” reprend Mgr. de Sidyme, “faites-vous sécher du poisson dans la chapelle?”—“Non, monseigneur; mais, en la nettoyant, mes braves gens ont employé du savon fait avec de l’huile de morue.”
Pendant les exercices donnés à la chapelle, nous pouvons nous convaincre de la vérité d’une remarque faite par feu monseigneur Plessis: dès que les pêcheurs, accoutumés à un travail presque constant, demeurent tranquilles, un sommeil de plomb pèse sur leurs paupières. Cette propension à dormir s’explique par les veilles précédentes et par le contact du poisson, auquel on attribue une puissante influence soporifique.
Vers le soir, la Sara regagne le large, pour être prête à entrer demain, de grand matin, dans l’anse au Gris-Fond[40], qui est à deux lieues de la Rivière-au-Renard.
Le soleil va disparaître à l’horizon. Une poursille, dauphin des mers américaines, vient faire quelques pirouettes autour de la goélette. Le seul fusil que nous ayons à bord est prêt, et le coup est dirigé contre la pauvre bête, qui, étant blessée, plonge et reparaît au bout d’une minute. “Elle est blessée,” dit un des spectateurs: “elle est blessée, et dans peu de temps elle reviendra à la surface.” On lance une chaloupe à la mer; et quatre amateurs du sport font force de rames vers le point où, pour la dernière fois, la poursille s’est montrée. “La voilà, à trente brasses de nous,” murmure le chasseur en chef; “appuyez légèrement sur la rame; je vais me tenir prêt à faire feu.” Le chien est levé; tous les yeux se dirigent vers la victime, à demi enveloppée dans l’obscurité qui s’accroît rapidement; les rames sont suspendues, prêtes à frapper la mer; le doigt du tireur presse la détente, qui obéit et déclique. Mais, au lieu d’une bruyante détonation, un son mat et étouffé se fait entendre. “L’infâme fusil a raté,” remarque le chasseur, en remettant une seconde capsule sur la cheminée; “mais le gibier est encore là; silence!” Le même son annonce une seconde déconfiture. Cette fois les chuchotteries, causées par un double désappointement, ont donné l’alarme à la poursille, qui disparaît tout à coup.
Rien de plus opiniâtre qu’un vrai chasseur. “La poursille blessée va reparaître; taisons-nous,” reprend à voix basse l’homme au fusil, en essuyant du revers de la main les grosses gouttes de sueur qui coulent sur son front.—“Peut-être,” dit un rameur; “.... mais la goélette s’éloigne et il se fait nuit.”—“Vrai, mais on va rire de nous, si nous retournons les mains vides.”—“Eh! bien, en avant, mes amis; je vois un point noir, là-bas; c’est elle assurément.” La chaloupe vole sur les flots; une rame est levée, prête à assommer la poursille mourante, si elle ose faire un mouvement pour échapper.... Illusion! ce n’est qu’un petit loup marin, qui, entendant tout ce vacarme, a mis la tête dehors; comme il voit que nos intentions sont hostiles, il bat précipitamment en retraite, et emporte avec lui nos dernières espérances. Il nous faut rebrousser chemin, et chacun de nous, en retournant vers la goélette, paraît Honteux comme un renard qu’une poule aurait pris.
N’est-ce pas là une édition abrégée de la vie de l’homme? Il a cru apercevoir le bonheur glissant auprès de lui; et, pour le joindre il a lancé sa nef. Elle vogue gaîment, légèrement, à la poursuite de l’objet séduisant. Au moment où il va le saisir, le fantôme lui échappe et brille un peu plus loin, pour disparaître de nouveau. Alors naissent des réflexions. L’homme déçu s’arrête pour délibérer; la vanité lui souffle un mot à l’oreille, et il s’élance vers de nouveaux désapointements. Cependant les ténèbres de la vieillesse descendent, et elles dissipent ses dernières illusions. Tristement, l’homme retourne vers le gîte qu’il a laissé alors que la lumière du soleil éclairait sa route; il revient sur ses pas, n’ayant plus devant lui que les profondeurs de la nuit éternelle.—Mais! voilà bien les flancs noirs de la Sara; et là haut, sur le pont, on rit, on plaisante sur notre compte. Eh bien! riez, riez, gaillards; moi, je viens de prendre une bonne leçon de philosophie, qui me permettra d’endurer tous vos brocards sans sourciller.
“C’est, tout de même, une place embêtante pour la chasse aux poursilles et aux loups marins, que c’te côte de Gaspé,” me disait, à la suite de cette course, un vieux marin qui connaissait bien le pays. “On ne finit pas toujours ici par prendre la bête qu’on a poursuivie, car on rencontre par fois de drôles de gibiers.—C’était en 18...; des navires avaient été jetés à la côte. Un jour, dans un de ces petits endroits, les berges étaient à terre, car la morue ne donnait plus depuis une semaine, et l’on en profitait pour faire un peu de foin sur les bords de la rivière. On n’oubliait pourtant pas la mer; car il y avait souvent des curieux sur la pointe. Deux obstinés pêcheurs avaient l’œil au vent depuis quelques minutes, quand, l’un d’eux dit à l’autre:—Mais, Jacques, c’est un drôle de loup marin qu’on aperçoit là-bas, au milieu de ces pièces de bois qui descendent avec la mer. Prends ton fusil et allons y voir.—Il y avait de fait, au large, une tête de loup marin, qui s’agitait au milieu de quelques morceaux de bois, comme si elle avait voulu tirer son corps d’un mauvais pas. Un saut et un bond, et les deux pêcheurs étaient sur un flette et gagnaient vers le loup marin. Déjà celui des deux qui était à l’avant mettait son fusil à l’épaule, quand la bête pousse un cri épouvantable: c’était comme quand un anglais jase bien fort. Le fusil tombe des mains du chasseur.—Retournons, Jacques, dit-il.—Son compagnon ne se le fit pas dire deux fois. Et le flette filait vers la terre.—As-tu vu comme il a la face noire?—Oui.—Et ses grands yeux blancs?—Oui.—Et puis c’est qu’il a parlé en anglais.—Eh ben! il faut que ça soit le malin, ni plus, ni moins.—C’est ce que j’allais te dire.”
“Nos deux chasseurs étaient arrivés à terre. On les avait aperçus, et plusieurs s’étaient rendus pour les questionner. A toutes les demandes qu’on leur faisait, ils répondaient: C’est le malin, ben sûr.”
“Cependant, au large, le loup marin secouait un bonnet au bout d’un bâton.—Vous êtes des lâches, dit un des pêcheurs, qui avait, un peu plus voyagé que les autres.—Qu’il en vienne un avec moi. Eh bien si c’est le malin, nous le prendrons à son tour.—Il avait parlé si résolument, qu’il eut bien vite un compagnon qui s’embarqua avec lui. De la terre on les suivait des yeux; ils arrivèrent près du prétendu malin qui sembla se montrer bon garçon, car ils le tirèrent de l’eau, et le mirent dans leur petit flette.”
“Miséricorde! que c’est noir! criaient les femmes, quand elles virent débarquer un beau grand matelot. C’était un nègre; il marchait en boîtant et en s’appuyant sur le bâton qui lui avait servi de mât de hune. Tombé à la mer, je ne sais comment, il avait été jeté sur la grève, loin des établissements; comme il s’était blessé une jambe, il prit un bâton pour s’aider à marcher, car il ne voulait pas mourir sans se défendre jusqu’au bout. Pendant quelques milles il trouva une belle grève; mais au pied d’un cap, il n’y avait pas moyen de passer. Il s’avisa de faire un radeau avec du bois qu’il trouva, et de continuer son voyage par mer. Le courant emporta le radeau au large, la mer le brisa, et il y avait déjà quelques heures qu’il se soutenait, avec bien de la peine, sur les pièces de son bâtiment, quand il eut la chance d’être pris pour un loup marin.—Voilà mon histoire de loup marin; elle vaut bien votre chasse aux poursilles.”—Certainement mieux; mais est-elle aussi vraie?
9 heures du soir.—Le vent d’est fraîchit; il souffle bientôt avec violence. N’ayant que deux lieues à faire pour arriver à l’anse au Gris-Fond, et n’y pouvant entrer de nuit, nous portons au large, suivis du cul-de-poule de Jersey. Notre marche plus rapide que la sienne nous le fait bientôt perdre de vue. Le capitaine V. aime beaucoup mieux la pleine mer que les côtes; aussi ce n’est qu’après s’être éloigné de terre d’environ cinq ou six lieues, qu’il fait mettre à la cape. Vers dix heures, le vent devient furieux, la mer est grosse, et la Sara, impatiente du frein, voudrait courir à toute vitesse; elle s’agite, se cabre, pirouette si violemment, que M. Montminy, tout missionnaire qu’il est, profite de la circonstance pour offrir son souper en sacrifice au vieux Neptune, dont on aperçoit le bonnet blanc à travers l’écume des vagues.
Southey, a dit, je ne sais ni où, ni quand, que la plus délicieuse position pour un flâneur, est d’être étendu sur un sofa, le cigarre aux lèvres, et la nouvelle du jour entre les mains. Les goûts sont différents: j’aime quelque chose d’un peu plus dur que le duvet d’un canapé; ce soir il me semble n’avoir rien à envier à cet heureux mortel du poète lauréat d’Angleterre. Enveloppé d’un épais manteau, vieux compagnon de voyage, muni d’une pipe prosaïque, et étendu sur le beaupré, pendant une heure je songe, comme songeait en son gîte le lièvre du bon LaFontaine. Au bruit des vagues, mes rêveries sont agréablement bercées par le balancement mesuré de la Sara; avec le filet de fumée, qui s’élève en tournoyant du fourneau de mon pétunoir, se déroulent les songes enchantés de l’enfance, les fantaisies, les espérances, et l’avenir couleur de rose de la jeunesse; les amis qui ne sont plus, et ceux que la Providence a dispersés, apparaissent les uns après les autres, traînant dans leur cortège des souvenirs, tantôt à demi effacés, tantôt pleins de vie et de fraîcheur. Souvenirs, espérances, voilà la somme des joies humaines; l’homme n’est heureux que dans le passé et dans l’avenir; mais le présent.... “Ouf! le présent est trop humide et trop froid pour que je reste ici,” fis-je, presque étouffé en si beau chemin, par une vague, qui venait de franchir le plat-bord, et brisait en un clin-d’œil la chaîne de mes méditations.
[34] En 1860, 119 familles habitaient Sainte-Anne des Monts.
[35] Le Mont-Louis renfermait, en 1860, 35 familles, formant une population de 216 âmes.
[36] Le barachois est un étang ou lac, qui se trouve ordinairement à l’entrée des petites rivières, au point où elles se jettent dans la mer. Les puissantes vagues qui arrivent du large élèvent un banc de sable, à l’embouchure des rivières; c’est derrière ce banc que se forme le barachois. Le surplus des eaux de la rivière tombe dans la mer, par un canal étroit, qui se creuse tantôt d’un côté, tantôt d’un autre.
[37] En 1858 la Rivière-au-Renard renfermait 84 familles.
[38] Goélette à poupe allongée et pointue.
[39] C’est ainsi que, sur la côte de Gaspé, l’on désigne le propriétaire d’un établissement de pêche. Les pêcheurs français emploient généralement les termes qui étaient en usage lorsque la France possédait ce pays. Grave signifiait d’abord, paraît-il, une certaine étendue de terre près du rivage, préparée pour faire sécher la morue; ce nom a été ensuite donné à l’établissement tout entier.
[40] Aujourd’hui l’on écrit Griffon au lieu de Gris-Fond, nom donné, suivant quelques-uns, parce que le fond de la mer est formé d’un sable grisâtre.
———
L’anse au Gris-Fond—Un baleinier, et les baleines—Entrée du Saint-Laurent—Le cap des Rosiers, le Fourillon et la Vieille—Brumes—Baie de Gaspé—Baie du Penouïl—Jacques Cartier et ses deux gaspésiens—Alguimou—Baie des Moines.
Juin, 24.—Vers huit heures du matin, nous mouillons à l’entrée de l’anse au Gris-Fond, qui ressemble beaucoup à celle de la Rivière-au-Renard, à cela près, qu’un cap s’avance vers le milieu de la première et la sépare en deux parties. L’entrée de ce hâvre est assez difficile, car de la pointe ouest courent au large des brisants, sur lesquels la mer vient rebondir avec fureur. Quinze ou seize familles catholiques, presque toutes d’origine anglaise ou irlandaise, forment la population stable de cette localité.[41] Tous parlent l’anglais et le français, ou plutôt, mêlent l’anglais avec le français; cette fantaisie s’est même attaquée aux noms propres, car plusieurs des habitants ont un double étui pour leurs noms de famille. Ainsi, le jour de notre arrivée, se présentait un des marguilliers de l’endroit, sous le nom de Rinfret; le lendemain il était désigné comme M. Coldback: c’était son nom breton, qu’il comprenait aussi bien que le nom gaulois de ses ancêtres.
Trois familles ont formé la base sur laquelle s’est élevée la population de l’anse au Gris-Fond et de la Rivière-au-Renard: ce sont les English, les Sinnot et les Bond. Des pêcheurs, venus généralement du district de Québec, sont entrés dans ces familles et en ont fondé de nouvelles. Ainsi que dans les autres villages de la côte, il s’y réunit pendant l’été un bon nombre d’étrangers, qui sont employés par MM. Janvrin et par la maison Buteau et LeBouthillier.
Une couple de goélettes sont dans le havre, échangeant des farines, du lard, des marchandises, contre les produits de la pêche. Sur les grèves règne un air de vie et d’activité.
Au fond de l’anse est une petite rivière avec son barachois. En général, sur cette côte, tous les établissements sont placés dans une situation analogue. En voici la raison: la pêche demande une grève commode pour faire sécher la morue, et un mouillage où les chaloupes et les goélettes puissent ancrer à l’abri des gros vents; il faut aussi trouver de l’eau douce dans le voisinage. A l’embouchure des petites rivières qui se jettent dans la mer, se rencontrent ordinairement une grève commode, une anse, de l’eau douce; la mer fournit le reste. Sur tous les autres points de cette côte, les flots viennent battre contre des rochers escarpés, au pied desquels une corneille trouverait à peine assez de place pour poser le pied.
Les terres sont bonnes aux environs de l’anse au Gris-Fond; mais, comme dans les autres parties de la Gaspésie, l’agriculture y est presque abandonnée pour la pêche.
Un fort vent contraire nous accueille à la sortie du petit hâvre; cependant notre malheur est fort avantageux pour une goélette que nous hêlons. Elle se rend de la Baie des Chaleurs à Québec, où le capitaine est prié de donner de nos nouvelles. La soirée est obscure, et de lourds nuages s’étendent sur l’horizon, puissamment poussés par le vent. Au large apparaît une goélette, à la coupe étrange, qui porte le cap sur nous. Deux longues chaloupes sont suspendues à ses flancs, l’une à babord et l’autre à stribord; sur son pont saut rangés une douzaine de gaillards, qui semblent prêts à tenter une aventure. Noire, lourde, se traînant péniblement sur les eaux, elle a la mine lugubre de ce mystérieux vaisseau de la mort, qui, suivant les marins anglais, se révèle, la nuit de la mi-été, à quelque bâtiment condamné à périr. Eh bien! les ténèbres, qui se répandent sur les flots, nous annoncent précisément le commencement de cette nuit terrible.
Après tout, ce n’est pas le “flying Dutchman” des Anglais, mais bien un baleinier de la baie de Gaspé, portant ses deux berges, longues, étroites et légères; il est monté par le nombre d’hommes nécessaire pour faire la pêche de la baleine. Cette goélette croise ordinairement entre l’île d’Anticosti et la côte du sud parage où les baleines sont nombreuses. En effet depuis quelques jours, à peine se passe-t-il une heure sans que nous en voyions plusieurs s’élever à la surface, lancer dans l’air une colonne d’eau, éternuer vivement, faire trois fois le plongeon, et aller répéter les mêmes tours un peu plus loin. Trois ou quatre baleines sont parfois en mouvement sur différents points, les unes assez rapprochées de nous, les autres à deux ou trois lieues de distance. Ces énormes masses se montrent, dit-on, difficiles dans leurs repas, et elles paraissent rechercher une nourriture choisie. Quand elles voyagent ainsi près de la surface, elles font la chasse à un poisson fort petit, dont elles raffolent, et qu’elles engloutissent par milliers.
Les Canadiens ont négligé les trésors que leur présente le golfe Saint-Laurent. Tandis que les armateurs d’Halifax et de Saint-Jean du Nouveau-Brunswick expédient annuellement des navires pour la pêche de la baleine, pas un seul bâtiment n’est frété à Québec pour faire la guerre à ces géants de la mer, qui, à l’entrée du grand fleuve, vivraient dans une profonde sécurité, si des écossais du bassin de Gaspé ne leur donnaient la chasse.
Juin, 25.—A trois lieues de l’anse au Gris-Fond, une terre basse s’avance du pied des montagnes, et se termine à la mer par une pointe, qui n’a guère plus de trente à quarante pieds de hauteur. C’est le cap des Rosiers, que les géographes donnent comme le point où finit le Saint-Laurent. Il faut avouer que ces messieurs ont, au mépris des convenances, choisi un des plus ignobles amers, pour désigner l’entrée du roi des fleuves de l’Amérique Septentrionale. Ils n’avaient cependant pas besoin de porter la pointe de leur compas, bien loin du misérable cap des Rosiers, pour trouver une colonne aussi grandiose que le Calpé et l’Abyla d’Hercule, et digne d’annoncer aux navires le majestueux Saint-Laurent. En effet, à sept milles au-delà du cap des Rosiers, se termine, par le promontoire du Fourillon, la chaîne des montagnes qui bordent la rive droite du fleuve, au-dessous de Québec. Le Fourillon est une péninsule étroite, qui s’avance hardiment jusqu’à une lieue dans la mer, entre l’anse du cap des Rosiers et la baie de Gaspé. Du côté du nord, il présente un roc nu, taillé à pic et s’élançant à une hauteur de sept cents pieds; c’est le reste d’une montagne, dont une moitié a été précipitée dans la mer, après avoir été minée à sa base par la glace et par les eaux; l’autre moitié est restée debout, droite comme une muraille.
Vis-à-vis de la pointe du Fourillon, est l’îlot de la Vieille, probablement uni autrefois avec la terre ferme, dont il est maintenant séparé par un étroit canal.
La Vieille, rocher de peu d’étendue, a reçu ce nom, parce que les yeux des marins y ont entrevu une tête de femme, couverte d’une large coiffe, comme en portaient nos grand’mères canadiennes. Mais le temps, les vents et les vagues ont dérangé les ajustements de la bonne dame. Aujourd’hui l’îlot, vu de la mer, ressemble tellement à un vaisseau portant toutes ses voiles, que les navigateurs, même ceux qui connaissent ces lieux, y sont quelquefois trompés[42].
C’est ici un pays de tempêtes et de naufrages. Ce qui ajoute aux dangers de la mer voisine, ce sont les brumes épaisses, qui dérobent à la vue les objets les plus rapprochés. A la hauteur de la Vieille, nous rencontrons un de ces brouillards que les matelots nomment bancs de brume. Devant nous s’abaisse, comme un immense linceul, un voile obscur, que l’œil ne peut percer, et qui sépare les ténèbres de la lumière. Au moment où nous l’atteignons, le soleil luit au-dessus de nos têtes; un instant après, nous sommes plongés dans une nuit, qui ne permet pas de distinguer un homme, d’un bout à l’autre de la goélette. Cette transition est subite; le changement se fait complet, tranché, comme celui qui s’opéra devant les anges rébelles, lorsqu’ils tombèrent de la splendeur des cieux dans la nuit des enfers.
Fréquemment, au milieu de ces brumes, des navires poussés par un vent favorable, et n’ayant point vu de terres depuis leur départ d’un port européen, vont se briser contre les rochers du Fourillon, ou les côtes basses du cap des Rosiers. D’autres entrent, à pleines voiles, dans la baie de Gaspé, croyant remonter le Saint-Laurent. Il y a deux ans, un bâtiment, qui naviguait ainsi dans de profondes ténèbres, s’échoua brusquement sur un banc de sable. Comme le capitaine se croyait en plein fleuve, il ne pouvait s’expliquer la mésaventure; le seul remède était de prendre patience, et il s’y soumit. La brume se dissipa; et quel ne fut pas son étonnement, lorsqu’il se vit échoué sur une pointe de sable, au fond de la baie de Gaspé! Ce printemps même a péri, près du même lieu, un navire chargé d’émigrés, qui à grande peine ont échappé à la mort.
La baie de Gaspé est une belle nappe d’eau, large de huit milles et s’avançant environ six lieues entre deux terres hautes. L’une, le revers du Fourillon, est montagneuse; l’autre est agréablement diversifiée par des coteaux, des vallons, des bois, des groupes de maisons. La terre du nord est généralement escarpée. Sur quelques points, néanmoins, les montagnes s’éloignent de la mer, et laissent à leur base un espace plus uni, sur lequel se sont formés des établissements de pêche; tels sont l’anse Saint-George, et la Grand’Grave, occupées par des familles venues de Jersey. L’industrie et l’esprit d’entreprise de ces Jersiais, comme on les nomme ici, leur procurent, bientôt après leur arrivée, une aisance qu’ils n’auraient jamais connue dans leur pays.
Au fond de la baie de Gaspé, est le meilleur port de toute la côte; il est séparé de la baie par deux pointes, qui laissent entre elles un canal navigable pour de gros navires. Avant d’arriver à l’entrée du port, on rencontre à la côte du sud, l’embouchure de la petite rivière Saint-Jean, près de laquelle, sur un coteau, est le village de Douglastown. Il fut fondé, il y a environ soixante ans, par un arpenteur écossais, nommé Douglas. Dans l’espérance d’y voir bientôt fleurir une ville considérable, il avait partagé un terrain étendu, en lots de quatre arpents, qu’il sépara les uns des autres par des rues larges et se coupant à angles droits. Le gouvernement impérial dépensa beaucoup d’argent, pour établir en ce lieu quelques américains restés fidèles à l’Angleterre, et pour rendre leur condition supportable. Malgré ces secours, ou plutôt en conséquence de ces secours, le fondateur se ruina dans la spéculation, et aujourd’hui à peine reste-t-il quarante familles descendant des premiers habitants. A ce petit groupe d’anglais se sont joints quelques canadiens et des français: aussi les langues anglaise et française paraissent familières à tous.[43]
A peine avons-nous mouillé, qu’un juif anglais, à la figure vraiment israélite, monte à bord de la Sara. Il fait le commerce sur cette côte, et a pris notre goélette pour un bâtiment qu’il attend de jour en jour. Après avoir fait gracieusement ses offres de service, il retourne à terre porter aux catholiques du lieu la nouvelle de l’arrivée de l’évêque.
Au sommet du coteau apparaît le clocher de la petite chapelle, dont le corps est caché par un bosquet de sapins. En débarquant nous dirigeons nos pas de ce côté, au milieu de monticules de morue et aux cris de joie des honnêtes citoyens de Douglastown.
Sous le rapport moral, cette mission est une des meilleures du district de Gaspé. La population est polie, intelligente et religieuse; elle présente une physionomie sociale qu’on ne rencontre point dans les postes environnants. Cette différence marquée doit être regardée comme un des effets de l’instruction, qui est généralement répandue parmi les habitants de Douglastown; depuis un grand nombre d’années, en effet, ils ont tenu à honneur d’avoir parmi eux un bon maître d’école. Les hommes, les femmes et les enfants s’occupent beaucoup de la pêche, et, afin de s’y livrer, négligent les autres genres d’industrie. Aussi c’est aux magasins qu’ils prennent habits, chaussures, outils, meubles et provisions, pour les besoins de la famille; ces articles coûtent fort cher sur les lieux, et il faut les payer en morue, qui n’est pas aussi abondante qu’ailleurs.
Depuis 1832, un poisson jusqu’alors inconnu a servi à augmenter les profits des pêcheurs; c’est, par la forme et les habitudes, un véritable maquereau, mais un maquereau géant, ayant une longueur de dix à onze pieds, qualités qui lui ont valu le nom de cheval-maquereau. Telle est la grosseur de ce poisson, qu’un seul individu de bonne taille suffit pour remplir trois barils; or c’est une assez belle aubaine pour le pêcheur, puisque le prix du baril est de six piastres.
Le cheval-maquereau est fort, actif, et se défend vigoureusement lorsqu’il est attaqué. La pêche de ce poisson ressemble en petit à celle de la baleine. Une berge légère s’avance sans bruit vers le maquereau monstre, qui se joue à la surface de l’eau; placé à l’avant de la berge, un homme lance contre lui un dard retenu par une longue corde, tandis qu’un second matelot veille à ce qu’en se déroulant, elle ne rencontre aucun obstacle qui l’arrête. Le poisson frappé plonge et s’enfuit d’abord rapidement: mais, bientôt épuisé par ses efforts et par la douleur que lui cause sa blessure, il revient sur l’eau, où il est attaqué de nouveau et traqué par ses persécuteurs, jusqu’à ce que la mort mette fin à ses souffrances.
L’agriculture est entièrement négligée, quoique les terres soient bonnes dans les environs, et qu’une dune, située à l’entrée de la rivière Saint-Jean, fournisse une vase propre à former un excellent engrais. Les céréales réussiraient, et la culture des pommes de terre serait profitable pour celui qui voudrait s’y livrer. Un irlandais, établi ici depuis deux ans seulement, en a vendu, le printemps dernier, pour la valeur de soixante-quinze louis.
Juin, 27.—Mgr. de Sidyme termine une des missions les plus consolantes pour lui, par un discours dans lequel il félicite les catholiques de Douglastown de leurs bonnes dispositions. A son départ du village, tous veulent avoir la satisfaction de l’escorter jusqu’à la goélette, afin de recevoir une dernière bénédiction de sa main, avant de se séparer pour retourner chez eux.
L’évêque avait témoigné le désir de visiter l’établissement où les trois baleiniers de Gaspé déposent leurs prises. Plusieurs embarcations ont été préparées pour nous y conduire, et nous profitons d’un vent léger, qui nous y pousse en peu de temps. Après avoir passé le banc extérieur, nous nous dirigeons vers une autre pointe sablonneuse, qui s’avance dans le port et sur laquelle s’élèvent quelques chétives baraques; là sont amoncelées des masses de lard de baleine, que l’on fait fondre dans d’immenses chaudières, afin d’en extraire les matières grasses et huileuses. Le résidu est employé comme combustible pour alimenter les feux.
Le dépècement se fait au large, ou dans un des havres voisins du lieu où la baleine a été tuée. Après l’avoir solidement amarrée sur un des flancs du bâtiment, les matelots, ayant des crampons fixés sous la semelle de leurs lourdes bottes, descendent sur la masse inerte et glissante. Munis de tranches, de couteaux et de crocs, ils découpent la viande par longues bandes, qui sont enlevées au moyen d’un cabestan et déposées dans la calle. Les barbes de la baleine sont arrachées soigneusement; et lorsqu’on s’est assuré de toutes les dépouilles, à un signal donné, les travailleurs remontent sur le bâtiment, les amarres qui retenaient la carcasse sont larguées, et elle descend lentement dans les profondeurs de la mer.
Les pêcheurs ne font aucune difficulté de manger le maigre de la baleine; mais les sauvages seuls ont le courage d’avaler le gras, dont le goût, suivant eux, ressemble à celui du lard. Il en découle une huile abondante, avant même qu’on l’ait soumise à l’action du feu. Cette première huile est bien supérieure à celle qu’on obtient par la chaleur des fourneaux; aussi se vend-elle plus cher que l’autre.
De la pointe au Penouïl[44], où nous sommes, l’on aperçoit tout le port, avec une grande partie du bassin, ainsi que le village où réside l’aristocratie de la Gaspésie. Dans le port de Gaspé se jettent la rivière du Nord-Ouest et celle du Sud-Ouest. L’entrée de la dernière forme le bassin, qui a moins d’un mille de longueur, et dont la profondeur varie de cinq à neuf brasses d’eau. Ce port intérieur peut recevoir une flotte considérable; il renferme dans ce moment plusieurs navires et une goélette du gouvernement, placée sous la direction du capitaine Bayfield et employée à faire le relèvement des côtes du district. Le grand port, connu autrefois des Français sous le nom de Baie du Penouïl, jouissait d’une certaine importance, il y a un peu plus d’un siècle. En 1745, M. de Beauharnois, gouverneur général du Canada, proposait au ministre de s’en occuper. “On pourrait absolument,” écrivait-il, “faire faire un établissement à Gaspé. Il y a, dans le fond de la baie de ce nom, un beau havre appelé la Baie du Penouïl; les plus gros vaisseaux y seraient en sûreté... On a vu à Gaspé et aux environs jusqu’à quarante et cinquante navires de pêche; elle commence ordinairement du quinze au vingt juin, et finit au quinze et vingt novembre et même plus tard. Le climat est à peu près semblable à celui de Québec. On assure que les terres qui sont dans le fond de la Baie du Penouïl sont passablement bonnes. Le nommé Harbour, canadien, y a une habitation, où il a cultivé du blé, qui est venu à maturité, ainsi que le blé sarrasin et les légumes de toute espèce.”
Plus de deux siècles avant la date de cette lettre, les Français avaient visité la Baie du Penouïl et en avaient pris possession. En 1534, Jacques Cartier fut forcé de s’y réfugier et se mit en rapport avec les naturels qui demeuraient dans le voisinage. Sa petite flotte était mouillée à l’entrée de la baie de Gaspé, lorsque le vent souffla avec tant de violence qu’un de ses navires perdit une ancre. “Pour ce,” dit-il, “nous fut besoin passer plus outre en ce fleuve, quelques sept ou huit lieues pour gagner un bon port, où il y eût bon fond lequel nous avions été découvrir avec nos barques; et, pour les mauvais temps, tempête et obscurité qu’il fit, demeurâmes en ce port jusqu’au vingt-cinquième, sans pouvoir sortir.”
“Cependant nous vîmes une grande multitude d’hommes sauvages qui pêchaient des tombes[45], desquels il y a grande quantité; ils étaient environ quarante barques, et, tant en hommes, femmes qu’enfants, plus de deux cents, lesquels, après qu’ils eurent conversé en terre avec nous, venaient privément au bord de nos navires avec leurs barques........... Ils n’ont autre demeure que dessous ces barques, lesquelles ils renversent et s’étendent sous icelles, sur la terre sans aucune couverture.”
Avant de quitter le port, Cartier voulut planter une croix, sur la pointe de sable qui en ferme l’entrée. “Le vingt-quatrième jour de juillet,” dit-il “nous fîmes faire une croix, haute de trente pieds, sur la pointe de l’entrée de ce port, au milieu de laquelle mîmes un écusson relevé avec trois fleurs de lis, et dessus était en grosses lettres entaillées en du bois: Vive le Roi de France. Et après, la plantâmes en leur présence sur la dite pointe. Et, l’ayant levée en haut, nous agenouillons tous, ayant les mains jointes.... de laquelle chose ils s’émerveillaient beaucoup.”
Cartier avait choisi un site admirable pour y arborer l’étendard sacré de la foi. Erigée pour la première fois dans la Nouvelle-France, la croix dominait d’un côté sur la magnifique baie de Gaspé, et, de l’autre, sur ce beau port, où, bien des fois depuis, les bâtiments français et anglais sont venus chercher un abri contre les fureurs de la tempête. Les Gaspésiens parurent cependant s’inquiéter de cette prise de possession, car, lorsque les marins français furent retournés à leurs navires, un capitaine sauvage, accompagné de ses trois fils et de son frère, vint protester contre l’occupation de son pays; c’est du moins ce que comprit Cartier. Vêtu d’une vieille peau d’ours, le chef se leva avec dignité dans son canot, et fit une longue harangue, durant laquelle, tantôt il montrait la croix, tantôt il étendait la main vers les terres voisines, comme pour déclarer qu’elles lui appartenaient. Quand il eut péroré à sa fantaisie on l’attira, ainsi que ses compagnons sur un des navires, où, après lui avoir remis quelques présents, Cartier lui expliqua qu’il désirait mener en France deux de ses fils. Pour les engager à faire ce voyage, on revêtit chacun d’eux d’une chemise, et d’un sayon de couleur; on leur mit sur la tête une toque rouge et on leur passa au cou une chaîne de laiton. Ainsi affublés, les jeunes gars ne pouvaient plus contenir leur joie; et, sous l’inspiration du moment, ils consentirent à suivre leurs magnifiques patrons. Taiguragny et Domagaya distribuèrent leurs vieux habits à leurs parents; le lendemain, ils faisaient leurs adieux et laissaient leur sauvage patrie, pour aller visiter le beau pays de France.
Lorsque, l’année suivante, le navire de Cartier débouquait du canal qui court entre l’île d’Anticosti et la côte du nord, pour entrer dans le grand fleuve, les deux jeunes gaspésiens, se balançant dans les haubans, saluaient la chaîne bleuâtre des montagnes du sud, aux cris joyeux de Honguedo! Honguedo! Malgré les splendeurs qu’ils avaient entrevues dans les villes européennes, ils portaient leurs regards avec bonheur vers la terre de leurs ancêtres. Et ils avaient le droit de la contempler avec un juste orgueil, car la France ne leur avait rien offert de plus majestueux que les monts Notre-Dame, de plus noble que la baie de Gaspé, de plus beau que le bassin sur les eaux duquel ils avaient souvent, dans leur enfance, poussé le léger canot de leur père, le vieux chef de Honguedo.
Comme il y a déjà trois cents ans que ces faits se passaient, et qu’ils ont perdu l’attrait de la nouveauté, il sera peut-être mieux de laisser le seizième siècle pour rentrer dans le dix-neuvième.
Pendant notre visite aux fourneaux, le vent a changé de direction, de sorte que nous pouvons en profiter pour retourner au mouillage de Douglastown. Cette partie du voyage est rendue peu agréable par quelques fortes ondées; cependant nous oublions presque ce contretemps, en prêtant l’oreille à la belle voix d’un de nos bateliers, qui répète avec goût quelques chants mélancoliques de la vieille Irlande. Né dans la Gaspésie ce jeune homme les a reçus de ses parents, et il les conserve comme de précieux souvenirs de la terre que ses pères ont habitée.
La pluie continue à battre le pont de la goélette, et nous nous félicitons de nous être mis à l’abri, lorsqu’un sauvage, grimpant par dessus le plat-bord, se présente au milieu de nous; il balbutie quelques mots, moitié français, moitié anglais, qui, mal articulés, ne peuvent guères nous expliquer l’objet de sa visite. M. F. est heureusement muni d’une assez bonne provision de micmac, et il s’en sert pour questionner notre homme. Après un long interrogatoire, on conclut qu’une femme sauvage est malade, tout près du lieu que nous venons de quitter dans le port de Gaspé; en vrais Micmacs, pour envoyer chercher un prêtre, ses amis ont attendu le jour et le moment où le vent favorable allait engager le capitaine V. à lever l’ancre.—“Où est la malade?”—“Oulla”, répond Alguimou, étendant le cou, comme une tortue qui veut reconnaître le terrain; “Oulla,” repète-t-il en recommençant sa pantomine.—“Ce doit être à une bonne distance,” remarque M. F.; “oulla signifie là bas; et, chez eux, là bas veut dire qu’il faut aller plus ou moins loin, selon que le cou est plus ou moins tendu. Or vous voyez qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour se l’arracher du milieu des épaules.” Mgr. de Sidyme se décide à aller administrer la confirmation à la malade; il est accompagné de messieurs F. et Montminy, dont les services sont requis en même temps. Ils ne reviennent de leur excursion que tard dans la soirée.
Juin 28.—De grand matin, la Sara s’ébranle pour quitter la baie de Gaspé. Dans sa course autour de la pointe Saint-Pierre, elle est serrée de près par un cul-de-poule américain; les deux goélettes se penchent, étendent leurs longues voiles, et glissent sur les flots comme des oiseaux de mer. On les dirait douées d’intelligence, tant elles semblent faire d’efforts pour se dévancer l’une l’autre, tant elles paraissent se passionner dans la lutte; chacune met dehors toute sa puissance de vitesse, pour ne point céder à sa rivale. La course se termine près du village de la Malbaie, où les deux concurrentes viennent s’arrêter bord à bord, sans que l’une puisse réclamer l’avantage sur l’autre.
La chapelle de la Malbaie est bâtie sur un coteau qui domine le village, et d’où la vue s’étend au loin sur la mer. Vers l’ouest une terre basse, coupée par un barachois et offrant quelques habitations éparses, forme le fond de la baie, qui a une lieue de longueur sur trois lieues de largeur. A l’autre bord de cette belle nappe d’eau, se dressent des montagnes brisées, au-dessus desquelles s’élève le mont Sainte-Anne, et dont les derniers contreforts forment l’île de Percé et celle de Bonaventure.
Cette baie a porté dans l’origine le nom de baie des Molues ou Morues, parce que ce poisson s’y prenait en abondance par les pêcheurs basques, normands et bretons. Les anglais ont changé les mots, Baie des Molues, en Molue bay, puis en Malbay; ce dernier nom a été accepté par les pêcheurs français du pays, et aujourd’hui il est le seul qui soit généralement connu.
Nous sommes reçus chez Guillaume Girard, premier marguillier du lieu, quoique encore protestant. Girard est un des plus riches pêcheurs de la Malbaie. Arrivé pauvre de l’île de Jersey, à force d’activité et d’industrie, il est parvenu à réaliser une petite fortune. Outre ses propriétés foncières, il possède dix-sept berges, qui depuis le printemps ont déposé sur ses vignots mille quintaux de morue. La morue est fort abondante dans les eaux voisines; souvent elle s’y jette en si grande quantité, qu’elle est poussée au rivage. Dernièrement on en a trouvé des masses considérables, qui, en poursuivant le capelan, s’étaient aventurées dans la rivière de la Malbaie, et étaient restées à sec sur le sable.
Comme cette mission est peu étendue, nous en repartons le même jour pour Percé.
[41] En 1858, l’anse au Gris-Fond renfermait quarante-une familles. Aujourd’hui la langue française y a presque supplanté l’anglais.
[42] Le rocher de la Vieille, miné par les flots, a été renversé, vers 1851 ou 1852; il pouvait avoir de trente à trente-cing pieds de hauteur.
[43] Depuis 1836 un grand changement s’est opéré à cet égard. Quelques familles irlandaises, s’étant jointes à l’ancienne population de Douglastown, l’anglais a pris le dessus, et la langue française a été complètement oubliée, même dans les familles canadiennes. Il ne reste plus guères que cinq ou six vieillards qui parlent le français.
[44] Ce nom, donné autrefois par les pêcheurs basques, signifie péninsule.
[45] Selon Hakluyt, ce sont des maquereaux.
———
Percé et ses souvenirs historiques—La fête de Saint-Pierre—L’hiver et le printemps à Percé—La morue marchande et la morue de réfection—La maison Robin—La Table de Rolland—L’île de Percé, et sa république—Les chercheurs d’œufs—Départ—Ile de Bonaventure.
Bâti sur deux anses, que sépare le Mont-Joli, le village de Percé se présente fort bien, et de fait le district de Gaspé n’offre rien de plus pittoresque. En dédoublant le cap Bérée, nous apercevons l’anse du nord-ouest, qui se déploie devant nous. Au rivage, sont les nombreuses embarcations employées pour la pêche; sur la terre, le premier plan est occupé par les chafauds et de longs vignots; au-delà sont les habitations, dont chacune est environnée d’un petit champ; en arrière, sur une colline, sont placés l’église et le presbytère. Le terrain s’élève graduellement, à mesure qu’il s’éloigne de la mer, et déroule à la fois toutes les parties de ce tableau, encadré par un demi-cercle de montagnes, au-dessus desquelles se dresse la Table de Rolland ou le mont Sainte-Anne. Plus près de nous, est l’île de Percé dont les deux arches se dessinent sur l’azur de la mer; on dirait les restes d’un pont bâti par une race de géants, pour unir l’île de Bonaventure au Mont-Joli, dont le beau plateau vert s’incline légèrement vers l’anse.
Sur la crête du Mont-Joli, un groupe nombreux d’hommes et de femmes paraît occupé à nous souhaiter la bienvenue; quelques hourrahs parviennent faiblement jusqu’à nous; une fumée blanchâtre jaillit en tourbillonnant, et le grondement du canon, répété puissamment par les échos, porte l’épouvante au milieu des habitants ailés du cap Percé, qui s’élèvent par nuages et remplissent l’air de leurs cris aigus.
A peine avons-nous jeté l’ancre, qu’une chaloupe de la douane arrive près de la goélette, pour conduire à terre l’évêque et sa suite. Le prélat est reçu au rivage par la population entière, qui se presse autour de lui pour demander sa bénédiction.
A l’exception de Mgr. Turgeon, aucun de nous n’a encore passé une nuit à terre, depuis notre départ de Québec. Nous allons enfin être hébergés, et la nuit et le jour, dans le presbytère de Percé. Quand on n’en a pas fait l’expérience, l’on ne saurait se figurer combien il est doux, après avoir été bercé par les vagues pendant deux semaines, de tomber dans un lit où l’on peut sommeiller en paix, sans craindre d’être jeté sur le plancher par un caprice du vent ou de la mer.
La maison du missionnaire est suffisamment spacieuse pour un homme qui n’est pas exposé à recevoir de visites. L’église, édifice de bois, est assez commode à l’intérieur, mais défigurée à l’extérieur par un maussade clocher, que couronne une boîte faite sur le plan d’un bonnet quarré. Près du flanc de l’église, un mamelon de forme régulière s’élève à une trentaine de pieds de hauteur; il sert de piédestal à une grande croix, sous l’ombre de laquelle viennent reposer après la mort les catholiques de Percé. Comme en creusant au pied du mamelon, l’on a trouvé des objets qui n’ont dû servir qu’à des sauvages, l’on a cru qu’il avait été élevé pour rappeler la mémoire de quelque capitaine renommé des temps anciens.
Percé fut visité en 1534 par Jacques Cartier, qui donna le nom de Cap des Prés, soit au cap Percé, soit au Mont-Joli. Depuis la fin du seizième siècle, ce lieu n’a cessé d’être fréquenté par les pêcheurs français, qui y prenaient le poisson en abondance et y trouvaient de grandes commodités pour le faire sécher. Il est même très-probable qu’ils y allèrent à la suite du voyage de Cartier. Après la fondation de Québec, Champlain, à plusieurs reprises, envoya des chaloupes à Percé, soit pour obtenir des provisions, soit pour faire passer en France des lettres ou des messagers par les derniers navires de pêche.
Le sieur Nicolas Denys, ayant obtenu de la compagnie de la Nouvelle-France toutes les côtes qui bordent le golfe Saint-Laurent, depuis Canseau dans l’Acadie jusqu’au Cap des Rosiers, visita cette portion de ses domaines et essaya de la faire valoir; il envoya quelques navires à Percé, mais sans retirer beaucoup de profit de ces voyages, parce qu’il ne pouvait surveiller ses employés. Ses affaires allèrent si mal, qu’il fut ruiné. Alors le gouvernement français, pour le tirer d’embarras et pour satisfaire aux justes demandes de plusieurs armateurs, fit rentrer dans le domaine royal cette immense étendue de pays, et en compensation accorda à son fils, Richard Denys de Fronsac, des terres dans la baie et sur la rivière de Miramichi. Plus tard le sieur de Fronsac obtint la concession de Percé et du territoire avoisinant, où il attira sept à huit familles qui s’y arrêtèrent; mais cette petite population était à peine perceptible pendant l’été, au milieu des cinq ou six cents hommes qui se rendaient à Percé pour y faire la pêche.
Mgr. de Laval crut devoir s’occuper des besoins spirituels de cette portion éloignée de son troupeau; en 1673, il chargea de cette mission les Pères Récollets, qui bâtirent une chapelle à Percé même, et une autre à l’île de Bonaventure sous le vocable de Sainte-Claire. Aux deux premiers missionnaires, succéda, en 1675, le P. Chrétien LeClercq, qui a écrit sur le Canada, deux ouvrages, aujourd’hui fort rares, La Gaspésie et Le Premier Etablissement de la Foi dans la Nouvelle-France.
Après que Guillaume d’Orange se fut emparé de la couronne de son beau-père Jacques II, des armateurs anglais profitèrent des troubles soulevés à cette occasion, entre la France et l’Angleterre, pour détruire les établissements français en Amérique et essayer de s’emparer du Canada. Percé fut attaqué à l’improviste. Le P. Jumeau, récollet, raconte cet épisode de l’histoire de la Gaspésie, qui se passait au mois d’août 1690.
“Deux frégates anglaises,” écrivait-il, “parurent sous le pavillon de France, à la rade de l’île Bonaventure, et par ce stratagème se saisirent aisément de cinq navires pêcheurs, dont les capitaines et les équipages, alors entièrement occupés à la pêche, furent obligés de se sauver à Québec, parce qu’ils n’étaient pas en état de se défendre. Les ennemis de l’état ayant tenté une descente à terre.... pillèrent, ravagèrent et brûlèrent les maisons des habitants, qui sont bien au nombre de huit ou dix familles, et qui pour la plupart s’étaient déjà réfugiés dans les bois.... Je frémis d’horreur au simple souvenir des impiétés.... que ces scélérats commirent dans notre église, qui leur servait de corps-de-garde. Ils brisèrent et foulèrent aux pieds nos images; les tableaux de la sainte Vierge et de saint Pierre.... furent tous deux criblés de plus de cent cinquante coups de fusil.... Pas une croix n’échappa à leur fureur, à la réserve de celle que j’avais autrefois plantée sur la table à Rolland, qui, pour être sur une montagne de trop difficile accès, subsiste encore à présent toute seule, comme le monument sacré de notre christianisme.... Ils mirent le feu aux quatre coins de notre église, qui fut bientôt réduite en cendres, de même que celle de notre mission en l’île de Bonaventure.”
Juin, 29.—Ainsi il y a déjà bien longtemps que la première chapelle de Percé, placée sous la protection de saint Pierre, était détruite par des anglais; deux ou trois autres chapelles l’ont, tour à tour, remplacée, et chaque année, malgré tous les changements, la fête du grand apôtre s’est célébrée ici avec une joie ordinairement vive, et souvent bruyante. Aujourd’hui que la solennité est rehaussée par la présence d’un évêque et de plusieurs prêtres, l’église est envahie par une foule compacte de fidèles, désireux de fêter leur patron et d’assister aux exercices de la visite épiscopale.
Pendant l’hiver, Percé est un village isolé, renfermant environ cinq cents âmes; la population est composée de Canadiens, de Jersiais et d’Irlandais. Comme ce poste est à cent cinquante lieues de Québec, pendant la saison des frimas et des glaces on n’y reçoit qu’une seule fois des nouvelles de l’étranger; elles sont apportées par un courrier, chargé de communiquer les révolutions du monde civilisé aux habitants de cette plage endormie. Toute la nature y paraît alors accablée par le sommeil de la mort; le commerce est enseveli sous des amas de neige, qui ne disparaissent qu’au mois de mai; des bancs de glace s’accumulent près du rivage et s’étendent au loin sur la mer; des vents lourds et froids soufflent constamment. Mais, dès les premiers jours de juin, l’aspect a complètement changé; des goélettes et des navires arrivent chargés de marchandises; ils versent sur le rivage une population nouvelle, qui apporte la vie et le mouvement. Les achats se font, les marchés se concluent, les embarcations sont gréées pour la croisière, les rêts et les seines se déroulent sur le rivage; au milieu des hommes occupés de leurs préparatifs, tourbillonne la cohue des enfants, des chiens et des flâneuses. Au-dessus du bruit discordant des voix humaines et canines, domine la voix solennelle de la mer, battant en mesure contre les falaises du cap Percé et du Mont-Joli. Bientôt de nombreuses berges sont poussées au large, pour recueillir les richesses de la mer. Pendant toute la journée, le pêcheur est occupé sans relâche à tendre ses lignes, à les retirer, à arracher les hameçons du gau de la gloutonne morue. Il n’a pas le temps de songer à prendre le repas du midi; il se permet seulement, lorsque la faim se fait sentir, de rompre un morceau de pain, qu’il avale tout en continuant son travail.
Au coucher du soleil, les berges se dirigent vers la terre. Si le temps est calme, des chants joyeux accompagnent le bruit cadencé des rames. Le vent souffle-t-il? Sur tous les points de l’horizon, vous apercevez des taches blanches se croisant, s’éloignant se rapprochant; tantôt elles se cachent, tantôt elles reparaissent brillantes sur le dos de la vague. Elles grossissent; des cris de joie annoncent la rentrée au port; les berges vont se ranger auprès des chafauds, pour y décharger le produit de la pêche, et le pêcheur descend à terre, ravi d’avoir ses coudées franches, après être resté pendant toute une journée, resserré dans l’étroit espace de sa nacelle.
Alors commence le travail des gens de terre; hommes, femmes et enfants s’occupent à piquer la morue, à la décoller, à la trancher, à la saler; il leur faudra, dans les semaines suivantes, l’étendre, la piler, et lui faire subir de nombreuses manipulations, avant qu’elle puisse mériter le titre de morue sèche.
La morue sèche est ou marchande ou de réfection, suivant qu’elle a été traitée avec plus ou moins de soin. On dit que la morue est marchande, lorsque, après la préparation, la chair ne présente ni taches, ni coupure, ni meurtrissure; elle se vend plus cher que l’autre, et est destinée aux marchés du Brésil, de l’Espagne et de l’Italie. La morue de réfection est gardée pour le Canada et les Indes Occidentales. Elle forme la principale nourriture du pêcheur gaspésien; il laissera de côté, la morue marchande, comme trop insipide, et choisira pour son dîner celle dont la chair tachetée dénote que les mouches y ont déposé leurs œufs. Ces matières étrangères produisent de la fermentation dans les parties voisines et leur donnent un goût plus piquant.
La morue verte ne s’apprête qu’en automne, quand les pluies deviennent trop fréquentes, pour qu’on puisse la faire sécher; on se contente de l’ouvrir, de la décoller, de la nettoyer et de la saler; elle est alors prête à être empaquetée.
Malgré l’abondance de la morue, il arrive souvent que des familles du pays n’ont pas de poisson pour le carême. Comme des navires demeurent à la côte aussi longtemps que le permet la saison, les pêcheurs leur fournissent de la morue jusqu’au dernier moment, dans l’espérance qu’il restera toujours assez de temps pour faire les provisions de la maison. Mais les approches de l’hiver, qui forcent les bâtiments de commerce à s’éloigner, obligent les pêcheurs à mettre leurs berges en lieu de sûreté; et de là naît la disette de poisson, parmi ceux qui en fournissent abondamment aux pays étrangers.
Trois compagnies occupent une large part du commerce de poisson, dans le district de Gaspé; ce sont les maisons Robin, Janvrin, Buteau et LeBouthillier. MM. LeBouthillier et Buteau se sont associés depuis peu d’années. Le chef-lieu de leurs opérations est à Percé, d’où ils exportent surtout la morue de réfection. M. LeBouthillier dirigeait auparavant dans ce pays les affaires de la maison Robin.
Il y a soixante ans, un jeune homme de Jersey, nommé Charles Robin, vint s’établir à Percé, où il n’y avait encore que quelques habitations. A l’intelligence et à l’activité de ses compatriotes, il joignait une instruction supérieure. Il s’engagea avec succès dans le commerce du poisson, et ses affaires s’étendirent graduellement. Autour de son établissement, se réunirent plusieurs jersiais, ainsi que quelques familles irlandaises, canadiennes et acadiennes.
Percé prenait un accroissement rapide. Vers 1808 et 1809, lorsqu’en Europe la population des campagnes, arrachée aux travaux de l’agriculture, se portait en masse dans les camps, le prix des vivres devint très-élevé; la morue se vendit alors jusqu’à six louis le quintal. Aussi les profits du commerce furent si considérables pour M. Charles Robin, qu’il ne savait plus où placer ses capitaux. Il s’associa ses neveux, qui avaient les goûts et les talents de leur oncle et qui continuèrent les affaires. Quoiqu’il soit mort depuis dix-neuf ans, les opérations de la compagnie sont encore conduites dans le même esprit qui a présidé à sa formation.
Cette maison possède trois grands établissements, un à Percé, un à la Grande-Rivière et le principal à Paspébiac. Aucun des propriétaires ne réside sur les lieux. M. Philippe Robin voyage en France et en Italie; de là, par lettres, il communique ses plans et ses ordres, que M. Jacques Robin, résidant à Jersey, est chargé de faire exécuter. Dans le district de Gaspé, les affaires sont dirigées par six commis, placés deux par deux. Ces employés doivent être célibataires, ou bien, s’ils sont mariés, ils ne doivent point avoir leurs femmes auprès d’eux. On leur a imposé un règlement très-sévère, entrant dans les plus minutieux détails de la conduite à tenir, et spécifiant même les plats qui, chaque jour, doivent être servis à la table. Si ce règlement était fidèlement observé, leur cuisine ne serait pas dispendieuse. Quoique les émoluments des commis soient faibles, jamais, cependant, maître n’a été mieux servi que ne le sont MM. Robin. Choisis vers l’âge de quatorze ans, et formés pendant quelque temps auprès des chefs, ces employés sont envoyés dans les établissements de Gaspé, où les intérêts de la compagnie semblent s’identifier avec les leurs. Tous les deux ans, un des commis de chaque magasin va passer l’hiver à Jersey, afin de rendre compte de l’état des affaires.
Un des grands principes de MM. Robin est de ne permettre aucune innovation. L’on rapporte bien des traits de leur attachement à l’ordre établi; je n’en citerai qu’un. Leurs navires de cabotage doivent se terminer en cul-de-poule; il y a peu d’années, leur principal charpentier, faisant un brick pour le service de la côte, crut devoir lui donner une poupe quarrée, parce que le bois qu’il employait favorisait cette forme. Quelques mois après, il reçut l’ordre de le défaire, et de le rebâtir à poupe allongée; les chefs joignaient une injonction sérieuse de conserver rigoureusement les anciens usages.
Après les offices de la fête de saint Pierre, nous allons visiter la Table de Rolland; une gorge profonde nous conduit jusqu’au plateau qui la couronne. Le sommet de cette montagne est à douze cent trente pieds d’élévation au-dessus du niveau de la mer. On peut le distinguer à une distance de quarante milles, lorsque le temps est clair; aussi de ce point élevé la vue est magnifique. Le regard plonge sur Percé avec ses vignots, ses maisons, ses deux anses bordées de berges, sur le Mont-Joli, le cap Percé et l’île de Bonaventure, humblement couchés au pied du géant. Vers la droite une ligne bleuâtre se confond avec la mer, et marque la direction que suit la côte, depuis la Grande-Rivière jusqu’à la Pointe au Maquereau; sur la gauche, la vue embrasse la Malbaie, ainsi que la baie de Gaspé, et va se reposer sur les hauteurs du Fourillon. Le sommet de la Table de Rolland forme un plateau dont une partie est unie, dépouillée d’arbres et couverte d’une herbe épaisse. Ce tapis vert est diapré de modestes fleurs, parmi lesquelles s’est glissée la blanche primevère trouvée par le botaniste Michaux, sur les bords du lac Mistassini.
Nous revenons de notre excursion aérienne assez tôt pour rencontrer, à la table de M. Montminy, le représentant du comté de Gaspé, M. LeB., homme distingué par son urbanité, son activité et ses connaissances. Suivant lui, le comté possède environ six cents berges de pêche; les profits sont tels à certaines époques, que, vers la fin de juin, dans le seul port de Percé, la valeur du poisson qui se prend chaque jour est d’environ cinq cents louis.
Des fenêtres du presbytère, l’on aperçoit clairement le plateau verdoyant de l’île de Percé. Il est semé de points brillants, tantôt stationnaires, tantôt mobiles; ce sont les habitants ailés de ce lieu, les uns couvant leurs œufs dans la sécurité la plus profonde, les autres veillant sur la famille nouvellement éclose. Cette ville aérienne se divise en deux quartiers bien distincts, celui des cormorans et celui des goélans. Si un individu d’une des tribus ose franchir la limite assignée à ceux de sa plume, cet empiètement n’est jamais toléré en silence. Un cri formidable, formé de milliers de cris, retentit dans les airs, et se fait entendre quelquefois à la distance de plusieurs milles; une nuée, semblable à un brouillard épais de neige, s’élève au-dessus du camp souillé par la présence de l’étranger. Les envahisseurs sont-ils nombreux; une colonne se détache de la masse des habitants du territoire menacé, et, décrivant un demi-cercle, va attaquer les ennemis sur les derrières. Comme les défenseurs de la patrie sont toujours forts sur le sol natal, les étrangers doivent céder et déguerpir devant les coups de bec et les malédictions de leurs adversaires. Cette petite guerre entraîne de fréquents combats, car à peine se passe-t-il un quart-d’heure, sans que des cris aigus nous avertissent que la discorde a lancé ses brandons parmi la gent volatile.
Les deux républiques, dont le territoire réuni couvre environ deux arpents en superficie, étaient autrefois protégées par l’escarpement de leur rocher, et vivaient à l’abri des incursions de l’homme. Le nid paternel se léguait de génération en génération; le goélan et le cormoran élevaient leurs enfants, au lieu où ils avaient eux-mêmes becqueté la coquille pour se glisser dans le monde. Ce monde cependant changeait autour d’eux; c’était bien toujours le même ciel; c’était bien la même mer se brisant, furieuse, contre les solides fondements de leur citadelle, et roulant des montagnes d’eau sur les rivages des deux anses. Mais, là-bas, à quelques centaines de toises, le monde n’était plus le même. La forêt était tombée; des fumées s’élevaient au-dessus de quelques cabanes habitées par l’homme blanc; la grève avait cessé d’être solitaire; les vagues soulevaient des embarcations, à la coque noire, aux ailes blanches et aux longs mats. La république était menacée; ses lieux de pêche étaient envahis par des barbares, qui plus d’une fois firent couler le sang des anciens possesseurs de l’île.
Du moins, s’il fallait aller chercher le poisson à une plus grande distance, cormorans et goélans le pouvaient encore manger en paix, au sommet inaccessible de leur rocher. Trompeuse sécurité! pour les goélans, comme pour les hommes, il n’est rien d’immuable sur la terre. Vers l’an 1805, quelques milliers d’années après l’établissement en ce lieu d’un descendant du premier goélan, deux hardis pêcheurs se déterminèrent à escalader cette forteresse, jusqu’alors réputée inexpugnable.
L’île de Percé paraît avoir autrefois été liée avec le Mont-Joli; elle n’en est séparée que par un étroit canal, qui assèche à basse mer. La longueur du plateau est d’environ huit arpents, et sa largeur n’est guère que de soixante à quatre-vingts pieds. Dans tout son pourtour, le rocher n’est qu’une falaise continue, dont la hauteur moyenne est de deux cent quatre vingt-dix pieds. L’œil perçant des deux pêcheurs avait souvent mesuré toutes les difficultés qu’ils rencontreraient à escalader cette muraille, pour arriver jusqu’au sommet. Un seul point leur présentait une chance de succès. Près d’une des arches, à quarante pieds de la base, le rocher fait une saillie, au-dessus de laquelle la falaise rentre un peu, et offre quelque facilité à celui qui la voudrait gravir. Mais cette route était trop douce pour les alertes pêcheurs; ils en choisirent une autre, propre à décourager un chamois. Des rames, fortement liées ensemble, sont appliquées contre la face du rocher. Au moyen de cette échelle improvisée, ils franchissent la partie la plus ardue de la montée: puis, s’attachant aux anfractuosités de la pierre et se soulevant à l’aide des arbrisseaux qui prennent racine dans les fissures, ils parviennent jusqu’au plateau.
Pour Duguay et Moriarty, ce fut un beau jour que celui où ils purent se glorifier d’être arrivés les premiers au sommet de l’île de Percé. Il existait bien une vague tradition qu’à certaines époques, un jeune homme aux formes herculéennes, à l’allure surhumaine, avait paru sur le cap; mais ces rêveries superstitieuses ne servaient qu’à donner un nouveau relief à la hardiesse des simples mortels, qui avaient osé braver le Génie du cap Percé, jusques dans son aire inaccessible.
Ce que l’amour de la gloire avait fait entreprendre à ces deux hommes, l’esprit d’intérêt et d’imitation le fit ensuite tenter à beaucoup d’autres; une fois la marche tracée, la moitié des difficultés s’évanouissait. Les nouveaux venus toutefois crurent devoir prendre la route, regardée comme trop facile par leurs devanciers. Tous les ans, quelques jeunes gens allaient enlever les œufs, et ramasser la plume des habitants du rocher.
D’abord la présence de l’homme effrayait si peu les oiseaux, que, pour arriver aux œufs, il fallait pousser la mère hors de sou nid. Plus tard, la fréquence des visites avait fini par effaroucher les goélans et les cormorans, et menaçait de les éloigner de leur antique empire; heureusement, un règlement fait par les magistrats du district de Gaspé a, depuis quelques semaines, rétabli les habitants du cap Percé dans la jouissance paisible de leur domaine.
La pitié pour les opprimés n’était cependant pas le motif qui portait à les protéger; il s’agissait plutôt de l’intérêt des oppresseurs. En effet, lorsqu’une brume épaisse se répand sur la mer voisine, comme cela arrive fréquemment, les cris des oiseaux du cap servent à guider les pêcheurs surpris au large par l’obscurité, et à leur indiquer le gisement des terres. Les services rendus dans ces occasions, étant nombreux et importants, devaient engager à mettre un terme à la destruction de serviteurs si utiles à la communauté.
D’ailleurs ces ascensions hasardeuses exposaient inutilement la vie d’un grand nombre de jeunes gens, qui les entreprenaient avec plus de courage que de prudence. L’année dernière, un de ces braves fut précipité d’une hauteur de près de cent pieds, par la chute d’une pierre, sur laquelle il venait de sauter. Accourus à son secours, ses compagnons ne relevèrent qu’un cadavre tout broyé.
Cette année, un jersiais a perdu la vie, en se risquant à enlever des œufs, sur une pointe de rocher, à l’île de Bonaventure. Une corde passée sous les bras, il s’était fait descendre jusque vis-à-vis des nids qu’il voulait spolier. Tandis qu’il se hâtait d’emplir son panier, la corde, rongée par le frottement sur une saillie du roc, se rompit, et laissa tomber l’imprudent dénicheur, qui se brisa la tête contre les pierres du rivage.
La témérité n’est pas toujours punie avec la même sévérité. Tranquille Duguay, dont le nom vient d’être mentionné, désirait enlever les œufs d’une famille de margots, qui avaient posé leur nid dans une cavité, sur la face d’un cap. Pour y arriver, il grimpa à une hauteur de cinquante à soixante pieds, au moyen de quelques arbres rabougris et des aspérités de la pierre. Comme la mère essayait de se défendre, il la saisit d’une main, tandis que de l’autre il mettait les œufs dans un sac. L’oiseau, dans ses efforts désespérés pour se dégager, réussit à crever un œil au maraudeur, dont la situation devenait fort périlleuse, puisque, par un seul mouvement mal assuré, il pouvait être lancé dans l’abîme béant sous ses pieds. En dépit de la douleur qu’il ressentait, celui-ci conserva son sang-froid, maintint sa position, et enleva tous les œufs. Puis, tenant toujours son ennemi par le cou, il descendit tranquillement au rivage, par la voie difficile qu’il avait suivie pour monter.
Du côté du Mont-Joli, le cap Percé est coupé à pic. Dans cette direction, le plateau se rétrécissant, s’avance de plusieurs pieds au-dessus de la mer, et se termine en pointe. “Vous voyez cette pointe-là;” nous disait un vieux pêcheur; “eh bien! il y a ici un ivrogne, qui monta un jour sur le cap avec quelques bons lurons de son espèce, pour avoir le plaisir de s’enivrer là haut. Quand il fut gris, il gagea avec ses amis qu’il irait boire un coup sur la pointe du rocher. Il s’y rendit, but un coup, chanta le coq, fit trois sauts et s’en retourna, sans accident. Le dieu des ivrognes le soutenait.”
C’était au pied de la falaise, à cinquante toises au-dessous de la saillie du rocher, qu’on nous rapportait l’escapade du pauvre ivrogne; placés ainsi vis-à-vis de cette muraille lisse, droite, surplombant même un peu, nous ne pouvions qu’applaudir à la sage décision, prise par les magistrats, pour empêcher le retour de semblables folies. Mes compagnons de voyage et moi, nous nous étions rendus pour visiter les arches de l’île de Percé, sous lesquelles quelques coups de rame eurent bientôt conduit notre berge.
Les montagnes voisines, ainsi que les îles de Percé et de Bonaventure, sont formées d’une pierre très-friable et se décomposant aisément à l’air; de sorte que l’action continuelle des vents et des flots leur donne avec le temps des formes nouvelles et souvent fantastiques. Poussées avec force entre l’île de Bonaventure et la terre ferme, par les vents qui arrivent de la pleine mer dans toute leur puissance, les vagues minent les rochers lentement, mais sûrement; elles ont déjà creusé ces deux arches, remarquables par leur régularité. Qui sait, si, dans les siècles passés, des arches semblables n’ont pas relié l’île de Percé avec le Mont-Joli? Tout semble l’indiquer; et Denys, qui visitait ces lieux, il y a deux cents ans, en était persuadé. Lorsqu’il y vint une première fois, il n’y avait qu’une arche; dans un second voyage fait, bien des années après, il reconnut que deux autres avaient été creusées par la mer. Il raconte qu’une de ces dernières disparut, fermée par l’éboulement d’une partie du rocher.
Les passages ouverts dans le roc ont à peu près vingt-cinq pieds de largeur, vingt pieds de hauteur et trente de longueur. Sous l’arche principale, des chaloupes peuvent passer en tout temps, soit à la voile, soit à la rame; sous l’autre, elles ne flottent que lorsque les eaux sont hautes. Les débris de rochers, semés alentour, attestent que la mer continue ses empiètements. Un jour, peut-être, les voûtes se seront écroulées graduellement, et l’île de Percé formera trois immenses colonnes, dont la masse rivalisera avec celle des pyramides d’Egypte[46].
Juillet, 1.—Le port de Percé n’est pas sûr, car il est ouvert aux vents du large. Comme il est divisé en deux anses, lorsque les bâtiments sont battus par les vagues dans l’une d’elles, ils se réfugient dans l’autre pour y chercher un abri sous la protection de l’île. C’est le parti qu’a pris le capitaine V., pendant notre absence. Nous avions laissé la goélette dans l’anse du nord-ouest, et nous la trouvons mouillée dans celle du sud-est, où elle a été forcée de se retirer pour se soustraire à la violence des vents du nord. La mer se jette avec fureur sur la grève, et rend l’embarquement une opération assez embarrassante; mais les pêcheurs de Percé, accoutumés à sortir du port dans tous les temps, savent surmonter ces difficultés. Nous montons dans une berge qui a été tirée à sec; une vingtaine d’hommes sont rangés à l’entour, prêts à la pousser à l’eau. Les regards fixés sur la mer, ils l’étudient et épient le moment favorable. “Voilà la bonne lame qui vient,” s’écrient à la fois plusieurs d’entre eux. En effet une vague énorme se dresse au-dessus de celles qui la précèdent; au moment où elle va toucher au rivage, le cri “en avant” met les pêcheurs en mouvement; la berge glisse rapidement sur le gravier; la vague la saisit, la soulève sur son dos écumant, et en se retirant, l’emporte loin de la terre.
Six vigoureux rameurs sont à bord; cependant, malgré leurs efforts, nous avons peine à tenir tête au vent et aux courants. Nous atteignons enfin la Sara, qui danse sur les flots, avec toute la légèreté d’une bayadère. Par un gros temps, c’est une affaire difficile et périlleuse que d’aborder un navire avec une chaloupe ou une berge. La petite embarcation doit se couler soigneusement sous le vent; un des rameurs saisit le cable qui lui est lancé d’en haut; l’équipage veille avec attention, pour empêcher qu’une rame, maladroitement posée en travers, n’envoie matelots et passagers naviguer avec les poissons. Avez-vous réussi à aborder sans accident? alors commence une danse désagréable, qui se compose d’une série de plongeons. Pendant un instant, élevé sur la crête d’une vague, vous pouvez promener vos regards sur tout le pont voisin; un moment après, vous descendez dans un gouffre profond, tandis qu’une masse noire se balance au-dessus de votre tête et menace de vous écraser sous ses flancs goudronnés. C’est là-haut cependant, qu’il faut vous hisser. Une échelle de corde vous est jetée; en vous redressant pour la saisir, prenez garde qu’un soubresaut de la berge ne vous lance sur un banc de rameur, contre lequel vous vous briseriez les côtes. Lorsque la vague vous rapproche du navire, saisissez ce cordage qui flotte au vent, et montez bien vite, si la vie vous est chère. Qu’une seconde lame survienne, pendant que vous avez les mains attachées à l’échelle et les jambes retenues dans la chaloupe, c’en est fait de vous: vous serez écartelé ou vous tomberez à la mer. Vos pieds se sont-ils dégagés à propos? vous voilà suspendu sur les flots, forcé, pour échapper au péril, de vous cramponner à une muraille glissante; encore prendrez-vous un bain froid, en attendant qu’une main charitable se hasarde à vous tirer par-dessus le bordage. Une fois monté, il vous est libre de rire de ceux qui, à votre exemple, escaladent les flancs du navire.
Nous voici enfin à bord, sains et saufs. Pendant le reste de la journée, la Sara croise péniblement, contre le vent et la marée dans le chenal, d’une demi-lieue de largeur, qui sépare la terre ferme de l’île de Bonaventure. Tantôt la goélette porte le cap vers les rivages verdoyants de l’île; tantôt, au rauque commandement du capitaine V., “paré à virer, mes garçons,” elle est ramenée vers les récifs de Percé, au-dessus desquels la vague s’élance, brisée et divisée en mille flocons d’écume.
A la chute du jour, les maisons blanches du village sont encore devant nous, quoique déjà plus de trente fois nous ayons viré de bord pour nous en éloigner.
Durant le cours de ces évolutions, nous avons tout le temps d’examiner l’île de Bonaventure, dont les côtes s’élèvent perpendiculairement à une hauteur de deux cents à deux cent cinquante pieds. Ses rochers servent de retraites à des familles de goélans, de margots, de cormorans, aussi nombreuses que celles de l’île de Percé. Bonaventure n’a que trois quarts de lieue en longueur et renferme quinze familles. On n’y trouve plus de traces, dit-on, de l’ancienne chapelle, dédiée à sainte Claire.
Denys remarque que, de son temps, l’île de Bonaventure était remplie de lièvres, et qu’en tendant trente collets le soir, on était sûr d’y trouver le lendemain matin au moins vingt prisonniers. Aujourd’hui encore, ils continuent d’être fort abondants dans les bois conservés sur l’île.
[46] Une des deux arches s’est écroulée depuis quelques années.
———
La Grande-Rivière—Un sourd—Instruction religieuse—Avantages matériels—Un catéchiste—Le naufrage anglais—Au pied de la grande échelle—Pointe-au-Genièvre—Richesses de la mer.
Juillet, 2.—Au point du jour, nous sommes encore près de l’île de Bonaventure; heureusement un fort vent du nord-est, s’élève tout à coup, et nous porte dans l’anse de la Grande-Rivière, où nous jetons l’ancre, vers 5½ heures du matin. Un coup de canon est tiré pour annoncer notre arrivée à M. Montminy, qui nous a laissés dans le dessein de nous devancer et de préparer les voies; personne ne paraît faire attention au signal donné, et nous attendons patiemment qu’on veuille bien s’occuper de nous. Enfin, du barachois sort un flette, conduit par un vieillard, qui fait jouer lentement ses deux rames. Nous le hélons à plusieurs reprises; mais il est trop occupé, et ne nous aperçoit qu’au moment où sa petite embarcation frappe contre la goélette. Comment décrire sa surprise? Sa tête est nue; ses longs cheveux gris flottent au gré du vent, tantôt couvrant sa figure bronzée, tantôt se tordant et se dressant comme des serpents. La bouche béante, les yeux attachés sur Mgr. de Sidyme, il s’appuie sur une rame, tandis qu’il tient l’autre prête à frapper l’eau, au premier mouvement d’hostilité qu’il remarquera.—“M. le missionnaire est-il arrivé?”—“Oui, oui; je le sais.”—“Avez-vous eu connaissance du prêtre?”—“Oui, oui; la plus belle voiture.”—Sans attendre d’autre question et sans donner d’explication plus claire, il fait volte-face, et, mettant en jeu toute la vigueur de ses vieux bras, il fuit vers le goulet d’où nous l’avons vu sortir.
Au bout d’une demi-heure, une berge nous amène des gens plus raisonnables, et le mystère qui accompagnait les allures du premier visiteur s’explique. Il avait puis la Sara pour un des bâtiments qui font le trafic sur la côte; suivant sa coutume, il se rendait à bord pour donner et recevoir les premières nouvelles, et prendre le petit coup d’eau-de-vie; lorsqu’il leva les yeux, il aperçut un évêque avec plusieurs prêtres, et reconnut sa méprise. Très-sourd, il ne put entendre les questions qui lui étaient adressées; mais il s’empressa de porter à terre la nouvelle de l’arrivée des étrangers, et de faire expédier vers eux la meilleure berge de l’endroit. Comme M. Montminy, retardé par quelque contretemps, n’est pas encore rendu à la Grande Rivière, personne ne nous y attendait.
Ce lieu de pêche, a son barachois et sa rivière, dont l’entrée est rendue difficile par une barre de sable. Le terrain est plat et peu élevé; depuis le mont Sainte-Anne, les hauteurs s’éloignent tellement de la mer, que d’ici on ne peut les distinguer.
Les nombreuses branches d’une même famille, établie ici depuis plus de cent ans, forment la plus grande partie de la population.
Il fut un temps, sur la fin du siècle dernier, où les côtes du golfe étaient rarement visitées par les missionnaires, qui ne pouvaient parcourir tous les établissements dans une seule année. M. Girouard fut, vers cette époque, chargé de desservir le littoral de la Baie des Chaleurs et le district de Gaspé tout entier; plusieurs années auparavant, un de ses prédécesseurs, M. Bourque, avait à visiter près de quatre cents lieues de côtes, dans la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et le Canada. Aujourd’hui que les missions ont été divisées, le pasteur peut veiller plus aisément sur son troupeau, et l’instruction religieuse se répand dans toutes les parties du pays. Nous avons ici l’occasion d’observer tout le bien moral qui résulte de la présence du missionnaire au milieu de ses ouailles.
Quant aux avantages temporels de la Grande-Rivière, ils sont considérables. Les terres y sont fertiles, et il est facile de les améliorer avec les monceaux de têtes de morues qui pourrissent près des vignots. Aussi fructueuses qu’à Percé, les pêcheries exigent moins de frais, car la bouette est plus abondante, et les berges s’usent moins vite.
Les embarcations sont beaucoup plus fortes que celles que nous avons vues jusqu’ici. La raison en est qu’à la Grande-Rivière, chaque pêcheur construit lui-même ses berges, et les fait très-solides, afin qu’elles durent plus longtemps.
Ici règne une aisance qu’on ne rencontre pas, dans nos plus riches paroisses du district de Québec. Les marchands forains apportent des provisions en abondance, et quelquefois à assez bas prix, comme cela est arrivé cet été; en retour, ils prennent de la morue marchande. Néanmoins les choses changent durant l’hiver, chez ceux qui ont manqué de prévoyance et d’économie; ces derniers se voient souvent réduits à une grande gêne, pour avoir imité la cigale, au lieu de suivre l’exemple de la fourmi. Malgré ces exceptions au bien-être général, tous les habitants de la Grande-Rivière sont restés hors de la dépendance de la maison Robin, qui n’a pu établir ici sa domination, comme elle l’a fait à Paspébiac.
Notre hôte, Baptiste Couture-Bellerive, descendant du digne compagnon de captivité du P. Jogues, exige que nous prenions tous nos repas chez lui. L’état d’aisance dans lequel il vit, lui permet d’exercer une généreuse hospitalité. Il possède un établissement de pêche, qui lui donne d’amples revenus. Ce matin même, il a pris quatorze saumons qui, au prix d’un écu la pièce, lui font une assez bonne aubaine. Grâce à sa libéralité, le saumon sera notre pain quotidien d’ici à quelques jours.
Trois lourds et forts fusils ornent sa grande chambre; ils ont sept pieds de longueur, et c’est, nous dit-il, la taille ordinaire des fusils dans ces parages. Les occasions de satisfaire sa passion pour la chasse sont si fréquentes, que chaque année il met de côté une somme de vingt louis pour l’achat de poudre et de plomb. Pendant tout l’été, les anses voisines sont couvertes de gibiers noirs; l’automne amène avec lui d’innombrables volées de canards et d’outardes. Et qui, à la vue ces richesses de l’air et de l’eau, ne serait tenté de se faire chasseur? Quel cœur ne battrait d’anxiété et de joie, en présence de ces phalanges ailées, couvrant les battures et se jouant au milieu des joncs. Aussi dans ce lieu tous les hommes sont chasseurs. Beaucoup de mains dégarnies d’un doigt ou d’un pouce attestent cependant que, si la chasse a des délices, elle offre aussi des dangers. Par une coïncidence remarquable, les accidents de ce genre sont toujours arrivés le dimanche ou un jour de fête d’obligation.
Dans toutes les missions du golfe Saint-Laurent, pendant l’absence du prêtre, les catholiques observent fidèlement l’usage de se réunir le dimanche à la chapelle, pour y faire leurs prières. On y chante certaines parties de la messe, ainsi que les psaumes des vêpres. Un catéchiste est chargé de lire les prières à haute voix et d’instruire les enfants. Ces fonctions, sont confiées à un homme probe, et assez instruit pour pouvoir, tant bien que mal, lire les prières de la messe d’un bout à l’autre. Il est nécessaire de remarquer que cette dernière condition ne se rencontre pas souvent chez les pêcheurs de la Gaspésie.—“Débis pien tes années,” nous disait le père Stiver, allemand de naissance et lecteur de la Grande-Rivière, “ché vais la brière; ché leux parle tu pon Tié; à brésent chi sis renti. Ché sis fenu tans le bays, afec le réchiment tes plancs. Il y a pien tes années; car ch’ édais cheune carson, et ch’ ai quadre-fingt-teux ans.”—Les cheveux du bon vieux soldat, du régiment hessois “des blancs,” ont blanchi au service de la mission. Aujourd’hui infirme et fort âgé, il ne peut plus lire; mais il récite de mémoire les prières qu’il a si souvent répétées.
Longtemps après nous, arrive M. Montminy, qui, sûr de nous dévancer, a passé la nuit à l’Anse-à-Beaufils, près de Percé. A peine nous a-t-il rejoints, qu’on vient le demander pour un malade, dont la maison est à quelques arpents du lieu d’où il est parti ce matin. Comme sa présence est nécessaire à la Grande-Rivière, je crois devoir lui offrir mes services, qu’il accepte volontiers.
Il est impossible de faire le voyage en berge; le vent est contraire et souffle avec violence. Quant à la route de terre, on ne peut la parcourir qu’à pied, car la mer est le seul grand chemin qui soit ouvert aux voyageurs, dans cette partie du pays. D’ailleurs, il n’y a dans tout le voisinage qu’un seul cheval, et il n’a pas encore été dompté. Qu’importe? un sentier a été pratiqué dans la forêt en faveur des piétons, et, Dieu merci, je me suis accoutumé à faire de longues marches dans les bois de Saint-Isidore. Un guide m’accompagne; tous deux nous cheminons joyeusement, tantôt plongeant dans l’épaisseur de la forêt, tantôt suivant sur le sable les bords de la mer. Après une course d’environ dix milles, durant laquelle nous traversons les habitations de la Petite-Rivière, de la Montée-du-Cap, de l’Anse-du-Cap et du Cap Désespoir, nous arrivons chez le malade, qui est assez bien portant encore, et n’a guères à se plaindre que du poids de ses quatre-vingts ans. C’est donc un voyage à peu près inutile; mais je ne puis regretter de l’avoir fait, car il m’a permis de visiter un lieu que depuis longtemps je désirais voir.
L’anse à Beaufils s’étend entre Percé et le cap nommé Des Espoirs par quelques géographes, et Désespoir par d’autres. Le dernier nom me parait le plus convenable, car ce cap est devenu célèbre par plus d’un naufrage. Il en est un surtout, dont le souvenir s’est conservé plein de vie parmi les habitants des environs. Sur la pointe la plus avancée, à vingt pieds au-dessus des plus hautes eaux, se trouvent les débris d’un bâtiment, connu des pêcheurs sous le nom de naufrage anglais. Pour le soulever jusque-là, la mer a dû dépasser de beaucoup ses limites ordinaires; or il est à remarquer que, dans ces parages, les plus fortes marées ne font monter les eaux que de quatre ou cinq pieds. Les grands pères de la génération actuelle ont vu cette carcasse de bâtiment dans le même lieu, et l’ont entendu nommer le naufrage anglais.
Le cap Désespoir s’avance au large, vis-à-vis l’extrémité méridionale de l’île de Bonaventure. Entre ces deux pointes et Percé, se déploie une belle nappe d’eau, remarquable par ses mirages. Suivant les traditions locales, des merveilles, plus inexplicables que les effets du mirage, se sont passées sur ces eaux, et ont été plusieurs fois renouvelées durant le siècle dernier et dans les premières années de celui-ci.
“Parfois,” rapporte la chronique de ces temps, “le pêcheur, qui s’est arrêté près du naufrage anglais, assiste à des scènes merveilleuses; une étrange vision se déroule sous ses yeux. Les eaux sont unies comme une glace, et le temps parfaitement calme. Tout à coup la mer se soulève et s’agite au large; les vagues se dressent comme des collines, se poursuivent, se brisent les unes contre les autres. Soudain, au-dessus de ces masses tourmentées, apparaît un léger vaisseau, portant toutes ses voiles dehors et luttant contre la rage des ondes bouillonnantes. Aussi rapide que l’hirondelle de mer, comme elle, il touche à peine les eaux. Sur la dunette, sur le gaillard, dans les haubans, partout, se dessinent des figures humaines, dont le costume antique et militaire convient à des soldats d’un autre siècle. Le pied posé sur le beaupré et prêt à s’élancer vers le rivage, un homme, qui porte les insignes d’un officier supérieur, se tient dans l’attitude du commandement. De la main droite, il désigne au pilote le sombre cap, qui grandit devant eux; sur son bras gauche s’appuie, une forme drapée de longs voiles blancs.”
“Le ciel est noir, le vent siffle dans les cordages, la mer gronde, le vaisseau vole comme un trait; encore quelques secondes et il va se broyer contre les rochers. Derrière lui, une vague, une vague aux larges flancs, se lève, s’arrondit et le porte vers le cap Désespoir. Des cris déchirants, au milieu desquels on distingue une voix de femme, retentissent et se mêlent aux bruits de la tempête et aux éclats du tonnerre.”
“La vision s’est évanouie, le silence de la mort s’est étendu sur ces eaux; le vaisseau, le pilote, l’équipage épouvanté, les soldats, l’homme au geste altier, la forme aux longs voiles blancs ont disparu; le soleil brille sur une mer calme et étincelante; les flots viennent mollement caresser le pied du cap Désespoir. Le pêcheur est resté seul à côté des varangues vermoulues du naufrage anglais.”
La tradition rapporte qu’en 1711 un orage effrayant jeta, sur les rochers du cap, un vaisseau anglais chargé de soldats.
Cette année-là, une flotte anglaise remontait le Saint-Laurent sous les ordres du général Walker; elle portait un corps de sept à huit mille hommes, commandé par le général Hill, frère de madame Masham qui venait de remplacer la duchesse de Marlborough dans la faveur de la reine Anne. Outre plusieurs régiments de vétérans et quelques compagnies des gardes royales, il y avait sur cette flotte un grand nombre de familles, qui se rendaient au Canada pour y habiter, tant était grande la confiance des Anglais dans la réussite de leur entreprise. Des officiers et beaucoup de soldats étaient aussi suivis de leurs femmes et de leurs enfants.
La consternation régnait dans Québec, où l’on se rappelait les angoisses et les souffrances endurées par les habitants de cette ville, lorsque Phips l’avait assiégée en 1690.
Conservant peu de confiance dans les secours humains, les Canadiens eurent recours à Dieu; pendant que les hommes se préparaient à combattre, les dames se réunissaient dans l’église de la Basse-Ville, pour implorer la protection de la sainte Vierge auprès du Dieu des armées.
Cependant la flotte anglaise était entrée dans le golfe Saint-Laurent, sans éprouver aucun accident; alors les brumes et les calmes commencèrent à retarder sa marche. Dans la crainte que les vaisseaux et les transports ne se séparassent les uns des autres, l’amiral fit jeter l’ancre dans la baie de Gaspé. Le vingt août, il se remit en route par un fort vent de l’ouest; mais les brumes se répandirent de nouveau sur la mer, et quelques vaisseaux durent s’écarter des autres et être poussés vers le golfe. Peu après, une violente tempête s’éleva; le vent venait du nord-est, et porta une partie de la flotte sur les rochers de l’île aux Œufs, où huit transports furent perdus; neuf cents hommes, tant officiers et soldats que matelots, périrent au milieu des brisants. Des femmes et des enfants se trouvèrent aussi enveloppés dans cette terrible catastrophe. L’on constata plus tard, par des objets de piété, qui furent trouvés dans les caisses jetées à la côte, que plusieurs familles catholiques avaient péri dans le naufrage.
Suivant, les chroniques de la Gaspésie, ce fut la même tempête, qui porta sur la pointe du cap Désespoir le vaisseau dont les restes sont connus sous le nom de naufrage anglais.
Vers neuf heures du soir, j’avais terminé mon voyage de vingt milles, et j’arrivais à la Grande-Rivière, tout à propos pour m’embarquer sur une berge, qui allait conduire Mgr. de Sidyme à la goélette.
Juillet, 3.—Nous laissons la Grande-Rivière au bruit d’une vive fusillade, comme à l’ordinaire. Un des longs fusils, trop fortement chargé, se brise entre les mains d’un jeune homme, qui est debout dans une berge, au milieu de dix ou douze personnes; quelques éclats passent près de la tête de M. Montminy, assis à côté de l’imprudent tireur. Par bonheur, personne n’est blessé; ses voisins rient du mouvement de terreur causé par l’accident, et continuent de faire feu avec le même entrain, ayant le soin de mouiller le bout du canon de chaque fusil, afin de produire une détonation plus bruyante.
Nous sommes embarqués; mais le vent ne veut encore rien faire pour nous; en attendant sa décision, la mer se charge de nous donner un avant-goût de ce qu’elle nous réserve au large; une grosse houle tourmente la Sara, qui s’agite et s’impatiente. C’est le résultat du gros vent qui a soufflé depuis quelques jours. Il a été si violent, qu’une berge conduite par des jersiais a chaviré avant-hier; les naufragés, habitués à ce contretemps, se réfugièrent sur la quille de leur embarcation et attendirent patiemment qu’on allât les délivrer.
Souvent il arrive des accidents de ce genre, par suite de l’imprudence et de la vanité des jeunes pêcheurs, qui craindraient de passer pour des poltrons, s’ils diminuaient de voiles lorsque la brise fraîchit.
Peu après midi, un faible vent contraire nous permet de nous élever en mer; mais nous n’y gagnons rien, car les courants qui sortent de la Baie des Chaleurs nous rejettent du côté de Percé. La chaloupe est mise à l’eau, et quatre rameurs essaient de remorquer la goélette vers le large. C’est peine inutile; elle est refoulée vers la côte, contre laquelle les vagues se brisent avec violence. Déjà nous n’en sommes plus qu’à trois ou quatre encablures, lorsque le capitaine rappelle les rameurs, fait jeter deux ancres, et se résigne à attendre, en ce lieu périlleux, des circonstances un peu plus favorables pour continuer le voyage.
Les balancements saccadés et non interrompus de la Sara produisent de mauvais résultats sur un des nôtres, qui jusqu’à ce jour s’est montré fort solide; pour arrêter le mal de mer dès son début, il prend le sage parti d’aller dormir. Quant aux autres voyageurs, qui commencent à avoir le cœur marin, ils s’occupent à faire la pêche; en moins de deux heures, ils ont jeté sur le pont une quarantaine de morues, dont les souffrances sont abrégées par le couteau. Mathieu leur tranche la tête, les éventre, et sale les chairs pour le jour où la pêche sera mauvaise; il réserve les têtes pour en faire un salmigondis, que les pêcheurs de Jersey nomment la quiode, et dont ils sont fort friands.
Vis-à-vis de notre mouillage, et près d’un ruisseau nommé la Pêche-à-Manon, une longue échelle est plantée verticalement contre la falaise. Un cultivateur irlandais, établi près de ce lieu, s’en sert pour transporter le varech, qu’il étend comme engrais sur sa terre. L’échelle est trop rapprochée de nous, pour que nous ne la voyions pas d’un mauvais œil; qu’un seul anneau des chaînes qui retiennent les ancres, soit trop faible pour résister aux secousses causées par les vagues, et la goélette est dans un instant broyée contre les rochers.
Malgré le voisinage peu rassurant de la grande échelle, nous ne pouvons nous empêcher de jouir avec délices de cette belle soirée. L’atmosphère est pure et tempérée; la voix de la mer a des sons graves, solennels, magnifiques. Une lueur argentée, produite par le phosphore des eaux, brille sur la crête des vagues, et s’attache aux chaînes, qui apparaissent comme un réseau de feu. Des poissons, étincelants de lumière, se jouent autour de la goélette; dans leurs ébats, ils laissent à leur suite une longue traînée d’étoiles; la mythologie dirait que c’est une nouvelle voie lactée, tracée sur l’azur de la mer par le passage de la déesse Amphitrite. Cette lumière phosphorique éclaire suffisamment pour permettre de distinguer avec facilité les lettres d’un livre.
L’on a présenté beaucoup d’explications de ce phénomène. Ce qu’il y a de certain, c’est que ces étincelles sont produites par le mouvement et par le frottement. Elles brillent, lorsqu’une vague se brise, ou lorsque l’eau bat contre un corps solide. Ce n’est pas une lumière dense, mais plutôt le rapprochement de myriades de points lumineux, ressemblant à ceux qui s’échappent de tous les poils d’une peau de chat, lorsqu’on la frotte avec la main.
Juillet, 5.—Un gros vent contraire, qui s’élève vers cinq heures du matin, nous permet de gagner la pleine mer. A force de louvoyer, nous avançons vers la Pointe-au-Genièvre, nommée Newport par les Anglais. Sur la droite, nous laissons au fond d’une belle baie, l’établissement de Pabos, qui jouissait d’une certaine importance sous le gouvernement français. Il renfermait alors quelques magasins et une chapelle, aujourd’hui détruite. Huit familles irlandaises sont établies à Pabos; elles se livrent à la culture et fournissent des pommes de terre à une partie des pêcheurs de la côte.
Vis-à-vis de la Pointe-au-Genièvre, s’avance une chaîne de rochers, qui s’élèvent de douze à quinze pieds au-dessus de l’eau. Entre cette presqu’île et la terre ferme, est un petit port, dans lequel on pénètre par un goulet étroit et dangereux. Vers cinq heures du soir, nous ne sommes guères qu’à une demi-lieue de ce port, d’où sortent plusieurs berges, les unes pour nous transporter à terre, les autres pour remorquer la goélette.
Quelques chétives cabanes, un sol maigre, des rochers, des bouquets de sapins entre lesquels serpentent les sentiers qui conduisent à la chapelle et au rivage: voilà la partie inanimée de ce lieu. Quant aux habitants, ils brillent plutôt par la bonne humeur que par la beauté des formes. Le teint cuivré, les pommettes saillantes, les cheveux noirs, longs et raides, dénotent qu’il existe dans une partie de la population un mélange de sang sauvage. Négligemment vêtues, environnées d’enfants, dont la toilette est encore à faire, les matrones mettent le nez à la porte pour nous voir passer, et donnent tous les signes du plus grand ébahissement.[47]
De leur côté, les hommes s’occupent à nous ménager des surprises; tapis au milieu des broussailles, ils attendent le moment où nous passons prés de leurs cachettes, pour décharger leurs fusils; puis ils se montrent, rayonnants de joie, à l’idée de nous avoir étourdis.
Mgr. l’évèque de Sidyme est reçu par messieurs Montminy et N...., qui nous ont dévancés sur une berge de la Grande-Rivière. La chapelle, tapissée de gravures aux couleurs brillantes, se remplit en peu d’instants, et tous les assistants écoutent la parole de Dieu, avec une attention et un recueillement remarquables. Comme l’heure avancée de la journée ne nous permet pas de prolonger la séance, après l’instruction publique, nous retournons prendre gîte sur la goélette. Tandis que, arrêtés au bord de la mer, nous attendons l’arrivée d’une chaloupe, un coup de filet, donné sous nos yeux dans le petit port, jette sur le sable un monceau de poissons: poules de mer, tanches, crapauds de mer, capelans, raies, plies, harengs, sardines, truites, loches, homards, se débattent pêle-mêle sur le rivage. Les pêcheurs choisissent le capelan pour bouéter la morue; le reste est abandonné sur la grève, où les enfants d’une pauvre veuve trient ce qui leur convient pour le souper, sans songer à faire de provisions pour le déjeûner du lendemain; ils savent que le lendemain pourvoira aussi à leurs besoins. Les homards deviennent notre lot.
Ce sont de hargneux personnages que ces homards, toujours prêts à écraser ou à déchirer ce qui tombe entre leurs serres. Aussi leurs mauvaises habitudes attirent ordinairement sur eux des malédictions et des coups, quand ils se trouvent pris dans un filet; et c’est vraiment à bon droit qu’ils y sont mal reçus car leurs dures tenailles font de larges brêches au milieu des mailles.
Les eaux de la mer sont toujours fort limpides; selon certaines dispositions de l’atmosphère, elles le deviennent encore d’avantage, et perdent alors leur couleur verdâtre pour prendre une teinte d’azur, fortement prononcée. Nous avons ce soir l’occasion de faire cette remarque. Du pont de la goélette, nous nous amusons à voir les tanches, nageant à quatre ou cinq brasses au-dessous de la surface, et se disputant la nourriture qui leur est jetée; nous pouvons même distinguer les herbes et les cailloux qui tapissent le lit de la mer, à une profondeur de trente-cinq pieds.
Juillet, 6.—Les braves gens de la Pointe-au-Genièvre, qui se pressent dans leur petite chapelle pour s’approcher des sacrements, sont aujourd’hui méconnaissables. Frottés, débarbouillés, endimanchés, ils ressemblent à des chrétiens ordinaires; leurs bonnes dispositions font regretter à l’évèque de Sidyme d’avoir à s’éloigner si tôt de ce lieu.
M. Montminy nous laisse pour retourner à Percé; la Pointeau-Genièvre est sa dernière mission du côté de la Baie des Chaleurs. Son ministère est partagé entre une quinzaine de petits villages, épars sur la côte. Dès qu’une misérable chapelle est bâtie au milieu d’un groupe de maisons, le missionnaire doit la visiter deux ou trois fois l’an. Pendant ces visites, qui durent de dix à quinze jours, il lui faut préparer les jeunes gens à la première communion, faire remplir le devoir pascal, réprimer les désordres, donner chaque jour des instructions, célébrer les mariages et baptiser les enfants nouveaux nés. Comme les chemins ne sont ouverts que dans le voisinage immédiat de Percé, il doit faire ses voyages, en berge durant l’été, et sur des raquettes pendant l’hiver; il doit trainer à sa suite ornements, pierre d’autel, vases sacrés, provisions de bouche. Retardé par le mauvais temps, parfois il ne trouvera personne pour le reconduire chez lui. Sa résidence, il l’établit dans quelque maison voisine de la chapelle, en choisissant, autant qu’il le peut, la plus honnête et la plus commode; souvent, cependant, la meilleure est encore bien triste.
Depuis la Malbaie jusqu’à la pointe au Maquereau, la morue se prend en plus grande abondance que dans tout le reste du district de Gaspé. L’immense quantité de poisson qu’on pêche le long de cette côte, donne une idée des trésors recélés dans le sein de l’océan, et prouve qu’à la mer, tout aussi bien qu’à la terre, appartient le titre d’alma nutrix. Le poisson d’eau salé dans ses différentes espèces, hareng, maquereau, morue, saumon, sardine, bar, anguille, ne forme-t-il pas en effet la principale partie de la nourriture des classes ouvrières, chez un grand nombre de peuples? Aux riches la mer offre les mets les plus délicats; aux pauvres elle fournit des aliments sains et peu coûteux.
Combien de bêtes de la terre lui demandent leur subsistance, depuis l’ours blanc, qui prend son passage sur les glaces polaires, et s’amuse pendant son voyage à faire la chasse aux loups-marins, jusqu’aux troupeaux de pourceaux, qui nettoient les grèves et les débarrassent d’amas de poissons pourris et infects? Combien d’oiseaux lui doivent leur pâture? les canards, les outardes, les goélans, les mouettes, les cormorans, les alouettes, les pluviers, se nourrissent les uns de poissons, les autres de plantes marines, d’insectes, de coquillages.
C’est sur les bords de la mer surtout, que la corneille déploie toute son intelligence et toute son habileté pour la maraude. Comme elle aime à dîner selon son goût, elle prend le temps convenable pour choisir ses provisions. Voltigeant sur les galets avec un air d’insouciance complète, elle observe attentivement les pêcheurs au moment où ils retirent leurs filets de l’eau. Quand elle s’est rapprochée d’eux insensiblement et comme par distraction, elle s’élance tout à coup sur quelque petit poisson qui lui convient, et s’éloigne rapidement, pour savourer en paix la proie si honnêtement acquise.
Le capelan semble être un de ses plats favoris; lorsqu’il devient rare sur la grève et qu’elle ne peut plus le manger frais, elle ne fait point difficulté de recourir à celui qui sèche dans les champs de pommes de terre. Au pied de chaque tige, le cultivateur a jeté quatre ou cinq capelans, qui servent à engraisser le sol et à fournir la sève de la plante. Dans les temps de disette, c’est le grenier de la corneille; elle passe de rang en rang, examine soigneusement, tourne, retourne, et choisit enfin un poisson mieux conservé que les autres. Elle l’enlève dans son bec, et s’envole au rivage afin de préparer son repas, car il faut quelque apprêt pour rendre ce capelan dur et sec, plus propre à son estomac. Quand elle a bien examiné les accidents de la grève, elle s’arrête à une flaque d’eau qui possède les propriétés requises, et y laisse tomber son poisson; en attendant qu’il soit bien préparé, et pour aiguiser son appétit, elle se livre aux jouissances de la méditation et de la promenade. De temps en temps, elle revient tâter et tourner le capelan; lorsque enfin elle le juge dans les conditions voulues, elle l’emporte pour le dépécer à loisir sur quelque rocher solitaire.
Si la disette de poissons s’étend sur les champs et sur la grève, la corneille en est réduite aux coques, méprisées dans les temps d’abondance. Elle en choisit une qui, dès qu’elle se sent enlever, se renferme soigneusement dans son manteau. Soins inutiles! la corneille s’élève dans l’air avec sa proie, et la laisse tomber sur le roc; les écailles volent en éclats, et la pauvre coque, mise à nud, est facilement déchirée par son bourreau.
Sur la mer, comme dans l’air et sur la terre, les plus forts et les plus adroits vivent aux dépens des faibles et des sots.
[47] Il n’y avait alors à la Pointe-au-Genièvre que douze ou quinze familles, qui depuis ont été en partie détruites par la petite vérole. D’autres les ont remplacées, et se sont étendues entre Pabos et la Pointe au Maquereau. En 1856, le nombre de famines s’élevait à 103.
———
Le Port Daniel—La mère Christine et ses miliciens—Paspébiac—Le feu des Roussi—Emmanuel Brasseur—Bonaventure—Les Acadiens—Un original—Cascapédiac.
Charles Roussi, homme intelligent et actif, que nous trouvons à la Pointe-au-Genièvre, se charge de conduire la Sara dans le port Daniel. A force de louvoyer, nous arrivons à la pointe au Maquereau, qui, avec l’île de Miscou sur la côte du Nouveau-Brunswick, forme l’entrée de la Baie des Chaleurs. Ainsi nommée par Jacques Cartier, à cause des chaleurs excessives qu’il y éprouva, cette baie a vingt-cinq lieues de longueur, sur quinze à vingt milles de largeur.
La pointe au Maquereau est à onze lieues de Percé, en ligne droite; elle se trouve à six milles de la Pointe-au-Genièvre et à sept du Port Daniel. Après l’avoir passée, nous courons devant une brise magnifique, en serrant la terre du nord, qui appartient au Canada. Des caps de pierre calcaire s’avancent dans la mer; les uns sont couronnés de grands arbres et revêtus d’une riche verdure, qui descend jusqu’au rivage; les autres, rongés et bouleversés par l’action des flots, offrent les formes fantastiques, tantôt de châteaux ruinés, tantôt de longues colonnades ou de statues gigantesques posées sur de lourdes bases. De distance en distance, un enfoncement obscur au milieu de la forêt désigne le lien où des défrichements ont été commencés; plus loin s’étendent des habitations rapprochées et des champs en culture, indices d’établissements déjà anciens. Un pont traverse une rivière, qui se jette dans l’anse au Gascon; c’est le seul que nous ayons jusqu’à présent rencontré dans le district de Gaspé.
Au soleil couchant, nous mouillons au Port Daniel. M. H., missionnaire du lien, vient saluer Mgr. de Sidyme et l’inviter à débarquer; il est lui-même arrivé hier soir du chef-lieu de sa mission, et ne nous attendait pas avant une semaine. Quoiqu’il soit un peu tard, nous allons visiter la chapelle, près de laquelle les pêcheurs nous reçoivent, la crosse du fusil à l’épaule. Une voix hante et criarde domine le bruit de la mousqueterie, et commande les mouvements de la milice improvisée.—“A genoux, les petits vieux... feu! feu!.... Ils n’avions pas besoin de ménager la poudre.” Cette voix appartient à la mère Christine L...., sexagénaire, qui a vu naître la génération présente, et ne paraît pas en avoir peur, car elle commande en reine et se fait obéir. Née à Paspébiac, elle vit ici depuis quarante ans; et, s’il faut en juger par la force de ses poumons, elle pourra y vivre encore aussi longtemps[48].
Le port Daniel est un excellent hâvre, qui peut avoir quatre ou cinq milles de tour. Les seuls vents du sud-est s’y font sentir; il est abrité contre tous les autres par un cercle de hautes collines. Un étroit goulet décharge, dans ce bassin, les eaux d’un lac formé par la réunion de plusieurs rivières. Entre le lac et le port, s’avancent deux pointes basses et sablonneuses, sur lesquelles les pêcheurs ont bâti les habitations d’été, pour être plus près de leurs filets, de leurs vignots et de leurs berges. Les maisons d’hiver sont plus haut, au bord des rivières; les familles y passent la saison rigoureuse, parce qu’il leur est plus facile de s’y procurer le bois de chauffage, et que les hommes y sont plus rapprochés de la forêt, où la plupart d’entre eux sont employés, durant l’hiver, à préparer les bois pour l’exportation. L’année dernière quatre ou cinq navires ont fait ici des chargements de bois; le nombre s’en augmentera sans doute, car de belles forêts s’étendent à l’intérieur et n’ont pas encore été exploitées. Le Port-Daniel fournit d’excellente pierre à chaux, qui se transporte aux autres établissements de la Baie des Chaleurs; dans quelques années, il pourra offrir au Canada du charbon de terre, dont on a découvert des gisements considérables près des rivières.
10 h. P. M.—La Sara est mouillée au pied du cap au Diable, qui par sa forme nous rappelle le cap aux Diamants de Québec. Ce qui ajoute à l’illusion, ce sont des feux que ravive la brise de la nuit. Pendant plusieurs jours, un incendie a parcouru les bois qui couronnent le promontoire, et ce soir tous les bûchers, d’où tantôt ne s’élevait qu’un peu de fumée, sont attisés et répandent une lueur rougeâtre sur une portion du port, tandis que les autres parties sont enveloppées de profondes ténèbres. Epars depuis la bâse jusqu’au sommet de la colline, ces flambeaux retracent à l’imagination les mille lumières, qui, pendant la nuit, s’étagent les unes au-dessus des autres, dans la vieille capitale du Canada.
Juillet, 7.—Vingt-cinq on trente familles habitent le Port-Daniel et les anses voisines. Ces bonnes gens ressemblent beaucoup à ceux de la Pointe-au-Genièvre. Leur langage n’est pas toujours intelligible pour un canadien, car ils ont des expressions et des tournures particulières à leur localité.
La température, nous dit-on, est ici un peu plus douce qu’aux environs de Percé; ce printemps les semailles y ont été commencées dans la première semaine de mai. Moins abondante qu’à la Pointe-au-Genièvre, la morue est en partie remplacée par d’autres poissons, surtout par le saumon, qui monte en grande quantité dans les rivières. Dernièrement un seul pêcheur a pris, dans une journée, soixante huit saumons, pesant de vingt-cinq à trente livres chacun.
Sous une main protectrice et capable de la guider, la population du Port-Daniel pourra, avec les avantages dont elle jouit, s’élever à une condition beaucoup plus prospère[49].
A notre départ de ce lieu, malgré la surveillance active de la mère Christine L.... sur ses miliciens, un fusil, chargé outre mesure, éclate, et les morceaux sont lancés au loin, sans néanmoins blesser personne.
Vers midi nous sommes sous voile. Le vent tombe; un calme plat nous arrête vis-à-vis des pêcheries de la Nouvelle. Nous espérions arriver de bonne heure à Paspébiac; il faut remettre la partie à demain. Cependant le temps est si beau et les causeries sur le gaillard d’arrière sont si gaies, que personne ne s’aperçoit du contretemps. Le soleil se couche dans toute sa gloire et éclaire de ses derniers rayons un ciel sans nuage; à l’occident, le crépuscule déploie lentement son manteau d’or et de pourpre; à l’orient, les côtes basses du Chippagan se dessinent, comme une longue bande qui se confond avec l’azur de la mer. A mesure que l’obscurité s’étend sur l’horizon, les feux allumés sur le banc de Paspébiac lancent des jets d’une lumière rougeâtre, qui tremblent sur la surface ridée des eaux, et produisent à cette distance un effet lugubre.
Les feux, placés souvent en plein air, sur cette pointe basse et avancée, étant reproduits par le mirage, ne seraient-ils pas la cause réelle du phénomène, connu dans les environs sous le nom de feu des Roussi? Suivant les rapports de ceux qui disent l’avoir examiné, une flamme bleuâtre s’élève par fois au sein de la mer, à mi-distance entre Caraquet et Paspébiac. Tantôt petite comme nu flambeau, tantôt grosse et étendue comme un vaste incendie, elle s’avance, elle recule, elle s’élève. Quand le voyageur croit être arrivé au lieu où il la voyait, elle disparaît tout à coup, puis elle se montre lorsqu’il s’est éloigné. Les pêcheurs affirment que ces feux marquent l’endroit où périt, dans un gros temps, une berge conduite par quelques hardis marins, du nom de Roussi; cette lumière, selon l’interprétation populaire, avertirait les passants de prier pour les pauvres noyés.
Juillet, 9.—De grand matin, nous dédoublons la pointe du banc de Paspébiac. Le banc ou, comme on le nomme ici, le bagne, est un triangle équilatéral dont la bâse est formée par la terre ferme; des deux extrémités de cette bâse, qui a un mille de longueur, partent deux bandes sablonneuses, larges environ d’un arpent et se joignant à un mille en mer. L’intérieur de ce triangle est un beau bassin, qui communique avec les eaux de la mer par un étroit canal. Le bassin et le goulet étaient autrefois assez profonds pour recevoir des navires; malheureusement au milieu du premier se trouvait un ilôt, qui, en s’affaissant, l’a rempli de manière qu’il ne sert plus que pour des berges.
La compagnie Robin a, dans ce moment, huit gros bâtiments mouillés dans le hâvre voisin du banc. Venus ce printemps avec une cargaison de marchandises, ils repartiront chargés de morue, au commencement de l’automne. En attendant, les matelots sont occupés à faire la pêche et à préparer le poisson.
Il y a soixante ans, quelques familles seulement habitaient ce lieu, où l’on compte aujourd’hui six cents âmes. Une partie de la population parait être venue de Plaisance dans l’île de Terreneuve; elle s’est depuis augmentée par l’adjonction de Basques, de Canadiens et de Jersiais. La renommée nous l’avait d’avance peinte sous des couleurs assez sombres; aussi fûmes-nous surpris de la trouver beaucoup mieux qu’on ne l’avait faite. Les Paspébiacs ne seraient certainement pas des ornements dans un salon; pour la science et pour les lettres, ils figureraient assez tristement à côté d’un Arago ou d’un Chateaubriand. “Mais après tout,” vous diront-ils avec complaisance: “les Paspébiacs, ils étions des hommes rares; pour la pêche, pour la chasse, pour prier le bon Dieu, ils n’en craignions point.” Ils paraissent vifs et emportés, et cependant ils sont toujours prêts à rendre service; ils parlent avec véhémence et à tue-tête, de sorte qu’on les croirait fâchés, tandis qu’ils se disent des douceurs. Un Paspébiac crie-t-il à son voisin: “Taise-toi, ou je t’enfonce un croc dans le gau;” il lui fait un compliment qu’on n’adresse qu’aux plus intimes amis.
Emmanuel Brasseur, le bras droit du missionnaire, est le beau idéal du Paspébiac. Sec, fort et vigoureux, les yeux brillants, plein de vie et de feu, il passe pour un habile pêcheur et un intrépide marin. Ses prouesses sur la mer sont nombreuses, et il aime à les raconter. Sa langue ne lui suffit pas pour exprimer ses pensées; car, quoiqu’il parle vite et haut, il emploie toutes les parties de son corps, pour présenter avec plus d’énergie les incidents et les faits que sa parole s’occupe à décrire. Vous dit-il les tempêtes qu’il a essuyées dans sa berge? Il se balance comme les mâts, il bondit comme la vague, il siffle comme les vents déchaînés. Rappelle-t-il quelques exploits au pugilat? Sur votre tête il promène un poing décharné et dur comme un marteau, et à chaque instant il menace de vous assommer. Vous raconte-t-il comment le médecin a coupé la jambe à son fils? il s’étend sur le plancher, s’arme d’un couteau, se roidit, se roule, se tord comme une couleuvre blessée, et cherche ainsi à exprimer les sensations de la douleur, que lui-même n’a jamais éprouvée. Cette dernière est une longue histoire, qu’Emmanuel termine en déclarant que, pendant une semaine, “le joculot n’avions pas d’autre goût que de flairer de la douceur.”—Dans le français des Acadiens, adopté en grande partie par les Paspébiacs, le joculot est le dernier garçon de la famille; flairer de la douceur, veut dire manger du sirop.
Quoique voisins, les Acadiens de Bonaventure et les Paspébiacs ont peu de rapports ensemble. De mémoire d’homme, l’on n’a point vu un garçon d’une de ces missions épouser une fille appartenant à l’autre. Des deux côtés, un certain orgueil de caste s’oppose à ces alliances.
Le presbytère de ce lieu est assez commode; une terre, de dix arpents en superficie et toute défrichée, est destinée à l’usage du missionnaire. Aussi les Paspébiacs voudraient-ils avoir un prêtre résidant, qui desservirait le Port-Daniel, tandis qu’un autre missionnaire serait chargé de Bonaventure et de Cascapédiac. Monseigneur de Sidyme approuve fort ce projet, qui serait avantageux à toutes les parties intéressées.
Les habitants de Paspébiac dépendent complètement de la maison Robin. Lorsque le gouvernement se décida à concéder des terres, M. Charles Robin, qui jouissait ici d’un pouvoir absolu, exposa aux pêcheurs qu’il leur serait plus avantageux de n’avoir chacun qu’un lopin de dix arpents, parce que la culture en grand les détournerait de la pêche. Ils se laissèrent persuader, et maintenant ils regrettent leur folie. Ces petits terrains, ne fournissent qu’un peu de pacage, et les propriétaires doivent tout acheter aux magasins de la compagnie, qui leur avance des marchandises à crédit, et dont ils demeurent toujours les débiteurs.[50]
Quand ils veulent secouer leurs chaînes et porter ailleurs leur poisson, on les menace de les traduire pour dettes, devant les tribunaux, qu’ils redoutent. Force leur est de se remettre sous le joug, et d’expier par une longue pénitence leur tentative d’émancipation.
Le règlement imposé aux agents leur défend de rien avancer aux pêcheurs, avant un temps marqué: les hangars seraient-ils pleins de provisions, pas un seul biscuit ne sera distribué avant l’époque déterminée. Comme les pêcheurs ne sont payés qu’en effets, il ne peuvent rien mettre de côté pour l’avenir; mais quand ils ont pris ce qui leur est nécessaire, on achève de solder leurs comptes avec des objets de luxe. Aussi les filles sont-elles ici mieux vêtues que les élégantes des faubourgs, à Québec.
Les écoles sont proscrites. “Il n’y a pas besoin d’instruction pour eux,” écrivait M. Philippe Robin à ses commis; “s’ils étaient instruits, en seraient-ils plus habiles à la pêche?”
Lorsque les Paspébiacs prirent leurs terres, la forêt descendait jusqu’au banc, sur lequel ils avaient élevé leurs maisons. Les défrichements s’étendirent, et il fallut songer à se rapprocher du théâtre de leurs travaux agricoles. Ils se bâtirent donc dans le bois: et, quoique aujourd’hui les arbres aient été abattus, ils continuent de désigner leurs habitations d’hiver sons le nom de maisons du bois, tandis que leurs habitations d’été sont les maisons du bagne.
Sur la terre ferme, près du hâvre, est la résidence ordinaire des commis de MM. Robin: c’est un joli cottage, à demi caché au milieu d’un bosquet. Sur le banc, un vaste établissement renferme les magasins, les hangars, les chantiers, ainsi qu’une maison qui sert de demeure aux agents pendant le temps de la pêche. Dans ce lieu, règne un ordre admirable: les cour sont couvertes de gravier, qu’on applanit sous le rouleau; tous les bâtiments sont blanchis à la chaux ou peinturés; les chantiers pour la construction des navires de la compagnie sont pourvus, en abondance, des meilleurs matériaux.
Paspébiac renferme le dépôt principal des marchandises destinées au pays, et du poisson préparé pour les marchés étrangers. C’est d’ici que partent les bâtiments qui vont porter la morue aux Antilles, au Brésil et en Italie. Une bonne fortune toute spéciale s’est attachée aux navires de la compagnie. Chaque année depuis plus d’un demi-siècle, ils sont expédiés vers différentes parties du monde, et il ne s’en est encore perdu que deux, tant est grand le soin que mettent les chefs à choisir de bons capitaines et à n’employer que des bâtiments convenablement équipés. Pendant la dernière guerre, tous les navires des Robin étaient armés de canons, et en état de se défendre contre les armateurs des Etats-Unis.
Juillet, 11.—Après midi, nous faisons voile de Paspébiac. Comme des chemins sont ouverts entre ce lieu et Bonaventure, M. F. nous a dévancés, et il est parti ce matin dans la voiture d’un de ses amis.
Suivant quelques touristes, Paspébiac est le plus beau site de toute la Baie des Chaleurs. En effet, de la mer, le coup-d’œil est vraiment remarquable. Au niveau des eaux, s’avance le banc, qui présente, à sa pointe une masse d’édifices éclatants de blancheur, tandis que sur ses flancs, s’étend la longue ligne de maisons des pêcheurs. Dans cette partie, se déploie le mouvement qui distingue les pêcheries un peu considérables. Au second plan, le côteau s’élève régulièrement, et déroule un beau tapis vert, dont l’uniformité est brisée par des bouquets d’arbres, et par les habitations d’hiver; au milieu de ce village, l’église catholique et la chapelle protestante forment deux objets saillants; le fond du tableau est fermé par la forêt, aux teintes sombres et sévères.
Le vent d’est nous amène une pluie abondante, la première qui soit tombée depuis le printemps dans la Gaspésie. Ce matin même, les Paspébiacs assistaient avec piété à une grand’messe, chantée pour obtenir de Dieu la cessation de la sécheresse; rendus à Bonaventure, nous apprenons que cette pluie bienfaisante ne s’est pas étendue hors des limites de Paspébiac.
A une lieue du banc, est New Carlisle, petite ville renfermant quelques maisons éloignées les unes des autres. On en pourrait dire, à plus juste titre que de Washington, que c’est une ville en promenade à la campagne. Elle possède une cour, une prison, des avocats et quelques notables personnages de la contrée. Le gouvernement anglais a dépensé quatre-vingt deux mille livres sterling, pour établir à Douglastown et à New Carlisle des familles, restées fidèles à la mère-patrie, pendant la révolution des provinces de l’Amérique. “Cet argent,” disait le juge Thompson à l’évêque de Sidyme, “n’a pu être dépensé que pour creuser des canaux sous terre, car, sur le sol, on ne voit rien qui ait pu causer de si énormes dépenses.” C’est encore à New Carlisle qu’est placé le bureau de la douane, pour le nord de la Baie des Chaleurs; et il est à déplorer qu’on l’ait relégué sur un point dont les vaisseaux ne peuvent approcher, tandis qu’à droite et à gauche se trouvent des havres excellents.
Dans le nom de cette ville, on reconnaît la manie de déplacer les anciens noms, pour en substituer de nouveaux, d’origine anglaise. Aux noms sauvages de Richibouctou, de Nipisiguit, de Tracadigetche, les autorités ont cherché à faire succéder les noms usés de New Liverpool, de Bathurst, de Carleton. De là naissent souvent des méprises. L’année dernière, un bâtiment arrive d’Angleterre à Bonaventure; le capitaine, vieux marin, connaissait tous les recoins de la Baie des Chaleurs. Il demande où il pourra trouver Bathurst, lieu de sa destination, et il est tout étonné d’apprendre que le port de Bathurst n’est autre que celui de Nipisiguit, où il a déjà fait bien des voyages.
Au détour de la pointe de Bonaventure, nous rencontrons une berge ornée de banderoles et faisant route vers nous; elle porte les notables du lieu, accompagnés de quelques miliciens, qui, le mousquet à l’épaule, n’attendent qu’un signe pour commencer la fusillade. Les premiers montent sur la goélette, et nous informent, qu’elle ne peut entrer dans la rivière de Bonaventure qu’à marée haute et par un chenal tortueux et difficile. Sur leur invitation, nous profitons de la berge qui les a amenés, pour nous rendre à la pointe, près de l’embouchure de la rivière. L’église est placée à un mille de là, sur une étroite langue de terre, qui s’avance entre la mer et le barachois; elle est remarquable par sa propreté exquise, plutôt que par son architecture. En arrière, est un joli presbytère, habitation principale de M. H., dont la mission comprend le Port-Daniel, Paspébiac, Bonaventure et Cascapédiac.
Bonaventure est à huit lieues du Port-Daniel, à quatre de Paspébiac, et à six de Cascapédiac; ses habitants sont des Acadiens, à la physionomie douce et intelligente. Leur caractère et leurs habitudes, nous dit M. le missionnaire, s’accordent avec ces dehors prévenants. L’instruction élémentaire, répandue parmi eux, a produit et produit encore les résultats les plus satisfaisants pour le corps et pour l’âme. Il est digne de remarque que dans les deux ou trois endroits du district de Gaspé où l’on a établi des écoles, les habitants remplissent leurs devoirs civils et religieux, mieux que leurs voisins qui sont privés de ce grand avantage.
En 1762, treize familles acadiennes, qui, depuis deux ans, étaient traquées par les autorités anglaises, et vivaient dans les bois avec les sauvages, se décidèrent à se fixer sur les bords de la rivière de Bonaventure. Les premiers colons et leurs descendants se livrèrent particulièrement à la culture de la terre, et ne s’occupaient de la pêche que pour subvenir à leurs propres besoins. Le gouvernement tarda longtemps à leur donner des titres de possession; en 1792, ils ne les avaient pas encore reçus, car ils se plaignirent à cette époque de ce qu’on accordait à d’autres les terres qu’ils avaient défrichées et améliorées.
En général, les Acadiens vivent très-vieux, et laissent de nombreuses postérités. Une des familles qui se sont le plus anciennement établies en ce lieu, celle des Poirier, renferme plusieurs centaines d’individus. Un vieillard, nommé Forêt, aïeul de quelques habitants de Bonaventure, mourut, il n’y a pas fort longtemps, au Cap-Breton ou dans la Nouvelle-Ecosse, laissant après lui trois cent dix-huit descendants.
L’on rencontre encore à Bonaventure, bien des restes de ces familles patriarcales, qui autrefois cultivaient en paix les terres de l’Acadie, et rappelaient, par leur foi et la pureté de leurs mœurs, les temps primitifs du christianisme. Dispersés dans toute l’Amérique du Nord, les Acadiens conservent encore religieusement la mémoire de ces temps de bonheur, interrompus par un acte atroce de barbarie; ils n’ont pas oublié les circonstances qui accompagnèrent l’expulsion de leurs ancêtres. Les malheureuses victimes, qui la veille vivaient sous la protection des lois anglaises, furent poussées, la bayonnette dans les reins, sur les navires de Sa Majesté Britannique: on ne leur laissa point le temps de se vêtir; on ne leur permit point de rien emporter. Le mari fut séparé de sa femme, le frère de son frère, l’enfant de ses parents. Les uns furent jetés sur les côtes d’Angleterre; on débarqua les autres dans les colonies anglaises, qui se les renvoyaient de port en port. L’Acadie presque entière resta ainsi privée de ses habitants, jusqu’à ce que des colons d’origine britannique vinssent prendre les terres, les bestiaux, les maisons toutes meublées des malheureux exilés. L’expulsion des Acadiens fournit une des pages les plus sombres de l’histoire de la domination anglaise en Amérique.
Peu d’événements ont causé des aventures aussi romanesques, aussi curieuses, que le grand dérangement; c’est ainsi que les Acadiens ont nommé leur expulsion de la terre de leurs pères. Portant leur foi, leur probité et leur industrie dans les lieux où on voulut les laisser aborder, beaucoup d’entre eux s’établirent avantageusement; après nombre d’années, quelques-uns réussirent à trouver les parents dont ils avaient été séparés depuis l’enfance.
La religion formait le fond des institutions morales et politiques des Acadiens; chez eux tout se rattachait à la religion, tout était réglé par les préceptes de la religion; leur histoire est, pour ainsi dire, imprégnée du sentiment religieux. Qu’on compare, sur les événements de cette époque, les détails sèchement donnés par les officiers français et canadiens, avec les traditions conservées au sein des familles acadiennes, et l’on sera forcé d’admirer la vivacité et la simplicité de la foi qui soutenait ce peuple, au milieu de ses adversités.
En 1756, l’intendant Bigot écrivait au ministre: “M. de Boishébert qui commande sur la rivière, Saint-Jean, nous a envoyé le capitaine et l’équipage d’un bâtiment, qui transportait des Acadiens au nombre de deux cent cinquante hommes, femmes et enfants, du Port-Royal à la Caroline. Ce bâtiment, étant séparé par le mauvais temps, d’une frégate qui l’escortait, ainsi que d’autres navires aussi chargés de familles, les Acadiens se révoltèrent et obligèrent ce capitaine à les mener à la rivière Saint-Jean.”
Voilà le rapport officiel; voyons le récit du même fait, modifié par la piété catholique et par la confiance en la providence de Dieu. Je le donne comme je l’ai reçu d’un ancien habitant de Bonaventure, dont le grand père était avec sa famille, sur le navire mentionné par Bigot. “Un des navires anglais portait un bon nombre de ces bonnes gens. Peu de jours après qu’il eût laissé Port-Royal, une violente tempête s’éleva. Parmi les prisonniers, il y avait de vieux marins, qui entendaient la navigation, encore mieux que les Anglais. Désespérant de conserver le navire avec son faible équipage, le capitaine appella les Acadiens à son secours. Ceux-ci ne se firent pas prier; car il s’agissait de sauver leurs femmes et leurs enfants. Pendant le trouble causé par le vent et par la mer, les prisonniers délivrent leurs compagnons de captivité, s’emparent du capitaine et des matelots anglais, qu’ils relèguent à fond de cale, et prennent eux-mêmes la direction du navire. Libres, ils commencent par se jeter à genoux et récitent les litanies de la sainte Vierge. Puis ils se relèvent pleins de confiance, attachent au gouvernail un scapulaire, et invitent leur bonne mère à guider le navire, tandis qu’eux-mêmes feront la manœuvre. Et le navire fut si bien conduit, qu’au bout de quelques heures il arrivait dans la rivière Saint-Jean.”
La navigation, l’agriculture et la coupe des bois de construction occupent les Bonaventuriens. Les bois, qui se descendent dans la rivière de Bonaventure, sont achetés par la maison Gilmour, et transportés à Dalhousie, d’où on les expédie en Angleterre.
Juillet, 14.—La visite épiscopale s’est terminée aujourd’hui; elle semble avoir produit les meilleurs effets sur les braves gens du lieu. Vers le soir, nous retournons à la goëlette, qui nous attend près de la pointe où nous sommes descendus en arrivant.
Un original, moitié anglais et moitié français, nous reçoit sur le gaillard, avec les airs d’un gentilhomme qui fait les honneurs de sa maison. Il est partout, sur le pont, dans la chambre, à l’avant, à l’arrière; impossible de l’éviter. Il s’attache comme une sangsue à ceux qu’il peut saisir; il poursuit son homme, du geste et de la langue, des pieds et des mains, en anglais et en français. “C’est avec un regret infini,” répète-t-il, “que j’ai appris le départ de Paspébiac de monseigneur l’évêque, au moment même où je me disposais à le visiter. C’est un devoir pour moi, de témoigner mon respect aux personnages distingués qui visitent la Baie des Chaleurs; aussi ai-je fait aujourd’hui un voyage tout exprès pour voir Sa Grandeur.” La soirée s’avance, et l’on n’a pu encore secouer à terre l’importun visiteur; sans avoir égard aux civilités qu’il semble attendre, nous descendons au souper, laissant le bourgeois se siffler dans les doigts.—“Monseigneur, un mot, s’il vous plaît; outre le plaisir de vous saluer, je voulais avoir celui de vous présenter un beau quartier de veau; il est à vous, au prix de quatre chelins.”—“Je suis bien reconnaissant de votre politesse,” répond l’évêque, “mais c’est demain un jour maigre chez les catholiques, et nous n’avons pas besoin de viande fraîche pour observer l’abstinence.”
Après le souper, le brave homme nous attend près de l’escalier:—“Monseigneur, je reviens; je n’ai pu vendre mon veau, je vous prie de l’accepter en présent.”—“Que votre veau soit offert en vente ou en présent, nous n’en mangerons point demain. Comme vous n’avez rien à faire avec les scrupules des catholiques, le plus court moyen de vous en débarrasser serait d’en faire un dîner pour vos amis.”
Juillet, 15.—De grand matin, nous sommes au large; un temps calme et brumeux fait place, sur les dix heures, à un soleil brillant et à un vent léger qui nous pousse vers Cascapédiac.
C’est chose facile d’observer les jours maigres, quand on vit dans ces parages. Hier nous nous sommes pourvus de saumon à Bonaventure; aujourd’hui, en poursuivant notre route, nous faisons provision de morues, aux berges des pêcheurs, qui nous offrent les plus belles, à un chelin la douzaine.
Vers midi le vent fraîchit; nous dédoublons le cap Noir, et devant nous s’étend la belle baie de Cascapédiac, qui a treize milles de largeur sur cinq ou six de profondeur.
Mgr. de Sidyme est reçu par la population, réunie sur la grève. Au milieu de la foule, s’agite un gros matelot anglais, qui est évidemment un digne disciple de Bacchus. Il vaut à lui seul une compagnie d’artillerie. Un tison à la main, il se tient près du canon, aussi droit que le permettent ses jambes chancelantes; comme officier, il commande de faire feu; comme seul artilleur, il applique la torche à l’amorce; et, comme assistant, il applaudit par un vigoureux hurrah.
L’église de Cascapédiac est un joli édifice de bois, bâti par M. Painehaud, autrefois missionnaire dans cette partie du diocèse de Québec. Elle touche au presbytère, où réside un vieux gardien, qui est en même temps chantre et sacristain.
Tout auprès, coule le petit Cascapédiac, qui, avant de se jeter dans la baie, fait tourner les moulins de M. Cuthbert, riche marchand écossais. L’embouchure du grand Cascapédiac est à une demi-lieue plus loin. Ces deux rivières, dans la partie inférieure de leur cours, arrosent une vallée unie et fertile, qui s’enfonce entre les montagnes, et s’étend jusqu’à trois lieues de la mer. Plusieurs familles écossaises et irlandaises, attirées par M. Cuthbert, ont commencé à défricher la portion la plus reculée de la vallée, et sont très-satisfaites de leurs premières récoltes. Cependant la masse de la population à Cascapédiac est d’origine française comme dans tous les autres lieux que l’évêque a visités sur la côte. De fait, même après l’établissement de petites colonies anglaises, à Douglastown et à New-Carlisle, la majorité des habitants de la Gaspésie a toujours été française et catholique. En 1793, M. Fromenteau, qui avait parcouru tout le pays, écrivait au juge en chef de la province du Bas-Canada: “Les cinq huitièmes des habitants du district de Gaspé sont acadiens et canadiens; le reste est de nations mêlées; les catholiques romains forment les trois quarts de la population.”
Juillet, 16.—Une belle pointe, couverte de pins, s’avance entre les deux rivières de Cascapédiac; c’est un des sites les plus agréables de toute la Gaspésie. La large baie de Cascapédiac, les rives verdoyantes des rivières, les montagnes de Maria, qui se terminent par la cime élevée du mont Tracadigetche, forment un tableau plein de noblesse et de grandeur.
Au delà du grand Cascapédiac, est un petit village de sauvages micmacs, établis sur un terrain de huit cents arpents, que le gouvernement a réservé pour leur usage, quand les terres voisines ont été vendues. Cet établissement parait être une dépendance du village de Ristigouche.
On nous désigne sur l’autre côte de la Baie des Chaleurs, une terre fort basse. C’est l’île aux Hérons, où, le printemps dernier, les pêcheurs des environs ont trouvé le hareng en grande abondance. Jusqu’à présent, la pêche au hareng avait été négligée, parce que l’on aimait mieux s’occuper du saumon et de la morue. Aujourd’hui que ces deux dernières espèces deviennent rares vers le fond de la baie, il y aurait plus d’avantage à faire la pêche au hareng, sur une plus grande échelle. Ce poisson, qui, il y a trois ou quatre cents ans, enrichissait les Hollandais, qui aujourd’hui donne des profits considérables sur les côtes de l’Angleterre et de l’Ecosse, pourrait devenir un objet important de commerce dans ce pays. Un écrivain du règne de Jacques I. prétend qu’en une seule année les Hollandais vendirent un million et soixante huit mille barils de hareng, et qu’ils en retirèrent une somme d’un million cinq cent dix-sept mille livres sterling. Outre ce qui fut ainsi vendu, il en fut consommé dans le pays pour une valeur de plusieurs centaines de milliers de louis.
On conserve le hareng, soit en le salant, soit en le fumant. Le poisson conservé par le premier procédé se nomme chez les Anglais, white ou pickled fish. Le mot de pickle, suivant quelques étymologistes, serait dérivé de Beauklen, nom d’un flamand, qui, le premier découvrit le secret de conserver le hareng en le salant. Pour reconnaître le service rendu au commerce par cette découverte, les états de Hollande érigèrent une statue à Beauklen, mort en 1397.
Pour fumer le hareng, on le laisse dans la saumure pendant vingt-quatre ou trente heures, après quoi on l’attache par la tête, et on l’expose à la fumée. Pour être bon, disent les Hollandais, il doit être gros, gras, huileux et mou. A Bonaventure et à Cascapédiac, l’on fume beaucoup de hareng; il serait peut-être mieux de le saler, car celui qu’on prend dans la Baie des Chaleurs est généralement fort maigre.
L’on prétend avoir découvert des huîtres près du cap Noir. Les eaux étant devenues très-basses, il y a plusieurs années, des pêcheurs crurent en apercevoir un banc, à une profondeur de deux brasses. Jusqu’à ce jour, cependant, Caraquet est le seul endroit de la Baie des Chaleurs qui en ait fourni.
Poussée par une brise de grand largue, la Sara fuit rapidement vers Carleton. La mer est houleuse, et frappe fortement contre le flâne de la goëlette. Tandis que M. N., étendu sur le pont, jouit des douceurs du sommeil, une vague vient se déployer sur lui, et l’inonde de la tête aux pieds. Le brave dormeur se soulève sur le coude, ouvre un œil pour s’assurer qu’il n’a pas été emporté à la mer, secoue son manteau, se retourne et ronfle.
Au bout d’une heure et un quart, nous avons parcouru les quinze milles qui séparent Cascapédiac de Carleton, et nous jetons l’ancre vis-à-vis de ce dernier endroit.
[48] La mère Christine est encore bien vivante, et toujours disposée à faire entendre sa voix. Elle se rappelle avec plaisir le temps où elle commandait la milice, quand Monseigneur Turgeon visita le Port Daniel: c’était alors un temps comme on n’en voit plus aujourd’hui. Et les miliciens donc! ce n’étaient pas des freluquets comme à présent; ça savait munier le fusil et obéir au commandement.
[49] Depuis qu’un missionnaire réside au Port-Daniel, une amélioration sensible s’y est produite, et au temporel et au spirituel.
[50] La compétition a opéré de grandes améliorations dans l’état des choses, depuis que la maison LeBouthillier a établi des magasins à Paspébiac.
———
Carleton—Un musée—Dalhousie—Un combat naval sur le Ristigouche—François Coundeau—Village de Ristigouche—Traditions—Pitre Baskette et son canot d’écorce.
Carleton, ou Tracadigetche, ressemble aux paroisses du district de Québec. Pour ses habitants, la pêche est d’une importance secondaire; l’agriculture forme leur principale occupation. Des chemins bien entretenus permettent de voyager en voiture, dans toute l’étendue de Carleton; aussi chaque cultivateur possède cheval et charettes, tant pour les voyages et les promenades, que pour les travaux de la terre. C’est un luxe que nous n’avons pas encore rencontré dans la Gaspésie.
Après la dispersion des Acadiens, quelques familles, originaires de Tracadie, poussèrent jusqu’à ce lien-ci, qu’elles nommèrent Tracadigetche ou petite Tracadie. Ce fut le noyau autour duquel se réunit la population actuelle.
Maria, Carleton et Mégouacha, qui forment cette mission, renferment environ treize cents âmes. Les deux derniers cantons sont presque entièrement peuplés par des Acadiens, tandis que le premier est occupé par des Irlandais. A Maria, entre la mer et le pied des montagnes, l’on trouve deux ou trois rangées de terres, qui peuvent être aisément cultivées: mais, à Carleton, le premier rang atteint le flanc du mont Tracadigetche, dont les aspérités ne sont guère propres à tenter le laboureur.
M. le missionnaire, qui ne nous attendait pas sitôt, est encore à Ristigouche, occupé à préparer les sauvages pour la visite épiscopale. Hier un canot léger a été expédié pour lui annoncer que l’évêque de Sidyme était à l’entrée de la baie des Chaleurs, car on croyait la Sara au Port Daniel, quand elle a paru dans le havre.
M. M., missionnaire de Carleton, a formé un cabinet d’histoire naturelle, riche en productions minérales et zoologiques de cette portion du pays. Les oiseaux de la mer y sont perchés à côté des habitants de la forêt; les poissons nagent dans l’air, soutenus par les instruments qui les ont arrachés aux douceurs de la vie aquatique; l’écorce, qu’une matrone micmaque a ornée de symboles et de fleurs en poil de porc-épic, est suspendue aux armes du guerrier. Le tomahawk, la massue, les haches, les têtes de flèches, les longs calumets de paix et de guerre se croisent, au-dessus du bonnet coquet de la fille sauvage, et du capot orné de rasades que le faraud micmac porte aux grandes solennités. Les fourneaux des calumets ont été taillés par les sauvages, qui emploient une pierre, molle au sortir de la carrière, mais se durcissant à l’air et prenant une teinte fort noire. Dans des corbeilles du pays, sont déposés les minéraux que M. M. s’est procurés pendant ses courses scientifiques. Il a surtout réuni un grand nombre d’agates, pierres fort abondantes sur les côtes de la Gaspésie. Les pointes de flèches sont formées d’un silex blanchâtre; souvent la charrue en déterre au milieu des champs sur la pointe à Bonami, où les sauvages ont été autrefois dans l’habitude de séjourner.
Devant l’église de Carleton est un grand barachois, de même forme que celui de Paspébiac; l’eau y est presque partout d’une profondeur de quatre à cinq pieds. Lorsque la mer agitée par le vent vient se briser avec furie sur le banc de sable, à quelques toises des vagues irritées s’étend ce bassin, toujours calme et paisible. N’est-ce pas l’image de l’homme juste, qui reste impassible au milieu des agitations du monde et des tempêtes de la vie?
Juillet, 17.—Pendant l’office du matin, M. le missionnaire arrive, tout surpris de nous trouver à l’œuvre, alors qu’il nous croyait encore bien éloignés. Les exercices de la visite se font ici avec plus de dignité que dans les missions voisines; la sacristie est abondamment fournie d’ornements, les clercs sont adroits, l’église est plus grande qu’aucune de celles que nous avons vues jusqu’à présent dans la Gaspésie.
Quelques bourgeois résident à Carleton, et parmi eux sont des avocats qui, lorsque la cour siège, vont à New-Carlisle discuter le pour et le contre avec leurs confrères du lieu. Quoique le désir d’obtenir justice engage à s’adresser à ces messieurs, les plaideurs ne sont pas toujours satisfaits des résultats. “Autrefois,” nous disait un ancien cultivateur, “nous vivions en paix; s’il s’élevait un différend entre voisins, deux experts avaient bientôt arrangé l’affaire. A présent qu’il y a des avocats, il n’y a plus moyen de s’accorder. Il faut en revenir aux experts et laisser les cours. Voyez, par exemple: le docteur LaB. avait établi une pêcherie à saumon; pour se maintenir dans ses droits, il fut obligé de plaider avec son voisin, pendant plusieurs années. Comme la décision n’arrivait point, les plaideurs convinrent de s’en rapporter au jugement de trois arbitres. Au bout d’une heure, l’affaire était conclue à la satisfaction des deux parties. Tenez, si l’on voulait nous en croire, la cour remonterait bien vite à Québec.” Cette mauvaise humeur des plaideurs tombe, non sur les particuliers, qui sont des hommes honorables, mais sur le système d’administration de la justice, propre à multiplier les frais et à retarder l’époque du jugement.
Juillet, 21.—Nous entrons dans la rivière de Ristigouche. A notre gauche, est une terre basse, qui appartient au Nouveau-Brunswick; c’est la pointe à Bonami. Vis-à-vis, sur le côté du Canada, est le cap de Mégouacha. Ce nom sauvage signifie longtemps rouge, et désigne la couleur de la terre; la teinte rougeâtre du sol s’étend sur une grande partie des côtes.
La pointe la plus avancée de Mégouacha porte quelques arbres, qui, de mémoire d’homme, ont toujours servi de refuge à des familles de corbeaux. Ces oiseaux, d’un noir brillant, sont beaucoup plus gros que les corneilles, et ne se rencontrent nulle part ailleurs, autour de la Baie des Chaleurs. Ils paraissent attachés à ce coin de terre, que leur tribu a sans doute habité depuis longtemps; aussi, quand ils voient approcher des maraudeurs, ils ne manquent point de protester contre les envahissements de l’homme, par des coassements bruyants et prolongés.
A un mille de la pointe à Bonami et sur la même rive, est la ville de Dalhousie, renfermant une trentaine de maisons. L’année dernière, soixante bâtiments y ont pris des chargements de bois. Une petite île située à quelques arpents de la terre ferme, met les navires, à couvert des vents. Près de cet îlot, sur une pente assez raide, est placée la ville naissante qui, par sa position avantageuse, pourra un jour acquérir de l’importance. Les rivières qui se jettent dans le Ristigouche arrosent une grande étendue de pays, aujourd’hui couvert de beau bois et renfermant des terres fertiles. Quand cette contrée sera ouverte à la culture, Dalhousie sera le centre d’un vaste commerce d’importation et d’exportation. Située au fond de la baie des Chaleurs, à l’embouchure d’une rivière, qui a ici une lieue de largeur et peut porter les plus gros navires, entourée de pêcheries abondantes, jouissant d’un climat salubre, cette ville réunit des avantages qui manquent à beaucoup de villes considérables de l’Amérique anglaise.
Nous mouillons devant Dalhousie. Mgr. de Sidyme demeure à bord, tandis que, poussés par la curiosité, ses compagnons de voyage mettent pied à terre, pour visiter la future capitale du pays de Ristigouche. Les habitants du Nouveau-Brunswick, comme leurs voisins, les Yankees, créent une ville à peu de frais; maint village du Canada renferme une population double et triple de celle de Dalhousie, sans aspirer cependant au titre de ville. Dalhousie est encore une cité microscopique, dont la rue principale, bordée de douze maisons, conduit à une hauteur, capitole futur de cette nouvelle métropole.
De la pointe à Bonami, on nous allons voir quelques familles sauvages sous leurs tentes, nous suivons la grève pour arriver au village de la Rivière-à-l’Anguille, qui, ainsi que Dalhousie et Ristigouche, est desservi par M. le missionnaire de Carleton. Malheureusement pour nous, un rocher s’avance dans la mer et nous barre le chemin. Reculer cette masse est impossible; nous jeter à l’eau, ne nous convient guères. Retourner sur nos pas? ce procédé ne paraît point honorable à un des voyageurs, qui entreprend d’escalader le cap, taillé presque perpendiculairement. Il grimpe, en s’aidant des pieds et des mains; mais à peine est-il arrivé au milieu de la montée, qu’une pointe de rocher cède sous son poids, et trois pirouettes conduisent l’aventureux individu dans l’onde amère.
Comme l’eau est peu profonde, le danger n’est pas grand. Une berge vient nous chercher pour nous déposer au village, où notre joyeux ami reste après nous, afin de faire sécher ses habits.
Pendant que nous sommes arrêtés à Dalhousie, M. MacDonald, nommé administrateur du diocèse de Charlotte-town après la mort de l’évêque MacEachern, arrive de Nipisiguit pour inviter Mgr. Turgeon à visiter la côte méridionale de la Baie des Chaleurs, qui fait partie du Nouveau-Brunswick. Ayant reçu une réponse favorable, il repart aussitôt, afin d’aller préparer les populations des villages acadiens à la visite épiscopale.
Dalhousie est à quatre lieues de Carleton, et à six lieues du village sauvage de Ristigouche, où il nous faut remonter par la rivière qui porte le même nom. Nous laissons la petite ville, vers trois heures, et quoique le vent ne soit point favorable, nous faisons route à l’aide de la marée; vers sept heures du soir, le reflux nous force à jeter l’ancre vis-à-vis de la pointe à la Batterie.
Les rayons argentés de la lune se jouent sur les eaux, légèrement agitées par une faible brise. En amont et en aval de la Sara, une bande scintillante marque le cours de la rivière; sur les côteaux voisins descend une lumière plus pâle et plus égale, qui en fait ressortir les contours; quelques maisons blanches se détachent çà et là sur les massifs assombris de la forêt. Ce demi-jour répandu dans les airs laisse errer un vague mystérieux sur les eaux et sur la terre.
Sauf le murmure des conversations parmi les passagers, et les aboiements d’un chien du Nouveau-Brunswick, auxquels répond l’écho de la rive canadienne, un calme solennel règne autour de nous. Et ces lieux si beaux, si paisibles, où l’homme n’a dû se livrer qu’aux travaux de la pêche et aux amusements de la chasse, peuvent néanmoins fournir l’occasion de s’écrier avec Virgile:
....................Bella, horrida bel’a,
El Tyberim multo spumantem sanguine cerno.
Les horreurs de la guerre ont jadis troublé ces eaux, qui aujourd’hui coulent silencieuses sur les ossements des guerriers d’un autre siècle. En ces lieux, l’orgueil, la haine, l’amour de la gloire, le dévouement à la patrie ont vivement disputé la palme de la victoire.
C’était au printemps de 1760; Québec avait été pris l’automne précédent. Pressée par le marquis de Vaudreuil, la cour de Versailles envoyait de faibles et tardifs secours au chevalier de Lévis, qui était décidé à tenter une attaque contre Québec. La flotille française s’était amusée en route à poursuivre quelques navires ennemis; aussi fut-elle dévancée par les vaisseaux anglais, qui lui barrèrent le passage à l’entrée du fleuve Saint-Laurent. Elle se jeta alors dans la Baie des Chaleurs, et remonta la rivière Ristigouche, où le commandant, M. de Danjac, trouva quinze cents personnes, réfugiées sur ces bords, et vivant dans un état déplorable de misère. Le capitaine Byron, probablement le célèbre navigateur, grand père du poète de ce nom, s’avança avec les vaisseaux le Fame, le Dorsetshire, l’Achille, le Scarborough et le Repulse, pour attaquer la flotte française, qu’il rencontra le huit juillet, à peu près dans cette partie du Ristigouche. Elle était composée du Machault, de trente-deux canons; de l’Espérance, de trente; du Bienfaisant, de vingt-deux; du Marquis de Marloze, de dix-huit. Les Français s’étaient préparés à recevoir chaudement l’ennemi; leurs vaisseaux étaient protégés par la pointe à la Batterie, où plusieurs canons avaient été mis en position. Plus bas, à la pointe à la Garde, d’où la vue s’étend jusqu’à l’embouchure du Ristigouche, était un piquet de soldats, qui avaient ordre de veiller sur le cours de la rivière et d’avertir de l’approche de la flotte anglaise.
Favorisés par un bon vent, les vaisseaux de Byron remontèrent sans obstacle, jusqu’à la pointe à la Batterie, où une vive canonnade s’engagea. Deux bâtiments français furent mis hors de combat, et les canons de la batterie réduits au silence; le Bienfaisant et le Marquis de Marloze durent alors se retirer vers le village sauvage, tandis que les Anglais s’avançaient jusqu’à la pointe à Martin, sur la rive opposée, où ils souffrirent beaucoup du feu de quelques canons placés à fleur-d’eau. Cependant, leur artillerie supérieure criblait les vaisseaux français; un de ceux-ci fut poussé au rivage, près de la chapelle de Ristigouche, tandis que le commandant de l’autre mettait le feu aux poudres, afin de l’empêcher de tomber aux mains des Anglais.
Resté maître du champ de bataille par la destruction de la flotte ennemie, Byron fit détruire un amas de cabanes, décoré du nom de la Nouvelle-Rochelle et situé sur la pointe à Bourdo, à trois milles au-dessus du village de Ristigouche. Pendant ce temps les Français et les Micmacs se réfugiaient dans les bois, où ils attendirent en sûreté le départ de la flotte anglaise.
L’imagination reporte fortement vers ces scènes animées et terribles, quand on se trouve sur le théâtre même de la lutte. Les vaisseaux des deux nations rivales, se croisant, se fuyant, se rapprochant; leurs longs pavillons qui flottent dans les airs et portent un défi à l’ennemi; au milieu des broussailles du rivage, ces troupes sauvages, grotesquement coiffées et habillées; ces caps arides, surmontés du drapeau blanc et défendus par des pièces d’artillerie, dont la gueule s’allonge hors des meurtrières pour vomir le feu et la mort; ces nuages de fumée roulant sur les eaux et dérobant aux combattants la vue du ciel; les craquements des mâts qui se brisent, les sifflements aigus du commandement; le bruit de la mousqueterie et du canon, les cris de la victoire, de la douleur, et de la rage: voilà les parties du drame qui se jouait, il y a soixante-quinze ans, sur le théâtre resserré, au milieu duquel nous nous trouvons. C’était un des épisodes de la longue rivalité entre la France et l’Angleterre.
Juillet, 22.—De grand matin la Sara louvoie, mais avec précaution, car le chenal du Ristigouche n’a ici qu’un quart de lieue de largeur. Sur la rive droite, loin devant nous, danse sur les eaux un groupe de maisons blanches: c’est Campbelltown, ou la Pointe-à-Martin, petite ville qui s’est élancée dans le monde, depuis trois ou quatre ans. De l’autre côté, sur la rive canadienne, est la pointe à la Croix, propriété de M. Christie, ancien membre du parlement provincial; un peu plus loin s’avance la pointe de Ristigouche, sur laquelle se trouve le village sauvage.
Trois chefs micmacs ont été députés pour offrir les hommages de leurs frères à Mgr. de Sidyme. François Coundeau, premier chef, est un peu courbé sous le poids de ses soixante-quinze ans. Il porte sur sa poitrine deux médailles d’argent: l’une lui fut donnée quand il devint chef; l’autre a appartenu à son père. Thomas Barnabé, le second chef, est un homme actif et intelligent; c’est le marchand et l’homme d’affaire du village; sa sobriété et sa prudence lui ont procuré une aisance inconnue à ses compatriotes. José Marie, troisième chef, n’est remarquable que par un air de douceur, qu’on rencontre assez souvent chez les Micmacs. Il réside ordinairement au village de Cascapédiac.
Malgré son extrême pauvreté, François Coundeau a conservé toute sa fierté sauvage. Fils et petit-fils de chefs, il ne reconnaît autour de lui que des inférieurs. Avec lord Dalhousie seul, il consentit à communiquer sur un pied d’égalité, lorsque ce haut personnage, alors gouverneur général du Canada, visita le village de Ristigouche. En adressant à l’évêque de Sidyme un discours en langue micmaque, Coundeau conserve un sang froid imperturbable. A quelques pas de lui, on tire le canon de la goélette; un mouvement involontaire se manifeste chez ceux qui l’entourent, mais la secousse ne produit pas la plus légère impression sur ses nerfs. Un grand chef ne se dérange pas pour si peu.
On l’a vu, après une marche de plusieurs jours, pendant lesquels il n’avait eu rien à manger, passer au milieu de framboisiers couverts de fruits, sans daigner se pencher pour en cueillir. “Il n’y a que les femmes,” disait-il, “qui se baissent pour manger des fruits.”
Un jour qu’il remontait au village, un vent contraire soufflait avec violence et empêchait son canot de doubler une pointe. En s’asseyant, Coundeau offrait moins de prise au vent; mais, suivant lui, un chef ne doit point plier devant l’ennemi. Debout, il continua à lutter contre la force qui lui résistait; neuf fois il fut repoussé sans perdre courage. Enfin sa persévérance l’emporta; et, à la dixième tentative, il doubla la pointe, sans avoir eu la honte de s’asseoir en face du vent.
“François,” lui disait M. F., alors missionnaire de Ristigouche, “pourquoi n’as-tu pas appris le français?”—Je n’en ai pas besoin.—Comment fais-tu quand tu es sans vivres, au milieu des habitations canadiennes?—Oh! voilà tout ce qu’il me faut: Ti pain; té l’eau; t’la fiande. Un capitaine n’a pas besoin d’en savoir plus long.
Coundeau a toute l’imprévoyance sauvage et ne s’occupe jamais du lendemain. “Coundeau,” remarquait Thomas Barnabé, “a moins d’esprit que le goélan; le goélan connaît le temps du hareng, mais Coundeau ne connaît pas le temps où il doit faire ses provisions.”
Dès que les chefs sont montés sur la goélette, une vive fusillade retentit sur le rivage. A travers la fumée, apparaissent tantôt un bras armé d’une baguette, tantôt une tête de micmac soufflant dans un canon de fusil, tantôt un groupe de chiens qui, le nez au vent, hurlent de toute la force de leurs poumons. De son côté, la pièce d’artillerie du village fait entendre sa grosse voix. Ce lourd individu, jadis défenseur d’une frégate française, fut encloué en même temps que plusieurs de ses confrères, lorsque ses anciens maîtres jetèrent leurs vaisseaux à la côte. Un sauvage a rendu la voix à celui-ci, en débouchant la lumière.
A neuf heures du matin, nous débarquons près de la chapelle, Messieurs et mesdames de la tribu, tous en grande tenue, sont rangés sur la grève, pour recevoir la bénédiction épiscopale. Monseigneur de Sidyme dit la messe, pendant laquelle Benjamin LaBauve, aidé de son père, de ses frères et de ses cousins, chante quelques prières en langue micmaque. Presque tous les hommes du village se mêlent de chanter, et la plupart s’en tirent assez bien: mais la voix douce et mélancolique de Benjamin attire surtout notre attention.
La famille LaBauve est renommée dans tout le pays par les bons chantres qu’elle a produits. Le père de Benjamin, grand et vigoureux vieillard de soixante-douze ans, conserve encore quelques restes d’une voix autrefois magnifique. Sous ce rapport, son fils et son petit-fils soutiennent dignement la réputation du père. Dans la bouche de Benjamin LaBauve, les chants de l’église, déjà si beaux par leur gravité et par la simplicité de leur cadence, se revêtent d’un charme particulier, que leur communiquent l’organe du chantre et la douceur de la langue micmaque. Lorsque, sous cette humble voûte, noircie par les années, et consacrée par les prières des premiers chrétiens de la Gaspésie, les descendants des enfants de la forêt entonnent des cantiques de douleur et de repentir, où quelque prière pour les morts, la pensée se reporte avec tristesse sur ce peuple, jadis maître de toute la contrée, et aujourd’hui disparaissant rapidement en présence de la civilisation européenne.
La plupart des cahiers de chant dont se servent les Micmacs sont dûs à un des anciens missionnaires de la nation, M. Maillard, mort à Halifax en 1768, après avoir longtemps instruit, édifié et protégé ses ouailles. Quelques-uns des manuscrits sont en lettres romaines, les autres en caractères dont chacun représente une syllabe ou un mot. Aucun européen n’a jamais su le micmac aussi bien que M. Maillard; ce vénérable prêtre a laissé sur cette langue des instructions et des règles, qui ont été d’un grand service aux missionnaires chargés de continuer son œuvre.
Juillet, 23.—Du pied des hauteurs qui sont en arrière du village, le terrain s’abaisse insensiblement et se termine à la pointe où est la chapelle. De cet endroit, la vue est magnifique. D’un côté, en remontant, la rivière s’élargit considérablement et ressemble à un lac; vis-à-vis, est Campbelltown avec ses jolies maisons, ses navires, ses longs trains de bois; sur la gauche, se déploie le cours inférieur de la rivière, que l’œil suit jusques près de Dalhousie. Dans cet espace de cinq lieues de longueur, le Ristigouche coule entre deux chaînes de côteaux, tantôt couronnés de beaux arbres, tantôt couverts de riches moissons, au milieu desquelles s’élève la cabane du pauvre colon, ou la demeure plus confortable du bourgeois cultivateur.
Campbelltown a dévancé Dalhousie, sa sœur aînée. Il renferme environ cinquante maisons et une chapelle presbytérienne. L’an dernier, trente-cinq ou quarante navires y ont pris des chargements de bois. En effet, depuis les grands incendies qui ont dévasté une vaste étendue des forêts du Nouveau-Brunswick, une partie du commerce de Miramichi s’est réfugiée dans le Ristigouche. A tous les avantages que possède Dalhousie, Campbelltown en joint un autre qui peut lui devenir fort utile, celui d’être plus avancé dans l’intérieur du pays. Relégué au fond des bois, le défricheur, qui trouvera des marchandises à bon compte dans une ville voisine, ne se donnera pas la peine de parcourir encore cinq lieues, pour acheter au même prix des objets semblables. Il viendra au lieu le plus proche échanger ses denrées contre les produits des pays étrangers; le commerce de l’intérieur s’y concentrera, et finira par y attirer le commerce du dehors.[51]
Cependant le site du village micmac était beaucoup plus avantageux pour la création d’une ville; son beau plateau était bien préférable au terrain raboteux, sur lequel est bâti Campbelltown. La pointe des sauvages s’avance en eau si profonde, que les navires y peuvent mouiller à quelques pieds de terre, tandis qu’ils ne peuvent approcher du rivage opposé.
Lorsque lord Dalhousie visita le Ristigouche, il offrit aux Micmacs, en échange de l’emplacement de leur village, des terres qui avoisinent le lac Métapédiac, et de plus une rente annuelle de six cents louis. L’offre était avantageuse; avec l’assurance d’une somme d’argent fort importante, ils devenaient maîtres d’un lac où le saumon monte en abondance dans la saison du frai. Or, pour eux, la pêche au saumon est une occupation favorite et un moyen de subsistance. En se transportant au lac Métapédiac, ils s’éloignaient d’une ville, qui tôt ou tard finira par corrompre leurs mœurs, ils se mettaient à l’abri des empiètements des blancs et occupaient le centre d’un pays de chasse.
Ils ne purent néanmoins se résoudre à abandonner les ossements de leurs pères. Qu’arrive-t-il aujourd’hui? Ils ne permettent pas aux blancs de se bâtir des maisons dans leur village; mais les propriétaires voisins ont empiété considérablement sur le terrain réservé pour la tribu. Ainsi, les terres des Micmacs qui devaient avoir quarante arpents de longueur, n’en ont plus que dix ou douze, parce qu’on les fait couper par une ligne diagonale. Des commissaires, nommés par le gouvernement pour s’enquérir des injustices dont se plaignaient les sauvages, donnèrent une opinion défavorable à leurs prétentions. Cependant, par une distinction assez singulière, ils laissèrent, à la terre réservée pour l’usage du missionnaire, une profondeur de quarante arpents, tandis que les deux terres voisines n’ont que le tiers de cette longueur.
A l’arrivée des Européens, les Micmacs ou Souriquois habitaient le pays qui forme aujourd’hui les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse; ils s’étendaient dans la Gaspésie, ainsi que dans les îles du Cap-Breton et du Prince-Edouard. Rien n’est connu de leur histoire avant les temps où ils furent visités par les Français. Peu nombreux, comme les autres peuples du nord de l’Amérique, ils occupaient des villages fort éloignés les uns des autres, et situés près de l’embouchure des grandes rivières du pays. La nation jouissait ainsi des avantages que lui offraient la mer, les rivières et les forêts.
Il existe parmi les Micmacs de Ristigouche une tradition, qu’ils font remonter à une époque éloignée, mais à laquelle on ne peut guères se fier aujourd’hui; car les sauvages, dans leurs souvenirs historiques, confondent souvent les temps et les lieux, et rattachent ensemble des faits qui se sont passés à des époques bien différentes.
Quoiqu’il en soit, voici ce que quelques anciens racontent. Les Micmacs établis à Ristigouche vivaient dans l’abondance et étaient devenus nombreux. Quelques familles, poursuivies par la faim et la misère, arrivèrent un jour sur les bords de la rivière. Elles appartenaient à une nation éloignée, dont elles avaient été violemment séparées. Humbles et faibles, elles demandèrent la permission de s’établir sur la rive droite du Ristigouche, et de vivre sous la protection de leurs puissants voisins de la rive gauche. Les guerriers étrangers se firent connaître aux Micmacs, sous le nom de Codesques; ils appartenaient réellement à la nation des Agniers, et avaient été attirés dans le pays par l’abondance du saumon et du gibier.
Bien des fois les feuilles des arbres tombèrent et les neiges se fondirent; et le village codesque était toujours là, vis-à-vis du village micmac. Mais enfin les quelques familles étrangères avaient fini par former une peuplade nombreuse, dont les guerriers étaient aussi courageux dans les combats que rusés dans les conseils.
Un jour plusieurs enfants des deux nations chassaient ensemble; un écureuil noir tomba sous leurs coups; c’était un objet curieux que chaque parti réclama. Personne ne voulut céder, et une rixe éclata entre les petits Codesques et les jeunes Micmacs. Moins nombreux que leurs rivaux, les premiers eurent le dessous, et coururent au village demander du secours à leurs ainés, tandis que les Micmacs en faisaient autant de leur côté.
Une fois que la pomme de la discorde a été lancée dans l’air, les sauvages ne la laissent pas aisément retomber à terre. Trente Micmacs étaient dans le haut du Ristigouche, occupés à darder et à fumer le saumon. Un parti codesque tombe sur eux à l’improviste, et les massacre tous, à l’exception de Tonnerre, chef renommé, qui se jette dans la rivière et s’échappe à la nage.
La hache de guerre était levée; le sang s’était mêlé aux eaux du Ristigouche; des combats presque journaliers succédèrent au premier massacre. Quelquefois les guerriers ennemis, du milieu de leurs villages éloignés d’un tiers de mille, s’amusaient à se lancer des flèches, exercice qui, sans causer de mal, servait à entretenir la haine; c’était le canon de Douvres envoyant des boulets vers les côtes de France. Le plus souvent ils se poursuivaient et se surprenaient dans la profondeur des forêts. Depuis la Baie des Chaleurs, jusqu’aux bords du Saint-Laurent, les partis de guerre se multipliaient et portaient l’épouvante et la mort dans les solitudes de la Gaspésie.
Du côté des Micmacs, était la supériorité du nombre; du côté des Codesques, l’astuce, le courage, l’activité. Après une résistance opiniâtre, prolongée pendant plusieurs générations, les Codesques, réduits à une poignée de guerriers, éteignirent leurs feux, abandonnèrent leur pays de chasse, et s’enfoncèrent dans les terres pour se rapprocher des tribus iroquoises. Pendant bien des années, cependant, ils continuèrent de temps en temps à faire des visites hostiles à leurs anciens voisins.
Les Micmacs restèrent les maîtres du pays, mais après avoir vu diminuer considérablement la population de leur village. Le souvenir de ces luttes s’est conservé si frais et si terrible, que, vers le commencement du siècle présent, un mystificateur, ayant répandu le bruit que les Codesques étaient en marche pour surprendre le village de Ristigouche, plongea toute la population dans l’émoi. Les femmes et les enfants s’enfuirent, tandis que les guerriers couraient aux armes, afin de repousser les envahisseurs qui ne se montrèrent point.
Doux, inconstants, pauvres par suite de leur indolence, ces sauvages ont peine à se maintenir dans le pays, où ils furent jadis nombreux et puissants. Possesseurs de terres fertiles, ils ne les cultivent pas, préférant se procurer une nourriture précaire par la chasse et par la pêche.
Autrefois des masses mouvantes de saumons remontaient le Ristigouche, dans la saison du frai; mais, depuis que des rets forts grands barrent la rivière dans toutes les directions, ce poisson ne paraît plus avec la même abondance, et peu de saumons peuvent arriver aux eaux mortes. Des lois ont été faites pour arrêter la destruction de cette source intarissable de richesses; ces règlements sont souvent éludés par ceux qui ont charge de les faire observer. N’ayant point les fonds nécessaires pour se procurer des rets, les sauvages se contentent du dard; aussi leur pêche est rarement abondante.
Qu’un saumon soit gros on qu’il soit petit, le micmac en demande toujours le même prix; il lui faut un écu. Lui représente-t-on qu’un petit saumon ne devrait pas coûter aussi cher que celui dont le poids est double ou triple: “Ecoute,” répond-il: “je le prends comme le bon Dieu l’envoie; et j’ai autant de peine à en darder un petit, qu’un gros. S’il ne pèse pas d’avantage, ce n’est pas ma faute.”
Les Micmacs ont conservé leur langue. Beaucoup d’entre eux cependant parlent l’anglais, et quelques-uns le français. Le costume de leurs ancêtres commence à être mis de côté par les hommes; les femmes au contraire conservent soigneusement les vêtements sauvages. Bonnet pointu, mantelet ouvert, jeté par-dessus les habits de dessous; machicôté, ou jupon formé d’un coupon de drap, et recouvert de mousseline dans les grandes occasions; mitasses, souliers de peau de chevreuil, garnis de rasades et de figures en poil de porc-épic: voilà la toilette des filles et des matrones, toilette que chacune d’elles diversifie, selon son goût et ses moyens. Tous ces ornements sont aujourd’hui étalés en l’honneur du grand patriarche.
L’apparence du village de Ristigouche est misérable. Quelques cabanes sont éparses de côté et d’autre, entre des bouquets de coudriers; point de rues, mais d’étroits sentiers, serpentant d’une habitation à l’autre. Cependant la terre est si fertile, qu’elle menace d’étouffer ses maîtres sous la vigoureuse végétation dont elle se couvre, tandis que ceux-ci restent flâneurs et nécessiteux, au milieu de champs qui ne demandent qu’à produire.
Juillet, 24.—Aujourd’hui, dimanche, la grand’messe et les vêpres sont chantées solemnellement. A l’office de l’après-midi, MM. F. et M. nous régalent de sermons en langue micmaque, que l’auditoire écoute avec un profond recueillement. A la messe et aux vêpres, assiste une foule considérable, accourue de tous les environs, et même de Carleton. Les pèlerins de ce dernier endroit sont venus sur la goélette du capitaine P., mouillée tout près de la Sara. Outre le désir de conduire ses amis à Ristigouche, le capitaine avait un autre objet en vue, quand il s’est rendu ici. Comme il a entendu louer la goélette du capitaine V., il voudrait nous prouver que son brick, l’Hubert Paré, est meilleur voilier.
Après les offices, monseigneur de Sidyme regagne son logis flottant, entre deux longues files de machicotés et de capots sauvages. Pas un souffle de vent dans l’air; il faut donc se résigner à passer la nuit près de la pointe de Ristigouche.
M. Christie, ancien membre de la législature du Bas-Canada, vient visiter l’évêque; il est accompagné de deux ministres presbytériens, l’un desservant de Miramichi, l’autre de Campbelltown. Celui-ci est un écossais, gai, gras, rubicond et fort bien élevé; il nous invite à le visiter et nous assure que sa digne femme sera bien aise de nous voir. Il nous désigne comme sa demeure une jolie petite maison, située près de la chapelle presbytérienne de Campbelltown.
Une autre visite inattendue produit des réflexions pénibles. François Coundeau, portant ses médailles, se présente sur la goélette. D’un air assuré, il vient déclarer à Mgr. de Sidyme qu’il a une grande faim, parce qu’il n’a pas mangé depuis deux jours. Il demande des provisions, qui lui sont données largement. Voilà où souvent le réduit son imprévoyance; sa fierté ne s’en effarouche point, car le sauvage ne croit point s’abaisser en demandant de quoi apaiser sa faim. Il ne se regarde même pas comme obligé de faire des remercîments, car il est prêt lui-même à partager le pain ainsi reçu, avec le premier nécessiteux qu’il rencontrera.
Juillet, 25. 4h. du matin.—Temps magnifique, vent frais et favorable; cependant l’équipage ne bouge point. Le capitaine et les matelots se font tirer du lit par les passagers, qui désirent profiter de la bonne humeur d’Eole. Les préparatifs du départ se font lentement; avant d’appareiller, le capitaine prend le temps de mettre les cordages en ordre, ce qu’il pourrait faire un peu pins tard. D’un autre côté, Hector a été envoyé à terre pour hâter l’arrivée d’un sauvage, qui désire vendre un beau canot d’écorce. On attend le messager et son compagnon, mais personne n’arrive. Enfin, au bout d’une heure et demie, on voit glisser vers la Sara un canot, qui porte notre envoyé et un sauvage malécite. Trapu, courtaud et lourd, Pitre Baskette grimpe à reculons dans l’échelle; arrivé sur le pont, il va s’appuyer contre le grand mât, et bâille tout à son aise, pendant qu’il se gratte la tête avec un vif sentiment de complaisance. Ces préliminaires réglés, il se hasarde à aborder les conditions du marché avec l’acheteur. Malgré les exhortations les plus pathétiques d’Hector, il n’a pu se décider à laisser sa cabane sans avoir fait sa prière, et une longue prière, suivie d’une forte méditation sur les douceurs du repos.
Les canots malécites sont relévés aux deux bouts; dans les canots micmacs, au contraire, le milieu est la partie la plus haute. La marche des premiers est plus rapide; les seconds sont plus sûrs lorsque la houle est forte. L’écorce mérite aussi d’être prise en considération dans l’appréciation des qualités d’un canot; l’écorce, nommée par les sauvages moskoui d’été, est légère et fragile, tandis que le moskoui d’hiver, par le nombre de ses feuillets, a toute la solidité du bois, sans en avoir la pesanteur.
[51] Je devais être mauvais prophète, il y a vingt-cinq ans; car il ne paraît pas que Campbelltown ait fait plus de progrès que Dalhousie.
———
Retour—Lutte entre l’Hubert Paré et la Sara—Les esterlets—Petit-Rocher—La croix—Nipisiguit—Philippe Hesnault et le Père LeClercq—Premiers colons du Nouveau-Brunswick et de l’île Saint-Jean—Caraquet—Coutumes et costumes—Huîtres—Insulte à la Vieille—Gros temps—La Nancy—La baie de la Trinité—La Grosse Ile—Arrivée à Québec—Conseil—Adieux.
Pendant que les clauses du marché se stipulent, l’un aperçoit quelque mouvement sur le brick du capitaine P. et sur la Sara; les mêmes manœuvres se font sur les deux bâtiments, un peu plus tard cependant sur le nôtre. A peine l’Hubert Paré s’est-il mis en route, que la Sara s’élance à sa suite. Le premier a la générosité de ne pas mettre toutes ses voiles dehors; il reste encore quelques vides dans le haut de ses mâts; aussi dès que la Sara a étendu ses deux grandes ailes, elle se rapproche facilement de son rival. Dès lors, tout s’agite chez nos voisins. “A bas la générosité,” devient le mot d’ordre sur l’Hubert Paré; toutes ses vergues se couvrent de voiles et le dernier pouce de toile est livré au vent.—Peine inutile! la Sara coule si lestement à côté de son rival, qu’elle le laisse promptement en arrière, et, dans une course de six lieues, elle le dévance au moins de quatre milles. Nous laissons le capitaine V. se frotter les mains de joie, et l’équipage étudier le mouvement des voiles afin de les faire toutes porter, et nous nous occupons de quelques leçons d’histoire naturelle que nous donnent les oiseaux.
Des perches enfoncées en terre s’élèvent au-dessus de l’eau, sur les bords du Ristigouche; elles servent, soit à retenir les rets, soit à en marquer la position, et forment une forêt marine. De grosses bandes d’esterlets y ont élu leurs domiciles. Chaque bout de bois qui s’élève au-dessus de la surface des eaux en porte deux, trois, ou plus, selon le nombre de nœuds qu’il peut offrir. L’esterlet est sans cesse en mouvement. Une bande arrive, fatiguée d’être sur l’aile, et fond sur celle qui est en possession des perches. Celle-ci s’élève, va décrire quelques cercles dans l’air et revient s’emparer de ses possessions. Leurs évolutions aériennes, leurs combats, leurs cris animent et vivifient les bords de la rivière, surtout dans les parties où ils seraient le plus monotones; car rien n’est plus triste qu’une pêcherie couverte d’eau et où l’on n’aperçoit plus que des milliers de perches, qui restent engourdies et immobiles, tandis que le courant fuit alentour avec rapidité.
Le capitaine V., obligé de se présenter à Dalhousie pour obtenir la permission de disposer de sa pacotille dans le Nouveau-Brunswick, mouille vis-à-vis de la ville, et peu après l’Hubert Paré, tout confus de sa déconfiture, vient jeter l’ancre auprès de nous. Comme le missionnaire de Carleton va nous laisser pour retourner au chef-lieu de sa mission, nous allons reconduire notre confrère et visiter en même temps ce beau bâtiment, qui est un modèle d’ordre et de propreté. Nous y trouvons madame P., environnée de tous ses enfants, dont quelques-uns se forment à la marine, sous l’œil exercé de leur digne père.
Les papiers de notre patron mis en règle, nous quittons la rivière de Ristigouche, pour entrer dans la baie des Chaleurs. Devant nous, s’étend une mer rase et resplendissante sous les rayons du soleil. Le fond de la baie fuit; les hauteurs décroissent, les coteaux disparaissent, et bientôt l’on n’aperçoit plus en arrière qu’une ligne bleuâtre, dansant à l’horizon. Ce tableau nous rappelle le beau vers d’un poète, qui en a tant fait de mauvais:
“Chinon au loin blanchit, décroît et disparaît.”
3 h. P. M.—Nous arrivons au Petit-Rocher, escortés par douze berges, qui sont venues au-devant de Mgr. de Sidyme. Déduction faite d’une heure passée à Dalhousie, la Sara n’a mis que huit heures à parcourir les vingt lieues qui séparent le village de Ristigouche du Petit-Rocher.
M. Madran, missionnaire du lien, a préparé ses paroissiens pour la visite épiscopale, de sorte qu’après l’office de l’après-midi, nous pouvons nous donner le plaisir de visiter les rochers de la grève. Aussi en profitons-nous à notre aise. Tandis que M. N. se livre avec ardeur à des recherches minéralogiques et conchologiques, il croit remarquer une belle pierre blanche, à demi cachée sous des feuilles de varech; pour la saisir il enfonce avidement la main dans l’eau: “Seigneur, que ça mord!” s’écrie-t-il, en retirant précipitamment les doigts, et secouant sur le sable un homard, qui heureusement n’a pu lui entamer que la peau.—“Maudit coq, tu mourras;” disaient les fileuses de La Fontaine. “Maudit homard, tu grilleras;” fut le cri général d’exécration, à la vue du traître, coupable d’une si honteuse supercherie. Le même soir, en effet, accompagné de plusieurs individus de son écaille, il a été dépecé par celui qu’il avait voulu tenailler.
Après cet accident, les recherches se font avec plus de prudence; dès que le blessé aperçoit un caillou blanc au fond de l’eau, il bat en retraite, et se porte à la bouche le doigt qui a failli devenir la victime d’un infâme guet-à pens.
Le presbytère est un bâtiment neuf, construit sur un rocher, qui s’avance dans la mer et donne à l’établissement le nom de Petit-Rocher.
A l’extrémité de la pointe, s’élève une haute croix, appuyée sur le roc et soutenue par quelques pierres. Bien qu’exposée à la fureur des vagues, qui, dans les grandes marées, viennent battre contre son pied, elle a jusqu’à ce jour résisté à toutes la violence des vents et des flots.
Dans notre catholique pays, la religion a planté ce signe sacré aux lieux qu’elle veut particulièrement honorer, et elle l’a placé sur la voie de l’homme, partout où il a besoin de force et de consolation.
La croix veille sur le champ de la mort, afin que le chrétien, conduit par la douleur auprès du tombeau de ceux qui lui furent chers, y trouve un gage d’union entre les vivants et les morts. Avec respect et reconnaissance, le nautonnier salue la croix du rivage, qui lui désigne l’écueil à éviter et l’avertit de prier pour l’âme du pauvre naufragé. Succombant sous la fatigue et brûlé par l’ardeur du soleil, le pèlerin, qui a suivi le chemin poudreux de la vallée, s’arrête pour se reposer près de la croix, au pied de laquelle murmure un ruisseau et qu’ombragent les longs rameaux de l’érable ou de l’orme. La croix marque l’endroit où furent déposés les restes de l’inconnu, qui mourut au coin du bois, sans qu’une voix amie lui adressât un mot de consolation; rudement taillée, elle apparaît au détour du tortueux sentier qui circule dans l’épaisseur de la forêt, et elle étend ses bras sur l’aventureux pionnier, pour lui rappeller que, même dans ces solitudes profondes, il est toujours sous la sauvegarde de Dieu.
Juillet, 26.—M. Madran dessert les missions de la Rivière-Jaquette, de la Belle-Dune, du Petit-Rocher et de Nipisiguit, où depuis quelques années beaucoup d’Irlandais se sont établis auprès des Acadiens.
Vers midi nous laissons ce village, et emmenons avec nous M. le missionnaire et quelques-uns de ses paroissiens.
La distance du Petit-Rocher à Nipisiguit n’est que de quatre lieues, et nous serions arrivés en peu de temps à ce dernier endroit, si le vent eût continué de souffler; mais un calme plat succède à la brise favorable, et empêche la Sara de continuer sa course. Par bonheur, plusieurs berges viennent à notre rencontre; sept ou huit d’entre elles sont attachées les unes aux autres et nous remorquent dans le bassin. Comme la mer baisse rapidement et que le chenal est difficile, il nous faut trois longues heures pour parcourir trois milles, depuis la passe jusqu’au fond du port.
La bassin de Nipisiguit est séparé de la baie du même nom, par une pointe basse et sablonneuse que traverse un étroit goulet. Pendant une de ses visites pastorales, Mgr. Plessis fut condamné à passer la nuit en plein air sur cette pointe, alors inhabitée, mais aujourd’hui occupée par des maisons et des chantiers.
De l’entrée du goulet, on aperçoit à droite et à gauche des habitations nombreuses, au milieu de champs cultivés. Au fond du port, beau bassin circulaire, dont le diamètre est d’une lieue, brillent les toits de la petite ville de Bathurst et le clocher de l’église catholique, à l’ombre duquel s’est réfugié un village acadien.
Toute nouvelle encore, la ville de Bathurst possède déjà plusieurs maisons de commerce; celles de Cunard, et de Gilmour et Rankin y font des affaires considérables. Elle est le siège d’une cour, et par conséquent elle réunit des hommes de loi et tous les officiers qui se rattachent à un tribunal judiciaire. C’est ici aussi qu’habitent les notables du comté, attirés par les avantages qu’offre la position centrale de la ville.
Du débarcadère, Mgr. de Sidyme se rend directement à l’église, suivi d’une foule de catholiques et de protestants. Comme il est sept heures du soir, il est forcé de congédier les assistants après leur avoir adressé une courte exhortation.
A notre grande surprise, le presbytère, que nous pensions trouver désert, a été meublé et préparé pour six ou sept voyageurs. Les chambres renferment des lits resplendissants de blancheur; dans la large cheminée pétille un bon feu, autour duquel s’empressent plusieurs matrones du lieu, armées d’ustensiles de cuisine; tout nous annonce que nous trouverons le souper et le coucher, sans être obligés de retourner à la goélette. Ces préparatifs sont dûs aux soins bienveillants du père Doucet, qui, pour nous héberger convenablement, a fait transporter au presbytère une partie des meubles de sa maison.
A peine nous a-t-il introduits dans notre logis, que les principaux citoyens de Bathurst arrivent pour saluer l’évêque de Sidyme. Parmi eux se trouve le représentant du comté de Gloucester, M. End. Jeune encore, il était employé comme avocat à la cour de Bathurst, lorsqu’aux dernières élections la portion française de la population jeta les yeux sur lui, pour se faire représenter au parlement du Nouveau-Brunswick. Dès la première session à laquelle il assista, il acquit une réputation bien méritée d’habileté et d’éloquence; comme orateur, il n’a peut-être pas son égal dans la chambre basse de la province. Il s’est jeté dans la faible minorité tory, qui soutient le pouvoir exécutif. Cependant son toryisme est beaucoup plus libéral que le radicalisme de certains personnages du parti opposé. Quoique irlandais et protestant, il a défendu contre eux les intérêts des catholiques acadiens, qui, dans une grande partie du Nouveau-Brunswick, sont plus nombreux que les sujets d’origine britannique.
M. End est accompagné de M. Morin, membre du parlement provincial du Bas-Canada. Notre compatriote est en route pour la Nouvelle-Ecosse, où il va traiter avec les commissaires des provinces voisines, au sujet du site et des frais d’établissement d’un nouveau phare dans le golfe Saint-Laurent.
Au souper, nous jouissons de la compagnie de M. le grand vicaire MacDonald, qui après nous avoir laissés, il y a bientôt huit jours, est venu attendre Mgr. de Sidyme à Nipisiguit; ainsi que M. Morin, il loge à l’hôtel tenu par M. Doucet.
Ce brave père Doucet est un des Acadiens les plus riches et les plus respectables du Nouveau-Brunswick. Il a toujours été l’ami des missionnaires, et très-souvent leur hôte. Par son industrie, il s’est créé une petite fortune, et possède aujourd’hui de grandes fermes, sur lesquelles il a, dans une seule année, recueilli jusqu’à trois mille minots de pommes de terres.
Trois rivières viennent tomber dans le bassin de Nipisiguit et forment ainsi deux péninsules. Entre la rivière Tétigouche et la rivière du Mitan, s’avance une pointe qui domine sur tous les environs, et qui par sa position, son escarpement et son élévation ressemble nu cap de Québec. Sur le bout de cette pointe sont placés l’église catholique et le presbytère, édifice presque neuf, bien fait, et admirablement situé. De ses fenêtres l’on aperçoit le bassin garni de navires, la ville de Bathurst bâtie sur un plateau entre la rivière du Mitan et la grande rivière de Nipisiguit, et, au-delà, de fort belles campagnes, qui s’abaissent graduellement vers le port. Au pied du cap, sur une étroite grève, s’étend un petit village, qui par sa position rappelle la Basse-ville de Québec.
Un beau chemin, de douze lieues de longueur, unit Bathurst avec Miramichi. C’est par cette voie que les villes et les villages des bords de la Baie des Chaleurs communiquent avec Saint-Jean et avec Frédéricton, capitale du Nouveau-Brunswick; c’est aussi la route par laquelle, pendant l’hiver, les habitants de la Gaspésie entretiennent des rapports avec Québec.
Le commerce de Bathurst est si considérable, que l’année dernière cent quarante navires européens et cent trente goélettes employées au cabotage y ont pris des chargements. Cependant le port est sujet à un grave inconvénient. En se réunissant, les trois rivières forment un chenal, que les bâtiments doivent suivre pour arriver au quai. Son cours est si tortueux et si étroit, que deux goélettes ne s’y rencontrent qu’avec le risque de s’échouer. Les difficultés augmentent, quand plusieurs bâtiments, environnés de trains de bois, restent à l’ancre dans ce passage pour y recevoir leurs chargements. Le reste du bassin qui a peu de profondeur peut à peine porter de petites goélettes.
Voici comme les sauvages expliquent les méandres de la rivière Nipisiguit. “Le grand esprit,” disent-ils, “faisait chaudière sur le cap. Il venait de prendre une grosse anguille et s’apprêtait à l’écorcher, lorsqu’elle glissa entre ses doigts, tomba dans le bassin, et, en s’enfuyant vers la mer, creusa dans le limon le chenal étroit et tortueux qui cause tant d’ennui aux pilotes.”
Nipisiguit se trouvait d’abord renfermé dans l’immense territoire accordé au sieur Nicolas Denys. Cette concession ayant plus tard été considérée comme invalide, le gouvernement français accorda des terres qui avoisinent la rivière de Miramichi au sieur Denys de Fronsac; les autres parties du domaine de son père furent distribuées à quelques personnes, qui s’engagèrent à les faire valoir. En vertu de cet arrangement et par acte du trois août 1689, Philippe Hesnault, qui habitait ces lieux depuis plusieurs années, obtint du roi le fief de la rivière Nipisiguit, contenant deux lieues de front sur la même profondeur. Hesnault faisait la pêche en grand et s’occupait de la traite avec les Micmacs, qu’il s’était attachés, en épousant une femme de leur nation. Après sa mort, une partie de sa famille paraît s’être établie dans les environs de Québec.
Le récollet Chrestien LeClercq était à Nipisiguit comme missionnaire des sauvages, en 1678. Il parle assez longuement du sieur Hesnault, à propos d’un voyage qu’ils firent ensemble de Nipisiguit à Miramichi.[52]
Comme ils devaient être accompagnés de quelques sauvages et que le voyage était alors long et pénible, ils s’étaient munis des provisions jugées nécessaires.
“Pour cet effet,” écrit le Père LeClercq, “On fit nos provisions qui consistaient en vingt-quatre petits pains, cinq à six livres de farine, trois livres de beurre et un petit baril d’écorce, qui contenait deux à trois pots d’eau-de-vie.” Les vivres leur manquèrent cependant en chemin, car ils avaient compté, sans songer à l’appétit des sauvages et aux accidents de la route.
“Nipisiguit” ajoute-t-il, “est un séjour des plus charmants qu’il y ait dans la grande baie de Saint-Laurent: il n’est éloigné que de douze à quinze lieues de l’île Percée. La terre y est fertile et abondante en toutes choses; l’air y est pur et sain. Trois belles rivières, qui s’y déchargent, forment un bassin très-agréable dont les eaux se perdent dans la mer, par un détroit qui en fait l’entrée et l’ouverture. Les récollets de la province d’Aquitaine y ont commencé la mission en 1620, et le P. Bernardin, un de ces illustres missionnaires, mourut de faim et de fatigues, en traversant les bois pour aller de Miscou et de Nipisiguit à la rivière Saint-Jean, à la Cadie, où ces Révérends Pères avaient leur établissement principal. Les RR. PP. Capucins et singulièrement les RR. PP. Jésuites y ont exercé leur zèle et leur charité pour la conversion des infidèles; ils y ont fait bâtir une chapelle dédiée à la sainte Vierge; et l’on remarque que celui de ces Pères qui quitta cette mission laissa son bonnet dessus l’autel, disant qu’il le viendrait chercher quand il lui plairait, pour faire connaître que sa compagnie avait droit d’établissement dans ce lieu.”
“Le sieur Hesnault y cultive la terre avec succès, et recueille du froment au-delà de ce qu’il en faut pour les besoins de sa famille.”
Voilà quel était Nipisiguit à cette époque reculée. Des français continuèrent d’y résider en petit nombre jusques vers 1756; alors quelques familles acadiennes y arrivèrent, et s’établirent en ces lieux, dont les héritiers du sieur Hesnault semblent ne s’être plus occupés. Du moins personne n’empêcha les colons de défricher le terrain, dont ils ne connaissaient d’autre maître que Dieu et le roi de France.
Après la cession du Canada aux Anglais, le pays dans lequel se trouvait renfermé Nipisiguit fut érigé en province, sous le nom de Nouveau-Brunswick, et partagé en townships. Accoutumés à ne point payer de rentes, les anciens habitants de ce lieu ne s’occupèrent point des redevances, qu’on ne leur demandait point. Plus tard les officiers du gouvernement provincial se ravisèrent à ce sujet; depuis quelque temps, la question des rentes territoriales fait du bruit dans la province, et ne sera définitivement réglée que par le gouvernement impérial.
Les cultivateurs du Nouveau-Brunswick sont, après tout, fort heureux de n’avoir pas été traités comme ceux de l’île Saint-Jean. Là, comme ici, s’étaient établies des familles acadiennes. Quelques années après que l’île eut passé sous la domination de l’Angleterre, des gentilshommes anglais et écossais s’avisèrent de se la faire partager en seigneuries; leur demande fut facilement accordée, sans aucun égard aux droits des anciens habitants. Alors, sur les épaules des premiers propriétaires, tomba un joug de fer dont ils ne purent se débarrasser. A la suite de longues discussions, on leur permit de garder leurs terres pendant quarante ans, à condition qu’ils paieraient une rente annuelle de cinq louis; encore, cette grâce ne fut-elle accordée que par quelques-uns des soigneurs. Les autres laissèrent les terres à bail, pour vingt ans seulement, et exigèrent une rente annuelle de dix et même de vingt louis. La conséquence naturelle de cette spoliation a été que beaucoup d’Acadiens ont été ruinés et ont cédé la place à des fermiers écossais. Ceux-ci, à leur tour, ont éprouvé le même sort, et sont partis aussi pauvres que leurs dévanciers. Les plaintes soulevées contre ces injustices ont été efficacement étouffées, par les gens qui en profitent et qui sont les maîtres dans les chambres législatives.
Juillet, 27.—A midi nous sommes prêts à faire route; mais le départ est retardé par l’absence de quelques-uns des matelots, que la curiosité retient à Bathurst. Le vent est favorable, et cependant ils nous font attendre deux grandes heures. Voilà un beau champ pour la mauvaise humeur; heureusement la lecture des journaux canadiens, que nous venons de recevoir de Québec, adoucit la bile des mécontents, et fait oublier les reproches préparés pour l’arrivée des retardataires.
Vis-à-vis de Nipisiguit, la baie des Chaleurs est dans sa plus grande largeur. Comme il y a environ sept lieues d’une côte à l’autre, l’on ne peut, du nord, distinguer les terres basses du Nouveau-Brunswick; d’ici, au contraire, l’on aperçoit clairement les montagnes du district de Gaspé.
Les rivages présentent une suite non interrompue d’habitations et de champs cultivés, entre Nipisiguit et Caraquet. Près de ce dernier endroit, est Poccha, qui possède une chapelle, et fournit au commerce de Québec d’excellentes meules à aiguiser; leur réputation a cependant diminué beaucoup, par la paresse et la malhonnêteté de quelques tailleurs de pierre. Ceux-ci, au lieu de chercher et de choisir les meilleurs lits de grès, prenaient les pierres qui leur tombaient sous la main, et livraient au commerce des meules dont on ne pouvait se servir. En conséquence de ces fraudes, l’anathème des affileurs s’est étendu sur toutes les meules de Poccha, sur les bonnes comme sur les mauvaises.
Vers 8h. du soir, nous jetons l’ancre à l’entrée de la baie de Caraquet, après avoir parcouru environ douze lieues, depuis la sortie du bassin de Nipisiguit. Comme le temps est obscur et l’entrée difficile, le Capitaine V. n’ose entreprendre de franchir le passage pendant la nuit.
Juillet, 28.—L’église de Caraquet est bâtie sur la baie du même nom, à peu près à une lieue de l’entrée. Quoique la marée et le vent soient contraires, le capitaine V. veut forcer la Sara à se faire un nom, en remontant jusqu’à l’église, malgré ces obstacles. Ayant été dans l’habitude de visiter Caraquet une ou deux fois par an, il se trouve ici en pays de connaissance. Souvent il s’est vanté de son habileté à construire des bâtiments, et il a même porté des défis aux charpentiers du lieu, qui passent pour fort habiles; sa goélette favorite vient de dévancer le brick du capitaine Painchaud, bâti par les frères Aché, qui sont les meilleurs ouvriers de Caraquet. Ces circonstances lui ont monté la tête, et mettent en jeu la double vanité du marin et du constructeur naval.
De grand matin donc, il déploie ses voiles pour louvoyer dans un chenal étroit; contre le vent et contre le courant, la Sara gagne à chaque bordée, et enfin elle arrive glorieuse et triomphante au mouillage, voisin de l’église. Je me trompe: la Sara reste indifférente à sa victoire; c’est le capitaine qui est glorieux et triomphant; il accepte, avec un légitime orgueil, les félicitations des habitants du voisinage, qui ont reconnu la goélette de l’évêque, et se sont réunis pour recevoir la bénédiction épiscopale. “Capitaine,” lui dit un des plus anciens marins, “vous nous avez fait voir aujourd’hui ce que nous n’avions pas encore vu; jamais bâtiment n’a réussi à monter jusqu’ici contre vent et contre marée.”
M. MacHarron, missionnaire de Caraquet, a été informé ce matin seulement de la visite de l’évêque: il est trop tard pour que ses paroissiens puissent se préparer à recevoir aujourd’hui la confirmation; notre séjour à Caraquet sera donc prolongé jusqu’à demain.
Deux choses nous étonnent, au débarquement: le costume antique des habitants, particulièrement celui des femmes, et la charité qu’on a de ne point nous assourdir à coups de fusil. Pas un seul de ces braillards, comme les appelle un vieux chasseur, n’ose ouvrir sa gueule noire. Mais trêve de compliments sur ce dernier point; car si les chasseurs de Caraquet n’ont pas aujourd’hui dérouillé leurs fusils, c’est qu’ils ont été pris à l’improviste; demain nous paierons le repos du premier jour. En effet, ce matin, dès que la renommée aux mille voix eut proclamé aux paisibles habitants de l’endroit l’arrivée de l’évêque de Sidyme, un conseil des notables s’est tenu, et six vigoureux rameurs ont été dépêchés au Chippagan, situé à quatre lieues d’ici, pour acheter une bonne provision de poudre.
Le sujet de notre première surprise est mieux fondé. Cette population a conservé les coutumes et le costume de ses ancêtres, bien plus religieusement que les autres communautés acadiennes. A voir l’habillement des femmes, on les prendrait pour des religieuses. La partie la plus curieuse de leur toilette est la couverture de tête, grande coiffe à fond quarré et sans aucune garniture. Sous cette enveloppe, toutes les têtes paraissent de loin appartenir aux bisaïeules de la génération présente.
“Et les huîtres de Caraquet! en mangerons nous?” demande l’ami N., qui craint moins les huîtres que les homards. Les huîtres de Caraquet sont renommées; elles habitent une batture d’une demi-lieue en superficie, vers le fond de la baie, et à deux milles environ de l’église. L’année dernière, les habitants du lieu, trop avides de gain, en chargèrent une vingtaine de goélettes, et par là en diminuèrent le nombre, de manière à donner des craintes pour l’existence de la colonie sous-marine. Munis des instruments nécessaires et habitués à ce genre de travail, ils ne craignent point de compétition de la part des étrangers, et se regardent comme autorisés à régler l’exploitation des huîtres de leur baie.
Les opérations sont généralement dirigées par un conseil d’anciens. Ceux-ci, reconnaissant leur imprévoyance de l’année dernière, résolurent de n’en point vendre à l’avenir avant la fin de septembre. Nous faudra-t-il donc attendre jusqu’au mois d’octobre? Non. A peine Mgr. Turgeon a-t-il témoigné le désir de se procurer des huîtres, que les anciens chargent cinq ou six pêcheurs d’en fournir autant qu’il en faudra.
Deux rateaux, attachés en ciseaux, forment l’instrument le plus commode pour saisir les huîtres au fond de l’eau. D’abord écartés l’un de l’autre, les deux rateaux sont rapprochées au moyen de leurs manches, et retiennent entre leurs dents les cailloux et les coquillages. L’instrument est alors tiré de la mer, déchargé dans la berge et plongé de nouveau.
L’église et le presbytère de Caraquet sont construits de pierre; c’est à M. Cooke, ancien missionnaire du lieu, qu’est dû l’honneur d’avoir fait bâtir le seul grand édifice de pierre qui soit dans la baie des Chaleurs.
Juillet, 29.—Vers 5 h. du soir, nous faisons nos adieux aux Acadiens, dont nous avons admiré la foi et l’attachement aux anciennes mœurs.
“................Heu pietas! heu prisca fides!”
peut-on répéter avec le poète, en rappelant les bonnes qualités de ces braves gens.
Au départ tous les fusils se font entendre, et les jeunes gens tâchent ainsi de réparer leur honneur, si gravement compromis à notre arrivée.
En sortant du goulet, le capitaine V. nous expose à passer la nuit sur un banc de sable. Malgré les avis d’un pilote qui a voulu nous suivre jusqu’en pleine mer, malgré les remontrances de son fils Benne, qui connaît mieux que son père le port de Caraquet, il s’obstine à suivre une route qui a bientôt mis la quille de la Sara en contact avec le fond de la mer. Par bonheur le vent souffle avec force; après avoir tracé un sillon de quatre ou cinq arpents, la goélette se trouve de nouveau dans le chenal et fuit vers Québec.
Tout va bien, hormis le cœur de M. le grand vicaire Gagnon, que Mgr. a invité à monter avec nous jusqu’à Québec.
Missionnaire dans ce pays depuis trente ans, et, par conséquent, obligé de voyager souvent, soit en goëlette, soit en berge, M. Gagnon ne peut se trouver sur mer sans être malade; chaque nouvelle excursion lui prouve que son apprentissage n’est pas encore fini. Tandis que, la gaîté dans le cœur et sur les lèvres, nous soupons avec appétit, le vieux missionnaire est étendu sur son lit de douleur, répondant avec piteuse mine à nos joyeux propos.
Juillet, 30.—9h. A. M. Nous sommes au milieu des berges de pêche de la Grand’Rivière. Désireux de se procurer de la morue fraîche pour le marché de Québec, le capitaine s’arrête pour en faire provision. Deux heures plus tard, quelques coups de canon tirés par la Sara informent de notre passage, M. le missionnaire de Percé, et vont porter l’épouvante parmi les goélans et les cormorans du cap.
Vers 5h. P. M. Nous passons vis-à-vis de la Vieille; un des voyageurs boit un verre d’eau à sa santé et lui lance quelques écailles d’huître.—“Ne faites point cela,” dit quelqu’un au mauvais plaisant; “si vous insultez la Vieille, elle se vengera, soyez-en sûr.”
6h. P. M. Des nuages épais roulent au-dessus de la baie de Gaspé; ils s’accumulent et semblent acquérir de la solidité, en se pressant les uns contre les autres. Bientôt ils forment une arche sombre et lugubre, dont la base repose sur la crête du Fourillon, tandis que le sommet s’arrondit sur nos têtes. Le vent souffle avec violence; l’obscurité des nuages est reflétée par la mer, qui est devenue furieuse; les vagues se poursuivent; elles s’élèvent comme des collines, entre lesquelles se prolongent des vallons, où, à l’abri de la tourmente, l’hirondelle de mer cherche sa pâture dans la plus profonde sécurité. La mer ne s’est pas encore montrée à nos yeux si sublime et si terrible.
8½ h. P. M. de profondes ténèbres sont répandues dans l’air, tandis que sur les eaux s’étend une nappe de feux phosphoriques. Les yeux marins de Benne aperçoivent un bâtiment à quelque distance, en avant de la Sara; peu après tous le voient et distinguent le sillage lumineux qu’il laisse après lui. Il est à petite portée de la voix, et fait même route que nous. De part et d’autre, les questions et les réponses se croisent, sans pouvoir être comprises au milieu des sifflements du vent et du bruit des vagues. Enfin après bien des cris poussés des deux côtés, Benne comprend que c’est une goélette qui vient d’Halifax et qui appartient à M. Tremblay de la Malbaie.—“Elle marche comme un quai,” observe le capitaine V. Il disait vrai, car nous l’avions déjà dépassée.
Juillet, 31.—“Où en sommes-nous ce matin?” L’opinion générale est que le Grand-Etang est sur notre gauche, et la pointe nord-ouest de l’île d’Anticosti à droite. La brume est si épaisse que le capitaine craint d’être trop rapproché de cette île.
Août, 1er.—A gauche est Sainte-Anne des Monts; nous faisons la traverse vers le nord. Loin devant nous, est la Pointe des Monts avec son phare.
Vis-à-vis de la Trinité, un lourd vent du nord s’abat sur la Sara et la pousse en peu de temps à la Pointe des Monts. Là, suivant la prédiction du capitaine, le vent favorable nous abandonne; les voiles ne portent plus et battent contre les mats; nous sommes arrêtés par une brise fraîche du sud-ouest, et condamnés à louvoyer, mais avec si peu de succès que chaque bordée vers la terre nous ramène près du phare.
Cette tour, qui doit avoir une centaine de pieds de hauteur, a empêché bien des naufrages. Le fleuve, qui au-dessus de l’île d’Anticosti a vingt-cinq lieues de largeur, se rétrécit rapidement ensuite, et ici n’en a plus que dix-huit. La côte du nord s’avance subitement vers le sud et se termine par une pointe basse et fort dangereuse, où les naufrages étaient fréquents et où les naufragés se trouvaient autrefois éloignés de tout secours. Aujourd’hui, avec sa lumière brillante, la pointe des Monts a perdu sa mauvaise renommée et offre des secours aux matelots, qui sont toujours sûrs de n’y point périr de faim, depuis que le gouvernement y a établi un dépôt de provisions.
—“Ça-t-il l’air de la Nancy, ça,” s’écrie Benne, en rapprochant de son œil la longue-vue, que depuis quelques moments il dirige vers un bâtiment occupé comme nous à louvoyer au large.—“C’est la Nancy qui arrive d’Halifax.”—“Ça serait drôle,” répond le père V., “si je nous rencontrions, où je nous sommes séparés.”
—“C’est elle, c’est elle;” reprend Benne, au moment où les deux goélettes se trouvent en même temps sur le sommet de deux vagues.
—“Vite, Benne, manne de botte; il faut aller voir où en sont les garçons.”—Le capitaine, dans sa joie mêlée d’inquiétude, mêle aussi un peu d’anglais avec son français; cette goélette lui appartient; un de ses fils la conduit et deux autres y sont sous les ordres de leur frère. La chaloupe revient bientôt, amenant Polite et Edoir, en échange de Benne. Coque à bord de la Nancy, Edoir est un égrillard de dix ans, qui oublie souvent le feu de la cambuse, pour grimper dans les mats comme un écureuil et s’y balancer comme un carcajou.—Aussi le père V. est-il fier de son Edoir, son joculot, à lui.
La Sara a beau louvoyer, elle n’avance que peu à peu et avec un immense travail, contre les efforts réunis du vent et des courants.—“Monseigneur,” dit le capitaine, “ce serait mieux de retourner à la rivière de la Trinité, où on attendra un bon vent.”—“C’est bon, capitaine; mais y serons-nous tranquilles?”—“Comme dans un pot, Monseigneur, on y mouille tout proche de terre, quoique la grève ne soit pas rouable.”—“Près de terre!” répètent plusieurs voix; “nous n’avons pas été à terre depuis cinq jours.”
Un quart-d’heure après, la Sara et la Nancy jettent l’ancre à l’entrée de la rivière de la Trinité, au milieu d’une nappe d’eau, unie comme une glace. Libre à nous de nous promener sur le pont, sans craindre de faire un faux pas. Mais ce n’est pas encore le plus beau de la position: la pointe de l’ouest est couverte de rochers; un peu plus loin est une grève de sable, que nous allons avoir le plaisir de parcourir.
Une goélette nous a précédés dans la baie. Qui sont nos voisins?—“A qui la goélette?”—“A M. Tremblay de la Malbaie.”—“C’est justement le quai que la Sara a passé dans le gros temps, au large du cap des Rosiers,” dit le capitaine V.; “c’est la tortue qui a été plus vite que le lièvre.”
Pendant l’après-midi nous explorons la belle grève de la baie de la Trinité, et nous visitons un petit établissement de la compagnie de la Baie d’Hudson, situé sur la rivière à une demi-lieue plus haut. Quatre employés résident là, pour faire la pêche du saumon et éloigner ceux qui cherchent à trafiquer avec les Montagnais. De notre promenade, nous rapportons coquillages, oursins, étoiles de mer, et de plus un magnifique saumon.
Sur la pointe de l’ouest, sont les morceaux à demi pourris d’une croix, qui a été plantée en ce lieu, il y a plus de vingt ans. Demain, si le vent est aussi défavorable qu’il l’a été aujourd’hui, nous la remplacerons par une croix nouvelle.
Août, 3.—A huit heures du matin tout est prêt pour notre entreprise; nous nous rendons à terre, munis de haches, de pinceaux et de peintures. Les ouvriers se mettent au travail, abattent deux sapins, les taillent et les clouent en croix. Sur cette œuvre un peu rude, s’étend une double couche de peinture; et voilà la croix prête à être élevée sur le rocher. Pour la soutenir, quelques grosses pierres sont roulées autour de sa base; ainsi appuyée, elle pourra résister aux plus rudes coups de vent. Les équipages des trois goélettes, les employés de l’établissement et quelques pauvres sauvages montagnais assistent à la bénédiction faite par Mgr. de Sidyme; tous viennent ensuite baiser avec respect le pied de la croix.
Les hommes sont avides de laisser un souvenir après eux; et, ce souvenir, chacun l’attache comme il peut sur son passage. La date de la bénédiction est tracée sur le montant de la croix, et les rochers qui la soutiennent sont chargés de porter à la postérité les noms des personnes présentes. Il n’y a pas même jusqu’à Jacques et à Edouard, qui ne désirent voir leurs noms peints en grosses lettres, à côté de celui de leur père. Ce memento ne durera probablement pas longtemps, car la peinture n’est pas œre perennius, mais il se conservera assez bien, pour que, dans trente ans, un savant antiquaire s’amuse à déchiffrer ces caractères, et à y découvrir l’histoire d’une tribu sauvage, on quelques fragments d’un récit sur les voyages des Scandinaves. La croix rendra de plus grands services, en rappelant quelque pensée religieuse aux équipages des nombreux navires qui mouillent dans ce port.
Août, 4.—Matane au Sud et Betsiamite au Nord.
Août, 5.—Nous passons la journée, en vue de Portneuf. C’est un petit purgatoire que de louvoyer en face d’un gros vent. Le bâtiment, penché sur le côté, prend une allure saccadée, qui vous ballotte comme le grain est ballotté dans un van. A force de patientes recherches, vous avez trouvé un coin où vous ne serez pas exposé à rouler sur le pont; vous bénissez votre étoile et commencez à jouir de votre bonne fortune, quand la voix du capitaine vient vous arracher à vos rêveries, par les trois mots magiques: “Parez à virer.” Le bâtiment s’arrête incertain. “Gare aux têtes,” retentit de l’avant à l’arrière; c’est un avertissement charitable, qui vous engage à tomber à plat ventre sur le pont, si vous ne voulez être emporté à la mer. A peine le lourd gui est-il passé en grondant sur votre tête, que le bâtiment se penche brusquement sur l’autre bord. Alors, mieux vous étiez blotti avant ce changement, plus il est probable que vous allez rouler à fond de cale ou vous empaler sur une patte d’ancre. Et combien d’autres bagatelles du même genre s’unissent pour vous tourmenter? Une vague franchit le plat-bord et vient rafraîchir votre sommeil ou tremper les feuilles de votre livre; un lourdaud, qui se hâte de changer les voiles, s’assied sur votre joue, tandis que les souliers ferrés d’un autre vous écrasent les orteils. Ami lecteur, Dieu vous garde de passer trois longues journées à louvoyer!
Août, 8.—De la Rivière-du-Loup nous traversons au Pot-à-l’eau-de-vie. Accoutumés depuis six semaines à un vaste horizon, le fleuve nous paraît étroit, quoiqu’il ait ici sept lieues de largeur. Le soir nous jetons l’ancre à la pointe aux Pins. Demain matin nous arrêterons à la Grosse-Isle.
Août 9, 4 heures A. M.—Le bruit des chaînes, qui se déroulent lorsque l’ancre tombe à l’eau, fait hâter le lever des plus paresseux. Arrivés à la Grosse-Isle, nous attendons la visite de l’officier de santé. Vers six heures, A. M., paraît une chaloupe à pavillon jaune, et gouvernée par un homme au visage long, blême et ombragé d’épais favoris. Avec ce teint et cette figure, on le prendrait pour la fièvre jaune elle-même, s’il n’était beaucoup plus courtois. Ayant reconnu Mgr. de Sidyme, le docteur P. s’empresse de lui offrir sa chaloupe et l’invite à descendre à terre pour visiter la chapelle et le missionnaire.
Déclarés sains de corps par messieurs les médecins, nous faisons route vers le terme du voyage, et vers 4h. la Sara entre dans le bassin de Québec. Sa faible artillerie salue la capitale du Bas-Canada; le pavillon des jours solennels est étendu sur le pont pour être hissé au grand mat; en se déployant, il enveloppe dans ses longs replis le bréviaire du curé de Saint-Isidore et le lance par dessus le plat-bord. Somme toute: voilà la seule perte que nous ayons faite dans tout le cours du voyage; cet accident est même bientôt réparé, car grâces la libéralité de Mgr. de Sidyme, le livre au teint hâlé, au couvert battu de la tempête, aux feuilles jaunies par l’eau de la mer, est remplacé par quatre beaux volumes, brillants de jeunesse, de force et de santé.
Voilà donc Québec, le lion du nord, assis en roi sur son rocher escarpé, dominant les eaux du grand fleuve, et environné de ses riches et riantes campagnes. Dans le cours de notre voyage la nature ne nous a rien offert de si magnifique.
A l’entrée de la rivière Saint Charles, la Sara est visitée par l’officier de santé, par un employé de la douane et par le capitaine du port; munis de leur permission, nous nous dirigeons vers le quai que nous quittions, il y a environ sept semaines. Et le groupe d’amis que nous y laissâmes est encore là, environné d’une foule considérable de citoyens, venus pour saluer l’évêque de Sidyme.
—“Montez, messieurs montez;” nous crie-t-on.—Mais comment arriver jusques là. Notre goëlette est échouée à deux brasses du quai et à quinze pieds au-dessous de la plate-forme.
Cependant on fait glisser sur le gaillard une longue échelle, dont nous sommes invités à nous servir. De notre côté, nous tenons conseil au pied du grand mât:—“Voilà nos amis qui nous attendent là haut; monterons nous au moyen de l’échelle tremblante et brisée que voici? Qu’en dites-vous, Messieurs?”
—“Non,” répond l’un; “nous sommes partis leurs égaux; nous ne ramperons point pour remonter vers eux.”—“Et pourquoi non? c’est le plus court chemin.”—“Vous êtes bien pressés; moi, je ne monterai pas, car il fait si noir, que d’ici en haut, je ne pourrai mettre la main sur un seul échelon.”—Or le préopinant a la vue si basse, qu’il n’y verrait goutte, même en plein jour.—“Point d’échelle! point d’échelle!” s’écrie M. F., qui a une aversion profonde pour les échelles, depuis la mauvaise nuit passée au pied de la grande échelle, près du ruisseau à Manon.
Le poids de ce grave personnage, jeté dans la balance, la fait pencher vers la négative.—“Ça ne fera pas comme ça,” observe le capitaine V; “mettez la chaloupe à l’eau: allons, Benne, entends-tu? Voyons, Moyse, mon garçon; bordez les rames; faites ça comme il faut, devant le monde.”—La chaloupe est préparée, et elle nous conduit à un point du rivage, où nous pouvons débarquer en observant toutes les règles de la bienséance.
Adieu! adieu! légère Sara. Sur ton bord, j’ai passé des jours agréables; accepte en retour mes meilleurs souhaits. Que la main de Constant V.... te soit propice! Puissent les tempêtes respecter ta forme si élégante et si coquette! Puisses-tu, parée de ta robe blanche, sillonner la mer pendant de longues années! Je retourne vers mes bois; adieu pour la dernière fois.
[52] Nouvelle Relation de la Gaspésie.
———
Deux ans après ce voyage, la Sara, gréée à neuf et fournie de voiles plus grandes que les premières, partait de Québec pour le golfe de Saint-Laurent. Une violente tempête la surprit sur les côtes du Labrador, et la jeta au rivage, où elle fut complètement brisée.
———
TABLE.
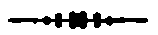
| Pages. | |
| LA POÉSIE, par M. L. H. Fréchette | 5 |
| TROIS LÉGENDES DE MON PAYS, par M. J. C. Taché: | ||
| Au Lecteur | 11 | |
| Prologue | 12 | |
| L’Ilet au Massacre, | La Paix | 27 | |
| L’Alarme | 32 | ||
| Sur les Pistes | 35 | ||
| La Guerre | 41 | ||
| Le Retour | 52 | ||
| La Vengeance | 55 | ||
| La Chasse aux hommes | 60 | ||
| Après la guerre | 71 | ||
| Réflexions | 74 |
| Le Sagamo du Kapskouk, | Le Missionnaire | 75 | |
| Le Sauvage | 80 | ||
| Le Récit | 84 | ||
| Premiers Rayons | 94 |
| Le Géant des Méouins, | L’Enfer ne prévaudra jamais | 97 | |
| Le Voyage | 101 | ||
| La Conscience | 104 | ||
| Conclusion | 109 |
| A MA SŒUR, poésie par M. A. A. Boucher | 111 |
| VOYAGE AUTOUR DE L’ILE D’ORLÉANS, par M. F. A. H. LaRue | 113 |
| JUDE ET GRAZIA, poésie par M. L. J. C. Fiset | 175 |
| LA JONGLEUSE, par M. l’Abbé H. R. Casgrain: | ||
| Prologue | 205 | |
| Première Partie. | Les Voyageurs de nuit | 208 | |
| La Lampe du sanctuaire | 213 | ||
| Hallucinations | 218 | ||
| Le Mirage du Lac | 224 | ||
| Un Esprit! | 227 | ||
| Comme un luth d’ivoîre | 232 | ||
| Course | 236 | ||
| Le Tomahawk | 243 | ||
| L’Écho de la Montagne | 247 |
| Deuxième partie. | L’Été des Sauvages et les Brayeuses | 252 | |
| Une âme défleurie | 255 | ||
| Les Visions | 261 | ||
| Gazelles et Tigres | 264 | ||
| L’Orchestre infernal | 271 | ||
| L’Orphelin | 277 | ||
| Epilogue | 286 |
| DONNACONA, poésie par M. P. J. O. Chauveau | 291 |
| HARMONIES, poésie par M. F. A. H. LaRue | 297 |
| TABLEAU DE FAMILLE, poésie par M. J. C. Taché | 300 |
| JOURNAL D’UN VOYAGE SUR LES CÔTES DE LA GASPÉSIE, par M. l’Abbé J. B. A. Ferland: | ||
| Avis au lecteur | 301 | |
| Le départ—Un canot sauvage—La Sara, ses passagers et son équipage—Le Pot-à-l’Eau-de-Vie—Le Bic et ses souvenirs—Le sauveur de la patrie—Navigation des mouettes—Le Cap-Chates | 303 | ||
| Sainte-Anne des Monts—Un village de pêcheurs—Le Mont-Louis—Le braillard de la Madeleine—La Rivière au Renard—Les pêcheries—Une chasse à la poursille, suivie de réflexions—Un loup marin qui cause en anglais—Le beaupré, et une heure de méditation sur le passé, le futur et le présent | 321 | ||
| L’Anse au Gris-Fond—Un baleinier, et les baleines—Entrée du Saint-Laurent—Le cap des Rosiers, le Fourillon et la Vieille—Brumes—Baie de Gaspé—Baie du Penouïl—Jacques Cartier et ses deux gaspésiens—Alguimou—Baie des Moines | 342 | ||
| Percé et ses souvenirs historiques—La fête de Saint-Pierre—L’hiver et le printemps à Percé—La morue marchande et la morue de réfection—La maison Robin—La Table de Rolland—L’île de Percé, et sa république—Les chercheurs d’œufs—Départ—Ile de Bonaventure | 360 | ||
| La Grande-Rivière—Un sourd—Instruction religieuse—Avantages matériels—Un catéchiste—Le naufrage anglais—Au pied de la grande échelle—Pointe-au-Genièvre—Richesses de la mer | 382 | ||
| Le Port Daniel—La mère Christine et ses miliciens—Paspébiac—Le feu des Roussi—Emmanuel Brasseur—Bonaventure—Les Acadiens—Un original—Cascapédiac | 402 | ||
| Carleton—Un musée—Dalhousie—Un combat naval sur le Ristigouche—François Coundeau—Village de Ristigouche—Traditions—Pitre Baskette et son canot d’écorce | 425 | ||
| Retour—Lutte entre l’Hubert Paré et la Sara—Les esterlets—Petit-Rocher—La croix—Nipisiguit—Philippe Hesnault et le Père LeClercq—Premiers colons du Nouveau-Brunswick et de l’île Saint-Jean—Caraquet—Coutumes et costumes—Huîtres—Insulte à la Vieille—Gros temps—La Nancy—La baie de la Trinité—La Grosse-Ile—Arrivée à Québec—Conseil—Adieux | 449 | ||

Note de Transcription
Les mots mal orthographiés et les erreurs d’impression ont été corrigées. Lorsque plusieurs orthographes se produisent, l’utilisation de la majorité a été employé.
Ponctuation a été maintenue sauf si évidente erreurs d’impression se produisent.
L’orthographe et la ponctuation reflètent les moments où le livre a été écrit et ou publié.
Certaines illustrations ont été déplacées pour faciliter la mise en page.
Une couverture a été créée pour ce livre électronique et est placée dans le domaine public.
[Fin de Les Soirées canadiennes Tome I, par Joseph-Charles Taché (ed.), Various.]