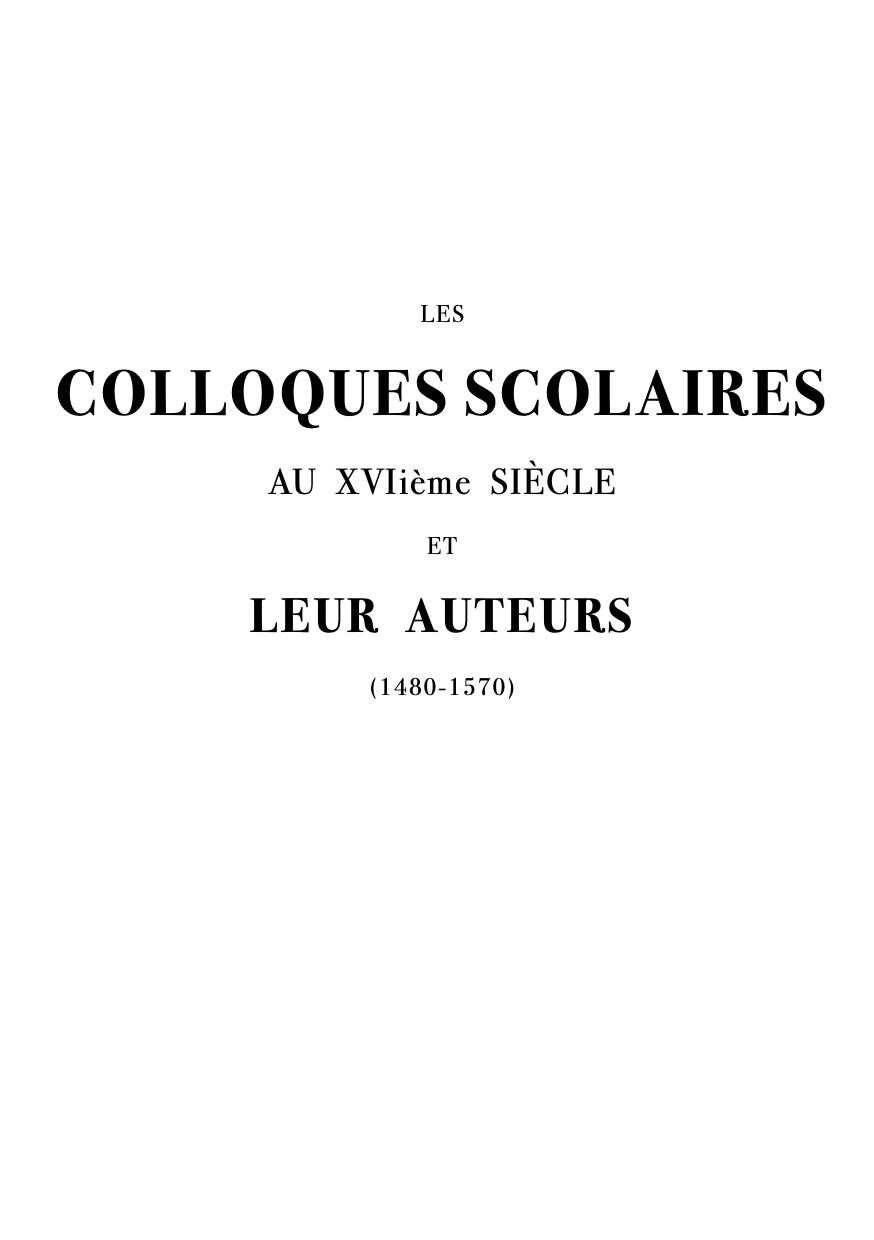
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: Les Colloques Scolaires Du Seizième Siècle et Leurs Auteurs (1480-1570)
Date of first publication: 1878
Author: Louis Massebieau (1840-1904)
Date first posted: October 30, 2025
Date last updated: October 30, 2025
Faded Page eBook #20251027
This eBook was produced by: rmedinap, Howard Ross & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
This file was produced from images generously made available by Internet Archive.
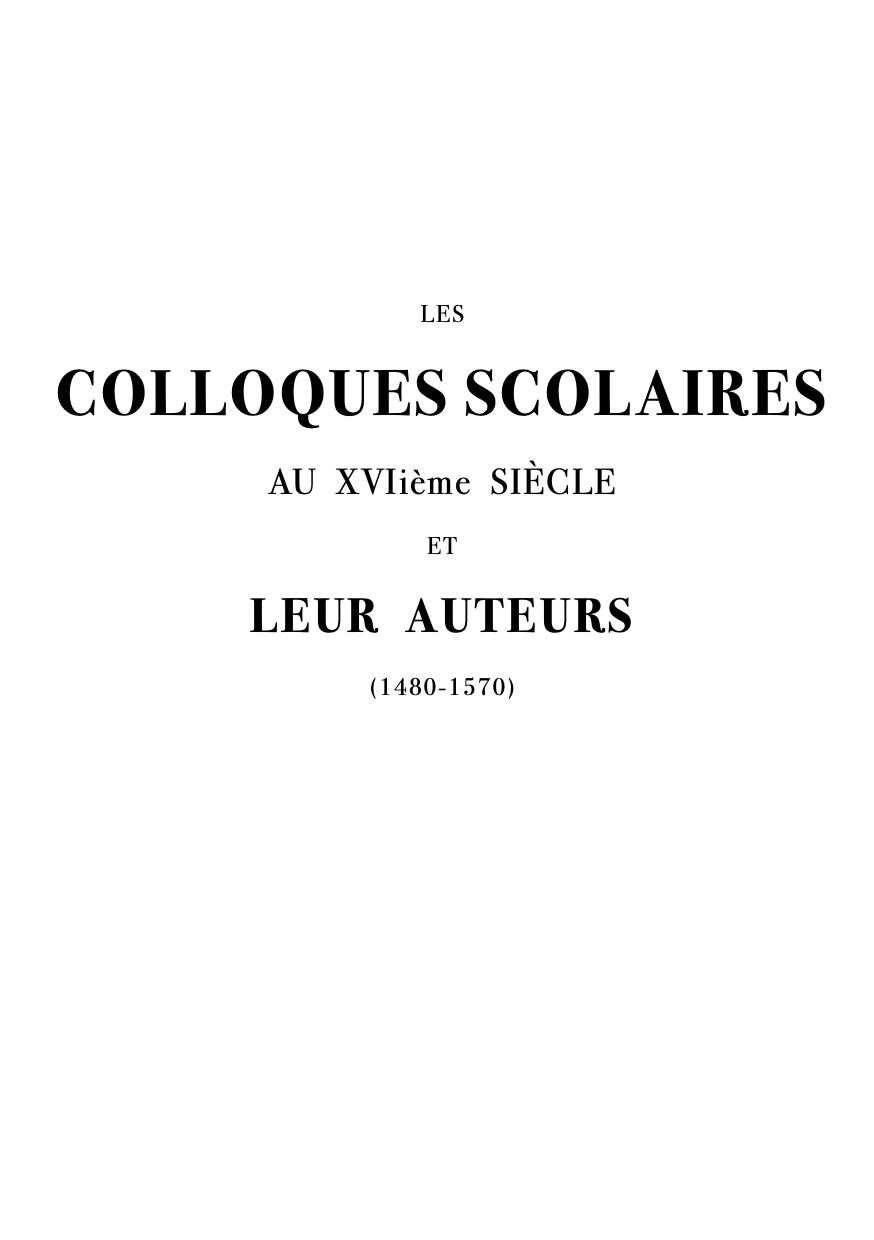
IMPRIMERIE D. BARDIN, A SAINT-GERMAIN.
LES
COLLOQUES SCOLAIRES
DU SEIZIÈME SIÈCLE
ET
LEURS AUTEURS
(1480-1570)
PAR
L. MASSEBIEAU
PARIS
J. BONHOURE ET Cie, ÉDITEURS
48, RUE DE LILLE, 48
1878
A
MONSIEUR E. EGGER
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES LETTRES DE PARIS
MEMBRE DE L’INSTITUT
HOMMAGE RESPECTUEUX
L. MASSEBIEAU
On sait que, dans l’Europe chrétienne, le latin a été longtemps la langue des livres : son importance comme moyen de communication orale fut aussi très-considérable. Le langage latin transmis aux savants par l’Église se développa d’une manière remarquable au xvie siècle, qu’on pourrait presque appeler le siècle des professeurs, puisque les grands mouvements religieux ou littéraires prirent alors leur naissance ou leur force dans les universités. Malgré les différences, malgré les inimitiés nationales, ces centres puissants réunis par la communauté de langage formèrent alors véritablement la république des lettres. Afin de maintenir une unité si précieuse et d’y faire entrer les générations nouvelles, les professeurs, tout en s’efforçant de ramener à sa classique pureté l’idiome des anciens Romains, en propagèrent l’usage journalier avec toute l’ardeur qu’avait excitée la Renaissance. Pour atteindre leur but, ils eurent recours à plusieurs méthodes et particulièrement à celle des colloques. C’est ainsi qu’ils renouvelèrent de l’antiquité, peut-être à leur insu, mais dans tous les cas avec des développements qui en font une véritable création, le genre dont nous nous proposons d’écrire l’histoire.
L’idée fondamentale en était modeste et beaucoup plus grammaticale que littéraire ; pourtant les auteurs de ces manuels de conversation crurent vite avoir pris une belle place derrière Quintilien ou derrière Platon, chacun suivant ses préférences. Ils ne se doutaient pas que dans trois siècles, à l’exception d’un exemple illustre, leurs ouvrages tomberaient dans l’oubli ; que les curieux auraient de la peine à se les procurer ; qu’il ne resterait peut-être de celui-ci qu’un exemplaire, de cet autre qu’une pincée de cendres, de cet autre encore qu’une mention perdue dans le volumineux recueil de quelque érudit[1]. Rien de plus juste, cependant : ils devaient disparaître en même temps que l’état de choses qu’ils avaient créé.
Le seul d’entre eux qui ait mérité et obtenu la gloire, Érasme, échappe presque complètement à notre prise, parce qu’il a tellement élargi ce genre qu’il en est sorti. Quoi qu’il en dise, il s’adressait surtout aux lettrés et aux gens du monde. Presque tous ses dialogues, d’ailleurs si connus, sont d’un moraliste ou d’un pamphlétaire ; nous nous contenterons de signaler leur apparition et leur influence.
Ce n’est pas sans regret que nous avons écarté l’œuvre d’un grand homme. Notre sujet semble ainsi avoir perdu en éclat plus qu’il ne gagne en nouveauté. On peut croire que nous n’avons étudié que de faibles imitateurs ou l’habileté puérile de quelques pédagogues. Dans ces ouvrages, dira-t-on, où est la pensée ? Car ils ne paraissent traiter que des mots. Où est même la philologie ? Car les essais étymologiques de la Renaissance sont presque toujours ridicules. Peut-on considérer avec plaisir cette contrefaçon de l’antiquité, ces maîtres et ces disciples qui balbutient la langue de Cicéron sous un habit si différent de la toge ? N’eût-il pas mieux valu laisser les ombres de ces faux Romains errer gauchement dans les brumes de leur Louvain ou de leur Cologne du xvie siècle ?
Nous croyons cependant qu’il n’est pas inutile de montrer comment une langue presque populaire au moyen âge s’est polie entre les mains des savants sans cesser de rester vivante. Mais surtout les colloques sont des copies fidèles et souvent minutieuses des mœurs de ces temps. Si nos auteurs n’ont pas eu l’esprit d’Érasme, force leur a été de suppléer au talent par l’observation, car ils ne pouvaient réussir qu’en reproduisant avec exactitude la vie et les pensées des écoliers auxquels ils prétendaient fournir des phrases pour chaque circonstance. Or, n’oublions pas que beaucoup de ces écoliers étaient des hommes.
Comme ces maîtres appartiennent à des universités et à des nations diverses, leurs ouvrages nous transporteront en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Espagne, en France et jusque dans le Nouveau-Monde ; ils nous feront ainsi connaître les différences que mettaient les lieux dans l’aspect si uniforme à tant d’égards du monde latin. A l’action des lieux devra se joindre celle des temps, car les colloques se succèdent de 1480 à 1570, et nous verrons ainsi se modifier avec les années cette physionomie universitaire du XVIe siècle, qui de loin paraît immobile.
J’ai dit que ces auteurs écrivirent d’abord pour des jeunes gens et des hommes. Ils ont donc pris parti dans la grande lutte entre le catholicisme et la Réforme. D’ailleurs, on ne songeait pas de leur temps à séparer l’éducation et les lettres de la religion. Grâce à eux, nous avons comme des fragments de mémoires sur l’état religieux des esprits à Leipzig avant Luther, à Cologne et à Louvain dans les commencements de la Réforme, et enfin beaucoup plus tard à Genève, devenue la ville de Calvin. Nous essayerons à l’occasion de réunir ces traits en tableaux distincts : il y a profit à contempler ces lointaines agitations avec impartialité, je ne dis pas avec indifférence.
Pénétrons donc dans ces villes ressuscitées, où l’Église domine maisons et collèges. Nos guides ne seront pas toujours des pédants à l’esprit étroit : ils auront quelquefois des noms célèbres et des idées dignes de leur nom. Car si Schottennius et Salazar sont des inconnus, si Barland n’est qu’estimable, il y a quelque chose d’héroïque dans Mosellanus ; Vivès est illustre, et Cordier, à force de bonté, touche à la grandeur. Nous essayerons d’ailleurs de faire revivre les auteurs aussi bien que leurs ouvrages. L’éloignement d’Érasme permettra de distinguer, avec leurs traits caractéristiques, un certain nombre d’hommes remarquables, qui ne méritaient pas chacun son livre et qu’unit un même amour pour le langage qu’ils considèrent tous comme la plus noble faculté de l’espèce humaine.
Nous ne craignons donc pas de manquer de matière, mais plutôt de mettre trop imparfaitement en œuvre la matière si variée et si abondante qui nous est offerte.
Notre travail se divise naturellement en deux parties. Dans la première, nous examinerons l’état du latin considéré comme langue vivante au moyen âge et aux débuts de la Renaissance. Nous verrons naître les colloques et nous présenterons le tableau de leur succession.
La seconde partie sera plus étendue. Nous y étudierons, dans une suite de chapitres, d’après l’ordre des temps qui, par une heureuse rencontre, se confond ici avec celui des lieux, les plus remarquables d’entre les colloques. Nous caractériserons chaque auteur en même temps que son ouvrage et que l’académie pour laquelle il le composa ; présentant ainsi sous ses aspects divers le maître du xvie siècle jusqu’au moment où, perdant de son importance, il s’enferme dans les écoles avec un langage qui a semblé un moment capable de devenir universel et qui meurt dans l’ombre des classes.
Oserons-nous, en terminant, dire un mot des difficultés que présentait la réunion des éléments de ce travail ? Il s’agissait non-seulement de mettre en œuvre, mais de trouver les matériaux, de constituer la série dont nous soupçonnions l’existence et l’intérêt. Il est possible que, malgré nos efforts, le tableau général de l’histoire des colloques demeure incomplet. Qu’il nous soit permis de remercier M. Egger, qui nous a fait connaître les ἑρμηνεύματα de l’antiquité et qui nous a encouragé en approuvant l’idée première de cet ouvrage ; M. Carrière, secrétaire de l’École des langues orientales, qui nous a indiqué le Manuale scholarium de 1480, et enfin M. Icazbalceta et M. Schlœsing. Le premier nous a envoyé de Mexico, copiés de sa main sur l’exemplaire unique, quatre dialogues de Salazar ; M. Schlœsing a bien voulu nous servir d’intermédiaire auprès de M. Icazbalceta.
|
Il s’agit des dialogues de Salazar, de Jean Sturm et de Cornelius Crocus. Voir, à la fin de la première partie, le tableau de l’histoire des colloques. |
Avant d’aborder les colloques, il convient de s’enquérir des circonstances auxquelles ce genre si particulier a dû son origine et son succès, ainsi que les limites de ce succès. Leur objet n’ayant pas été de créer mais seulement d’épurer l’usage d’une langue qu’on peut considérer aujourd’hui comme tout à fait morte, nous commencerons par nous demander quelles étaient, avant leur apparition, la vitalité de cette langue et l’étendue de son domaine. Nous chercherons ensuite ce qu’elle était devenue dans la bouche des prêtres, des docteurs et même des artisans, pour avoir traversé le moyen âge. En troisième lieu, ce qu’aurait dû faire la Renaissance en présence du développement des idiomes nationaux, et si c’est uniquement par enthousiasme et par routine qu’elle restaura l’enseignement du langage d’une civilisation si différente de celle des temps modernes. Enfin, nous énumérerons les moyens dont on se servit pour cette entreprise et nous assignerons leur rang aux colloques parmi ces moyens.
Si nous en croyons Laurent Valla, qui écrivait vers 1450, la langue nationale est sans contredit le latin. Il ne s’agit pas seulement de l’Italie : une telle illusion n’aurait rien d’étonnant, à l’époque où Philelphe ignorait pour ainsi dire la langue du Dante ; mais l’affirmation s’étend à toute l’Europe. « La gloire la plus pure de nos ancêtres, dit Valla, qui s’intitule patricien romain, c’est d’avoir donné aux nations la langue latine, présent divin, vraie nourriture de l’esprit. Nous avons perdu Rome, perdu l’empire et perdu la domination, non par notre faute, mais par le malheur des temps ; cependant, grâce à cette domination plus éclatante, nous régnons encore sur une grande partie de la terre. A nous est l’Italie, à nous la Gaule, à nous l’Espagne, la Germanie, la Pannonie, la Dalmatie, l’Illyrie, et beaucoup d’autres contrées. Car l’empire romain n’est-il pas partout où domine la langue romaine ?... Chez nous, c’est-à-dire chez un grand nombre de nations, tout le monde parle romain[2]. »
Sans doute il exagère : il fallait beaucoup de dédain ou d’ignorance pour considérer les idiomes de Boccace, de Froissard et d’Ayala comme des dialectes méprisables ; pour confondre le romain avec le roman ; pour ne voir dans les rejetons qui grandissaient autour de la souche que des végétations parasites. Cependant, par rapport à une de ces contrées qu’il dénombre avec tant de complaisance, son affirmation était entièrement exacte. La Pannonie, ou mieux la Hongrie, (car la désignation ancienne est trop incomplète) semblait entièrement peuplée de descendants des légionnaires. L’idiome magyar y existait à peine. Le plus ancien monument qu’on en connaisse et qui n’est pas antérieur au XIIe siècle demeurait caché dans un manuscrit latin[3]. La langue savante étouffait l’autre, comme les végétaux européens transportés en Australie y affament les plantes indigènes, et cette accablante domination devait durer plusieurs siècles. Nous ne nous autoriserons pas pour le prouver du cri des magnats en faveur de Marie-Thérèse. Voici un fait autrement significatif quoique moins connu. Un des premiers vocabulaires magyars fut écrit en latin. Tel est l’intermédiaire dont il fallut se servir pour interpréter à une nation un des éléments les plus intimes de son caractère, c’est-à-dire sa propre langue.
Parmi les provinces de la la latinité, Valla n’avait pu comprendre ni l’Angleterre où la domination romaine, passagère et détestée, avait été sans influence sur la littérature nationale, ni le Mexique dont la découverte devait se faire attendre encore soixante ans. Dans ces deux pays, la culture latine sera brillante mais tardive. Au contraire, l’idiome de l’Espagne n’était encore au xiie siècle que du latin plus ou moins altéré.
Dans toutes ces contrées, l’action civilisatrice de l’ancienne Rome avait été fortifiée ou remplacée par celle de la Rome chrétienne dont Valla oublie singulièrement l’influence. C’est l’unité de culte qui maintenait dans ce vaste empire l’unité de langue. C’est dans les églises et dans les écoles dont la physionomie était nettement ecclésiastique, qu’il faut chercher la chaîne vivante du langage par lequel le présent s’unissait sans interruption au passé. Omettons les faits extérieurs et sans importance. Ne nous arrêtons pas à signaler les consultations orales des médecins, ni à faire observer que nos avocats, après avoir plaidé longtemps en latin, furent invités en 1487 à reprendre de temps en temps l’usage de cette langue en l’honneur des ambassadeurs étrangers. Convenons rapidement avec Barland[4] que ces ambassadeurs auraient eu honte de ne pas savoir s’exprimer comme des sénateurs antiques ; mais plaçons bien au-dessus de leurs discours et de toutes les harangues de cérémonie, les sermons prêchés en latin jusqu’au xvie siècle « devant le peuple mêlé des fidèles[5]. » Il y avait entre ce latin et l’idiome vulgaire encore dans l’enfance des ressemblances évidentes et des affinités secrètes qui assuraient la communication générale des idées. Le prédicateur faisait tout son possible pour être clair : de son côté la foule le secondait par cette intuition que nous remarquons encore non moins étonnante dans nos provinces du Midi où beaucoup de ceux qui ne parlent que leur patois entendent suffisamment le français. Remarquons-le, ce n’est pas brusquement que les litanies et les chants d’église cessèrent d’être compris : la tradition en conserva longtemps le sens, la mère expliquant à sa fille ce qu’elle avait elle-même appris de sa mère. On n’est pas trop surpris de lire dans le récit d’un Espagnol[6], qui visita la Flandre en 1549, qu’à cette date on parlait latin à Louvain par toute la ville, même dans les boutiques des artisans, même aux femmes. Et à Lille, les petits mendiants disaient au coin des rues : « Date bonis pueris panem pro Deo[7]. »
Nous avons dû prendre nos exemples dans les grandes villes, et surtout dans les villes d’université. L’influence conservatrice de l’Université de Paris, sur ce point comme sur tant d’autres, fut considérable. Pendant plusieurs siècles, l’usage de l’idiome vulgaire fut interdit à ses écoliers. S’ils n’étaient peut-être pas, comme on l’a dit[8], au nombre de trente mille, il faut cependant les compter par milliers. Ils étaient entourés par tout un peuple de suppôts qui partageant leurs privilèges étaient tenus à la même obligation. C’est en latin que les messagers, les grands et les petits, doivent s’entretenir avec leurs clients. Il en était de même des papetiers. En 1537, l’un d’entre eux, auquel le recteur faisait dans une harangue latine des reproches sur ses fournitures, lui ayant dit : « Parlez français, je vous répondrai, » fut mis en cause devant le Parlement[9]. Que dirons-nous des hôteliers et des marchands de toute sorte avec lesquels les écoliers entretenaient de fréquents rapports ? Sans cette langue universelle, que seraient devenus les étudiants accourus de toutes les parties de l’Europe, Anglais, Allemands, Espagnols, Provençaux, Grecs même, si l’on en croit du Boulay ? Le latin leur permettait d’être partout chez eux : ils contribuaient à le répandre quand ils retournaient tous les ans, par centaines, chacun dans sa patrie. Mais il y avait des universités ailleurs qu’à Paris et qu’en France. Si donc on fait la part de cet élément toujours jeune et toujours renouvelé et qui appartenait en général aux familles pauvres, si on la joint à celle de la tradition que nous avons essayé de dégager, on admettra facilement qu’un peu avant la Renaissance, une partie notable des populations entendait la langue latine et même la parlait tant bien que mal.
|
Amisimus Romam, amisimus regnum, amisimus dominatum, tametsi non nostra sed temporum culpa ; verumtamen per hunc splendidiorem dominatum in magna adhuc orbis parte regnamus. Nostra est Italia, nostra Gallia, nostra Hispania, Germania, Pannonia, Dalmatia, Illyrium, multæque aliæ nationes. Ibi namque romanum imperium est, ubicunque romana lingua dominatur... apud nos, id est, apud multas nationes nemo nisi romane... loquitur. (Laur. Valla, Élégances latines, préface.) |
|
E. Sayous, les Origines et l’époque païenne de l’histoire des Hongrois, p. 34. |
|
Dialogue XXI. — Voir aussi une anecdote sur les discours latins des ambassadeurs, dans le traite d’Érasme de Recta pronuntiatione. |
|
Tout en reconnaissant qu’on avait depuis longtemps commencé à prêcher en langue vulgaire, nous nous associons aux réserves de M. Hauréau (H. litt., XXVI, 388-90) contre la théorie de M. Lecoy de la Marche (la Chaire franç. au moy. âge, p. 219-46), d’après laquelle, même avant le xiiie siècle, les sermons aux laïques auraient été d’ordinaire prêchés en français, quoiqu’ils nous aient été transmis en latin. M. Hauréau objecte : 1º que les prédicateurs nous avertissant lorsque leurs sermons écrits en latin ont été prononcés en français, supposer que ceux qui ne sont pas précédés de cet avertissement ont été également traduits en latin, est une simple conjecture ; 2º que les textes contredisent souvent cette conjecture. Ainsi il arrive à des prédicateurs parlant devant des laïques de traduire en français des phrases qu’ils avaient d’abord dites en latin. Ex. : « Dicitur in gallico : Talis ridet in mane qui in sero plorat. Tel rit au mein qui au soir plure. » M. Hauréau ajoute : « Nous avons en latin la plupart des sermons qui nous ont été transmis comme ayant été prononcés durant l’espace de cinq siècles, du xie au xvie, les dimanches et les jours fériés, devant le peuple mêlé des fidèles. Est-il donc vraisemblable qu’après les avoir recueillis en français, on les ait ainsi constamment traduits en latin pour les rendre moins intelligibles ? Certains prédicateurs ont eux-mêmes, dès le xiiie siècle, réuni leurs sermons en un corps d’ouvrage. Peut-on supposer qu’ils les ont traduits, uniquement pour nous tromper ? » D’ailleurs, le concile de Trente (XXIV, vii) n’eût pas ordonné de prêcher au peuple en langue vulgaire si on ne lui avait pas prêché en latin. |
|
Calvete de Estrella, cité par Félix Nève, dans son mémoire sur le collège des trois langues, p. 116. |
|
A. Monteil, Histoire des Français des divers états, t. II, xve siècle, p. 13. |
|
Hist. litt., XXIV, p. 247. — A. Monteil. |
|
Monteil, III, p. 126, d’après du Boulay. |
Ne différons pas plus longtemps un aveu que le bon sens et la réalité historique nous pressent de faire. Ce latin, qui s’opposait ainsi à l’essor des idiomes modernes, en les recouvrant et pour ainsi dire en les pénétrant par en haut après les avoir supportés à leur origine ; cette enveloppe qui les serrait de toutes parts sans qu’on pût toujours distinguer la surface de séparation ne ressemblait guère au tissu pur et brillant des phrases classiques. Usée, déchirée, souillée, elle était devenue méconnaissable. Spectacle affligeant sans doute pour le lettré, mais curieux pour le philosophe, car il y surprend l’activité d’un de nos instincts généralement comprimé, atrophié, dont la durée tient du prodige et dont beaucoup ont contesté l’existence. On impose à l’homme qui paraît à son tour sur la terre les mots et les tournures dont il doit se servir, comme on lui impose les formes de son vêtement. Il est obligé de verser sa pensée dans des moules, parfaits si l’on veut, mais refroidis et inflexibles, que ses prédécesseurs ont construits à leur convenance. Esclave des grands écrivains, il n’a que le choix de ses maîtres. Tandis que l’idiome d’une tribu sauvage change presque à chaque génération et, après avoir été soigneusement recueilli par un voyageur, n’est plus, au bout de cinquante ans, intelligible pour un autre, nous, scrupuleusement fidèles à la tradition, nous faisons resservir sans relâche des termes fatigués par un long usage, jusqu’au moment où la civilisation changeant encore, l’instinct du langage, toujours vigoureux comme une partie essentielle de l’âme humaine, brise une fois de plus sa frêle prison et, des débris, refait pour la pensée une demeure plus commode, parée de l’éclat de la nouveauté, plus durable peut-être, mais certainement temporaire.
Le psychologue aime donc à voir au moyen âge une religion et une société nouvelles élargir et au besoin dénaturer la langue latine avec une ardeur inconsciente. La synthèse fait place à l’analyse ; les harmonieuses mais savantes complications de la syntaxe sont délaissées pour un enchaînement de propositions simple et uniforme. Surtout le vocabulaire s’accroît, tantôt par des dérivations logiques, tantôt par une invasion de mots étranges, qui, une fois revêtus de la terminaison latine, sont acceptés au rang des autres. Saint Prosper avait dit que la latinité ne consiste pas dans une élégance fleurie, mais dans la précision et la clarté[10]. On agissait d’après cette définition, sans la connaître. C’est ainsi que, dans son traité sur la fauconnerie[11], Frédéric II ne chercha pas péniblement des périphrases pour faire deviner ce qu’il voulait dire, mais il emprunta sans hésiter à la langue vulgaire les termes techniques qui avaient été trouvés au fur et à mesure des besoins par les fauconniers, suivant les règles de la nature. Puisque dans une langue chaque art a son dialecte particulier, il était inévitable que tant d’arts nouveaux enrichissent la langue latine ; tant de peuples si divers de génie, en s’accordant à en faire usage, ne pouvaient pas ne pas la modifier. Taxée autrefois d’indigence par Sénèque[12], on avait pu la croire incapable d’exprimer en philosophie des notions précises : maintenant elle fournit aux subtilités chaque jour nouvelles de la dialectique ; elle est supérieure en un sens à ce qu’elle était du temps de Sénèque, de même que sous la plume du stoïcien romain elle était bien différente du langage qui avait suffi par exemple aux contemporains de Cincinnatus, pour noter le petit nombre de leurs idées.
N’oublions pas d’ailleurs que tant d’efforts accumulés dans une langue qui va cesser d’être vivante ne seront pas perdus. Au jour de la dissolution, ces richesses se répandront dans les jeunes idiomes, comme les glaces en fondant grossissent le fleuve dont elles avaient gêné le cours. Ainsi non-seulement le plus grand nombre des idées abstraites, mais les mots créés pour les représenter seront recueillis et servent encore de nos jours. Pour ce qui concerne particulièrement la France, l’esprit de la dialectique, dont la domination fut chez nous si longue, en quittant peu à peu son ancien corps, incarnera dans notre langue ce qu’il avait de réellement heureux, c’est-à-dire l’ordre et la précision. Ces qualités se trouveront ainsi avoir passé dans le caractère national.
Malheureusement, à l’action inconsciente des écrivains comme Frédéric II et des philosophes se joignirent des théories sorties, les unes des couvents, les autres des écoles et qui au lieu de transformer la langue la gâtèrent sans aucun profit.
Les moines[13] prétendirent, au xive siècle, qu’il fallait dédaigner les règles purement humaines, et ils firent de parti pris des barbarismes et des solécismes[14].
Quant aux maîtres, pour se distinguer du vulgaire, ils fabriquèrent un vocabulaire pompeux et ridiculement inintelligible avec une grammaire à l’avenant.
Tel fut le Grécisme d’Ébrard qui s’imposa aux écoliers pendant près de trois siècles, car il parut en 1212[15], et fut au nombre des livres classiques qu’étudiait Érasme à Deventer, en 1476[16]. On le trouvait encore dans les écoles de Paris à la fin du xve siècle, malgré la vogue du Doctrinal, car nous en avons une édition de 1487, publiée à Paris par Pierre Levet[17].
C’est à la fois un vocabulaire et une grammaire. La grammaire débute par un traité des figures dont les noms sont tirés du grec. Les moindres phénomènes du langage sont notés et étiquetés. Ce pédant nous apprend avec importance qu’il y a cathatiplosis quand on vous donne le nom de votre père ou de votre mère ; hidiopasis, quand par exemple je m’aime, vous vous aimez ; allopasis, quand je vous aime ou que vous m’aimez. Une phrase qui commence et finit par le même mot, c’est une anapolensis[18]. Tout cela mis en vers barbares qu’Érasme dut réciter dans son enfance, sous peine d’être fouetté.
Quant au vocabulaire, qu’on en juge par ce fragment :
Cauma cremat, sed spuma est casmia, casme coruscat.
Casmia femineum : cetera neutra duo.
Ce n’est pas du latin, et les deux derniers mots ne sont même pas du grec. Il faut recourir au commentaire de Métulin, qui est imprimé en petits caractères, au-dessous des vers. « Casmia est spuma auri vel cujuslibet metalli. Casma, tis, est fulgétia seu fulgur. »
Lorsque Ébrard descend aux mots ordinaires, véritables, c’est pour faire des distinctions étranges.
Labra virorum sunt sed labia sunt mulierum[19].
Vel dicas quod erit melius. Dic inferiora
Labia. Labra quoque contrà dic superiora.
Ces aberrations s’expliquent. On ne connaissait les anciens que de nom par Boèce, ou par les écrits des Pères ; de plus, on les tenait pour la plupart en défiance comme païens et même comme sorciers. A les trop aimer, on risquait de se faire appeler cousin du démon[20]. Les maîtres les plus éclairés mettaient Alcuin, Bède, saint Ambroise et les traductions latines d’Aristote sur la même ligne que Cicéron. Martial, connu par une de ses épigrammes, était appelé Martialis coquus. Dans cette pénurie, si l’on ne voulait pas se réduire à l’enseignement du jargon des moines, la tentation était grande d’en composer un autre plus ambitieux. On avait commencé par chercher dans les livres qu’on avait sous la main les mots les plus bizarres, mais cependant à peu prés latins, et on en avait composé des phrases comme celle-ci : « Quo ilicet experrectus crepitaculo, semihulcos meticulose retegens ocellos, toralque involucro præ vultu clanculo corrugatim objectans, etc.[21]. » Cela se comprenait encore. On ne fut satisfait que par les inventions d’Ébrard et par le Cornutus. Le Cornutus, ainsi nommé des cornes des bœufs, parce qu’il se compose de distiques à double sens, à double pointe, est le chef-d’œuvre du genre :
Cespitat in faleris ipus blattaque supinus,
Glossa velut temeto labat hemus infatuato.
Voilà le premier distique. Érasme, qui les avait tous appris à Deventer (il n’y en a par bonheur que vingt-trois), leur garda rancune, et il s’écriait longtemps après : « Quel siècle que celui où l’on expliquait à grand appareil, devant la jeunesse, les distiques de Jean de Garlande[22] ! »
On apprenait aux élèves émerveillés que blatta signifiait pourpre, et hemus homme, tandis que le vulgaire devait se contenter de purpura et de homo.
Mais le bon sens ne perd jamais tout à fait ses droits. Il reparut précisément sous la plume de Jean de Garlande (xiiie siècle). Après avoir fait montre d’érudition et d’invention, celui-ci comprit que le vrai moyen d’être utile, c’était de réunir dans un livret de quelques pages les expressions les plus usitées du latin populaire, et de mettre ainsi ses élèves en état de soutenir une conversation. Son nouvel opuscule, si l’on n’en considère que le but, serait une sorte d’ébauche de nos colloques, dont on surprendrait ainsi l’idée générale, cherchant sa forme et en trouvant provisoirement une assez heureuse. Car, bien que Garlande n’ait prétendu faire qu’un dictionnaire il ne suit pas l’ordre alphabétique, et se sert de petites phrases familières. Son artifice est de raconter ce qu’il a vu, ce que chacun pouvait voir en regardant autour de soi dans Paris. Ici, c’est le voisin Guillaume qui vend sur la place des aiguilles, des pierres à fusil, etc. Là, c’est un autre voisin qui porte au bout d’une perche des souliers à lacets et des souliers à boucles. Ailleurs, il s’agit des foulons qui, nus et haletants, foulent le poil et la laine, qui exposent le drap au soleil[23]. Ce n’est pas encore le dialogue, mais ce n’est plus le vocabulaire.
Il ne faut pas croire que l’auteur ait employé cette forme presque anecdotique par amour de l’art ou pour le plaisir de ses élèves ; il pensait avec raison qu’il leur serait ainsi plus facile d’apprendre son livre par cœur[24]. Car, outre qu’il est nécessaire de savoir les mots si l’on veut parler, le meilleur moyen d’avoir un exemplaire correct d’un ouvrage, c’était alors de le graver dans sa mémoire. Les copistes n’étaient pas rares, mais leur ignorance rendait souvent les textes inintelligibles. Que dire des transcriptions des écoliers ? On les forçait donc à tout mettre, non sur le papier, mais in cordis armariolo, comme dit le préambule de Garlande.
C’est ce qui explique les précautions d’Ébrard dans les vers suivants. Elles n’auraient pas eu de raison d’être, si les écoliers avaient pu remarquer la différence d’orthographe sur le papier :
Lignum de fuste, sed lychnus dicitur esse
Ardendi causa quia volvitur undique cera.
Garlande a le mérite d’avoir essayé de substituer une prose agréable aux vers techniques. On connaît l’Olla patella. Voici des vers de Matthieu de Vendôme[25], que devait apprendre, d’après leur auteur,
Quisquis abundare cupit in sermone latino,
Atque reservare quæ mens cito lubrica fundit.
Glis animal, glis terra tenax, glis lappa vocatur
Ris animal, sis terra tenax, tis lappa vocatur.
Sic genus istius dignoscitur et genitivus...
A braccos braccare venit, lumbareque lumbis...
......Enucleat atque revelat,
Insignat, retegit, edisserit atque retexit,
Duplicat et pandit, ævo dat, promit et edit,
Nuntiat, exponit, elucidat atque serenat,
Explicat, exercet, declarat vel manifestat,
Exprimit et reserat, propalat, indicat atque
Notificat, verbis his sensus convenit idem.
On pense que la liste est complète, mais l’auteur reprend haleine et il ajoute :
Expedit, evolvit, aperit, nudatque recludit.
Quant à Garlande, en même temps qu’aux vers il avait tout à fait renoncé au style noble et même à la correction : Capellarii faciunt capella de fultro... In pertica una, au bout d’une perche. Des souliers à lacets, solutares ad laqueos. L’Université elle-même, quand elle s’exprimait par la bouche de ses dignitaires, mais avec la pensée d’être intelligible, usait d’une langue aussi ridicule que celle des médecins de Molière. Voici par exemple comment s’exprimait, en 1445, le procureur de Martignac, parlant au nom de la nation française : Placuit nationi remediare et obviare abusibus commissis vel committendis per nuntios nationis. Vult specialiter quod fiat una distincta tabula omnium diæceseon, etc. L’histoire de l’Université de du Boulay est presque toute en documents de ce style.
Faut-il descendre au langage des écoliers ? Il est naturellement encore plus mauvais. Mathurin Cordier nous a conservé le jargon en usage au collége de Navarre en 1530, et qui mérite un examen particulier. Contentons-nous d’en citer ici deux ou trois phrases : Semper gratat se. — Facit morguentam suam. — Vadamus ad promenandum nos. On ne s’étonne plus maintenant de la facilité des artisans de Louvain à parler latin. A vrai dire, l’ancienne langue, vigoureuse dans les premiers siècles du moyen âge, s’est maintenant, sous l’action chaque jour plus énergique des idiomes modernes, décomposée et comme réduite en fumier. Il faut qu’elle disparaisse ou qu’elle renaisse dans des conditions toutes différentes.
|
Ea est, ni fallor, judicata latinitas, quæ breviter et aperte, observata dumtaxat verborum proprietate, res intelligendas enuntiat, non quæ vernantis eloquii venustate luxuriat. — Saint Prosper, lib. III, de vite contemplanda. Cité par du Cange, préface. |
|
Ita Fredericus II, imperator de aucupio per falcones, quod veteribus incognitum fuit scripturus, hæc præfatur : « Nam quum ars habeat sua vocabula propria, etc. » — Préface de du Cange. |
|
Epître 58. |
|
Hist. litt., XXIV, p. 382-391. |
|
J’ouvre au hasard le tome XX du Recueil des historiens de la France : in quodam castro regis Franciæ quod dicitur Chasteau-Landon, quidam maleficus et sortilegiator cuidam abbati de ordine cisterciensi promiserat magnam pecuniæ summam ab ipso perditam facere restitui, necnon fures pecuniarium sibi facere nominari. Modus autem per quem venire voluit et credidit dictus sortilegiator obtinere intentum : Catum enim sumens nigrum, etc. — T. XX, p. 633. Continuatio chronici Guillelmi de Nangiaco, après 1300. |
|
Anno milleno centeno bis duodeno Condidit Ebrardus græcismum Bethuniensis. Hist. litt., XVII, p. 129. |
|
Prælegebatur Ebrardus et Joannes de Garlandia. — Vita Erasmi, Erasmo auctore. |
|
Ebrardus Bethunensis Græcismus du figuris et octo partibus orationis cum expositione Johannis Vincentii Metulini aquitannici in Pictaviensi universitate regentis. Parisiis per Petrum Levet, 1487, in-fol. — Bibl. nat., X, 314 A. Voici un échantillon du style de la préface. C’est le début : Quoniam ignorantiæ nubilo turpiter excecati quidam imperiti fatuitatem exprimentes asinivam chimerinas imaginantes statuas : nescio quid inopinabile somniantes : dictionum discrepantiam matrimonio non legali copulant inconcinne. Succurrendum opinioni eorum fore existimavi, etc. |
|
Est cathatiplosis quando sub nomine patris Vel matris sive alterius persona vocatur. Diligo me tu te solet hidiopasis esse. Allopasis te me me vel te diligit ille. Extat anadiplosis quum finit ut incipit ille, Incipit et finit verbo anapolensis eodem : Multa super Priamo rogitans super Hectore multa. (Lib. I, de Figuris.) Ces distinctions remontaient d’ailleurs à l’antiquité. Voir l’Anthologie latine de Riese, fasc. II, p. 16 de Figuris vel Schematibus. Carmen Codicis parisini, 7530. |
|
On fait de ces distinctions chez les Bassoutos. Les noms des mois n’y sont pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Mais je doute que les Romains aient connu les distinctions indiquées par Ébrard. |
|
Consanguineus dæmonis. Vivès, dans le dialogue intitulé Sapiens. |
|
Hist. litt., XXII, p. 9. Tiré de la préface d’un dictionnaire anonyme du xiie siècle. |
|
On en connaît deux éditions du xve siècle dont la première (1481) est citée par Brunet. La Bibliothèque nationale n’a ni l’une ni l’autre. C’est un vide à remplir, puisqu’il s’agit d’un auteur français. Nous avons bien aux manuscrits le no 7679, du xve siècle. Mais l’écriture du commentaire y est très-fine et pénible à déchiffrer. M. Leclerc cite ce manuscrit Hist. litt., XXII, p. 101. |
|
Voir ce Dictionnaire réimprimé par Géraud (Documents inédits sur l’histoire de France). On a été longtemps incertain sur l’époque de la vie de Garlande. Elle a été enfin fixée d’après deux vers de son poëme de Triumphis Ecclesiæ où il dit qu’il recommence à versifier en 1245. V. Hist. litt., XXII, p. 94. |
|
Dictionarius dicitur libellus iste a dictionibus magis necessariis, quas tenetur quilibet scolaris, non tantum in scrinio de lignis facto, sed in cordis armariolo retinere, ut ad faciliorem orationis constructionem et enuntiationem possit pervenire et primo ut sciat vulgaria nomina. (Préface de Garlande.) |
|
Dans Leyser, Historia poetarum medii ævi, p, 312 et suiv. |
La scolastique devait régner longtemps à Paris, à cause du caractère théologique de l’Université et de l’importance de ce grand corps. Mais ailleurs sa durée fut plus courte, surtout en Italie, où la gloire des auteurs classiques était considérée comme nationale. Nous ne voulons pas refaire une fois de plus l’histoire de la Renaissance latine. Il suffit de signaler Pétrarque découvrant au xive siècle tant de manuscrits et surtout les Institutions oratoires de Quintilien, qui devinrent le manuel des maîtres et contribuèrent peut-être plus qu’on ne pense à la nouvelle direction des esprits : le Pogge continuant l’œuvre de Pétrarque et nous rendant, par exemple, Plaute et Lucrèce ; Philelphe, Laurent Valla et tant d’autres qui n’attendirent pas la prise de Constantinople pour se tourner du côté de l’antiquité et pour s’abreuver à ses sources avec un véritable enivrement.
Ils n’eurent pas de peine à communiquer leur enthousiasme à leurs concitoyens. Philelphe dut donner cinq leçons publiques par jour, et parfois professer dans la même journée à Bologne et à Padoue. Protégés par des papes éclairés, dont le plus fameux fut Nicolas V, qui était lui-même un savant, ces nouveaux missionnaires, ces pacifiques conquérants subjuguaient des foules toujours croissantes qui ne demandaient qu’à se laisser vaincre. De quelle ardeur guerrière ils étaient animés, on en peut juger par le cri de Valla : « Jusques à quand, Quirites (c’est ainsi que j’appelle les lettrés et ceux qui cultivent la langue latine), oui, Quirites, jusques à quand souffrirez-vous que votre ville soit occupée par les Gaulois, c’est-à-dire que la latinité soit opprimée par la barbarie[26] ? » Et il cherche un nouveau Camille. La liberté du Capitole, c’est-à-dire de l’Italie, ne lui suffisait pas ; il ne pouvait voir sans indignation l’Europe soumise aux Ébrard, aux Hugutio, au Catholicon, aux Aymon[27], et à tant d’autres indignes d’être nommés, qui enseignaient chèrement, dit-il, l’art de ne rien savoir ou de devenir à jamais stupide.
Quelques années après cet appel, l’Allemagne eut aussi son défenseur de la bonne cause, Rodolphe Agricola (1443-1485), qui s’était formé en Italie. Réclamé comme Philelphe par deux villes, il se partagea entre Heidelberg et Worms. « Mais, nous dit Bayle, ses auditeurs de Worms étant plus faits aux chicaneries de la dialectique qu’aux belles-lettres, n’avaient pas le tour d’esprit qu’il souhaitait. » Sur une terre encore barbare, il fut donc tenu à des ménagements pour le passé. Il enseigna même la philosophie d’Aristote, mais d’après les textes. Dans sa lettre sur les études (1484), il ose bien envelopper dans le même blâme les niaiseries de la grammaire et de la dialectique, et il les accuse aussi nettement que Valla de tuer dans son germe l’intelligence de la jeunesse. Mais aussitôt, craignant d’en avoir trop dit, il ajoute : « Je loue tous ces arts et les louerais bien davantage si on en traitait avec sagesse, car je ne suis pas assez fou pour condamner seul ce que tant de gens approuvent[28]. »
Cette prudence n’était pas inutile dans le voisinage de Louvain et de Cologne. On a lieu de croire qu’elle porta ses fruits, et que les vieilles universités témoignèrent plus de surprise que d’irritation. Mais bientôt la voix d’Agrippa n’est plus isolée. Il a pour successeurs d’abord son disciple Hégius, puis Érasme, dont il avait, dit-on, deviné le génie, dès l’année 1477, en passant à Deventer. La lutte contre les novateurs, qu’on accuse de paganisme, éclate avec violence. Nous n’avons pas à la raconter ; nous n’en retiendrons que ce qui a plus directement rapport au langage.
Cette part est encore bien importante, car il ne faut pas croire qu’on poursuivît uniquement la restitution de la pureté et de l’élégance. Dans ce cas, il eût suffi de réimprimer, en le corrigeant, l’ouvrage de Laurent Valla. Si les contemporains d’Érasme ignoraient l’histoire naturelle du langage, s’ils ne le connaissaient pas comme une faculté presque indépendante du caprice des hommes et dont le développement est réglé par un système de lois immuables, cependant ils en comprenaient toute l’importance philosophique ; ils le tenaient non-seulement pour un instrument, mais pour l’interprète nécessaire et presque le collaborateur de la raison. Je ne parle pas ici d’Érasme lui-même : ses traités sont plutôt d’un professeur de rhétorique ou d’un humoriste. Je prendrai pour preuve le manifeste de Mosellanus, car on peut appeler ainsi le discours que ce savant prononça solennellement à Leipzig, en 1518.
« Qui ne sait, dit-il, que l’usage de la parole nous a été donné par le Créateur comme un privilège qui nous élève au-dessus de la basse condition des autres animaux et nous rapproche au plus haut degré du type divin ? Ne considérons pas d’autres qualités avec complaisance, car les éléphants nous surpassent en grandeur, les lions en courage, les cerfs en agilité, les taureaux en force ; en un mot, la nature a été pour eux en tout une mère, pour nous une marâtre. La parole seule nous fait hommes. On peut trouver chez les fourmis et chez les abeilles des traces de raison. Mais jamais personne n’a eu la folie d’admettre que les bêtes participent comme les hommes à la faculté du langage[29]. » Il n’oublie pas que parmi les animaux auxquels il a reconnu de l’intelligence, quelques-uns ont des organes pareils à ceux de l’homme et peuvent articuler des sons, mais il ajoute, devançant les observations de Buffon et de Max Muller[30], que leurs facultés mentales ne sont pas assez développées, ou plutôt, et c’est entrer encore plus profondément dans la vérité tout en paraissant faire aveu d’ignorance, que la nature ne leur a pas donné l’instinct de se servir de leurs organes pour exprimer leurs sentiments[31]. En effet, il ne suffit pas d’avoir d’un côté de l’intelligence, de l’autre des organes ; il faut encore avoir l’idée de mettre ces organes au service de l’intelligence ; or, les hommes eux-mêmes n’y auraient peut-être jamais songé, sans cette impulsion mystérieuse, sans cette initiative d’un ordre supérieur, qui n’a pas été accordée aux animaux.
« Où serait, ose dire ensuite Mosellanus, où serait l’utilité de la raison, si elle n’était développée par le langage ? De même que l’éclat du soleil serait inutile s’il était caché par l’épaisse obscurité des brouillards, de même la raison chez des êtres muets ne produirait aucun avantage[32]. » De nos jours on dira : « Les signes des choses tirent de l’ombre la notion des choses : notion qui demeure imparfaite chez la plupart, mais qui est admirable chez tous, si on la compare au ténébreux chaos d’un esprit à qui l’usage des signes serait refusé, et devant qui tous les objets intellectuels, confusément agglomérés, passent et repassent comme devant un miroir terni[33]. » Il est remarquable qu’un homme de la piété et du mérite de Vinet n’ait pas craint de renouveler au xixe siècle la distinction de Mosellanus, et d’aborder l’hypothèse d’un esprit auquel l’usage des signes aurait été refusé.
Ce n’est pas en passant et pour éblouir ses auditeurs par un paradoxe, que le professeur de Leipzig accorde une telle influence à la parole. Écoutez-le développer sa pensée avec un bon sens digne de Locke :
« A mon grand étonnement, il se trouve des hommes qui n’hésitent pas à déclarer qu’on peut atteindre les essences sans le secours des signes. Cependant on ne transmet pas dans les écoles des notions toutes nues, mais leurs signes, c’est-à-dire des mots. Il faut être hors de sens pour ne pas voir que plus abondante est notre provision de mots propres, c’est-à-dire de mots qui serrent de très près les notions, plus il est facile au maître d’exprimer, et à l’élève de comprendre les différences de ces notions. Il y a réciprocité d’influence et comme une sorte de réflexion entre le signe et la chose signifiée. Ainsi, comme Crassus le remarque dans Cicéron, les mots n’ont pas de raison d’être sans les idées, et les idées n’auraient aucune clarté sans les mots. Concluons donc que si nous étions privés du secours des langues, nous serions nécessairement réduits, pour les idées, à la divagation du rêve[34]. »
Vingt ans plus tard (1538), un autre savant, qui n’avait ni l’imagination ni l’enthousiasme de Mosellanus, mais qui nous plaît par la continuelle sagesse de ses pensées, l’Espagnol Louis Vivès, ne témoigne pas une moindre admiration pour les langues. Mosellanus les jugeait en philosophe. Vivès insiste de préférence sur les avantages que le latin procurerait à l’humanité, si on parvenait à en faire la langue universelle.
On ne remarque pas assez aujourd’hui l’importance que le latin avait acquise au xvie siècle comme moyen de communication. Grâce à lui, un très-grand nombre d’hommes parcouraient l’Europe, sans cesser de se sentir chez eux. Pendant le moyen âge, les voyages avaient été rares, mais à la Renaissance, soit que la destruction de la féodalité eût rendu les routes plus sûres, soit que le désir de s’instruire eût poussé à voir d’autres mœurs, tandis que l’ignorance semble préférer l’isolement, soit que la réputation de certains maîtres attirât tour à tour les écoliers en divers lieux[35], soit que les maîtres eux-mêmes cédassent facilement aux invitations des rois ou des villes, il semble que le mouvement des personnes ait été aussi marqué au xvie siècle que celui des esprits. Les marchands, il est vrai, gardaient quelque chose de l’ancienne timidité : il leur en restait du moins des traditions, puisque les passagers qui faisaient pour la première fois la traversée de Cologne à Francfort étaient plongés dans le Mein par les mariniers et donnaient ensuite une pièce d’or, absolument comme si l’on eût été sous la Ligne[36]. Mais pour les savants il n’est pas d’obstacles : il faut les chercher partout, excepté dans leur pays, et courir sans cesse après eux. Le Portugais André de Gouvéa passe de Paris à Bordeaux et meurt à Coïmbre. Montaigne fut donné en charge à un Allemand qui mourut médecin en France. Est-il rien de plus gracieux que la rencontre à Ferrare d’André Grunther et d’Olympia Morata ? Venu de Schweinfurt pour étudier la médecine, il épousa la brillante fille du Midi et l’emmena dans sa patrie sans qu’ils eussent jamais été des étrangers l’un pour l’autre. Ne parlaient-ils pas la même langue ? Érasme, dans ses voyages, n’avait appris ni l’italien, ni le français, ni l’anglais[37] ; quant à l’idiome de son pays natal, il l’ignorait par principe, le considérant comme très-nuisible et parfaitement inutile[38]. Vivès, natif de Valence, séjourne à Paris, à Louvain, à Oxford ; dans la grande république des lettres, il trouve partout des concitoyens. Un jour, à Paris, des écoliers espagnols et flamands sont mis en prison comme sujets de Charles-Quint : l’Université sollicite leur délivrance et l’obtient du roi[39]. Ses suppôts, en quelque pays qu’ils fussent nés, étaient réputés citoyens de Paris. Barland, dans le dernier de ses dialogues, avait parlé assez librement de la défaite de Pavie, de l’ambition du roi et de sa captivité. Il s’imprime à Paris, en 1535, une édition de cet ouvrage chez Wecheli, qui ne se croit tenu à aucune suppression, à aucun adoucissement du passage[40]. De son côté, Vivès, sujet de Charles-Quint, parle amicalement de la France. Aujourd’hui, les barrières nationales se sont relevées. Malgré nos chemins de fer et nos télégraphes, malgré les projets de paix perpétuelle, nous sommes plus étrangers les uns aux autres que ne l’étaient entre eux les lettrés du xvie siècle, dans un état de guerre incessant. Tel est l’effet de la diversité des langues. On ne pensera plus maintenant qu’il eût mieux valu, après avoir épuré le latin, le réduire à n’être qu’un moyen d’éducation. Si l’on eût donné ce conseil à nos savants, ou même au moindre de leurs écoliers, ils auraient frémi. Comment auraient-ils pu, de gaieté de cœur, renoncer à la plus noble des satisfactions et revenir à l’isolement, j’allais dire à l’état sauvage ?
« Il serait de l’intérêt du genre humain, dit Vivès, qu’il n’y eût qu’une langue, qui fût commune à toutes les nations, ou, si cela est impossible, à un très-grand nombre de nations, et dans tous les cas, à nous chrétiens qui vivons sous la même loi religieuse, une langue qui unît les hommes et fît circuler le trésor des sciences. La diversité des langues est un effet du péché. » Après avoir fait une belle description de ce langage idéal, il montre qu’elle convient de tout point au latin « qui est déjà répandu chez tant de nations » , et que ce serait un crime de ne pas le cultiver et le conserver : « s’il se perdait, il s’ensuivrait la perturbation de toutes les sciences : les hommes, ne se connaissant plus, se haïraient. Saint Augustin a eu bien raison de le dire, on aimerait mieux vivre avec son chien qu’avec des gens dont on ignorerait la langue[41]. »
Vivès ne sépare pas la langue elle-même des connaissances dont elle a le dépôt. C’est là un point de vue particulier à la Renaissance[42]. Valla, dont on nous pardonnera de citer encore la préface, parce que les idées nouvelles y étaient d’avance contenues en germe, exagère sans doute quand il s’écrie : « Quels ont été les plus grands philosophes, les plus grands orateurs, les plus grands jurisconsultes, enfin les plus grands écrivains ? Ceux qui se sont surtout appliqués à bien parler. » La science universelle est autre chose qu’une langue bien faite. Cependant, si on joint à la connaissance des termes celle de leur signification, on s’est approprié la part de sciences qu’enferme une langue. Ces savants qui couraient l’Europe, voyageaient avec la même ardeur et la même facilité dans toutes les provinces de la langue latine. Il n’est pas rare qu’ils soient à la fois maîtres ès arts et docteurs en théologie et en médecine. Pour eux, savoir le latin c’était tout savoir, c’était être un homme.
Aussi quel sentiment de l’importance de leurs fonctions, chez les maîtres ! Prenant à la lettre toutes les instructions de Quintilien, ils se considéraient comme les seconds pères de leurs élèves et regardaient même leur tâche comme supérieure à celle des parents. Si plusieurs, par leur ignorance et leur brutalité, ont mérité les reproches d’Érasme, on ne peut qu’être touché, en lisant les différentes parénésies, de voir ceux qui sont dignes de leur nom et qui dirigent l’esprit général entrer dans les détails les plus humbles de la vie des écoliers. Ils leur enseignent le secret d’étudier avec profit, leur fixent l’heure du lever, leur apprennent à manger convenablement, à bien se tenir. Ce n’est pas assez pour eux de développer l’esprit s’ils ne perfectionnent les manières. Ne sourions pas : les fils de roturiers et de pauvres gens apprenaient avec la politesse le respect d’eux-mêmes ; elle leur permettait de communiquer avec des personnes d’un rang élevé et préparait ainsi les voies à l’égalité. Ce sont des codes d’affranchissement que tous ces petits traités de civilité puérile et honnête, qui se répètent d’Érasme à Cordier, sans oublier celui de Vivès, car les hommes les plus illustres ne dédaignaient pas de les rédiger. Je ne lis pas sans reconnaissance celui d’Adamarius qui a arrangé par demandes et par réponses le traité d’Érasme, et ceux d’Hegendorf, d’Othon Brunfels, de Théodidacte, de Vergérius, de Rapicius, de Heyden. Je sais gré à Bechius d’avoir réuni, en 1556, leurs petits ouvrages, avec les conseils de saint Jérôme, de Socrate et des sept sages. Anciens et modernes étaient appelés pêle-mêle, l’un donnant son talent, l’autre ses efforts, à préparer par les jeunes générations un monde nouveau. L’instrument commun de leur action était le latin.
Pour toutes ces raisons il fallait à la fois en maintenir l’usage et en retrouver la pureté. Tâche délicate, car à tout moment il était à craindre que la langue savante, parlée par des Français, des Allemands, des Espagnols, ne se fractionnât à son tour en dialectes, cessant ainsi une seconde fois d’être universelle[43]. Voyons les méthodes qu’on employa pour parer à ce danger toujours renaissant, et comment on réussit quelque temps à satisfaire aux nécessités de la civilisation moderne, et à se servir d’une langue ancienne sans la gâter.
|
Préface des Elégances latines. |
|
Ebrardus, Hugutio, Catholicon, Aymo, et cæteri indigni qui nominentur, magna mercede docentes nihil scire, aut stultiores reddentes discipulum quem acceperunt. — El. lat., livre II, p. 84 de l’édition de Gryphius. |
|
« Laudo eos omnes, tamen plus certe laudaturus si recte ordineque tractarentur : nec enim tantum desipio ut solus damnem quæ tam multi laudant. » — De formando studio R. Agricolæ epistola, Heydelbergæ, 1484. Page 464 du recueil de Bechius (de Disciplina puerorum... doctorum virorum libelli aliquot vere aurei : Basileæ per Joannem Oporinum, 1556). Cinquante ans plus tard, Othon Brunfels, prétendant donner un extrait du passage d’Agricola, en supprime les restrictions et en accentue les sévérités : Steriles et jejunæ scientiæ sunt, quas vocamus artes, jus canonicum, Barbaries grammatistarum et sophistica philosophorum ; quæ miseras adolescentium onerant aures et meliorem ingenii spem in plerisque, tenerioribus adhuc annis, velut in herba enecant. (Dans Bechius, p. 535.) |
|
Oratio de variarum linguarum cognitione paranda, Petro Mosellano Potegense auctore. In-4º, Basileæ, apud Joannem Frobenium, mense maio, anno m.d.xix. « Ac primum omnium quis nescit orationis usum unicum esse, quo nos naturæ princeps et mundi fabricator deus præ cæteris donavit, et supra reliquorum animalium vilem conditionem evexit, quoque proxime ad suæ imaginis divinitatem accedimus ? In aliis sane dotibus non est, quod nobis ipsi placeamus, quando magnitudine nobis superiores sunt elephanti, ferocia superant leones, velocitate vincunt cervi, rohore tauris cedimus, breviter in nullo non fuit illis natura mater, nobis noverca. Sola est oratio quæ nos homines facit sola cujus beneficio brutis præferimur : cum interim formicæ providentia, etc., nonnullam in eis animalibus rationem videntur indicare. Nemo autem unquam eo dementiæ est progressus, ut sermonis facultatem homini fecerit cum brutis communem. » (P. 15.) |
|
La Science du langage, p. 376. |
|
Loqui soli homini omnibus ex animantibus a natura est concessum. (P. 15.) |
|
Quis usus rationis nisi adesset quæ eam explicaret oratio ? Etenim ut solis splendor nulli esset usui, si intra nubilum densam caliginem lateret sic in mutis quoque ratio in nullius commodum se promere poterit. (Id.) — On dira que les muets emploient un langage artificiel et manifestent ainsi la dignité d’homme : mais remarquons que ce langage leur est enseigné. |
|
Chrestomathie de Vinet. Préface du 1er vol., p. 7, de l’édition de 1871. |
|
Voici le passage tout entier. Nous l’avons abrégé en le traduisant : Admiror inveniri qui pronuntiare non dubitent, citra vocum notas accurate præceptas, vim rerum ac proprietatem percipi posse. Præsertim quum non res ipsas nudas, sed eorum notas, hoc est voces in scholis proponamus. Et quis sanus dubitat quin, quo uberior vocum propriarum, et per hoc rebus propinquarum supellex nobis suppetat, eo facilius quoque sit rerum discrimina docenti quidem exprimere, discenti vero percipere ? Nam quum in omni scientiarum genere, juxta philosophorum traditionem, per sensus in hoc a natura inditos e singularium rerum conditione species in animum, velut quasdam summas colligamus, quas illi partim προλήψεις, partim ἔννοιας, nos cum Cicerone notiones vocamus, qui quæso poterit quis hoc sine linguarum et vocum beneficio in aures atque animos aliorum transfundere ? Nisi forte falso scripsit Aristoteles, voces esse rerum quæ apud animum concipiantur proxima signa. Jam mutuus est nexus et velut respectus sese reflectens inter signa et quæ signantur. Etenim ut quicquid notatur habet notam sibi peculiarem, ita cuilibet notæ aliquid, quod designet respondet, ut, quemadmodum apud Ciceronem colligit Crassus, neque verba sedem habere possint, si rem subtraxeris, neque res lumen si verba summoveris. Quare si linguarum præsidio destituti fuerimus, ut in rerum quoque judicio hallucinemur, necesse est. (P. 46-47.) |
|
Voir les Mémoires de Platter. |
|
Dialogues de Schottennius, p. 49. |
|
Burigny, I, p. 153-155. |
|
Absum ab hollandis linguis quæ plurimum nocere norunt, nulli autem prodesse didicerunt (ep. à Nicolas Weiner). V. Revue catholique, p. 64, un article de M. Félix Nève. |
|
Crevier, Histoire de l’Université de Paris, t. V, p. 147. |
|
Suis finibus non contentus ipse finitimis bellum intulit. — Quid eum huc pertraxit ? — Dominandi libido. — Quo animo fert servitutem ? — Quo ille animo ferat quod acciderit equidem ignoro. Ex varia lectione scio multos viriliter captivitatem tolerasse. Jugurtha, etc. Barland, lvie dialogue. |
|
Vivès, de Tradendis Disciplinis, livre III, p. 462-463 de l’édition de Bâle. E re esset generis humani unam esse linguam qua omnes nationes communiter uterentur : si perfici hoc non posset, saltem qua gentes ac nationes plurimæ, certe qua nos Christiani initiati eisdem sacris, et ad commercia et ad peritiam rerum propagandam. Peccati enim pœna est tot esse linguas : eam vero ipsam linguam oporteret esse quum suavem, tum etiam doctam et facundam... Quæ omnia efficerent ut libenter ea loquerentur homines et aptissime possent explicare quæ sentirent : multumque per eam accresceret judicii. Talis mihi videtur lingua latina ex iis certe, quas homines usurpant, quæque nobis sunt cognita... Ea quoniam diffusa est jam per complures nationes... nefas esset non coli eam et conservari. Quæ si amitteretur, et magna confusio sequeretur disciplinarum omnium, et magnum inter homines dissidium atque aversio propter linguarum ignorantiam. Quoniam quidem, ut D. Augustinus inquit, mallet quisque cum suo cane versari, quam cum homine ignotæ linguæ. |
|
On le trouve déjà dans un manuel de conversation allemand de 1480 et dont nous parlerons ci-après. |
|
Nam corruptus desinet unus esse... barbarissans Hispanus barbarus est barbarissanti Germano. — Vivès, id., t. I, p. 463-464. |
Il fallait d’abord épurer la langue, ou, comme on disait, nettoyer les étables d’Augias. Ceux qui se chargèrent de cette tâche sont innombrables, mais les premiers n’en comprirent pas la difficulté. L’instinct de l’élégance ne pouvait suppléer au goût qui est ici le résultat d’un long commerce avec les bons auteurs. Du moins le vigoureux travail de ces réformateurs à moitié barbares déblaya le terrain. Citons en Allemagne Henri Bebel. Dans sa polémique contre le Mammetrecte, par exemple, il énumère longuement les fautes de ce mauvais ouvrage. Dans son traité de Abusione linguæ latinæ, il met à l’index un grand nombre de mots qui circulaient impunément. « Hæc verba, zechare, tibisare, vobisare, avisare, crinisare, bursare,... cipare, deteriorare, appodiare, verba sunt penitus barbara et gouthica, nec digna quæ in latini sermonis campo admittantur[44]. »
Environ vingt ans plus tard, le Hollandais Cornélius Crocus, dans un ouvrage souvent réimprimé à la suite de l’abrégé des Élégances latines par Érasme, relève avec une patience plus minutieuse encore que celle de Bebel les mauvaises locutions et les termes impropres dont on persistait çà et là à se servir. Il nous apprend par exemple que de son temps on ne disait plus e contra, mais que les grammairiens disputaient sur la latinité de e converso ; que glis se prenait communément pour sorex et lar pour rima. Son but est de corriger le langage (sermonem quotidianum). Il se réfère aux bons auteurs, et parmi les modernes à Valla et à Érasme qui avait toute l’autorité d’un classique[45].
Le plus fameux des ouvrages de cette sorte fut celui de Cordier, qui parut en 1530, et dont nous parlerons plus loin avec détail. D’année en année, la critique devenait plus sévère. Bientôt même, on se servit pour ainsi dire d’un tamis trop fin. Alors, le bon sens proteste par le livre : de Latinitate falso suspecta[46].
Dans ces conditions, la conversation devenait un art, une peine ; puisqu’on voulut la maintenir pour conserver l’unité de la république des lettres, il fallut lui constituer une existence artificielle dans les écoles, ou plutôt dans le monde des écoliers. Presque partout, le fouet punit ceux d’entre eux qu’on surprenait à faire usage de la langue maternelle ; à Venise, ils étaient soumis à des amendes dont le produit se partageait entre les élèves studieux. L’obligation de parler latin subsistait hors du collége, dans les places publiques, dans les rues et souvent jusque dans la famille. Des surveillants choisis parmi les écoliers facilitaient la tâche du maître. D’ailleurs, depuis le moyen âge, la dénonciation était ordonnée par les règlements[47], et nous verrons comment l’espionnage était organisé en Allemagne. C’est ainsi qu’on avait pu créer un milieu factice dont la nécessité était si bien comprise pour cette partie de l’enseignement que Vivès, dans ses conseils à la reine Catherine sur l’éducation de Marie Tudor, veut qu’on donne à cette petite fille de huit ans des compagnes de son âge qui parleront latin avec elle[48]. On sait de quel expédient se servit le père de Montaigne et comment, de la maison paternelle, la langue latine se répandit jusque dans le village.
Vivès veut qu’on dresse l’enfant à la conversation dès sa septième année[49] : ainsi cette habitude lui deviendra naturelle. Quelquefois, ils avaient honte et peur : celui qui refusera de parler après une année d’instruction sera puni dans la mesure de son âge[50]. Rien ne vaut la pratique[51]. Comme la foi, la science vient de l’ouïe[52]. Les enfants apprennent beaucoup par imitation. C’est un plaisir pour eux que d’imiter[53].
Une fois le but admis, on ne pouvait suivre une méthode plus naturelle. Elle dérivait en grande partie du moyen âge qui, manquant de livres, devait substituer la mémoire et l’action aux devoirs écrits. L’imprimerie ne multiplia les livres que peu à peu : on voit par les mémoires de Platter qu’à Breslau, en 1512, le maître seul possédait un Térence. Il en dictait bien des fragments à ses élèves, mais ceux-ci devaient chercher avant tout à retenir par cœur ses explications. Aussi, quels soins donnés à la mémoire, cette faculté aussi instable que précieuse ! On la croyait unie à la santé, mais surtout à la tempérance. Les indigestions, la débauche, la bière trop épaisse lui étaient funestes. Les maîtres recommandaient pour l’améliorer de se coucher sur le dos et, contrairement à l’hygiène moderne, d’éviter le froid à la tête. Il y avait un apophthegme terrible dans sa brièveté : Vinum memoriæ mors[54].
On ne donnait pas de moindres soins à la prononciation. Érasme s’en est occupé[55]. Vivès lui consacre une grande page et donne des conseils sur la manière de corriger non-seulement de mauvaises habitudes, mais des défauts naturels. On ne voulait pas que la belle langue latine passât par une bouche grimaçante ou par une voix désagréable. La sollicitude de Vivès s’étend jusqu’aux gestes ; cependant il ajoute qu’il ne faut pas faire de l’écolier un acteur. Et, dans ses dialogues, il se moque des maîtres qui tombaient en défaillance en entendant une faute d’accentuation ou de quantité. Il eût peut-être trouvé exagéré l’enthousiasme du professeur Morato, qui s’écriait dans une lettre à sa fille : « La parole, oui, la parole messagère de l’intelligence fait honte à sa souveraine quand elle se départ de la dignité d’un ambassadeur, et j’aimerais mieux être muet que de bégayer ou seulement de parler d’une manière désagréable[56]. »
Ce respect superstitieux pour la parole rappelle celui des Chinois pour le papier ; mais ne pèche-t-on pas aujourd’hui dans les écoles par l’excès contraire ?
Voilà le cerveau et les organes de l’enfant bien disposés : d’où tirera-t-on les matériaux nécessaires à la conversation ? Tout d’abord, des auteurs anciens, et particulièrement de ceux qui avaient écrit avec élégance et simplicité. Les Comiques, les lettres familières de Cicéron et les satires d’Horace, ces dernières, grâce à leur titre de causeries familières, furent surtout mis à contribution. On comprend moins l’estime accordée par quelques-uns à Juvénal pour le même objet. Ces hommes nouveaux trouvaient dans sa déclamation de la gravité et de la force ; leur goût n’était pas encore formé, et le sage Vivès lui-même préférait Lucain à Virgile.
Heureusement, tous étaient d’accord sur les ressources de Térence, à qui dans aucune école on ne disputa le premier rang. Chacun paraphrase à sa manière en son honneur le jugement de Quintilien : « C’est, dira Hegendorf[57], l’auteur qui s’approche le plus de nos conversations journalières, et je ne crois pas que vous puissiez dire sans balbutier tout ce qui vous vient à la langue, si vous n’avez usé plus d’un exemplaire de Térence. » Les maîtres dépouillaient soigneusement ses comédies et en dictaient les phrases à leurs élèves, qui devaient les apprendre par cœur. Il nous reste au moins un monument de cette pratique. En 1537, Grapheus publia un recueil des locutions familières de Térence. C’est un travail très-complet, fait acte par acte et scène par scène, et pour toutes les comédies. Il est suivi de maximes tirées du même auteur : elles étaient destinées, venant à propos sur les lèvres, à donner à l’entretien plus de solidité et à renforcer l’élégance par une érudition plus apparente.
On paraît avoir fait moins de cas de Plaute. Cependant, il est peut-être encore plus naturel que Térence. Il avait des partisans, comme Dorpius de Louvain. Mais, en général, on le trouvait trop grossier. On le renvoyait au moulin. Il fallait à nos raffinés le bon ton du gentilhomme Lélius. Peut-être aussi que l’étrangeté de certains mots rebutait. On n’avait pas eu le temps de s’y habituer, tandis que Térence était connu depuis fort longtemps, puisqu’il avait été imité dès le xiie siècle par Roswitha. Quand Barland voulait faire profiter ses élèves du texte de Plaute, il le mettait à leur portée par une sorte de traduction[58]. On en usait de même pour les satires d’Horace[59].
Les épîtres familières de Cicéron étaient, avec les comédies de Térence, le vade-mecum de tout écolier. Elles servaient pour la composition des lettres, mais on ne les prisait pas moins pour la conversation. Les témoignages en leur honneur abondent : tous sont explicites ; nous citerons le plus complet. « Ces épîtres, dit Vivès, sont propres à faciliter la conversation, car la langue en est pure et simple. C’est celle dont Cicéron se servait avec sa femme, avec ses enfants, avec ses serviteurs, avec ses amis ; à table, au bain, dans son cabinet, dans ses jardins[60]. »
Le maître prenait des formules dans tous ces auteurs, les adaptait comme il pouvait aux nécessités de son temps et les dictait à ses élèves. Ils avaient leur livret, il avait le sien. Bientôt il pensa naturellement à devenir auteur lui-même et mettant en œuvre pour former le langage de ses écoliers les matériaux qu’il avait amassés, il écrivit des comédies ou des dialogues.
On se demandera peut-être si l’idée première de ces dialogues ne serait pas due soit au souvenir et à l’autorité de certains ouvrages du même genre laissés par les anciens, soit à des exemples du moyen âge. Car, premièrement, il existe des manuels gréco-latins de conversation qui paraissent avoir été composés au commencement du iiie siècle, surtout à l’usage des Grecs qui voulaient apprendre la langue latine[61]. Ils sont d’ordinaire divisés en trois parties, savoir : un catalogue de mots rangés par ordre de sujets et qui rappelle l’Onomasticon de Pollux, un glossaire alphabétique et enfin une série de courts dialogues[62]. Un seul de ces ouvrages nous est parvenu à peu près complet ; c’est celui que M. Boucherie a publié en 1872, d’après un palimpseste de Montpellier. Un autre, édité en 1832, par M. Böcking, ne contient pas de dialogues. Ce sont au contraire les dialogues qui nous ont été seulement conservés d’un troisième, dans un manuscrit d’Hermonyme de Sparte qui se trouve à la Bibliothèque nationale[63]. Ce dernier opuscule se rapporte tout particulièrement à notre sujet. Il a pour titre : « περὶ καθημερινῆς ὁμιλιάς — de Quotidiana Locutione » et contient, avec la description des occupations ordinaires d’un Romain, celle de la journée d’un enfant. On le voit successivement se lever, faire sa toilette du matin, aller saluer ses parents, se rendre à l’école et prendre part aux exercices scolaires. Ne serions-nous pas ici en présence d’un des modèles d’après lesquels auraient été conçus nos premiers colloques ?
Nous ne le croyons pas. Si nos maîtres de la Renaissance, qui rédigèrent les manuels de conversation, s’étaient connu des prédécesseurs dans l’antiquité, ils n’auraient pas manqué de citer dans leurs préfaces de tels exemples et de s’en prévaloir. Or c’est ce qu’aucun d’eux n’a jamais fait.
Nous n’avons pas le droit d’ajouter que c’est seulement de nos jours que les ἑρμηνεύματα ont été tirés des manuscrits qui les recélaient, et qu’ils étaient tout à fait ignorés du xvie siècle. Ce serait une erreur, du moins pour la καθημερινὴ ὁμιλία. Car elle fut imprimée à Louvain dès 1517, pour apprendre aux écoliers à parler grec[64], et Vivès me paraît s’en être servi en 1536 comme d’une sorte de sommaire de ses trois ou quatre premiers dialogues. Mais, chose singulière, on n’eut pas un moment l’idée que ce petit livre pût appartenir à l’antiquité. Beatus Rhenanus, le premier qui l’édita, l’attribue à un humaniste inconnu du xve siècle, qui n’aurait su que médiocrement les deux langues ; en 1542, un autre éditeur, Albanus Torinus, ne soupçonne pas davantage la vérité. Cette publication n’eut d’ailleurs aucune influence sur l’origine de nos colloques, car ils s’étaient développés bien avant elle.
Mais, s’ils n’ont pas été directement imités de l’antiquité, ne doivent-ils rien au moyen âge ? Le premier de ceux que nous connaissons et qui date de 1480, n’aurait-il pas été précédé de plusieurs autres ? Certainement on peut supposer qu’il y a eu avant la Renaissance toute une série de colloques scolaires[65] dont le dernier terme serait alors le manuel de 1480 qui a conservé tant de traits de la physionomie du moyen âge. Mais cette série, quand même on arriverait à en démontrer l’existence, resterait en dehors de notre sujet ; car, ainsi que nous le montrerons plus tard, elle a été ou ignorée ou dédaignée de nos auteurs du xvie siècle. Ils cherchaient, on ne saurait trop le redire, à purifier la langue latine autant qu’à en répandre l’usage. Ils durent donc renouveler le genre : leurs dialogues nous fournissent un solide point de départ et tout au plus devrons-nous caractériser en quelques lignes le manuel de 1480, pour faire voir combien il diffère de ce qui le suivit.
Avant d’examiner successivement les plus remarquables d’entre ces ouvrages, jetons un rapide coup d’œil sur l’ensemble.
|
Feuillet xxix (verso) du Recueil des ouvrages grammaticaux de Bebel, publié en 1513, in-4º, sous le titre de Commentaria epistolarum, etc. La dédicace est de 1500. |
|
Farrago sordidorum verborum, sive Augiæ stabulum repurgatum, per Cornelium Crocum Amstelredamum. — Nous en connaissons deux éditions, l’une de 1546, par F. Gryphius, l’autre de 1548, par R. Etienne. Baillet cite la première comme étant de 1520 (in-8º, Cologne). Il doit se tromper, non parce que l’auteur n’aurait eu que 28 ans à cette époque, mais parce que Crocus cite une phrase des Dialogues de son maître Barland qui ne parurent qu’en 1524. A moins que Crocus n’ait eu ce dialogue en manuscrit. Voici le passage sur e contra. L’auteur vient de nier la latinité de ex opposito. Ejusdem farinæ e converso et e contra sunt : quorum hoc constanter rejicitur : de illo grammatici certant et adhuc sur judice lis est. Ac producuntur quidem exempla non pauca e probatissimis undecunque authoribus, sed quæ non vacent mendi suspicione : nulla tamen e poetis, apud quos an mendum esset, facile deprehendi posset. Eruditorum centuriæ contra, e contrario, e diverso dicere amant. |
|
On sait à quel point fut poussée la superstition cicéronienne. Voir la thèse de M. Lenient, de Bello Ciceroniano. |
|
Règlement donné par Gerson pour l’école de la cathédrale. Chacun devra dénoncer au maître les fautes de ses camarades. Celui qui ne dénoncerait pas serait puni comme le coupable. Une des grandes fautes était de parler français. — V. Thurot, de l’Organisation de l’enseignement dans l’Université de Paris au moyen âge, p. 95. |
|
De Ratione puerilis studiis ad Catharinam reginam Angliæ, t. I, p. 6. |
|
Tome I, p. 463. |
|
Page 469. |
|
Id. |
|
Page 467. |
|
Page 6. |
|
Recueil de Bechius, passim. |
|
De recta latini græcique sermonis pronuntiatione Dialogus. |
|
Pages 74-82 de l’édition de 1562 des œuvres d’Olympia Morata. « Vocem inquam, informatricem sensuum animi et creatricem nuntiorum humanæ intelligentiæ : quæ si ut Legati non solemnissime prodeat, dominis fit ignominiæ. Equidem mutus esse malim quam rustice, quam inarticulate, quam ingrate loqui. » Toute la lettre est curieuse ; il s’y moque d’un Allemand qui ayant à dire : Majestas Cæsarea gaudet vos advenisse incolumes, prononça : Magestas Cæsarea caffdet fos fenisse incoglumes. — Cette anecdote se retrouve aussi dans le traité d’Érasme. |
|
Dialogue xii. — Quotidiano sermoni Terentius proximus est : et haud scio an citra balbutiem quidquid in linguam venerit garrire possis, nisi Terentii comœdias in manibus triveris. |
|
Asinaria, acte V, sc. ii. Ain tu meum virum hic potare, obsecro, cum filio? Et ad amicam detulisse argenti viginti minas? Meoque filio sciente id facere flagitium patrem! — Neque divini neque mi humani posthac quiquam accreduas, Artemona, si hujus rei me esse mendacem inveneris, etc. Traduction : Quid ais? maritum hic meum potare una cum filio, et amicæ argentum dedisse, idque præsente filio ? — Nihil credis mihi, posthac, Artemona, si mendacem hic inveneris. — Ah ! imperita ego et stupida mulier, quæ viro meo credidi esse continentiorem neminem, etc. — Barland, dial. xli. |
|
Ex satira quadam Horatii iu garrulum. Barland, dial. xviii. — Quid agis dulcissime Horati ? — Suaviter ut nunc est rerum status, et omnia quæ vis cupio. — Nostin ? me doctus sum. — Tanto pluris te facio. — Ut video abire cupis, sed nihil agis, usque tenebo te et persequar. Hinc quo nunc est iter tibi ? etc. |
|
Ad quotidianum sermonem multum confert Terentius quo multum Cicero utebatur. Ciceronis quoque epistolæ familiares expeditum reddere sermonis usum possunt, nam illis est sermo ille purus et simplex quo Cicero cum uxore, cum liberis, cum servis cum amicis, in triclinio, in balneo, in lecto, in hortis utebatur. — T. I, p. 9. |
|
D’après M. Boucherie : voir le Palimpseste de Montpellier, notice par A. Boucherie, dans le tome XXIII, 2e partie, des Notices des manuscrits de la Bibliothèque nationale. |
|
Tel est l’ordre indiqué par la préface de la καθημερινὴ ὁμιλία (voir plus loin). Mais cet ordre n’est pas le même dans tous les ἑρμηνεύματα. |
|
Et qui a été aussi publié par M. Boucherie. |
|
Il y eut au xvie siècle plusieurs tentatives pour faire apprendre le grec par la méthode des colloques. Outre la publication de la καθ. ὁμιλ, nous aurions à signaler un projet de Henri Etienne, dans l’édition de 1564 des Colloques de Cordier et un οἰκειων διαλόγων βεβλίον ἑλληνιστὶ και ρωμαιστὶ de Posselius, Wittebergæ, 1601, où l’auteur a traduit plusieurs petits dialogues d’Érasme. |
|
Nous ne rappelons pas le Glossaire de Garlande (xiiie siècle), dont le plan a des ressemblances avec celui de l’Onomosticon, car il ne s’agit ici que des dialogues. |
C’est en Allemagne, dans les États espagnols et en Suisse que ce nouveau genre de littérature se développe. L’Angleterre importe pour ses besoins les auteurs et leurs ouvrages. La France contraint à la fuite celui qui aurait pu la représenter et qui publiera son livre à Genève. Quant à l’Italie, elle ne prend aucune part à ce mouvement.
Non qu’elle manque de dialogues écrits en latin, vous en rencontrez dès la fin du xve siècle. Mais ce sont des ouvrages d’érudition, de philosophie, ou tout simplement des pamphlets, à l’adresse des lettrés et nullement des écoliers. Voici, par exemple, les Banquets de Philelphe, ce Macrobe moderne, comme disait Vivès[66]. C’est un répertoire confus : astrologie, médecine, étymologies, épigrammes contre le Pogge ; histoire de la philosophie et philosophie, tout s’y trouve. Abraham, inventeur de l’astronomie, y coudoie Astrampsychos le vétérinaire et Aristophane. Longtemps après la mort de l’auteur (1484) les demi-savants pillèrent ces Banquets à pleines mains, mais la tête des écoliers s’y serait perdue[67].
De même Léonicus (1524), dont les dialogues exposent avec élégance et clarté la doctrine de Platon, aurait regardé avec un sourire le premier étudiant qui se serait hasardé à ouvrir son livre[68].
On dirait que dans cet heureux pays tout est arrivé d’abord à la perfection et que les auteurs n’ont affaire qu’à des lecteurs instruits et d’un goût délicat. Il s’agit bien d’enseigner à balbutier le latin ! On poussait le raffinement jusqu’à ressusciter des termes archaïques pour renouveler l’attention blasée ; Accursius (Mariangelo) se moqua de cette tendance dans le dialogue de Osco, Volsco et eloquentia romana (1529).
Enfin en 1561 on croit avoir mis la main sur un ouvrage italien qui se rapporte à notre sujet, en ouvrant le traité de Sigonius sur le dialogue[69]. Mais il ne s’agit dans ce livre que des dialogues de Platon et de Cicéron. Tous les exemples en sont pris de l’antiquité ! Chose étrange, près de quarante ans après la publication des colloques d’Érasme, le nom d’Érasme ne s’y trouve pas. Toutes les tentatives d’outre-monts y sont passées sous silence, avec un dédain qu’on ne s’explique guère chez l’humaniste qui voulut faire revivre à la fin du xvie siècle l’usage de la langue latine[70], chez le savant consciencieux qui débrouilla l’histoire du moyen âge et créa la diplomatique.
Qu’arriva-t-il de ces mépris ? Mettons de côté une élite de gens de goût et le reste tombera sous le jugement de Mosellanus. Les Italiens, dit-il, qui affectent la supériorité pour le langage, emploient journellement un vrai jargon ; sermone quotidiano immundo utuntur.
Les Allemands tinrent une conduite toute contraire. Ils s’attachèrent à l’éducation du grand nombre : par de patients et habiles efforts ils étaient heureux d’élever d’un degré la médiocrité de la multitude. D’ailleurs, comme le latin était pour eux une langue tout à fait étrangère, qui alors ne semblait avoir aucun rapport avec leur idiome, ils croyaient n’avoir jamais assez multiplié et perfectionné les méthodes qui devaient en faciliter l’accès. On voit par un passage de la lettre d’Agricola sur les études combien étaient pénibles les premiers essais pour exprimer la pensée en latin. C’est donc en Allemagne que les dialogues à l’usage des écoliers devaient prendre naissance, comme complément indispensable de la grammaire. Dès lors la plupart des écoliers de race germaine surpassèrent ceux des autres pays pour la conversation en langue latine.
C’est du vivant de Rodolphe Agricola que fut composé par un anonyme, d’après des souvenirs d’Heidelberg, où professait ce savant, le premier de ces manuels[71], du moins à notre connaissance. Il parut à Ulm en 1480. M. Zarncke, qui l’a réimprimé dans ses Universités allemandes au moyen âge[72], en décrit sept éditions, toutes antérieures au xvie siècle, celle d’Ulm, trois de Cologne et une de Strasbourg[73] (1481). Ce curieux ouvrage semble avoir été, pendant la seconde moitié du xve siècle, d’un usage général dans les universités allemandes. La langue en est à peine latine. L’écolier y dit encore vous au maître[74]. La seule étude en honneur y est celle de la dialectique. On y compare les mérites d’Albert, de saint Thomas et de Scot. On y apprend qu’Erfurth, le port de toutes les nouveautés, tient pour les modernes, c’est-à-dire pour les nominalistes, et qu’Heidelberg admet des maîtres de toute opinion ; que si l’on parle latin c’est en grande partie pour se distinguer des laïques[75] et que les leçons se donnent encore devant le portail des églises[76]. Quand les auditeurs ne comprennent pas la subtilité des distinctions ils les admettent par obéissance. L’important est de ne pas manquer le cours[77]. Il est bien question une ou deux fois des bons auteurs : Maître Conrad Schuitzer a fait savoir qu’il expliquerait les comédies de Térence ; mais se décidera-t-on à aller l’entendre ? Que peut-il y avoir de bon dans Térence ? Presque tous les maîtres condamnent ces comédies. Ils sont appuyés par beaucoup d’écoliers ignorants et fanatiques[78]. Seules les épîtres de Cicéron et sa Rhétorique trouvent grâce.
Telle est la physionomie de ce manuel dont le morceau le plus curieux est la description du cérémonial adopté pour la réception des béjaunes.
Enfin Malherbe vint, c’est-à-dire la Pédologie de Mosellanus parut en 1517. C’est une description curieuse de l’état des écoles à peine débarrassées de la barbarie[79]. En 1521, Hegendorf imite Mosellanus, dans la même ville, et le complète en quelques endroits. Il nous apprend dans sa préface que ce nouveau genre est approuvé du grand Érasme. L’année suivante, Érasme lui-même publie ses colloques, sur lesquels tout a été dit. En 1526, paraît la seconde édition de ceux de Schottennius, œuvre originale dans sa grossièreté et qui nous fait réellement revivre à Cologne. Barland, à Louvain (1524), imiterait volontiers Érasme, mais il a la sagesse de se borner à des peintures locales et mêle en vrai Flamand à l’exactitude allemande quelque chose de la finesse française. Son catholicisme frondeur a cependant horreur du luthéranisme. Jonas Philologus[80], oublié par Bayle, par Moréri, et dont nous avons vainement cherché partout la biographie, nous intéresse par quelques détails sur l’école de Deventer. En somme, il est plus savant qu’original (1529).
Une seconde période s’ouvre avec Vivès (1539), si poli, si fin, qui se souvient d’avoir vécu dans les cours. Rien de plus ingénieux que son vocabulaire, en grande partie tiré du grec : rien de plus sensé que les concessions qu’il fait aux langues modernes. Il se marie ; c’est encore un signe des temps. Les exemplaires de son livre se répandent partout, jusqu’en Amérique ; et le Mexicain Cervantes leur donnera une suite en 1554.
Nous allions oublier Crocus, Hollandais, qu’on retrouve partout où il y a à faire une besogne honnête et pénible. Il a déjà balayé les impuretés de la langue et celles des mœurs : nous le connaissons par le Farrago. Maintenant (1536) il se met en tête d’écrire des colloques pour les opposer à ceux d’Érasme, qu’il a loués mais qu’il se repent d’avoir loués. C’est en vain que nous avons cherché partout, sur la foi de Baillet, un exemplaire de cet ouvrage, plus utile peut-être que spirituel.
Enfin en 1564 Cordier, l’année même de sa mort, publie à Genève ses colloques, dont la réputation a duré jusqu’à notre temps. Cordier et Mosellanus sont les deux extrêmes. Le premier représente la satisfaction d’un besoin et le second le maintien d’une routine. Disons encore un mot des Neanisci de Jean Sturm (1570), en regrettant d’être obligé de nous borner à les signaler. Ces cinq dialogues, publiés à Strasbourg par le restaurateur des études dans cette ville, ne se trouvent pas dans les bibliothèques de Paris. Le seul exemplaire qu’en connût M. Charles Schmidt, le savant auteur de la biographie de Jean Sturm, n’est plus que cendres depuis l’incendie de la bibliothèque de Strasbourg. On relève les édifices ; la perte d’un petit livre sans apparence peut être irréparable. Les malheurs de la dernière guerre causent des vides jusque dans notre humble travail.
Le xviie siècle eut aussi ses dialogues ; mais que nous importe ? La conversation en langue latine est alors de plus en plus reléguée dans les écoles, et les manuels n’ont plus d’intérêt. Déjà du temps de Muret, on craignait d’émettre des phrases autrement qu’en langage vulgaire, de peur d’être pris en flagrant délit de barbarisme ou seulement d’inélégance. Muret réservera le latin pour les discours d’apparat et pour les explications littéraires ; il n’aurait jamais eu l’idée de composer des dialogues. D’ailleurs les langues nationales atteignaient leur majorité.
Étudions maintenant les principaux d’entre ces ouvrages, ainsi que leurs auteurs. L’ordre des temps, qui concorde ici avec celui des lieux, nous conduira d’abord en Allemagne, ensuite dans les possessions espagnoles, et enfin en France et en Suisse. Nous nous occuperons premièrement de Mosellanus, et l’on ne s’étonnera pas de la place relativement considérable consacrée à l’homme qui non-seulement renouvela les colloques, mais qui prépara la Renaissance à Leipzig, présida aux premières luttes de la Réforme, et mourut si jeune après avoir fait espérer qu’il aurait pu être un digne successeur d’Érasme.
|
« Macrobium Philelphus imitatus est, » etc., dit Vivès dans sa Prælectio reproduite en tête de l’édition de 1537. De son temps on expliquait Philelphe dans les écoles. |
|
Conviviorum Francisci Philelphi libri II, varia eruditione referti. Coloniæ, excudebat Joannes Gymnicus, mdxxxvii. — La première édition est de 1498. D’après une lettre de Léonardus Justinianus à Philelphe, reproduite dans l’édition que nous citons, l’ouvrage aurait été composé en 1443. |
|
Nicolai Leonici Thomæi Dialogi, 1542, Gryphius. La dédicace est de Padoue, 1524. L’un des interlocuteurs est Bembo. |
|
Caroli Sigonii de dialogo liber Joannis Jessenii opera luci redditus. Leipzig, 1596. La 1re édition est de Venise, 1561. Le médecin Jessenius, Allemand, en trouva en Italie un exemplaire rongé des vers, d’après lequel il fit l’édition que nous avons consultée. Voir sa préface. |
|
Voir son discours De latinæ linguæ usu retinendo. |
|
Manuale scolarium qui studentium universitates aggredi ac postea is eis proficere instituunt. |
|
Die deutschen Universitæten in Mittelalter. Erster Beitag : Leipzig, 1857. |
|
Impressum in nobili Argentina per Martinum Flach, 1481, in-4º (p. 222). |
|
Reverende magister, Reverentiam vestram oratam facio (p. 3). |
|
P. 28. |
|
Vidi intimatum hodie, magistrum Jodocum libros lecturum elencorum prope valvam ecclesiæ Sancti spiritus hora sexta, p. 11. |
|
P. 15. |
|
Camillus. Magister Conradus Schuitzer interpretaturum se intimavit Terentii comœdias, sumusne audituri ? Bartoldus. Quid autumas in his esse comœdiis utilitatis ?... Putasne homines intelligere perdoctos, quid in se Terentius boni habeat ? Præceptores pæne omnes dissuadent prorsusque inhibent, Nam de nuptiis deque lascivis rebus ejus sunt comœdiæ, quæ adolescentulis lasciviam libidinemque incutiunt... — Camillus. Primo ex te scire cupio, a quibus hausisti, poetas illos nihil boni scripsisse ? Habesne ab his, qui plura in ipsis scripta legere, an ab his, qui nullam ab eis capere sententiam queunt ? — Bartoldus. Neque hoc plane scio, at, quantum conjectura carpere valeo, nihil in poetis sapiunt. Camille fait contre les ignorants proscripteurs un discours que Bartold interrompt ainsi : Obmutesce, mi Camille, Si hujuscemodi sermo tuus deferretur, tibi irascerentur. — Cam. Recte mones. Ratio mihi in hac re atque cautio habenda est. — S’il avait le temps il lui révélerait le sens caché des comédies : « Si quis detegeret, tu conspicare mysterium sacrum, quod nullo ebetis vulgi vis animo complecti ac comprehendere potest. » — Mais il n’a pas le temps (p. 15-16). Il est curieux d’assister à l’aurore des bonnes études et de voir l’idée qu’on se faisait de ces comédies, qui cachaient un mystère sacré. |
|
Nous laissons de côté les ouvrages qui, par leur titre, semblent rentrer dans notre sujet, mais qui en réalité n’y sont pas compris, comme la Grammaire par demandes et par réponses intitulée : Dyalogus gramatice vicegerens Donati, par Pierre de Lilla, 1518, à Lyon. |
|
Il ne mérite pas une étude particulière. On voit par ses dialogues qu’il est Allemand. On ne peut l’identifier avec aucun des Jonas connus de la Renaissance. Les deux éditions que nous connaissons de ses Dialogues n’ont ni dédicace ni préface, ni rien qui puisse renseigner sur cet auteur. La première fut imprimée à Mayence, par Jean Schœffer, en 1525 (Jonæ Philologi dialogi aliquot lepidi ac festivi, in studiosæ juventutis informationem nunc primum et nati et æditi). Le 2e est de 1540, Paris, Simon Colinæus. Il existe de lui un Epitome Fabii Quintiliani dont nous connaissons deux éditions à Paris et une à Lyon, et qui est dédié au jurisconsulte Sibert de Lowenbouh. Il s’y donne pour professeur, mais sans dire en quel pays. S’agirait-il de Christophe Jonas de Kœnigsberg qui était à Wittenberg en 1529 ? (Voir les Universités de la réformation, par Muther.) |
PREMIÈRE SECTION
ALLEMAGNE
C’était en 1518. L’université de Leipzig tenait une séance solennelle. Une grande assemblée, composée surtout de savants et d’étudiants, attendait avec autant d’émotion que d’impatience, car il ne s’agissait pas de la pompe vaine de quelque harangue officielle : une véritable lutte allait commencer. Un jeune maître, ne consultant que son ardeur et bravant les périls que la prudence d’Érasme chercha toujours à éviter, était sur le point d’attaquer en face la barbarie. Quoique soutenu par une partie de l’auditoire, il avait devant les yeux beaucoup d’ennemis déclarés ou cachés ; ces moines, défenseurs de l’ignorance et qui criaient à l’hérésie quand on enseignait une autre langue que le latin, ou seulement un latin différent de celui de la tradition, comme si Luther n’avait pas été nourri dans la scolastique[82] ; ces dialecticiens, qui tremblaient de voir leurs salles devenir désertes, et entretenaient avec soin l’irritation de leurs écoliers[83] ; ces savants jaloux, murmurant de tant d’audace chez un maître si jeune qui n’avait pas même l’honneur d’être Italien[84], et se disposant à saisir au passage toute expression d’un goût discutable pour la ridiculiser et en faire un prétexte à des récriminations haineuses.
Celui qui allait prendre la parole savait tout cela. Professeur public de grec à vingt et un ans, c’est au milieu de difficultés de toute sorte qu’il enseignait depuis trois ans[85] cette langue suspecte, au service de laquelle il allait solennellement risquer la réputation qu’il avait commencé à acquérir, à force de travail. Bien plus, il venait aussi demander qu’on introduisît dans la ville l’enseignement de l’hébreu[86], et après s’être exposé au soupçon d’hérésie, encourir celui de judaïser. Peu de jours auparavant, des frères prêcheurs avaient insulté du haut de la chaire les partisans des études nouvelles et essayé de soulever contre eux la populace. Que d’autres s’en tiennent aux épîtres et aux satires et restent dans leur cabinet : il répondra de vive voix, regard contre regard et presque poitrine contre poitrine, en s’exposant aux applaudissements mais aussi aux murmures et peut-être à des conséquences plus graves si la faveur du duc Georges ne persiste pas à le couvrir[87]. Il a fallu du courage pour faire l’apologie des trois langues.
L’orateur se lève. Ne vous le représentez pas grand et fort, et prêt à faire entendre une voix tonnante. Il n’a pas l’air d’un Allemand. Petit, le teint brun, les cheveux noirs[88], c’est pourtant un fils de cette Moselle, dont il prit le nom ; mais à cette époque les savants germains eux-mêmes étendaient jusqu’au Rhin les limites de la Gaule, et ils rangèrent plus d’une fois Mosellanus de Trèves parmi les Français[89].
En voyant debout ce jeune homme amaigri par les veilles, on se demande si sa poitrine, déjà dévorée par la maladie[90], pourra suffire à la fatigue d’un long discours. Il promène sur l’assemblée ces yeux qu’on comparait pour la couleur aussi bien que pour l’expression à ceux de la déesse de la science et de la guerre[91], et sa voix faible, quoique nette[92], ne se fait entendre qu’à la faveur du plus grand silence.
« Je ne suis pas assez stupide, hommes distingués et vous, jeunes gens studieux, pour ne pas me rendre compte de la grandeur et de la diversité de l’attente que j’excite dans cette assemblée, en me levant pour parler sur la connaissance des différentes langues. Au contraire, il y a longtemps que je savais que je devais parler devant des personnes dont les unes, par leur faveur et leurs applaudissements, s’étudieraient à encourager mes efforts, tandis que les autres, pourvues des armes de l’envie et de la haine, pèseraient comme à la balance toutes les syllabes de mon discours ; prêtes, s’il m’échappait quelque négligence, à l’emporter soigneusement et à en faire comme l’étincelle qui allumerait la flamme de leur calomnie. Que si les convenances les empêchent de s’exprimer à haute voix, elles murmurent en elles-mêmes que c’est une indignité de voir un tout jeune homme qui hier encore était au berceau et qui s’est à peine frotté de je ne sais quelle littérature, traiter devant des personnages si considérables et si éclairés un sujet si grave. »
Ici, je m’imagine que le ton de Mosellanus s’anima, que ses regards brillèrent de fierté et qu’il y eut dans sa voix une vibration belliqueuse lorsque, devançant les vers que Corneille mettra dans la bouche du Cid, après avoir raillé ceux qui croient que la science, comme le vin, a besoin d’avoir vieilli pour être estimée, il ajoute : « Et cependant, peu importe d’être grand par l’âge quand on l’est par l’âme : il en est qui, grâce à je ne sais quelle fécondité du génie, ont atteint dans la fleur de leurs ans ce que des vieillards n’auraient jamais pu espérer, même en songe. »
Nous avons signalé plus haut la partie philosophique de ce beau discours : nous n’en parcourrons pas les arguments, tantôt solides, tantôt d’une théologie bizarre. Nous passerons à regret sur la magnifique prosopopée de saint Jérôme, ainsi que sur l’éloge si net et si vigoureux d’Érasme. Plus l’orateur avance, plus son triomphe s’accentue. Il termine en montrant dans le lointain, à l’horizon, comme des astres éclatants et favorables, tous ces protecteurs des lettres, les Léon X, les François Ier, l’invincible Maximilien, Charles d’Espagne, le duc de Bavière, Frédéric le Sage, Georges duc de Saxe : dans cette splendeur amie, il voit se perdre la malignité de ses adversaires, et quand il se rassied au milieu d’applaudissements enthousiastes, sa cause est gagnée. Cet excès de fatigue aura encore abrégé ses jours : qu’importe ? Désormais l’enseignement du grec n’a plus rien à craindre, et le professeur d’hébreu peut venir.
Mosellanus (Pierre Schade) avait vingt-six ans de moins qu’Érasme. Il naquit, en 1493, à Bruttig, dans le diocèse de Trèves. C’était le quatorzième enfant de parents pauvres, mais honnêtes, dit son biographe, usant d’une locution déjà vieille, je pense, au xvie siècle. Le père de cette nombreuse famille était barbier, travaillait aux vignes dans la saison, et faisait aussi un petit commerce. Avec ces trois moyens de gagner de l’argent, il était toujours dans la gêne. Cependant, frappé de l’intelligence et de l’élévation morale de son dernier-né, qui était d’ailleurs si délicat qu’on ne croyait pas qu’il pût jamais vivre du travail de ses mains, il le mit aux études et ne cessa pas de s’imposer, pour cet objet, des sacrifices. Malheureusement ce père ne tarda pas à mourir, peut-être de fatigue, et sa veuve retira aussitôt l’enfant de l’école. C’était du même coup supprimer une dépense et s’adjoindre un aide pour le ménage. Ignorante du prix de l’instruction, endurcie par le labeur et l’infortune, croyant sans doute le dresser pour son bien, elle ne lui laissait aucun loisir. Enfin, un de ses frères obtint qu’on le rendrait aux lettres, et l’envoya à Lutebourg. Là, il tomba entre les mains d’un de ces maîtres grossiers qu’a flétris Érasme, incapables d’instruire leurs écoliers et ne sachant que les battre jusqu’à les abrutir. Aussi ne fit-il à Lutebourg aucun progrès, malgré son désir de réparer le temps perdu.
Il faut que cet enfant ait paru doué d’une intelligence bien remarquable[93] ou qu’il ait trouvé sur son chemin de bien bonnes âmes, car des amis le tirèrent de ce milieu où il dépérissait de corps et d’esprit, pour l’envoyer à Limpourg[94], sous une direction plus habile. Quand leur bienveillance se fut épuisée, souffrant du froid et de la faim, passant par toutes les misères qu’il décrira dans ses Colloques, il partit pour Trèves, où on lui avait promis la maîtrise des enfants de chœur de la grande église. L’âge venait. Mais ce fut la fin des épreuves. Son grand-père, Jean Schade, lui donne l’argent nécessaire pour aller à Cologne achever tranquillement ses études. Le voilà sous la discipline et dans l’intimité de Cæsarius, savant si désintéressé dans son amour pour les belles-lettres qu’il serait mort de faim sans le secours de ses amis. Le maître et le disciple étaient faits pour se comprendre. Avec Cæsarius, il dévore la grammaire de Chrysoloras et quelques dialogues de Lucien. Encouragé par le succès, il conçoit l’ambition, alors peu commune, de lire couramment Homère[95]. Heureusement qu’à cette époque[96] l’université de Cologne possédait, par exception, des professeurs habiles que la persécution, des dégoûts ou simplement leur humeur errante, ne tardèrent pas à disperser. Tel était Hermann de Busche, qui avait été, à Deventer, condisciple d’Érasme[97], et qui, de retour d’Italie, prêchait de lieu en lieu une sorte de croisade contre les méthodes du moyen âge. Pour le moment, il enseignait avec éclat dans cette Cologne dont il devait tant se moquer plus tard. Le jeune Mosellanus s’attacha à lui et en tira tout ce qu’il put. Sa réputation s’élève : de tous côtés on sourit à ses efforts, et il remplit enfin, dit son biographe, de qui nous n’attendions pas ce trait, les espérances de sa famille. Pauvres gens, père, frères, amis, grand-père, qui s’étaient comme relayés, se sentant responsables, et à qui nous devons Mosellanus autant qu’à lui-même. Ils avaient été à la peine ; ce que nous savons du caractère de leur protégé autorise à croire que les survivants furent à l’honneur.
Ni les profits de la médecine, ni les dignités de l’Église ne l’attirèrent. Le désir de s’instruire qui le mina comme une fièvre se confondait chez lui avec le désir d’instruire les autres. Aussi son ami Gaspard Borner n’eut-il pas de peine à lui persuader d’aller à Fribourg, près de Leipzig, contribuer au succès d’une école qu’Æsticampanius y avait ouverte. Libres de toute surveillance administrative, les jeunes savants de cette époque, allant où les poussait leur esprit, s’établissaient sur quelque terre d’ignorance et enseignaient comme il leur plaisait ce qui leur plaisait. Bientôt, on apprenait de proche en proche qu’un nouveau foyer s’était allumé, dont la clarté s’étendait souvent sur une grande partie de pays.
Au bout de peu de temps, sa réputation l’appelle à Leipzig[98]. Des amis puissants le recommandent au duc Georges, qui aimait les lettres, leur avait bâti un palais et avait mis à leur disposition d’abondants revenus. Mosellanus est nommé professeur de grec à l’Académie[99], où il enseigne seul cette langue après le départ de Richard Crook, helléniste anglais qui voulut aller finir sa vie au pays natal. Aussitôt, le jeune homme fut regardé comme l’égal de ses collègues les plus distingués, et peut-être même comme leur supérieur. Il avait à peine vingt et un ans.
En 1517 paraissent ses Dialogues. Son grand discours fut prononcé l’année suivante. Alors toute l’Europe savante parla de lui et une lettre qu’il obtint d’Érasme, en consacrant sa gloire, acheva la confusion de ses adversaires. En 1519 il préside à la dispute qui, s’étant ouverte entre Eck et Carlstadt, se continua entre Eck et Luther. Du haut de la chaire il leur prêcha la modération dans un discours qui nous a été conservé.
On s’étonne de ce qu’il a pu écrire dans sa courte existence, sans cesser de s’occuper de ses élèves, aux progrès desquels il songeait même dans le peu d’heures qu’il était forcé de donner au sommeil. Tous les jours, de grand matin, il expliquait Homère à ses pensionnaires, donnait deux ou même trois leçons publiques et deux leçons particulières, et se reposait en lisant, en transcrivant, ou en composant. Sa vie était si sobre et si pure qu’elle avait passé en proverbe : son seul luxe était sa bibliothèque. Il l’augmentait avec passion, à grands frais et recherchait surtout les éditions des Aldes. Platon, Cicéron, Plutarque, Suidas[100], Isocrate, Démosthène furent tour à tour l’objet de ses leçons, ainsi que Prudence, saint Augustin, l’Évangile selon saint Jean, l’Épître aux Romains. Il traduisit des discours de saint Basile, de saint Chrysostome et de saint Grégoire de Nazianze, ainsi que celui d’Isocrate sur la paix. Il édita le Plutus d’Aristophane, il commenta Quintilien et Aulu-Gelle. Mais nous ne voulons pas donner la liste complète de ses ouvrages.
Quelquefois l’excès de travail rend irritable ; les biographes de Mosellanus disent qu’on recherchait son amitié à cause de sa modestie et de sa douceur. Ce qu’il y avait en lui du lion ne se réveillait que lorsqu’on attaquait les belles-lettres. Nous n’avons pas l’intention de faire un panégyrique, mais comment ne pas admirer ce mélange d’élégance, de philosophie et de piété, tant de promesses qui faisaient espérer un digne successeur d’Érasme et que la mort anéantit si brusquement ? Ce n’est pas par un reste d’attachement au moyen âge qu’il donna dans ses travaux une place si considérable aux auteurs chrétiens : ce n’est pas davantage pour ménager les moines, on a vu comment il leur tenait tête au besoin ; c’est parce qu’il pensait à Dieu autant qu’à ses études et à ses élèves. « C’est à la Réformation, dit M, Charles Schmidt, qu’appartient la gloire d’avoir proclamé la doctrine que l’instruction doit servir à l’éducation pour une vie pieuse[101]. » Malgré notre respect pour le savant professeur de Strasbourg, nous n’hésiterons pas à dire que son affirmation est trop absolue. On sait que les ouvrages d’instruction écrits au moyen âge commencent et finissent par une formule pieuse ; le nom de Jésus-Christ revient souvent sous la plume des premiers écrivains de la Renaissance et rien n’est plus touchant que les sentiments religieux de Mosellanus. Je n’insisterais pas sur ce point, si M. Merle d’Aubigné n’avait rangé le jeune professeur dans la classe des indifférents, toujours prêts à rire des fautes des deux partis. Sans doute Mosellanus ne comprit pas tout d’abord la gravité de la discussion qui, à l’aurore de la Réforme, eut lieu entre Eck et Carlstadt, sous sa présidence. Il eut le tort de ne la prévoir que comme une de ces querelles de dialecticiens, si fréquentes, si bruyantes et si inutiles. « D’un côté, dit-il, la faction augustinienne, de l’autre la foule des frères prêcheurs. On verra lutter un noble couple de scotistes[102]. » Il les connaissait bien l’un et l’autre[103], et d’ailleurs que pouvait penser notre jeune recteur aux mœurs si douces et si polies en apprenant qu’il fallait faire surveiller les docteurs des deux partis à la table de leur hôte par un hallebardier et que l’un d’entre eux, Baumgartner, était mort de colère dans une dispute[104] ?
Mais au commencement de la même lettre, il s’exprime ainsi : « Aussi vrai que je désire que Jésus-Christ me fasse avancer dans mes études[105]. » Si ce début ne vous paraît qu’une vaine formule, lisez ce qu’il écrit au père Martin de Lochau : « J’en atteste Dieu qui voit tout, mon unique ambition a été, avec l’approbation des hommes les plus vertueux et les plus instruits, d’offrir en suppliant une âme purifiée des souillures du monde par les bonnes lettres, au Christ Jésus, la vraie source de la sagesse, pour qu’il l’arrosât des flots jaillissants de la sainte doctrine. J’ai pensé le jour, j’ai songé la nuit au compte que j’aurais à rendre à ce Riche de l’Évangile. J’ai tout fait des pieds et des mains pour qu’il ne manquât rien à l’intérêt du talent, si petit qu’il soit, qu’il m’a confié. Ma vie n’a jamais eu d’autre but. » Est-il juste de présenter cet homme sous les traits d’un Lucien ou d’un Démocrite ?
Après la dispute entre Eck et Luther, il pencha d’abord pour ce dernier avec un grand nombre d’esprits sérieux qui souffraient des maux de l’Église. Sa correspondance sur ce sujet avec Julius Pflug est curieuse[106]. « L’archevêque de Trèves, lui écrit-il le 6 décembre 1519, ne veut pas de mal à Martin, dont la cause lui a été remise par le Saint-Père. Il me l’a dit lui-même, quand j’ai dîné avec lui dans mon dernier voyage au pays natal. Ce sage et magnanime personnage n’a pas grand’peur des Italiens[107]. »
Mais Mosellanus désirait une réforme et non une rupture. Le 4 juin 1520, l’impétueux Ulrich de Hütten qui consent à périr dans l’incendie, à condition d’y consumer les méchants, lui écrit pour lui reprocher sa faiblesse[108], et l’engager à montrer un peu d’audace. Il le charge même de réveiller Luther. Le ton de la lettre est si vif qu’on s’imagine voir le chevalier agitant d’une main la torche, de l’autre le glaive, soulever les peuples au nom de la liberté. Ni le moine de Wittenberg ni le professeur de Leipzig ne le suivirent. Luther, sans armes, continua lentement, mais résolûment sa marche. Onze jours après, le 15 juin, il était excommunié. Mosellanus qui détestait les discordes, dit son biographe, et qui avait l’âme plus tendre que vigoureuse, resta dans le sein de l’Église. Il ne désespéra pas d’une réforme intérieure et ne voulut renoncer ni aux lettres ni à ses amitiés.
Il n’avait pas l’humeur satirique d’Érasme. On ne lui connaît pas d’ennemis. L’adversaire des humanistes, le chanoine Latomus l’estimait et en répondant à son grand discours, il ne voulut pas l’attaquer personnellement[109]. « Tout le monde l’aime, dit Henri Stromer ; il a même gagné le cœur de ceux qui ne le connaissent que par ses livres[110]. » Il fut chéri de ses protecteurs, de ses collègues et de ses disciples ; d’Érasme qui le loue magnifiquement[111] ; de Mélanchthon qu’il défend auprès d’Érasme[112]. Adolphe, évêque de Fribourg, Gryffencla, archevêque de Trèves ; Julius Pflug, qui fut conseiller de deux empereurs[113] ; Carlovitz, qui avait passé quatre ans dans sa maison et qui devint ministre de Charles-Quint[114] ; Eobanus Hessus, médecin et professeur de belles-lettres à Nuremberg ; Moltzer, de Strasbourg, qui enseignait le grec à Heidelberg et qu’on surnommait Micyllus[115] ; le célèbre érudit Camérarius, qui avait été son auditeur assidu en 1517[116] ; Jean Apel, qui fut plusieurs années son élève et qui était plus âgé que lui[117] ; un grand nombre d’autres encore s’honorèrent de lui donner le titre d’ami.
Quand il mourut à l’âge de trente et un ans, de fatigue comme son père, mais de fatigue intellectuelle, ayant perdu le sommeil, Mélanchthon, qui était venu de loin pour le voir, eut la douleur de n’arriver qu’après son dernier soupir. Julius Pflug prononça son oraison funèbre ; on lui éleva un tombeau à Leipzig, devant l’autel de cette église de Saint-Nicolas où il avait été deux fois présenté à l’Université comme recteur[118], et on grava sur la pierre un vers grec qui peut se traduire ainsi :
Faible et petit de corps il avait l’âme grande[119].
Quatre ans après sa mort, le regret de cette perte n’était pas effacé. « J’admire, dit Érasme en 1528, cette égale connaissance des deux langues, cette âme droite et généreuse, cette activité infatigable, ce style vif, fleuri et clair. On pouvait tout attendre de son génie, si, dès la jeunesse et à peine entré dans la lice de la gloire, une mort prématurée ne l’eût ravi, à la grande tristesse de tous les savants et au grand dommage des lettres[120]. »
Tel était celui qui prêta le premier un langage correct aux sentiments et aux pensées de la jeunesse des écoles, en y mêlant, dans une juste proportion, ses pensées et ses sentiments.
Depuis Érasme le mot de colloque semble inséparable des mots de finesse et d’esprit, et l’on pourrait croire que le jeune maître qui précéda son illustre ami dans cette voie s’y joua en souriant et avec plaisir. On se tromperait. Ce n’est pas sans quelque honte que Mosellanus se décida à publier ses Dialogues. Le commentateur de tant de chefs-d’œuvre se demanda s’il ne compromettait pas sa réputation en descendant à donner des modèles de conversation d’écoliers. Derrière lui, il n’avait guère que le Manuel de 1480, devenu ridicule ou plutôt complètement oublié, car il n’en fait mention ni dans sa préface, ni dans l’énumération de mauvais ouvrages qui commence la dédicace de son grand discours ; quant aux livrets que les maîtres dictaient dans leurs écoles, en les composant suivant les besoins, ils se sentaient encore, soit pour le fond, soit pour le style, de la grossièreté du xve siècle, et ne contenaient sans doute que des détails d’une puérilité mesquine. Ces essais même étaient rares, car Mosellanus va parler du genre, comme s’il était à créer ; s’il ouvre cet humble sentier (1517)[121], c’est par devoir et parce qu’en effet il se sentait obligé de ne laisser improductive aucune partie du « talent qui lui avait été confié. » Mais laissons-le expliquer lui-même sa pensée.
Il le fait en tête du livre dans une lettre à Jean Polyandre, principal du collége de Saint-Thomas, à Leipzig, et qui fut, en quelque mesure, son collaborateur :
« Tu sais, lui écrit Mosellanus, tu sais, mon cher Jean, par une expérience de beaucoup d’années, avec quelle difficulté et quelle lenteur l’âge si faible de l’enfance arrive à l’imitation de la latinité antique. Aussitôt après les éléments de la grammaire, ces intelligences toutes tendres sont pliées à l’usage de la conversation en langue latine, sans le secours d’aucune méthode. Aussi leurs efforts pour obéir, n’importe comment, produisent un jargon tout à fait barbare qui suit l’idiome vulgaire à la trace. Ces vicieuses empreintes pénètrent si profondément dans leurs jeunes esprits, qu’on ne peut plus ensuite les effacer. Voilà pourquoi non-seulement les Allemands, mais encore les Italiens qui veulent nous paraître mieux doués sous ce rapport, usent, pour les besoins de chaque jour, d’un langage si impur. On dirait vraiment que Quintilien n’a rien écrit sur l’improvisation. »
Mosellanus rappelle ensuite que Polyandre, désireux de faire avancer les enfants confiés à ses soins, l’avait prié d’écrire à leur usage quelques formules. « Longtemps, comme tu le sais, je t’ai résisté, en partie parce que la gravité de mes occupations me faisait dédaigner ce travail, très-utile sans doute, mais d’une apparence humble et presque basse ; en partie parce que, faute d’habitude, j’aurais eu de la peine à jouer ce rôle avec convenance, car je voyais bien que pour cette espèce de comédie, il fallait redevenir enfant, et, comme dit Horace, aller à cheval sur un long roseau. » Heureusement le directeur du collége de Saint-Thomas revenait toujours à la charge et promettait de mettre au service du savant professeur, la connaissance qu’il avait des mœurs des écoliers. Il fallut céder, et c’est peut-être à Polyandre que nous devons, par l’influence de l’exemple de Mosellanus, les Colloques d’Érasme ; l’amitié et le désir d’être utile l’emportèrent. « Voyons, vous qui me trouvez ridicule et froncez le sourcil, en disant que c’est perdre le papier à des sottises, oubliez un peu que vous êtes homme, faites-vous enfant, figurez-vous qu’il vous faut apprendre à parler latin, et vous verrez tout de suite avec quelle facilité, au moyen de ces petites scènes, on arrive, comme par des degrés insensibles, à la pureté de Térence, à l’abondance de Cicéron. Vous m’auriez sifflé si j’avais fait parler mes jeunes acteurs avec la sagesse refrognée des vieillards. »
D’ailleurs, pour mieux échapper aux reproches des Aristarques, il a mêlé des choses sérieuses à ces badinages. Sera-t-il ainsi tout à fait à l’abri de la critique ? Il l’espère à peine et revient encore sur le tort qu’il a fait à sa dignité. Il termine en remerciant son ami : « J’ai voulu te dédier ce travail, mon cher Polyandre, puisque tu nous as engagé et en même temps aidé à l’écrire : protége-le de ta parole, de ton autorité et de ton crédit. S’il ne nous revient de cette publication aucune gloire, nous nous en consolerons tous les deux en pensant que nous n’avons pas agi par le désir d’un vain renom, mais en toute simplicité et piété. Nous avons cherché à être utile à quelques-uns sans nuire à personne. Adieu. De Leipzig, ce jour de Saint-Matthieu, en l’an 1517. »
Des efforts du principal et du professeur, l’un donnant ses observations et l’autre son style, naquit une suite de scènes détachées où la vie universitaire de Leipzig était reproduite aussi exactement que le permettait le respect dû à la jeunesse. Le Manuel de 1480 avait décrit avec une verve complaisante la dégoûtante cérémonie de la réception des béjaunes, les rapts de volailles, la saleté, les querelles et les pugilats des étudiants de son temps ; pour les tenir éloignés des femmes, il les avait représentées comme des êtres d’un contact venimeux, en assaisonnant d’injures ce conte ridicule : Mosellanus passe sous silence les faits de cette nature (tous ses successeurs n’auront pas la même discrétion); il leur refuse l’usage de la langue latine, et sans en avoir l’air, épure les mœurs autant que le style. Il a donc moins dérogé qu’il ne croyait. On voit d’ailleurs qu’il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu’il dit de la puérilité de son sujet : qui ne sait que les écoliers du xvie siècle étaient souvent des jeunes gens et quelquefois des hommes faits ? C’est ainsi que Rapicius, dans ses conseils sur la disposition d’un auditoire, assigne des places distinctes aux enfants, aux adolescents, et aux hommes[122].
Trois sujets ressortent dans ces entretiens : la vie ordinaire des écoliers, leurs idées religieuses et le détail de leurs études. Nous grouperons les faits d’après cette division naturelle.
Ce qui frappe le plus, ce qui revient sans cesse, ce qui est comme le fond du tableau, c’est la misère des étudiants. On la connaît, et nous nous serions contenté de la signaler comme un lieu commun, sans les intéressants détails donnés par l’auteur. Si l’on en croit l’anonyme de 1480, la vie universitaire était moins pénible en Allemagne au moyen âge, car on n’y entrait que si l’on était pourvu de quelques ressources ; ou bien on se mettant au service d’un professeur[123]. Mais la Renaissance avait suscité de tous côtés des disciples aux belles-lettres. Accourus de bourgs et de villages lointains dans la même ville, ils n’y pouvaient vivre sans rien faire, puisque, en général, leurs parents étaient trop pauvres pour les entretenir ; et leur grand nombre créant la concurrence, il ne leur était pas facile de vivre du travail de leurs mains, quand même ils en auraient eu la volonté. S’ils recevaient quelques secours, c’était à des époques irrégulières. On ne voit pas qu’il y ait eu à Leipzig, comme à Paris, des messagers[124], uniquement chargés d’entretenir les rapports entre les écoliers et leurs parents : institution si importante que Du Boulay la mentionne presque à chaque page de son histoire. Les étudiants de Leipzig ne pouvaient pas, comme le Limousin que rencontra Pantagruel, « quand leurs marsupies étaient exhaustes de métal ferruginé, prestoler les tabellaires à venir des pénates et lares patriotiques. » Il fallait attendre la foire qui se tenait deux fois l’an, suivant l’ordonnance de Maximilien, savoir en automne et au premier janvier, avec défense d’en tenir de pareille dans les pays de Halberstadt, de Misnie et de Mersebourg, à la distance de quinze milles[125]. Alors les marchands apportaient des lettres et quelquefois une petite somme d’argent, « plus précieuse que les lettres. » Ou bien c’était du drap pour se faire un habit d’hiver[126], don qui avait aussi sa valeur, car l’hiver n’était pas seulement pour ces pauvres gens une des quatre saisons. Beaucoup ne recevaient rien. Les plus heureux devaient s’armer de patience. Le marchand ne se pressait pas de s’acquitter des commissions paternelles. Il donnait la lettre tout de suite ; quant à l’argent, c’était autre chose. « Je ne puis tirer un sou de lui avant la fin de la foire : il dit que dans un tel bruit de gens il n’a pas le temps de me faire mon compte[127]. »
A cause de l’incertitude et de l’insuffisance de ces envois, on mendiait. La mendicité des écoliers était une institution et même un droit reconnu par les habitants, qui ne donnaient pas dédaigneusement, mais pour l’amour de Dieu. Ils distinguaient les étudiants dans la foule des misérables qui se pressaient devant leurs maisons. Cependant plus d’un paresseux abusait de la dîme que les bourgeois payaient ainsi à la science et vieillissait en ôtant aux travailleurs le pain de la bouche[128].
On les attendait à certains jours et à certaines heures. « Aussitôt après la messe, dit Laurent, je courrai si vite à la porte des riches que je serai sinon des premiers, au moins des seconds ou des troisièmes à recevoir la pièce. — Tu auras de la peine à me dépasser. — Nous verrons bien[129]. »
Le jour de Saint-Martin, ce soldat charitable qui donna à un pauvre la moitié de son manteau, leur était particulièrement consacré. « Ce sera demain la Saint-Martin. — Eh bien ? — Nous autres écoliers nous faisons ce jour-là une très-abondante récolte. D’abord on nous donne à manger plus largement que d’habitude, puis c’est l’usage que les pauvres aillent de porte en porte recevoir de l’argent. J’espère ramasser de quoi passer l’hiver sans avoir trop à souffrir[130]. » Toujours ce redoutable hiver !
Ils faisaient la quête jusque dans la campagne. Mais alors Mosellanus blâme leur paresse et leur manque de dignité, puisqu’ils s’exposaient à être confondus par les paysans avec le vulgaire des vagabonds. « Qui veut venir avec moi aux champs ? Nous mendierons des œufs suivant la coutume[131]. » Refus et reproches du camarade. « Est-il rien de plus dégradant que de tourner autour des bergeries pour neuf ou dix œufs et de manquer ainsi les leçons ? — Mais comment apaiser ma faim ? — Ici, à la ville. Au moins tu ménageras le temps[132]. » A cette réponse on reconnaît l’homme qui répétait que rien n’est plus précieux que le temps[133], et qui ne perdit jamais le sien.
On s’occupait si bien d’eux à la ville que de riches citoyens avaient établi des fondations en leur faveur[134]. C’était, par exemple, une distribution de viande[135], que les plus savants comparaient peut-être à l’antique sportule, exemple qui les eût relevés à leurs yeux s’ils avaient senti le besoin de l’être ; on avait aussi l’habitude de les faire participer aux magnificences des noces[136]. On les voyait en foule se disputer les restes des plats.
Mais, on le sait, leur ressource ordinaire était le chant. Luther s’en souvient. C’est surtout la veille des fêtes qu’on entendait de la rue leur voix fraîche et pure, trop souvent tremblante de froid. Ils ne se soumettaient pas toujours de bon cœur à cette obligation. Ils trouvaient dur, aux approches de la Noël, de quitter les livres et de passer le temps à apprendre des cantiques[137], pour rester ensuite toute la journée dans l’église à chanter en chœur. Ils se plaignent d’y grelotter[138] pendant cette longue station, surtout ceux qui n’avaient pas reçu leur drap pour l’hiver, mais ils se résignent au souvenir des Innocents qui souffrirent bien plus encore à pareille époque, puisqu’ils furent tués par Hérode. Ne croyez pas qu’ils pouvaient chanter le premier cantique venu. Peut-être qu’à l’église on n’était pas difficile, mais devant les maisons c’était autre chose. Les raffinés donnaient en proportion de la surprise offerte à leurs oreilles : aussi, pour égayer les repas des riches[139], cherchait-on des paroles et des airs nouveaux.
Que de temps perdu ! ce n’était pas assez. Après avoir mendié le vivre, ils avaient besoin du couvert et n’obtenaient un coin quelque part qu’à la condition de rendre mille services. Quand leur maîtresse était bonne cela leur rappelait la vie de famille, mais il n’en fallait pas moins quelquefois renoncer à la classe, après avoir, par exemple, prévenu le maître qu’ils resteraient l’après-midi à la maison pour tirer de l’eau[140]. Quelquefois (c’est Hegendorf qui nous fournit ce détail comme pour achever la peinture[141]) le maître du logis veillait très-tard en se faisant à tout moment servir de la bière. Ils ne pouvaient ni dormir ni ouvrir un livre, et chaque nouveau pot, il fallait l’offrir avec une belle formule de politesse[142]. On enviait pourtant le sort de ceux qui étaient ainsi domestiques dans de bonnes familles, au lieu de coucher sur la paille de la classe[143], et nous voyons un étudiant riche promettre pour cet objet sa protection à son camarade dans l’indigence[144] ; offre faite et reçue avec une fraternelle simplicité. D’ailleurs, tout entiers aux classiques, ils se souvenaient de Cléanthe pétrissant du pain et de Plaute qui avait tourné la meule. L’espoir d’un meilleur sort les animait, toutes les dignités étant promises à la science.
Quelquefois cependant ils se laissaient aller au découragement. « Heureux ceux qui sont assez riches pour rester chez eux, assis devant la cheminée ou autour d’un poêle bien chauffé ! — Et nous, que nous sommes malheureux, obligés de demander notre pain de porte en porte, presque nus, sous la pluie ou sous la neige ! Ce qui me console, c’est le passage d’Horace :
Qui cupit optatam cursu contingere metam
Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit.
Autrement, j’aurais envie d’accuser Dieu. — Tais-toi, lui dit son camarade indigné : prends garde de parler de Dieu avec une légèreté brutale[145]. »
J’aurais voulu les montrer au jour de l’an, lorsqu’ils trouvent dur de ne pas avoir de quoi faire un petit cadeau. Quant à la saleté, conséquence d’une pareille misère, quoique nous ayons des renseignements d’autre part, il faut imiter la réserve de Mosellanus et se borner à dire qu’un bourgeois, non moins soucieux de la salubrité publique que compatissant, avait légué ce qu’il fallait pour que les bains fussent ouverts gratuitement aux écoliers, une fois par an[146]. La négligence de ceux-ci était d’autant moins excusable qu’on croyait que la propreté du corps rend l’esprit plus net et que la tête étant le siége de la science, il faut la laver[147].
J’aurais voulu montrer que leur vie n’était pas toujours aussi triste et décrire les distractions qui leur étaient permises. On leur défendait pendant le carnaval de courir la ville en masque[148], ce divertissement étant bon pour les artisans. Mais ils avaient le spectacle des danseurs de corde : un jour, des Russes font sauter leurs ours au son de la trompette[149]. Un autre jour, c’est un tournoi, et l’on a eu grand soin de couvrir le cirque de fumier pour amortir les chutes[150]. Enfin, un autre jour, pendant la semaine sainte, il y a une représentation de la Passion. Les acteurs seront des écoliers. « J’aimerais mieux, dit naïvement un des interlocuteurs, qui nous donne à penser que la réalité était parfois trop fidèlement imitée, j’aimerais mieux jouer dans cette pièce le rôle du plus grossier soldat ou même celui du bourreau que celui du Christ[151]. » Combien de détails nous aurions pu glaner encore ! Mais pour leur rendre aujourd’hui leur intérêt, il faudrait, comme disait Mosellanus, se refaire enfant ou se souvenir qu’on assiste aux commencements de plusieurs hommes illustres qui durent à cette vie pénible une vaillance trop souvent mêlée de rudesse. Abordons un sujet plus grave et plus étroitement lié au grand mouvement du xvie siècle.
Si les petites choses aident à comprendre les grandes, s’il vaut la peine, avant la manifestation d’un grave changement, d’en étudier la naissance dans les rangs obscurs d’une petite partie de la société, quand il n’a pas encore pris conscience de lui-même, le témoignage de Mosellanus sur l’état religieux des étudiants de Leipzig mérite d’être recueilli. Il est d’autant plus digne de foi que l’auteur ne le donne qu’en passant et négligemment. D’ailleurs il écrivait quand la Réforme n’était pas même soupçonnée, c’est-à-dire avant la venue de Tetzel à Wittemberg, et lorsque Luther n’était encore connu que comme un professeur distingué. En effet, c’est le 31 octobre 1517 que furent affichées les propositions contre les indulgences, et c’est le jour de Saint-Matthieu, c’est-à-dire le 21 septembre, plus d’un mois auparavant, que Mosellanus avait terminé l’épître dédicatoire de son livre. N’est-il pas utile de connaître les dispositions des étudiants, précisément à la veille de la Réforme, et pourrions-nous trouver un meilleur guide que notre auteur, si réservé, si ennemi de la satire[152], qui resta catholique, et qui fait honneur au catholicisme allemand du xvie siècle ?
Chez lui, les écoliers et les maîtres sont pieux[153]. Sans doute, dans ces écoles sorties des monastères et des églises, le langage traditionnel enchérissait sur la pensée, mais il ne la maintenait pas moins dans un certain état général.
L’Université n’était pas devenue tout à fait laïque. Nous ne pouvons pas affirmer que toutes les ordonnances du xve siècle, et entre autres celle qui obligeait d’assister à la promulgation des indulgences sous peine d’une amende de quatre gros[154], fussent en vigueur ; mais les écoliers que nous avons déjà vus chanter dans les églises étaient aussi tenus de suivre en corps les processions. Un jour, ils se joignent au cortège funèbre[155] d’un riche bourgeois qui avait été sans doute leur protecteur : aux Rogations, quand l’évêque porte l’hostie autour des murs de la ville, et le lendemain, quand il ira bénir les champs à la tête de son clergé[156], les étudiants auront dans cette pompe leur place marquée. Ils sont pour ainsi dire le trait d’union entre le prêtre et le peuple.
Que de saints ils ont à fêter comme des amis particuliers ! On se souvient de saint Martin, mais il faut citer aussi saint Grégoire, sainte Catherine et saint Nicolas. Sainte Catherine était la patronne des études[157]. C’est une dignité qu’elle partageait avec saint Grégoire, dont on choisissait la fête pour entrer aux écoles et se faire inscrire sous d’heureux auspices[158]. La veille de cette cérémonie on se confessait. Quant à saint Nicolas, il présidait à la création de l’évêque des écoliers[159], car si plus tard on nomma les premiers d’entre eux empereurs, c’est au clergé qu’on demandait alors des titres. La nomination était faite par les écoliers avec l’approbation du principal : le dignitaire était conduit en pompe à l’église et la cérémonie se terminait par un grand dîner qu’offrait quelque amphitryon de la ville.
Ainsi les amusements mêmes avaient quelque chose de religieux. Celui-ci se passait au collége et dans l’église, sous la surveillance des maîtres, du clergé et des magistrats, tandis qu’à Paris la même coutume avait dégénéré en mascarade, en courses nocturnes avec des torches et en lutte avec le guet[160]. A Paris on jouait des pièces satiriques ; ici, à nous en tenir au témoignage de Mosellanus, on en était encore aux mystères[161]. Cependant l’esprit de critique pénètre par deux voies assez différentes, celle de la misère et celle de l’instruction.
Si les fêtes étaient nombreuses, les jours de jeûne ne l’étaient pas moins, car ils avaient lieu la veille de toutes les fêtes. Or, l’observance en était plus sévère que maintenant. L’écolier, si mal nourri en temps ordinaire, ne faisait taire qu’à grand’peine, suivant une expression qui revient souvent, « les rugissements de son estomac. » — « Maudits soient, criait-il, quand revenait une de ces fatales journées, maudits soient ces je ne sais quels personnages qui chargent de jeûnes presque toute l’année. N’était-ce pas assez d’un carême de quarante jours ? Moi qui peux à peine apaiser ma faim une fois par an, me voilà encore tourmenté par les jeûnes ! » Son camarade est devenu moins scrupuleux depuis qu’il a entendu un moine dire en chaire (symptôme à noter) que, d’après les Pères de l’Église et saint Jérôme, ces mortifications étaient surtout imposées aux riches. « Alors je remercie bien saint Jérôme qui nous a pris, nous autres pauvres et toujours affamés, sous sa protection[162]. »
Une autre fois leur colère tombe sur un usage trop coûteux pour qu’ils puissent s’y conformer. « Pourquoi n’as-tu pas de cierge, mon cher Nicolas[163] ? — Eh ! comment m’en procurerais-je, moi qui n’ai pas même assez d’argent pour acheter de quoi manger ? Si j’étais chez moi, ma mère m’aurait vite acheté de telles babioles. » Indignation du camarade. Mais l’autre : « Je ne serai pas devenu tout de suite hérétique pour ne pas porter de cierge. Je crois qu’il serait plus agréable au Christ que tout l’argent qu’on met en cierges fût employé à soulager les pauvres. — Tu as raison, car moi-même j’ai souvent ri de la superstition des bonnes vieilles qui sont si contentes d’elles, parce qu’elles offrent tous les jours trente-six cierges, qu’elles croient ainsi mériter le ciel, lorsque sur les places tant de pauvres crèvent de faim[164]. »
Dans ces dispositions ne devaient-ils pas se montrer sévères pour des superstitions évidentes ou pour des coutumes inconnues dans leur propre pays, et qui étaient dans cette ville des articles de foi ? Les uns remarqueront que la bénédiction solennelle des campagnes est remplacée chez eux par une cavalcade de paysans précédés d’un prêtre[165] ; d’autres, qu’on ne fête pas dans leur pays saint Urbain, le protecteur des vendanges, et ces urbanales où l’on boit et danse leur paraissent de vraies bacchanales[166]. A la Saint-Jean, le prêtre faisait passer la coupe sacrée et les fidèles y trempaient les lèvres pour se prémunir contre les chances d’empoisonnement. « Mais moi, je ne boirais pas la ciguë sur cette confiance, sauf la révérence due au calice[167]. »
Ainsi, les souvenirs classiques nuisaient aux croyances populaires, et les moines n’avaient pas tout à fait tort de redouter le progrès des lettres. On ose traiter la confession de charge incommode et dire à haute voix qu’on cherché un prêtre peu exigeant, à moitié endormi, à qui l’on pourra facilement cacher quelques fautes[168]. Enfin on regarde les saints en face, ces saints si nombreux, cause de tant de jeûnes, et on les interroge sur leur origine. « Sainte Catherine ! dit Valère, mais je ne croyais pas que l’Église eût solennellement établi sa fête. — Eh bien, la coutume a pris force de loi. — Je ne refuse pas de jeûner : cependant, à ne te rien cacher, jusqu’à présent j’avais cru que le Christ était le vrai patron des études, puisque c’est lui qu’on appelle la sagesse, dans les sermons. — Tu t’efforces d’introduire des nouveautés ; moi j’aime mieux suivre la voie commune. — Ne connais-tu donc pas le vers de Pythagore : Il ne faut pas aller sur le grand chemin ? — Tu m’ennuies : va par ton chemin, j’irai par le mien[169]. »
N’entend-on pas ici comme les premiers bégayements de la Réforme ? Nous comprenons maintenant qu’en 1519, après la dispute entre Eck et Luther, un grand nombre d’étudiants aient quitté Leipzig pour Wittemberg. Comme il eût mieux valu éviter un déchirement en faisant droit dès l’origine aux légitimes réclamations de tant d’esprits éclairés !
La Pédologie donne aussi des renseignements sur la discipline et sur les études.
Le maître y est doux, poli, intègre. Polyandre n’aurait pas fait passer, pour deux ou trois florins, des examens de complaisance, comme cela arrivait au moyen âge[170]. On ne lui dit ni Reverentia vestra ni vestra Dignitas : ses élèves le tutoient, conformément au génie de la langue latine, mais ils le consultent avec une confiance mêlée de respect. Il a conservé la férule, car les déclamations contre cet instrument ne sont pas encore devenues un lieu commun ; nous regrettons qu’il ait conservé l’espionnage, tout en le faisant exécrer par les écoliers qu’il met en scène.
On n’ignore pas que, d’après le règlement donné par Gerson pour l’école de Notre-Dame, les élèves devaient dénoncer les fautes de leurs camarades, sous peine d’être punis comme le coupable. Cette règle, conforme à l’esprit d’une époque qui faisait trop bon marché de la liberté et de la dignité individuelles, paraît avoir existé au moyen âge dans toutes les écoles. Les élèves l’avaient acceptée plus facilement qu’on ne le croirait, à cause de leur déférence pour le principe d’autorité, et parce qu’ils l’avaient éprouvée utile à leurs progrès. « Dès qu’il m’échappe un mot en langue vulgaire, dit Camille, dans le vieux Manuel, tu me signales. — C’est la règle. Il n’y a pas là de quoi nous brouiller. — Mon bon Bartold, j’ai peine à me contenir quand tu me signales, mais si je considère le bien qui en résulte, mon indignation tombe tout à coup.[171] » Cependant le cœur humain n’est pas fait de telle sorte que celui qui provoque le châtiment et celui qui le subit, le considèrent toujours comme un remède. Ce qui prouve que la dénonciation est contre nature, c’est que nous la voyons plus d’une fois maudite, même au moyen âge[172].
Au xvie siècle, cette institution tendit à se modifier en deux sens contraires, les deux principes qu’elle contenait développant chacun séparément ses conséquences. En France, dans les Pays-Bas, en Suisse, en Angleterre, elle se régularisa en une sorte de magistrature, confiée publiquement à de grands élèves qui étaient d’ailleurs tenus d’aider les autres dans leurs études[173]. Le maître continua d’être soulagé d’une partie de la surveillance, mais comme un père de famille qui se repose sur des fils aînés ; et la morale souffrit de moins en moins, car les observateurs que nous trouvons déjà animés d’un esprit respectable à Genève, d’après les colloques de Cordier, deviendront, en Angleterre, ces præpostors qui existent encore, protecteurs autant que censeurs et dont les fonctions méritent enfin un éloge sans mélange.
Ainsi l’obéissance publique à la règle eut pour résultat, dans ces derniers pays, d’éliminer peu à peu la dénonciation et de la remplacer par une loyale surveillance, remise entre les mains des plus dignes. En Allemagne, quand les délateurs désirèrent le secret, les maîtres curent la faiblesse de le leur promettre et les transformèrent ainsi en espions ; en même temps ils trouvèrent commode d’être partout présents, par cette police mystérieuse. Ils s’applaudirent d’avoir favorisé, par ce moyen, les progrès des études et ne prirent pas garde qu’ils se dégradaient, eux et leurs complices. Nous avons cherché soigneusement en France des traces d’une telle organisation ; elle semble avoir répugné à notre caractère national. Nous n’avons trouvé dans nos colléges que les exploratores ou observatores déjà signalés ; nous ne les avons vus ni à Heidelberg, ni à Leipzig, ni à Cologne ; ils sont remplacés dans ces universités allemandes par des lupi[174], ainsi appelés parce qu’ils s’approchaient par derrière, à pas de loup.
Je les remarque d’abord dans le vieux Manuel[175]. Je les retrouve ensuite, à mon grand regret, dans la Pédologie. « Nous sommes punis le vendredi de toutes nos fautes de la semaine. — Mais comment les maîtres peuvent-ils les connaître ? — Ils choisissent secrètement quelques élèves, et leur donnent charge de nous dénoncer et de nous trahir, nous, leurs camarades. De sorte que nous ne pouvons jamais vivre en sécurité, car il est toujours à craindre que quelqu’un de ces corycæi[176] ne nous écoute et ne soit pour nous le loup du proverbe[177]. Aussi, nous les détestons ! » Il faut que les idées se juxtaposent dans les têtes d’une façon étrange, puisqu’on pouvait respecter les maîtres qui se servaient de pareils moyens ; il faut que la morale fasse de grands progrès d’un siècle à l’autre, puisque ces maîtres croyaient bien agir, et que, dévoués à leurs élèves, ils étaient en effet respectables par tant de côtés !
Donnons-nous un spectacle moins pénible et qui sera tout à fait honorable pour Polyandre ; considérons l’état des études au collége de Saint-Thomas.
On ne savait guère le grec au commencement du xvie siècle. Dans la plupart des colléges on ne l’enseignait pas. Vers 1513 ou 1514, Polyandre en avait fait enseigner les éléments dans la première classe, et le bruit de cette nouveauté s’étant répandu, plus d’un écolier avait quitté les écoles des villes environnantes, pour venir à Leipzig se mettre en état de lire plus tard le Nouveau Testament ou Homère. « Quand j’eus atteint l’âge de raison, dit un de ces nouveaux venus[178], j’allai entendre un maître qui n’expliquait que les auteurs latins. De temps en temps il se rencontrait des mots grecs dans le texte. Alors notre maître croyait s’acquitter parfaitement de son devoir, quand il nous avertissait en passant que c’était du grec, comme si ce détail était pour nous sans importance[179]. Mais, moi, je me disais : Si ces mots ne nous regardent pas, si la connaissance n’en rend pas savant et l’ignorance malhabile, pourquoi ne débarrasse-t-on pas les livres de ces pierres d’achoppement ? Puis, j’admirais la bizarrerie de presque tous les écrivains anciens qui, non-seulement, ont appris ces balivernes avec grand soin, mais en ont comme maculé leurs ouvrages. Comme j’étais dans cet embarras, il plut à notre maître d’expliquer le De officiis. Or, dans la préface, ce philosophe et cet orateur si considérable conseille à son fils d’apprendre le grec en même temps que le latin, pour qu’il soit capable de s’exprimer dans les deux langues. Mon maître eut beau embrouiller le texte tant qu’il pouvait, je saisis le sens du passage ; je gémis de n’avoir pas l’occasion d’apprendre une littérature qu’un consul n’aurait pas louée si elle eût été inutile, et qu’un père si sage n’aurait pas conseillée à son fils unique. Le bruit qu’il en était tout autrement à Leipzig m’attira dans cette ville. »
Si enseigner les éléments du grec était une merveille, il ne faut pas s’attendre à ce que le choix des auteurs latins fût encore bien pur. Jérôme revient de chez le professeur de la première classe[180]. « A-t-il donné la liste des auteurs qu’il expliquera le prochain semestre ? — D’abord, les comédies de Térence (elles étaient inévitables); en second lieu, le De officiis, modèle de morale autant que de style, et que Pline conseille d’apprendre par cœur. Enfin quelques livres de Virgile. » Mais ce dernier ne passe que sur l’autorité de saint Augustin. Douze ans plus tard, à Deventer[181], le programme sera le même, sauf le Virgile, dont la mention a peut-être été omise par inadvertance, car il n’est pas probable que les Hiéronymites aient conservé les préjugés du moyen âge jusqu’en 1529. D’ailleurs l’année même où parut la Pédologie, Robert Goulet, à Paris, recommandait Virgile autant que Cicéron[182].
Sachons gré à Polyandre d’avoir rejeté Apulée et les auteurs de même farine, écrivains bizarres qu’on expliquait encore de son temps, précisément à cause de leur bizarrerie, dira Muret, et pour triompher de leurs difficultés. Quant à Catulle, Tibulle et Martial, on les écarte au nom de la morale, et ce scrupule était encore une exception.
Les jours de fête, comme à Deventer, et sans doute comme partout, on expliquait les hymnes de Prudence, dont Mosellanus fait l’éloge, et le Miles christianus d’Érasme, qui était devenu classique presque aussitôt après son apparition (1509).
Ce programme est moins riche et surtout d’un goût moins sévère que celui que Muret développera cinquante ou soixante ans plus tard à Rome, dans son Discours sur l’enseignement des belles-lettres[183]. Alors les auteurs de la décadence auront tout à fait disparu ainsi que les modernes Valla et Érasme ; tout le trésor de la bonne antiquité grecque et latine sera répandu avec une profusion intelligente. Il serait trop long de citer ce programme de Muret, qui est à celui de Mosellanus ce que la plante est au germe, et pourtant c’est par les discours et surtout par les Prælectiones de Muret, si claires, si philosophiques, si élégantes, qu’on peut deviner ce que voulaient être en 1517 les explications des professeurs du collége de Saint-Thomas[184].
En 1520, Mosellanus ajoute à sa Pédologie deux dialogues, dont le dernier traite du choix d’une université pour le jeune homme qui sort du collége. Il recommande premièrement celles de Leipzig et de Wittemberg. Ni Erfurth, ni Bâle ne sont à mépriser. Mais Louvain brille par son collége des trois langues et surtout par le bonheur qu’elle a de posséder Érasme. L’illustre. archevêque Albert a de grands projets pour Mayence[185]. Le dialogue, et en même temps le livre, se termine par des conseils parmi lesquels je remarque celui de s’attacher à un professeur sur le modèle duquel on réglera ses mœurs autant que ses études. Coutume excellente et qui mériterait de revivre.
Considérons maintenant la langue de la Pédologie. Mosellanus ne commença à écrire que lorsque Érasme était déjà célèbre ; cependant il n’a pas l’aimable facilité de son devancier. Son élégance, surtout dans les discours académiques, a quelque chose de recherché et de pénible. Nous savons par Justin Gobler qu’il avait fait une collection des métaphores de Cicéron ; on sent trop qu’il adapte ces ornements à sa pensée comme les anciens appliquaient les mêmes figurines tantôt à une coupe tantôt à une autre.
Dans la Pédologie, sa phrase trop périodique manque quelquefois de simplicité. Pourtant les fragments de Térence y remplacent les métaphores cicéroniennes. Quant aux mots, un très-petit nombre appartiennent à la basse latinité. Ainsi septimana (semaine), qu’on trouve dans le code Théodosien et qui appartient probablement au latin rustique ; conterraneus (compatriote), mot déjà employé au xve siècle par les écoliers et que Pline l’Ancien donne dans sa préface comme un castrense verbum ; semestre (semestre), qui n’est pas même dans du Cange. Impostura est pris de Terlullien. Obulus, hostiatim, hostium (porte), hymbres n’ont de défectueux que’ l’orthographe.
Quelquefois les mots sont latins, mais la signification en est altérée. Manuarium artificium ne peut pas signifier travail manuel, car le sens de l’adjectif manuarius est ce qu’on peut saisir avec la main : ce n’est que dans du Cange qu’on trouve le substantif manuarius, un manœuvre. Rationarium ne peut pas être davantage le registre où le maître inscrivait les noms de ses écoliers : ce mot est employé par Suétone, mais avec le sens de statistique (Aug. 28). Le Manuel de 1480 disait avec moins d’élégance mais plus correctement : Matricula.
Mosellanus crée quelquefois des diminutifs : strenula (petite étrenne). Plus rarement qu’Érasme, et surtout que Vivès, il fait des emprunts au grec : bibliopolium (librairie). Il a le bon sens de conserver la langue de l’église qui fait en quelque sorte partie des objets sacrés. Toutefois il lui échappe la locution païenne bonus genius, qu’il explique aussitôt : quem angelum dicimus.
Assez souvent des mots à physionomie suspecte sont tirés de bons auteurs. Cereus, dans Plaute, Cicéron, Martial, signifie sinon un cierge, du moins une chandelle de cire. Locarium (loyer) est de Varron. Pour éviter à la fois les périphrases et la barbarie, ces savants feuilletaient avec un soin minutieux des auteurs anciens qu’on ouvre rarement aujourd’hui.
Il faut remarquer que si Mosellanus a dû se mettre en peine de chercher des termes pour exprimer des idées familières, il n’a pas eu souvent à traduire des idées modernes. Si l’on en excepte l’église et l’école, ses sujets sont de tous les temps. Sa langue est celle des lettres et de la morale. Encore ici il fait preuve de bon sens en s’abstenant de mettre en latin les petits détails de la civilisation nouvelle.
Je pourrais relever, en terminant, des constructions bizarres comme ad nullas litteras appositus ; ursos ad exiguam stipem exhibebunt ; mais ce que j’ai signalé suffit pour faire connaître le goût de Mosellanus et ce qu’un bon professeur des premières années du xvie siècle croyait pouvoir approuver et proposer comme modèle.
Malgré quelques défauts, le nouvel instrument était précieux. On s’empressa d’en faire usage : la Pédologie, réimprimée à Mayence, à Anvers, et à trois reprises à Paris, eut un long succès. En même temps, elle suscitait des imitations.
En 1521, les Dialogues de l’enfance[186], par Hegendorf, parurent à Leipzig presque en même temps que la seconde édition de la Pédologie, comme pour rivaliser avec elle. C’est une imitation élégante et courte, qui ne vaut pas la peine d’être analysée. Elle dut la durée de son succès à son modèle, dont elle suivit pour ainsi dire le sillage : car ces douze dialogues tenant peu de place, on prit l’habitude de les imprimer à la suite de la Pédologie.
Dans sa dédicace, Hegendorf, en se gardant bien de nommer son rival, fait allusion aux dialogues de personnages très-doctes qui circulent beaucoup et sont très-utiles aux écoliers.
En même temps, il se plaint que certains maîtres soient encore rebelles à cette méthode[187]. N’a-t-elle pas été approuvée par le grand Érasme[188] ? La malignité seule pourrait ne pas s’incliner devant un tel suffrage.
Cependant l’auteur traite encore cette sorte de travail de bagatelle, et promet une œuvre plus sérieuse.
Ses écoliers sont aussi fort misérables, à l’exception de quelques paresseux déjà pourvus de bénéfices. L’espionnage n’est pas oublié[189]. Les études semblent avoir fait quelque progrès depuis 1517. Le professeur explique la grammaire de Mélanchthon, en l’ornant d’exemples tirés des auteurs. Il donne à faire des lettres en grec[190].
Enfin (1522)[191], les colloques d’Érasme parurent. C’est tout dire. Cependant, si l’on néglige quelques formules, quelques dialogues préliminaires, l’illustre humaniste se souvient plutôt de Lucien, qu’il avait traduit. Les professeurs virent avec orgueil l’éclat répandu sur un genre jusqu’alors si humble ; mais soit habitude, soit défiance d’eux-mêmes, soit sentiment de leur devoir, ils ne suivirent pas, en général, la nouvelle route, et celui qui va nous occuper maintenant, Schottennius, se contenta d’écrire pour ses élèves.
|
Voir la vie de Mosellanus dans les Vitæ germanorum philosophorum collectæ Melchiore Adamo ou dans le Recueil de Fichard. L’auteur de cette vie est le jurisconsulte saxon Justin Gobler (1496-1567) dont l’épître dédicatoire est de 1541. |
|
Quasi Lutherus his præsidiis instructus, ac non magis scholasticis litteris. — Érasme, lettre à Mosellanus (1519), ép. 380. |
|
Voir la lettre de Mosellanus à Érasme, écrite quelques mois après le discours (1519). Il y peint la jeunesse divisée en deux camps. — In hoc certamine, qui majorem juventutis partem in suam pertraxerint factionem, abeunt victores, etc. (Ép. 379.) |
|
Id. ibid. — Il fallait alors être Italien ou Grec pour avoir la confiance des Allemands. — Jactant nebulones isti, ut maxime sint discenda græca, ea tamen a me homine germano aut (sic Treviros agnoscunt) semigallo tradi non posse. |
|
Mosellani vita, p. 59. Et la dédicace du discours : Jam in tertium annum utriusque linguæ professores et sumptu tuo foves et auctoritate tueris, p. 9. |
|
V. le discours et la préface adressée au duc Georges. — Nec dubitamus quin brevi, ubi per aliquam occasionem licuerit, et sanctæ, hoc est hebraicæ liuguæ magistrum tua celsitudo sit procuratura. |
|
Professores... auctoritate tuero. — (Ibid.) |
|
Erat statura brevi ac humili, facie subfusca, subnigro et crispo admodum capillo. — Mos. vita, p. 61. |
|
Sed ubi mihi ponendus est Petrus Mosellanus Trevir, inter Germanos an inter Gallos ? — Nihil refert ad id sane quod nunc agitur (Erasmi dialogus ciceronianus). — A me homine germano aut (sic Treviros agnoscunt) semigallo (lettre de Mosellanus déjà citée). |
|
Erat imbecilliori corpore, ac lateribus non satis valentibus... Ætate ante tempus ingravescente atque effæta erat... Mortuus est morbo atque langore diuturno qui ipsum confecerat. (Mos. vita, p. 61 et à la fin.) |
|
Cæsioque (quod de Minerva Homerus prædicat) aspectu. — (Ibid.) |
|
Voce debili magis quam sonora, acuta tamen. (Ibid.) |
|
Baillet l’a compté parmi les enfants célèbres. |
|
Dans l’électorat de Trèves, entre Wetzlar et Nassau, et à trois milles de cette dernière ville (La Martinière). |
|
Vivès écrira en 1531 : in græca lingua magni sunt labyrinthi et vastissimi recessus, non solum in dialectis variis, sed in unaquaque illarum. — De tradendis Disciplinis, t. I, p. 464 de l’édition de Bâle. |
|
Vers 1510. |
|
Ils étaient presque du même âge, étant nés l’un en 1467, l’autre en 1468, et avaient eu à Deventer le même maître, Hégius. — Langius puerum (Buschinns) misit in scholam amici Hegii, Daventriam. (Thèse de M. Thurot sur le Doctrinal, p. 57.) — Post aliquoties audivit Hegium. (Vita Erasmi, Erasmo auctore.) |
|
En 1513, d’après Théodore Muther (aus dem Universitæts und Gelehrtenleben in Zeitalter der reformation. Erlangen, 1866, p. 234). |
|
Probablement après un stage au collége de Saint-Thomas dont il appelle le principal, dans ses Colloques, ludimagister meus. En 1518, d’après la dédicace de son discours, il n’y avait de professeur public de grec que depuis trois ans. Pour la munificence du duc Georges voir la même dédicace. « Quid ego nunc commemorem splendidissima ædificia, in usum quum discentium tum docentium partim a te, partim etiam a majoribus tuis hic magnificentissime exstructa ? Quid annuos reditus, quibus omnis generis scientiarum professores liberalissime dotasti ? » (p. 8 et 9). |
|
C’est l’ordre donné par le biographe. |
|
La vie et les travaux de Jean Sturm, p. 225. |
|
Œuvres d’Érasme, lettre de Mosellanus, t. III. |
|
Utriusque stomachum belle novi. (Ibid.) |
|
Merle d’Aubigné, Hist. de la Réf. t. II, p. 56, édition in-8º. |
|
Ita studia mea Christus promoveat (même lettre, p. 239). |
|
Elle se trouve dans Schilter, de Libertate Ecclesiarum Germaniæ libri VII. Ienæ, 1683. |
|
Œuvres de Hutten, édition Bœcking, t. I, p. 316. |
|
Utinam fidem facere possim bonis omnibus quam sim animo expeditus et quam ferus satis qui hoc excitem vobis incendium. Adurentur enim improbi, adurentur etiamsi conflagrare me simul oporteat. Vos confidite et omni postergata imbecillitate spem sumite vobis plenam et aliquando audete non nihil et ipsi. Luthero scripsi, sed pro opportunitate leviter. Excitate hominem si languet. Incitate si laborat. Circumsistite si nutat. Fulcite si labat. Consolamini si mœret. Prœsidium est illi in Francisco, si non satis confidit istis defensoribus... Asserenda libertas est et indicanda. Hoc qui agit tuendus venit et servandus. Causam studiorum nostrorum age strenue. Erasmo te commendabo (Œuvres de Hutten, édition Bœcking, t. IV, p. 688-9.) |
|
V. la lettre déjà citée d’Érasme à Mosellanus. |
|
Œuvres de Hutten, t. I, p. 344. |
|
Dial. Ciceronianus, t. I, p. 850, édit. de Bâle. |
|
Illud magnopere te rogo, per Jesum etiam Christum, ne inducas animum credere illis qui apud te Ph. Melanchtonem deferunt. Cave quicquam sinistrum de homine suspiceris : est adolescens optimus, ad summam eruditionem natus nec pietatem minorem. (Œuvres d’Érasme, III, p. 240, même édit.) |
|
Moréri. |
|
Moréri. |
|
D’un rôle qu’il avait joué à Francfort dans un drame imité du Songe de Lucien. |
|
Voir le Recueil de Melchior Adam, p. 259. |
|
Théodore Muther, étude sur Apel, dans les Savants du temps de la réformation, p. 234. |
|
Voir Liber formularis Universitatis Lipozensis, p. 157. Mandatum pro recommendando novo rectore. — Cras finito sermone apud sanctum Nicolaum fiet recommendatio novi Rectoris, etc. |
|
Μικρὸς ἔην ῥῶμην οὗτος γνώμην δὲ μέγιστος. |
|
Admiror parem utriusque linguæ peritiam, ingenium candidum minimeque sordidum, industriam indefatigabilem, dictionem vividam, floridam ac dilucidam. Nihil ab eo non erat expectandum nisi juvenem non ita pridem hujus laudis agonem ingressum præpropera mors, gravi doctorum omnium mœrore nec levi studiorum dispendio, sustulisset e medio. (Dial. Cicer. loco laud.) |
|
Noua avons eu entre les mains six éditions do la Pédologie. Tel est le titre des dialogues de Mosellanus, et il a trompé l’auteur de l’article sur ce savant, dans la Biographie Michaud, qui prend la Pédologie pour une grammaire. Ces six éditions se trouvent à la Bibliothèque nationale. 1º Pædologia Petri Mosellani Protegensis, jam denuo in puerorum usum diligenter ædita et recognita. Adjunctis insuper dialogis duobus, quorum unus relegendæ prælectionis rationem complectitur, alter vero de habendo academiarum delectu disserit. Moguntiæ, an. M. D. XXI. — Chez Jean Scheffer, comme on le voit à la dernière page. 2º Pædologia Petri Mosellani Protegensis, in puerorum usum conscripta et aucta et a multis mendis denuo repurgata dialogi xxxvii. — Avec les dialogues de Hegendorf. — A la dernière page : Antverpiæ, apud Martinum Cæsarem, impensis Godefridi Dumæi, anno M. D. XXXI. — Indications marginales. 3º Pædologia Petri Mosellani Protensis, in puerorum usum conscripta et aucta. Dialogi xxxvii. Parisiis ex officina Christiani Wecheli sub scuto Basileiensi M. D. XXXV. — Cette édition a plusieurs fautes d’impression, sans compter celle du titre ; de plus elle est la seule à notre connaissance qui remplace dans l’épître dédicatoire Leipzig par Fribourg et Polyandre par Severius. Ces trois premières éditions ne sont pas paginées. 4º Pædologia Petri Mosellani Protegensis. Dialogi xxxvii. avec les dialogues d’Hegendorf. — Lutetiæ, ex officina Roberti Stephani, typographi regii, M. D. XLVIII. 5º Pædologia Petri Mosellani Protegensis. Dialogi xxxvii. avec les dialogues d’Hegendorf. — Parisiis, apud viduam Mauritii a Porta, in clauso Brunello, sub intersigni divi Claudii 1550. — Cette édition, en caractères romains et très-joliment imprimée, n’est d’ailleurs que la reproduction de celle de R. Étienne, dont elle reproduit une faute d’impression (Simon Pehm au lieu de Phem). 6º Pædologia Petri Mosellani Protogensis in puerorum usum conscripta dialogis xxxvii. constans. Post primam Lipsiæ, MDXVII et secundam Smalcaldiæ, MDLXXXVI, editio tertia cui accesserunt dialogi pueriles Christoph. Hegendorphini lepidissimi æque ac docti. Helmstadii, typis et sumptibus Hernici Hessii, anno MDCCVI. — Indications marginales différentes de celles du no 2. Cette édition n’est remarquable que par la date et parce qu’elle nous en révèle une de Smalcalde de 1586, la seule dont l’éditeur paraît avoir eu connaissance. Nous avons cherché en vain l’édition originale. Mais la date de l’épître dédicatoire montre que l’ouvrage fut terminé en 1517. L’indication du no 6 prouve qu’il fut publié la même année. Brunet ne signale pas la Pédologie. |
|
Recueil de Bechius, p. 690. Il s’agit de l’établissement d’un collége à Venise. |
|
V. Manuale scholarium, p. 45. — Cam. Consanguineus mihi est adolescens. Is inclinationem quamdam ad studium habet universale, parentes vero ejus pauperculi sunt. Quantæ pecuniæ sibi necessariæ sunt ? — Bart. Ut tibi vera dicam, ad minus ut habuerit viginti florenos, vel singula non bene expediet. — Cam. Vach, nimis magna pecunia. — Bart. Pecuniosos requirit Universitas. — Cam. Consului nuper unum magistrum. Fuit ejus sententia, ut famularetur magistro alicui atque additionem adjungeret. Quid tibi videtur ? |
|
Il n’en est question ni dans Mosellanus, ni dans Hegendorf, ni dans le Libellus formularis Universitatis Lipozensis, publié par Zarncke, Die deutschen Univ., p. 158-220. |
|
Ordonnances de 1467 et de 1469, citées d’après Bertius, Comm. rerum german., 1. III, p. 591, par La Martinière. — Nous userons à l’occasion, mais avec discernement, de son dictionnaire géographique, qui n’est pas sans erreurs, mais que les Allemands ont jugé assez utile pour le traduire. |
|
Dialogue i. — Nundinæ partim nuncios, partim litteras, partim omnibus litteris quidem gratiores pecunias nobis apportant... Pannum in vestem hibernam. |
|
Dialogue ii. — Ante nundinarum exitum, e mercatore qui litteras modo dedit extorquere possum nihil, ait enim sibi in tanto hominum strepitu, otium ad numerandas pecunias non esse. |
|
Dialogue vii. |
|
Dialogue xi. — Ipse certe statim ubi peractum fuerit sacrum, ad divitum ostia citato cursu contendam, ut si non in primis, secundis saltem et tertiis stipem accipiam. — Sed me vix antevertes. — Res ipsa indicabit. |
|
Dialogue xix. |
|
En Bourgogne, pendant la semaine sainte, les enfants vont encore aujourd’hui quêter des œufs en chantant la complainte de la Passion. (A. Theuriet, Revue des Deux-Mondes, 1er mai 1877.) |
|
Dialogue xxx. |
|
V. sa vie par Gobler. |
|
Dialogue xiii. |
|
Visceratio. |
|
Dialogue xiii. |
|
Dialogue xxv. |
|
Dialogue xxv. |
|
Dialogue xix. |
|
Dialogue xii. |
|
Hospes meus subinde procœnium peragere solet, et ad inempestam usque noctem somnum pertraho. Nec vesperi ullius libri inspiciundi copia datur. Cervisia semper afferenda est. (Heg., dial. iv.) |
|
Cervisia vobis saluti sit. Cervisiam Deus sua bonitate consecret, ne quid noxii vobis ingeratur. (Heg., dial. vii.) |
|
Dialogue vii. et pour son argent. |
|
Dialogue vii. |
|
Dialogue xxi. |
|
Dialogue xiii. |
|
Dialogue xviii. |
|
Dialogue xxviii. et voir deux-ordonnances à ce sujet, Liber formularis Universitatis Lipozensis, p. 169 et 175. Sous peine de trois florins d’amende ou d’un mois de prison. |
|
Dialogue xxiii. |
|
Ibid. |
|
Dialogue xxxiii. — On peut comparer ces divertissements à ceux des écoliers du moyen âge, tels que les rapporte le Manuale scholarium. Ou y retrouverait les tournois (hastiludia et torneamenta) et les faiseurs de tours. Voici un passage assez curieux : Cam. Unde venis ? — Bart. Dicam tibi mira, conspexi ostentationem jaculatoris... Effecit magister N., quoniam videndi haberet appetitum meque rogaret ipsum sequerer. Non audebam denegare, præsertim quum pro me denarium exponeret. — Cam. Quid boni vidisti ? — Bart. Nihil quod aut relatu dignum esset aut quandam mihi dedisset delectationem. Dimicare scivit, quod commune est ; habuit vulpem : ea humanis vocibus obtemperat, de quo parumper mirabar. Postremo vitreas hymagines facit de loco quodam velato exire, quæ bellum inter se gerebant. (M. sch., p. 43.) — Ils dansaient aussi beaucoup. |
|
Avant lui, Wimpheling et d’autres encore en Allemagne avaient, comme on sait, hasardé des critiques plus fortes contre l’état de l’Église. |
|
Dialogue xxxi. |
|
Libellus formularis, etc., p. 173. Voir aussi p. 171, etc. |
|
Dialogue xii. |
|
Dialogue xxxii. |
|
Dialogue xx. |
|
Dialogue xxix. — Pueri qui suam ætatem in litteris agere volunt, eo die in hanc nostram militiam nomina dant, faustis ut ominantur auspiciis. |
|
Dialogue xxii. |
|
Voir Sauval, Antiquités de Paris, t. II, p. 622-23. « En 1275, à la Saint-Nicolas et à la Sainte-Catherine, et cela autant le jour que la nuit, les écoliers allaient par les rues masqués avec des torches, dansant et faisant tant de désordres, que cela leur fut défendu dans une assemblée de l’Université. « En 1367, à la Saint-Nicolas de décembre, ils créaient entre eux un évêque : et cela fait, tous en habit de prélat, couraient de nuit les rues avec des flambeaux allumés. Et comme enfin ils furent attaqués par le guet, l’un d’eux qui était diacre et en habit d’évêque comme les autres vint à être blessé. Le Parlement, informé de cela, envoya le chevalier du guet chez le malade pour l’interroger. Y étant venu, non-seulement la porte lui fut fermée au nez, mais quantité de ses gens blessés, quoiqu’il fît savoir qu’il venait de la part de la Cour. Aussitôt ceux qui avaient couru les rues la nuit de Saint-Nicolas furent condamnés à faire amende honorable à genoux, pieds nus, sans manteau ni ceinture, dans le chapitre des Mathurins, et là demander pardon au roi, à l’évêque, au recteur et à l’Université qui y était assemblée. Pour les autres qui avaient fait résistance au chevalier du guet, il leur fut pardonné, avec défense à l’avenir d’être réfractaires aux ordres du Parlement. » |
|
Je ne connais pas de représentations de comédies de collége à Leipzig, mais il y en avait eu à Heidelberg dès 1470. |
|
Dialogue xxiv. — Male sit istis, nescio quibus, qui totum pæne annum jejuniis onerarunt. Neque enim satis fuit eis quadraginta dies, etc. Habeo gratiam divo Hieronymo qui pauperculis nobis et impatienter esurientibus patrocinatur. |
|
Voir Liber formularis, etc., p. 174 : Mandatum pro solutione duorum grossorum ad candelas dandorum. |
|
Dialogue xxvii. |
|
Dialogue xxxii. |
|
Dialogue xxxv. |
|
Dialogue xxv. |
|
Dialogue xxix. |
|
Dialogue xx. |
|
Habundans enim possis examinatoribus facere honores reverentiasque. Nostro ævo multum faciunt munera : tribus quatuorve florenis omnium tibi favorem comparabis. — Recte indicas : nunc cepi animum. — Et id facere necesse est, etc. (Man. schol., p. 27. Voir d’ailleurs tout le dialogue.) |
|
Man. schol., p. 25, 26. |
|
Voir le Manuel des écoliers, passim. |
|
Partout les grands répétaient la prælectio aux plus faibles. Pour les observateurs des Pays-Bas ; voir les dialogues de Vivès. |
|
Le De corrupti sermonis emendatione, de Cordier, qui recueille avec complaisance les locutions et les usages des écoliers, et qui est en France l’équivalent des colloques des autres pays, contient bien des menaces de dénonciation ; par exemple : « Faciam te ponere in rotulo » (p. 356, 1re édition), mais il n’y a aucun vestige d’espionnage, c’est-à-dire de police secrète organisée par les maîtres. Nous n’avons pas la prétention d’avoir lu tout du Boulay, mais les tables ne portent ni lupi, ni corycæi. M. Quicherat, dans son histoire de Sainte-Barbe, montre les maîtres plutôt complices des fautes des élèves ; il ne les soupçonne pas d’avoir des espions. On n’est jamais sûr d’avoir consulté tous les documents : nous exposons simplement le résultat des recherches que nous avons faites aussi consciencieusement que possible. |
|
Cam. Quod inferi cum eradicent, et, si unquam investigabo nomen ejus, ultio non evadat. — Bart. Quid te sollicitat ? — Cam. Obsecro, animadverte ; duodecies fuerim in lupo ! Ribaldus certe, et ab ore differt nihil : omnibus caret, et discretione et decentia. — Bart. Quis erat ? — Cam. Haut scio (p. 28). — M. Zarncke, dans sa note sur le mot lupus (p. 230), dît qu’il ne sait ce que ce mot veut dire ici. Il en aurait trouvé l’explication dans le xviie dialogue de Mosellanus. |
|
On les appelait lupi ou corycæi. Ce dernier mot est expliqué longuement par Érasme à l’adage : Corycæus auscultavit. Le Corycus était, d’après Strabon, livre XIV, une montagne de Lydie dont les habitants, qui étaient des pirates, se dispersaient dans les ports pour écouter les marchands sans défiance et les dépouiller ensuite plus sûrement, d’où le proverbe grec que Cicéron a employé dans une lettre à Atticus. |
|
Et lupus sit in fabula, hoc est, ille ipse nobis ignorantibus adsit. (Dial. xvii.) Ou connaît le proverbe latin : Lupus in sermone, lupus in fabula : quand on parle du loup on en voit la queue. Ici Mosellanus ne lui donne pas tout à fait le même sens. Plus loin il désigne encore ces espions par le nom de loups. Le dialogue a pour titre : De quæestionibus commissorum quæ die Veneris in ludis exercentur. « Quæstiones in ludo hodie sunt non aliter quam quædam carnificina. De singulis quæ per totum septimanæ cursum quoquo modo commisimus hodie quisque pro se pænas dare cogimur. — At qui scire possunt præceptores quæ singuli nos designemus ? — Aliquot clanculum in hoc selectis provinciam dant, nos suos commilitones deferendi prodendique, ut nusquam quicquam omnino tuto agere queamus. Semper enim verendum ne quispiam ex ejusmodi corycæis nos auscultet, et lupus sit in fabula. » (Dial. xvii.) Érasme ne donne au mot corycæus que le sens d’espion en dehors des habitudes scolaires. (Voir le colloque, Arnoldus, Cornelius, où il s’agit des choses de la religion. Cornelius est un pèlerin.) Voir aussi les œuvres d’Olympia Morata (p. 115, et p. 125 de l’édition de 1562). Les corycæi sont pour elle les espions du Saint-Office. C’est seulement dans les colloques allemands que j’ai vu ce terme dans les écoles. (Voir plus loin les colloques de Schottennius à Cologne.) |
|
Dialogue v. |
|
C’est presque le mot d’Accurse : græcum est, non legitur. |
|
Dialogue ix. |
|
Dans un dialogue de Jonas Philologus. |
|
Voir à la fin du 1er volume de l’Histoire de Sainte-Barbe, par J. Quicherat, aux pièces justificatives, les conseils donnés sous le nom d’Heptadogma par Goulet, avant 1518, pour l’établissement d’un collége. Il faut ajouter qu’en France on donnait une extrême importance aux vers latine. |
|
De via ac ratione tradendarum disciplinarum, oratio XVIII, prononcée sous le pontificat de Grégoire XIII. Ce programme, qui comprend non-seulement la liste des auteurs pour toute la durée des études, mais la raison du choix de chaque auteur, suivant les différentes années, est malheureusement beaucoup trop long pour être cité. On le lira avec plaisir, soit dans l’édition de Ruhnkenius, soit dans la petite édition Tauchnitz, t. II, p. 164-168. |
|
Voir dialogue x, De relegenda prælectione. — « Hoc tantum quæro primum an totam authoris sententiam, ex præceptoris interpretatione sis assecutus. Deinde singulas ne clausulas expenderis ? Videlicet si quam habeant sententiam insignem, si quod proverbium, si quod σχῆμα, si quem tropum, si quem colorem rhetoricum, si quem locum dialecticum, si quas venuste loquendi formulas, quæ omnia enotare operæ pretium est, partim ut sit in promptu semper quo mores nostros pariter et alienos corrigamus, partim ut ex idoneis scriptoribus suppetant recte loquendi scribendique exempla. » Il blâme les vieux maîtres « qui scriptorum sensum exposuisse utcumque contenti erant. » Cependant sa Prælectio n’est guère que celle du moyen âge, plus développée. (Voir la thèse latine de M. Thurot.) |
|
Dans sa lettre du 6 décembre 1519 à Pflug, Mosellanus dit qu’Ulrich de Hütten fonde à Mayence un collége des trois langues aux frais de son prince. |
|
Dialogi pueriles Christophori Hegendorphini XII lepidi æque ac docti. La 1re édition, in-4º, 1521 (d’après Brunet). Hegendorf, qui n’avait alors que vingt et un ans, est connu comme jurisconsulte. |
|
Errant illi et vehementer errant qui non his loquendi formulis propositis puerorum linguam expolitiorem reddere laborant. |
|
Erasmus ille magnus alicubi hoc ipsum cum pueris faciendum esse admonet, ejus calculum nemo non candide probat. |
|
Dialogue ii. — Nec desunt corycæi qui clandestinos sermunculos quos amicus cum amico nugatur ad præceptorem deferant. |
|
C’est peut-être un prospectus plutôt qn’un programme. |
|
Il s’agit de la 2e édition, dédiée au fils de Froben. La première, dont on ignora la date, n’était qu’une sorte de cahier fait par Érasme pour un de ses élèves. On le lui avait volé et on l’avait fait imprimer sous son nom en le défigurant. (Voir De sycophantiis et imposturis cujusdam dominicani, etc., Erasmi admonitiuncula et une lettre du 10 mai 1536.) |
Il faut quitter Leipzig pour Cologne, c’est-à-dire la lumière pour l’obscurité, et Mosellanus pour Schottennius, c’est-à-dire un érudit pour un pédant.
Tandis que l’académie de Leipzig grandissait librement sous la protection du duc Georges, la vieille université des bords du Rhin, dotée en 1389 par le pape Urbain VI des mêmes privilèges que l’université de Paris, s’obstinait à continuer le moyen âge. En 1480, elle s’était solennellement déclarée pour le maintien du Doctrinal, et n’avait beaucoup plus tard renoncé à cette gothique grammaire, dont on se moquait par toute l’Europe, qu’après l’intervention des savants italiens, provoquée par Lange[192], et devant l’initiative de l’archevêque. En 1505, elle chasse Jean Rhagius, dont le crime était son dévouement aux belles-lettres ; quelques années plus tard, c’est le tour des maîtres de Mosellanus : Cæsarius et Jean de Busche. Érasme la nomme avec dédain[193]. En 1520, elle s’empresse de condamner les écrits de Luther sans attendre la bulle de Léon X, et un an avant la décision de l’université de Paris. N’avait-elle pas, d’ailleurs, condamné Reuchlin, Laurent Valla, Pic de La Mirandole et d’Occam ?
On ne pouvait guère attendre une autre conduite des docteurs de la ville que ses deux cent soixante églises et les reliques plus ou moins authentiques de tant de martyrs avaient fait surnommer la Sainte. Les rois Mages, les onze mille vierges, les Macchabées, l’un des innocents tués par Hérode, la maison de saint Bruno attiraient de toutes parts des pèlerins qui circulaient dans une foule de moines et de mendiants. Arrivait-il jamais que, les yeux fatigués de tant de châsses et de tant de crânes garnis d’argent, un penseur solitaire allât chercher dans l’église des Cordeliers, derrière l’autel, le tombeau de celui qui fonda la philosophie de la liberté, et méditer devant la pierre qui couvre les restes de Duns Scot ?
Un prince, laïque ou ecclésiastique, car on a pu dire d’Albert de Mayence qu’il fut le Léon X de l’Allemagne, un puissant protecteur des lettres se serait opposé au mauvais esprit de l’université de Cologne. Mais la ville était gouvernée par des marchands âpres au gain, fiers d’ailleurs de superstitions à la fois éclatantes et profitables. L’archevêque-électeur ne pouvait pas demeurer plus de trois jours à Cologne sans leur permission. Tout était soumis au conseil des bourgmestres et à deux régents qui tranchaient du consul romain[194]. Si parfois le chef d’une grande famille, après un voyage en Italie ou sous l’influence de l’esprit du temps, se créait une bibliothèque et commençait à protéger les lettres, il ne tardait pas, comme Rynx, dont le fils fut un des correspondants d’Érasme, à être découragé par des obstacles. On pouvait être un personnage consulaire, conseiller de Charles-Quint, chevalier par la grâce de Henri VIII, et même tenir quelque temps entre ses mains les destinées de la Hongrie : tout cela était plus facile que d’obtenir la permission de relever un collége à ses dépens[195]. Ni l’Université ni la bourgeoisie n’auraient supporté un Médicis. Nous respectons les institutions d’une ville libre, mais nous ne pouvons approuver cet esprit municipal qui voyait l’histoire dans les traditions locales et se faisait une originalité avec des préjugés antiques ; qui luttait certainement avec courage et sans ménager le sang des citoyens quand il fallait repousser les soldats de l’électeur, mais qui semblait ne vouloir maintenir l’indépendance dans son enceinte que pour y faire régner les ténèbres.
Celui qui composa des colloques dans cette ville, Hermannus Schottennius Hessus, ou plus simplement Hermann Schouten, venu de la Hesse, n’était pas même professeur public. Avec ses trois noms, qui rappellent les patriciens romains, c’est un simple maître d’école. Il dirige à Cologne, non une bursa (collége approuvé par l’université), mais un ludus trivialis[196], fréquenté surtout par des enfants riches. Quoiqu’on ne sache rien de sa vie, la platitude de ses dédicaces le fait trop connaître.
Ses Mécènes sont ou des marchands, dont il loue la richesse et l’économie, ou le fils du directeur de la Monnaie. Une fois il s’élève jusqu’à l’ami d’Érasme, Jean Rynx, dans une dédicace qui vaudrait la peine d’être citée. Il y loue le nom, les ancêtres, le père, les oncles de son protecteur et termine en lui souhaitant une bonne santé, ainsi qu’à sa femme. Il observe qu’elle est dans un état à avoir doublement besoin d’un pareil souhait. C’est bien de ce sot personnage qu’on pourrait dire :
Jusqu’au chien du logis il s’efforce de plaire.
Son pédantisme est à la hauteur de son caractère. Voyez comment il profite de la signification du mot Rynx[197]. « Les Romains, ces fameux païens, avaient aussi des familles patriciennes. C’étaient les Pisons, les Fabius, les Lentulus, ainsi nommés de mauvais légumes. Mais votre surnom vous vient de l’anneau, dont on estime avec raison les qualités. Il est rond ; c’est la plus noble des formes : la matière en est précieuse ; on le porte au doigt pour le faire voir à tout le monde : il pare les fiancés et protège le secret des lettres. Toutes ces propriétés de l’anneau sont particulières à votre famille. »
Il paraît que les Rynx avaient bâti ou réparé beaucoup d’églises. « Si Homère appelle les rois chefs des peuples, c’est parce qu’ils doivent construire des édifices. Béroalde l’assure. C’est ainsi qu’Auguste se glorifia d’avoir laissé de marbre la ville qu’il avait reçue de briques. J’en ai pour garants Suétone, Sextus Aurélius et Orose. Plutarque pense qu’on voulut louer Domitien, quand on lui dit : Tu aimes à bâtir. Le quatrième roi des Romains, Ancus Martius, est aussi loué pour avoir bâti. »
Schottennius était sans doute de ces maîtres que raille Barland et qui achetaient par toute sorte de complaisances pour leurs écoliers le droit de s’asseoir à la table des parents. S’il y choquait les mères par des plaisanteries grossières, du genre de celles qu’on trouve trop souvent dans ses Dialogues, en revanche il les éblouissait par des citations bizarres. On dirait qu’il ne connaît les anciens, sauf Térence, que par ces recueils du xve siècle, qui étaient encore la bibliothèque des ignorants. Il ouvrira solennellement la bouche pour dire que les Goths élisaient roi le plus gros d’entre eux, les Syracéens le plus long, et les Carthaginois le plus honnête, ou que les Perses ne crachaient jamais dans la mer[198]. Il citera Juvénal d’après Béroalde, car Béroalde et Philelphe sont ses grandes autorités. Dans ses ouvrages[199], s’il lui prend fantaisie de mettre en scène les Sages de la Grèce, Socrate invitera ses hôtes à s’approcher du poêle, et Pythagore bénira la table au nom de Jupiter, triple en personnes, mais un en essence. Les disciples répondront amen.
Qui croirait, après cela, que ses Dialogues scolaires[200] sont simples, naturels, sans trace de pédanterie, utiles à consulter pour l’historien, et parfaitement appropriés à leur but ? Leurs phrases toutes courtes, leurs vives répliques indiquent plus de connaissance de l’enfance et de l’art du dialogue que les périodes oratoires de la Pédologie. C’est que dans son premier ouvrage le maître d’école n’aspire point encore à la gloire : il s’est contenté de réunir les exercices qu’il a composés, suivant l’usage, pour les besoins de sa classe, et fait voir que lorsqu’il oublie ses prétentions, il ne manque ni d’esprit d’observation ni de bon sens.
Il n’eut pas l’idée malencontreuse d’imiter Érasme, dont les Colloques étaient encore dans l’éclat de leur nouveauté, et sut garder une originalité modeste. Cette sagesse fut récompensée : la première édition de ses Dialogues s’épuisa si vite qu’on en ignore même la date[201] : la deuxième parut en 1526[202]. Elle était suivie d’un appendice moins heureux, intitulé : Banquets ; le succès commençait à gâter l’auteur. Cependant, malgré ce fardeau, la barque navigua longtemps encore ; car Moreri cite une édition de 1538 à Nuremberg, et nous en constatons deux à Lyon en 1545 et 1547[203].
La suffisance ne perce que dans la préface qui date peut-être de la seconde édition. L’auteur commence par nous apprendre que Platon, cédant aux prières de ses disciples, réunit ses Dialogues en un seul volume. Il en a fait autant. Quelques-uns lui ont reproché d’avoir osé publier des colloques après Érasme. Mais il y a place pour Aristote après Platon. « Voilà pourquoi, tout rustique que je suis, sorte de chameau dansant dans une école, je n’ai pas eu honte d’écrire aussi des dialogues. S’ils ne sont pas parfaits, je me contenterai du second rang. » Oubliait-il Mosellanus, ou voulait-il rendre la pareille au professeur dé Leipzig qui, en recommandant différentes universités, n’avait rien dit de celle de Cologne ?
Schottennius peint surtout les écoliers riches, les fils des citadins : quant aux étrangers, s’il en parle de temps en temps, c’est pour les montrer sales et dépourvus de fierté, mendiant sans scrupule à la campagne, flattant, importunant jusqu’à ce qu’on leur ait donné du pain ou des œufs[204]. Comme on cessait de faire maigre la veille de la Saint-Martin, et que les tables se chargeaient de viandes au coucher du soleil, ils vont à la desserte, vers huit heures, de maison en maison, la marmite à la main, se ramasser de quoi faire liesse à leur tour[205]. Ils avaient aussi la Saint-Blaise dont Mosellanus n’a rien dit. « Que veux-tu faire de ce bâton ? — Demain nous courons de porte en porte. — Pour demander ? — Un petit cadeau au nom de saint Blaise. — Et que donne-t-on ? — Un morceau de porc on un petit pain de froment. — D’où vient cette coutume ? — Je me souviens d’avoir vu à l’église une statue de saint Blaise qui tenait une tête de porc plantée au bout d’un bâton[206]. » Ce saint est le patron des enfants et des bestiaux. On sait qu’en Allemagne on choisit encore aujourd’hui le jour de sa fête pour bénir le pain et le sel.
Dans un dialogue impossible à traduire, Schottennius n’hésite pas à nous montrer un de ces étrangers, couvert de gale, et n’allant pas au bain, parce qu’il a peur de se laisser voir. (Ces bains se prenaient en commun, et tel y était entré en bon état qui en sortait avec des ulcères. Encore n’étaient-ils pas gratuits.[207])
Les fils des citadins sont paresseux, mais bons camarades pour ces étrangers. Ils partagent quelquefois avec eux leur copieux goûter de fromage, de viande et de bière, et à l’occasion les prennent pour répétiteurs.
Schottennius aime à s’étendre sur la description des bons repas en prétendant que ce sont les meilleurs moments de la vie. Ici c’est une noce, plus loin la fête des Rois. Les parents, tels qu’il nous les montre, préfèrent de beaucoup la bonne chère aux plaisirs de l’esprit. Ils sont bien imités par leurs enfants. Chez lui tout est aux écoliers occasion de manger et surtout de boire[208]. Si deux anciens amis se rencontrent : « Viens, dit l’un, je sais où se cachent les écoliers buveurs. — Sans doute que tu es souvent avec eux. — De temps en temps, quand j’ai de l’argent. » Ils se réunissent à la brasserie du Marché aux Brebis, endroit bien tranquille, éloigné de l’école et de la surveillance du maître. S’ils luttent à la course, « le vaincu payera deux mesures de vin. — Non, pas de vin, mais de bière, c’est moins cher. » Après une chasse au pigeon, c’est au cabaret qu’on fera rôtir le gibier. Le jour de la Saint-Gall, le vainqueur du tir, celui qui a abattu le coq, régalera ses camarades : il promet deux volailles à la broche et quatre mesures de vin. On était sobre, quand on ne vidait que trois verres. Et cela sur l’autorité de Thalès. La première coupe, aurait dit ce philosophe, est pour la soif, la seconde pour la gaieté, la troisième pour le plaisir, mais la quatrième nuit à la raison[209]. Ce n’étaient pas là les principes des écoliers de Mosellanus : ce n’est pas pour y faire de ces découvertes qu’ils étudiaient les anciens. Le professeur de Leipzig corrige les mœurs, le maître vulgaire de Cologne encourage les mauvaises habitudes en les décrivant.
Luther était sorti de la Wartbourg ; la Réforme s’accomplissait et même, soit pour la discipline, soit pour le dogme, s’étendait au delà des intentions de son auteur. Luther ne luttait plus avec le pape mais avec Carlstadt. Partout les paysans, qui voulaient affranchir les corps autant que les âmes, se révoltaient. En Thuringe, Thomas Muntzer était à la tête de trente mille anabaptistes. Parmi les Allemands restés fidèles au catholicisme, les uns s’effrayent ou s’irritent, les autres proposent des concessions. Cependant on dirait que de tout cet ébranlement il ne parvient à Cologne que des bruits confus. Sous le gouvernement de ses consuls, la ville jouissait d’une tranquillité absolue. « Notre Germanie orientale est tout entière dans l’agitation, dira Schottennius au commencement de l’année 1527, dans sa dédicace de la Vie honnête : la religion y est méprisée, le culte négligé, les cérémonies odieuses : la guerre civile y manifeste ses cruautés. Partout ailleurs on chasse les religieux comme des bêtes sauvages, mais ici on les respecte et on les protège ; ailleurs, les temples sont profanés et changés en écuries : ici on vit encore pour Dieu, on l’adore et on célèbre son culte, grâce à la vigilance de nos magistrats. »
Le désir des mères en envoyant leurs fils aux écoles, était toujours d’en faire des prêtres. Cependant les conversations formulées ou recueillies par notre auteur trahissent quelque inquiétude sur ce sujet. « Aujourd’hui le sort des prêtres n’est pas heureux. — Eh ! pourquoi ? — Parce que les luthériens les haïssent et les traitent comme des juifs[210]. » Ailleurs un autre, qui se plaint de la cherté des vivres et de la mauvaise apparence des récoltes, ajoute que, pour comble de malheur, les messes se font rares ainsi que les enterrements, à cause des progrès du luthéranisme[211]. Notre homme considère toujours les choses par le petit côté ; c’est ainsi que les moines ne lui paraissent jeter le froc que pour jouir plus librement des plaisirs du monde[212].
Le temps n’était pas encore arrivé où l’Église catholique devait purifier et serrer ses rangs pour faire front au protestantisme. Les abus que Paul III essayera de détruire florissent tranquillement à Cologne, et Schottennius, en s’en moquant avec tout le monde, montre ce qu’on pouvait oser dans cette ville, avant que la nécessité de devenir sérieux se fût imposée.
Je ne répéterai pas ce qu’il dit sur la gourmandise et l’ignorance des moines, sur les repas de corps des prêtres, sur la difficulté d’avoir une grasse cure, poisson qu’on ne prend qu’avec un hameçon d’or, c’est-à-dire en bien payant les amis qui sollicitent les grands pour vous[213]. J’aime mieux rappeler qu’il loue le courage des moines de Saint-Alexis, qui restèrent dans la ville pour soigner les malades pendant une peste[214]. Il doute de l’efficacité du jubilé et conseille aux pénitents de ne pas quitter Cologne[215]. C’est que les bourgeois qui n’aimaient pas à dépenser leur argent inutilement et à le porter à Rome pensaient comme lui. N’étaient-ils pas, d’ailleurs, dans la Rome de l’Allemagne ?
Il est curieux d’observer que nos écoliers, différant aussi en cela de ceux de Leipzig, ne demandent pas mieux que d’être dispensés de l’école pour aller chanter au chœur. Bien chauffés et bien nourris, ils ne se plaignent du jeûne qu’en gourmands : le carême ne leur apparaît que sous l’allégorie d’une guerre entre la ville de Veau et celle de Hareng. La visite aux églises est un de leurs plaisirs : on les bat parce qu’ils s’y sont attardés. Ils échangent des œufs de Pâques. Le jeudi saint ils courent aux endroits où on lave les pieds, pour y attraper quelque bonne aubaine. « Dis-moi, où iras-tu aujourd’hui voir laver les pieds ? — Dans quelque couvent. — Tu t’attends sans doute à de bons morceaux ? — Certainement, il y a des couvents où l’on se met à table. — Où vas-tu aujourd’hui ? — Au couvent de Saint-Antoine. — Et tu y gagneras ? — Deux gâteaux de froment. — Le premier venu peut se mettre à table ? — Oui, et on lui sert un verre de vin. — Et combien de gâteaux ? — Deux à chacun et ensuite un pour deux qu’on grignote afin de s’exciter à boire. — On emporte donc chez soi les deux autres ? — Sans doute. — Combien de fois vous remplit-on votre verre ? — Trois fois, si je ne me trompe. (Est-ce d’après la loi de Thalès ?) — Vous lave-t-on les pieds ? — Seulement aux religieux ; mais aux étrangers rien que la main droite. — Qui remplit le rôle du Christ ? — Le supérieur du couvent : c’est de notre temps le vrai Mécène des gens de lettres[216]. »
Heureux habitants de Cologne ! tels du moins que les peint Schottennius. On mangeait, on buvait, on cherchait surtout à gagner de l’argent. On ne sentait pas que l’âme étouffait dans cette atmosphère.
Notre maître d’école ne s’explique guère sur la nature de son enseignement. Son but paraît avoir été de mettre ses élèves en état d’écrire une lettre en latin et de tenir une conversation dans la même langue. Tel était sans doute le programme des gymnasia triviala.
Sa discipline serait considérée aujourd’hui comme brutale. Il injurie ses élèves pour une peccadille et les soumet à la férule en employant des expressions d’une grossièreté intraduisible. Il ne faut pas demander si les loups existent dans cette école. « Le maître a établi des espions contre ceux qui ne parlent pas latin. — Que feront ceux qui n’en savent pas un mot ? — Ils se tairont ou parleront latin comme ils pourront. — Comme j’ai peur de ces délateurs clandestins[217] ! » Le tyran ne se déride qu’à la Saint-Lambert[218], jour où chacun lui fait des présents, l’un apportant un sou, l’autre une pièce blanche ; ou bien encore lorsqu’un nouvel élève, en arrivant, lui remet quelques écus pour sa bienvenue. « Usage très-convenable, dit-il, car les apprentis en font bien autant la première fois qu’ils entrent dans la boutique. » Et il donne une après-midi de congé[219].
Il veut qu’on le respecte et revendique pour lui la fameuse phrase sur le maître qui doit passer dans le cœur des élèves avant les parents[220]. Il médit des colléges ou plutôt des écoliers qui le quittent pour les fréquenter[221], il se moque du latin de ses rivaux[222]. Voyons donc le sien.
On doit reconnaître qu’il fait la guerre avec une minutie tout allemande aux locutions qu’il sait mauvaises : En voici quelques-unes :
Bonum mane, dit un élève. — Semper sane, lui répond son camarade, sans doute à cause de la rime. Il aurait dû dire : Et tibi quoque.
Bonum serum est condamnable, ainsi que bonum vesper, locution qu’employaient encore quelques vieillards.
Cui dabis tuam vocem ? au lieu de tuum suffragium.
Jusqu’à présent tout va bien. Mais c’est par une fausse délicatesse que Schottennius condamne carnisprivium (carême), qui était commode et consacré par un long usage. « Tais-toi, je t’en supplie, ce mot est barbare. Il faut dire : Tempus bacchanale. » Adieu la précision. Employer des termes païens, c’est dénaturer la pensée. C’est, en rendant la langue composite, embarrassée, la retirer de l’usage commun, et la réduire, contre le but qu’on s’était proposé, à n’être qu’un instrument d’éducation dans les écoles. Même remarque pour moniales, qu’on veut remplacer par virgines vestales. Enfin les écoliers de Cologne avaient imaginé pour désigner un ballon le mot omnia. Le maître a raison de couper court à cette manifestation de l’instinct du langage. Mais que va-t-il mettre à la place du mot condamné ? Globulus missilis per pollicem. Se figure-t-il que dans la chaleur du jeu en prononcera cette longue périphrase ?
A-t-il du moins purifié la langue autant qu’il le croit, et ses écoliers peuvent-ils se fier à toutes ses indications ? On est étonné de trouver chez lui des fautes grossières comme manere dans le sens d’exspectare, qu’il fallait laisser au Manuel de 1480, et des verbes déponents comme persequi employés comme passifs. Voici des expressions qui appartiennent à la langue du moyen âge et n’ont rien de classique :
Fortiter esurio, p. 10, j’ai grand’faim. Dans du Cange, fortiter est synonyme de valde, multum.
Chirotecæ, p. 27, gants. Latin moderne d’après Freund, mais du Cange en cite de nombreux exemples du moyen âge.
Bolus (passim), bouchée. Térence et Plaute ne l’emploient que dans le sens de profit, mais dans la basse latinité, bolus, buccata est (du C.).
Parœcianus, p. 41, curé. Parochianus (du C.). Schottennius a voulu se rapprocher du mot grec.
Missa, p. 63, la messe (du C.).
Deplumare, p. 99, piller (du C.).
Nocumentum, p. 98, dommage (du C.).
Mots qui ne sont ni dans Freund ni dans du Cange :
Panniculus emunctorius, p. 38, mouchoir. Le deuxième mot n’est ni dans Freund ni dans du Cange.
Quadra, p. 59, assiette.
Plebeiarius, p. 77, curé. Mais plebeanus dans le supplément de Diefenbach, et plebanus, du C., qui cite aussi le gallobelge pleban.
Sacellanus, vicaire, sacristain ? p. 77. Se trouve dans les comédies de Macropedius. C’était donc un mot d’usage courant.
Suppactor, qui raccommode des souliers.
Raptitius liber, livre de notes.
En général, ces mots se rencontrent ailleurs que chez Schottennius.
Mots latins curieux :
Panis jurulentus, p. 14, la soupe. Le deuxième mot signifie cuit dans son jus. Cels. 2, 18 (Fr.).
Interula, chemise, p. 38, d’Apulée d’après Freund, de Tertullien d’après du C. (Employé par Olympia Morata.)
Decimas pendere, p. 41. Decima, æ, Varr. Cité par Macrobe (Freund).
Amusus, p. 56, ignorant. Vitruve (Fr.).
Hybernaculum, p. 67, appartement d’hiver (Fr.). Pline le Jeune, ép. 2, 17, 7.
Colophon, passim. Imponere colophon, mettre la dernière main. Se trouve dans presque tous les auteurs du xvie siècle. D’un mot grec. Festus (Fr.).
Si on ajoute à ces expressions quelques solécismes comme crepidæ me calefacere faciunt, et aussi la phrase prendebis ad nudum panem (nous avons vu dans la Pédologie un emploi analogue de la préposition ad), on aura ce qu’il y a de particulier dans le style de Schottennius. On voit qu’il est loin d’être pur.
Hâtons-nous maintenant de quitter Cologne. Nous en avons fini avec la mendicité des écoliers et leur manière de vivre. En passant d’Allemagne en Flandre, on respirera un air différent.
|
Thurot, de Doctrinali, p. 57. |
|
Lettre à Mosellanus, 1519. |
|
On portait derrière eux une sorte de faisceau. « Post ipsum dealbatus a puero geritur fustis inflexibilis, in signum juatitiæ. » (Schottennius, dédicace de la Vita honesta.) |
|
Rynx le père fut consul, gouverna Cologne plusieurs années, s’acheta une belle bibliothèque : « Deinde ad gymnasium quoddam litterarium reficiendum ære suo subvenisset, nisi auster floribus immissus fuisset. » Son frère, Hermann Rynx, fut conseiller de Charles-Quint et créé par Henri VIII eques auratus. Il reçut à Cologne les ambassadeurs de ce roi qui venaient le consulter sur l’utilité d’envoyer des secours aux Hongrois contre les Turcs. (Schottennius, dédicace de la Vita honesta). |
|
Dans un de ses Dialogues (p. 53 de l’édition de 1545), de More post gymnasia trivialia accedendi scholas prœcelsas quas Bursas appellant, il fait des allusions jalouses à ces Bourses. Les dialogues de Jonas Philologus (dial. iii) parlent aussi de ludi triviales. Quant aux Bursæ, les actes de l’université de Leipzig les définissent ainsi : in collegiis seu Bursis per universitatem approbatis (p. 167-8 et passim). C’était tout simplement les analogues des fondations françaises, comme le collége de Navarre, etc. Outre les dialogues qui feront l’objet principal de cette étude, Schottennius a composé : 1º Deux comédies latines, Cologne, 1525. (Voir le catalogue Soleinne.) 2º Vita honesta sive virtutis, petit traité de morale, dont la 1re édition est de 1527, d’après la dédicace. (Voir à la Bibl. nat. l’édition de 1545, imprimée à Lyon, sub scuto coloniensi, par les frères Frellonius, in-8º.) 3º Colloquia moralia ex variis philosophorum dictis condita, per quæ stulta juventus sapere possit et eam consequi prudentiam quam senibus contulit longævitas. (A Cologne, 1re édition, 1535, in-8º) Ce livre est affreusement imprimé et ne donne pas grande idée des presses de Cologne. (Bibl. nat.) Ni Baillet, ni Bayle, ni les Biographies ne parlent de Schottennius. Moreri lui consacre quelques lignes, et ne connaît ni ses colloques moraux, ni ses comédies. |
|
Ring, anneau. Il y a deux lettres d’Érasme à Jean Rynx. |
|
Les colloques moraux sont pleins de ces niaiseries. |
|
Voir les Convivia à la suite des Dialogues. |
|
Colloquia sive confabulationes tyronum litteratorum Hermanno Schottennio Hesso authore. Ab eodem nuper plusquam triginta conviviis lepidissimis auctæ, ad hæc quotidiani sermonis formulas communiores ex doctissimis quibusque auctoribus decerptas, in puerum gratiam adjecimus. (Lugduni, sub scuto Coloniensi, apud Joannem et Franciscum Frellonios fratres, 1545. — Bibl. nat.) Autre édition : Lugduni, apud Theobaldum Paganum, 1547. |
|
Moreri la prend à tort pour la première. |
|
Comme le montre la date de l’avertissement qui précède les Convivia. |
|
Celle de 1545 est d’un imprimeur aux armes de Cologne, qui prit sans doute plaisir à faire paraître les œuvres d’un compatriote. On sait qu’il y avait à Lyon des imprimeurs étrangers, p. ex. : le Souabe Gryphius. |
|
Édition de 1545, p. 102. |
|
Page 36 et 37. |
|
Page 87. |
|
Page 70. Scabie infectus sum ideo vereor conspici nudus... Multi ingressi mundi exeunt ulcerosi. (Voir les Mémoires de Thomas Platter, traduits par Flocon, et reproduits par extraits dans le Magasin pitt. de 1860. — Voir dans quel état il se trouve à Schlestadt, dans l’école de Jean Sapidus.) |
|
Page 83. |
|
Page 81. |
|
Page 75. |
|
Page 91. |
|
Page 96. |
|
Page 94. |
|
Page 70. |
|
Page 78. |
|
Page 52. Nous citons ce fragment pour donner un échantillon du style de Schottennius. Ubi hodie intereris pedum lotioni ? — Cœnobium aliquot religiosum accedam. — Expectas aliquem bolum opiparum ? — Utique : in quibusdam cœnobiis mensæ accumbitur. — Cui monasterio soles interesse hoc die ? — Antonio divo dicatis ædibus. — Ibidem quid consequeris lucri ? — Placentas duas triticeas. — Accumbit quilibet istuc veniens mensæ ? — Assidet et ante ipsum calix vini ponitur. — Et quot placentæ ? — Cuilibet duæ, et deinde una inter duos, de quo rodant ut sitim excitent. — Defert quisque duas secum domi ? — Quidni ? — Quoties calices vino replentur ? — Tribus, ni fallor, vicibus. — Lavanturne ibi pedes ? — Religiosis, sed advenis dextra manus. — Quis Christi munus exequitur ? — Cœnobii antistes quem vulgus præceptorem appellat, in nostra ætate vere litterarum Mæcenas. |
|
Page 19. |
|
Page 30. |
|
Page 38. |
|
Page 48. |
|
Page 53. |
|
Page 87. |
DEUXIÈME SECTION
FLANDRE — ESPAGNE — MEXIQUE
Les Allemands qui nous ont laissé des dialogues méritent à peine le nom d’auteurs, tant ils s’effacent derrière leurs personnages : en les lisant, on croit n’entendre que des écoliers. A force de modestie et de scrupule, et précisément parce qu’ils ont substitué au désir de faire une bonne composition littéraire celui d’être utiles, ils ont donné à ces écrits un charme et une valeur dont ils n’avaient certainement pas le moindre soupçon. Nul doute, par exemple, que Schottennius ne mît ses Dialogues moraux, qu’on croirait écrits par un Sganarelle, bien au-dessus des petites conversations où il avait été trop à l’étroit pour déployer sa grande science. Nous savons avec quel embarras et même avec quel sentiment d’humiliation (le mot n’est pas trop fort) Mosellanus avait présenté sa Pédologie au public savant.
Avec Barland, la simplicité du genre s’altère. Ce nouveau venu veut paraître capable de mettre de l’agrément et de l’esprit dans nos dialogues, soit parce que l’exemple d’Érasme avait porté des fruits, soit plutôt parce que la Flandre était plus polie et d’une civilisation plus brillante.
Tandis que l’Allemagne restait encore assez isolée et ne se développait qu’avec lenteur dans le sens de l’originalité de son caractère, la nature primitive du peuple flamand avait été depuis longtemps modifiée par la triple influence de la France, dé l’Angleterre et de l’Italie, auxquelles s’était ajoutée depuis peu celle de l’Espagne. « Ceux des Pays-Bas, dit Luther, ont l’esprit éveillé : ils ont aussi de la facilité pour apprendre les langues étrangères. C’est un proverbe que si l’on portait un Flamand dans un sac à travers l’Italie et la France, il n’en apprendrait pas moins la langue du pays[223]. » Il est inutile de rappeler les relations continuelles que l’industrie avait établies depuis le moyen âge entre la Flandre et l’Angleterre[224] ; il ne l’est peut-être pas de remarquer que les savants des deux pays séjournèrent souvent les uns chez les autres. Louvain envoyait Érasme, Barland ou Vivès[225] et recevait Thomas Morus. On saut que les traces espagnoles subsistent encore dans les Flandres, l’union politique ayant bientôt produit une union de mœurs plus intime, sorte d’alliage qui n’a jamais pu se décomposer entièrement. Il y aurait trop à dire sur l’influence de la France. Contentons-nous de rappeler que ce pays donnait son nom à l’une des nations de l’université de Louvain et que, si la Flandre fut soustraite au ressort du Parlement de Paris en 1521, notre langue y demeurait celle de la cour, du gouvernement et de la noblesse. Quant à l’Italie, son action sur les Pays-Bas, pour n’avoir rien de politique, n’en fut pas moins très-importante. Les flottes qui tous les ans partaient de Venise pour aller, au xve siècle, alimenter les entrepôts de Bruges et, au xvie, ceux d’Anvers[226], portaient aussi sans doute plusieurs de ces nombreux écoliers flamands qui faisaient leurs études à Bologne et de ces peintres flamands non moins nombreux auxquels l’Italie imposait au commencement du xvie siècle son coloris et ses méthodes.
Les arts et les lettres prospèrent de bonne heure dans les Pays-Bas, sous la protection de riches marchands[227] qui étaient en relation avec le monde entier et qu’excitait encore l’exemple d’une cour brillante. « La cour de Brabant, écrira Érasme à Luther en 1519, déteste les théologiens ennemis des lettres. » La Flandre est, pour ainsi dire, le cœur de l’Europe savante ; malgré les théologiens de Louvain, elle offre d’avance une image de ce que la Hollande sera au xviie siècle, en dépit de l’intolérance d’un Voët. On y voit vivre ou séjourner la plupart des auteurs de nos dialogues, Barland, Vivès, Cervantes Salazar, et même le futur luthérien Jean Sturm, qui, en 1527, était à Louvain, à la fois imprimeur et professeur. C’est à Deventer que les frères de la vie commune avaient de très-bonne heure essayé de renouveler l’instruction publique. Cependant l’art parvint le premier à l’indépendance, parce qu’il tient de moins près aux idées qui règlent la vie pratique.
La science resta plus longtemps fidèle au passé, dont elle était la gardienne officielle. Il faut des citadelles aux pays ouverts : le moyen âge s’était pour ainsi dire fortifié dans l’université de Louvain. Néanmoins celle-ci ne tarda pas à se laisser pénétrer par l’esprit de sage liberté qui l’enveloppait, par ce bon sens fait de finesse méridionale et de solidité germanique, également ami de la tradition et des réformes, qui eut son heure avant le despotisme de Philippe II, et qu’on retrouve avec toute la saveur locale dans les Dialogues de Barland, dont la scène se passe à Louvain.
Adrien Barland était Hollandais comme Érasme. Il avait vingt et un ans de moins que son illustre compatriote et quelques années de plus que Mosellanus. Il naquit en 1488 dans l’île de Sud-Beveland, près de l’embouchure de l’Escaut. Chose rare chez un savant du xvie siècle, il eut des yeux pour voir la nature, et se souvint toujours avec délices des fraîches prairies, des grands vergers et des petits bois de son pays natal, ces petits bois où, dit-il, il est si doux d’errer en causant avec un ami[228]. Non loin de la mer, les femmes, plus blanches que le lait, travaillent aux salines[229]. Barland aimait tellement son village « séjour digne des études, digne des muses » , qu’il en prit le nom.
La misérable vie des étudiants allemands lui fut inconnue, car, lorsqu’il eut atteint sa onzième année[230], son père, qui paraît avoir joui d’une certaine aisance, l’envoya à Gand, comme pensionnaire, dans la maison de Pierre Scot, maître distingué. Dans cette ville, le jeune campagnard fut témoin des fêtes qui eurent lieu en 1500, à l’occasion du baptême de Charles-Quint. Les feux sur les tours, la galerie lumineuse jetée dans les airs entre deux clochers, le retour du cortège aux flambeaux, l’or et l’argent prodigués au peuple par de simples bourgeois, les maisons tendues de velours, sur toutes les places et aux coins des rues des représentations dramatiques, ces magnificences qu’il rappellera plus tard[231] le frappèrent et contribuèrent peut-être à éveiller en lui de bonne heure le goût des chroniques.
Pierre Scot, très-savant, très-disert, et, si l’on en croit Barland, sans rival à cette époque pour l’explication des orateurs et des poëtes, ne ressemblait en rien à l’ignorante et cruelle tourbe des pédagogues du xve siècle[232]. Il veillait sur les mœurs avec autant de soin que sur les esprits, et mettant de côté la férule, c’est par le prix qu’on attachait à son approbation, c’est par l’autorité de son exemple qu’il obtenait des progrès extraordinaires[233]. En voyant le jeune Barland passionné pour les lettres, il se communiqua tout à fait à lui. Cette action se continua quatre ans de suite pendant la période si importante qui s’étend entre l’enfance et la jeunesse. Mais enfin le père, désireux de faire donner à son fils une éducation complète, et trop peu instruit lui-même sans doute pour apprécier l’influence exceptionnelle de Pierre Scot, envoya Barland dans un des colléges de Louvain.
« Jeunes gens, disait Muret, vous trouverez toujours quelqu’un pour vous expliquer la rhétorique à Hérennius, ou pour vous faire remarquer, dans un discours de Cicéron, la division, les arguments et les figures de rhétorique. Tout le monde ne vous donnera pas ce que je vous donne, ou du moins ce que je m’efforce de vous donner[234]. » Cette fierté si naturelle et si légitime d’un homme qui pense par lui-même et qui est comme une source d’eau vive pour ceux qui l’écoutent, d’un homme qui sait qu’il se donne et qu’il se perd en se donnant, nous ignorons si Pierre Scot la connaissait, mais nous pouvons juger de la tristesse que lui fit éprouver cet enlèvement par les regrets de Barland lui-même.
« Combien je fus malheureux dans ce collége de Louvain ! dit ce dernier dans sa lettre à Borsalus. Quel désastre pour mes études, que la privation de l’enseignement du meilleur des maîtres ! Je perdis tout à fait une seconde période de quatre ans, qui, à cet âge, aurait pu être si bien employée[235]. »
La scolastique s’épanouissait alors à Louvain dans toute son horreur (1507). Avant 1382, cette ville avait été fameuse par son industrie. On y avait vu jusqu’à quatre mille fabriques de drap et cent cinquante mille ouvriers. « Lorsque cette foule de tisserands revenait de l’ouvrage, il fallait, dit un vieil auteur cité par La Martinière, sonner la grande cloche afin que les mères retirassent leurs enfants des rues de peur qu’ils ne fussent écrasés. » Mais à la suite d’une révolte contre leur comte, en 1382, les artisans s’étaient enfuis en Angleterre et la ville s’était trouvée dépeuplée. Des quartiers se changèrent en décombres, et ces décombres en terrains vagues, qui devinrent vignes et prés, bois et pâturages, donnant à l’intérieur de la ville une physionomie singulière. En 1426, pour rétablir la prospérité de Louvain, Jean IV y fonda une université, du consentement du pape Martin V. Bien que moins ancienne que celle de Cologne, elle grandit aussi sous l’influence du moyen âge. En 1483, Sixte IV la dota du privilège de nommer aux bénéfices du pays. D’ailleurs les dix-huit canonicats de la collégiale de Saint-Pierre étaient réservés aux professeurs de théologie et de droit, ainsi qu’au rhetor publicus de la faculté des arts[236]. Ainsi l’Église assurait à la fois l’indépendance des maîtres et le recrutement des auditoires, car l’espérance d’avoir part à la distribution des bénéfices attirait et retenait beaucoup d’écoliers. Cette circonstance n’avait peut-être pas été étrangère à la résolution du père de Barland.
On voit que, sans « l’esprit éveillé » des habitants des Pays-Bas, il y aurait eu beaucoup de chances pour que l’université de Louvain conservât l’immobilité de celle de Cologne. La Flandre, où se sont livrées tant de batailles, devint un des théâtres de la grande lutte pour la Renaissance. L’issue n’en pouvait être douteuse, car l’université qui se vantait de ne le céder qu’à celle de Paris pour le nombre des écoliers et de donner un enseignement complet, tandis qu’on n’apprenait à Orléans que le droit romain, à Paris que la théologie, le droit canon et la scolastique, et à Montpellier que la médecine ; qui comptait quarante colléges, dont les principaux ceux du Lys, du Faucon et du Porc avaient des classes de philosophie ; la république savante dont le recteur était si respecté que les magistrats lui cédaient le pas, et si puissant qu’il ne pouvait rester que six mois en charge comme les dictateurs romains[237] ; la mère adoptive de tant d’étrangers, étudiants ou professeurs venus, outre la Comté et la France, de l’Angleterre, de la Westphalie et des bords du Rhin, ne pouvait pas se détruire elle-même en repoussant obstinément et de toutes parts les partisans des belles-lettres. D’ailleurs les magistrats qui avaient part à la nomination des professeurs n’auraient pas laissé déchoir une institution qui était plus que l’orgueil de la cité, qui en était la principale ressource. Privée de ses écoles, que serait devenue la ville de Louvain quand, suivant un acte de 1523, elle était dans une telle détresse qu’il lui était impossible de payer les charges publiques et d’entretenir ses monuments ? Si l’on n’y pourvoit, ajoutait cet acte, ses habitants seront obligés de l’abandonner et de la laisser tomber en ruine[238].
L’université donna donc, dès 1490, la chaire d’éloquence publique à un vrai lettré, Paludanus, qui la garda jusqu’à sa mort, tandis que nous avons vu Cologne exiler ses professeurs les plus distingués. Si Louvain conserve les théologiens Jean Briard et Latomus, ennemis d’Érasme, elle lui offrira l’hospitalité dans le collége du Lys, le pressera d’accepter une chaire et répondra avec modération à ses attaques. Timide, embarrassée comme on l’est trop souvent aux époques de transition, l’université craignait, en trop favorisant la Renaissance, de nuire à la foi, qu’elle confondit quelque temps avec les traditions de la scolastique. La Faculté de théologie, en 1517, condamne le Nouveau Testament d’Érasme, et en 1548, elle traduira la Bible en flamand. La Faculté des arts, détestée de Barland en 1502, lui donne en 1525 sa plus belle chaire. Les principaux promoteurs de ces changements furent le sage Dorpius, Jérôme Busleiden, Érasme, malgré ses perpétuels voyages, mais surtout peut-être notre Barland, si l’on doit la plus grande reconnaissance au laboureur qui ouvre le sillon et qui le trace sans s’arrêter, sous le faix du jour.
Le jeune Barland, pour en finir avec la scolastique, s’était hâté de se faire recevoir maître ès arts (1508), et à vingt ans[239], l’ambition paternelle satisfaite, il revint avec empressement aux belles-lettres, à ces études qu’il avait, par force, non-seulement interrompues, mais, suivant son expression : « brisées et rejetées. » « De quels torrents de joie je fus inondé les premiers jours où je repris l’étude de ces belles-lettres qui avaient fait mon unique plaisir dès ma tendre enfance ! » Ces transports furent courts. Il reconnut qu’il avait presque tout oublié, et ne reconquit son butin qu’au prix d’efforts et de veilles qui, à l’en croire, auraient compromis sa santé[240].
Quand il lui fallut choisir une profession, sur le conseil de ses amis, qui flattaient sans doute ses secrets désirs, il se décida pour l’enseignement. Il lui paraissait beau d’imiter Pierre Scot et de faire à Louvain le bien que son vieux maître faisait à Gand. Mais l’université ne se pressa pas de l’accueillir. Tandis que le jeune Mosellanus brille à Leipzig, dans l’éclat du premier rang, lui, patient, tenace, dut, pendant dix ans, se contenter de donner des leçons particulières dans les différents colléges. Il eut quelquefois de la peine à vivre, et nous le voyons invoquer en distiques la munificence de Jérôme Busleiden[241]. En 1514, il publie un recueil de proverbes tirés des Bucoliques ; en 1515, une histoire des empereurs romains protecteurs des lettres, et les Dits remarquables de Ménandre ; ouvrages insignifiants, mais vrais coups d’audace, à une époque et dans une ville où il était interdit de faire un cours sur la géographie de Pomponius Méla[242]. Vivant dans des classes poudreuses[243] qui lui rappelaient par contraste les fraîches campagnes de la Zélande, et avec des maîtres dont beaucoup n’avaient jamais ouvert un auteur ancien, il lutte sans se décourager pour la bonne cause, à laquelle il gagna peu à peu ses élèves, dont le plus fameux fut Cornélius Crocus[244]. En 1516, il publie, en tête de ses scolies sur Pline le jeune, une sorte de manifeste adressé à tous les gymnasiarques du Brabant, de la Flandre et de la Hollande, car on ne pouvait guère agir sur les maîtres que par les directeurs des colléges. Deux ans après, le professeur indigne de haute littérature (c’est le titre qu’il se donnait) obtint enfin sa récompense. Il est choisi pour occuper la chaire de langue latine au collége des trois langues, que le noble et riche Jérôme Busleiden avait fondé par testament et qu’Érasme venait d’organiser contre les tendances de l’université (1518).
Après dix ans d’instabilité et de fatigues, est-ce le repos ? Non, l’épreuve a aigri cette âme délicate. Barland soupçonne Goclenius d’envier sa chaire et la quitte brusquement. Il se trompait, si l’on en croit une lettre d’Érasme ; pourtant Goclenius s’empressa de lui succéder[245]. En 1520, Barland part pour l’Angleterre avec le fils du comte de Berghes. Il n’eut pas à se féliciter de ce voyage, si l’on en juge par l’amertume contre les grands qui se manifeste dans la préface et dans le corps de ses Dialogues. Un peu plus tard nous le retrouvons près de Bruxelles, à Afflinghem, où il dirige les études de Charles de Croy[246], administrateur de cette abbaye et son ancien disciple. C’est dans cette retraite qu’il composa quelques-uns de ses Dialogues, et c’est à ce seigneur qu’il les dédia (1524).
Dans sa vie errante et dépendante, Barland sut toujours maintenir la dignité de sa profession. « Je n’ai jamais cessé de penser, illustre Charles, qu’aucune espèce d’hommes ne mérite mieux de la patrie et de l’État que ceux qui forment à la fois les mœurs et l’intelligence de la jeunesse. A ce travail j’ai dépensé la meilleure part et la fleur même de ma vie, prêt néanmoins à de nouvelles fatigues si je puis, moi aussi, venir en aide à la renaissance des belles-lettres[247]. »
Les temps étaient changés. L’université accueille enfin Barland, qui devient professeur public d’éloquence, à la mort de Paludanus (1525). Il avait trente-sept ans. Il mourut en 1542, après avoir écrit en latin l’histoire de son pays.
Barland conciliait avec sa passion pour les lettres la plus grande fidélité à la religion catholique. Quelle que fût son admiration pour Érasme, il critiqua l’Éloge de la Folie. Ami sûr, esprit d’autant plus indépendant qu’il est plus loyal ; sensible aux beautés de la nature, lorsque autour de lui on ne regardait que les livres ; chroniqueur exact et curieux ; constatant avec inquiétude les progrès de la littérature française, tandis que les savants affectaient d’ignorer jusqu’à l’existence des langues modernes, il a sa physionomie distincte, et ses Dialogues, quoi qu’on en ait dit, ne sont pas plus un reflet de ceux d’Érasme que de ceux de Mosellanus. Il commence d’ailleurs en rendant hommage, avec sa politesse ordinaire, à ses deux prédécesseurs.
Composés en partie pour un grand seigneur qui se plaisait à renouveler ses études par des entretiens d’une latinité élégante et spirituelle, les Dialogues de Barland semblent, malgré leur titre[248], moins utiles à la déroute de la barbarie qu’au plaisir d’un groupe de délicats. A côté des écoliers qui s’occupent de leurs progrès et non de leur subsistance (car nous avons dit adieu aux mendiants, et il fallait des ressources pour étudier dans une ville pauvre), divers personnages paraissent en scène : aubergistes, baillis, chanoines, marchands. Nous avons déjà dit que le théâtre sera toujours la ville de Louvain. Ce souci de l’unité, joint à certains traits de mœurs, décèle le futur historien des ducs de Brabant, tandis que plus d’une boutade part du professeur fatigué et qui n’a pas encore trouvé le repos dans une chaire. Enfin, les attaques contre la ville de Rome et contre les abus n’ont pas le caractère de fine moquerie de celles d’Érasme : elles marquent plutôt l’honnête indépendance de l’université de Louvain et rappellent la sévère sincérité d’un de ses plus illustres docteurs, Adrien d’Utrecht, qui fut pape sous le nom d’Adrien VI. Voilà pourquoi les Dialogues ont pu être dédiés à l’administrateur d’un monastère, au frère d’un archevêque espagnol. On peut ajouter que l’université leur donna une sorte de sanction, puisque c’est quelques mois après leur publication qu’elle appela l’auteur à succéder à Paludanus.
Commençons par dire quelques mots de la rancune de Barland contre les grands et contre la cour. Elle s’était annoncée très-énergiquement dans la préface. « Excepté ton frère et toi, tous les grands détestent les lettres, détestent les écoles, enfin détestent le nom des muses et veulent du mal à ceux qui les cultivent. » Nous avons cru trouver l’origine de cette rancune dans l’ingratitude du seigneur de Berghes : le dialogue suivant[249] fortifierait cette supposition. Deux maîtres se rencontrent :
« Élever des fils de courtisan avec l’espoir d’une récompense... — C’est chasser dans la mer ou jeter la ligne dans les forêts (vieilles métaphores qu’on retrouve dans la préface d’Ébrard de Béthune). Car les courtisans promettent des monts d’or, mais ils se bornent à des promesses. — Ils n’estiment guère les précepteurs de leurs enfants. — Comment ? Mais ils font plus de cas de ceux qui leur présentent le pot de chambre. — Après vingt ans d’esclavage et de dévouement à leurs fils, c’est à peine s’ils vous jettent en payement une cure de quatre sous. — Ah ! comme le Psalmiste a raison ! ne vous confiez pas aux fils des hommes, car il n’y a pas de salut en eux. — Ce n’est que trop vrai. Plus d’une fois j’ai été joué par ces grands, qui se fâchent quand on leur rappelle leurs promesses et qui, lorsque une bonne occasion se présente, les ont oubliées. — Aussi, si tu n’es pas un sot, prends les fils de marchands, c’est le moyen de s’enrichir plus vite. Les marchands ne sont pas libéraux en paroles, mais en actes, et ils protègent les lettres. J’en connais à Bruges, j’en connais ailleurs qui sont les patrons des savants. Mais à la cour, surtout à la nôtre, c’est tout autre chose. — Je suivrai tes avis et je suis heureux d’avoir trouvé un bon conseiller pendant qu’il en est temps encore. »
Quelques pages plus loin[250], il s’agit d’un autre, maître ou bourgeois, on n’en sait rien, qui, moins sage, avait été chercher fortune à Bruxelles. « Tu avais donc tout à fait émigré à la cour, mon cher Pamphile ? — Mieux eût valu aller dans une étable (il joue sur les mots aula et caula). — Là, tu vivais avec les grands, des dieux sur la terre ! Tous les jours, tu marchais vêtu de pourpre et de soie, et c’étaient tous les jours des festins splendides. — Avec quel plaisir j’ai dit adieu à cette splendeur ! — Sans doute c’est parce que tu ignorais les finesses du métier de courtisan. » (Et Carin continue en décrivant le manège de ceux qui veulent réussir. Il faut cajoler jusqu’au fou de cour. Pamphile, éclairé, se promet de faire entendre raison à certains confrères qui étaient tentés de suivre son exemple.)
Cet esprit d’opposition sent son Hollandais, ou peut-être tout simplement le bourgeois de Flandre à qui Marguerite d’Autriche demandait trop fréquemment des contributions. On y discerne encore le dépit d’un savant qui croit représenter les belles-lettres et qui voit toutes les faveurs réservées à de minces et ignorants poëtes français. Barland n’aime pas notre langue. Il se moque de monsieur le bailli, qui mettrait son fils à l’école si on y apprenait eleganter sonare gallicum sermonem. Il trouve une telle étude aussi futile que le goût des faucons et des chevaux. Le commencement du dialogue[251] est singulier : « Sit tibi felix exortus hujus diei monseur le bailliu. — Tautumdem tibi reprecor magistredote. »
Nous avons dit que Barland était resté bon catholique ; or, parmi les universités allemandes, les plus florissantes étaient précisément celles qui avaient accepté la Réforme. Plus d’un fils de famille quittait Louvain pour les fréquenter : de là chez notre professeur quelque dépit, mais surtout la crainte que l’hérésie n’infectât ces jeunes âmes. Le dialogue V nous montre un disciple qui, après deux ans passés au collége, prend congé de son maître pour aller en Allemagne. C’est son père qui le veut. « Je conviens, lui répond le maître, que les études fleurissent dans ce pays et que les talents s’y développent avec éclat, mais je suis effrayé d’y voir tant de savants infectés de la contagion saxonne : j’ai peur qu’elle ne te gagne, toi aussi. » Charles-Quint laissait les princes confisquer les biens du clergé ; François Ier n’avait pas encore pris parti ; des astrologues avaient prédit la fin de la papauté pour 1524 ; on se répétait la prophétie suivante[252], trouvée, disait-on, dans un vieux livre :
Papa cito moritur, Cæsar regnabit ubique
Et subito vani cessabunt gaudia cleri.
Barland se décourage. « Il n’y aura bientôt plus de ville, plus de bourg, plus de village à l’abri du fléau. Peut-être que cet incendie dévorera un jour le monde entier. Mais toi, cher élève, prends bien garde ! Maintiens-toi pur de cette contagion. Ne lis pas même les livres d’où elle s’est exhalée. Si tu veux être cher à Christ ton Sauveur, écarte-toi soigneusement de la vie et des pensées du vulgaire. » Le jeune homme remercie son maître et s’en va. Que deviendra-t-il ?
Barland ne se défiait pas moins de Paris, quoique la Sorbonne eût condamné les ouvrages de Luther. Mais dans cette foule d’écoliers venus de toutes les parties du monde au pays latin, les opinions se propageaient avec sécurité. « Je n’enverrai pas mon fils à Paris, dit un père, mais à Louvain. Le prêtre dont j’ai pris les conseils m’a dit que la doctrine évangélique ne se conservait nulle part ailleurs avec autant de pureté[253]. » Nous savons tout au moins par le témoignage d’Érasme que la jeunesse de Louvain était particulièrement studieuse et grave.
Quand on s’est déclaré avec cette netteté contre les luthériens, quand on a menacé de la mort éternelle ceux qui se détachent de la « sainte église romaine, » on a le droit d’attaquer les abus. Barland ne les ménage ni en Belgique, ni en Italie. A la manière dont il parle d’Adrien VI, on sent qu’il était animé de son esprit.
Ce vertueux pontife était mort depuis quelques mois. Louvain était fière de lui et les étrangers y venaient de loin comme en pèlerinage, pour voir sa maison[254]. Il avait fait ses études au collége du Porc. Après l’avoir longtemps connu professeur de théologie et chancelier de l’université, les Flamands l’avaient vu avec orgueil cardinal, régent d’Espagne et enfin souverain pontife. Ceux qui espéraient encore une conciliation au moyen de sages réformes avaient applaudi à cette élévation ; mais les Romains l’avaient appelée l’invasion d’un Barbare. Adrien n’avouait-il pas ingénument que Dieu avait permis le schisme à cause des désordres du clergé[255] ! On attendit beaucoup de sa sincérité, on ne prit garde ni à la mélancolique faiblesse de son caractère, ni à la médiocre étendue de son esprit. Quand il mourut, et surtout quand on sut à Louvain que les Italiens avaient écrit sur la porte de son médecin : « Au libérateur de la patrie, » beaucoup crurent à un crime. « Il circule ici, dit André à un voyageur qui revient de Rome, un bruit trop consistant pour être faux, c’est qu’Adrien est mort empoisonné. Perte d’autant plus déplorable qu’elle n’est causée ni par le destin, ni par la nature. — Tu dis vrai, mon cher André[256]. »
Barland avait donc contre Rome qu’il distingue soigneusement de « la sainte Église romaine, » une rancune personnelle. Il ne voyait en elle ni la mère des arts (dont nos modernes Latins s’inquiétaient peu, et auxquels il ne fait lui-même aucune allusion dans ses Dialogues), ni, avec Montaigne, « la seule ville universelle où chacun est chez soi[257] : » elle ne lui apparaissait de loin que comme le tombeau d’Adrien et le séjour d’une corruption qui avait été la cause du schisme.
Luther n’a pas écrit avec plus de rudesse et de violence contre Rome, que ce fidèle catholique, que cet homme sage et modéré qui, en publiant un choix de lettres d’Érasme, avait écarté celles qui lui semblaient contenir des railleries trop acérées[258].
D’après le voyageur qui regrette avec tant d’amertume la mort d’Adrien, « il n’y a place à Rome ni pour la science, ni pour la vertu ; autant d’hommes dans les rues, autant de voleurs, d’entremetteurs et de sacriléges. Les cardinaux, qui devraient prier jour et nuit pour le rétablissement de l’Église, ne désirent que troubles et confusion. » A Rome, pour faire fortune, il faut étriller les mules des prêtres. Les bénéfices vont tout droit aux ânes. Tel de ces ânes est chargé de dix-neuf cures, de vingt-neuf canonicats, d’autant d’abbayes.
D’ailleurs la candeur de Barland ne ménage pas davantage ses compatriotes. Il flétrit les rivalités scandaleuses auxquelles donnait lieu le droit qu’avait la faculté des arts de nommer aux bénéfices. Un étudiant apprend de son camarade Pancrace qu’une abbaye se trouve vacante et qu’on en a donné (provisoirement) l’administration à un homme remarquable par sa sainteté. « — Je vais donc vite me faire nommer par la faculté des arts, et je te prie, mon cher Pancrace, de ne répéter à personne ce que tu viens de me dire. Car l’université est pleine d’argus qui vont à la chasse des bénéfices, et, ce qui t’étonnera le plus, on les trouve surtout parmi ceux qui ont reçu les ordres et qui étudient la théologie. — Je m’en étonne en effet, puisque la tonsure leur est un signe que celui qui s’est donné à Christ doit être libre de toutes les passions humaines. La théologie n’enseigne qu’à mépriser les biens terrestres, c’est-à-dire à vendre tout ce qu’on possède pour acheter la perle de grand prix. — Eux, ils ont toujours à la bouche ce refrain : Quel en est le revenu ? A l’école, au dîner, au goûter, au souper, aux repas commémoratifs de leur entrée en religion, même à l’église, vous n’entendez pas d’autre question. — A l’église, dis-tu ? mais le Seigneur a dit : Ma maison est une maison de prière. — Oui, quand ils prient et qu’ils disent : Ton règne vienne ! ils appellent de leurs vrais souhaits le règne du monde, c’est-à-dire les honneurs ecclésiastiques. Tous les jours ils se querellent sur de pareils sujets et enrichissent greffiers, notaires, avocats[259]. »
Les attaques de ce genre sont très-nombreuses et très-variées. Nous n’en citons que ce qu’il faut pour ne pas altérer la physionomie de ces Dialogues. Elles étaient alors un lieu commun, et sans doute elles furent utiles en contribuant à la restauration de la discipline. Mais bientôt l’œuvre du concile de Trente, en leur donnant satisfaction, ne leur laissa qu’un intérêt historique. Il sera plus curieux et plus profitable de terminer en mettant en lumière les dialogues où notre professeur s’occupe particulièrement des études.
On ne serait peut-être pas fâché d’assister à une de ses leçons et de saisir comment cet homme, plein d’expérience pour l’enseignement, au dire d’Érasme, entendait l’explication des auteurs latins. Ce plaisir nous est procuré par la mise en scène de l’examen que fait subir à l’écolier Guillaume, Thomas, homme docte[260]. Les questions ont d’abord pour objet l’Énéide, qu’on étudiait le matin, et les Épîtres de Pline le Jeune, qu’on expliquait l’après-midi. On y voit que les élèves étaient exercés à discuter le sens des textes. Ainsi, dans l’épître à Calestrius[261], les uns prétendent que le brigand auquel Corellius désire survivre, c’est lui-même, mais l’opinion du maître est qu’il s’agit de Domitien. Dans une autre épître du livre Ier, la description d’un repas donne lieu à des explications d’usages antiques qui sont comparés à ceux de la Hollande d’alors. Malheureusement, pour ce qui concerne Virgile, les questions témoignent de plus de subtilité que de sens historique. « Virgile a-t-il eu raison, dit Thomas, de faire aller la reine des dieux chez Éole, chez une divinité subalterne ? — Il nous a montré comment on agit dans la colère : et, de plus, que lorsqu’on a besoin d’un plus petit que soi, il faut le traiter avec honneur. — Pourquoi fait-il dire à Junon : Une nation odieuse, et non : Mon ennemi Énée ? — Pour qu’Éole ne réponde pas qu’il n’ose agir contre le petit-fils de Jupiter de qui il tient sa dignité. — Savamment répondu. Pourquoi Énée regrette-t-il de n’être pas mort devant Troie ? — Parce qu’il risque ici de périr sans gloire. — Pourquoi le poëte fait-il consoler les Troyens par Énée ? — Parce qu’à un indifférent ils auraient pu citer le vers de Térence :
Tu, si hic sis, aliter sentias.
Pourquoi Didon invoque-t-elle après Bacchus la bonne Junon ? — Pour apaiser cette déesse ennemie des Troyens. — Pourquoi les Troyens ne se mettent-ils à danser que lorsque les Tyriens leur en ont donné l’exemple ? — Parce qu’ils ignoraient les habitudes de leurs hôtes et qu’ils pouvaient craindre de les choquer en prenant l’initiative. »
Si mesquines que soient la plupart de ces remarques, elles valaient encore mieux que celles qu’on faisait à Paris à propos du même poëte, en admettant que Vivès, qui nous les rapporte[262], n’en ait pas exagéré le ridicule.
Après le profane, le sacré. Si Mosellanus explique à Leipzig tantôt une épître de saint Paul, tantôt un discours d’Isocrate, ici, dans une chaire moins élevée, le maître passe de l’Énéide à l’Évangile. « Pourquoi Jésus-Christ, avant de confier ses brebis à saint Pierre, lui a-t-il demandé trois fois s’il l’aimait ? Pourquoi les Géraséniens ont-ils demandé à Jésus-Christ de quitter leur pays ? Que faisait Marie quand l’ange Gabriel la visita ? Pourquoi craignit-elle en le voyant ? » Les réponses sont superficielles, mais on aime à reconnaître qu’au xvie siècle l’Évangile tenait sa place aussi bien dans les colléges d’une université catholique[263] qu’en Allemagne. Cependant, quoique Barland en maintienne la lecture, il n’hésite pas à supprimer, en cela plus hardi que Mosellanus, les Pères latins et Prudence lui-même de la liste des auteurs qui servent à former le goût[264]. Quant aux écrivains grecs, il se borne à dire en passant un mot des Dialogues de Lucien : le grec ne paraît pas lui avoir été familier.
Au milieu de ces exercices on n’avait garde d’oublier la conversation en langue latine. Déjà Dorpius, une des gloires de l’université de Louvain et grand ami de Barland, avait loué, en 1513, dans un de ces discours qui étaient des événements, ces conversations familières, « domesticæ confabulationes » qui se développaient sans le secours du professeur de grammaire, mais que celui-ci devait rendre élégantes, agréables et surtout correctes[265].
Pour arriver à ce but, on faisait apprendre aux novices non-seulement des locutions tirées de Térence[266], mais souvent des comédies entières. Les élèves zélés prenaient les devants. Témoin ce dialogue entre un maître qui revient chez lui après un voyage, et un de ses disciples. Après des questions sur le ménage, sur les nouveaux pensionnaires : « Et toi qu’as-tu fait ? — Pendant ton absence j’ai appris deux comédies. — Lesquelles ? — L’Eunuque et les Adelphes[267]. »
De les apprendre à les jouer, il n’y avait pas loin. En Italie ces représentations étaient chose toute naturelle. Il est vrai que Pomponius Lætus, qui fit jouer une comédie de Plaute au xve siècle, était un païen, mais en 1543, le duc de Ferrare donnera sans scandale devant un pape la représentation des Adelphes. A Louvain, le pas fut d’abord franchi sans tumulte. En 1508, un futur professeur de théologie, Dorpius, qui n’était encore que professeur de rhétorique au collége du Lys, fit jouer l’Aululaire par ses meilleurs élèves. La pièce fut annoncée par affiches et précédée d’un prologue que Dorpius composa lui-même. Soit étonnement, soit ivresse générale des commencements de la Renaissance, il n’y eut pas d’opposition, et Dorpius récidiva avec le Miles[268].
Barland trouvait le sel de Plaute trop grossier. S’il s’intéressa, nous ne savons en quelle année, à une représentation de l’Aululaire au collége d’Arras, et s’il composa même un prologue de circonstance, ce fut sans doute par politesse et pour ne pas refuser ses encouragements. Mais à Louvain, maître de ses préférences, c’est une comédie de Térence qu’il choisit, et la plus languissante peut-être, l’Hécyre. Chose singulière au premier abord, c’est à cette occasion que la défiance des adversaires de l’antiquité s’éveilla. On ne discerne pas tout d’abord l’importance d’un grand mouvement ; ce qu’ils avaient trouvé naturel en 1508 leur parut une énormité en 1524, et Barland se crut obligé de préparer la représentation par un dialogue en prose dont les interlocuteurs sont un des acteurs et un simple écolier. Henri trouve qu’il vaut bien mieux jouer des comédies que de passer le temps à boire dans les cabarets, comme on le faisait pendant les fêtes. Si Lactance, dans un passage fameux, a flétri comme corruptrice l’influence de la scène, il s’est trompé. Car la comédie, qui n’est qu’une image de la vie humaine, n’en montre les faiblesses que pour les condamner. C’est ce que prouveraient des milliers d’exemples. La comédie, si on la lit dans cet esprit, n’est pas nuisible, mais utile. « Nous nous moquerons donc de ces aréopagites, de ces petits moines qui font résider la vertu dans l’habit et dans le froncement des sourcils, et nous allons donner l’Hécyre, une comédie élégante et tout à fait morale que le maître nous a expliquée cette année, âmes camarades et à moi[269]. »
L’épreuve réussit-elle ? Les savants du moins furent charmés. « Quant aux ignorants, dit Barland par la bouche de Jodocus après la représentation, quant aux ignorants nous ne nous en soucions pas[270]. »
Nous croyons qu’il allait trop loin, car si le rire est bon, si d’ailleurs la beauté du style, la peine à comprendre, l’ardeur de bien dire atténuaient l’effet des mauvaises impressions, il convient d’avoir un entier respect pour la jeunesse et de ne pas l’initier d’avance à ce qu’il y a de bas et d’humiliant dans les réalités de la vie. Cependant, à cause des mœurs plus grossières du xvie siècle, le mal était moindre qu’il ne le serait de nos jours. D’ailleurs Barland agit avec une telle sincérité et des intentions si pures qu’il est bien difficile de le condamner. C’est cette sincérité d’esprit, souvent peu pénétrante, qui lui laisse quelque originalité malgré le voisinage d’Érasme : il la porte dans la peinture de la ville érudite qu’il nous a si bien fait connaître et dont il représente lui-mème l’honnêteté, les contradictions, mais non la faiblesse. Avant de le quitter, disons qu’il honore l’université de Louvain qui elle-même, malgré la gaucherie de son attitude et les violences de quelques-uns de ses docteurs, occupe en somme une place honorable au xvie siècle. Elle ne réussit pas dans l’œuvre de conciliation : elle n’y persista pas ; elle eut un moment plutôt l’instinct que la claire vue de la direction religieuse qu’elle eût pu tracer à l’Europe, entre l’Italie et l’Allemagne ; moment que signalent, avec une verve indignée ou railleuse, les Dialogues de Barland et avec une tragique mélancolie le court pontificat d’Adrien VI.
|
Michelet, Mémoires de Luther, III, 302. |
|
Ces relations subsistaient au xvie siècle, malgré la décroissance de l’importation des laines. |
|
Vivès était Espagnol, mais il habita de préférence la Flandre et fut professeur à Louvain. |
|
Voir Robertson, Histoire de Charles-Quint, p. 34, de la trad. Suard, édit. Buchon. — Voir A. Henne, Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique, t. V, ch. xx. |
|
Dialogues de Barland, passim. |
|
Voir Historica Adriani Barlandi, Cologne, 1603 (De Belgicis oppidis, p. 243). |
|
Dialogue lii. |
|
Voir dans les Historica, p. 273-5, la lettre à Borsalus, qui est une sorte d’autobiographie de Barland. |
|
Historica, p. 204. Voir aussi la description de ces fêtes, d’après les grandes chroniques du Hainaut, dans A. Henne, t. I, p. 24 et 27. |
|
Voir Érasme, De conscribendis epistolis. |
|
Barland rend hommage à son maître non-seulement dans la lettre à Borsalus, mais encore dans les dialogues et dans la Chronique des ducs de Brabant. |
|
Mureti oratio, explicaturi libris Aristotelis de republicâ, t. II, p. 82, de l’édition Tauchnitz. |
|
Voir la description de Louvain, par Barland, dans ses Villes de la Germanie inférieure, imprimées à la suite des Dialogues. |
|
Voir pour ces privilèges, qui furent confirmés par Léon X, La Martinière et F. Nève, Mémoire sur le collége des trois langues. |
|
Toute cette description est de Barland qui l’a faite, comme on le voit, un peu trop pompeuse. |
|
A. Henne, t. V, p. 270. |
|
M. F. Nève dit vingt-quatre, mais la lettre à Borsalus dit vingt. |
|
C’est peut-être une de ces exagérations familières aux écrivains du xvie siècle. |
|
Voir Revue catholique du 15 février 1876, p. 131 (article de M. F. Nève). |
|
En 1521. Voir Feugère, Érasme, p. 399. |
|
Lettre à Borsalus. |
|
Voir la première partie de cet essai. |
|
Voir la lettre d’Érasme à Barland. Voir aussi Rottier, vie et travaux d’Érasme, p. 111-112. |
|
Frère du cardinal Guillaume de Croy, archevêque de Tolède et aussi élève de Barland. |
|
Dédicace des Dialogues. |
|
Dialogi xlii. per Hadrianum Barlandum, ad profligandam e scholis barbariem utilissimi. Ad priorem editionem accesserunt tredecim dialogi. Ejusdem dialogi duo post tredecim illos jam recens excussi. Coloniæ, apud Eucharium, anno MDXXX, in-8º. Il y a en outre à la Bibl. nat. une édit. d’Anvers 1534, et deuxde Paris, 1º de Wecheli, 1535 ; 2º de Maurice de Porta, 1542. M. Fél. Nève les signale d’après Paquot et en ajoute deux d’Anvers, 1532 et 1539. « Il est certain, dit-il encore, que deux éditions in-8º parurent à Louvain, en mars et en août 1524, et que la seconde était augmentée de treize dialogues. » (Mémoires sur le collége des trois langues, p. 402-403.) |
|
Dialogue xiii. |
|
Dialogue xvi. |
|
Dialogue xxi. |
|
Dialogue xxiv. |
|
Dialogue xxxi. |
|
Dialogue i. |
|
A Nuremberg, par la bouche du légat Cheregat. |
|
Dialogue xxiv. |
|
Essais, livre III, ch. ix. |
|
Il choisit des Lettres « quæ nihil habeant aculeorum. » Lettre d’Érasme à Barland, en 1520, tirée des Epistolæ selectæ, édit. Martens (Revue catholique de 1876, p. 131). |
|
Dialogue lv. |
|
Dialogue xix. |
|
Livre I, ép. xii. |
|
Dans son dialogue intitulé Sapiens. |
|
Il en était de même à Paris. Voir l’Heptadogma, de Goulet, réimprimé par M. Quicherat dans son histoire de Sainte-Barbe. |
|
Dialogue xx. Voir cependant l’épître à Guillaume Zagara. |
|
Oratio Martini Dorpii theologi de laudibus sigillatim cujusque disciplinarum. (Voir le mémoire de F. Nève, p. 115.) |
|
Voir notre première partie. |
|
Dialogue xxxvii. |
|
Voir pour ces deux essais de Dorpius le mémoire de F. Nève. |
|
Dialogue vi. |
|
Dialogue vii. |
Après une obscurité de plusieurs années, où l’on n’aurait à mentionner que le très-médiocre opuscule de Jonas Philologus (1529)[271], le genre dont nous essayons d’écrire l’histoire renaît avec éclat et prend une physionomie nouvelle. Les dialogues qui signalent ce changement paraissent en 1539. Vifs et spirituels, d’une politesse aristocratique qui contraste avec les allures bourgeoises de ceux de Barland, ils ont pour héros des enfants, car nous sommes sortis de la période héroïque et nous ne reverrons plus ces étudiants que leurs maîtres mêlaient à toutes les luttes. Ici, plus d’allusions aux dissensions religieuses : le temps de l’hésitation ou de la soumission frondeuse est déjà lointain : il a fallu prendre parti avec gravité, puis se renfermer dans l’école et laisser la défense de la foi au prêtre ou au soldat ; on ne changera plus des livres de classe en ouvrages de controverse. En revanche, la barbarie est vaincue, la Renaissance triomphe à condition de se purifier de toute trace de paganisme. C’est ainsi que le style des dialogues dont nous allons nous occuper, quoique d’une élégance soutenue, n’admet les ornements mythologiques que très-rarement et avec répugnance. Cette transformation qu’on pouvait prévoir s’opère en partie sous l’influence de l’Espagne. On ne l’a peut-être pas assez remarqué : l’Espagne eut, à une certaine heure, la prépondérance sur la république des lettres latines aussi bien que sur l’Europe politique : il n’y a pas d’exagération à dire qu’en 1539 elle domine ici par Charles-Quint et là par Louis Vivès.
A cette époque, Charles-Quint et François Ier se sont rangés résolûment du côté du catholicisme ; Calvin a paru (1535), et Loyola va fonder l’ordre des jésuites (1540). Le pape Paul III se prépare à restaurer l’inquisition et à convoquer (1542) le concile de Trente, qui fixera le dogme catholique. Luther, à qui il reste encore huit années à vivre, est presque oublié. Érasme est mort (1536); il ne demeure du triumvirat de la Renaissance que Vivès et Budé, qui vont eux-mêmes disparaître. Mais tandis que Budé se confine dans l’érudition, Vivès, le réformateur des études, le mordant ennemi de là scolastique, l’infatigable conseiller des pères qui de tous côtés le consultent sur l’éducation de leurs enfants, jouit à Bruges de la gloire que ses ouvrages lui ont procurée par toute l’Europe. La Flandre est sa patrie d’adoption, et sans doute il lui doit beaucoup : cependant son amour de la mesure, son esprit, sa fine morale, je ne sais quelle sécheresse, surtout la piété paisiblement unie à la culture des lettres latines et au respect pour les langues modernes, enfin presque tous les traits de son talent s’expliquent par le caractère de la Renaissance dans son pays natal.
Tandis que, dans le Nord, Érasme, Mosellanus et Barland furent obligés de lutter contre la barbarie, représentée surtout par les moines, il semble qu’en Espagne la rénovation eut lieu presque sans secousse, par un progrès lent et naturel[272]. Sous le regard favorable du clergé, tout se développe en gardant son rang et ses limites. Les dialecticiens laissent en paix les professeurs de rhétorique ; ceux-ci, au lieu d’être prêtres ou chanoines comme en Allemagne et en Flandre, ou tout au moins soumis au célibat comme à Paris, sont ordinairement de simples laïques qui ont pris femme. Ainsi Antonio de Lebrijà, Venegas et Vivès lui-même, pour ne citer que les plus célèbres. Aucun mélange de fonctions. Partout l’accord dans la règle.
Comment l’Espagne aurait-elle accueilli avec défiance les lettres latines ? Elles ne lui étaient pas venues par Érasme, inconnu ou suspect[273], mais, depuis très-longtemps, par l’Italie, que les Espagnols respectaient comme le centre du monde chrétien, tandis qu’ils se sentaient attirés vers elle par les ressemblances de langue et de climat. Bien avant la conquête du royaume de Naples, ils s’étaient soumis avec confiance à l’influence littéraire de l’Italie. Dès le xiiie siècle, c’est là qu’ils avaient envoyé étudier leur jeune noblesse. Plus tard, en 1364, un archevêque de Tolède avait fondé à Bologne le magnifique collége de Saint-Clément pour ses compatriotes, qui le remplirent pendant toute la durée du xve siècle[274]. C’est de ce collége que sortit, en 1473, le promoteur de la Renaissance espagnole, Antonio de Lebrijà, qui, sous la protection d’un autre archevêque, alla professer la langue latine à Séville, alors qu’Érasme accomplissait à peine sa sixième année. Si Lebrijà réussit à ôter des mains de la jeunesse les traités gothiques, la grammaire de Pastrana, celle d’Alexandre de Villedieu, le Catholicon et le monstrueux grécisme d’Ébrard de Béthune, dont Érasme enfant apprenait alors les vers dans Deventer encore barbare[275], ce fut avec l’aide des humanistes italiens, Georges Mérula, Philelphe le jeune, François de Nole. Après un simulacre de lutte à Valence, les bonnes méthodes et les auteurs classiques sont solidement établis partout, en particulier à Salamanque et à Alcala, dès 1480[276].
Cependant le latin n’essaye pas d’étouffer la langue nationale. Les Espagnols, et les savants aussi bien que les ignorants, aimaient avec fierté cet idiome sorti avec eux des montagnes des Asturies, qui s’étendait avec leurs conquêtes et gagnait ce que perdait celui des Arabes. Érasme ignorera le hollandais, mais Antonio de Lebrijà met sa gloire à fixer le castillan autant qu’à purifier le latin : en 1492, il publie une grammaire et un dictionnaire purement espagnols et qui n’ont pas encore aujourd’hui cessé d’être classiques. Ceci se passait sous Isabelle II. Plus tard, quand Charles-Quint crut pouvoir espérer la conquête du monde civilisé, que lui promettaient tant de poëtes, c’eût été manquer de patriotisme que de dédaigner la langue que parlait le maître de tant de nations. On lisait les auteurs anciens, mais on écrivait autant que possible en espagnol : seulement, on essayait de donner à la langue nationale la gravité et l’énergie du style des Salluste et des Sénèque. Mendoza rassemble des manuscrits rares, sur l’un desquels on fait la première édition des œuvres de Josèphe, mais il écrit la guerre contre les Morisques et le roman de Lazarille de Tormes ; en 1538, Paul Manuce lui dédie une édition des œuvres de Cicéron et loue sa science, mais en ajoutant que Mendoza exhortait les jeunes gens à étudier avec soin leur propre idiome[276]. Alejo de Venegas, Oliva, Cervantes de Salazar dont nous aurons à examiner les dialogues, et beaucoup d’autres suivent constamment cette double tendance. « Toutes ces œuvres sont en romance, dit avec orgueil Venegas en 1546, langue très-célèbre et très-estimée, même hors d’Espagne : mieux vaut être utile au grand nombre en langue vulgaire qu’à peu de personnes en latin[277]. » On n’eut pas besoin dans la Péninsule d’un manifeste analogue à celui de Du Bellay.
Au respect des érudits pour la langue nationale, il faut ajouter celui qu’ils avaient pour les mœurs et la religion. Plus encore que la langue, la foi entrait comme élément essentiel dans l’idée de patrie. Durant tant de siècles où l’on ne passa pas une nuit tranquille, où le cheval tout harnaché se tenait dans la chambre à coucher, pour qu’on n’eût qu’à s’élancer sur son dos et courir au combat, chaque parcelle de terrain reconquise devenait chrétienne, en même temps qu’espagnole. On était noble, pourvu qu’on n’eût dans les veines ni du sang des Juifs, ni du sang des Maures ; l’Inquisition fut une institution nationale, et Lope de Vega se glorifiera, en tête de ses ouvrages, d’être un de ses familiers. Il assistera officiellement aux auto-da-fé. Dans un tel milieu, la mythologie ne pouvait être regardée qu’avec défaveur. Les lettrés prirent l’habitude de demander pardon, à la fin de leurs livres, pour le cas où ils lui auraient fait involontairement de trop nombreux emprunts[278]. Plaute et Térence sont suspects ; même les proverbes et les maximes de Térence doivent disparaître de la conversation latine, pour faire place à la morale chrétienne[279] ; il faut ôter aux écoliers les excerpta de l’Andrienne et de ses autres comédies ; ces locutions qui semblent inoffensives et purement élégantes ont, d’après les maîtres espagnols, une senteur de vice.
Certes, il faut rendre justice à cet esprit qui produisait une morale pure dans les livres, sinon dans les mœurs. Mais la pensée, en même temps, était soumise à un joug insupportable. Si les livres soumis à la censure royale ne l’étaient pas encore (1539) à celle de l’Inquisition, les auteurs demandaient déjà de temps à autre cette seconde approbation pour être à l’abri de toute inquiétude. La gravité castillane, contenue dans les limites d’une étroite orthodoxie, se rabattait sur les lieux communs de morale, qui sont le sujet de tant d’ouvrages à cette époque, en attendant qu’elle aboutît aux puériles recherches de style et au gongorisme.
On comprend maintenant ce que pouvait être le talent de Vivès, bien qu’il eût eu soin de s’établir en Flandre, loin de sa ville natale, de cette Valence où on avait fait servir aux fondations d’un pont, des pierres couvertes d’inscriptions antiques, pour dérober aux regards ces prétendus monuments d’idolâtrie[280]. On comprend qu’il ait été connu, au moins autant par ses ouvrages de piété que par ses dialogues, chez les Français du xvie siècle, qui traduisirent souvent son Introduction à la sagesse et ses Prières[281] ; on s’attendra avec raison à voir Plaute et Térence absolument bannis de ses exercices de conversation latine[282]. D’un autre côté, on fera honneur à son pays, plus qu’à lui-même, de ce bon sens avec lequel il recommande, dans ses divers ouvrages, de n’enseigner le latin aux enfants, qu’après leur avoir bien appris la langue nationale. C’est déjà beaucoup, pour le contemporain de Mendoza de Hurtado, de n’avoir écrit qu’en latin. Il aurait scandalisé ses compatriotes si, dans ses dialogues, au lieu de se borner à donner des leçons aux écoliers, il avait prétendu enseigner pour les hommes faits une langue destinée à remplacer le romance[283]. Le sage Vivès, comme on l’appelle, doit donc à sa patrie la plupart des traits de son caractère ; cependant son talent n’appartient qu’à lui.
Nous ne referons pas sa biographie. Il n’a pas besoin qu’on renouvelle sa mémoire, son nom est populaire. De nos jours encore, ses compatriotes le citent avec orgueil et ne craignent pas de le mettre à côté de celui de Descartes[284]. Nous ne rappellerons pas davantage tous ses ouvrages ; Vivès est trop grand pour être contenu tout entier dans notre modeste cadre. Le philosophe, le théologien, et même en grande partie l’humaniste nous échappent. Disons seulement que l’Espagne, la Flandre et l’Angleterre se partagent inégalement sa vie : Valence eut sa jeunesse ; Louvain l’initia aux lettres ; Oxford marque pour lui la période des grandeurs et de leurs dangers ; Bruges, celle du repos, du bonheur domestique et de la gloire. Il vécut assez dans sa patrie pour y prendre ces premières habitudes qui peuvent plus tard se cacher au fond de l’âme, mais qui y conservent toute leur puissance en réglant la vie presque à notre insu. Paris, qu’il visita à l’âge de dix-sept ans et où il acheva ses études, ne lui donna que le dégoût de la scolastique ; à Louvain, il eut le bonheur de connaître Érasme et fut précepteur d’enfants de grande naissance, de Guillaume de Croy et du fils du seigneur de Bergues que nous avons déjà connus comme élèves de Barland. Peu s’en fallut qu’il ne fît l’éducation du duc d’Albe[285], mais il fut chargé un moment de celle de Charles-Quint[286], et, en 1523, le roi d’Angleterre, Henri VIII, qui n’était encore connu que par son amour pour les lettres, lui confia sa fille, celle qui fut plus tard Marie Tudor. C’est plus qu’il n’en faut pour expliquer le ton aristocratique de ses dialogues. Après avoir joui cinq ans de la faveur de Henri VIII, il la perdit pour s’être opposé aux passions de ce prince, fut même mis en prison et put cependant venir se fixer à Bruges, où les soins de sa femme Marguerite Valdaura lui adoucirent les souffrances de la maladie. C’est dans cette dernière période, au milieu de la colonie espagnole de cette ville, qu’il écrivit ses dialogues, deux ans avant une mort prématurée (1492-1540). Ils furent son dernier ouvrage ; il ne pouvait le dédier qu’à un roi ou à un fils de roi ; en effet, il le dédia à l’infant Philippe, celui qui devait épouser son élève Marie et régner sous le nom de Philippe II.
Puisque tant de circonstances avaient amoindri l’importance de nos dialogues, il restait à se faire enfant avec les enfants, tout en demeurant leur conseiller par la supériorité de la raison. On pouvait faire une œuvre durable dans ce nouveau genre. Il fallait pour cela de la simplicité et l’amour de l’enfance encore plus que du génie. Vivès ne fit pas cette œuvre. Accoutumé à commenter saint Augustin ou à écrire l’histoire de la philosophie, ou, quand il s’occupe d’éducation, à voir de haut l’ensemble des choses, il sait cependant ici être naturel ; seulement il apporte, au lieu de la candeur qui attire la confiance des enfants, l’esprit qui amuse les maîtres. Se souvenant qu’autrefois il avait fait rire aux dépens de la scolastique, il peignit avec finesse et d’une manière satirique dans ses dialogues, soit les enfants eux-mèmes, soit les personnages qui se groupent autour d’eux. Ce fut la cause d’un succès vif, mais dont il ne reste rien aujourd’hui. Les œuvres uniquement spirituelles durent peu ; d’ailleurs, il eût fallu, pour celle qui restait à faire, étudier toute la république dés enfants, sans distinction de rang ni de fortune. Vivès n’oublie pas assez qu’il a vécu à la cour près des fils de princes ; ses écoliers sont des enfants gâtés : ils ont des montres. Le premier dialogue nous offre un petit gentilhomme habillé par sa bonne qui ne veut pas qu’on l’appelle laide[287]. « Mais ie luy diray la premiere fois que vous m’appellerez laide, comme vous auez accoustumé. — Mais si ie vous appelle larronnesse ? — Tout ce que vous voudrez, moyennant que ne m’appelliez point laide. » Notre écolier va ensuite voir ses parents. Il descend dans une belle salle à manger, joue avec son petit chien, et sa mère est près de s’évanouir parce qu’il lui raconte qu’il a eu mal à la tête quelques minutes ; ce n’est pas qu’il n’ait pas bien dormi. « Toutefois ie me suis reueillé sur la minuict de douleur de la teste. — O pauure femme et misérable que ie suis, que dites-vous ? De quel costé de la teste ? — Aux deux costés sur le deuuant. — Combien de temps ? — A grand peine la huictième partie d’une heure ; puis i’ay redormy et ne l’ay plus senty. — Me voilà reuuenue et resuscitée, car vous m’auiez rendue comme morte[288]. » Son père emploie la persuasion pour le mener à l’école et lui remplit son panier de bonnes choses. Plus loin, deux petits grands d’Espagne vont chez le maître d’écriture qui les complimente sur leur noblesse. Cependant ils ne veulent pas avoir la grande et irrégulière écriture des gentils-hommes[289].
A tous ces enfants de noble maison préside le petit Philippe, qu’on voit lui-même, maigre et débile, courbé sur ses livres. L’auteur lui donne d’ailleurs une leçon de morale aussi adroite qu’ingénieuse, et lui prouve qu’il ne pourra pas plus tard gouverner l’État s’il n’étudie maintenant, puisqu’il ne peut diriger un petit bateau sans l’avoir appris[290].
Où sont les grossiers étudiants de Leipzig ? Cependant Vivès est d’un an l’aîné de Mosellanus. Mais depuis 1517 la civilisation a fait des progrès : surtout le pays n’est pas le même. Vivès nous conduit en Espagne, en Flandre, à Paris, pour que son petit drame à cent actes divers soit plus attrayant ; partout enfin, excepté en Allemagne. S’il pénètre dans une école, on dirait la visite d’un grand seigneur : il raille avec une finesse un peu dédaigneuse la simplicité du sous-maitre. « Le maître. Mais vous, mon subalterne, que dites-vous ? Qu’auez-vous à dire de nouueau à ce souper ? — Le sous-maître. Je ne dy rien : mais ces deux heures dernières i’ay pensé à beaucoup de choses de grammaire. — Et quoy donq ? — Choses certes bien obscures et du profond de la science. Premièrement pourquoy les grammairiens ont mis trois genres en l’art, veu qu’il n’y en ha que deux en nature, ou pourquoy nature ne produit choses de genre neutre, comme elle fait de masle et de femelle. Je ne saurois trouuer ny entendre la cause d’un si grand secret. En après les philosophes dient qu’il n’y ha que trois temps : nostre art en met cinq : nostre art donq est outre la nature des choses. — Mais vous-mesme estes outre la nature des choses : car l’art est en la nature des choses. Auez-vous autre chose à dire ? — Ie vis hier commettre un fait capital, un cas mortel. Le maistre d’escole de la rue droitte ; plus puant qu’un bouc, qui en son escole en toute puanteur et vilenie enseigne ses escoliers diablotins, ha prononcé trois ou quatre fois Volúcres d’un accent sur la pénultime et ie me suis esmerveillé que la terre ne s’est ouverte pour l’engloutir. — Vous faites trop de bruit pour une chose de petite valeur et faittes d’un rien un grand cas[291]. »
Vivès nous montrera encore les étudiants bavardant dans la rue et faisant la chronique scandaleuse de la ville, mieux que les dames parisiennes de Villon, ou bien encore à la campagne, en partie de plaisir, comme dans le joli dialogue dont la scène se passe entre Paris et Boulogne. Il faut les voir, sortis per portam Marcellinam, par la porte Saint-Marceau, s’en aller les uns à cheval, les autres en bateau ou en charrette. Leur frayeur à la vue de quelques lansquenets, leur odyssée, leurs mésaventures et la description de la campagne près de Boulogne-sur-Seine mériteraient d’être cités[292]. N’oublions pas une visite à un collége de Paris, où l’esprit de Vivès s’exerce aux dépens des professeurs et des ouvrages aussi bien que des élèves[293].
Tout le monde voulut avoir ce livre charmant. De tous côtés il fut imprimé, commenté, traduit. C’est le premier de nos colloques dont il existe autre chose que des réimpressions pures et simples. On l’explique dans un très-grand nombre d’écoles. Une bizarrerie de l’auteur, en piquant la curiosité et en offrant des difficultés en réalité aisées à résoudre, augmenta le succès. N’écrivant que pour les enfants, il avait voulu nommer les objets qui leur sont familiers : il avait commis la faute évitée par Mosellanus de faire porter la conversation sur les détails de l’habillement et du mobilier. Cela lui semblait piquant. Comme il s’adressait à des riches, cette partie du vocabulaire devenait considérable. D’ailleurs, il avait trop de bon sens pour employer des périphrases, et puisque la langue latine ne lui fournissait pas assez de termes, il en demanda à la langue grecque, si complaisante ; ainsi qu’on le fait de nos jours, pour nommer les découvertes de la science[294]. De là tout un attirail de mots inconnus qui effrayèrent les pauvres maîtres de province. Tel, comme Housteville de Caen, après avoir acheté le livre, le jeta de côté avec regret et dépit, parce qu’il n’y pouvait presque rien comprendre. Alors l’Espagnol Motta, le premier, non sans quelque ironie, donne son commentaire[295], vient au secours des malheureux. Freigius, en Allemagne, en fit autant. Housteville de Caen, muni du commentaire de Motta, se remit à l’œuvre et, voulant épargner aux enfants la peine qu’il avait lui-même éprouvée, il donna à son tour des éclaircissements très-étendus en langue vulgaire, et qui sont aujourd’hui assez curieux. Dans ce désir d’adoucir aux écoliers les difficultés par le secours de l’idiome maternel, on alla plus loin : on fit des traductions avec le texte en regard pour l’usage des classes ; nous en connaissons trois en français. C’est ainsi que l’obscurité même de l’ouvrage contribua à sa renommée. On l’imprima d’abord dans le format ordinaire des livres de classe, et puis dans un format mignon et en très-petits caractères, pour qu’avec ce corps élégant il fût de tout point digne de la jeune noblesse dont il était destiné à faire les délices en France comme en Espagne.
Tel fut le succès de ce livre, qui vint à son heure et succéda dans plusieurs pays aux colloques d’Érasme, qu’il fallait remplacer depuis qu’ils avaient été condamnés par l’Université de Paris (1529), mais surtout parce qu’ils ne convenaient pas à l’état des générations nouvelles. D’ailleurs Vivès avait trouvé qu’ils n’étaient aucunement faits pour l’enfance et avait osé faire part de son sentiment à Érasme, à propos du colloque sur le Carême. Sans doute il voulut attendre la mort de son maître pour publier lui-même des dialogues vraiment destinés aux enfants. Nous l’avons vu montrer ce que peut l’esprit : Mathurin Cordier devait faire voir ce que peut le cœur.
|
Voir la rapide revue des colloques dans la première partie de notre livre, au sujet de cet ouvrage, qui est un écho de ceux d’Érasme et de Barland, dans un style imité de celui de Plaute, et avec une gaieté grossière. |
|
Les moines espagnols essayèrent bien de s’opposer à là réforme littéraire d’Antonio de Lebrijà, mais celui-ci, soutenu par de hauts personnages ecclésiastiques, vint facilement à bout de cette résistance. Voir Hallam, Litt. de l’Europe, t. I, ch. iii. Il faut bien ajouter que la scolastique reprit plus tard le dessus. Voir Hallam, t. I, ch. v, et beaucoup d’autres témoignages. |
|
Les hardiesses religieuses d’Érasme ne pouvaient que lui attirer l’inimitié des Espagnols, surtout des moines. Ceux-ci voulaient faire interdire en Espagne la lecture de tous ses ouvrages, et il ne fut guère défendu en 1527 que par quelques lettrés et, chose singulière, par le grand inquisiteur (ép. 876). En 1529, Érasme dit que ses ennemis les plus violents sont à Salamanque (ép. 1072). |
|
Voir Antonio B. Vetus, édition de Rome, préface, p. xv, et II, p. 104 et 265. Voir aussi Ticknor, Histoire de la litt. espagnole. |
|
Voir la vie d’Érasme, Erosmo auctore. |
|
Antonio, art. A. Nebrissensis. |
|
« Todas estas obras van en romance, » etc., dans Mexico en 1554, p. xxviii. |
|
Voir Ticknor, passim. |
|
Voir la préface de Motta à son commentaire sur les dialogues de Vivès. |
|
Voir Bibl. d’Antonio, I, p. 593, art. Joannes de Salaia. |
|
Pierre de Lancrau (Avignon, 1552) et Geoffroy de Billy (Paris, 1570) traduisirent ses Prières ; Jaques de Changy (Lyon) et Loys Turquet (Lyon, 1580), l’Institution de la femme chrétienne ; Guillaume Paradin (Lyon, 1550), l’Introduction à la sagesse, et Jaques Girard, l’Aumônerie (Lyon, 1583). Voir La Croix du Maine et Du Verdier, passim. |
|
Il ne publia ses dialogues qu’après la mort d’Érasme ; et dans une lettre qu’il lui écrivit de Bruges en 1526 (Er. op., ep. 829), il laisse voir combien il est choqué que l’auteur des colloques, qui semble avoir écrit pour les enfants, les ait introduits dans des controverses auxquelles ils ne peuvent rien comprendre, si ce n’est qu’on s’y moque de la religion. Érasme (ép. 871), se défend comme il peut. |
|
Il parlait le français presque aussi bien que l’espagnol et comprenait le flamand. Ce témoignage lui est rendu par Érasme, si étranger lui-même aux langues modernes (ép. 385). |
|
Nous avons entendu M. Castelar faire cette comparaison un peu hasardée. En revanche, Ticknor ignore absolument le nom de Vivès. Les traducteurs espagnols n’ont pas réparé cette omission étrange. Vivès n’est pas même mentionné en passant dans la meilleure histoire de la littérature de son pays. |
|
Voir Namèche, Mémoire sur la vie et les ouvrages de Vivès, dans les Mémoires couronnés par l’Académie de Bruxelles. |
|
Voir Henne, Histoire de la Belgique sous Charles-Quint. |
|
Trad. de 1560. (Voir plus bas), Dialogue i. |
|
Dialogue ii. |
|
Dialogue x. |
|
Dialogue xx. |
|
Trad. de 1560. Dialogue xvii. |
|
Dialogue ix. |
|
Dialogue xiii. |
|
On lui en fit un reproche. Voir Bibl. nova d’Antonio, t. I, p. 554. |
|
L’histoire des éditions, des commentaires et des traductions des Dialogues de Vivès n’est pas sans intérêt. Voici ce que nous en connaissons. I. Ils furent imprimés pour la première fois en 1539 (in-8º, apud Joannem Foncher et Vivantium Gaultherot, via Jacobea), avec une approbation de Richard Simon. Voir Namèche, Mémoire sur la vie et les écrits de Vivès, 1841. C’est par une erreur renouvelée de Paquot et réfutée par M. Namèche, que la biographie Didot parle d’une édition à Bâle en 1538. Il ne faut pas s’étonner de voir les Dialogues de Vivès paraître d’abord à Paris. Cette ville était devenue le centre de la publication des colloques ; nous dirons pourquoi, dans un autre chapitre. II. C’est encore à Paris que notre ouvrage reparaît en 1547, avec cette erreur singulière : nunc primum in lucem editus, qui donne à penser que le succès qui devait être si vif ne fut pas très-prompt : « Linguæ latinæ exercitatio, Ioannis Lodoici Vivis Valentini. Libellus admodum doctus et elegans, nuncque primum in lucem editus. Una cum rerum et verborum memorabilium indice diligentissimo. Parisiis apud Joannem Roigny, via ad D. Jacobum, sub Basilisco et quatuor elementis 1547. » (Bibi. Mazarine.) Pas d’autre préface que la dédicace de Vivès à Philippe. Caractères romains. Notes marginales explicatives. A la fin un index. Une épigramme de G. Paradin montre que le livre semblait surtout destiné à la noblesse. Ad Lodoicum de Malain, clarissimum adolescentem, F. Mangarii discipulus G. Paradinus.
Nil mirum Latias hac nostra ætate Camœnas Inter magnates exeruisse caput. Quarum præsidio totum sibi subdidit orbem Stirps Cypriæ quondam sanguine juncta deæ. Quin igitur, soboles illustris et indolis altæ, Ore loqui latio si cupis, idque brevi, Formabit linguam mire hic tu’ ordine Vives Qui precor ut studii sit scopus usque tui. III. — En 1553, à Lyon, chez S. Gryphius. En italiques suivant l’usage de cet imprimeur. Avec le commentaire de Motta. « Linguæ latinæ exercitatio Io. Lodo. Vive autore cum Petri Mottæ Complutensis græcarum priscarumque dictionum ac subobscurorum locorum interpretatione : quam in fine libri post indicem rerum ac verborum invenies. » (Bibl. nationale.) Ce commentaire de Motta avait d’abord paru en Espagne, nous ne savons à quelle époque. La bibliothèque d’Antonio n’en connaît qu’une édition qui aurait été publiée à Barcelone en 1615. Elle nous renseigne du moins sur la vie de l’auteur qui, après avoir été à Alcala élève du fameux Antonio de Lebrijà, professa les belles-lettres à Grenade et finit par devenir prêtre à Antequerra (B. N. II, p. 176, édit. de Rome). Nous pouvons affirmer que le commentaire de Motta avait été publié longtemps avant que Gryphius l’eût fait connaître en France. C’est ce qui résulte du témoignage de Cervantes Salazar, autre commentateur des dialogues de Vivès, et qui écrivait en 1554 : Adjeci permixtas lucubrationibus meis interpretationes : quas ante me jam pridem Motta Complutensis, vir certe doctissimus, in autoris cognitionem publicaverat. (Préface des commentaires de Cerv. Sal., citée dans Mexico en 1554, p. 19.) Les éclaircissements de Motta parurent probablement un peu après 1540, époque de la mort de Vivès. Ils sont précédés d’une préface où se montre l’aversion espagnole pour les auteurs profanes et où il se moque du menu peuple des grammairiens que terrifiait le grec latinisé de Vivès. En voici des extraits : « Ex aliorum librorum lectione, velut Terentiana atque Plautina excerpi quidem elegantiæ fructum quis negat ? Sed in eis tamen vitiorum incitamenta et morum offendicula inesse quis non videt ? At in autore nostro, cum elegantiæ latinæ flosculos, quos ex clarissimis quibusque autoribus excerptos in hunc libellum congessit, invenies, tum nihil est, quod vel Christum ipsum, vel certe optimos mores et probam educationem non sapiat. » Il ajoute qu’il exhortait en vain les maîtres à expliquer cet ouvrage à leurs élèves. Mais les maîtres, après un plus ou moins grand nombre d’efforts, le mettaient de côté tout en l’admirant, parce qu’ils ne pouvaient pas le comprendre. A en croira Motta, ils le suppliaient d’ajouter quelques explications à celles qui se trouvaient déjà à la marge. Lui, ne sachant s’il devait rire ou se fâcher, composa enfin ce commentaire, non pour faire parade d’érudition, mais infirmæ grammaticorum plebi consulendi animo. Ce commentaire est court ; nous n’y avons guère remarqué qu’un hommage à la mémoire d’Antonius Nebrissensis, et une petite dissertation sur la manière dont les différents peuples portent l’épée. A partir de 1553 il est réimprimé dans la plupart des éditions. IV. En 1554, à Mexico, commentaire de C. Salazar, dont nous parlerons au chapitre suivant. V. C’est ici le lieu de parler du commentaire de Housteville de Caen, quoique nous n’en connaissions pas la première édition. Nous savons seulement par Nicéron qu’il avait fait imprimer à Caen une prosodie en 1552. Ce régent était un des infortunés que la difficulté des dialogues avait rebutés, et il l’avoue naïvement dans sa préface, où il s’intitule « Ægidus de Housteville sanctimarianus Constantinas, Cadomi studiosæ juventutis in gymnasio Montano institutor. » Voici le commencement de cette préface qui est datée de 1553 : « Cum superioribus annis Joan. Lud. Vivis latinæ linguæ exercitationem auditoribus nostris prælegere incepissemus, lector amice, eamque vulgo inauditis obscurisque vocabulis undique refertam et scatentem in ipso comperissemus vestibulo, statim ab interioribus tam spinosi tamque difficilis operis penetralibus pedem nobis referendum esse prospeximus. » Il laissa donc le livre de côté plusieurs années ou ne s’en occupa que dans ses heures de loisir. Enfin, lorsque parut une nouvelle édition plus correctement imprimée et enrichie des notes de Motta (il s’agit sans doute de celle de Gryphius, v. III), il songea à remettre entre les mains des élèves un ouvrage qu’il admirait. Motta avait négligé l’explication d’un grand nombre de termes peu familiers aux lettrés. Housteville a dû combler ces lacunes tout en ayant honte de travailler sur le même sujet après un si grand homme ; mais il s’agissait de l’utilité et du plaisir des petits enfants. Ce dernier trait nous fait aimer Housteville. Par sa candeur et sa bonté il ressemble un peu à Mathurin Cordier, qui était Normand comme lui. Il lui ressemble encore par le soin qu’il a pris d’écrire ses notes en français. Elles sont en général simples et claires. On ne les consulterait pas sans quelque profit pour l’histoire de la langue française. En voici deux ou trois prises au hasard : Academia, tout lieu d’exercice qu’on appelle Université. — Agmine, etc., la Seine coule doucement et sans grand randon. — Antiae, cheveux de femme passants dessus le front en passe-filon. — Asilus, une statue à laquelle on s’enfuit. — Batillum, une palle de fer. VI. 1555. Jolie petite édition parisienne, in-16, chez Menier. C’est la reproduction de celle de Gryphius. Même titre. Parisiis ex typographia Mauricii Menier, via Nova, in suburbiis Victorianis, ad insigne D. Petri (B. Mazarine). VII. Nous arrivons aux traductions françaises. Nous en connaissons trois différentes, toutes anonymes. La première, dont Brunet ne dit rien, parut à Lyon, chez Cotier, en 1560. Nous en avons cité des extraits. « Les dialogues de Jean Loys Vivès : pour l’exercitation de la langue latine. En latin et en françois, pour la commodité de ceux qui voudront conférer l’une à l’autre langue. A Lyon, à l’Escu de Milan, par Gabriel Cotier, 1560. Auec privilège du Roy. » (B. Mazarine.) A la fin, les éclaircissements de Motta et de Housteville. La seconde édition (1564), « reuue et corrigée mieux que par cy-devant, » se trouve à la bibliothèque de l’Arsenal. Cette traduction, comme on a pu en juger, n’est pas sans une certaine grâce naïve. VIII. La seconde traduction, signalée par Brunet, fut publiée en 1571, à Anvers, chez Cuzman, in-16. D’après Brunet, La Croix du Maine l’attribue à Guillaume Paradin et Nicéron à Housteville. Elle fut réimprimée en 1573 à Nancy, chez Janson. On peut voir un exemplaire de l’une et de l’autre édition à la bibliothèque Nationale. IX. Il y a encore à l’Arsenal une traduction de chez Thiboust, Paris, 1665, qui paraît incomplète et où l’ordre des dialogues n’est pas observé. Ajoutons que Brunet en signale une quatrième par Jamin, chez Buon, 1556. Nous ne l’avons pas vue. Elle ne peut être la même que celle que nous avons citée la première. X. En 1572, les Allemands se mettent de la partie et le commentaire de Freigius paraît à Nuremberg. (Bibliothèque Sainte-Geneviève, in-8º.) Voici un extrait de la préface. Il nous apprend que ces dialogues étaient d’un usage commun en Allemagne depuis longtemps. « Quos quum studiose a pueritia legissem, eosdemque certatim in omnibus fere scholis enarrari viderem. » Il ne manque pas de répéter la phrase obligée sur les difficultés du texte, dont il fait d’ailleurs l’éloge. « Ut omittam reconditam cognitionem rerum variarum, historias ubique docte aspersas, tot proverbia, tot similitudines, tot præclaras sententias, etc. « Nec me movet quod Hispanus natione fuerit. P. Ramus Gallus est, Erasmus Batavus, Sigonius Italus, Glareanus Helvetius, Melanchton Germanus. « Nec agitur hic de religione aut fidei articulis. Quanquam si eam pietatem et rerum sacrarum cognitionem ad christianam Ecclesiam afferrent plerique, quam Vives attulit (ad vivum id non reseco) fortassis et Hispani haberent quod libenter et honeste etiam in suis adversariis imitari possent. « Atque utinam genti illi, quæ alioqui laudis et ethicæ doctrinæ studiosissima est, Vives sui scripta magis cognoscere liberet, quam quorumdam recentium sophismata : non tantum opibus et potentia, sed etiam solida eruditione politaque philosophia haud dubie omnibus nationibus præstaret. » XI. D’après Paquot les dialogues de Vivès furent traduits en allemand, en italien (Florence, 1708 ; Venise 1718) et en polonais. |
Ce n’était pas assez du suffrage de toute l’Europe ; l’Amérique connut les dialogues de Vivès. Trente ans après la conquête du Mexique par Fernand Cortès ils passent l’Océan : on les explique, on les réimprime, on les imite dans la capitale de la Nouvelle-Espagne où plus d’un Indien à peine sorti de l’état sauvage s’essayait à converser dans la langue de Cicéron[296]. François Cervantes Salazar, professeur de rhétorique à l’Université de Mexico, publie, en 1554, une édition des Exercitationes linguae latinae[297] qu’il enrichit de curieux commentaires : il y joint sept dialogues de sa composition, dont les trois derniers sont devenus des documents ds grand prix. On en peut juger par leurs titres : Academia Mexicana, Civitas Mexicus interior, et Mexicus exterior. Nous nous promenons dans les rues du Mexico chrétien que les vainqueurs sont en train de construire ; nous en visitons les environs et surtout nous nous rendons compte de l’état de l’instruction publique en ce pays. Tout cela grâce à Cervantes, mais encore plus grâce à l’érudit qui a bien voulu rééditer ces trois dialogues longtemps introuvables en les complétant par des introductions et des notes qui sont un trésor[298]. M. Joaquin Garcia Icazbalceta était déjà connu des bibliophiles et sans doute aussi des historiens par la publication de documents rares ou inédits relatifs à l’histoire du Mexique[299]. Nous avons grandement profité de son travail ; nous lui devons de plus des remercîments particuliers pour l’obligeance qu’il a eue de nous envoyer, copiés de sa main sur l’exemplaire unique, les quatre premiers dialogues qui remplissent une quarantaine de pages et qu’il n’a pas jugé à propos de réimprimer parce qu’ils n’ont aucune importance au point de vue historique.
L’ouvrage de Cervantes[300], dont l’Europe n’avait jamais entendu parler, fut longtemps considéré par les bibliophiles américains comme totalement perdu. Enfin, en 1844, l’historien Alaman en découvrit un exemplaire auquel manquaient le frontispice et les deux derniers feuillets. M. Icazbalceta le reçut en don, et pendant plus de vingt ans ses recherches pour le compléter furent infructueuses. Cependant, en 1866, on lui en communiqua un second exemplaire, mutilé et en très-mauvais état, sur lequel il put copier le dernier feuillet. Quant à l’avant-dernier, il avait disparu avec beaucoup d’autres, sans doute par les mains destructrices des écoliers. Bien petite et comme nulle était l’espérance de remplir un jour ce dernier vide : elle ne s’est pas encore réalisée. M. Icazbalceta se décida, en 1854, à rééditer les trois dialogues les plus importants, avec cette irrémédiable lacune : son œuvre ne fut achevée que le 8 novembre 1874. Avant d’entrer en matière et de mettre à profit, suivant notre plan, les documents qu’il a réunis avec tant de soin, nous ne pouvons nous empêcher de citer la fin de sa préface. On ne se croira pas sorti du xvie siècle.
« En reportant la vue sur le quart de siècle qui s’est écoulé depuis que pour la première fois j’ai pensé à exécuter le travail que je termine aujourd’hui, je ne puis m’empêcher de rendre des grâces infinies à la Providence divine pour m’avoir conservé la vie, et pour les innombrables bienfaits qu’elle m’a dispensés, entre lesquels je compte au premier rang les châtiments que, pour la correction de mes fautes, j’ai reçus de sa main paternelle. Pour cette raison, avant de prendre congé du lecteur, je l’invite à s’incliner avec moi devant l’auteur de toute grâce, en disant : Soli Deo honor et gloria. »
François Cervantes Salazar était Espagnol de naissance. L’émigration divise naturellement sa vie en deux parties. Il naquit à Tolède vers 1515, d’une famille noble mais pauvre, et apprit le latin dans la même ville sous Alejo de Venegas, dont Nicolas Antonio et de nos jours Ticknor ont parlé avec éloge[301]. Un peu avant 1540, nous le retrouvons en Flandre à la suite du licencié Giron, alors notable personnage, mais aujourd’hui entièrement inconnu. Là, Cervantes rechercha la société des savants, et c’est sans doute alors qu’il connut Vivès qui achevait de vivre à Bruges. De retour en Espagne et secrétaire latin du cardinal archevêque de Séville, qui était en même temps président du Conseil des Indes, il peut croire sa fortune faite ; mais son protecteur meurt en 1546. Un mois après, il publie les seuls ouvrages que ses contemporains de l’ancien continent aient connus de lui, c’est-à-dire deux traités moraux et une traduction de l’Introduction de Vivès à la sagesse, le tout réuni en un volume in-4º[302].
On sait que les Espagnols du xvie siècle étaient grands amis de la dialectique et de la morale, leur vivacité s’accommodant de la première, leur gravité de la seconde. Le maître de Cervantes, Alejo de Venegas, était lui-même un moraliste, et il patronna dans une préface les débuts de son disciple.
Remarquons encore que les premiers ouvrages de Cervantes sont écrits en langue vulgaire. Cet érudit est fier de l’idiome maternel, comme les Lebrijà et les Mendoce.
En 1550, notre auteur, âgé d’à peu près trente-cinq ans, était professeur de rhétorique à la petite université d’Ossuna. C’est sans doute alors qu’il composa pour ses élèves son Commentaire sur les colloques de Vivès, ainsi que ses quatre premiers dialogues originaux, car s’il ne les fit imprimer que plus tard à Mexico, il déclare les avoir écrits en Espagne[303]. Vain comme il l’était, il devait aimer à rappeler devant ses élèves son séjour en Flandre, ses rapports avec les savants de cette fameuse contrée, sa traduction de l’Introduction à la sagesse. « Il faut avoir été en Flandre, s’écrie-t-il dans son Commentaire, pour comprendre qu’une même fenêtre puisse avoir deux fermetures, l’une vitrée et l’autre en bois plein : nous expliquerons à l’occasion plusieurs usages qu’un séjour dans ce pays peut seul faire comprendre[304]. » Peut-être que ces notes ne seraient pas aujourd’hui tout à fait inutiles pour l’histoire de la civilisation.
Les quatre premiers dialogues de Cervantes, composés longtemps avant les trois autres, ne méritent qu’une mention. Sous prétexte que Vivès avait oublié certains jeux, notre auteur décrit successivement le saut, l’exercice de la boule lancée à travers un anneau de fer[305], le jeu de quille et le jeu de paume. Cela est ingénieux, subtil et mesquin. C’est se plaire à reproduire le talent de Vivès dans ce qu’il avait de petit ; c’est accomplir un tour de force qui nous semble aujourd’hui bien inutile. Si Cervantes n’avait pas plus tard changé de manière, on ne l’aurait pas tiré de l’oubli.
Fort heureusement pour sa mémoire, il se lassa d’un rôle qui lui semblait peut-être trop modeste, et de nouveau chercha fortune. Un courant d’émigration, dont la durée devait être funeste à l’Espagne, emportait alors les mécontents et les hardis vers le nouveau monde. On sait que tous les droits de la couronne sur les provinces américaines étaient exercés par le Conseil des Indes, qui administrait les domaines, conférait les offices et réglait les affaires ecclésiastiques, militaires, civiles ou commerciales[306]. Cervantes avait été cinq ans secrétaire du président de ce Conseil ; il avait même connu à cette époque Fernand Cortez, et lui avait dédié un de ses ouvrages[307]. Mais le conquérant du Mexique était mort depuis. Le mouvement d’affaires que Cervantes avait vu de près excita sans doute en lui des espérances qui n’attendaient qu’une occasion pour se donner carrière. Quoi qu’il en soit, il partit en 1550 pour Mexico, où il arriva avec une réputation de grand latiniste[308].
On le voit d’abord professeur de grammaire dans une école[309], mais lorsque l’université de Mexico eut été fondée, en 1553, il y obtint la chaire de rhétorique et c’est lui qui fit le discours d’inauguration. En 1554, il fait imprimer par un Italien, Jean-Paul de Brescia, autre chevalier errant de l’érudition, ses Commentaires sur les colloques de Vivès, avec les quatre dialogues déjà écrits en Espagne et les trois autres qu’il venait de composer en l’honneur de sa nouvelle patrie. L’année suivante il reçoit les ordres[309] dans l’espoir d’arriver aux dignités ecclésiastiques, les plus enviables du pays. Poursuivant ses études sacrées sans négliger son cours de rhétorique, professeur dans une salle, élève dans une autre, il devient bachelier, licencié, puis docteur en théologie. Dès qu’il le peut, il laisse sa chaire qui n’avait jamais été pour lui qu’un marchepied. Historiographe de la ville de Mexico en 1560[310], sans doute à cause de ses derniers dialogues, chanoine de la cathédrale en 1563, deux fois recteur, il vieillit en s’occupant à écrire une chronique des Indes qui devait rester manuscrite comme tant d’autres ouvrages d’historiens espagnols et qui paraît même s’être perdue[311]. Il fait sourire les chanoines ses collègues, en exprimant devant eux l’espoir de devenir évêque. C’est en vain qu’il adresse des compliments à l’archevêque Montufar[312] ; celui-ci ne les lui rend pas en estime. Plus tard, l’archevêque Moya, dans un rapport à la cour d’Espagne, le dépeint comme un homme léger et changeant, de mauvaises mœurs, ami de qui le flatte, incapable de traiter une affaire et n’ayant rien d’ecclésiastique. M. Icazbalceta trouve cette appréciation bien sévère et même il la qualifierait d’injuste s’il ne craignait de manquer de respect à un archevêque ; mais son plaidoyer, si ingénieux qu’il soit, ne nous paraît pas devoir faire infirmer un jugement qui s’accorde avec le passé de Cervantes et qui en expliquerait au besoin certaines parties. N’était-il pas changeant cet homme qui va, je ne dis pas de pays en pays, tout le monde en faisait autant, mais de profession en profession ? Méritait-il beaucoup d’estime, celui qui, à cette époque de dédicaces et prodigue de noms propres, ne rappelle en aucun endroit la mémoire de son protecteur, le cardinal de Loaysa ? Était-il un véritable ecclésiastique, celui qui arrive séculier dans le nouveau monde et attend l’âge de quarante ans et le séjour dans un pays où les évêchés abondent, pour prendre les ordres ? Je ne parle pas de la vanité qui le porte à se mettre en scène dans ses Dialogues ; elle ne le distingue pas des autres Espagnols ; je laisse de côté ses mœurs, quoique ce qu’en dit le prélat puisse aussi aider à comprendre qu’il ait quitté l’université d’Ossuna où il était professeur de rhétorique pour aller au delà des mers enseigner la grammaire dans une école. Cet homme léger et médiocre, s’il fallait comparer les divers mérites, ne brillerait guère dans la galerie des auteurs de colloques. Nous n’avons raconté sa vie que parce qu’elle était fort inconnue et qu’il fallait un supplément au peu que disent de lui les biographies ; mais ce qui importe, en somme, c’est l’heureux choix qu’il a fait de ses sujets quand il a voulu briller devant les habitants de Mexico.
Quel était l’état de l’instruction publique dans cette ville avant la fondation de l’université ? Quelle est l’histoire de cette fondation ? Voilà ce qu’il convient d’examiner avant de visiter l’université avec les interlocuteurs du premier des grands dialogues de Cervantes. Pour traiter cette question, nous aurons évidemment recours aux détails que notre auteur lui-même donne çà et là ; mais ces ressources sont bien faibles et notre tâche eût été inexécutable sans les matériaux amassés avec tant de patience par M. Icazbalceta et qu’on aurait vainement essayé de se procurer en Europe, sans ces notes qu’on nous excusera de louer encore et dont plusieurs sont de véritables monographies. Nous n’avons eu qu’à faire notre choix parmi tant de richesses.
Avant la fondation de l’université, il y avait à Mexico des écoles religieuses ou laïques, mais il va sans dire que les premières étaient de beaucoup les plus importantes. Chaque couvent, selon l’usage, avait sa bibliothèque et son école, où des maîtres souvent distingués enseignaient les novices. Or, le premier de ces couvents était déjà bâti en 1525, quatre ans après la conquête[313], quand il y avait à peine dans le nouveau Mexico (l’ancien ayant été détruit) cent cinquante maisons espagnoles[314], comme perdues dans l’espace compris par le plan. Le castillan Bustamente, qui fut plus tard professeur à l’université, commença par enseigner la grammaire chez les dominicains, en 1533[315].
En dehors des novices, les fils des Indiens furent le premier objet de la sollicitude des religieux. C’est aux franciscains que revient l’honneur de s’être consacrés à leur instruction. Il ne faut pas juger de la situation qu’on fit d’abord aux indigènes par ce qui se passa plus tard, un demi-siècle environ après la conquête, lorsqu’on leur refusa, peu s’en faut, la qualité d’hommes. Déjà en 1540, on se demandait s’il était convenable de les faire participer à l’Eucharistie[316] : à cause de leur stupidité et de leur penchant à l’ivrognerie on refusait de les ordonner prêtres, et au xviiie siècle[317] il fut question d’établir un collége pour eux seuls dans la Nouvelle-Espagne, puisqu’ils n’étaient admis ni dans les séminaires, ni dans les colléges. Mais cette exclusion systématique n’avait pas lieu dans les premiers temps. Si les fils des Indiens ne furent pas élevés avec ceux des conquérants, les franciscains créèrent pour eux, dans leurs couvents ou dans le voisinage, des écoles et des colléges. Leur charité contraste avec la brutale avidité des aventuriers. Pour eux le nouveau monde est une vaste province des États du démon, et ils travaillent de tout leur cœur à la lui arracher. La docilité des Indiens, leur admiration enfantine pour les pompes du culte avaient charmé les religieux. Ils s’étaient établis leurs protecteurs et leurs professeurs autant que leurs missionnaires, et leur enseignaient la langue latine. Ce n’était pas seulement pour en faire de bons catholiques : toutes les fois qu’ils rencontraient un sujet intelligent ils lui communiquaient ce qu’ils savaient eux-mêmes et n’éprouvaient aucun scrupule à en faire leur égal.
A peine arrivés à Mexico, les franciscains s’occupèrent d’apprendre à lire aux petits Indiens. A cet effet ils ajoutèrent à chacun de leurs couvents une grande salle destinée surtout aux fils des caciques. Ils les demandèrent à leurs parents, mais ceux-ci, craignant de les livrer et n’osant pas désobéir, envoyèrent souvent sous le nom de leurs fils ceux de leurs vassaux[318]. « Dieu fit, dit à ce sujet le père Mendieta, que croyant tromper ils furent joués par eux-mêmes, car ces plébéiens apprenant à lire et à écrire, devinrent d’habiles gens et furent plus tard alcades et gouverneurs de leurs anciens maîtres. » La plus fameuse de ces écoles fut celle de la chapelle de Saint-Joseph des naturels de Mexico, où un laïque, surnommé le père des Indiens, Pedro de Gante, leur enseignait non-seulement le catéchisme et la lecture, mais encore les arts libéraux.
Ces écoles d’Indiens remontent à l’année 1529, ou même à une époque antérieure. En 1537, don Antonio de Mendoza, premier vice-roi du Mexique, fonda chez les franciscains et fit inaugurer solennellement, non plus une modeste école, mais un véritable collége pour les indigènes[319], sans doute sur le modèle de ceux de l’Espagne, et qui renfermait un certain nombre de boursiers (colegiales). Le plus fameux d’entre ces derniers fut don Antonio Valeriano, fils d’un cacique et parent de Montezuma, qui fit de tels progrès qu’il succéda à ses maîtres dans la chaire de grammaire, ce qui veut dire non-seulement qu’il enseignait lès règles, mais qu’il expliquait aussi les auteurs[320]. On a de lui une épître latine : le père Fr. Jean-Baptiste assure qu’il était très-bon rhétoricien et qu’il parlait ex tempore avec tant de justesse et d’élégance, qu’on aurait dit un Cicéron. En 1554, nous le retrouvons dans le second des grands dialogues de Cervantes. « Au nord est un couvent de franciscains, et dans son enceinte le collége des Indiens qui apprennent à lire et à écrire en latin. Ils ont un maître de leur race, Antonius Valerianus, qui ne le cède à aucun de nos grammairiens : convenablement instruit dans notre foi, il est passionné pour l’éloquence[321]. » Croyait-on que la Renaissance s’était étendue jusque chez les Indiens, et que la conversation en langue latine, qui fait le sujet de cet ouvrage, comprendrait ceux qui n’avaient connu dans leur enfance que l’idiome de Montezuma ? Cet exemple est un de ceux qui prouvent le mieux qu’à cette époque primitive, le mérite faisait sortir les Indiens de leur caste. Valerianus, puisqu’on ne le connaît que sous son nom espagnol ou latin, fut plus tard gouverneur des Indiens de Mexico[322] et dut habiter, en cette qualité, le magnifique palais réservé à sa dignité et dont parle Cervantes[323]. Certes, ces quelques marques de justice ne doivent pas diminuer notre horreur pour les tortures que subirent trop souvent les vaincus, mais il est bon de remarquer ce que fit pour eux un vice-roi qui suivait d’ailleurs la politique et les constantes recommandations de la cour d’Espagne : le gouvernement s’unissait aux moines pour communiquer aux Indiens toutes les lumières de l’intelligence, je veux dire ce qu’en possédaient les Espagnols au xvie siècle.
Sa sollicitude alla plus loin. Une classe encore plus malheureuse que celle des indigènes la réclamait. Mais laissons la parole aux personnages de Cervantes :
« En face est le collége des métis, sous le patronage des deux Saint-Jean. — De quels métis me parles-tu ? — Des Hispano-Indiens. — Explique-toi plus clairement. — Des orphelins nés de pères espagnols et de mères indiennes. — Que font-ils enfermés dans ce lieu ? — Ils lisent et écrivent, et, ce qui vaut mieux, on les instruit dans la foi chrétienne. Ils marchent deux à deux en robes longues et plus souvent quatre à quatre, parce qu’ils sont petits. — Devenus grands, que feront-ils ? — Les plus intelligents étudient les arts libéraux, les autres apprennent un métier ; de façon que, leur vertu croissant avec l’âge, ils ne puissent être entraînés au mal que par la violence. — C’est bien servir l’État que d’élever ainsi les enfants en les affermissant de bonne heure dans la vertu, avec tant de force qu’il leur sera impossible de l’abandonner[324]. »
C’est aussi chez les franciscains qu’avait été fondé ce second collége, par le vice-roi don Antonio de Mendoza, pour remédier à un mal contre lequel la cour de Madrid ne cessait de s’élever. Les fils illégitimes des Espagnols et des Indiennes, auxquels on n’avait fait aucune attention dans les premières années, finirent par ouvrir le pays, bien qu’il en pérît un grand nombre par la main même des mères, qui étaient trop pauvres pour les nourrir. Souvent le roi donna ordre de leur ouvrir un asile, ainsi qu’à ces malheureuses femmes ; enfin, l’infirmerie indienne de Saint-Jean de Latran, que les franciscains avaient créée, fut transformée en un collége de métis, qu’on dota richement, car le roi lui accorda, en 1548, la moitié du gros et menu bétail errant et, en 1552, une rente de six cents écus d’or[325]. On espérait que les meilleurs élèves, devenus maîtres, iraient fonder d’autres colléges dans les différentes parties de la Nouvelle-Espagne, et l’on donnait ainsi à la maison mère le caractère d’une école normale. Cet établissement a subsisté, avec des fortunes diverses, jusqu’au commencement du siècle actuel.
N’oublions pas le collége de la Conception, pour les métisses, puisque Cervantes en dit quelques mots. Il était doté avec l’autre moitié des troupeaux errants. Là, ces jeunes filles apprenaient à coudre et à broder, mais non pour entrer plus tard dans un cloître, car dès qu’elles étaient arrivées à l’âge nubile on les mariait. Ubi ad annos nubiles pervenere maritis copulantur[326]. La politique royale paraît à cette époque sage et habile jusque dans les moindres détails.
Pour compléter le tableau des établissements religieux de la Nouvelle-Espagne, nous devrions sortir de Mexico et signaler l’école que les augustins avaient fondée, en 1540, pour leurs religieux, à Tiripitio (Michoacan). Les augustins, venus après les dominicains et les franciscains (1533), semblent avoir possédé un plus grand nombre d’hommes distingués. Le fameux fray Luis de Léon[327], qui professa avec tant d’éclat à Salamanque à partir de 1561, n’était-il pas aussi augustin ? C’est à Salamanque même que le P. François de la Cruz, provincial des augustins du Mexique, alla chercher, en 1535, un maître ès arts en théologie. Il avait fait exprès dans cette intention le voyage d’Espagne : il jeta les yeux sur un des plus fameux professeurs de l’antique université, Alonzo Guttierez, et l’enleva, pour ainsi dire, d’autorité. Il le rattacha à son ordre pendant le voyage, et Guttierez devint le père Alonzo de Vera-Cruz qui, nommé à son tour provincial, fonda le collége de Saint-Paul, qu’il enrichit d’une vaste bibliothèque, de cartes, de globes et d’instruments scientifiques. Cervantes nous fera faire plus ample connaissance avec cet homme remarquable.
A côté des puissantes corporations religieuses qui se recrutaient incessamment dans la mère patrie, qui avaient à leur service des tribus entières pour la construction de leurs couvents ou de leurs colléges, et qui recevaient, comme vivant d’aumônes, une large part du produit des mines d’or, l’élément laïque ne pouvait être que faible et subordonné. On voit cependant qu’en 1536 un grammairien était entretenu aux frais du gouvernement, et, un peu plus tard, du temps de Cervantes, un autre maître récemment arrivé d’Espagne, Diego Diaz, n’avait pas hésité à ouvrir une école particulière. Il expliquait les auteurs : passionné pour les lettres, il semblait devoir rendre à la jeunesse d’utiles services, si l’on en croit notre auteur[328], dont il s’était peut-être fait bien venir par des flatteries. On finit par lui ordonner de cesser son cours ou de venir le faire dans l’université. D’autres professeurs encore avaient tenté des essais plus ou moins heureux, mais les avaient abandonnés pour des raisons que nous ignorons.
On voit qu’il ne manquait pas à Mexico d’hommes distingués et capables de remplir les chaires d’une université espagnole. Le clergé, par la force des choses, devait occuper les plus importantes et dominer sur le reste. Dans de telles circonstances, la fondation d’une université ne pouvait qu’être agréable à l’empereur et au vice-roi : d’ailleurs le temps n’était plus où de telles institutions jouissaient d’un pouvoir dangereux pour l’État ; maintenant, on avait soin, en les créant et tout en leur accordant des privilèges, de mettre leur organisation en harmonie avec la prépondérance de l’autorité royale ; de plus, le clergé mexicain, grâce au politique Ferdinand X et à l’imprévoyante complaisance des papes Alexandre II et Jules II, dépendait entièrement de la cour d’Espagne[329]. Ce n’est pas à Rome, mais à Madrid et partout où siégeait le Conseil des Indes, que les affaires ecclésiastiques étaient débattues et réglées[330]. Par toutes ces raisons, le pouvoir civil ne pouvait que favoriser la création d’un grand centre d’enseignement à Mexico. D’ailleurs, la Nouvelle-Espagne était alors comme un véritable prolongement de la patrie européenne. A cette heure indécise, on ne la considérait pas encore comme une ferme dont il fallait tirer le plus grand profit, au risque de l’appauvrir jusqu’à l’épuiser.
La ville désirait une université, aussi bien pour les naturels que pour les fils des Espagnols. Les prélats et les religieux appuyèrent sa demande ; on croyait généralement qu’il viendrait un temps où la jeune colonie tirerait d’elle-même ce qui constitue une grande partie de la vitalité d’un État, c’est-à-dire l’instruction publique. Le vice-roi Mendoce, dont nous avons déjà fait connaître les louables tendances, s’empressa d’organiser des cours provisoires, et les dota avec les revenus d’un certain nombre d’estancias qui étaient sa propriété particulière.
En ce pays de pâturages, les troupeaux jouent un rôle important dans les fondations. En 1551 arriva l’autorisation de Charles-Quint avec une dotation de mille écus par an en sus du produit des estancias. Mendoce était devenu vice-roi du Pérou ; c’est à son successeur, don Luis Velasco, que revint l’honneur d’inaugurer l’université. Elle était gratifiée des mêmes privilèges que celle de Salamanque, sur le modèle de laquelle elle avait été créée ; un peu plus tard, le saint-siége lui accorda le titre de pontificale.
Le 25 janvier 1553, elle fut solennellement créée en l’église de Saint-Paul, devant le vice-roi, l’audience, les tribunaux et les moines des divers ordres. Un recteur et un écolâtre ou chancelier (maestrescuelas) furent nommés ; je remarque que l’université ne fut point divisée en facultés, mais, comme cela se pratiquait à Salamanque, les chaires différentes furent groupées dans un même centre : ni la considération ni les traitements n’étaient égaux. Après le recteur et le chancelier, on nomma des professeurs de théologie, d’Écriture sainte, de droit canon, de décrets, d’institutes, des arts ou de philosophie, de rhétorique et de grammaire. Le professeur de rhétorique fut notre Cervantes. L’Écriture sainte était expliquée par l’augustin fray Alonzo de Vera-Cruz ; la théologie enseignée par un dominicain, la philosophie par un prêtre. Au sortir de l’église, le nouveau corps se dirigea vers la maison qui devait lui servir de demeure, avec une brillante procession qui comprenait le vice-roi, les tribunaux, les religieux, les lettrés de la ville et les députations des peuples voisins. Les cours ne s’ouvrirent que l’un après l’autre, car le vice-roi et l’audience assistèrent à chaque première leçon. L’union des pouvoirs civil, ecclésiastique et universitaire ne pouvait être plus étroite, chacun se tenant à sa place dans l’ordre que je viens de suivre en les nommant. Les réunions des professeurs eurent lieu d’abord au palais du vice-roi, puis dans une église, non dans une église particulière, qui aurait été leur Saint-Julien le Pauvre ou leurs Mathurins[331], mais dans la salle capitulaire de la cathédrale.
On voudrait maintenant connaître les méthodes, les livres de classe, l’esprit de l’enseignement. L’éditeur de Cervantes n’a pas songé à éclaircir ces derniers points. Cervantes lui-même ne donne que de rares indications. Il est plus pressé de se plaindre de la médiocrité des salaires, ou de vanter la magnificence du bâtiment, ou de passer en revue ses collègues, avec un compliment pour chacun d’eux. C’est surtout ici qu’il faut regretter la légèreté ou la timidité de son esprit.
Les interlocuteurs de son premier grand dialogue sont Meta et Gutierrez. Ce dernier a traversé, dit-il, l’immense Océan, non pour s’enrichir comme tant d’autres, mais pour voir des choses nouvelles. C’est ce qu’il appelle être sage, car, sur l’autorité d’Aristote, il définit la sagesse : la connaissance d’objets nombreux et importants. « Quel est, demande-t-il, cet édifice percé de nombreuses fenêtres où entrent tant de jeunes gens en manteau long, et coiffés de bonnets carrés qui leur descendent jusqu’aux oreilles ? »
Eh ! que nous importent l’aspect et la distribution de l’édifice ? A peine est-il plus utile de savoir que les maîtres touchaient les uns deux cents, les autres trois cents écus d’or, et que cette somme était médiocre dans un pays où tout était fort cher, où l’or n’avait que la valeur de l’argent en Espagne, et où manquait la monnaie de cuivre. Heureux ceux que César favorisera de dignités ecclésiastiques ! La grammaire occupe le rez-de-chaussée. Au premier étage voici la salle où le maître ès arts Garcias, le prêtre dont nous avons parlé, enseigne deux fois par jour la philosophie, c’est-à-dire la dialectique. Ici Barland mourrait d’ennui, non moins qu’à Louvain. Sans doute les auteurs classiques, sévèrement choisis, ont pris la place qui leur est due ; les citations de Cervantes le montrent assez ; mais la scolastique règne dans la région supérieure qui lui a été assignée. Ce n’est pas ici que la pensée fera son séjour. « Bon Dieu, dit Gutierrez, avec quels cris et quels gestes ce gros écolier dispute contre ce maigre ! Vois comme il le presse et comme il l’accable ! — L’autre en fait autant et résiste de toutes ses forces : cependant tous deux discutent pour un fétu quoiqu’ils aient l’air de s’occuper d’un sujet important[332]. » Cervantes a beau se moquer, il n’y peut rien, et aujourd’hui encore on importe des ballots de livres de scolastique au Mexique.
Voici une quantité d’augustins et de prêtres : ils entrent dans l’auditoire de théologie pour entendre le père Vera-Cruz, qui lui, du moins, rendons-lui cette justice, nourrissait quelquefois les étudiants d’une viande plus solide : en effet, s’il leur commentait le livre des Sentences, il a laissé un cours manuscrit sur les épîtres de saint Paul.
Le décret est enseigné de manière à aiguiser l’esprit et à lui donner de la subtilité plutôt que de la justesse. « De dix à onze heures, le docteur Arevalo Sedeno éclairait les décrets des pontifes. Dans les sujets stériles il est abondant, et dans les fertiles, concis. Prompt à citer, subtil à induire, il tend des pièges et enseigne à les éviter. » Gutierrez l’avait déjà entendu à Salamanque.
Saluons en passant don Juan Negrete, d’une érudition universelle et maître ès arts de la faculté de Paris. Le bedeau, tête nue, vient annoncer au professeur de théologie que le lendemain, qui est un jeudi, sera jour de congé, parce qu’il n’y a pas eu de fête pendant la semaine. « Que contient ce papier affiché à la porte ? — Des thèses de physique et de théologie, les unes douteuses, les autres affirmatives, les autres négatives, qui, suivant l’indication que vous pouvez lire, seront soutenues et attaquées dans cet auditoire, mardi, c’est-à-dire le troisième jour de fête, comme disent les écoliers[333]. »
Le dialogue se termine par une description de l’université de Salamanque que fait à son tour Gutierrez.
Nous avons rendu justice au zèle et à la charité des moines, à l’ardeur de la ville de Mexico pour faire instruire ses citoyens, au bon vouloir de l’empereur et du vice-roi pour satisfaire ce désir ; nous en serons plus à l’aise pour ajouter que, sous le contrôle de l’inquisition, aucune liberté n’étant laissée à la pensée, et les plus orthodoxes eux-mêmes[334] tremblant à tout instant d’avoir admis sans le savoir une proposition hérétique, tant de bon vouloir devait rester stérile. Sauf une culture littéraire que nous ne pouvons qu’entrevoir, mais dont on peut juger par la condamnation que Motta porte en Espagne sur Térence, et par la rudesse du style de Cervantes, la mémoire seule avec le talent de jouter en syllogismes étaient exercés. M. Icazbalceta, ce chaud partisan du passé, ne nous démentira pas, car pour défendre notre affirmation nous nous servirons des armes que sa science nous fournit contre lui. Après avoir loué les élèves de cette université, exalté les hommes de mérite qu’elle aurait produits, que trouve-t-il quand il en faut venir aux exemples ? Quels sont enfin ces hommes rares qu’il offre à notre admiration ? Des bacheliers de douze à quatorze ans, des candidats aux chaires qui n’ont pas atteint leur quinzième année et qui, dit-il, enseignaient magistralement. Je le crois bien, ils répétaient en perfection. Je veux que Solis ait été à treize ans bachelier en droit canon et ès lois, qu’il ait été, l’année suivante, reçu avocat de l’audience royale et qu’il ait aussitôt rempli une charge de rapporteur. Je consens qu’il ait été à seize ans et demi licencié et docteur en droit canon. Je demande quelle idée nouvelle ce prodige de précocité a apportée au trésor de l’humanité, et comment, arrivé à l’âge d’homme, il a tenu la promesse de ses éclatants débuts. N’a-t-il pas plutôt ressemblé à ces Moresques, mères à douze ans et vieilles à vingt, ce qui dénote une race inférieure, une sorte d’éphémères humains ? Vous m’opposez encore cet aveugle qui conquit tous ses grades, qui citait avec indication de la page, et qui, à dix-neuf ans, concourut pour une chaire de philosophie, de laquelle il fut jugé digne. Vous ajoutez le cas encore plus extraordinaire d’Antonio Calderon, qui vendait un livre aussitôt après l’avoir lu, car il pouvait le réciter d’un bout à l’autre. Je ne puis qu’être attristé et effrayé de l’importance qu’on donnait à la mémoire, cette qualité subalterne, qui tend à réduire l’esprit en habitudes et à tuer le jugement. Vos hommes distingués récitaient trop pour avoir le temps de penser. Quant au dominicain Naranjo que vous avez gardé pour le dernier, il semble échapper à la loi commune : en effet, celui-là ne récitait pas, il composait. Il dictait d’abondance, en séance publique, à quatre secrétaires, et quand il s’était arrêté, au bout d’une heure, vérification faite, on trouvait qu’il avait composé quatre dissertations irréprochables, chacune sur un sujet différent. Est-il bien vrai qu’ici la mémoire n’avait rien à faire ? qu’il y avait dans une seule de ces quatre dissertations quelque vérité originale, autre chose que des groupes d’idées ou de mots, déjà fortement enchaînés depuis longtemps dans le cerveau plutôt que dans l’esprit ? Je vois des machines qui transmettent avec fidélité le mouvement, de génération en génération : je cherche en vain ce qui constitue la dignité de l’homme. L’université de Mexico resta deux cents ans sans bibliothèque.... sans doute ses élèves se contentaient de leurs cahiers.
Si curieux que soient les deux derniers dialogues de Cervantes, on n’attend pas que nous nous engagions à sa suite dans les rues de Mexico, et que nous fassions aussitôt après une promenade à Chapultepec. Les maisons des quinze cents Espagnols, entourées à distance respectueuse par les demeures de trois cent mille Indiens, sont fortifiées et garnies de tours : le palais archiépiscopal et celui du vice-roi présentent l’aspect de vastes citadelles, les canaux dont la ville est sillonnée servent de fossés. Nos interlocuteurs passent devant un édifice d’où il sort de grands cris : c’est l’université. Plus loin, ils pénètrent dans la salle d’audience où le vice-roi rend la justice, assisté de quatre oïdors, de l’avocat des pauvres et du protecteur des Indiens. Plus loin encore, c’est le marché des indigènes. Que de denrées et de plantes inconnues ! La monnaie est le gland de cacao ; elle a l’avantage d’être comestible. Cette maison appartient à Castanède, un des conquérants, cette autre au médecin Lopez, cette autre à dona Marina, la fameuse Indienne qui servit d’interprète à Fernand Cortez et qui lui donna un fils, don Martin, lequel est pour le moment en Espagne. Ici c’est le palais du riche Villaseca, aux grandes portes garnies d’anneaux d’or.
A Chapultepec, si nous gravissions la colline, nous remarquerions ces larges marches de pierre, sorte d’escaliers des géants, autrefois remparts circulaires construits par les Mexicains pour se fortifier à leur arrivée dans le pays, plus tard jardins délicieux, lorsque le premier Mexico fut bâti et que Chapultepec devint un lieu de plaisance. Les empereurs avaient accompli ce changement en faisant remplir de terre les intervalles entre les murs. Plus tard encore, les eaux et les éboulements détruisirent ce qu’on admirait du temps de Cervantes. Cette colline n’était pas la plus haute des environs. D’autres la dépassaient, élevées par la main des hommes. C’étaient les teocallis. « A leurs sommets, qui se terminaient en plateaux, on arrivait par un escalier de pierre ; et là, comme des troupeaux à la boucherie, hommes et femmes étaient offerts en sacrifice aux idoles après qu’on leur avait arraché le cœur. Ce qui se renouvelait non-seulement tous les ans, mais tous les mois, et ces cérémonies ont coûté la vie à d’innombrables milliers d’hommes. — Heureux donc les Indiens de l’arrivée des Espagnols, qui d’une telle servitude les ont fait passer à la véritable liberté ! »
Le dialogue se termine par la description des environs de Mexico vus du sommet de la colline et par quelques pages sur les mœurs des Indiens. Ce n’est plus un guide de la conversation, mais des lieux eux-mêmes, et que les notes de M. Icazbalceta expliquent ou complètent admirablement. Il suffit de le signaler, ainsi amendé, à l’attention des historiens. Nos dialogues ont pris ici une importance spéciale que nous devions nous borner à indiquer. Aussi bien nous tarde-t-il de quitter ces descriptions brillantes, mais tout en surface, pour arriver au dernier auteur qui a ramené les colloques à des proportions plus humbles mais plus utiles. Mosellanus a été le commencement, Cordier sera le terme de notre ouvrage, et après avoir débuté par l’ardeur du premier, on se reposera avec la candeur et le dévouement du second, qui n’a pas vécu seulement quelques années, mais qui a donné jusqu’à la plus longue vieillesse le spectacle d’une belle âme, et dont les ouvrages n’ont pas entièrement cessé d’être classiques.
|
Voir plus bas. |
|
On se souvient que c’est le titre des Dialogues de Vivès. |
|
Mexico en 1554. — Tres dialogos latinos que Francisco Cervantes Salazar escribió è imprimió en México en dicho año. Los reimprime, con traducion castellana y notas, Joaquin Garcia Icazbalceta, etc. Mexico, 1875, grand in-8º. |
|
Colecion de documentos para la historia de México. Mexico, 1858-1865, 2 vol. in-4º. Historia ecclesiastica indiana. Obra escrita a fines del siglo XVI por Fr. Gerónimo de Mendieta. La publica por primera vez Joaquin, etc. Mexico, 1870, un vol. in-4º. |
|
Francisci Cervantis Toletani, ad Ludovici Vives Valentini exercitationem, aliquot dialogi, 1554. — C’est le titre de la seconde partie du livre. Le titre de la première qui contient les commentaires, manque. Mais on sait que l’ouvrage a été imprimé par Jean-Paul de Brescia, qui le présente lui-mème au lecteur dans une courte épître. |
|
Voir la trad. Magnabal, vol. II, p. 71. |
|
Ticknor, qui ne connaît que cette partie de l’œuvre de Salazar, l’appelle un écrivain d’une vaste érudition et dit de son style qu’il est pur et élevé. Trad. Magnabal, II, p. 69. |
|
« Elucidationes, quas olim in Vivem, quum agerem in Hispania, composueram, una cum aliquot dialogia. » (Dédicace des dialogues de Cervantes à l’Université de Mexico. Mexico, en 1554, p. 19). |
|
Voir la citation latine dans Mex., p. 20. |
|
Il y a un dialogue sur le même sujet dans Schottennius. |
|
Voir Robertson, Hist. d’Amérique, livre v. |
|
Le Dialogue sur la dignité de l’homme, en 1546. |
|
D’après la lettre de l’archevêque Moya, citée p. 19, de Mexico en 1554. |
|
Mexico, etc., p. xiv. |
|
Id., p. xl. |
|
Id., ibid. |
|
En lui dédiant ses Dialogues. |
|
Voir Robertson, Hist. d’Amérique. |
|
Mexico, etc. |
|
Mexico, etc., p. 50, d’après la chronique manuscrite de l’université, par Plaza. |
|
Robertson, Hist. d’Amérique. |
|
Id. |
|
Mexico, etc., p. 231, d’après le P. Mendieta, Historia eclesiastica indiana, lib. III, cap. xv. |
|
C’est le collége de Tlaltelcolo. (Voir Mexico, etc., p. 7, 150 et 242). |
|
Mexico, p. 242. |
|
Ad septentrionem, Franciscanorum positum est monasterium et in ipso, Indorum collegium, qui latine loqui et scribere dicentur. Magistrum habent ejusdem nationis, Antonium Valerianum, nostris grammaticis nequaquam inferiorem, in legis christianæ observatione satis doctum et ad eloquentiam avidissimum, p. 150. |
|
Page 242. |
|
« Eorumdem gubernatoris quem ipsi cacique vocant, permagnifice erectæ sunt ædes ». (2e dialogue, p. 150.) |
|
Dialogue ii, p. 132-134. |
|
Comme nous tirons tous ces détails des introductions et des notes de M. Icazbalceta, il nous paraît inutile de renvoyer dorénavant à telle ou telle page de son livre. |
|
Dialogue ii. |
|
Voir Histoire de la litt. espagnole de Ticknor. |
|
Dialogue i. |
|
Voir Robertson, Hist. d’Amér., livre VIII. |
|
Id. Ibid. |
|
On sait que c’étaient les églises où se réunissait plus particulièrement l’Université de Paris. |
|
Dialogue i. |
|
Dialogue i. |
|
P. ex. le père Alonzo de Vera-Cruz, qui fut un moment suspect. |
TROISIÈME SECTION
FRANCE ET SUISSE
Nous avons vu les colloques naître en Allemagne, se développer dans les Pays-Bas et passer l’Océan pour donner à Mexico des fruits exotiques sous l’influence du nom de Vivès. La France est le seul pays où les nécessités de notre travail ne nous aient pas encore conduits : c’est à peine si nous avons entrevu de loin, dans une ou deux occasions, l’Université de Paris, qui était cependant la mère de presque toutes les autres ou leur modèle. Est-ce que la langue latine aurait été familière à ses nourrissons au point de leur rendre la sollicitude des maîtres inutile ? Il s’en faut de beaucoup. En 1530, les écoliers de Paris, au rapport d’un maître qui les connaissait depuis longtemps[335], « bavardaient toujours en français avec leurs camarades, ou, s’ils essayaient de parler latin, il leur était impossible de dire trois mots de suite, et ils s’en tiraient si grossièrement et si sottement qu’ils auraient beaucoup mieux fait de se taire. » Pendant ce temps le même témoin voyait tous les jours « des enfants des pays étrangers, même ceux qui avaient été élevés dans des hameaux rustiques et qu’on avait envoyés dans notre académie, converser avec facilité et élégance, même avec les hommes les plus savants[336]. » Il n’est pas difficile de découvrir les causes de l’infériorité des Français.
D’abord l’Université de Paris, précisément à cause de son antiquité et de sa célébrité, restait enchaînée à ses traditions. Le latin du moyen âge était chez elle une langue officielle qui semblait faire partie de son patrimoine et même de son caractère : on le retrouvait journellement dans les actes, dans les harangues et dans ces délibérations dont le style nous paraît si étrange quand nous le lisons dans le grand ouvrage de du Boulay. Celui qui aurait fait des changements à ce style aurait paru aussi audacieux que le clerc qui s’aviserait aujourd’hui de remplacer, dans un acte, la langue judiciaire par celle de Bossuet ou de Racine.
De plus, la logique était la fin et le but des études dans la faculté des arts. A quoi bon apprendre des tours élégants, puisqu’il faudrait bientôt s’en défaire pour passer trois ou quatre ans à disputer dans la langue nécessairement toute différente de la dialectique ? Or, on sait combien fut long le règne de la dialectique dans l’Université de Paris. Les colonies de cette antique métropole, chez lesquelles le nouvel esprit avait pénétré, ne la regardaient qu’avec une sorte de crainte et d’horreur. « On dispute avant le dîner, écrivait Vivès en 1531, on dispute pendant le dîner, on dispute après dîner : on dispute en public, en particulier ; en tout lieu, en tout temps[337]. » C’est seulement en 1534 que les maîtres ès arts, qui enseignaient la grammaire et les lettres, furent admis à la participation des privilèges accordés aux régents[338]. Mais même alors la dialectique continua à posséder la prépondérance. C’est en vain qu’en 1545 une vigoureuse tentative sera faite par le recteur pour réduire de trois ans et demi à deux ans et demi ce qu’on appelait le cours de philosophie ; cette réforme n’eut lieu qu’en 1600 avec beaucoup d’autres[339]. En attendant, les nouvelles études étaient méprisées par beaucoup de théologiens et de maîtres ès arts, qui les confondaient sous la dénomination méprisante de grammaire. Bon grammairien, mauvais logicien, c’était leur maxime[340]. C’est dans la faculté de théologie que la résistance se concentra. La Sorbonne resta longtemps redoutable dans sa lente décadence[341].
Des maîtres graves et instruits, dont la longue vie eût été consacrée à l’éducation de la jeunesse, auraient pu, lorsque les lettres furent décidément en faveur, les propager chez leurs élèves ; mais c’était également une tradition que les maîtres fussent jeunes et de passage : tout en donnant leurs leçons, ils étudiaient ou la théologie qui leur promettait de fructueux canonicats, ou, plus modestement, la médecine : quelques-uns visaient à enseigner un jour la dialectique. Quant aux professeurs étrangers, ils ne restaient pas davantage ; une fois en réputation, les rois les appelaient pour leur confier l’éducation de leurs enfants ou la fondation d’universités nationales, ou même des postes d’hommes d’État. C’est ce qu’on voit par l’exemple d’André de Gouvéa et de Buchanan.
Cependant si jamais des maîtres d’une grande autorité morale furent nécessaires, c’est surtout à cette jeunesse si nombreuse, si turbulente, venue de toutes les parties de l’Europe, où se confondaient tant de langues et où le caractère français, agissant surtout comme un ferment d’indépendance, exerçait, par exemple dans le domaine du langage officiel, une influence délétère. Avec la netteté de leur esprit, les écoliers français donnaient un tour analytique aux phrases latines : d’ailleurs, la facilité qu’ils avaient à apprendre le latin dont leur idiome était sorti, avait des résultats funestes, tandis que les Allemands s’y étaient appliqués de tout leur pouvoir comme à une langue entièrement étrangère et très-difficile. Enfin, souvenons-nous qu’en 1530, tandis que la littérature allemande commençait à peine, nous avions eu Villon et Gringoire ; le talent de Marot brillait dans tout son éclat, et Pantagruel allait paraître. La langue française commençait à évincer le latin dans les cours étrangères : les apologies de Henri Estienne et de du Bellay étaient en germe dans beaucoup d’esprits. Le moment de l’émancipation définitive de notre langue approchait. C’est ce que sentaient obscurément les écoliers. Ils n’auraient pas voulu converser dans une langue qui tombait peu à peu au rang de langue morte. Puisqu’on les y force, ils la dénaturent, ils en font un idiome étrange, un nouveau roman qu’on peut étudier, car il a été recueilli avec patience dans les cours du collége de Navarre par un ennemi qui voulait le faire disparaître et qui l’a précisément conservé à notre curiosité, par notre Cordier, l’auteur du De corrupti sermonis emendatione (1530), et des derniers colloques[342] du xvie siècle (1564).
Nous ne pouvons signaler ce jargon des écoliers qu’en passant ; il est précieux, car il montre l’instinct du langage se faisant jour avec violence, s’emparant des matériaux qu’on veut lui imposer et qui le gênent, pour les dénaturer ; employant ici les termes de l’idiome maternel, comme il fallait s’y attendre, là, les ressources de la métaphore, et même du jeu de mots : au fond de cette source trouble mais jaillissante on pourrait aussi recueillir non des richesses ignorées mais des débris de la langue française du xvie siècle qui s’y sont déposés et comme envasés et ne sont pas arrivés jusqu’à nous.
Je ne relèverai pas le simple latin de cuisine : parvus garsonus bavat super sese ; capis me pro uno alio : vadamus ad pormenandum nos : ego bibi unum magnum vitrum totum plenum de vino ; ego mallem quod tu esses crepatus ; locutions prises au hasard entre beaucoup d’autres de même nature. Je pourrais remarquer un certain nombre de termes qui se retrouvent dans du Cange et dont la plupart étaient peut-être des restes du dialecte des écoliers du moyen âge, comme adventura (ego posui me ad adventuram); advisare (quo modo potuisti te advisare de uno tam stulto proposito ?) processus (amisit suum processum); caphardus dont l’origine est inconnue mais que nous trouvons employé au xvie siècle par d’Aubigné et Ronsard[343] ; Bigotia, qui paraît remonter au xiie siècle[344] ; Bragare (bragat se vel facit morguentam) que du Cange a trouvé dans les sermons de Ménot, etc.[345].
D’autres termes dont l’origine est entièrement inconnue resteraient même inexpliqués sans le contexte ou sans la traduction de celui qui les a recueillis. Qui se douterait que arrachare et moulare signifient être battu ? tu bene arrachavisti. Non solum arrachavit sed etiam moulavit[346] ; que chifrare c’est dérober et dechifrare, recouvrer ? (Chifravit unum dimidium panis. — Chifravit totam epistolam super Ciceronem. Volo me dechifrare[347]). De là était venu le mot français chifrer employé dans le même sens.
Comment habeo antipodium pouvait-il signifier j’ai le premier rang ? On comprend que l’harmonie imitative ait fait imaginer bombycinium pour poitrine et la ressemblance des sons tortillon pour tort (tu habes tortillon). Un jeu de mots donnait Ovidius pour os vide : on devine le sens de trousquinare (faire déshabiller un écolier pour le fouetter); faciemus hodie bonum cherubim, nous ferons aujourd’hui bombance, s’entend de reste ; mais mittere ad galathas[348] est tout à fait obscur, à moins que par un autre calembour il ne s’agisse de galetas[349].
Tel était, avec une abondance dont ces quelques échantillons ne peuvent donner l’idée, le jargon des écoliers de tous les colléges quand parut, au mois d’octobre 1530, le livre destiné à le purifier, ouvrage remarquable par le bon sens non moins que par le savoir de l’auteur et qu’on doit signaler avec d’autant plus de soin qu’il est à peu près le seul qui ait été publié dans cette intention par un Français[350]. Cordier connaissait trop le caractère national pour commencer par écrire des colloques qui n’auraient pas eu prise sur cette turbulente jeunesse et qui eussent été un sujet de moqueries. Il aima mieux aller droit au fait. On avait besoin de phrases au dortoir, au réfectoire, dans les classes, pour les jeux, pour les mille circonstances de la vie d’écolier, il en fit un recueil avec des variantes élégantes suivant la coutume de l’époque, et les disposa par chapitres, chacun avec son titre bien net, afin qu’on pût trouver rapidement dans cette sorte de magasin ce dont on avait besoin. Notre professeur fit plus ; à l’exemple de Guy de Fontenay[351], il traduisit en français les phrases latines qu’il donnait comme modèles[352]. Son livre devint aussitôt classique[353] : les maîtres s’en servirent par toute la France, et les Allemands le traduisirent pour leurs écoles (en 1537).
Il semble même que cet ouvrage ait ouvert la porte aux dialogues qui venaient de l’Allemagne et de la Flandre. Sans doute les écoliers originaires de ces contrées apportaient souvent avec eux des exemplaires des colloques de Mosellanus ou de Barland, mais à partir de 1530 des éditions en sont publiées à Paris même, soit par des libraires étrangers établis en France, soit par des libraires français. C’est ainsi qu’en 1535 Wechel donne à la fois la Pédologie de Mosellanus et les dialogues de Barland. En 1539, c’est à Paris que s’impriment pour la première fois les dialogues de Vivès. L’année suivante paraissent ceux de Jonas le Philologue, chez Colinæus. Le chemin est frayé ; quand Cordier voudra à son tour composer des colloques, il n’aura plus à craindre qu’ils soient mal reçus.
Cependant, si ses colloques parurent en France, ce n’est qu’au bout d’un temps très-long et après avoir été composés dans l’exil. Ils nous appartiennent, car ils ont été classiques dans toutes nos écoles pendant deux siècles et ils sont les seuls dont on se souvienne aujourd’hui en France : mais c’est à Genève qu’ils furent écrits, pour les écoliers du collége de la Rive, et il faut que leur mérite soit grand puisque, après avoir contribué à l’éducation des fils des proscrits, ils furent un siècle plus tard, sous Louis XIV, et quelque temps avant la révocation de l’édit de Nantes, dédiés à un abbé, fils d’un pair de France et neveu d’un évêque[354].
D’où vient cette singulière fortune ? Elle ne s’explique bien que par la vie de l’auteur. Nous devons donc la raconter, non-seulement parce qu’elle n’a été encore retracée que d’une manière incomplète[355] (et cependant il s’agit d’un Français qui honora son pays); non-seulement parce que dans sa très-longue durée elle est comme le vivant résumé de l’enseignement au xvie siècle, mais parce que n’ayant eu qu’un seul objet, « la piété lettrée, » elle trouva son complet épanouissement dans ce dernier livre, qui parut en 1564, l’année même de la mort de Cordier. Commençons donc par connaître de près cet homme dont la personne, aussi bien que les ouvrages, fut, en ce siècle de furieuses, divisions, réclamée par tous les partis, ce disciple de Calvin à qui Launoy[356] rend hommage et que du Boulay ne veut pas compter parmi les hérétiques[357].
Mathurin Cordier vécut sous sept rois. Sa carrière s’étend depuis le règne de Louis XI jusqu’au milieu du règne de Charles IX, depuis Villon jusqu’à Ronsard : il vit le moyen âge et les temps modernes, la barbarie et tous les triomphes de la Renaissance, la paisible domination du catholicisme et les conquêtes de Calvin. Disciple du réformateur de Genève, il l’avait eu jadis pour élève et put accompagner ses restes au cimetière de Plain-Palais. La vie de ce régent embrasse l’histoire du xvie siècle ; on pourrait presque dire qu’elle en est le tableau, si elle n’avait été si calme au dedans, malgré tant d’agitations à l’extérieur.
Il naquit en 1479[358], en Normandie, d’après Launoy[359], dans le Perche, si l’on en croit dom Liron[360]. La Croix du Maine, le plus ancien de ses biographes, laisse ce point incertain[361]. Comme les deux provinces se ressemblent beaucoup, la question est peu importante, même pour ceux qui aiment à tirer des inductions du milieu où leur héros a vécu.
Sa famille paraît avoir été pauvre, comme celle de tant d’autres étudiants[362]. Il nous apprend lui-même que les pompes et les enseignements de l’Église touchèrent son cœur dès la première enfance[363]. Alors déjà son âme paraissait ce qu’elle fut toujours, tendre et presque mystique. Mais en même temps (et qu’on rapproche si l’on veut ce fait de la grasse nature de sa terre natale), son esprit fut toujours ferme et raisonnable.
Il vint de bonne heure étudier à Paris[364]. C’était, comme nous le verrons bientôt, avec la pensée d’avoir plus tard une cure et de passer modestement sa vie au service de Dieu. Sur la botte de paille dont il fallait se pourvoir pour s’asseoir en classe, le jeune Mathurin fut heureux : ce n’est certes pas à son intention qu’on doubla au xve siècle la longueur du fouet, car, au rebours d’Érasme, il aime à se souvenir de ses premières années et parle de l’Université avec une aimable reconnaissance[365]. N’avait-il pas d’ailleurs ce qui donne du charme à la vie, un ami véritable ? C’est Claude Budin, qu’il ne quitta guère durant un demi-siècle. « De nostre jeune aage, dit-il, luy et moy avons toujours esté si bons amys et si familiers ensemble, que nous avions selon nostre pouvreté, et argent et livres, et aultres choses en commun[366]. »
A une époque incertaine, nous le retrouvons à Rouen, prêtre de l’église de Notre-Dame des Bonnes-Nouvelles[367]. On sait que la nation normande, qui avait le plus de bourses et de colléges, avait aussi un plus grand nombre de bénéfices à sa disposition. Jusqu’à présent la vie de Cordier est toute naturelle. Il n’agit pas autrement que les étudiants de sa nation. Mais comment se fait-il qu’en 1514[368] nous le revoyions à Paris, commençant sa longue carrière de professeur, pour ne l’abandonner que trois ou quatre jours avant sa mort ?
Nous sommes maintenant en présence d’un homme de trente-cinq ans, dont l’âge contraste déjà avec celui de ses jeunes collègues qui, comme nous l’avons déjà dit, ne traversaient l’enseignement que pour arriver à la théologie. Sa gravité et sa douceur se remarquent à côté de leur humeur bruyante et satirique qui en faisait plutôt des complices que des modérateurs dans les révoltes des écoliers[369]. Toujours il a le nom du Christ à la bouche[370] ; ses élèves le respectent autant qu’ils l’aiment. On le considère comme un de ceux qui font fleurir les belles-lettres : quelle différence pour la prose et les vers entre son style et celui de ses contemporains, de Ravisius Textor, par exemple ! En même temps, on le redoute comme le censeur des mauvaises mœurs[371]. S’il continuait à porter le costume ecclésiastique il n’en compromettait pas la dignité, comme ces diacres dont parle Sauval, qui couraient les rues.
Que s’est-il passé ? Pourquoi l’ancien prêtre a-t-il quitté Rouen ? Sentait-il qu’il servirait Dieu d’une manière plus efficace en contribuant, dans les colléges de Paris, à la réforme littéraire, dont il fut certainement un des promoteurs, puisque son style n’a rien gardé de la grossièreté du moyen âge et semble avoir été toujours nourri du plus pur froment de l’antiquité ? Venait-il simplement étudier en théologie pour arriver aux dignités ecclésiastiques ? Enfin, était-il poussé tantôt par l’un, tantôt par l’autre de ces deux motifs, peut-être sans les bien démêler, comme il arrive quand une vocation puissante s’ébauche longtemps avant de se manifester ? Cette dernière hypothèse est la plus plausible et les faits ne tarderont pas à lui donner raison.
Il enseigna dans un grand nombre de colléges et en dernier lieu dans ceux de Reims, de Sainte-Barbe, de Lisieux et de la Marche[372]. Sa pauvreté était grande, son logement plus que modeste[373]. Ses leçons n’étaient pas toujours payées, mais ce Christ, qu’il avait dans le cœur autant qu’à la bouche et qu’il aimait d’une tendresse mystique, le soutenait. Toujours heureux, il ne songeait qu’au devoir.
Jusqu’à présent il avait enseigné la rhétorique que Ravisius Textor professait en même temps avec éclat au collége de Navarre[374]. Tout le monde sait qu’en 1523, au collége de la Marche, il descendit de cette classe, la première, comme on disait alors, et qui aurait pu le conduire au rectorat, pour faire la classe de quatrième, et cela tout simplement parce que les élèves qui lui arrivaient, pleins de bouffissure, payant de mine, étaient vides en réalité et ne savaient rien. Fatigué d’avoir tous les ans à les reformer, il lui parut utile de descendre dans une classe où il enseignerait les éléments, puisque ceux qui étaient chargés de le faire dédaignaient ce devoir[375]. En effet, soit légèreté, soit excessive ardeur pour les belles-lettres, les jeunes professeurs mettaient de côté la grammaire et voulaient bâtir le faîte de l’édifice avant d’en avoir posé les fondements. C’est ce que leur reprochait Robert Goulet avant 1518. « Professeurs et pédagogues, disait-il, prenez garde, quelle que soit l’intelligence de votre élève, de le mettre à la lecture des auteurs, je dis même à celle de Caton, avant qu’il sache par cœur le petit Donat, le dominus quæ pars, ou, mieux encore, une grammaire écrite en français. » Ce qu’il conseillait, Cordier le fit. Depuis 1523, il s’intitula professeur de grammaire en tête de tous ses ouvrages.
Il semble que Cordier ait enfin trouvé sa voie. Il avait quarante-quatre ans. Il semble qu’arrivé à l’âge où l’on connaît bien ce que peut donner la vie, notre professeur sentit que c’était l’enfance qu’il fallait à son âme toujours candide, l’enfance qu’il aimera de plus en plus, l’enfance qu’il comprendra si bien et qu’il traitera avec une indulgence maternelle à une époque où on était très-dur pour elle. Oui, la pureté de l’enfance convenait à la sienne, et c’est vers elle qu’il se courbe en attendant que la vieillesse mette de niveau sa tête blanche avec leurs têtes blondes. Cependant voici un retour inattendu des anciens projets. Des deux formes de servir Dieu, des deux ministères, le premier reprend une nouvelle force, et, en 1528, ce maître si connu, dont on disait, sur la montagne de Sainte-Geneviève, que partout où il enseignait florissaient les lettres latines[376], le voilà qui entre au collége de Navarre comme boursier, pour y apprendre la théologie[377].
Il avait quarante-neuf ans. On était habitué à voir des étudiants de cet âge profiter des bienfaits de la femme de Philippe le Bel, qui avait fondé ce collége en 1304, et y vivre tranquillement sous prétexte de se préparer à la licence en théologie. On n’était pas admis à moins d’être fort pauvre ; nous savons que Cordier remplissait cette condition. Débarrassé des soucis de l’existence, il vécut là quelque temps heureux avec les huit sous parisis de la reine Jeanne. Cependant, tout d’un coup, il renonce à ces nouvelles études sans avoir pris aucun grade, soit que leur longueur[378] ou leur aridité l’eût effrayé, soit par une tendance secrète au luthéranisme, ce qu’il est impossible de décider[379]. Cependant il ne quitta pas le collége de Navarre, mais il y resta comme professeur de grammaire ; c’est ce qu’on voit par le titre de la première édition du De corrupti sermonis emendatione, en 1530.
Nous avons déjà dit combien cet ouvrage contribua à détruire la barbarie. Il est peut-être encore plus remarquable comme le dépôt des locutions familières de la langue française au xvie siècle, et on y trouverait plus d’un renseignement curieux sur les mœurs et sur les usages[380]. Cependant, quel que soit notre désir de ne pas diminuer la réputation de Cordier, nous devons nous élever ici contre une louange qu’on lui donne à tort et que nous avons été surpris de retrouver chez ses plus judicieux biographes[381].
On a voulu l’ériger en novateur, en homme qui aurait reconnu qu’il était absurde de faire parler aux écoliers la langue latine ; il ne se serait, dit-on, soumis à cette coutume qu’à contre-cœur ; il aurait favorisé de toutes ses forces la pratique de l’idiome maternel.
Nous avons cherché avec soin des preuves de cette assertion, et nous n’en avons trouvé aucune. Oui, Cordier était indigné contre le jargon des écoliers, mais c’est en faveur du bon latin. Il suffit de lire la préface du traité sur l’amendement du langage pour se convaincre qu’il suivait la voie commune, tout naturellement d’ailleurs et sans se demander pourquoi. N’est-ce pas lui qui écrivait : « Il faut amener les enfants non-seulement à aimer la langue latine, mais à en être charmés, à avoir honte de se servir de l’idiome national, même avec leurs mères, et à ne l’employer qu’à contre-cœur[382] ». Après ce passage, il ne nous semble pas nécessaire d’en citer d’autres.
Mais, dira-t-on, et nous avons aussi partagé un moment cette erreur, il a du moins le mérite d’avoir pensé le premier à traduire les phrases latines, pour ne pas proposer aux élèves des modèles inintelligibles. Ni Mosellanus, ni Barland, ni Vivès, ni aucun de ses prédécesseurs n’avaient pris ce soin. C’est à lui qu’on doit l’emploi de la langue vulgaire dans les livres de classe, et non aux solitaires de Port-Royal, qui ne firent que l’imiter sans le savoir, un siècle plus tard. Nous accordons que son amour pour la jeunesse et son expérience de l’enseignement lui auraient suggéré cette méthode, si elle n’eût pas été employée avant lui. Il semble, en effet, l’entrevoir d’abord et s’en servir plus tard avec assurance. La première édition du De corrupti contient beaucoup moins de phrases traduites que la quatrième. Mais nous ne pouvons pas oublier que Guy de Fontenay avait aussi traduit ses Synonymes et que Goulet, dans l’Heptadogma, avait recommandé l’emploi de la langue vulgaire ; ce dernier laisse même supposer qu’il y avait avant 1517 des grammaires latines écrites en français[383]. Seulement, aujourd’hui, Guy de Fontenay et Robert Goulet sont oubliés. On est, en vérité, trop enclin à faire honneur à tel ou tel homme remarquable d’une époque des idées qu’il présente avec éclat et qui existaient avant lui.
Cordier n’était-il plus catholique en 1530, c’est-à-dire deux ans après avoir renoncé à l’étude de la théologie ? Le De corrupti fut-il composé, comme l’a dit M. Bonnet, sous l’influence de ses sentiments nouveaux ? S’il était devenu luthérien, il s’en cachait fort, puisqu’il continuait à enseigner dans ce collége de Navarre destiné à produire des défenseurs du catholicisme, et surtout puisqu’il insérait dans son ouvrage un chapitre sur la confession, qu’il n’aurait certainement pas écrit à Genève. Mais il n’en était pas ainsi. Cordier ne fut ni un de ces cœurs qu’une lumière soudaine enflamme et qui volent avec ardeur au martyre, ni un de ces esprits qui, après avoir perdu la foi, font semblant de la conserver par prudence, parce qu’ils préfèrent à la vérité leur bien-être. Chez lui, tout est lent et proportionné à la longue durée de sa vie : le choix définitif d’une profession, celui d’une croyance, le mariage. On dirait qu’il sait qu’il a beaucoup de temps devant lui et qu’il juge inutile de se presser. Lui-même, il nous apprend qu’il ne changea que par degrés, et que trois ans après avoir pris conscience de sa conversion, il n’avait pas encore une connaissance complète de la vérité évangélique[384]. Cette âme droite et naturellement chrétienne se détacha peu à peu des erreurs qui l’enveloppaient sans l’étouffer. Un jour elle se trouva libre, presque sans secousse. Souvenons-nous, d’ailleurs, que la foi des professeurs du xvie siècle n’avait rien de superstitieux et qu’aussi bien qu’à Louvain on lisait la Bible à Paris dans les colléges[385]. C’est sous l’influence de son intime ami, Robert Étienne, esprit aussi résolu que celui de notre régent était doux et aimable, que Cordier se décida à embrasser la Réforme.
Sa conversion ne se manifesta d’abord que par un redoublement d’ardeur dans ses exhortations religieuses[386] aux écoliers. Cependant il ne crut pas pouvoir rester plus longtemps professeur au collége de Navarre et il alla enseigner à Nevers. A la fin de l’année 1534, nous le retrouvons à Paris, et décidément protestant. Les temps étaient changés. Le discours du recteur Kopp, dicté par Calvin et prononcé en pleine église des Mathurins, le 1er novembre 1533, et surtout l’affaire des placards (28 octobre 1534) avaient attiré la persécution sur l’Église naissante. Sur une liste des hérétiques ajournés « à comparoir en personne, » on lit au-dessous du nom de Clément Marot, celui de « maistre Cordier, qui autrefoys a tenu les escoles à Nevers. » Il y eut un certain nombre d’exécutions[387].
Précisément à cette époque, André de Gouvéa « le plus grand principal de France[388], » qui avait quitté la direction de Sainte-Barbe pour aller, sur les prières des jurats, relever le collége de Guyenne, arrivait à Paris avec l’intention d’y recruter quelques bons régents. De retour à Bordeaux dans les premiers jours de l’an 1535, il ramena avec lui cinq professeurs, parmi lesquels Mathurin Cordier et son ancien ami Claude Budin.
Ainsi Gouvéa avait trouvé Cordier à Paris, environ un mois après la publication de la liste, et notre régent avait sans doute profité du pardon accordé, sur la prière du pape, après les premières exécutions, « à ceulx qui n’avaient pas touché à l’honneur du saint sacrement. » Gouvéa ne fut pas rebuté par les croyances de Cordier et de Budin, car celui-ci était aussi devenu calviniste. C’est que les régents qu’il avait laissés à Bordeaux étaient presque tous partisans de la Réforme, comme Zébédée, Grouchy et, selon toute apparence, Guérente[389]. D’autres, comme Britannus[390], désiraient avec ardeur la réunion d’un concile qui, par de sages concessions, pacifierait l’Église. Enfin, parmi ces professeurs de Bordeaux, se trouvait un propre frère du principal, Antoine de Gouvéa, qui avait goûté d’abord, selon le dire de Calvin, la vérité évangélique[391]. Cordier dut partir avec joie pour la ville lointaine où il allait trouver une atmosphère plus libre. Cependant il pouvait encore supporter quelque gêne dans la manifestation de sa foi ; car le prudent Gouvéa avait inscrit en tête du programme affiché dans la grande salle du collége de Guyenne ce premier article :
« Premierement, les escolliers seront religieux et craignant Dieu. Ils ne sentiront ou parleront mal de la religion catholique ou orthodoxe. Ils ne tiendront et liront les livres condamnés par les saincts Pères[392]. »
Cette situation transitoire ne pouvait se prolonger longtemps. Avec les progrès de la Réforme dans la ville de Bordeaux la vigilance et la sévérité du parlement redoublèrent : bientôt il fallut se résoudre ou à subir le supplice, ou à renoncer aux idées nouvelles, ou à prendre la fuite. Budin s’accommoda du second parti. Il se maria et mourut paisiblement à Bordeaux, propriétaire de deux maisons et d’un grand jardin, ayant demandé par testament à être enterré dans l’église de sa paroisse. Cependant, après sa mort, on trouva chez lui des livres calvinistes[393]. Cordier quitta la ville. Il céda enfin aux conseils de Calvin qui l’appelait à Genève, au collége de la Rive. Mais ce ne fut pas sans avoir participé d’une manière durable à la prospérité du collége de Guyenne, qui avait été réformé en partie d’après ses conseils. « Toute la partie du programme relative à l’instruction élémentaire fut écrite, dit M. Quicherat, sous la dictée du bon Cordier, qui y fit passer la tendresse de son cœur pour le jeune âge. On y rencontre des détails charmants, comme par exemple la tolérance recommandée au maître s’il arrive que des bonshommes accompagnent les devoirs d’écriture dont il serait satisfait à d’autres égards : la raison en est qu’il faut prendre garde de mettre obstacle chez les enfants à la manifestation de la pensée[394]. »
C’est dans les derniers mois de l’année 1536 que Mathurin Cordier quitta le collége de Guyenne, où il avait passé deux ans. Son ami Budin ne put lui dire adieu sans verser des larmes et Cordier crut plus tard bien faire en écrivant en sa faveur aux magistrats de Genève[395], mais nous avons vu que Budin n’était pas fait pour l’exil.
En avons-nous fini avec les pérégrinations de Cordier ? Pouvons-nous nous arrêter et nous reposer avec lui, maintenant que le voilà enfin sur une terre de liberté ? Ni la vieillesse ni le mariage ne le fixeront. Il se maria deux fois, peut-être à Bordeaux, où le célibat des régents n’était pas en faveur comme à Paris[396], peut-être en Suisse. Dans ce petit pays, il trouva le moyen de changer de place : il en habita tour à tour les villes les plus importantes. C’était un restaurateur d’écoles, un missionnaire de l’enseignement. D’abord régent au collége de la Rive, il quitte Genève au bout d’un an avec son principal, Antoine Saulnier, qui avait été banni par les magistrats. Il se réfugie à Neufchâtel, dont il dirige le collége pendant sept ans ; de Neufchâtel il passe à Lausanne sans qu’on sache pourquoi, et il y demeure douze ans entiers comme gymnasiarque, sous la protection des magnifiques seigneurs de Berne : c’est là qu’il composa ses épîtres chrétiennes en vers français (1557). Enfin, en 1558, presque octogénaire, il revient à Genève et prend part à la réforme du collége de la Rive, dont le programme fut imité par les jésuites[397]. Dans combien de lieux n’avait-il pas restauré les lettres ! Suivant son habitude, après avoir inauguré la méthode, il s’employa modestement à l’appliquer et mourut presque en faisant sa classe. Il avait quatre-vingt-cinq ans et venait de mettre la dernière main à ses Colloques (1564). On l’a caractérisé d’un mot en l’appelant le Lhomond du xvie siècle. La France est riche en talents éclatants, mais elle est aussi bien française cette famille de maîtres modestes, savants et pieux, qui s’appellent Cordier, Lancelot, Rollin ou Lhomond. On parle de notre bruyante légèreté : trouverait-on ailleurs une telle succession d’hommes vénérables, non moins distingués dans l’ordre de l’intelligence que dans celui de la charité et qui, en se consacrant à l’enfance, ont fait pour elle des chefs-d’œuvre, car ils ont mêlé à la solidité de la science et au cœur du chrétien la netteté de l’esprit français ?
Certainement ce n’est pas un médiocre mérite que de savoir faire parler les enfants d’une manière à la fois naturelle et variée. Les Colloques de Cordier ont à ce point de vue une valeur littéraire qu’il serait possible de déterminer. Pourtant nous ne le ferons pas ; ce serait perdre notre temps. Quand même ces jolies scènes ne seraient pas écrites dans une langue morte, les héros en sont trop petits. Le dernier ouvrage de Cordier ne peut aujourd’hui nous intéresser que comme un document, en tant qu’il nous fait connaître ce collége de la Rive que Calvin créa, comme un des organes vitaux de la nouvelle Genève. Ainsi, après avoir remarqué, pour n’y plus revenir, la simplicité et le charme de ces dialogues, dégageons-en l’esprit : voyons (autant qu’on le peut sans sortir des classes de grammaire) comme les premiers protestants s’y prenaient pour développer les intelligences et former les âmes.
Cordier n’improvisa jamais, mais surtout son dernier ouvrage fut le fruit de l’expérience de sa très-longue vie.
Robert Étienne, son meilleur ami depuis la mort de Budin, et qui s’était aussi retiré à Genève[398], l’engageait vivement à écrire pour l’enfance et lui avait donné un secrétaire qu’il payait de ses propres deniers[399]. Il ne voulait pas que le vieillard mourût sans laisser un livre où il se serait mis lui-même, un de ces traités qui demeurent tant qu’on prend souci de l’éducation.
Mais l’illustre imprimeur mourut en 1559. En même temps Cordier redevenait professeur au collége de la Rive, et les soins de l’enseignement, auxquels il donnait jusqu’à ses heures de loisir, ne lui permirent pas de poursuivre son projet. D’ailleurs il ne voulait rien publier qu’il n’en fût entièrement satisfait. Il résista donc aux sollicitations d’un grand nombre de personnes.
Enfin, en 1563, comme on sentait qu’il n’abandonnerait l’enseignement qu’avec la vie et comme on désirait qu’il terminât l’ouvrage dont il avait déjà fait une ébauche, on lui donna un aide pour la classe. Il put alors disposer de ces matinées, de ces premières heures du jour qui étaient si précieuses à Érasme, comme elles le furent plus tard à Franklin. C’est avec bonheur qu’il se mit à l’œuvre. Il put de son vivant publier cet ouvrage, dont l’idée première remontait sans doute à l’époque lointaine où il avait vu les premiers colloques entre les mains des étudiants venus d’Allemagne.
C’est à la fois un manuel de conversation et un traité de morale. Morale nettement calviniste, mais l’auteur est tellement dépourvu de rancune et de préjugés, tellement humain, que son livre fut employé pendant deux siècles dans les écoles catholiques, sans autres modifications que quelques retranchements dans la préface. C’est bien l’homme qui, dans ses Épîtres chrétiennes, reprochait à une partie de ses frères de croire avoir la foi quand ils avaient déclamé contre l’Antechrist. Ce qu’il faut, ajoutait-il, c’est changer sa vie ; la vraie foi « besongne par charité[400]. »
Comme manuel de conversation, ce petit livre, dit Cordier, ne doit pas être appris par cœur, mais lu et relu, autant que possible avec plaisir. Il est surtout destiné aux enfants de la classe de cinquième, qui l’auront entre les mains avec la grammaire[401].
Ne croyons pas qu’il ait changé d’avis en vieillissant et que la conversation en langue latine ne soit maintenant pour lui qu’un moyen de se préparer à la lecture des auteurs. C’est bien le même qui, trente-quatre ans auparavant, aurait voulu empêcher les écoliers de parler français à leurs mères. Ayant fait autrefois insérer dans le programme du collége de Guyenne l’article suivant : « Ils ne parleront entre eux autre langage que le latin, si ce n’est qu’ils fussent encore rudes et abécédaires[402], » il veut à Genève que les enfants, à l’âge où on leur apprend à « former leurs lettres, soyent duits et accoustumes à parler latin[403]. » Aussi, dans les colloques, les interlocuteurs, qui ne sont autres que ses anciens élèves auxquels il a même conservé leurs noms, s’exercent à retenir des noms de meubles, d’ustensiles, de mets, et toute sorte de mots curieux, très-inutiles au développement de l’esprit. Ils savent comment on dit, en latin, un buffet, un banc, un chandelier, un coquemar, un chevet de lit, un pot à cuire, un pot à vin, non-seulement de la venaison, mais de la venaison de sanglier (aprugna[404]); ils distinguent aussi la graisse du sanglier de celle du porc, et ils auraient honte d’en être incapables[405]. « Que vous êtes fou ! — Pourquoi ? — Parce que vous vous trompez à nommer ces choses ; car ce qu’on appelle saindoux dans les pourceaux privés, on l’appelle du cal dans les pourceaux sauvages, c’est-à-dire dans le sanglier, lequel est très-dur[406]. » Ils parlent latin dans les rues, quoique des polissons « se moquent d’eux à pleine bouche[407], » mais le bonheur de Cordier est de nous montrer une famille, peut-être celle de Robert Étienne, où tout le monde parlait latin, excepté cependant la mère ; pour éviter la mauvaise influence de son langage, ses enfants ne lui adressaient la parole qu’à une certaine heure, quand elle les faisait appeler.
« Quel âge a votre frère ? — Cinq ans. — Que dites-vous ? il parle déjà latin. — De quoi vous étonnez-vous ? Nous avons toujours un maître chez nous, savant et soigneux, qui nous enseigne toujours à parler latin : il ne dit rien en français, si ce n’est pour nous expliquer, et même nous n’osons parler à notre père qu’en latin. — Vous ne parlez donc jamais français ? — Seulement avec ma mère, et cela à une certaine heure, quand elle nous fait appeler. — Comment faites-vous avec les valets ? — Nous ne parlons guère à eux, si ce n’est en passant, et néanmoins les valets nous parlent latin. — Et les servantes ? — Si nous avons besoin de leur parler, nous leur parlons français, comme nous avons accoutumé de parler avec ma mère. — O que vous êtes heureux d’être instruits si soigneusement[408] ! »
Ainsi la mère est mise au niveau des servantes. On reconnaît bien là le vieux dédain, la persistante antipathie des maîtres du xvie siècle pour leur éternelle adversaire. Notre Cordier si doux et si aimable n’a trouvé de paroles dures que pour les mères. Il se moque d’un grand garçon de dix-sept ans qui aimait tellement la sienne qu’il n’avait pas eu le courage de vivre loin d’elle. « Voyez combien cette tendresse pour nos mères est impertinente ! — Mais ce sont nos mères elles-mêmes qui en sont cause : car pourquoi nous aiment-elles si follement ? » Ainsi raisonnent Lucas et Orose sur l’aventure de leur camarade ; il est vrai qu’ils finissent par excuser l’amour maternel, car, conclut Lucas, il est difficile de contraindre la nature, et quand même on la chasserait à coups de fourche, elle reviendrait toujours[409].
Cependant tous les pères ne secondaient pas aussi bien le maître que celui dont nous avons parlé plus haut. Il y en avait qui trouvaient bien long un enseignement dont ils ne discernaient pas l’utilité. C’étaient sans doute des marchands dont on instruisait en prêtres et en docteurs les fils qui devaient leur succéder dans la boutique. Ils murmuraient avec le bon sens de l’ignorance, et puisqu’une mode maintenant surannée condamnait leurs enfants à parler latin, ils auraient voulu que la chose se fît en un an[410]. D’autres plus avisés, devançant les usages de notre siècle, envoyaient leurs enfants dans les pays étrangers pour y apprendre les langues modernes et particulièrement en Allemagne[411].
Inutiles symptômes ! Cordier, dominé par ses habitudes du xve siècle, continue par routine, après le manifeste de du Bellay, après l’Institution chrétienne, à considérer le latin comme la langue universelle et à ne faire usage du français que pour rendre ses leçons intelligibles. Il réserve les reproches publics après la prière à ceux qui causent en français avec leurs camarades[412]. Chez les bons élèves, l’habitude de la conversation latine était poussée si loin qu’elle étouffait ou faussait la pensée. Pour mieux s’exercer on soutenait le contraire de son opinion, et ainsi le vieil esprit de contradiction, chassé de la classe de philosophie, rentrait par la porte des classes de grammaire[413].
Certes, le système une fois admis, rien de plus ingénieux que la méthode. Le maître explique en classe les colloques et les élèves sont d’autant plus attentifs que c’est leur vie et leurs personnes mêmes qui sont mises en scène. Quelquefois ils les répètent comme un petit drame, chacun jouant son rôle ; quelquefois le maître improvise devant eux : les déclinaisons et les règles de la grammaire sont aussi comprises dans ces entretiens et s’apprennent ainsi sans fatigue[414].
Pour le reste, l’enseignement de Cordier rappelle celui de l’Université de Paris dans les mêmes classes. Les auteurs sont les mêmes : ce qui diffère et ce qui mérite d’attirer plus particulièrement l’attention, c’est l’esprit général ou la morale[415].
La morale, dans le collége de Genève, ne pouvait être qu’une conséquence de la religion. La plupart des écoliers étaient des fils de proscrits qui étudiaient pour entrer en théologie et revenir ensuite comme ministres sur la terre natale, au péril de leur vie. Leurs professeurs, depuis Bèze jusqu’à Cordier, avaient souffert pour la foi. Genève, gouvernée par Calvin, environnait l’école et semblait la continuer : les élèves y étaient surveillés par les ministres et par tous les citoyens. Jusque dans les tavernes, comme on appelait alors les hôtelleries, régnait la discipline calviniste. Le voyageur s’y asseyait à table à côté de l’étudiant[416], et tous deux écoutaient la prière prononcée à haute voix par le tavernier, « vrai chef de ménage[417]. » Souvent ce voyageur était un proscrit, père de l’étudiant[418], et cette prière, il l’entendait avec émotion, en se souvenant qu’il n’aurait pu la murmurer, même à voix basse, sans péril, de l’autre côté de la frontière.
On ne sera donc pas étonné d’apprendre que les écoliers avaient été distribués en quatre bandes, non selon les classes, mais d’après les quartiers de la ville, afin que tous ceux qui habitaient le même quartier se rendissent ensemble au temple[419]. Chaque bande était sous la surveillance d’un régent. Elles étaient tenues de se trouver de bonne heure au temple, chacune dans les bancs qui lui étaient assignés, le mercredi matin pour entendre un sermon et le dimanche pour en entendre deux, en sus du catéchisme. Les absents et les inattentifs étaient marqués pour être le lendemain « publiquement châtiés au collége, selon leur démérite. »
Tel est le règlement. Les colloques nous font voir qu’il ne restait pas lettre morte. Il y est plusieurs fois question de l’assiduité au sermon. « Avez-vous été aujourd’hui au sermon ? — Oui, monsieur. — Qui en sont témoins ? — Plusieurs de mes compagnons qui m’y ont vu en peuvent rendre témoignage. — Mais il en faut produire quelques-uns. — Je vous en produirai quand il vous plaira. — Qui a prêché ? — Monsieur un tel. — A quelle heure a-t-il commencé ? — A sept heures. — Quel a été son texte ? — De l’épître de saint Paul aux Romains. — En quel chapitre ? — Au huitième. — Vous avez bien répondu jusqu’ici : voyons ce qui suit. Qu’avez-vous retenu ? — Rien que je puisse dire. — Quoi, rien ? Pensez-y un peu et ne vous troublez pas : ayez bon courage. — Certes, monsieur, je ne puis m’en ressouvenir. — Pas d’un mot ? — Rien du tout. — Ah ! fripon, quel profit avez-vous donc fait ? — Je ne sais, si ce n’est peut-être que je me suis abstenu de faire mal. » Il a dormi de temps en temps et aussi pensé à mille badineries, comme font les enfants. « Qu’avez-vous donc mérité ? — Le fouet. — Oui, certes, vous l’avez mérité et bien fort[420]. » Mais le bon Cordier finit par pardonner.
D’après le règlement, tous les jours, à onze heures, les écoliers devaient s’exercer « à chanter psaumes jusqu’à midi. » Cette coutume se retrouve dans les Colloques[421]. Ils apprenaient aussi des versets de la Bible et les récitaient tour à tour[422]. Quant aux prières, il est inutile de dire qu’elles avaient lieu officiellement plusieurs fois par jour ; de plus, le maître exhortait ses jeunes élèves à prier eux-mêmes de cœur, en secret, à laisser leur âme céder à l’action divine et monter ainsi vers le ciel[423].
On se demandera si cette éducation ne formait pas des hypocrites, si du moins cette accumulation de pratiques ne produisait pas le dégoût de la piété. Les faits montrent le contraire. C’est que le calvinisme, tout en paraissant écraser les âmes sous la volonté divine, les grandissait par la communication intime, par l’union avec l’immensité de l’Être parfait. Car plus la doctrine du serf arbitre, si souvent mal comprise, rendait grande la dépendance de l’homme, plus elle rendait étroite, par le moyen de la grâce, sa communion avec Dieu. « Ne dites pas : Je ferai mon devoir, répétait Cordier à ses élèves, mais Je le ferai s’il plaît à Dieu[424]. » — Il ajoutait : « Les moindres événements dépendent de Dieu, qui gouverne les desseins des hommes comme il lui plaît. C’est Dieu lui-même qui produit en nous les bons mouvements et la direction vers le bien[425]. » Quoi qu’on pense de cette doctrine, on ne peut nier que tous ceux qui s’en sont pénétrés, les jansénistes et Malebranche, par exemple, pour ne sortir ni du catholicisme ni de la France, ont étonné par la sévérité de leur morale et par la pureté de leur vie.
Sous une telle influence les institutions se transforment, les emprunts faits à l’Université de Paris prennent un sens tout nouveau. On se souvient des dénonciateurs qui florissaient en Allemagne et qui, moins odieux à Paris parce qu’ils n’y étaient pas enveloppés de mystère, n’en exerçaient pas moins de tristes fonctions. Les supprime-t-on à Genève ? Nullement, mais on change le mal en bien. Le maître, ne pouvant tout faire, appelle à son aide les plus grands élèves, qui sont comme les frères aînés des autres. Il les revêt d’une magistrature mensuelle, après avoir pris l’avis de leurs camarades. C’est devant Dieu qu’il a fait ce choix, c’est par la prière qu’il les installe : il les réunit ensuite dans son cabinet, les instruit de leur emploi qu’il déclare saint et honorable, et les conjure par Jésus-Christ d’accomplir avec la crainte de Dieu tout ce qu’ils jugeront être leur devoir. « Je vous ai fait venir ici pour vous avertir de votre devoir. Vous n’ignorez pas avec quelle crainte du Seigneur je vous choisis dans notre salle commune ; nous avons commencé par les prières ; je vous ai parlé ensuite à vous et à tous vos compagnons, devant Dieu, des bonnes mœurs qui conviennent aux écoliers. Je vous ai ensuite choisis vous cinq, avec le témoignage des meilleurs élèves, vous croyant capables de cette fonction. On a terminé par une autre prière. Croyez donc que votre emploi est honorable et saint. Si vous en jugez autrement, il est impossible que vous vous acquittiez bien de votre charge : je vous conjure donc par Jésus-Christ d’accomplir avec la crainte de Dieu tout ce que vous connaîtrez être de votre devoir. Ne favorisez personne, ne haïssez personne, ne faites grâce à personne, ne vous vengez de personne, n’ayez pas ces passions qui emportent les hommes et qui corrompent la sincérité du jugement. Ne craignez point les menaces des méchants qui étonnent les jeunes gens sans courage, car quelle puissance ont-ils sur vous ? Craignez plutôt le Seigneur qui a sur vous puissance de vie et de mort. Souvenez-vous de la parole dont il exhortait ses disciples à la oonstance. Si le monde vous hait, dit-il, sachez qu’il m’a haï avant vous. Ne faites donc aucun cas, pour l’amour de Christ, des menaces et de l’inimitié des méchants, pourvu que vous puissiez servir fidèlement à la gloire de Dieu[426]. » Dans ces exhortations, les observateurs puisaient, avec le sentiment de leur devoir, le respect d’eux-mêmes et des autres.
Nous pourrions maintenant les voir à l’œuvre dans différents dialogues[427]. Ils mêlent la douceur à la vigilance. Nous pourrions nous arrêter sur les distinctions entre les élèves, nomenclateurs, éveilleurs de semaine, décurions ; nous pourrions donner mille exemples de la bonté du maître qui s’est plu à se peindre dans son dernier ouvrage, mais nous aimons mieux terminer en montrant quelle était l’estime des maîtres pour les élèves : on les laissait aller en ville sur leur parole. Un grand nombre de dialogues sont remplis par ces demandes et ces permissions de sortie ; de même lorsqu’ils niaient avoir commis une faute, on les croyait sur la garantie de quelques amis. On en faisait vraiment des hommes, et si les Colloques de Cordier ont vieilli comme livre classique, ils sont encore bons à consulter pour les maîtres, qui n’y verront pas sans profit comment il faut aimer, comment il faut estimer l’enfance.
|
« Nostros autem fere cum suis condiscipulis aut gallica semper garrire : aut si latine loqui tentarent, non posse tria verba bene latina continuare : idque tam inepte et rustice facere ut omnino satius foret abstinere. » — Cordier, préface du De corrupti, etc. |
|
Atque eo magis quidem mirabar, quod viderem pueros exterarum gentium in vicis etiam rusticis institutos et in hanc nostram academiam missos... solere et latine et expedite fabulari etiam cum viris doctissimis. — Id., ibid. |
|
Thurot, thèse sur l’Université de Paris, p. 88. |
|
Id., p. 91, 92. |
|
Voir toutes les histoires de l’Université de Paris. |
|
Thurot, p. 84. |
|
Voir Goujet, Mémoire sur le collége royal de France, Ire partie, p. 10, pour la barbarie avant 1530. |
|
Puisqu’il paraît que ceux de Sturm n’existent plus depuis l’incendie de la bibliothèque de Strasbourg. |
|
Par d’Aubigné, d’après Littré ; par Ronsard, dans l’épître aux ministreaux de Genève. |
|
D’après Littré. |
|
Rotulus, la liste des écoliers à punir, se trouve à tout moment dans les actes de l’Université avec le sens de liste. — Birrus, qui signifiait roux chez les Romains, puis bure dans la basse latinité, puis rochet d’évêque, a toujours, chez les écoliers, le sens de bonnet, que ne lui donne pas du Cange. Unus theologus accipiet cras birrum. — Birrus de nocturno. — Dans leur jargon, accipere signifie prendre, comme chez leurs prédécesseurs du moyen âge. Vis accipere hominem rasum ad crines ? Acceperam istum locum ante te. — On a pensé que quinaut signifiait celui qui reste en cinquième, et on a dit que ce mot aurait été inventé par Cordier ; nous le trouvons dans les comédies du xvie siècle : Faciam te quinaudum (no 8439 des mss. lat. de la Bibl. nat.), je te fermerai la bouche. |
|
Moulure, être battu très-fort. |
|
En citant ces étranges expressions, Cordier s’indigne « Utinam chifrare et dechifrare cæteraque ejusdem farinæ ad gothos essent relegata ! Quid enim est ineptius, quid absurdius, sive barbare dicas chifrare sire gallice chifrer. Vidi permultos qui etiam in celeberrimo virorum illustrium cœtu sese maxime ridiculos facerent : qui non possent talibus abstinere, adeo hærent tenaciter quæ et pessima et rudibus annis percepta sunt. » |
|
De corrupti, etc., 1re édition, p. 357. |
|
Mot d’origine inconnue. Cordier traduit ainsi le dicton : « Je t’enverrai bien au grat, ablegabo te quo dignus es. » |
|
On pourrait signaler l’Olla patella, mais ce n’est qu’une sèche et très-incomplète nomenclature. |
|
Guy de Fontenay avait publié avant 1517 les synonymes qui « forment un glossaire d’équivalents latins placés à la suite de divers mots ou idiotismes français. » (Quicherat, Histoire de Sainte-Barbe, t. I, p. 105.) |
|
Il donne d’abord le jargon, puis la traduction française, puis le bon latin. Exemple : Da mihi gallicum, donne-moi congé de parler françois, fac mihi gratiam linguæ vernaculæ. Suet. |
|
La première édition est presque introuvable. Elle manque à la Bibliothèque nationale et à la Sorbonne. Il y en a un exemplaire à l’Arsenal. En voici le titre exact : De corrupti sermonis emendatione libellus, nunc primum per auctorem editus. Dictabat suis Lutetiæ in gymnasio regio Navarræ Maturinus Corderius, professor grammaticæ. Ad minus candidum lectorem. Cur ducis vultus et non legis ista libenter? Non tibi sed parvis parva legenda dedi. apud Rob. Stephanum M. D. XXX. Cal. oct. Cette première édition avait été elle-même précédée d’un essai anonyme dont il paraît n’être resté aucune autre trace : « Editionem illam superiorem quæ nobis anonyma exciderat, amicorum consilio, ob rerum omnium tumultuariam confessionem, in totum retractavimus. » (Lectori brevis admonitio authoris.) Les écoliers s’empressèrent d’apprendre par cœur toutes les locutions impropres que la candeur de Cordier n’avait réunies que pour recommander qu’on les évitât. Sur les plaintes des maîtres, il fit paraître une édition corrigée avec ce titre : « Commentarius puerorum de quotidiano sermone, qui prius liber De corrupti sermonis emendatione dicebatur. » Barbier en signale une réimpression en 1536. Nous connaissons à l’Arsenal celles de 1542 et de 1550, chez R. Estienne. On trouvera à la Bibliothèque nationale l’édition allemande, qui est de 1537, Bâle. Le français y est remplacé par de l’allemand. Le jargon a disparu. |
|
En 1672. Traduction dédiée à l’abbé de Coislin. |
|
Voir Quicherat, Histoire de Sainte-Barbe ; l’excellent récit de M. Bonnet dans ses Nouveaux Récits du xvie siècle ; A. Berthault, Mathurin Cordier, et Gaullieur, Histoire du collége de Navarre. Les préfaces de Cordier fournissent de précieux renseignements. |
|
Histoire du collége de Navarre, ch. xlvii, p. 699. Il l’appelle le destructeur de la barbarie et loue sa piété. |
|
T. VI, p. 963. Non numeratur tamen ab hæreticis inter Calvinistas quanquam eum spectatæ probitatis et eruditionis virum nominant. |
|
Voir la fin de la préface des Colloques, qui est une sorte d’autobiographie. |
|
Histoire du collége de Navarre, p. 699. |
|
Bibliothèque chartraine ; 1re édition, p. 164. |
|
T. II, p. 109. |
|
Voir plus bas ce qu’il dit lui-même de sa pauvreté. Voulté parle aussi dans ses Épigrammes de la pauvreté de Cordier. |
|
Ecclesiæ ritus quos ego pæne ab incunabulis hauseram (préface des Colloques). Cette préface est mutilée dans plusieurs éditions. Elle est complète dans celle de Lyon, par Thomas de Straton, 1564. |
|
Préface du De corrupti, etc. |
|
Id. « Huic Academiæ quæ me qualiscumque sum genuit peperit atque educavit. » |
|
Lettre de Cordier aux seigneurs de Genève, publiée par le Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, t. XV, p. 414. Budin était de Chartres, ce qui fait penser que son ami d’enfance pouvait bien être du Perche comme lui. |
|
D’après La Monnaie, dans La Croix du Maine, t. II, p. 109, note, il avait été originairement prêtre, etc. |
|
« Annus agitur minimum quinquagesimus, ex quo suscepta docendi pueros provincia, » écrit-il en 1564. (Préface des Colloques.) |
|
Voir Quicherat, Histoire de Sainte-Barbe, passim. |
|
Voir l’épigramme de Voulté, citée par Gaullieur, Histoire du collége de Guyenne, p. 99. Ad Corderium.
Te docuit Christus verumque fidemque docere; Te docuit Christus spernere divitias... Te docuit Christus duros sufferre labores; Te docuit Christus munus obire pium, etc. |
|
Épigramme de Voulté, citée par Quicherat : Cordatus linguæ, morum, vitæque magister, Corderius censor crimina cuncta notat. |
|
« Quum in aliis gymnasiis tum in Rhemensi, sanctæ Barbaræ, Lexoviensi, Marchiano, etc. » (Préface des Colloques.) |
|
« Te docuit Christus nulla mercede parata : Vira litterulas voce docere bonas... Paupertatis onus, spicula sæva pati. Te docuit Christus contentum vivere parvis In tenui docuit teque habitare casa. » (Voulté, loc. cit.) Voulté, né en 1510, avait fait ses études à Sainte-Barbe. |
|
En 1520. Voir du Boulay, t. VI, p. 957. |
|
« Nam quum primo ordini summa cum laude præfuisses : quia discipulos ab aliis magistris ambitiose formatos, meras tantum ampullas, nihil solidi afferre videbas, ut tibi de integro fingendi essent, hujus molestiæ pertæsus, eo anno ad quartam classem descenderas. » (Calvin, dédicace à Cordier du Commentaire des l’épître aux Thessaloniciens.) |
|
Quicherat, Histoire de Sainte-Barbe. |
|
Voir Launoy, Histoire du collége de Navarre, ch. IX, p. 405. Il signale Cordier dans la liste des étudiants en théologie en 1528. P. 700, il dit : « Quum annus supra millesimum quingentesimum vicesimus octavus ageretur, in theologicum Navarræ sodalitium admissus est Sed in theologiæ facultate gradum, quod sciam, nullum suscepit. Relicto theologiæ studio quam ante spartam nactus fuerat hanc excolere atque exornare perrexit. » |
|
Elles duraient au moins dix ans. |
|
Ses continuelles louanges de Jésus-Christ ne prouvent rien, elles sont entièrement conformes à la piété catholique des professeurs du xvie siècle, de Mosellanus, par exemple. Il n’y a qu’un degré de ferveur de plus. |
|
« Il a été fessé par les carrefours, pour ce qu’il avait coupé une bourse. — On l’est allé exécuter, c’est-à-dire pendre, ou brusler, ou décoller, ou escarteler, ou bouillir (ad capitale supplicium perductus est). — La relieure de mon livre a couté deux sols. — J’avoye perdu le couteau de Pierre, mais il m’en a fallu payer deux liards. » Voir passim. |
|
MM. Quicherat et Bonnet. |
|
Equidem censeo præmiolis... ita ducendos, ut eum sermonem non modo ament, verum etiam illo delectentur, eosque pudeat vel cum ipsis matribus uti lingua vernacula, nec nisi maxime inviti hanc usurpare velint. (Préface du De corrupti, etc.) |
|
Principio grammaticalia, præsertim vernaculo inscripta sermone. (Voir l’Heptadogma dans l’Histoire de Sainte-Barbe de M. Quicherat.) |
|
Préface des Colloques : « Ex quo autem mei misertus Pater clementissimus mentem vèra sui Evangelii cognitione illustravit multo etiam ardentius id propositum persecutus sum. Quod et nivernensis schola... per triennium experta est. Sed quum et plenior Evangelii cognitio deinde accessisset, » etc. |
|
Voir l’Heptadogma. D’après la préface du De corrupti, les professeurs, en parlant toujours de Jésus-Christ, ne craindraient pas de passer pour hérétiques, mais pour d’ennuyeux prédicateurs. |
|
Voir la préface des Colloques. |
|
Voir le document communiqué par M. de Montaiglon au Bulletin de l’histoire du protestantisme français, t. XI, p. 253-258. On y voit que la liste fut dressée « peu après que lesdits plaquars eurent esté atachez, » c’est-à-dire en novembre 1534. Cordier était donc à Paris à cette époque et, d’ailleurs, c’est en décembre qu’André de Gouvéa l’y recrute pour le collége de Guyenne. (Voir Gaullieur, Histoire du collége de Guyenne, p. 92 et 95.) |
|
Montaigne. On sait que le collége de Guyenne avait été fort compromis par Tartas. |
|
Gaullieur, p. 83, 90 et 91. |
|
Id., p. 114. |
|
Quicherat, Histoire de Sainte-Barbe, t. I, p. 214. |
|
Gaullieur. |
|
Voir Gaullieur. |
|
Histoire de Sainte-Barbe, t. I, p. 235. |
|
Voir cette lettre dans le Bulletin de l’histoire du protestantisme français, t. XV, p. 214. |
|
Voir la comédie contre les professeurs de Bordeaux, no 8439 du fonds latin de la Bibliothèque nationale. |
|
Jésuitæ non sunt veriti multa ex regulis et institutis scholæ genevensis in collegiorum suorum usum derivare ac transplantare (Richer, Obstetrix animorum, ch. vi, p. 80.) |
|
Depuis 1552. |
|
Voir la préface des Colloques, pour ces détails et pour beaucoup d’autres. |
|
Épîtres chrétiennes, préface de la IIe épître. Nous n’en connaissons que l’édition de 1625. |
|
Il s’agit, en tous cas, de jeunes enfants. « Nondum complevi octavum annum, ut ait mater. » (Livre I, colloque xxxii.) — « Quot annos habes ? — Tredecim, ut a matre accepi. Tu vero ? — Equidem non tot habeo. » (Livre II, colloque xliv.) |
|
Voir Gaullieur, p. 106, 107. |
|
Voir les loix de l’académie de Genève, reproduites par M. Berthault, M. Cordier, p. 47. |
|
Colloques, I, li. |
|
« O quam ineptus es ! — Quid ita ? — Quia falleris in rerum nominibus ; nam quod in sue domestico dicitur axungia, id in sue fero, id est apro, callum vocatur, et est in eo genere durissimum. » (IV, xi.) |
|
Trad. de l’édition de 1727, à la Haye, chez Néaulme. |
|
Liv. II, coll. xxx. |
|
II, xliv. |
|
Jam non poterat ferre matris desiderium. — O tenellum adolescentem ! quotum agit annum ? — Septimum decimum... — Vide quam ineptus sit iste in matres nostras affectus. — Atque ipsæ matres sunt in causa : cur enim adeo temere nos amant ? — Naturam cogere difficile est... Naturam expellas furca, etc. (L. IV, colloque vii.) L’un des interlocuteurs est le propre frère du jeune homme dont il s’agit. Voir cependant l. IV, coll. xxiv. |
|
Latine loquentes attente observa teque ad eorum imitationem diligenter accommoda. — At istud longum est, præceptor. — Non fiunt nisi longo tempore præclara ædificia. — Experientia nos istud docet : at pater meus vellet me annuo spatio doctum videre. — Pater tuus quia non didicit litteras, etc. (III, xxxi) |
|
IV, coll. vii. |
|
IV, x. |
|
Passim. Voir surtout I, i ; II, xxxviii ; IV, i, v, xxiv. |
|
Voir les vers latins en tête de l’ouvrage et la préface du second livre. |
|
On ne le dirait pas en voyant les distiques de Caton entre les mains des élèves de Genève comme entre les mains de ceux de Paris. Cordier aimait beaucoup ces distiques dont il avait donné une édition et dont la morale, banale pour d’autres, était vivante pour lui. Il les cite presque à tout moment dans ses colloques. Mais ce petit livre, composé, dit-on, par le grammairien Dyonisius Cato, qui aurait vécu au ive siècle, ne pouvait être le véritable manuel du collége de la Rive, malgré les apparences. |
|
Colloques, passim. |
|
Voir les épîtres chrétiennes. La dernière est adressée aux taverniers. Toy qui reçois les gens en la taverne, Premièrement selon Dieu te gouverne... Fay rendre à Dieu (mais ne l’oublie pas) Grâces devant et après le repas. |
|
Colloques. |
|
Voir p. 43 de l’opuscule de M. Berthault, le règlement du collége. |
|
L. III, coll. ii. |
|
II, lv. |
|
IV, xxxiii. |
|
IV, xvi. |
|
III, ii. |
|
IV, xiv, et IV, xvi. |
|
III, vi. |
|
Voici quelques détails sur les éditions des Dialogues de Cordier. La première est de 1564, à Lyon. « Colloquiorum scholasticorum libri quatuor ad pueros in sermone latino paulatim exercendos Mathurini Corderii. Lugduni excudebat Thomas de Straton 1564. » (B. nat.) Barbier en signale une de Genève, 1563. Ce ne peut être que fautivement, puisque la date de la préface porte 1564. Il signale celle de Straton, une autre à Paris, chez Gabriel Buon, également en 1564. Nous ne la connaissons pas, mais nous avons vu à la bibliothèque Mazarine une édition de Buon, 1576, dont Barbier ne dit rien et dont la préface est mutilée. Tous les passages relatifs au protestantisme de Cordier ont été retranchés. On voulait bien de ses ouvrages, mais on voulait que sa foi fût ignorée. On trouvera dans Barbier et dans Brunet la liste des éditions des Dialogues : je remarquerai seulement qu’ils ont été souvent réimprimés en Angleterre, et que Barbou en faisait reparaître douze en 1770. Quant aux traductions, elles sont nombreuses. La principale est celle de Gabriel Chapuys, disciple de Cordier, Lyon, 1576 (Barbier). Voici celles que nous avons vues : 1º Celle de Chapuys, avec le nom du traducteur. Paris, Jean Libert, 1646, in-16. (B. Sainte-Geneviève.) 2º La même, sans le nom du traducteur. Rouen, 1665, chez D. Maurry, près le collége des RR. PP. Jésuites. (B. de l’Arsenal.) 3º Une anonyme. Paria, Thiboust, 1672, dédiée à l’abbé de Coislin. « Ces petits dialogues viennent vous demander votre protection. » Sans dire de qui ils sont. (Sainte-Geneviève.) 4º La même, La Haye, Gosse et Neaulme, 1727, avec des changements et des suppressions. (La Sorbonne, B. Leclerc.) |
Le latin a été pendant plusieurs siècles la langue littéraire de l’Europe, et c’est un privilège qu’il n’a pas entièrement perdu : les savants de la Renaissance voulurent le ressusciter comme langage journalier. Nous avons essayé de marquer l’importance de cette entreprise et de faire l’histoire du genre d’écrit auquel elle donna lieu.
Les colloques, créés pour fournir des aliments à la conversation des écoliers, devaient surtout reproduire leur vie, c’est-à-dire le mouvement intérieur des universités, et comme celui-ci se divisa en deux grands courants, qu’il comprend à la fois les études et la religion, notre sujet d’abord si modeste s’est agrandi.
Il a dû être complété par la biographie des auteurs de ces manuels, non-seulement parce qu’il était bon d’ouvrir une sorte de refuge commun à ces enfants perdus des littératures nationales, mais parce que, si la connaissance de l’écrivain est en général utile pour celle de l’œuvre, ici, l’écrivain, par sa profession, par ses sentiments et par ses idées, en un mot par toute sa personne, faisait étroitement partie de notre sujet.
Nous avons donc vu passer sous nos yeux, dans la jeune université de Leipzig, l’héroïque vaillance de Mosellanus ; à Cologne, dans l’antique citadelle des préjugés, la pédanterie étroite et bizarre de Schottennius ; dans la sage mais médiocre université de Louvain, le bon sens un peu maussade de Barland ; en Espagne, Vivès ; au Mexique, la légèreté de Cervantes et le curieux mais triste spectacle de la stérilité de l’esprit produite par le développement presque exclusif de la mémoire. La France nous a montré dans un milieu bruyant et satirique un homme que sa bonté, son application et sa candeur mettent presque au niveau des grandes intelligences. Ainsi les différentes universités et les différents maîtres se sont montrés à nous avec ce que le temps et les lieux ajoutaient à leur nature. Partout nous étions conduits par une même idée générale dont il faut maintenant résumer l’histoire.
Le moyen âge, qui n’avait qu’une religion, devait aussi tendre à n’avoir qu’une langue. Aussi de très-bonne heure vit-on se répandre des répertoires de phrases latines. Les Allemands apportèrent à ce travail le sérieux et la persévérance de leur caractère. Ils avaient d’ailleurs besoin de faire effort plus que les autres, puisque leur idiome semblait alors sans analogie avec le latin. C’est donc chez eux que les manuels proprement dits prennent naissance à la fin du xve siècle ; c’est aussi chez eux qu’ils se perfectionnent, lorsque les auteurs antiques pénètrent tumultueusement dans le monde chrétien et commencent à remplacer l’empire de l’Eglise par la république des lettres. Pendant un certain temps, les deux courants agissent dans la mime direction, la piété et l’érudition refoulent d’un commun accord les langues vulgaires : de plus, le bon sens domine encore, et obtient que le langage latin, en satisfaisant aux besoins journaliers, ne descende pas jusqu’aux détails les plus mesquins de l’habillement et du mobilier. Mosellanus représente cette heureuse période. Grâce au perfectionnement et à la diffusion de l’instrument de communication, les savants sont partout chez eux. Ils sont en Flandre, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne, sans être obligés de savoir une autre langue que le latin.
Un peu plus tard, le développement vigoureux des idiomes modernes auxquels cette nouvelle sève a profité, et qui participent d’ailleurs au réveil universel du xvie siècle, inquiète les savants. Ils sortent de leur premier enivrement, se sentent menacés ; la période de la réflexion succédant d’ailleurs à celle de la spontanéité, ils cherchent à s’assurer des générations futures en apprenant leur langage à l’enfance. Ils veulent en même temps envahir toutes les provinces du langage et forgent des mots pour tous les objets qu’inventent les besoins et le luxe modernes. C’est la période de Vivès (1539). Le grec est mis à contribution pour former ces mots nouveaux, comme il l’a été de nos jours pour fournir des noms à toutes les inventions des sciences. L’Allemagne avait dominé dans la première période ; ici, comme il convenait, c’est l’Espagne qui représente, avec l’empire de Charles-Quint, une civilisation plus brillante.
Cependant la victoire des idiomes modernes n’est plus douteuse : ils pénètrent même dans le domaine de la haute et grave littérature ; d’ailleurs l’Eglise s’est divisée et la Réforme, qu’elle en ait ou non conscience, tend à restreindre partout l’usage de l’antique langue du catholicisme. Alors la conversation dans l’idiome de Térence et de Cicéron se renferme de plus en plus dans les écoles, pour ne devenir à la fin qu’un des moyens de mieux arriver à l’intelligence des auteurs. Mais telle est la force de l’esprit de routine que c’est un protestant, Mathurin Cordier, qui maintient l’usage vieilli et qui lui élève un dernier monument, en 1564[428].
On sait d’ailleurs qu’une fois enfermé dans les colléges, le langage latin y dura longtemps et qu’en France[429], lors de la réforme de l’Université, sous Henri IV, il survécut à la destruction de tant d’institutions surannées. Le statut de 1600 défendit aux écoliers de parler dans les colléges une autre langue que le latin, et les maîtres eux-mêmes ne durent leur adresser la parole que dans cette langue. « On ne s’était point encore avisé, dit Crevier à ce propos, que la langue française méritât d’être étudiée, ni que cette étude dût entrer dans le plan de l’éducation. C’était une erreur générale dont aujourd’hui on est bien revenu. Aussi la grammaire française s’est-elle heureusement introduite dans quelques-uns de nos colléges, et nos poëtes et orateurs français tiennent compagnie dans les hautes classes à Cicéron et à Virgile. C’était une addition nécessaire et sans laquelle le plan de l’instruction de la jeunesse demeurait imparfait. » Mais le disciple de Rollin n’approuve pas cette réforme autant qu’il veut bien le dire. Ecrivant dans la seconde moitié du xviiie siècle, il n’a cependant pas renoncé à l’idée que le latin doit être la langue commune des savants. « Je ne puis m’empêcher d’observer, dit-il, qu’il ne faut pas que le français, nouvel hôte, empiète trop de terrain sur l’ancien propriétaire. Inutilement alléguerait-il qu’il ne fait que rentrer dans son domaine, que le pays lui appartient, que le latin est un étranger ; le latin est la langue des savants : il est une langue universelle, qui fait la communication de toutes les parties de l’Europe ; il est la source de tout notre savoir, et ce n’est que par l’influence continuelle de la source que les plus grands fleuves s’entretiennent[430]. »
Cette dernière phrase de Crevier, bien interprétée, pourrait servir de conclusion à notre ouvrage. Il ne resterait aujourd’hui personne pour soutenir que le latin est une langue universelle : non-seulement il a péri comme moyen de conversation, mais, excepté dans les travaux d’érudition pure, les savants eux-mêmes ont renoncé à écrire dans cette langue. Pour la conversation, qui reflète surtout les idées et les usages du moment, il serait absurde d’employer une langue morte qu’on ne pourrait charger d’une multitude toujours croissante de termes nouveaux sans la dénaturer ; quant aux œuvres littéraires, il est bon que chaque peuple prenne conscience de lui-même dans les chefs-d’œuvre écrits en sa langue ; et les traductions ne manqueront jamais de vulgariser ce qu’il importe aux peuples voisins de connaître. Mais, au point de vue de l’éducation et du développement de l’esprit, on peut affirmer que l’étude des langues, et surtout des langues anciennes, ne peut être remplacée avec avantage par aucune autre, et que c’est cette culture particulière, tout incomplète qu’elle soit, qui adonné aux hommes du xvie siècle une notable partie de leur valeur. Qu’ils l’aient ou non voulu (et l’importance que nous leur avons vu donner au langage montre qu’ils savaient très-bien ce qu’ils faisaient), ils ont rencontré la vraie méthode pour le développement des jeunes esprits. Si nous envisagions en entier leur plan, dont la conversation en latin n’était qu’une petite partie, nous verrions qu’ils se sont fait l’idée la plus juste de ce que doit être l’instruction. Ils ont compris qu’elle doit être une gymnastique de l’intelligence, que celle-ci est active, que le cerveau est une machine dont il faut exercer les ressorts, et non un récipient destiné à être rempli.
Car n’est-il pas vrai que s’il est une étude qui exerce l’activité de l’enfant et le fait connaître lui-même à lui-même, c’est celle du langage ? Ses lois ne se confondent-elles pas avec celles de la pensée ? N’est-il pas admirable qu’une telle étude, même faite comme elle l’est le plus souvent, soit à la portée des jeunes esprits, dans lesquels elle insinue, comme on l’a remarqué, la seule philosophie que beaucoup d’entre eux auront l’occasion de connaître ? Le meilleur moyen pour faire distinguer ces lois, qu’on se bornerait à appliquer d’instinct, et pour en montrer l’universalité, n’est-il pas l’étude d’une langue étrangère ? De plus, comme on fait surtout connaître à l’élève, parmi les diverses provinces d’une même langue, celle de la vie morale, ne porte-t-on pas ainsi la lumière au centre de son âme ?
Parmi les langues étrangères, ne faut-il pas choisir celle qui nous fait le mieux comprendre la nôtre, celle dont la littérature, nous ouvrant le passé, nous permet de mieux connaître l’humanité, comme nos souvenirs d’enfance nous aident souvent à nous mieux rendre compte de nous-mêmes ? Ne faut-il pas, par exemple, contre-balancer l’excessive importance donnée aujourd’hui à l’étude de l’individu par la considération de l’idée de la patrie antique ? Ce n’est pas que les sciences soient à négliger, quoique la philologie offre les méthodes et les résultats intellectuels de l’histoire naturelle, et quoique les problèmes de la traduction exercent la sagacité presque autant que ceux des mathématiques. Apprenons les mathématiques et les sciences naturelles, bien que, parmi ces dernières, la physique, dont les lois ne sont pas encore coordonnées en système, mérite plutôt le nom d’empirisme que celui de science : mais tant que le langage sera le miroir de l’esprit humain, c’est par l’étude du langage qu’il faudra commencer et continuer longtemps. Ainsi, en blâmant les savants du xvie siècle d’avoir méconnu les langues vulgaires, nous les louons d’avoir mis à la base de l’éducation la langue latine, qu’ils considéraient avec raison comme le dépôt d’un grand nombre de connaissances et comme civilisatrice par sa propre vertu[431]. Nous ne pouvons, en terminant, nous empêcher de regretter que les universités où se conservait cette langue ne subsistent plus dans tous les pays, sans doute avec des modifications nécessaires, mais avec leur antique importance, comme un des principaux organes, comme une des parties nobles du corps social.
|
Le dernier monument remarquable. |
|
On comprend que nous n’ayons pas suivi la décadence du langage latin dans toutes les parties de l’Europe. En Allemagne, il régna longtemps encore dans les colléges, comme on peut en juger par ce passage du discours de Posselius : « De ratione discendæ ac docendæ linguæ latinæ. » (Wittenberg, 1601.) — « De exercitio latine loquendi hic non dicam. Sciunt enim viri docti et sapientes, id omnino necessarium esse et sine magno discentium incommodo negligi aut omitti non posse. » |
|
Crevier, Histoire de l’Université, t. VII, p. 65, 66. |
|
Cela est vrai à plus forte raison du grec, dont le seul désavantage ici est de ne pas avoir été la source de notre langue. |
FIN
| Introduction | 1 |
| PREMIÈRE PARTIE. | |
| LE LATIN CONSIDÉRÉ COMME LANGUE VIVANTE AU XVIe SIÈCLE ET L’ORIGINE DES COLLOQUES. | |
| Chapitre premier. — Du domaine de la langue latine un peu avant la Renaissance | 11 |
| Chapitre ii. — Le latin avant la Renaissance | 17 |
| Chapitre iii. — La Renaissance | 28 |
| Chapitre iv. — La conversation | 42 |
| Chapitre v. — Tableau de l’histoire des colloques | 54 |
| SECONDE PARTIE. | |
| LES COLLOQUES ET LEURS AUTEURS. | |
| Première section. — Allemagne. | |
| Chapitre premier. — Mosellanus (1517) | 65 |
| Chapitre ii. — Les colloques d’un maître d’école de Cologne. Schottennius (1524 ou 1525) | 113 |
| Deuxième section. — Flandre, Espagne et Mexique. | |
| Chapitre premier. — Les colloques d’un professeur libre de Louvain | 131 |
| Chapitre ii. — Les dialogues de Vivès et l’influence de l’Espagne après l’âge héroïque de la Renaissance | 158 |
| Chapitre iii. — Les colloques d’un professeur de l’université de Mexico | 178 |
| Troisième section. — France et Suisse. | |
| Le traité de l’amendement du langage et les colloques de Mathurin Cordier | 205 |
| Conclusion | 245 |
IMPRIMERIE D. BARDIN, A SAINT-GERMAIN.
Notes du transcripteur
L'orthographe et la ponctuation de l'original ont été conservées, sauf lorsque des erreurs typographiques évidentes ont été trouvées.
Les anciennes orthographes de « college » et « siége » ont été conservées.
Des orthographes cohérentes ont été adoptées pour les noms « Ébrard » en français et « Ebrardus » en latin, et pour « Vivès » en français et « Vives » en latin.
Les notes de bas de page ont été renumérotées de manière séquentielle dans tout le livre.
[The end of Les Colloques Scolaires Du Seizième Siècle et Leurs Auteurs (1480-1570), by L. Massebieau]