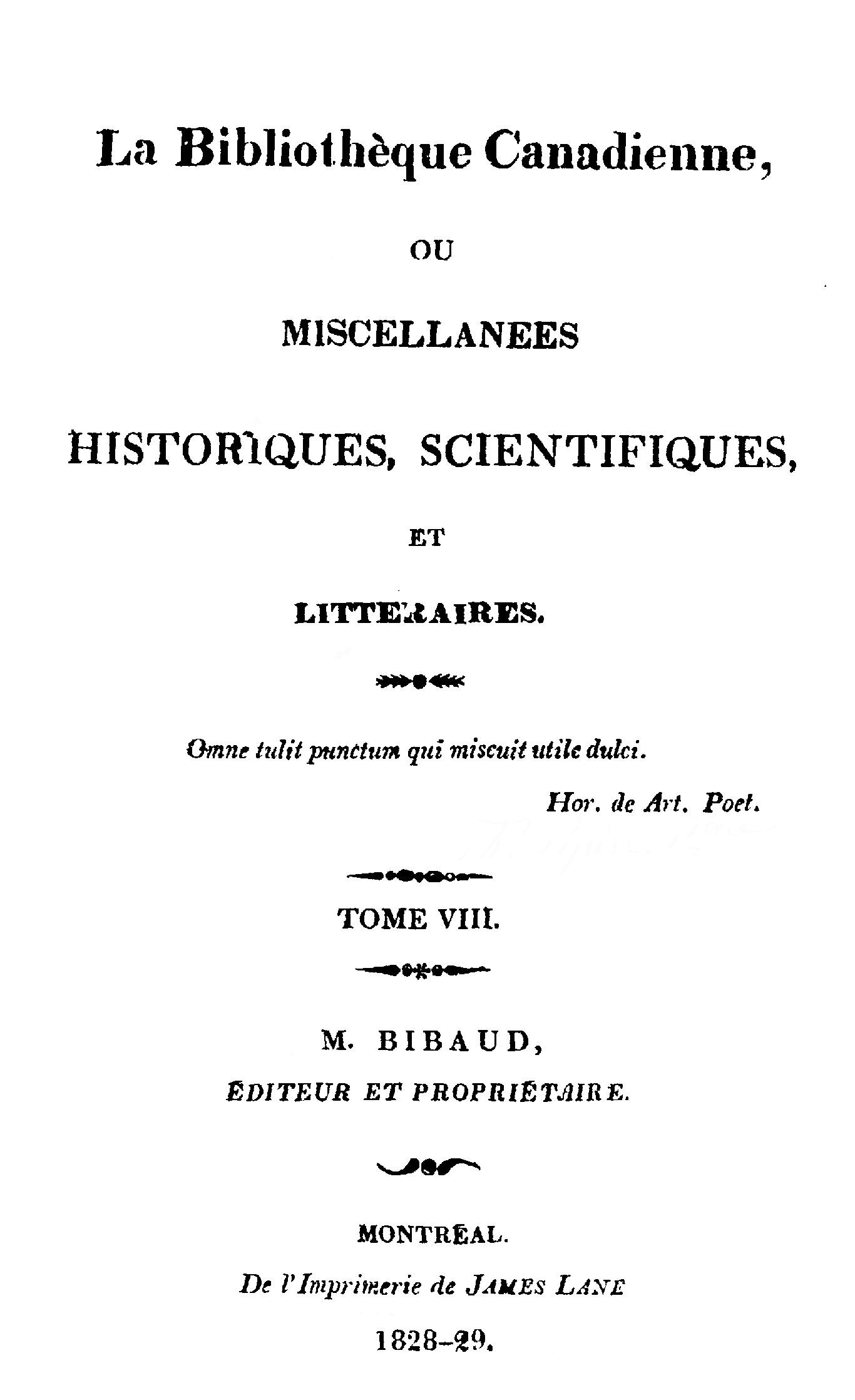
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque canadienne, Tome VIII, Numero 2, Janvier 1829.
Date of first publication: 1829
Author: Michel Bibaud (1782-1857) (editor)
Date first posted: Nov. 30, 2022
Date last updated: Nov. 30, 2022
Faded Page eBook #20221158
This eBook was produced by: John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
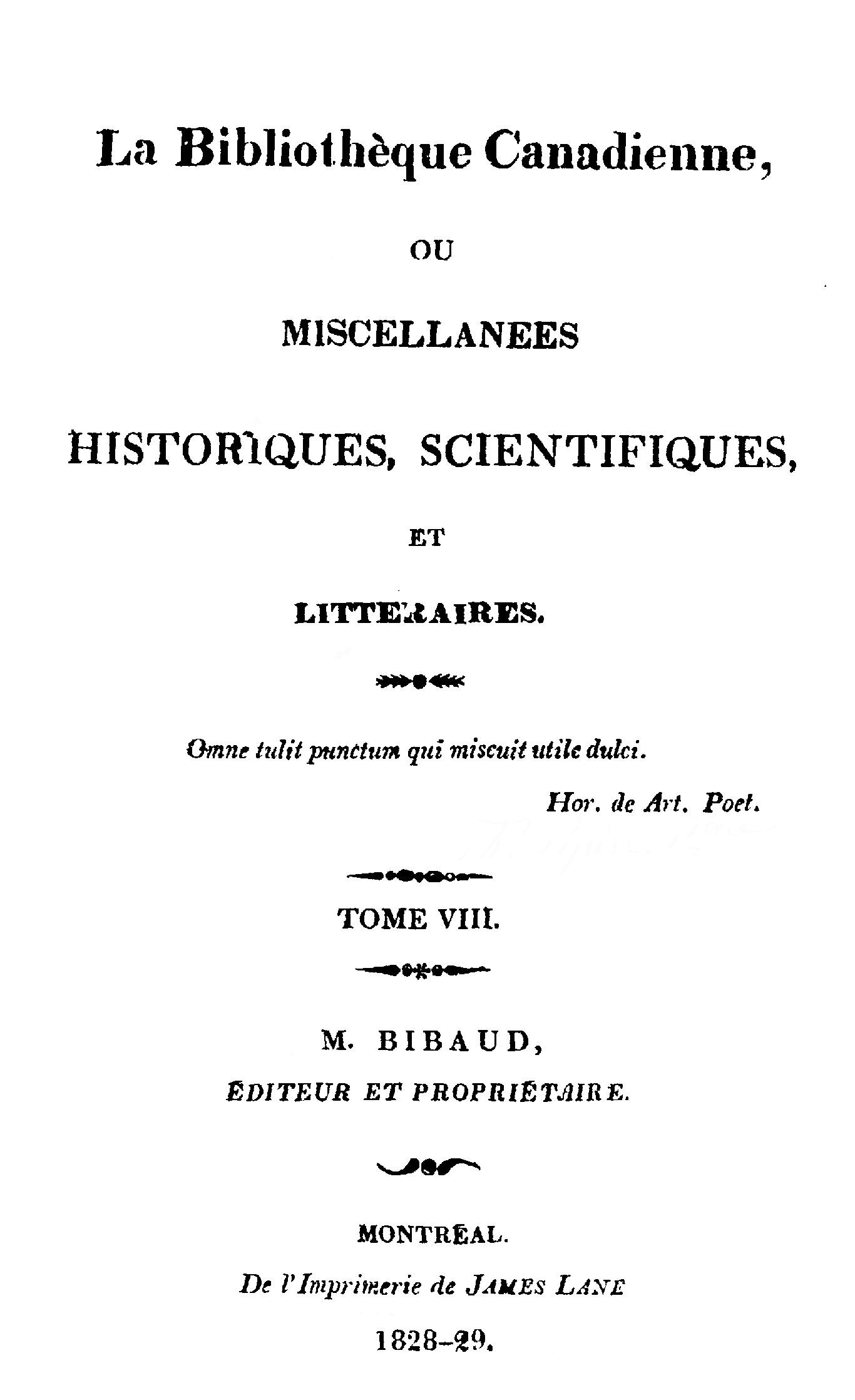
La Bibliothèque Canadienne
| Tome VIII. | JANVIER 1829. | Numero II. |
A la prière de Téganissorens, M. de Callières fit accompagner les envoyés iroquois, à leur retour, des mêmes personnes qu’il avait députées vers les Cantons, l’année précédente. Ils furent à peine arrives dans la principale bourgade d’Onnontagué, que le conseil s’assembla. Quoiqu’il y eût alors sur les lieux des députés du gouverneur d’Orange, les seuls envoyés Français y furent introduits.
Le P. Bruyas commença par déclarer que le gouverneur général était déterminé à ne plus souffrir de remises, et voulait enfin savoir à quoi s’en tenir avec les Cantons; que les députés de toutes les nations ne manqueraient pas de se rendre à Montréal, au temps marqué, pour y terminer la grande affaire qui avait été si heureusement commencée l’automne précédente, et que si les Iroquois ne s’y trouvaient pas, on ne les écouterait plus; qu’ils devaient surtout se souvenir de la parole qu’ils avaient donnée à Ononthio de lui rendre tous les prisonniers français; qu’il pourrait bien se faire que la guerre recommençât entre les Français et les Anglais, mais qu’il serait de l’intérêt des Cantons de ne point entrer dans le démêlé.
Ce discours fini, on se sépara; trois jours après, le conseil se rassembla pour y répondre, et les députés anglais y furent admis. Téganissorens présenta d’abord à leur chef un collier, pour l’engager à ne pas traverser l’accommodement qu’il était près de conclure avec les Français. Il en mit ensuite un autre aux pieds du P. Bruyas, en disant qu’il rendait la liberté à tous les Français qui étaient encore captifs dans son canton. “J’ouvre toutes les portes, continua-t-il; je n’arrête personne: je veux vivre en bonne intelligence avec Ononthio mon père, et avec Colar mon frère: je les tiens tous deux par la main, résolu de ne me séparer jamais ni de l’un ni de l’autre. Cinq députés vont partir pour Montréal, et deux pour Orange: quant à moi, je demeurerai sur ma natte, pour faire connaître à tout le monde que je ne prends point de parti, et que je veux demeurer dans une exacte neutralité.”
Le P. Bruyas et M. de Maricourt, qui avaient envoyé Joncaire à Tsonnonthouan et le sieur de In Chauvignerie à Onneyouth, crurent pouvoir compter sur une telle déclaration, et leur confiance fut encore augmentée par l’arrivée du sieur de Villedonné, lieutenant d’infanterie, avec la nouvelle que le P. Anjelran était à Montréal, ayant pris les devans pour avertir le général que les députés de tontes les nations se rendraient incessamment auprès de lui. Mais la Chauvignerie étant revenu d’Onneyouth, rapporta qu’il avait trouvé ce canton assez mal disposé, et qu’il n’en avait pu retirer aucun prisonnier.
Joncaire avait négocié plus heureusement dans les cantons de Tsonnonthouan et de Goyogouin, et il en amena des députés et plusieurs prisonniers. Les Onnontagués n’en remirent que cinq à M. de Maricourt, prétextant que les autres ayant été adoptés et s’étant mariés dans le pays, leurs parens ne voulaient pas entendre à les laisser partir. Enfin les Onneyouths, suivant l’exemple qui leur avait déjà été donné par trois cantons, envoyèrent aussi des députés à Gaunentaha, où le P. Bruyas s’était rendu. Ceux des Agniers promirent de descendre par le lac Champlain, et les envoyés français, suivis de deux cents Iroquois, se mirent en route pour Montréal, où ils arrivèrent la 21 Juillet. Le lendemain, sept ou huit cents sauvages des quartiers du nord et de l’ouest y débarquèrent aussi. Les uns et les autres furent reçus au bruit du canon, et Kondiaronk, chef et orateur de la députation des Hurons de Michillimakinac, fit à M. de Callières un très beau compliment, au nom de tous. Le 25, le général commença à traiter en particulier avec tous les députés; mais avant de rendre compte de ce qui se passa à Montréal, nous exposerons en peu de mots les difficultés que M. de Courtemanche et le P. Anjelran avaient rencontrées dans leur négociation.
En arrivant à Michillimakinac, ils trouvèrent presque tous les sauvages partis pour la chasse: ce qui les obligea à faire partir des courriers pour les avertir du sujet de leur voyage. Courtemanche laissa ensuite son collègue à ce poste, pour y négocier avec les Hurons et les Outaouais, et se rendit à la rivière St. Joseph, où il arriva le 21 Décembre 1700. Outre les Miamis qui y étaient établis depuis longtemps, il y rencontra des Pouteouatamis, des Sokokis, des Mahingans, des Hurons et des Outagamis. Il apprit que les deux premières de ces tribus avaient envoyé des partis de guerre contre les Iroquois, et que les Miamis se disposaient à en faire autant. Il engagea ces derniers, en les menaçant de l’indignation du gouverneur général, non seulement à retenir leurs guerriers, mais encore à faire courir après les autres, pour les obliger à revenir sur leurs pas. Il vint aussi à bout de leur faire entendre raison au sujet des prisonniers iroquois qu’ils avaient adoptés, et il tira d’eux la promesse de se rendre à Montréal, au temps marqué.
Cela fait, il se rendit auprès des tribus illinoises. Toutes, à l’exception des Kaskaskias, étaient sur le point d’aller en guerre contre les Iroquois, et il les en détourna par la même voie qu’il avait employée pour retenir les Miamis. Il revint ensuite à Chicagou, où il trouva des Ouyatanons, tribu miamise, qui avaient chanté la guerre contre les Scioux et contre les Iroquois; ils les obligea de désarmer, et tira d’eux parole qu’ils enverraient des députés à Montréal.
Le 5 Mai, il arriva chez les Mascoutins, qui faisaient de grands préparatifs de guerre, et il réussit, quoiqu’avec peine, à leur faire prendre des sentimens pacifiques. Il continua sa route vers la Baie, où il arriva le 14: il y rencontra des Sakis, des Otchagras, ou Puans, des Outagamis, des Pouteouatamis, des Malhomines, ou Folles-Avoines, et des Kikapous. Il parla à chaque tribu en particulier, puis il les assembla toutes, et après bien des contestations, il arrêta trois cents guerriers, qui allaient partir pour courir sur les Scioux, et il obtint de chacun de ces peuples des députés pour la paix générale.
Il arriva le 2 Juillet, à Michillimakinac, après une course de plus de quatre cents lieues: il y trouva toutes choses mises en bon ordre par les soins du P. Anjelran. Ils convinrent entr’eux que le jésuite partirait incontinent pour Montréal, et que M. de Courtemanche attendrait à Michillimakinac les députés qu’il n’avait pas amenés avec lui. Après avoir surmonté encore quelques difficultés, particulièrement au sujet des prisonniers iroquois, ce dernier partit pour Montréal avec une flotte de cent quatre-vingts canots.
Après les audiences privées dont nous venons de parler, et où M. de Callières n’eut pas peu à faire pour donner satisfaction à tout le monde, et pour amener les chefs à ce qu’il désirait, la première conférence publique eut lieu, le 1er. Août. Comme il allait commencer sa harangue, Kondiaronk tomba en défaillance. On le secourut avec d’autant plus d’empressement que le gouverneur général fondait sur lui sa principale espérance pour le succès de son grand ouvrage. Il lui avait presque toute l’obligation de ce merveilleux concert, et de cette réunion, sans exemple jusqu’alors, de tant de tribus sauvages pour la paix générale. Quand on l’eut fait revenir à lui, on le fit asseoir dans un fauteuil, au milieu de l’assemblée, et chacun s’approcha pour l’entendre.
Il parla longtemps, et comme il était naturellement éloquent, et que personne parmi les sauvages n’eut peut-être jamais plus d’esprit que lui, on l’écouta avec la plus grande attention. Il fit avec modestie et en même temps avec dignité le récit de tous les mouvemens qu’il s’était donnés pour ménager une paix durable entre toutes les nations: il fit comprendre la nécessité de cette paix, les avantages qui en reviendraient à tout le pays en général, et à chaque peuple en particulier, et démêla avec une singulière adresse les différents intérêts des uns et des autres. Puis, se tournant vers le chevalier de Callières, il le conjura de faire en sorte que personne n’eût à lui reprocher d’avoir abusé de la confiance qu’on avait eue en lui.
Sa voix s’affaiblissant, il cessa de parler, et reçut de toute l’assemblée des applaudissemens qu’il ne manquait jamais de recevoir lorsqu’il parlait en public, même de la part de ceux qui ne l’aimaient pas. “Il ne brillait pas moins, ajoute Charlevoix, dans les conversations particulières, et on prenait souvent plaisir à l’agacer pour entendre ses reparties, qui étaient toujours vives, pleines de sel, et ordinairement sans réplique. Il était en cela le seul homme du Canada qui pût tenir tête au comte de Frontenac, lequel l’invitait souvent à sa table, pour procurer cette satisfaction à ses officiers. Dans les commencemens, il disait qu’il ne connaissait parmi les Français que deux hommes d’esprit, le comte de Frontenac et le P. Carheil. Il en connut d’autres dans la suite, auxquels il rendit la même justice.”
Le gouverneur général lui fit répondre qu’il ne séparerait jamais les intérêts de la nation huronne de ceux des Français, et qu’il lui donnait sa parole d’obliger les Iroquois à satisfaire les alliés des uns et des autres, particulièrement sur l’article des prisonniers.
Il se trouva plus mal à la fin de la séance, et on le porta à l’hotel-dieu, où il mourut, vers les deux heures du matin, après avoir reçu les derniers secours de la religion chrétienne, qu’il avait embrassée. Sa mort causa une affliction générale, et il n’y eut personne, tant parmi les Français que parmi les sauvages, qui n’en donnât des marques sensibles. Son corps fut quelque temps exposé, en habit d’officier, ses armes à côté, ayant dans les troupes françaises le rang et la paie de capitaine. Le gouverneur et l’intendant allèrent les premiers lui jetter de l’eau bénite, et ensuite le sieur Joncaire, à la tête de soixante guerriers du Sault St. Louis, qui pleurèrent le mort et le couvrirent, c’est-à-dire firent des présens à ceux de sa nation.
Le lendemain, on fit ses funérailles, qui eurent quelque chose de magnifique et de singulier. M. de St. Ours, premier capitaine, ouvrait la marche avec soixante soldats sous les armes. Ensuite venaient seize guerriers hurons, marchant quatre à quatre, vêtus de longues robes de castor, le visage peint en noir, et le fusil sous le bras. Le clergé venait après, et six chefs de guerre portaient le cercuil, Qui était couvert d’un poële semé de fleurs, sur lequel il y avait un chapeau avec un plumet, un hausse-col et une épée. Les frères et les enfans du défunt étaient derrière, accompagnés de tous les chefs des nations, et M. de Vaudreuil, gouverneur de la ville, fermait la marche.
A la fin du service, il y eut deux décharges de mousquet, et une troisième, après que le corps eut été mis en terre. Il fut enterré dans la cathédrale, et l’on grava sur la tombe cette inscription: Cy gît le Rat, Chef Huron. “Kondiaronk, son vrai nom, dit un autre historien, eût été aussi harmonieux et aussi convenable.”
Une heure après les obsèques, M. Joncaire mena les Iroquois de la Montagne complimenter les Hurons, auxquels ils présentèrent un soleil et un collier de porcelaine: ils les exhortèrent à conserver l’esprit et à suivre toujours les vues du grand homme qu’ils venaient de perdre, et à ne se départir jamais de l’obéissance qu’ils devaient à leur père Ononthio. Les Hurons le promirent, et tinrent parole.
Cependant la maladie s’était mise dès le commencement parmi les sauvages, et plusieurs des plus considérables en étaient déjà morts, surtout parmi les Hurons. Cet accident obligea le gouverneur à presser la conclusion du traité. II était convenu de tout dans les audiences particulières, et il ne s’agissait plus que de signer les articles et de publier la paix. Il indiqua la dernière assemblée générale au 4 Août, et il voulut qu’on n’omit rien pour qu’elle fût aussi solennelle que possible. On choisit pour cela une grande plaine hors de la ville; on y fit une double enceinte de cent vingt-huit pieds de long sur soixante et douze de large, l’entre-deux en ayant six. On ménagea, à l’un des bouts, une salle couverte d’environ trente pieds en quarré, pour les dames et le beau monde de la ville. Les soldats furent placés tout autour, et treize cents sauvages furent arrangés dans l’enceinte en très bel ordre. M. de Champigny, M. de Vaudreuil et les principaux officiers environnaient le gouverneur général, qui était placé de manière à pouvoir être vu et entendu de tous, et qui parla le premier. Il dit en peu de mots, que l’année précédente, il avait arrêté la paix entre toutes les nations; mais que comme de toutes celles du nord et de l’ouest il ne s’était trouvé à Montréal que des Hurons et des Outaouais, il avait fait savoir aux autres qu’il désirait qu’elles lui envoyassent des députés, afin que tous étant assemblés, il pût leur oter solennellement la hache des mains, et déclarer à tous ceux qui le reconnaissaient pour leur père, qu’il voulait être désormais le seul arbitre de leurs différens; qu’ils oubliassent donc le passé, et qu’ils remissent tous leurs intérêts entre ses mains, devant se convaincre qu’il leur rendrait toujours une égale justice; qu’ils devaient être las de la guerre, dont ils n’avaient tiré aucun avantage, et que quand ils auraient une fois goûté les douceurs de la paix, ils lui sauraient gré de tout ce qu’il avait fait pour la leur procurer.
Les interprètes ayant répété aux sauvages, dans leurs différentes langues, le discours que M. de Callières venait de leur adresser, tous applaudirent avec de grandes acclamations. On distribua ensuite des colliers à tous les chefs, qui se levèrent les uns après les autres, et qui marchant gravement, revêtus de longues robes de peaux, allèrent présenter leurs prisonniers au général, avec des colliers, dont ils lui expliquèrent le sens. Ils parlèrent tous avec esprit, et même avec politesse; mais ils eurent grand soin de faire entendre qu’ils sacrifiaient leurs intérêts particuliers au désir qu’ils avaient de contenter leur père. Le général leur répondit a tous d’une manière obligeante, et à mesure qu’ils lui présentèrent des prisonniers, il les remit entre les mains des Iroquois.
Cette cérémonie, très sérieuse de la part des sauvages, fut pour les Français une espèce de comédie burlesque, qui les réjouit beaucoup. La plupart des députés, surtout ceux des tribus les plus éloignées, s’étaient habillés et parés d’une manière tout-à-fait grotesque, et qui faisait un contraste fort plaisant avec la gravité qu’ils affectaient.
Le chef des Algonquins était vêtu en voyageur canadien, et avait accommodé ses cheveux en tête de coq, avec un plumet rouge, qui en formait la crête, et descendait par derrière. C’était un jeune homme de haute taille et de belle mine, et le même qui avec trente jeunes guerriers de sa nation, avait défait, près de Catarocouy, le parti d’Iroquois où avait péri le grand chef de guerre onnontagué appelle La-Chaudière-Noire. Ce brave s’avança vers le gouverneur d’un air noble et dégagé, et lui dit: “Mon père, je ne suis point homme de conseil, mais j’écoute toujours ta voix; tu as fait la paix, j’oublie tout le passé.”
Onanguicé, chef des Pouteouatamis, s’était coiffé avec la peau de la tête d’un jeune taureau, dont les cornes lui pendaient sur les oreilles. Le chef des Outagamis s’était peint tout le visage en rouge, et avait mis sur sa tête une vieille perruque fort poudrée et très mal peignée; ce qui lui donnait un air affreux et ridicule tout à la fois. Comme il n’avait ni chapeau ni bonnet, et qu’il voulait néanmoins saluer le gouverneur à l’européenne, il ota sa teignasse; ce qui produisit un grand éclat de rire, qui pourtant ne le déconcerta pas, et qu’il prit sans doute pour un applaudissement. Le chef des Sauteurs s’était fait avec un plumet une espèce de rayon autour de la tête, en forme d’auréole.
Après que toits les chefs, tant des nations d’en haut que des sauvages domiciliés et des Iroquois, se furent approchés du gouverneur et lui eurent fait leurs complimens, on apporta le traité de paix, qui fut signé de trente-deux députés, puis le grand calumet de paix. M. de Callières y fuma le premier; ensuite M. de Champigny, puis M. de Vaudreuil, et tous les chefs et les députés chacun à leur tour, après quoi on chanta le Te Deum. Ensuite parurent de grandes chaudières, où l’on avait fait bouillir trois bœufs. Chacun fut servi à sa place, sans bruit et sans confusion, et tout se passa gaiement. Il y eut à la fin plusieurs décharges de boëtes et de canons, et le soir, illumination et feux de joie.
Le gouverneur donna encore audience aux députés des tribus de l’ouest et du nord, le 6, et à ceux des Iroquois, le 7, pour leur faire les recommandations, ou leur donner les explications qu’il croyait nécessaires. Les Agniers n’avaient point envoyé de députés à l’assemblée générale, comme ils l’avaient promis, et M. de Callières en avait témoigné son ressentiment à ceux des autres cantons; mais ceux-ci étaient à peine partis de Montréal, que les Agniers y arrivèrent. Ils firent leurs excuses, et signèrent le traité. Quelques temps après, Joncaire revint avec très peu de prisonniers, le plus grand nombre ayant absolument refusé de le suivre. L’on crut, ou l’on feignit de croire qu’il n’y avait pas de la faute des Iroquois, et la chose en demeura là.
L’année suivante, les Cantons firent à M. de Callières une députation solennelle, pour le remercier de leur avoir donné la paix, et pour lui demander des missionnaires jésuites. Ils lui apprirent en même temps la mort de Garakonthié, qui jusqu’à son dernier moment n’avait cessé de servir utilement les Français auprès de sa nation; et ils lui présentèrent son neveu, qui s’offrit d’être, à la place de son oncle, le correspondant du gouverneur, et fut agréé.
Le général n’avait garde de ne pas prendre au mot les Iroquois au sujet des missionnaires, et il en fit partir un grand nombre pour leur pays, persuadé que s’il n’y avait pas à espérer qu’ils fissent beaucoup de prosélytes, il était néanmoins important pour la colonie qu’il y eût parmi ces barbares des personnes revêtues d’un caractère capable de leur en imposer, dont la présence les assurât qu’on voulait vivre en bonne intelligence avec eux, qui pussent éclairer leur conduite, avertir le gouverneur général de leurs démarches, les gagner par leurs bonnes manières, ou du moins se faire des amis parmi eux, et surtout éventer et déconcerter les intrigues et les projets des Anglais. Ces derniers sentaient tellement combien la présence des jésuites était préjudiciable à leurs intérêts dans les Cantons iroquois, qu’ils ne tardèrent pas à intriguer de toutes manières pour les en faire chasser.
Peu après avoir reçu la nouvelle que la guerre était déclarée entre la France et l’Angleterre, le chevalier de Callières apprit par un envoyé de M. de Brouillon, qui avait succédé à M. de Villebon dans le gouvernement de l’Acadie, qu’on attendait à Boston des vaisseaux d’Angleterre pour assiéger Québec, et croiser dans le golfe et même dans le fleuve St. Laurent, afin qu’il n’y pût entrer aucun bâtiment français. Il fut en même temps informé que les milices de la Nouvelle York étaient en route pour se rendre à Boston.
Après avoir écrit à la cour de France, pour avoir des recrues, M. de Callières songea à achever les fortifications de Québec, et prit toutes les autres mesures que lui suggérèrent son habileté et son expérience dans la guerre. “Il était lui-même, dit Charlevoix, la plus grande ressource de la Nouvelle France, mais elle eut le malheur de le perdre dans le temps qu’il lui était le plus nécessaire. Il mourut à Québec, le 26 Mai 1703, autant regretté que le méritait le général le plus accompli qu’eût encore eu cette colonie, et l’homme dont elle avait reçu de plus importants services.”
(A continuer.)

San-Salvador de Bahia fut d’abord la capitale du Brésil: aujourd’hui même que Rio Janeiro lui enlève sa prééminence, elle est encore, par son étendue, ses fortifications et ses édifices, par sa population, ses chantiers, ses magazins et sa vaste baie, une des villes les plus importantes du nouveau monde.
L’origine de cette ville a quelque chose de si singulier et de si romanesque, que nous ferons sûrement plaisir au lecteur, en lui en faisant connaître les principales circonstances.
La baie magnifique de San-Salvador avait été reconnue par Christoval Jacques, qui en fit un tel éloge à Jean III, roi de Portugal, que ce prince résolut d’y fonder un établissement. Il y envoya Coutinho, en le nommant gouverneur de tout le pays qui s’étend depuis la grande rivière de San-Francisco jusqu’à la Punta du Padram de Bahea. Celui-ci équippa quelques vaisseaux, et se mit en route pour aller entreprendre la colonisation projettée.
Dans l’intervalle, un hazard singulier avait déjà mis ces parages au pouvoir d’un jeune compatriote de Coutinho, enflammé, comme lui, de la passion des voyages et des découvertes. Ce Portugais, nommé Diego Alvarès Correa de Viana, allait aux Indes Orientales. Battu par la tempête, ainsi que l’avait été Cabral, il fut entrainé de même à l’occident, vers le Brésil. Moins heureux ou moins habile que ce navigateur célèbre, et ne pouvant plus gouverner son vaisseau, Alvarès fit naufrage sur les bas-fonds, au nord de la barre de Bahia. Une partie de l’équipage périt: ceux qui échappèrent aux vagues furent pris par les naturels du pays et mangés à la vue même d’Alvarès, qui était resté près du vaisseau échoué, pour recouvrer différents objets dont il espérait se servir pour se rendre favorables les sauvages. Ceux-ci étant rentrés dans leur aldée, Alvarès, armé d’un mousquet, osa s’aventurer tout seul sur la côte, et se mit à reconnaître le pays.
Alvarès, frappé de la beauté de tous les lieux qui s’offraient à sa vue, leur donna le nom de San-Salvador (Saint-Sauveur,) parce qu’il y avait trouvé son salut. Il apperçoit tout-à-coup une troupe de Brésiliens, armés de flèches et de massues, mais qui n’avaient pas l’air de s’avancer en ennemis. Plusieurs d’entr’eux avaient vu comme sortir de la mer le jeune Alvarès, et s’étaient tenus d’abord cachés; mais, s’avançant ensuite pleins d’étonnement, ils répondirent aux signes de bienveillance et de paix que leur fit Alvarès, s’approchèrent pour recevoir ses présens, et le traitèrent en ami. Conduit à la plus prochaine aldée, il fut présenté au cacique, dont il devint le captif, mais il reçut de lui, ainsi que de toute sa peuplade, autant d’égards que de soins.
Ces Indiens étaient de la race des Tupinambas, dont le nom signifie braves, et qui, de tous les naturels du Brésil, sont les plus jaloux de leur indépendance. Ces sauvages eurent bientôt occasion d’admirer l’intelligence et l’adresse d’Alvarès. Un jour, ayant tué avec son fusil, un oiseau devant ces sauvages, les femmes et les enfans s’écrièrent: Caramouron! caramouron! c’est-à-dire homme de feu, et témoignèrent la crainte de périr ainsi de sa main. Alvarès, se tournant alors vers les hommes, dont l’étonnement était mêlé d’une moindre frayeur, leur fit entendre qu’il irait avec eux à la guerre, et qu’il tuerait leurs ennemis. Ils marchèrent aussitôt contre les Tapuyas. La renommée de l’arme terrible de l’homme de feu le précédait, et les Tapuyas s’enfuirent. Caramouron fut le nom sous lequel Alvarès Correa fut connu depuis chez les Tupinambas, et même parmi les Portugais.
Bientôt les Tupinambas attribuèrent à Caramouron une puissance surnaturelle, et eurent pour lui des respects et des déférences qu’ils ne rendaient pas au même degré à leurs chefs. Caramouron devint le souverain absolu de ces sauvages. En signe de respect, ils le revêtirent d’une espèce de manteau ou tunique de coton, lui firent présent de leurs plus belles plumes, de leurs meilleures armes, et lui prodiguèrent les produits de leur chasse. Ils lui offraient à l’envi leurs filles pour épouses, et s’estimaient heureux qu’il voulût bien les recevoir.
Caramouron fixa son séjour dans le lieu où la Villa Velha (la vieille ville) fut ensuite fondée. Il devint le père d’une famille nombreuse, et encore aujourd’hui, les maisons les plus distinguées de Bahia rapportent à lui leur origine. Il fit élever d’abord quelques cabanes sur le rivage de la baie; bientôt ces cabanes, faites à la hâte, furent remplacées par des habitations plus convenables. Il établit et maintint une sorte de police dans son nouvel établissement. Des débris du navire brisé il fit construire de petites barques plus solides que les pirogues des Brésiliens, avec lesquelles il espérait reconnaitre tout le golfe. Heureux et tranquille parmi ces sauvages, il s’efforçait de les civiliser; il faisait même des dispositions pour donner à son établissement plus de consistance et une forme plus régulière, se croyant à jamais confiné parmi les Tupinambas, lorsque parut tout-à-coup, à l’entrée de la baie, un navire normand, parti de Dieppe pour faire des découvertes dans le Brésil.
Caramouron et les sauvages reçurent amicalement les Français, avec qui l’on fit, pendant plusieurs jours, un commerce d’échanges. Mais l’arrivée imprévue du navire européen avait fait naître l’idée à Caramouron de retourner dans sa patrie, et d’aller rendre compte au roi de Portugal, de son naufrage et de son heureux établissement à San Salvador. Il espérait par là mériter la protection et les encouragemens du monarque. Il obtint facilement le passage pour lui et pour Paraguazon, sa femme favorite, dont il ne voulait pas se séparer. Il promit à ses hôtes de revenir bientôt, et s’embarqua, emportant avec lui des échantillons de la richesse et des curiosités du Brésil. Mais ses autres femmes indiennes ne purent supporter cet abandon: elles suivirent le vaisseau à la nage, dans l’espoir d’être prises à bord. La plus courageuse ou la plus passionnée s’avance si loin, qu’avant de pouvoir revenir au rivage, ses forces l’abandonnent, et elle meurt victime de son amour pour Caramouron.
Arrivé en France, Caramouron parut à la cour de Henri II, sous les auspices du capitaine auquel il devait son retour en Europe. Lui et Paraguazon furent reçus et traités avec amitié par Catherine de Médicis. La jeune Indienne attirait surtout la curiosité des courtisans français, étonnés de voir la fille d’un chef de sauvages au milieu de la cour la plus polie de l’Europe. On s’empressa de la conquérir à la religion, et Paraguazon fut baptisée avec solennité. La reine lui donna son nom de Catherine et lui servit de marraine. Le roi lui servit de parrain.
Cependant Caramouron, voulant partir pour Lisbonne, le roi de France lui en refusa l’autorisation. On avait l’intention de se servir de lui dans les pays qu’il avait découverts. Il fit donc une convention avec un riche commerçant français, en vertu de laquelle deux vaisseaux chargés d’objets utiles pour le trafic avec les naturels brésiliens, furent mis à sa disposition, de même que les munitions et l’artillerie de ces vaisseaux, dès qu’ils seraient arrives à Bahia. Caramouron s’engagea, de son côté, à les charger pour leur retour de bois de brésil et d’autres objets de commerce. Mais, avant de partir, il avait fait connaître au roi de Portugal, pur une voie secrète, la découverte importante qu’il avait faite dans le nouveau monde.
Arrivé à San-Salvador avec sa femme Catherine, il fut reçu par les sauvages avec d’incroyables transports de joie. Sa femme Paraguazon, fière du nom de Catherine et des talens qu’elle avait acquis en Europe, fit tous ses efforts pour convertir et pour civiliser ses sauvages compatriotes. Déjà au milieu des premières cabanes, une église venait d’être élevée; déjà même Caramouron avait distribué plusieurs plantations à sucre, commencé la culture des terres, rassemblé par des bienfaits les naturels, jusqu’alors errants et dispersés, lorsque parut dans la baie l’expédition préparée à Lisbonne, et commandée par Coutinho, pour venir prendre possession de la province entière; apparition sinistre, qui jetta la consternation dans toute la colonie.
Armé de l’autorité royale, Coutinho s’établit dans la colonie de Caramouron. Bientôt ne voyant dans celui-ci qu’un rival secret de son pouvoir, il commença à déployer l’appareil de la force, à condamner tout ce qui avait été fait par lui, et à blamer surtout les voies de douceur dont Caramouron s’était servi pour civiliser les sauvages. Les soldats signalèrent leur arrivée par toutes sortes de violences et de rapines; l’un d’eux tua le fils d’un chef des naturels. Coutinho paya chèrement cette nouvelle offense. Les fiers Tupinambas, ne respirant plus que vengeance, deviennent l’objet d’une longue persécution qu’ils endurent d’autant plus impatiemment qu’ils sont moins accoutumés à la servitude et à l’oppression. Caramouron veut plaider pour ses amis, pour ses hôtes, pour ses bienfaiteurs: il est, par ordre de Coutinho, enlevé à sa femme, et transféré à bord d’un navire. Le bruit de sa mort, faussement répandu, jette le désespoir dans l’âme de Paraguazon, qui appelle à la vengeance, non seulement les sauvages de sa nation, mais encore leurs voisins les Tamoyos.
Les redoutables Tupinambas, les plus vaillants de tous les Brésiliens, font tête aux Portugais, brûlent les sucreries, détruisent les plantations, tuent un fils de Coutinho, et après une guerre de plusieurs années, ils emportent enfin les ouvrages élevés par les Portugais, et forcent leur chef à chercher son salut sur ses vaisseaux.
Mais à peine était-il parti que quelques chefs des Tupinambas, qui regrettaient les marchandises d’Europe, devenues enfin des besoins pour ces malheureux sauvages, firent un traité avec lui, et l’engagèrent à revenir à San-Salvador. Coutinho revint donc, suivi de Caramouron, qui était dans une caravelle séparée. Mais comme ils étaient à la vue du golfe, une tempête, s’élevant tout à coup, les fit échouer sur les bas-fonds de l’île d’Itoporica. Témoins de ce naufrage, les Tupinambas, qui avaient reconnu leur oppresseur, s’arment de leurs massues de guerre, malgré l’opposition de ceux de leurs chefs qui avaient rappellé Coutinho, et se jettant en foule dans leurs pirogues, ils joignent les insulaires, qui étaient aux prises avec l’équipage de Coutinho. Ce capitaine avait déjà gagné le rivage; mais il n’était échappé à la fureur des flots que pour tomber sous les coups des sauvages. Sa tête, détachée de son corps et parée de plumes, fut portée en triomphe par les vainqueurs. Les prisonniers furent assommés et dévorés; il n’y eut que les équipages de Caramouron qui furent épargnés; et lui-même, rentrant dans son ancienne habitation, releva sa colonie avec le secours des Tupinambas, sur lesquels il reprit son premier ascendant.
La colonie resta dans cet état jusqu’en 1549, où donc Thomé de Souza fut nommé gouverneur général du Brésil. Il vint aborder à Bahia, où il fut reçu par Caramouron, déjà vieux, qui lui concilia le cœur des habitans, et lui donna ainsi les moyens de poser les fondemens de la ville de San-Salvador, à une demi—lieue de l’ancien établissement. Cette ville devint bientôt la plus florissante du Brésil. (Beautés de l’Histoire d’Amérique.)

Mme de Krudner a brillé à Paris, comme jolie femme, comme femme auteur, comme chef de secte. De la beauté, des talens, de l’enthousiasme porté à l’extrême, voilà plus de titres qu’il n’en faut pour devenir promptement célèbre. Mme de Krudner le fut beaucoup, durant sa courte mais orageuse carrière. Elle esseya d’abord de l’empire de la beauté. Il serait inouï qu’une femme douce de cet entraînant prestige, ne l’eût regardé que comme un accessoire aux charmes de son esprit; une foule d’adorateurs tomba à ses pieds. Elle eut un moment de bonheur; mais son cœur impatient voulut aller au-delà même de ce qu’elle avait désiré avec tant d’ardeur, et de cruels mécomptes la désabusèrent. Détrompée sur la puissance persévérante de la beauté, elle voulut conquérir un autre sceptre qu’elle était digne sans doute de porter; et elle composa Valerie. Le succès qu’obtint cet agréable ouvrage plaça Mme de Krudner au-dessus de Mme Cottin, et à côté de Mme Flahaut de Souza. Les lauriers se mêlèrent alors aux myrtes pour former sa couronne; mais elle prétendit les relever merveilleusement en y joignant les épines de la pénitence et les palmes du martyre. Toute l’énergie de la tête masculine la plus fortement constituée eût à peine suffi pour supporter le fardeau qu’elle s’imposait: car il ne s’agissait de rien moins que de subjuguer, que d’entraîner, à la fois, les rois et les peuples, les armées combattantes et les spectateurs inoffensifs dont les intérêts venaient de se discuter à coups de canon et de se régler sans leur avis. “La Providence est grande, disait Mme de Krudner; Jesus-Christ naquit dans une étable, et son adorable mère partage aujourd’hui la gloire ineffable du Dieu des chrétiens.” Toutefois elle ne se présenta que comme une Madeleine pénitente; mais elle se mit à prêcher. Il y avait du charme dans ses discours, bien qu’à force de torturer le dogme, qu’elle ne comprenait certainement pas, elle finit par poser des principes que la religion chrétienne et la morale universelle pouvaient considérer comme des blasphêmes. Elle fit spectacle, et c’est là surtout ce qu’elle ambitionnait. L’empereur Alexandre parut à ses conférences mystiques, à Paris. J’eus l’honneur d’y assister, et son entourage me rappela les scènes fantasmagoriques de Robertson, ou plutot les mystérieuses soirées de Cagliostro. Vêtue de blanc, prosternée d’abord, se relevant ensuite avec grâce, les cheveux épars, l’air inspiré, la voix haute, elle semblait jouir de l’étonnement qui se peignait dans les regards des assistans. Sa fille, jeune et belle, l’accompagnait sous le même costume; ses charmes purs et l’innocence qui brillait dans toute sa personne, détournaient plus d’un néophyte de l’attention qu’on devait aux discours de la mère. Je l’avouerai, je ne fus nullement touché. Cette comédie, jouée à Paris, me parut une honteuse profanation des cérémonies des religions chrétiennes. La présence de plusieurs grands personnages me donna lieu de supposer que ces réunions avaient un but politique que l’on cachait sous ce voile singulier. En effet, on a prétendu que Mme de Krudner avait été l’inspiratrice du traité connu sous le nom de Sainte-Alliance. Je ne puis le croire encore. Un traité conçu dans l’ombre, et sous le honteux attirail de la déception, ne pouvait être qu’une œuvre de ténèbres, et des princes chrétiens ne l’eussent pas hautement avoué, D’ailleurs, Mme de Krudner avait un cœur tout dévoué à l’amour du prochain, et ce n’est pas exactement là le sentiment qui domine dans le traité.
On n’est pas longtemps dupe à Paris des prétendues inspirations divines. Mme de Krudner sentit qu’à l’étonnement allaient succéder le dédain et le ridicule; elle se hâta de partir pour la Suisse, où elle ouvrit son temple, qui se remplit à l’instant d’une foule de gros Teutches, suivant l’expression de J.-J. Rousseau, gens essentiellement admiratifs, et peu portés à la réflexion. La prêtresse se trouva bientôt à l’étroit dans l’enceinte des édifices construits par la main des hommes; elle éleva son autel en plein air; quatre ou cinq mille personnes la suivirent de village en village, et, comme la charité est encore de l’amour, une troupe nombreuse de mendians dut à l’auteur de Valerie la nourriture et le logement. Alors commencèrent les miracles et les persécutions. Mme de Krudner annonça la fin du monde, imposa les mains aux malades, et enseigna une doctrine quelque peu contraire à la fidélité conjugale. Il en résulta que plusieurs femmes, ou filles abandonnèrent leurs maris et leurs familles, et suivirent la Madeleine qui leur ouvrait des routes inusitées pour gagner le ciel. Mais les gouvernemens ne goutèrent pas un code de morale d’une si étrange nature. Invitée à quitter la Suisse, et successivement le grand duché de Bade, la Prusse et la Russie, Mme de Krudner prêcha et voulut convertir les officiers de police: un peu de martyre eût assuré sa mission; on lui refusa jusqu’à ce plaisir; et tout ce qu’elle put obtenir, ce fut la permission d’aller en Crimée se faire des prosélytes parmi les Cosaques, les Baskirs et les Tatares du Kouban. Elle y trouva le dénoûment de son roman, et ses cendres reposent sur les bords de la mer d’Asof.
Voilà l’histoire de la vie publique de Mme de Krudner, telle que je l’ai connue. Elle possédait toutes les qualités qui peuvent faire une femme accomplie: il ne lui manquait que du bon sens. Tourmentée d’un désir insatiable de célébrité, elle y sacrifia jusqu’il ce vernis de décence qu’aiment à conserver les femmes les plus corrompues; et cependant, si elle fut faible, elle n’était point dépravée. Sa conduite, durant ses dernières années, ne fut qu’un long accès de folie. Il faut la plaindre; il faut gémir sur le triste sort d’un être si remarquable, si bien fait pour plaire et pour être aimé, et qui a manqué sa destinée.

M. Cuvier présente à l’Académie le dessein, qui lui a été envoyé par M. Schleïr Macher, directeur du comté de Darnestadt, de la mâchoire d’un énorme animal inconnu. On avait déjà rencontré plusieurs dents semblables à celles que porte cette mâchoire. Ces dents, carrées et à deux collines transverses, assez semblables à celles du tapir, avaient fait croire à l’existence antédiluvienne d’une espèce gigantesque de ces animaux. La découverte de M. Schleïr Macher détrompera les naturalistes. L’animal dont il a trouvé un reste si précieux appartenait à un genre nouveau, et ses dimensions étaient vraiment extraordinaires. En supposant en effet que chez lui le corps fût aussi peu volumineux en proportion de la tête qu’il est chez l’hyppopotame (celui de tous les quadrupèdes chez lequel la proportion de la longueur de la tête à celle du corps est la plus petite); on trouverait encore que la longueur totale aurait été de 19 pieds. Jusqu’ici le quadrupède connu le plus volumineux était un paresseux gigantesque, le mégalonix, qui n’avait pourtant que 12 pieds de longueur.
La mâchoire dont il est ici question a été trouvée à Eppenheim, canton d’Arrey, sur la rive gauche du Rhin, pays de Darnestadt.
Le dessin envoyé à M. Cuvier était exécuté au quart de la grandeur naturelle. M. Cuvier l’a fait copier de grandeur naturelle.
Nouvelles découvertes de fossiles dans la Montagne de Périer.
M. Cuvier fait un rapport verbal sur le premier volume de l’ouvrage intitulé: Recherches sur les ossemens du département du Puy de Dôme, par MM. l’abbé Croiset et Jobert ainé.
M. le rapporteur commence par rappeller un autre ouvrage sur le même sujet publié par MM. Deveze de Chabrol et Bouillé Cordier sur lequel M. a fait un rapport.[1]
Aux lumières que ces deux écrits nous fournissent, on doit ajouter plusieurs renseignemens communiqués à MM. les commissaires par M. le comte de Laiser, minéralogiste distingué, qui, dès 1824, avait, dans une séance publique de la Société géologique d’Auvergne, présenté quelques échantillons des os des mêmes lieux, qui font l’objet principal de ces deux ouvrages, et des coupes indiquant les positions des terrains qui les recèlent. C’est d’après ces documens que M. Cuvier donne une idée du gîte intéressant qui a occupé ces différents observateurs.
Les fossiles de la montagne de Périer ou de Boulade (car elle porte ces deux noms selon le village par lequel on y monte) se trouvent répandus dans trois couches distinctes. Les deux premières appartiennent à la troisième époque des alluvions anciennes, à celle qui a succédé à la deuxième époque des productions des volcans: la dernière couche fossile appartient à la quatrième et dernière époque des alluvions anciennes. Cependant toutes les couches ne se trouvent pas dans la montagne même de Périer, et c’est du rapprochement et de la comparaison des diverses montagnes du même ordre que les auteurs en ont déduit l’ensemble.
Le nombre des espèces reconnues par MM. Croiset et Jobert est maintenant de près de quarante, savoir; un éléphant, un ou deux mastodontes, un hippopotame, un tapir, un cheval, un sanglier, cinq ou six felis, deux hyènes, trois ours, un canis, une loutre, un castor, un lièvre, un rat d’eau, quinze cerfs, et deux bœufs. Leurs felis et leurs cerfs forment surtout une augmentation très importante pour la zoologie fossile; et quand il n’y aurait que ces espèces-là de constatées, cette couche ossifère de Périer prendrait son rang parmi les monumens les plus remarquables de l’ancien monde. Or, sans vouloir garantir que toutes les différences que les auteurs ont remarquées soient spécifiques, M. Cuvier déclare pouvoir, sur plusieurs espèces de ces deux genres, dont ils lui ont montré des fragmens, joindre son témoignage au leur; et, sur le seul aspect des figures, qu’ils ont données des bois, il n’est, dit-il, aucun zoologiste qui ne convienne que ce doivent être des espèces différentes de celles que nous connaissons. En général, on ne saurait assez louer la patience ingénieuse avec laquelle MM. Croiset et Jobert ont rapproché et comparé tant de fragmens, surtout quand on considère qu’ils n’ont eu souvent pour point de comparaison que les figures des livres, ressource presque toujours si insuffisante.
Le point qui paraît avoir été le plus fécond en fossiles est un ravin dit des étuaires, où la couche qui les renferme est à jour des deux côtés. On y a trouvé des os de plus de trente espèces. Quelquefois ceux d’un même individu sont encore rapprochés; plus souvent ils sont épars. Les genres, les espèces y sont entassés pêle-mêle; on y trouve des os de tous les âges. Les individus de certaines espèces s’y trouvent en très grand nombre. Il y en a beaucoup de brisés; d’autres qui portent l’empreinte de la dent des carnassiers. Les excrémens de ces mêmes carnassiers s’y montrent aussi; mais aucun de ces os n’est roulé, et aucun fossile marin ne les accompagne. Tout fait croire aux auteurs que la couche qui les supporte était le sol même sur lequel ils ont vécu, et que les lignites que l’on y rencontre sont les débris des végétaux qui les nourrissaient. Ces messieurs n’ont encore décrit dans leur premier volume que les pachydermes et les carnassiers; ils ont déjà livré au public les figures des ruminants des mêmes terrains. Ils font espérer des descriptions et des figures d’autres ossemens trouvés dans des terrains plus anciens, et qui appartiennent, comme on devait s’y attendre, à des genres tout différents, et qui rentrent dans ceux de l’avant-dernière époque de M. Cuvier, et se rapprochent plus ou moins des palæotherium, des anoplotherium, ou des lophiodons. Déjà, depuis long-tems, M. Brogniart avait découvert une mâchoire de palæotherium dans un terrain semblable, au Puys en Velay.
M. Cuvier met sous les yeux de l’Académie un échantillon de ces animaux de terrains d’eau douce. C’est une portion de mâchoire d’un pachyderme qui paraît avoir eu de grands rapports avec son genre anthracotherium. Malheureusement il ne s’y trouve que deux dents incisives, et l’intervalle entre ces dents et les premières molaires a été mutilé. C’est aussi dans ces terrains, d’une origine plus ancienne, que se trouvent les os d’oiseaux, dont l’Auvergne est si riche, et MM. Croizet et Jobert en ont fait une collection qu’ils rapportent à trois ou quatre espèces. Ils ont trouvé jusqu’à des œufs parfaitement conservés.
Ces découvertes d’objets d’une autre époque ont engagé les auteurs à étendre leurs recherches au-delà de la montagne de Périer ou de Boulade, qui en avait d’abord été l’objet unique, ils ont cru devoir embrasser dans leur discours préliminaire l’ensemble des couches de l’Auvergne, et ils ont même présenté un système applicable à la théorie de là terre tout entière.
Leur exposition des couches de l’Auvergne a de l’intérêt comme présentant en abrégé la disposition d’une province où la géologie offre des phénomènes très particuliers. Toute la formation secondaire n’y est représentée que par le terrain houiller. Quant aux formations tertiaires, les auteurs reconnaissent aujourd’hui, comme M. Brogniart l’avait annoncé dès 1811, et M. Delaizer en 1824, que, dans les contrées qu’ils décrivent, il n’en existe aucune d’origine marine, et que des masses immenses, uniquement remplies de produits de la terre et de l’eau douce, y sont tellement liées entr’elles, qu’elles doivent, de toute évidence, avoir été déposées dans une période non interrompue, et sans qu’aucun évènement géologique un peu important soit venu morceler leurs points de contact ou altérer leur régularité. Il y en a des couches accumulées sur 200 mètres d’épaisseur; les plus élevées se portent à près de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, et on peut en trouver jusqu’aux bords de l’Allier qui n’est guère qu’à 300 mètres, ce qui leur fait supposer que cette formation s’est faite dans des lieux placés à des niveaux différents. Les os y sont épars, non roulés; souvent ces os très grêles y sont entiers: ce qui prouve qu’ils étaient déposés à mesure que les animaux dont ils proviennent mouraient. Dans le gisement de Volvic, les os d’oiseaux sont confondus avec des lymnes et des bélices.
Le sol habité ne se composait que des sommités granitiques qui s’élèvent de 300 et de 800 mètres au-dessus des plus hautes couches d’eau douce.
M. Cuvier ne suit les auteurs ni dans leurs observations (d’ailleurs pleines d’intérêt) sur les terrains volcaniques de leur province, ni dans leur systême général sur la théorie de la terre, systême à la vérité entièrement original et même contraire à tous ceux qui existent, car c’est de l’intérieur même du globe qu’ils font sortir à mesure de son refroidissement beaucoup de matières qui l’enveloppent et même l’eau qui en a couvert si longtemps une grande partie. Ils y font une application ingénieuse des idées de M. Delaplace et de celles de M. Cordier; mais ce systême aurait besoin de plus grands développemens. Le mérite de l’ouvrage de MM. Croizet et Jobert consiste surtout à faire connaître une multitude d’espèces fossiles auparavant inconnue et à confirmer de plus en plus cette présomption du rapporteur que ce que l’on a découvert en ce genre n’est qu’une petite partie de ce qui reste à découvrir.
|
MM. Jobert et Croizet ne s’accordent pas entièrement avec MM. Devèse et Bouillé sur l’énumération des différents terrains supérieurs au calcaire lacustre; mais ces observateurs sont tous unanimes sur la position relative des couches de sable qui contiennent des ossemens, des couches de galets et de déjections volcaniques qui les recouvrent, et des immenses dépôts de calcaires d’eau douce qui leur servent de base, c’est-à-dire sur les points les plus importants. |

Le nom de météores se donne indistinctement à tous les corps et phénomènes qui se forment et apparaissent dans le ciel.[1] Nous ne nous occuperons ici que de ceux qu’on appelle globes de feu, et qui, se montrant tout à coup dans les régions les plus élevées de l’atmosphère, où ils se meuvent en ligue horizontale, et avec une vitesse extraordinaire, disparaissent, soit sans bruit, soit avec explosion, en laissant après eux une trainée lumineuse qui subsiste pendant quelques secondes. Tout porte à croire qu’ils sont de la même nature que les étoiles tombantes, dont ils ne diffèrent effectivement que par l’étendue de leur volume, l’éclat de leur lumière, et des intermédiaires qui les unissent évidemment les unes avec les autres.
Parmi les météores dont l’apparition a été la plus remarquable, celui qui a été vu à l’orient de Cumana, dans l’Amérique méridionale, tient le premier rang. Ce fut le 12 Novembre 1799, à deux heures et demie du matin, que ce phénomène se manifesta par la présence de mille globes qui se succédèrent dans une direction régulière du midi au nord. L’air était frais et le ciel serein. Ces météores remplirent d’abord dans le ciel un espace qui s’étendit de l’orient environ 50 degrés du côté du midi, parurent ensuite s’élever de soixante au-dessus de l’horizon, dans la direction de l’est-nord-est, et décrire à l’est des arcs qui tombaient du côté du midi, après avoir suivi la direction du méridien. Plusieurs de ces arcs atteignirent une hauteur de 40 degrés, et tous s’élevèrent au-dessus de 25 ou 30.
On remarqua que dans le premier moment où ce phénomène fut apperçu, il y eut dans le ciel un espace égal en étendue à quatre diamètres de la lune, où il ne parut ni globes de feu, ni étoiles tombantes; mais tous ces météores s’étant bientôt réunis, ils laissèrent derrière eux des traces lumineuses longues de cinq jusqu’à dix degrés, et dont la durée était de sept à huit secondes. On voyait distinctement dans la plupart des globes, un nucleus aussi large que le disque de Jupiter, d’où partait une vive lumière accompagnée d’étincelles, et lorsqu’ils éclataient il y avait toute apparence que c’était à la suite d’une explosion. Cependant les plus grands, qui avaient un degré et quinze minutes de diamètre, disparaissaient sans scintillation, en laissant toutefois derrière eux une trace phosphorique de 15 à 20 minutes. La lumière de ces météores, au lien d’être couleur de feu, était blanche, ce que l’on doit attribuer à l’absence des vapeurs, ou à l’extrême transparence de l’air; de même que sous les tropiques les grandes étoiles ont une lumière infiniment plus blanche qu’en Europe.
Ce ne fut pas sans effroi que les habitans de Cumana virent ce phénomène, car les vieillards se rappellèrent que le tremblement de terre de 1766 avait été précédé d’une apparition semblable. Tous les pêcheurs, qui avaient profité de la beauté de la nuit pour tendre leurs filets dans le golfe, assurèrent qu’il avait commencé à une heure après minuit, par quelques petites étoiles tombantes qui s’étaient montrées du côté de l’orient. Ils affirmèrent aussi, d’après les observations que leur état les met souvent dans le cas de faire, qu’il était très rare de voir des météores paraître sur ces côtes, après deux heures du matin.
Quatre heures s’étant écoulées, pendant lesquelles l’air ne cessa pas d’être en feu, les globes et les étoiles tombantes devinrent moins fréquents; mais on apperçut cependant encore quelques unes de ces dernières un quart d’heure après le lever du soleil. Leur lumière, à la vérité, était entièrement blanche, et leur disparition plus prompte. Cette circonstance, qui peut paraître d’abord extraordinaire, cessera de l’être, lorsqu’on saura qu’en 1788 toutes les maisons de Papoyan furent frappées d’une brillante lumière par un météore d’une immense grandeur, qui passa sur la ville à une heure après midi, et le 21 Septembre 1800, un savant, M. Bonpland, ayant observé à Cumana, l’immersion du premier satellite de Jupiter vit très distinctement la planète jetter encore de la lumière, après que le soleil eut paru sur l’horizon. Cela s’explique facilement par la pureté et la transparence de l’atmosphère sous la zone torride.
Des recherches faites postérieurement, à la Guiane, dans la contrée sauvage qu’arrose le Rio Negro, soit auprès des habitans qui passent la nuit en plein air, soit auprès des missionnaires et des religieux qui sont établis à Oronoko et à Maroa, ont prononcé que le 12 Novembre 1799, la voûte du ciel avait été extraordinairement éclairée par un grand nombre de globes de feu et d’étoiles tombantes. Maroa, situé au sud-ouest de Cumana, en est distant de cent soixante quatorze lieues; d’où l’on peut conclure que ce phénomène a dû être visible au vingtième degré de l’horizon. Il paraît également certain qu’il a été vu à San-Gabriel de Cachoeiras, sur les frontières du Brésil, c’est-à-dire à l’équateur même.
Si l’étonnement est déjà grand de savoir que ce phénomène du 12 Novembre 1799 a été vu le même jour à Cumana et sur les frontières du Brésil, dans une ligne de deux cent trente lieues de long, que sera-t-il donc, lorsqu’on apprendra qu’il a encore été observé, à la même époque, dans le golfe de Floride, à Weimar, en Allemagne, et à Herrenhut, dans le Groenland? La distance de Weimar à Rio Negro est de 1800 lieues de mer; et de Rio Negro à Herrenhut, dans le Groenland, de 1300. En admettant maintenant que le même météore a été apperçu, en même temps, à des points si éloignés les uns des autres, et dans un espace de 921,000 lieues carrées, il faut nécessairement admettre aussi que son élévation a été de 411 lieues.
Des observations faites récemment sur les étoiles tombantes et leurs parallaxes[2] peuvent les faire considérer comme des météores qui appartiennent aux points les plus reculés de notre atmosphère, entre la région des aurores boréales et celle des nuages légers. On a vu de ces météores qui n’avaient pas plus de 14,000 toises, ou cinq lieues d’élévation. Les plus élevés paraissent n’en avoir que trente. Leur diamètre est souvent de plus de cent pieds, et leur vitesse est telle, que leur lumière frappe presque dans le même moment un espace de deux lieues. On en a mesuré plusieurs. Leur direction, prise d’en haut, était presque perpendiculaire, et formait un angle de 50 degrés avec la ligne verticale. Cette circonstance conduit naturellement à conclure que les étoiles tombantes ne sont pas des aérolithes,[3] qui après avoir parcouru, pendant un assez long temps, l’espace qui se trouve au dessus de notre atmosphère, éclatent en y entrant accidentellement, et tombent ensuite sur la terre.
Nous ne finirions pas si nous entreprenions de rendre compte de toutes les dissertations et discussions auxquelles ont donné lieu l’existence et l’origine des météores dont nous parlons. D’ailleurs, cela ne conduirait à aucun résultat certain, puisque M. Humbolt, et plusieurs autres savans d’aussi bonne foi que lui, avouent que nous sommes aujourd’hui presque aussi ignorants sur ce point qu’on l’était du temps d’Anaxagore. (Merveilles du Monde.)
|
Le tonnerre, les éclairs, la pluie, la neige, la grêle, et l’arc-en-ciel sont des météores. |
|
On appelle ainsi l’angle formé dans le centre d’un astre par deux lignes qui se tirent, l’une du centre de la terre, l’autre de l’œil de l’observateur. |
|
Météores dont le résultat est une chute de pierres sur la terra. Voyez Bib. Canad. Tome V, No. 1, page 34. |

pour l’éducation de la jeunesse, sous la direction du général Lallemant, établie à l’ancienne maison de plaisance du Colonel Varick, et comprenant le carré formé par Bleecker, Thompson, Sullivan, et Houston Streets.[1]
Former des hommes, leur offrir les moyens de prendre rang dans la société avec plus d’avantages pour elle et pour eux-mêmes, tel est le but que l’on se propose dans l’éducation.
L’enseignement pratiqué dans les collèges ne la constitue pas entièrement; il en pose les bases, en exerçant les facultés naturelles, en donnant l’habitude de l’application, le goût des sciences, et la méthode qui en ouvre la route; les leçons des parens, leurs exemples, ceux dont un jeune homme bien préparé sait profiter sur la scène du monde, les études d’un ordre supérieur auxquelles il se livre alors, achèvent l’œuvre. C’est ainsi que se dessinent les charactères.
A cette partie de l’éducation qui est du ressort des collèges sont donc attachées d’importantes fonctions. Des résultats d’un haut intérêt pour les individus, pour les familles, pour la société, découlent nécessairement de la première direction donnée aux facultés physiques, intellectuelles et morales. Comme elles ont entre’elles une action réciproque, leur développement doit être ménagé sur un plan raisonné qui embrasse leurs rapports et favorise leur marche progressive.
Un bon système d’éducation doit encore être en harmonie avec les institutions, les besoins et l’esprit du pays. Aux Etats-Unis, le citoyen ne voit à son élévation d’autres limites que celles de ses connaissances et de son talent. L’éducation doit être libérale, étendue, en rapport avec les droits que l’homme est appelé à exercer, avec les devoirs qu’il doit remplir, avec la vaste carrière offerte à sa contemplation.
Dans le plan de l’établissement, seront donc comprises toutes les études propres à disposer les élèves pour les professions diverses qu’ils désireront embrasser, pour les situations auxquelles ils peuvent être élevés. Ces études seront dirigées par des professeurs instruits et habiles. L’enseignement des langues modernes ne sera confié qu’à des professeurs qui enseigneront leur langue maternelle.
Sous le rapport des langues, l’Amérique doit être considérée comme partagée en deux grandes régions. Les peuples qui les habitent sont unis par des intérêts politiques et commerciaux qui doivent se multiplier et resserrer les liens. Aussi la connaissance des deux langues est elle un besoin chaque jour plus fortement senti par les habitans des deux Amériques.
Une application soutenue sera donnée à l’étude des langues Anglaise et Espagnole. Les élèves seront de bonne heure exercés à prononcer correctement, à s’énoncer clairement et avec aisance. Le don de la parole est une des facultés les plus précieuses et qu’il est le plus important de cultiver dans les états libres et républicains. La langue française sera également usitée dans l’établissement; son utilité est universellement reconnue pour les richesses qu’elle offre dans la littérature, les sciences, et les arts. C’est la langue de la diplomatie, et le moyen de communication le plus général dans la société européenne.
Les langues Grecque et Latine, ces deux langues mères de la plupart des langues modernes, leur littérature qui offre de si beaux modèles de goût, des sources d’instruction si fécondes, seront enseignées avec toute l’attention que commande leur importance.
Toutes les connaissances se lient. C’est sur ce principe créateur que l’enseignement sera conduit. Ainsi par exemple:
L’étude des mathématiques comprendra l’application de leurs diverses branches aux sciences et aux arts, auxquels elles se rapportent;
L’histoire et la géographie, dont la connexion frappe notre esprit plus vivement, à chaque pas que nous fesons dans l’investigation de l’univers, ne formeront qu’un même cours; et la géographie, embrassant ses rapports mathémathiques, physiques, politiques, maritimes et commerciaux, offrira une utilité générale;
L’étude de la philosophie, comme analyse de l’entendement, l’éclaire, le développe et le fortifie; la logique apprend à penser, à raisonner, à démêler le faux et le vrai: la morale inculque les vérités fondamentales, initie à la connaissance du cœur humain.
La grammaire générale, en donnant des idées nettes sur la formation du langage, en multiplie les richesses.
La littérature orne la mémoire et l’esprit, agrandit le domaine de l’imagination.
Après ces études propres à rectifier le jugement, à épurer le goût, les élèves, possédant déjà quelque fonds, pourront, avec espoir de succès, tenter de premiers essais dans l’art oratoire.
C’est en suivant cette marche méthodique; c’est en observant avec soin l’enchainement des connaissances, afin d’en faciliter l’acquisition; c’est surtout en aidant les élèves à bien étudier, que l’on tâchera de leur éviter la perte du temps et de poser de concert avec eux, une base solide pour leur avancement dans l’ordre social et politique.
A une surveillance active sur les progrès de l’instruction se joindra une sollicitude constante sur la santé des élèves, sur leurs habitudes, sur le choix d’exercices gymnastiques appropriés aux constitutions individuelles que des soins bien entendus rendent plus robustes.
La discipline adoptée dans l’établissement, rejetant toutes ces punitions corporelles qui flétrissent ou irritent les cœurs, sondera les dispositions pour les corriger et les perfectionner. Procédant par le raisonnement, les avis, l’émulation et l’honneur, elle proposera de donner la connaissance du juste et de l’injuste, d’inspirer le sentiment du bien, le noble amour de la vérité et le respect pour le bon ordre.
Conditions.
La règle première de l’établissement est que les jeunes gens pour y être admis, aient été vaccinés, ou que leurs parens ou tuteurs donnent, par écrit, l’autorisation de les faire vacciner.
Le système d’instruction se composera des Cours suivans: Ecriture; Langues Anglaise, Espagnole et Française.
Cours complet de Mathématiques; Dessin linéaire; leur application à l’Architecture, à l’Arpentage, au Génie civil et militaire, aux Constructions navales.
Histoire et Géographie.
Philosophie; Grammaire générale; Littérature comparée; ancienne et moderne; Art oratoire.
Elémens de Physique, de Chimie, de Géologie et de Minéralogie.
Principes du Droit public universel et des Négociations.
Elémens d’Econoajmie politique.
Exercices Gymnastiques, en y comprenant la Natation.
Pour les cours indiqués ci-dessus, pour la pension, le blanchissage et le raccomodage, pour les fournitures de papier, encre, plumes et crayons, le prix sera par an, de £300.
Les payemens se feront par quartier et d’avance.
Nous tenons d’un témoin oculaire et digne de foi (Mr. le Dr. Doucet) les renseignemens suivants à ajouter à ce qu’on vient de lire sur l’établissement de Mr. le général Lallemant.
Cet établissement est dans New-York même, mais sur un vaste terrain élevé de plus de trente pieds au-dessus du sol primitif. Le général s’applique personnellement à former le cœur et l’esprit des enfans; les meilleurs professeurs l’assistent dans les autres parties de l’éducation. Tous les enfans sont instruits dans la religion de leurs parens: un savant et pieux ecclésiastique catholique est le professeur de belles-lettres. Le général, les professeurs et les enfans mangent ensemble: il en résulte ces double avantage, que les jeunes gens profitent d’une conversation intéressante et instructive, et qu’ils se forment aux bons usages. Enfin, il serait difficile de trouver de ce côté-ci de l’Atlantique un établissement d’éducation supérieur ou même égal à celui de Mr. le général Lallemant, tant par la situation, que par la tenue de la maison, et le système d’enseignement qui y est suivi; et nous espérons que quelques uns au moins de nos jeunes compatriotes iront y puiser des connaissances qu’ils ne pourraient pas probablement se procurer ailleurs aussi sûrement et avec autant de facilité.
|
Nous devons à la politesse de notre compatriote, Mr. le Dr. F. O. Doucet, de New-York, l’envoi du prospectus que nous transcrivons ici en partie. Nous mettons d’autant plus volontiers cet article sous les yeux de nos lecteurs, qu’ils y trouveront sur l’éducation l’énoncé de principes lumineux qui ne devraient jamais être perdus de vue, et que l’établissement de Mr. le général Lallemant nous paraît digne d’un encouragement libéral et étendu. |

Les croisades qui jadis ouvrirent au génie une si vaste, une si belle carrière, n’ont guère fourni de traits aussi frappants que ceux que nous offre la première guerre d’Amérique: elles n’en ont certainement point fourni de si authentiques. Ecoutons le Général Burgoyne, publiant sa malheureuse campagne terminée par le désastre de Saratoga.
——“Ce jour (8 Octobre 1777,) fut remarquable par une circonstance d’infortune privée trop extraordinaire, trop attendrissante pour être omise; je veux parler de la résolution qui prit Lady Harriet Ackland, de traverser l’armée ennemie, en Amérique, pour porter ses secours à son mari blessé et prisonnier de guerre. On aura de la peine à regarder comme déplacés ou superflus les détails relatifs à cette dame, à sa marche à la suite de l’armée, &c.:—ils seraient intéressants, quand même ils n’auraient pour objet que de donner de l’authenticité à une anecdote tenant du merveilleux. Ces détails, bien écrits, offriraient dans un tableau touchant le courage, l’esprit d’entreprise, les détresses du roman; le tout réalisé et réglé sur les chastes principes d’un amour raisonnable et du devoir conjugal.
“Au commencement de 1776, Lady Harriet Ackland avait accompagné son mari en Canada: dans le cours de cette campagne, elle avait traversé une vaste étendue de pays, ayant à combattre les extrémités opposées des diverses saisons, et étant environnée de difficultés dont il n’est pas facile de se former une idée. L’objet de tant de fatigues était de venir trouver à Chambly son mari, malade dans son lit, et de le servir dans une misérable hutte.
“A l’ouverture de la campagne de 1777, les injonctions positives de son mari ne lui permirent pas de partager avec lui les fatigues et les dangers auxquels on s’attendait devant Ticonderoga: le lendemain de la prise de cette place, il fut dangereusement blessé, et elle passa le lac Champlain pour le joindre. Sitôt qu’il fût rétabli, Lady Harriet s’attacha à sa fortune pour le cours de la campagne. Au fort Edward, ou au premier endroit où les troupes campèrent, elle fit l’acquisition d’une espèce de tombereau à deux roues, construit par les artilleurs, et ressemblant à-peu-près aux chariots qui portent des malles sur les grands chemins d’Angleterre. Le major Ackland commandait les grenadiers anglais, qui, attachés au corps du général Fraser, formaient toujours, par conséquent, le poste le plus avancé de l’armée, et se trouvaient dans un état d’alerte si fréquente, que personne ne se déshabillait pour dormir. Comme ils se trouvaient dans cette situation, le feu prit subitement dans la tente où le major et Lady Harriet reposaient. Un sergent des grenadiers, au grand danger d’être suffoqué, s’y précipita et en retira la première personne qui se trouvait sous sa main; c’était le major. Dans l’instant même, Lady Harriet, sans savoir ce qu’elle faisait, et peut-être dormant encore à demi, s’échappait, en se traînant ventre à terre sous les derrières de la tente: à peine a-t-elle repris ses sens que le premier objet qui la frappe, est le major qui s’était élancé dans le feu pour la chercher; le sergent le sauve encore, mais le ramène ayant le visage grièvement brûlé, ainsi que diverses parties de son corps: tout ce qu’ils avaient dans la tente fut la proie des flammes.
“Cet accident arriva un peu avant que l’armée passât la rivière Hudson; il n’altéra en rien ni la fermeté ni même l’enjouement de Lady Harriet, et continuant la marche, elle partagea toutes les fatigues du corps avancé.—L’épreuve à laquelle son courage fut mis ensuite, a été d’une nature différente, et infiniment plus pénible, en ce qu’elle fut plus longs-temps en suspens. Dans la marche du 19 Septembre, comme les grenadiers avaient à combattre à chaque pas qu’ils faisaient, le major avait engagé son épouse à suivre l’artillerie et les bagages, parce que leur route n’était point exposée: au moment où l’action commença, elle se trouvait près d’une petite hutte inhabitée où elle s’arrêta.—Les chirurgiens de l’hôpital s’apercevant que le combat devenait général et sanglant, prirent possession de cette même hutte, comme étant l’endroit le plus convenable pour recevoir les blessés qui avaient besoin du premier appareil: c’est là que, pendant quatre heures consécutives, Lady Harriet entendit le feu non interrompu du canon et de la mousqueterie, sachant que son mari, à la tête des grenadiers, se trouvait nécessairement dans l’endroit le plus exposé; là, s’aggloméraient devant elle les blessés et les mourans, dont le triste sort semblait lui présager celui de leur vaillant officier. Lady Harriet avait, il est vrai, trois dames avec elle, la baronne de Reidesel, les femmes du major Harnage et du lieutenant Reynell, officiers anglais; mais, par l’événement, la compagnie de ces dames fut moins qu’une consolation pour elle: on ne tarda pas d’apporter aux chirurgiens le major Harnage dangereusement blessé, et peu de tems après arrive la nouvelle que le lieutenant Reynell est tué: il est inutile d’aider l’imagination pour se figurer l’état dans lequel se trouva le malheureux groupe.
“De ce moment au 7 Octobre, Lady Harriet conservant sa sérénité ordinaire, parut préparée à de nouvelles épreuves; sa destinée voulait que leur cruauté augmentât en proportion de leur nombre: elle se vit encore exposée à entendre tout le fracas du combat; et enfin, en apprenant la calamité générale, elle reçut le coup qui la frappait personnellement. Nos troupes étaient défaites, et le major Ackland, plus que dangereusement blessé, était pris prisonnier!....Lady Harriet et ses compagnes passèrent la journée du 8 dans un état de détresse commune: point de tente, pas d’autre appentis que celui qui appartenait à l’hôpital; elles n’avaient de refuge que parmi les blessés et les mourans.
“Après la halte dont j’ai parlé, l’armée se trouvant sur le point de se mettre en marche, je reçus de Lady Harriet une lettre, dans laquelle elle soumettait à ma décision la proposition de passer dans le camp ennemi, et de demander au général Gates la permission de donner ses soins à son mari; proposition qu’elle paraissait avec sollicitude déterminée à exécuter, si elle ne contrariait pas mes desseins.
“Quoique, d’après mon expérience personnelle, je fusse disposé à croire que la constance et le courage, portés au plus haut degré, pouvaient se trouver, ainsi que toutes les autres vertus, déguisés sous les formes les plus délicates; néanmoins, cette proposition ne laissa pas de m’étonner beaucoup. Qu’une femme, après une si longue agitation d’esprit, épuisée, non seulement par la privation du sommeil, mais par le manque absolu de tout aliment, ayant été exposée, pendant douze heures, à une pluie continuelle et glaciale, fût capable d’une entreprise aussi hardie que l’était celle de se livrer à l’ennemi, probablement pendant la nuit, sans savoir en quelles mains elle pourrait tomber en arrivant, me paraissait être un effort au-dessus de la nature humaine. Le secours que j’avais à lui offrir était mince en vérité; je ne pouvais même pas lui envoyer un verre de vin. On me dit que quelque main bienfaisante avait eu le bonheur de lui offrir un peu de rum et d’eau bourbeuse. Tout ce que je pus lui fournir fut un bateau découvert, et quelques lignes écrites sur du papier sale et humide pour le général Gates, à la protection duquel je la recommandais. C’est dans cet état de dénuement absolu que mon héroïne est allée à la poursuite du digne objet de ses affections, tandis que tous les cœurs la suivent au milieu des dangers qu’elle affronte si généreusement.”
Quant un militaire s’exprime avec une telle onction, tout autre éloge serait languissant: bornons-nous donc à faire connaître la fin attendrissante de Mistress Ross, rivale d’Harriet Ackland en héroïsme, et dont la vertu s’exerça aussi dans notre hémisphère.
Lorsque les troubles de l’Amérique éclatèrent, la nouvelle Emma dont il s’agit avait contracté avec le capitaine Charles Ross des engagemens que ses parens refusèrent de ratifier. Pour ajouter à son désespoir, le devoir et l’honneur lui enlevèrent celui qui ne pouvant être son époux, ne cessait pas d’être son amant; il partit pour l’Amérique, où elle ne tarda pas de le suivre sous les vêtemens d’un homme.
A peine arrivée, elle apprend que le capitaine a été détaché quelques jours auparavant contre un parti d’Américains et de sauvages: elle vole sur ses pas, parcourt rapidement les lieux qu’on lui a indiqués. Quelqu’un l’informe qu’à tel endroit, sur la lisière de tel bois, il y à eu la veille une escarmouche sanglante; elle s’y rend: tout était dispersé: il ne restait sur le champ de bataille que quelques cadavres épars, parmi lesquels le corps du capitaine était étendu et palpitait encore; elle le reconnaît, se précipite sur lui, découvre une étroite blessure, cherche à étancher le sang, et finissant par sucer la plaie, le ramène insensiblement à la vie.... Le capitaine ouvre les yeux, et les tourne languissamment sur elle: elle croit remarquer quelque émotion; prévoyant la révolution que produirait infailliblement une reconnaissance trop prompte, et craignant que ses habits d’homme ne la déguisent pas assez à des yeux si accoutumés à lire dans les siens, elle couvre sa peau d’une infusion jaunâtre, et continue avec la même assiduité de soigner le convalescent: six semaines s’écoulent avant qu’il soit en état de marcher; pendant cet intervalle, le souvenir de son amante renaît dans son cœur; il en entretient le généreux inconnu devenu, à de si justes titres, son ami, son confident. “Si je meurs, lui dit-il, portez-lui mes derniers soupirs, mes derniers sermens; dites-lui qu’aux yeux du ciel, je suis mort son époux.” Enfin il se rétablit; on se met en chemin, on arrive à Philadelphie, où le capitaine ne tarde pas à reconnaître celle qui ne prend plus la peine de se déguiser: un ministre couronne aux pieds des autels une des plus respectables passions dont on ait des exemples....
A peine Mistress Ross avait-elle joui du prix de sa constance, qu’on la vit tomber dans un état de langueur, interrompu quelquefois par des accès de douleur aigüe: le capitaine se désole; on examine, on consulte, on pèse les circonstances: on découvre que la plaie sucée avait été empoisonnée: horreur que les sauvages se permettent!—Le poison, attiré par l’aspiration, avait passé du flanc de l’époux dans le sein de l’épouse qu’il minait lentement.... Enfin, après trois années passées dans un état de crainte progressive, le capitaine s’affecta si vivement de ce qu’il allait causer la mort de celle à qui il eût sacrifié mille vies, qu’il mourut au commencement du printems de 1779, à John’s Town, consumé par la douleur. Mistress Ross sentant sa fin s’approcher, mais espérant avoir assez de temps et de force pour repasser en Angleterre, s’embarqua peu de jours après: elle arriva, dans le mois de Mai de la même année, chez ses parens, pour leur demander pardon des chagrins qu’elle leur avait causés; et elle expira le 26 Juillet suivant, à l’age de 26 ans! (L’Abeille Canadienne.)

Un fermier de Liverpool avait un chien plein de courage, d’intelligence et d’autres belles qualités; mais il avait un défaut que rien ne peut excuser, du moins dans les chiens: il manquait de probité. De jeunes agneaux disparaissaient de tems en tems de la bergerie du fermier. On ne pouvait pas accuser les loups; il n’en existe pas en Angleterre. Le berger fut soupçonné, mais le vrai coupable ne tarda pas à être découvert, et le chien infidèle reçut le châtiment qu’il avait mérité. Il ne se corrigea pas; la récidive fut punie plus sévèrement. Le criminel est laissé pour mort, dans le champ même où il avait exercé ses rapines; il se traîne dans un taillis voisin, il s’y blottit, et, grâce à la force de sa constitution, à l’énergie de son caractère, et peut-être à l’absence de toute intervention médicale, ses profondes blessures sont bientôt cicatrisées.
A quoi lui sert-il d’être guéri? Il se croit chassé pour toujours de la maison de son maître; il se regarde comme indigne de pardon, et peut-être désespère-t-il de triompher de l’un de ses penchans irrésistibles, faciles à expliquer d’après le systême fameux d’un physiologiste moderne. Il se lève, va loin de Liverpool, mène une vie vagabonde, et finit par s’enroler dans une bande de voleurs de grands chemins.
Deux ou trois années s’étaient écoulées, lorsque le fermier de Liverpool fit un voyage. La nuit et l’orage le surprennent auprès d’une auberge isolée et de mauvaise apparence; il entre. Une vieille femme, trois hommes étaient près du feu; un gros chien tournait la broche: le fermier reconnaît son ancien domestique et s’avance pour le caresser; l’animal gronde avec fureur, il montre les dents et va se jetter sur l’étranger. Les maîtres de l’auberge interviennent; le chien battu va reprendre ses fonctions. Le fermier, ayant soupé, se retire dans l’appartement qu’on lui a indiqué.
Il se disposait à se coucher lorsque des gémissemens se font entendre à la porte; il ouvre et il voit entrer le chien tourne—broche; ce n’est plus un être méchant et furieux, c’est un animal doux et caressant, qui se couche aux pieds du fermier, lui lèche les mains et lui demande pardon, en son langage, de ses emportemens. Après lui avoir rendu toutes ses carresses, le fermier veut le renvoyer. Le chien refuse de sortir. Le voyageur consent à le laisser dans l’appartement, et il va fermer la porte. Le chien s’y oppose; il saisit avec les dents les pans de l’habit du fermier, il cherche à l’entraîner dehors; celui-ci ne comprend rien à tout cela; il se demande pourquoi, quand il avance vers le lit, le chien le tire de toutes ses forces vers la porte: pourquoi, s’il annonce l’intention de sortir, le chien fait éclater la joie la plus vive. Tout cela lui donne à penser. Où est-il? dans une maison isolée, au milieu d’un désert. Les individus qui l’ont reçu dans cette méchante auberge avaient des physionomies peu rassurantes. Ne se trouverait-il pas dans une caverne de voleurs? Il prend son parti: il fait sortir le chien, arme ses pistolets, ouvre les volets, tire avec précaution les draps du lit, les noue à la fenêtre, cache la lumière sous la cheminée; il se barricade et attend.
Il n’attend pas long-tems; un ressort part, une trappe s’ouvre au pied du lit, le lit fait là culbute et s’engloutit.
A cet aspect, le voyageur se laisse couler le long des draps du lit noués à la fenêtre; il court au hameau le plus voisin. On s’arme, on vole, le repaire est investi, les bandits sont arrêtés. On fait des perquisitions; le chien les dirige. La trappe correspondait à une fosse immense où gisaient plusieurs cadavres couverts de chaux, et un grand nombre d’ossemens humains.
Le fermier reconnaissant ramena son chien qui ne vola plus d’agneaux. Avait-il fait un cours de probité à l’école des voleurs de grands chemins?

Les loups de bois, gris et blanchâtres, sont très communs et par troupes qui suivent la vache. On en rencontre souvent, dans Mars et Avril, d’enragés, qui attaquent et mordent tout ce qu’ils rencontrent. Les Ricaras perdent souvent leurs chevaux par ces accidens, et malgré leur défiance, en sont souvent les victimes eux-mêmes. Ces loups sont toujours seuls et faciles à distinguer par leur marche et par les symptômes de la rage. Comme les guerriers sauvages, ils attaquent le plus souvent au point du jour. Mr. Vallée, chasseur, l’a malheureusement expérimenté, avec un de nos engagés, le 14 Avril 1804. Tous deux dormaient paisiblement à l’aube du jour, lorsque l’engagé, nommé Calvé, bien enveloppé dans sa couverture, sentit qu’on marchait sur lui. Relevant le bord de la couverte, il ne fit qu’appercevoir le loup, qui lui égratigna légèrement le bras dont il se servit pour se renvelopper aussitôt. Mais ses cris et ses mouvemens firent faire à Mr. Vallée et au loup chacun un bond, qui les fit rencontrer corps à corps. Le loup furieux présentant sa gueule ouverte, Mr. Vallée, nu et sans armes, en saisit fortement la mâchoire inférieure, et eut le courage d’entrainer le loup jusque près d’un fusil, dont il ne put se servir qu’en le lui brisant sur la tête. Pendant ce combat, Calvé court au canot, dont il rapporte une hache, qui tire enfin Mr. Vallée d’affaire. Pendant plus de six mois, il n’a pu se servir de sa main, dont le pouce surtout était mâché à plusieurs endroits. Le jour même, on pansa la plaie, en mâchant une racine connue sous le nom de bois-blanc de prairie, et fort commune aux Illinois. Soit que le loup ne fût pas effectivement enragé, soit que cette racine soit aussi efficace contre la rage qu’elle l’est certainement contre le venin du serpent à sonnettes, il n’en est résulté que les suites ordinaires d’une forte morsure. Les Ricaras m’ont assuré depuis l’avoir plusieurs fois employée avec succès, particulièrement sur leurs chiens et leurs chevaux.
On voit ici peu des espèces de serpens et de couleuvres qui se rencontrent aux Illinois; mais en récompense, le serpent à sonnettes y est beaucoup plus commun. Heureusement que les plantes qui attirent le venin ne sont pas rares, et que tous les sauvages connaissent le bois-blanc de prairie, dont j’ai déjà parlé.
Une sorte d’araignée noire, de la grosseur d’un œuf de pigeon, dont les pattes sont courtes, se tient ordinairement dans les pailles, et s’attachent quelquefois aux vêtemens des passans. Il faut que cet insecte porte un terrible venin, puisqu’un de mes hommes n’en ayant été que légèrement touché sur la main, a souffert une douleur insupportable, et qu’en moins d’un quart d’heure, tout le bras s’est enflammé étonnamment. Le bois-blanc de prairie a encore dans cette occasion produit son effet ordinaire. Les sauvages craignent cette araignée plus que le serpent à sonnettes, et racontent mille histoires à ce sujet.

.... Ainsi mon imagination charmait la route. Cependant nous approchons de la ville sacrée dont les bourgeois de Londres ne parlent qu’avec respect. D’arides mamelons l’environnent: je n’aperçois à droite et à gauche qu’une terre stérile, et devant, la mer immense dans toute la monotonie de sa grandeur. O beautés pittoresques, qu’êtes-vous devenues?
C’est là Brighton! point de gazons, de pelouses, de bocages! partout des sables stériles. Je m’achemine lentement vers la mer. Hélas! ces collines crayeuses achèvent de me désoler. Rentrons dans la ville. Au détour d’un roc, je lis avec étonnement des mots tracés en grandes lettres rouges sur un poteau barbouillé de blanc: Route du parc. Un parc à Brighton! où peut-il être, où se cache-t-il? dans quelles profondeurs ensevelit—il sa verdure, ce parc mystérieux. Autour de la ville et dans la ville, je n’ai pu découvrir que des pierres et du sable; une aridité dans le sol, une tristesse dans le ciel qu’il est plus facile de sentir et de déplorer que de décrire.
Allons au parc, en quelqu’endroit qu’il se trouve! Je dis et je suis la rue d’Egremont dans la direction que le poteau mystérieux m’a indiquée. Une porte en bois frappe mes regards; un suisse solitaire me demande deux pennys pour droit d’entrée; j’ai payé, je suis dans le parc. Imaginez-vous une espèce de fossé oblong, environné de ces collines de craie dont je viens de parler. Là une douzaine d’arbrisseaux mort-nés élèvent du sein de cette terre désolée leurs rameaux jaunâtres; un gazon pelé tapisse quelques toises du sol. Je me demande avec douleur si ce sont là des plantes, si ce sont là des arbres. Ah! si ces parias du règne végétal, condamnés à languir dans le prétendu parc de Brighton, pouvaient parler, quelles tristes plaintes n’exhaleraient-ils pas? quelle lamentation universelle s’échapperait de ces fleurs fanées sur leurs tiges, de ces arbustes frappés de consomption, de ce gazon dévoré d’étésies, que les Brightoniens prennent pour des végétaux.
Dans le fait, un citoyen de Brighton ignore aussi complètement ce que c’est qu’un arbre, qu’un bon gentilhomme qui n’est pas sorti des lagunes de Venise ignore la forme et l’utilité d’un cheval. Oui, si j’étais peintre ou poëte, et que je dusse personnifier la cité dont je parle, je la représenterais sous la figure d’une nymphe décrépite, sans cheveux, sans fraîcheur et couverte de rides.
Cependant je fis le tour de la ville et j’y cherchai dans la beauté des édifices quelques compensations à l’incomparable laideur de la ville. Toutes les pompes et tous les agrémens de l’architecture ont été prodigués pour orner cette solitude. On trouve partout des frises, des chapiteaux, des colonnes, des portiques, mais point d’habitans. Le plus profond silence n’est interrompu que par le sourd mugissement des flots de la mer. Vous appercevez des palais magnifiques dont les fenêtres sont dégarnies de leurs vitrages. Sur une enseigne immense on lit: Café de l’Univers; la porte et les jalousies du café de l’Univers sont fermées, et il est évident que l’ingrat univers a fait banqueroute à son hôte. L’auberge de l’Europe est ouverte à tous les voyageurs; un garçon en tablier blanc se tient à la porte; à l’indolence de sa contenance, à l’apathie de son regard, il est aisé de voir combien il s’ennuie de sa sinécure.
C’est donc là ce Brighton si vanté; c’est pour obtenir ce résultat que toute la noblesse anglaise, prodiguant le fer, le bois, le marbre, l’acier et l’or; imitant son noble maître et commandant des constructions magnifiques dans le style grec, romain, oriental, égyptien, arabe, a fait naître du sein de ce territoire désenchanté, une ville de féerie.
Le Pavillon (tel est le nom que porte le palais de S. M. Georges IV,) n’a qu’un seul défaut, c’est d’être bâti à Brighton. Rien de plus pittoresque que ces groupes de dômes, de minarets, de lanternes, de coupoles, de girandoles dont l’élégance bizarre semble créée par l’imagination d’un conteur des Mille et une nuits: mais pourquoi ce choix malheureux? Le séjour de désolation, l’asile de stérélité qui environne ces édifices, leur fait perdre une partie de leur prix. Une petite chaumière au milieu d’un joli paysage, dans le fond d’une vallée riante, flatte davantage nos yeux.
Vous voilà donc, voluptés de Brighton! et j’ai quitté pour vous Londres, la foule des Dandys qui encombrent Bond Street, la gracieuse Mme Vestris, Veluti, Curioni, Debegnis le roi des bouffés, et Mme Pasta! Rendez-moi la fumée de la grande ville, et mes délices accoutumées! Ah! je le sens, je suis guéri de la manie des voyages.—The London Magazine.

Je m’étais ennuyé long-tems; et j’en avais ennuyé bien d’autres. Je voulus aller m’ennuyer tout seul. J’ai une fort belle forêt. J’y allai un jour, ou, pour mieux dire, un soir, pour tirer un lapin. C’était l’heure de l’affût. Quantité de lapereaux passaient, disparaissaient, se grattaient le nez, faisaient mille bonds, mille tours, mais toujours si vite que je n’avais pas le tems de lâcher mon coup. Un ancien, d’un poil un peu gris, d’une allure plus posée, parut tout à coup au bord de son terrier. Après avoir fait sa toilette tout à son aise (car c’est de là qu’on dit, propre comme un lapin), voyant que je le tenais au bout de mon fusil: “Tire donc, me dit-il; qu’attends-tu?” Oh! je vous avoue que je fus saisi d’étonnement!....Je n’avais jamais tiré qu’à la guerre sur des animaux qui parlent. “Je n’en fei ai rien, lui dis-je, tu es sorcier, ou je meure!”—Moi, point du tout, me répondit-il, “je suis un vieux lapin de La Fontaine.” Oh! pour le coup, je tombai de mon haut. Je me mis à ses petits pieds, je lui demandai mille pardons, et lui fis des reproches de ce qu’il s’était exposé. “Eh! d’où vient cet ennui de vivre?....—De tout ce que je vois....—Eh, bon Dieu! n’avez-vous pas le même thym, le même serpolet—Oui; mais ce ne sont plus les mêmes gens. Si tu savais avec qui je suis obligé de passer ma vie! Hélas! ce ne sont plus les bêtes de mon temps; ce sont de petits lapins musqués qui cherchent des fleurs. Ils veulent se nourrir de roses, au lieu de bonne feuille de chou, qui nous suffisait autrefois. Ce sont des lapins géomètres, politiques, philosophes, que sais-je? d’autres qui ne parlent qu’allemand; d’autres qui parlent un français que je n’entends pas davantage. Si je sors de mon trou pour passer chez quelque gent voisine, c’est de même, je ne comprends plus personne. Les bêtes d’aujourd’hui ont tant d’esprit! Enfin, vous le dirais-je, à force d’en avoir, ils en ont si peu, que notre vieux âne en avait davantage que les singes de ce tems-ci.” Je priai mon lapin de ne plus avoir d’humeur, et je lui dis que j’aurais soin de lui et de ses camarades, s’il s’en trouvait encore. Il me promit de me dire ce qu’il disait à La Fontaine, et de me mener chez ses vieux amis. Il m’y mena en effet. Sa grenouille, qui n’était pas tout-à-fait morte, quoiqu’il l’eût dit, était de la plus grande modestie en comparaison des autres animaux que nous voyons tous les jours. Ses crapauds, ses cigales, chantaient mieux que nos rossignols. Les loups valaient mieux que nos moutons. “Adieu, petit lapin, je vais retourner dans mes bois, à mes champs et à mon verger. J’élèverai une statue à La Fontaine, et je passerai ma vie avec les bêtes de ce bonhomme.”—Journal Français.

On vient de découvrir à Voghera, royaume de Sardaigne, dans le torrent de la Staffora, en tirant du sable, une très-belle statue en bronze antique, représentant Minerve-Pallas; elle est dans l’attitude d’une déesse, portant sur la paume de la main droite, soit une patère, soit une choutte, soit une petite Victoire, car on n’a retrouvé aucun de ces trois attributs. Le bras gauche est pendant: elle pose avec dignité sur une jambe; l’autre est légèrement ployée. Sa taille est svelte et celle que les Grecs donnent à Minerve. Elle a la robe longue sans manches, descendant jusqu’aux pieds (la colocasia des anciens;) la poitrine armée de l’égide au milieu de laquelle est la tête de Méduse, entortillée de petits serpens artistement exécutés. Sur sa tête est un casque surmonté d’une crinière d’un travail exquis.
Soit que l’on considère la proportion des membres, la beauté de la figure, et surtout celle des yeux, soit la draperie, d’une perfection inimitable, tout annonce un ouvrage des meilleurs tems de la sculpture antique du règne d’Auguste ou de celui de Trajan. Par un hasard des plus heureux, la statue est parfaitement conservée. Il ne lui manque que le bout du petit doigt de la main gauche et la tête d’un des deux serpens de Gorgone. Le bras gauche était endommagé, mais il sera très-facilement réparé. Les amateurs des arts, qui font tant de cas des statues en bronze, sentiront tout le prix de celle-ci, qui, dans sa dimension, surpasse toutes celles qu’on admire dans les musées de Naples et de Rome, et qui les égale toutes en beauté. Ce nouveau chef-d’œuvre enrichit déjà le musée de Turin.
Manière de condenser et conserver les substances végétales pour les provisions des navires.
La quantité de liquide qui entre dans la constitution des végétaux est très-abondante; lorsqu’on les en prive, leur volume n’est presque plus rien. Cette préparation de la nourriture animale (appelée pemmican.) par laquelle six livres de viande sont condensées et réduites en une seule, est simplement l’effet de l’abstraction du liquide. Les végétaux peuvent subir la même opération; faites-les bouillir sur un grand feu de bois, de manière qu’ils conservent leur couleur après la cuisson; réduisez-les complètement en pulpe, ainsi qu’on fait des pommes à faire le cidre, et alors soumettez-les à l’action du pressoir (les ayant d’abord enfermés dans des sacs de crin, ou disposés comme les grappes seraient pour faire le vin) jusqu’à ce que la partie liquide en soit complètement sortie; ce qui restera sera extraordinairement condensé, et aussi ferme que le marc de vendange; empotez, en pressant fortement, dans des jarres bien vernies et imperméables à l’air, ou des boîtes de fer blanc, que vous soumettez au procédé de M. Appert, pour conserver les substances animales et végétales. Si vous vous servez de jarres, il suffira de les couvrir successivement de deux peaux de vessie; lorsqu’en faisant chauffer, l’air qui s’y trouve renfermé sera absorbé, la pression de l’atmosphère rendra alors la surface de ces peaux concave; et tant qu’il en sera ainsi, on peut être sûr que la matière intérieure sera bien conservée.
Si l’on voulait conserver entièrement la saveur des végétaux, on pourrait ajouter au marc un extrait du liquide exprimé. Mais les épinards, les choux, les laitues, et beaucoup d’autres légumes, ont assez de saveur, sans cette addition, quand ils sont desséchés. La préparation des végétaux pour l’usage se réduit à y mêler une quantité suffisante d’eau, de lait, ou de la jus de limon, et les faire chauffer. Que le gouvernement et les approvisionneurs de navires prennent connaissance de ceci: une quantité suffisante de ce végétal pemmican, embarquée à bord des navires, serait de la plus grande utilité pour les équipages, et dans de longs voyages, les préserverait du scorbut. On doit remarquer que les estomacs les plus irritables ne peuvent pas être incommodés par les végétaux préparés de cette manière. (Phare du Havre.)

“C’est non loin des quatre beaux sycomores plantés au milieu du désert, au pied des pyramides, que la roche calcaire élève de toutes parts ses crêtes nues, au nombre desquelles se trouve le fameux Sphynx, qui a partagé, sinon la durée, au moins la réputation des pyramides. Ce monument, sur lequel on a avancé tant de conjectures, n’est autre chose qu’une espèce de témoignage des excavations profondes pratiquées tout autour, et dont les pierres devaient servir comme de supplément à celles qui sortaient des immenses carrières du Mokatam. La tête, malheureusement fort endommagée, est le portrait du roi Thoutmosis XVIII, qui vivait environ 1700 avant Jesus-Christ. Cette tête, qui conserve des traces profondes d’une couleur rouge, que bien des voyageurs ont prise pour celle du granit, s’élève seule, avec le cou et une partie de la croupe, au-dessus du sable; mais il n’y a pas long-tems qu’un nommé Caviglia a fait faire des fouilles tout autour, et a découvert entre les jambes un grand monolithe, avec quatre lions et une inscription portant la date ci-dessus. Il est vrai qu’en véritable vandale, ce Caviglia a vendu un lion aux Anglais, et recomblé le reste; mais la chose n’en est pas moins constatée, et fait cesser toute incertitude sur un colosse auprès duquel le Neptune de Jean de Bologne n’est qu’une figurine.
“En se plaçant juste en face du Sphynx, on découvre d’un seul point de vue la grande pyramide, entièrement dépouillée de son revêtement, et dentelée dans toute sa hauteur; la seconde, qui ne lui cède guère, conservant à son sommet comme une espèce de croûte polie, irrégulièrement interrompue aux trois quarts de la hauteur totale; la troisième, vraiment lilliputienne auprès de ses aînées; et puis tout autour une foule de petites pyramides, de débris de chaussées, d’enceintes et d’autres constructions; des portes de tombeaux sculptées dans le roc; enfin les restes encore magnifiques d’un des plus beaux spectacles que l’imagination humaine ait pu concevoir. C’est là le vrai coup de théâtre; il perd un peu à l’analyse. D’abord, quand on s’occupe de la grande pyramide, on ne peut concevoir la grandeur des pierres qui la composent qu’en les touchant, en se mesurant avec elles; puis l’imagination est importunée de ce grand amas de matériaux, dont elle ne comprend plus ni la forme ni le but.—C’est donc avec une espèce d’ébahissement stupide que l’on parcourt tout cela, qu’on escalade ces gradins interminables, dont les marches semblent faites pour es géants, qu’on pénètre ces longs corridors, ces détours sinueux qu’on a peine à croire construits dans le seul but de mener à un tombeau. Il n’y a pas moyen, en définitive, de suivre une idée, de construire un système, quel qu’il soit. Aussi cela vous expliquera-t-il pourquoi j’ai éprouvé une véritable jouissance à me rejeter sur les bas-reliefs d’un tombeau assez commun, où du moins je trouvais des choses toutes formulées, des hommes paraissant agir dans un but.”

La ville de Clermont possède une fontaine qui jouit de la singulière propriété de pétrifier toutes les substances végétales ou animales. On nous a montré une collection fort curieuse de fleurs, de fruits, d’oiseaux et de quadrupèdes parfaitement solides, et qui n’étaient pas soumis depuis plus d’un an à l’action de cette eau remarquable. Une pétrification énorme, un vrai rocher de plus de cinquante pieds de long, s’est formé aux dépens de la fontaine, et par suite de ses dépôts successifs. Les corps qu’on y plonge n’éprouvent aucune altération dans leur composition intérieure; ils se recouvrent seulement d’une espèce de cristallisation terne et grisâtre, dont l’épaisseur augmente insensiblement, et finit par former autour d’eux un enduit impénétrable. Un bœuf entier était exposé et déjà à moitié pétrifie, le jour de notre visite à la fontaine. Plusieurs chevaux l’ont été précédemment et contribuent aujourd’hui à l’embellissement du jardin qui environne la source. Le temps et les réactifs m’ont manqué pour analiser cette eau singulière, dont aucun pharmacien de Clermont n’a cherché à connaître la composition.

Un auteur moderne (M. Dutens, à ce que je crois,) a recueilli, sous ce titre, quelques passages des écrits des anciens philosophes de la Grèce qui m’ont paru curieux, et qui paraîtront tels sans doute aux lecteurs de la Bibliothèque Canadienne. On y peut voir du moins que souvent, en fait de physique et d’astronomie, les anciens ont deviné assez juste et se sont approchés du but, même en marchant à tâtons.
M. D.
Les principes de toutes choses sont des monades, des figures et des nombres desquelles se sont formés les élémens.
Hereclite introduit des atômes infiniment petits et exempts de parties (c’est-à-dire indivisibles.)
Epicure dit que les principes de la matière, (atômes ou monades) sont incompréhensibles, (ou insensibles), mais qu’il s’en forme des corps qui ont de la pesanteur, &c.
Xenocrate et Diodore disent aussi que les principes des corps sont indivisibles.
Pythagore, Platon, Aristote disent que la puissance formatrice, (ou créatrice) est incorporelle, comme l’âme qui meut le corps.
Démocrite dit qu’il est possible que des atômes forment des mondes: il dit aussi que la diversité des couleurs provient du mélange des élémens.
Pythagore dit qu’il y a des antipodes: il est le premier qui se soit servi de ce terme.
Rien de ce qui est produit (dans les règnes animal et végétal,) n’est produit sans semence.
Empedocle reconnaît des sexes dans les plantes.
Tout corps inspire et respire (exspire.)
Les Stoiciens disent que le tonnerre est produit par le choc des nuées, et les éclairs par le frottement.
Démocrite dit que chacune des étoiles est le centre d’un monde (système) comprenant des planètes avec des atmosphères, &c. dans l’immensité du ciel.
Philolaus dit que la terre fait une révolution autour du feu (au soleil) par un cercle oblique.
Eraclide du Pont et le pithagoricien Ephantus font mouvoir la terre, non d’un lieu à un autre (translativement), mais d’occident en orient sur son propre centre, comme une roue qui tournerait sur un essieu fixe.
Platon dit que tous les astres se meuvent, non seulement circulairement avec l’univers, mais encore sur leur centre.
Séleucus le mathématicien, qui est un de ceux qui pensent que la terre se meut, dit que son mouvement de rotation et de révolution se fait en sens contraire à la marche de la lune.
Timée dit qu’il ne faut pas croire que la terre soit immobile au milieu du monde, mais qu’elle tourne et se meut autour d’un centre (du soleil,) comme l’ont démontré ensuite Aristarque et Séleucus.
Archimede disait: Donnez-moi un point d’appui, et je mouvrai la terre.[1]
Aniximandre dit que la lune ne brille pas d’une lumière qui lui soit propre, mais qu’elle réfléchit la lumière du soleil.
Anaxagore disait qu’il y avait dans la lune des montagnes et des vallées, et qu’elle était habitable; et Démocrite soutient que les ombres qu’on y voit sont occasionnées par ses hautes montagnes.
|
Dos moi poû stô, kai kinô tèn ghèn. Dic ubi consistam, (cœlum) terramque movebo. |

Les nouveaux menechmes.
De tous les points deux jumeaux ressemblants,
En plein marché se donnaient en spectacle:
Sandis! s’écrie un Gascon, beau miracle!
J’ai bien vu, moi, des prodiges plus grands:
J’avais un frère; (Ah! Parque trop cruelle,
Sans tes ciseaux il vivrait aujourd’hui!)
Sa ressemblance entre nous était telle,
Qu’à chaque instant il me prenait pour lui.
Epitaphe.
Mortels, sous cet abri je ne suis plus des vôtres:
Fortune, espoir, amour, vous en tromperez d’autres.

Printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Mis-spelled words and punctuation have been maintained except where obvious printer errors occur.
[Fin de La Bibliothèque canadienne, Tome VIII, Numero 2, Janvier 1829. edited by Michel Bibaud]