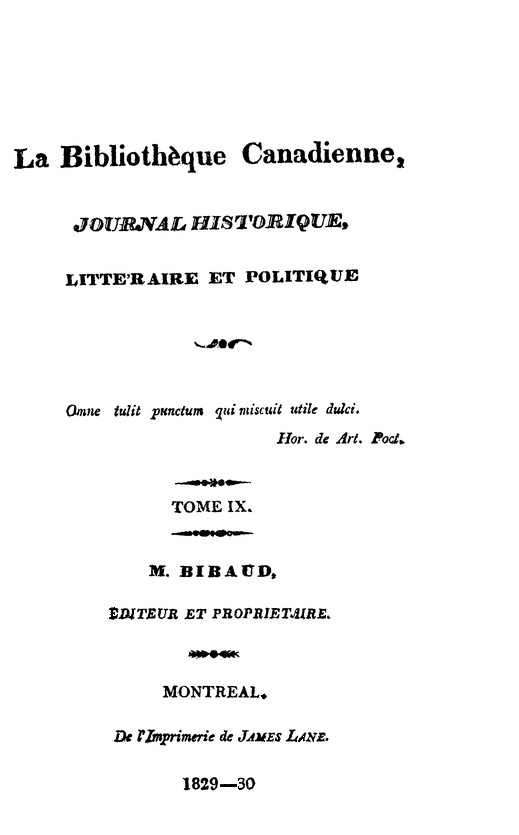
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome IX, Numero 7, Octobre 1829.
Date of first publication: 1829
Author: Michel Bibaud (1782-1857) (editor)
Date first posted: Dec. 28, 2021
Date last updated: Dec. 28, 2021
Faded Page eBook #20211264
This eBook was produced by: Marcia Brooks, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
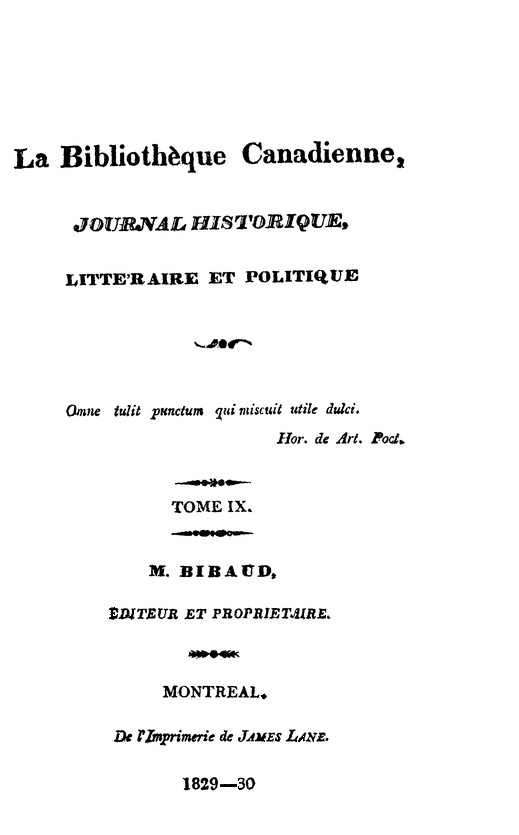
La Bibliothèque Canadienne
| Tome IX. | 1er. OCTOBRE 1829. | Numero VII. |
Mr. de la Jonquière ne crut pas devoir suivre les plans de son prédécesseur, par rapport à l’Acadie, persuadé que les limites de cette province seraient déterminées par les commissaires que les deux couronnes avaient nommés à cet effet, et qu’avant cette détermination, il ne convenait pas d’y rien entreprendre qui pût donner ombrage à l’Angleterre, et peut-être entraîner la France dans une nouvelle guerre avec cette puissance.
Ce plan de conduite, peut-être dicté par la prudence, fut taxé en France, de timidité; M. de la Jonquière fut blâmé de son inactivité, et réprimandé pour n’avoir pas de lui-même continué ce que le comte de la Galissonnière avait commencé. Il lui fut envoyé de nouvelles instructions par lesquelles il lui était ordonné de prendre sans délai possession du pays, c’est-à-dire de la terre-ferme de l’Acadie, d’y construire des forts, d’y envoyer des troupes, et de s’aider de l’avis et de l’influence de l’abbé Leloutre et des autres missionnaires, qu’on lui recommanda de ménager et de traiter avec toutes sortes d’égards, comme gens nécessaires dans les circonstances où l’on se trouvait.
En conséquence de ces instructions, le chevalier de la Corne fut envoyé dans l’Acadie continentale, afin d’y choisir un endroit convenable pour l’érection d’un fort, et d’où l’on pût facilement donner appui et protection aux familles acadiennes qui voudraient se soustraire à la domination anglaise. M. de la Corne fit d’abord choix de Chédiac, parce qu’étant près de la mer, on y devait être à portée de recevoir des secours et des approvisionnemens du Canada. Ce choix ne plut ni au gouverneur ni à l’abbé Leloutre; ils trouvèrent que le poste serait trop éloigné des établissemens acadiens, et il fut finalement choisi un autre endroit, entre la Baie Française, ou de Fundy et la Baie Verte, comme plus capable de remplir les vues du gouvernement. On jugea à propos de prendre poste en même temps à l’embouchure de la rivière St. Jean, et M. de Boishebert y fut envoyé à la tête d’un détachement de troupes et de Canadiens, avec ordre d’y bâtir un fort, et de s’entendre avec le P. Germain, jésuite, dont l’influence, dans ces quartiers, était égale à celle de M. Leloutre dans la presqu’île de l’Acadie.
Ce n’était pas assez d’avoir établi ces postes; il fallait encore trouver le moyen de les approvisionner, et la chose n’était ni facile ni sans danger, surtout pour celui de la rivière St. Jean, qui n’était guère accessible que par mer; car pour y parvenir, il fallait faire le tour de la Nouvelle Ecosse, et il était à craindre que les vaisseaux qu’on y enverrait ne tombassent entre les mains des Anglais. Il fallait pourvoir ces forts non seulement de provisions de bouche, mais encore d’armes et de munitions pour l’usage des Acadiens et des sauvages qui s’y étaient réunis. Comme ces approvisionnemens ne pouvaient venir que de Québec, le gouverneur, après plusieurs demandes à cet effet, fit partir pour la rivière St. Jean une corvette chargée de ces articles, sous le commandement de M. de Vergor. Cet officier avait ordre de tâcher d’éviter la rencontre de tout vaisseau anglais, mais en même temps de se défendre jusqu’à la dernière extrémité, s’il était attaqué. Le gouverneur de la Nouvelle Ecosse, informé de la chose, ordonna au capitaine Rouse de croiser le long de la côte, et d’intercepter tous les vaisseaux qu’il rencontrerait. Il n’y avait que quelques jours que cet officier était en mer, lorsqu’il rencontra M. de Vergor. Celui-ci fit force de voiles pour l’éviter; mais Rouse l’atteignit bientôt; et le capitaine français, se voyant incapable de soutenir le combat, abattit son pavillon, sans avoir tiré un seul coup de canon. Aussitôt que M. de la Jonquière eut été informé de cette prise, faite en temps de paix, et sans prétexte plausible, si la rivière St. Jean appartenait à la France, il envoya au gouverneur de Louisbord l’ordre d’user de représailles contre tous les bâtimens anglais qui étaient alors, ou qui entreraient dans son port. Si ces représailles eurent lieu, l’affaire dut devenir sérieuse; cependant Mr. Smith, qui nous sert ici de guide, ne dit pas comment elle s’arrangea; peut-être la prise fut-elle restituée, et les vaisseaux anglais, s’il y en eut de détenus, relâchés en conséquence.
Quoiqu’il en soit, le gouverneur de la Nouvelle Ecosse, instruit de l’ordre qu’avait reçu M. de la Corne de bâtir un fort entre la Baie de Fundy et la Baie Verte, c’est-à-dire dans l’isthme qui joint la presqu’île acadienne à la terre-ferme, envoya le major Lawrence à la tête d’un détachement de troupes, avec ordre de s’opposer à ce que les Français s’établissent sur le territoire anglais, et de bâtir un fort aussi près du leur qu’il serait possible, afin de les tenir en échec, et de leur ôter le dessein et le pouvoir de faire des incursions dans la Nouvelle Ecosse. Le major Lawrence trouva M. de la Corne campé à l’endroit nommé Beauséjour, et eut avec lui un pourparler au sujet de cet empiétement, comme il l’appellait. La Corne l’assura que ses ordres ne lui permettaient pas de passer au-delà de la rivière Beaubassin, et qu’il pouvait prendre poste et se fortifier de l’autre côté de cette rivière, s’il le jugeait à propos. Sur cela, Lawrence bâtit un fort vis-à-vis de celui de la Corne, et les deux commandans se maintinrent dans la possession de leurs forts respectifs. M. Smith rapporte ici un fait, dont il ne cite pas la garantie, et qui nous paraît peu croyable: il dit qu’aussitôt que l’abbé Leloutre eut été informé du mouvement du major Lawrence, il fit brûler les maisons et les granges des Acadiens qu’il dirigeait, pour les punir de ne s’être pas retirés de sous le gouvernement britannique. Ce n’est probablement pas le seul endroit où l’historien anglais outre la vérité, en parlant de la conduite de ce missionnaire français.
Depuis quelques années, des commerçons anglais avaient pénétré jusqu’à la baie Sandousky, à trente lieues du Détroit, et avaient acquis une influence considérable sur un nombre de Hurons qui s’étaient établis dans l’endroit, M. de la Jonquière ne vit point la chose avec indifférence, d’autant plus que le commerce du Canada en pouvait souffrir, et il crut que le meilleur moyen de remédier au mal était d’engager ces sauvages à aller joindre ceux de leur tribu qui étaient établis au Détroit. Il se servit pour cela du ministère du P. de la Richardie, leur missionnaire, qu’il crut le plus propre à réussir dans l’entreprise. Le P. de la Richardie assembla les Hurons de Sandousky en une espèce de conseil, et leur dit en substance: “Que c’était un sujet continuel de regret et de chagrin pour leurs frères de Lorette, de voir qu’ils s’étaient établis dans une contrée qui offrait des voies de communication si faciles avec les Anglais, dont l’unique objet était de les tromper, et que leur père Ononthio, mû par la tendre affection qu’il avait pour eux, désirait ardemment qu’ils allassent se fixer au Détroit, avec ceux de leur tribu qui y étaient déjà établis, et où ils ne manqueraient de rien de ce qui leur serait nécessaire.”
Les sauvages lui répondirent, “qu’ils étaient établis dans un pays fertile et abondant en gibier; qu’ils ne pouvaient empêcher les Anglais, non plus que les Français, de commercer avec eux, et qu’ils aimaient mieux rester où ils étaient que d’aller s’établir au Détroit.” M. de la Jonquière voyant qu’il ne pouvait réussir dans son premier dessein, prit le parti d’envoyer un officier pour résider parmi ces sauvages et épier leurs mouvemens. Cet officier eut ordre d’agir de concert avec le P. la Richardie, et de le consulter toujours, lorsqu’il y aurait quelque mesure à prendre.
La découverte supposée faite, du côté de la terre, de l’océan Pacifique, ou plutôt d’un grand golfe ou d’une mer de l’Ouest communicant avec cet océan par un détroit, occupait l’attention de M. de la Jonquière depuis son arrivée en Canada. Il avait approprié de grandes sommes d’argent pour s’assurer d’un fait aussi important, et avait donné commission à M. de la Verandrye de pénétrer, par le canal des lacs et des rivières de l’intérieur, jusqu’à cette mer, et de prendre, chemin faisant, possession des contrées qu’il traverserait, au nom du roi de France. Cet officier s’avança à quelques centaines de lieues au-delà du lac Supérieur, et érigea, de distance en distance, des espèces de forts, au dernier desquels il donna le nom de fort de la Reine.[1] C’était tout ce dont M. de la Verandrye était capable: il n’avait ni les talens ni les connaissances nécessaires pour faire des découvertes importantes, ou même des observations utiles. Il ne sut pas tracer une carte des immenses contrées qu’il avait parcourues; son journal n’en contenait point la description; il ne parlait ni de leur climat, ni de leur sol, ni de leurs productions; il n’était rempli que du récit insignifiant de la marche de chaque jour et de quelques discours de chefs sauvages, sans importance. On le jugea incapable de remplir la tâche qu’on lui avait confiée: sa commission fut révoquée, et donnée à d’autres individus. Mais des vues d’intérêt particulier vinrent se mêler au but noble, patriotique et désintéressé qu’on semblait s’être proposé d’abord: il se forma une espèce de société composée au gouverneur, de l’intendant, du comptroleur et de deux autres officiers, Legardeur de St. Pierre et Marin, lesquels devaient partager entr’eux les profits de l’expédition, s’il y en avait. Les deux derniers furent chargés de faire les découvertes. St. Pierre eut ordre de se rendre au fort la Reine, pour de là gagner en avant jusqu’à un lieu dont il serait convenu avec son compagnon de voyage, pour leur rencontre. Marin devait remonter le Missouri, et de là, s’il trouvait une rivière allant à l’ouest, la suivre jusqu’à ce qu’il fût parvenu à l’océan Pacifique, où St. Pierre le devait joindre, si, de son coté, il trouvait une rivière qui y conduisît. Ces messieurs partirent munis, aux frais de la couronne, de tout ce qui était nécessaire pour le voyage, et ils auraient probablement réussi, non pas à trouver une mer de l’Ouest qui n’existe pas, mais à atteindre l’océan Pacifique, s’ils eussent été plus entreprenants, ou plutôt, s’ils n’eussent pas eu plus à cœur leur intérêt particulier que le bien de leur pays. Mais indifférents quant au but ostensible de faire de nouvelles découvertes, ils ne s’avancèrent dans les pays sauvages qu’autant qu’il leur fut nécessaire pour amasser une immense quantité de pelleteries, avec lesquelles ils s’en revinrent à Québec, où leur vente rapporta à chacun des associés un énorme profit. La part du gouverneur se monta, suivant Mr. Smith, à la somme de trois cent mille francs; et le reste fut partagé entre l’intendant, le comptroleur et les deux voyageurs.
(A CONTINUER.)
|
Ce sont: le fort de Caministigoia, à l’entrée dans le lac Supérieur, de la rivière de même nom, aussi appellée Trois-Rivières, à cause de ses trois embouchures; le fort St. Pierre, à 110 lieues environ & l’ouest du premier, sur le lac des Pluies; le fort St. Charles, à 80 lieues au-delà, sur le lac des Bois; le fort Maurepas, à 100 lieues du dernier, et près de l’entrée du lac Ouinipic ou Ouinipigon; enfin le fort la Reine, à 100 lieues au-delà, sur la rivière des Assiniboils. Il fut encore construit trois autres forts, savoir: le fort Dauphin, sur le lac des Prairies; le fort Bourbon, sur le lac de même nom, et le fort Peskoyac, sur la rivière de ce nom, dont quelques géographes français du temps placent la source à 25 lieues seulement de leur prétendue mer de l’Ouest. |

Dès que les hommes commencent à se multiplier dans un nouveau pays, leur premier soin est de séparer leurs domaines et leurs habitations respectives, par des lignes et des bornes, qui en assurent l’étendue à leur postérité, et qui leur ôtent les moyens d’empiéter les uns sur les autres. Mais bientôt cette utile opération en nécessite et demande une autre, qui oblige les voisins à partager et diviser leurs propriétés respectives, par des murs ou clôtures mitoyennes, et qui gardent leurs moissons contre les ravages destructifs des animaux de toute espèce. Car sans cette nécessaire division à quoi ne seraient pas exposés les champs du cultivateur, lorsqu’ils sont couverts des superbes moissons que lui accorde un créateur libéral, grand et magnifique? Une seule nuit suffirait pour ruiner entièrement toutes les espérances d’un riche agriculteur, et même pourrait diminuer considérablement ses facultés domestiques et le jetterait dans la peine et le découragement. La négligence d’un berger nonchalant et paresseux; la force et la nécessité du sommeil d’un gardien fidèle et vigilant: la vitesse et les ruses d’un animal ?orbe, avide et gourmand, seraient autant d’occasions qui causeraient au cultivateur des pertes et des dommages considérables, et souvent irréparables. Outre ces accidens funestes, qui sont toujours très préjudiciables à l’agriculture, les frais et les soins d’un gardien fidèle et honnête conteraient encore une somme assez forte au cultivateur qui serait obligé d’employer un étranger à cette garde. Mais heureusement que l’industrie des hommes leur donne et fournit les moyens d’éviter toutes ces inquiétudes, et ces différents soins: une clôture haute, forte et solide, donne au cultivateur laborieux une tranquillité parfaite. Il dort paisiblement, tandis que les moissons croissent sous les soins bienfesants d’une providence libérale.
Particulièrement dans ce pays, où les bois sont très communs, on peut se procurer d’excellentes clôtures à peu de frais, et qui durent fort longtemps. Le meilleur bois pour les clôtures est le cèdre: presqu’exempt de la corruption, à laquelle tous les autres bois sont sujets, sa durée est longue et infiniment profitable. Toutes les autres espèces de bois ne fournissent que de médiocres clôtures et qui ne résistent pas longtems aux injures des tems et à la corruption. Un cultivateur soigneux et attentif à ses intérêts fait des clôtures un de ses principaux ouvrages. Il veille sans cesse à leur confection et à leur entretien. Une perche tombée par la force du vent, où quelqu’autre accident, un piquet qui se romp ou s’arrache, ou une brèche faite par la férocité de quelques animaux fougueux, peuvent causer au cultivateur des pertes et des dommages considérables. Une seule heure qu’un nombreux troupeau passe dans la moisson peut devenir très préjudiciable à la fortune d’un cultivateur indifférent. Une terre qui est bien enclôse et dont les clôtures sont en très bon état, produit toujours quelque chose au-delà de celles qui ne sont environnées que par de mauvaises clôtures, qui tombent ça et là, faute d’être bien faites et suffisamment entretenues. A l’aspect d’un champ et des clôtures qui l’environnent, on peut presque toujours et d’une manière certaine, juger quel est le soin, l’industrie, la vigilance et la capacité du propriétaire, auquel le tout appartient. Car presque toujours, un cultivateur paresseux et négligent a de mauvaises clôtures; sa terre paraît comme si elle n’appartenait à personne.
Vous voyez à un endroit un bout de clôture neuve, mal faite, et incapable de résister longtems aux injures des tems ou à la férocité des animaux. Plus loin, une vieille clôture faite de perches cassées et de vieux piquets, qui ne sont plus bons qu’à faire du feu ailleurs une mauvaise palissade, mal liée et qui ne doit durer que la saison qui l’a vu naître. Plus loin encore, cette palissade est faite de vieux bouts de planches et des restes de quelques bâtisses qui ont été démolies. Enfin on ne finirait point si l’on voulait faire une description exacte des clôtures qui environnent la propriété d’un cultivateur négligent et insensible à ses intérêts et à son honneur.
Chaque partie offre à l’œil la ruine et la décadence du propriétaire. C’est toujours une marque infaillible d’un cultivateur oisif et nonchalant. C’est la première pensée qui vient à l’esprit du passant, qui contemple avec peine et regret, une terre dont les clôtures sont en mauvais état. La Législature de cette Province, toujours attentive aux intérêts et aux avantages du peuple canadien, et cherchant par tous moyens possibles, à favoriser l’avancement de l’agriculture, a passé une loi fort utile, et qui pourvoit d’une manière efficace et non dispendieuse, à la confection et au rétablissement des clôtures, par l’opération d’inspecteurs nommés à cet effet dans chaque paroisse; de sorte que par cette loi, un cultivateur vigilant et soigneux peut contraindre un voisin négligent et paresseux à la confection d’une nouvelle clôture, ou au rétablissement d’une ancienne, lorsqu’elle peut être suffisamment réparée. Rien de si flatteur que de voir un champ environné de hautes, belles et fortes clôtures: tout y annonce le bonheur, la fortune et la prospérité du propriétaire, et chacun lui donne des louanges justes et bien méritées.
Mais si les clôtures sont nécessaires sur une terre pour y empêcher les ravages des animaux; les fossés y sont aussi d’une grande utilité pour arrêter les suites et malheureux effets que peuvent causer des pluies abondantes. C’est pourquoi, un cultivateur doit exactement environner et même couper sa propriété par des fossés et rigoles, qui puissent suffire à l’écoulement des eaux. Car rien n’est si préjudiciable aux grains que les inondations: elles arrêtent la crue de la végétation et lui sont plus nuisibles qu’une longue et brûlante sécheresse. Beaucoup de cultivateurs, soigneux et diligents pour faire tous les autres travaux nécessaires sur leurs terres, manquent cependant à celui-ci, qui exige autant de soin et de précautions que toute les autres obligations de leur état.
En remerciant l’auteur de nous avoir communiqué son ouvrage pour être publié dans ce journal, nous nous permettrons d’ajouter qu’il aurait pu, peut-être, le rendre plus complet, en y parlant, plus au long qu’il ne l’a fait, de l’épierrement, ou de la nécessité d’oter les pierres d’un champ où elles se trouvent en trop grande quantité, et faire de ce sujet un chapitre particulier. Nous prendrions sur nous de faire ce chapitre, tant bien que mal, s’il n’était pas parlé assez au long de la chose dans un numéro précédent de la Bibliothèque Canadienne (celui d’Avril 1829), auquel nous prenons la liberté de renvoyer les lecteurs.

Messieurs: quand le corps du génie, si fécond en officiers de mérite, vient de perdre un de ses chefs les plus distingués; quand je pleure à la fois l’ami le plus tendre, et le père le plus éclairé, laiserai-je sa tombe se refermer en silence? Non, messieurs: j’éprouve le besoin de vous faire partager ma douleur, je veux vous entretenir, une dernière fois, des précieuses qualités qui assurèrent au général de Léry votre estime, et comme guerrier, et comme citoyen.
Je vais essayer de tracer à votre mémoire quelques-unes des circonstances dans lesquelles il sut déployer, avec le plus de succès, l’énergie de son caractère, et cette supériorité de talens qui le plaça à la tête de son arme, poste dû à sa longue expérience et à la sagacité avec laquelle il sut toujours appliquer les règles de son art â la grande tactique. Dans toutes les occasions qui le mirent en position de commander pendant sa longue et honorable carrière, il sut se concilier l’estime et l’affection de ses subordonnés; sa bourse leur était toujours ouverte, et sa protection, puissante alors, ne leur fut jamais refusée; son cœur noble et généreux ne se rebutait jamais parles nombreux exemples d’ingratitude qu’il éprouvait: il se contentait, pour prix de ses bienfaits, du concours unanime d’estime et d’affection de tous les gens de bien qui le connaissaient; il obligeait pour le plaisir d’obliger, et sa générosité naturelle s’opposait incessamment à l’accroissement de sa fortune. Il négligeait même les moyens les plus légitimes de s’assurer un bien-être.
En Hollande, en Italie, en Espagne, il ne fit jamais d’épargnes sur ses traitemens, qui s’élevaient à des sommes considérables: tout ce qu’il n’employait pas à soutenir dignement le rang qu’il occupait, était divisé en gratifications sur les soldats, en secours pour ses officiers; et le seul héritage enfin qu’il ait laissé à sa femme et à son fils, c’est une réputation intacte et de beaux exemples à suivre.
Combien de grands personnages, possesseurs d’une immense fortune, eussent donné, à leur heure dernière, les millions que leur avarice avait entasses, pour laisser à leurs citoyens des souvenirs aussi glorieux, aussi touchans, pour emporter avec eux, comme le général de Léry, la consolante certitude qu’ils ne laissent après eux que des exemples d’honneur et de vertu, des êtres dont ils avaient assure le bonheur, quelques envieux de leur renommée, peut-être, mais pas un seul ennemi.
J’ai parlé de ses vertus, comme militaire, et je fournirai à la fin de cette notice, les preuves à l’appui de ce que j’ai dit.
Vous entretiendrai-je maintenant des droits qu’il sut acquérir à la reconnaissance des villageois au milieu desquels il se retira, lorsque l’ordonnance rendue sur la proposition du maréchal Gouvion St. Cyr, vint l’envelopper dans la ruine de tant d’officiers-généraux, qui pour prix de leurs longs services, n’obtinrent qu’une retraite modique et forcée, lorsqu’ils devaient espérer au moins qu’on leur laisserait la liberté de servir jusqu’à leur dernier soupir, une patrie à laquelle ils avaient assuré une gloire immortelle pendant trente années de guerres consécutives; un roi, objet de leur vénération auquel ils savaient, pour ainsi dire, fait hommage de leur renommée.
Difficilement justifiera-t-on un acte qui sembla anéantir les services de tant d’illustres vétérans.
Cependant, le coup était porté; il fallut s’y soumettre; retiré, à huit lieues de la capitale, dans une campagne agréable, qui appartenait à sa femme, le général de Léry cherchait toujours les occasions de servir son pays et son roi: il s’en présenta bientôt une, et elle lui fut d’autant plus agréable qu’elle devait lui fournir de nombreux motifs pour donner de nouvelles preuves de son désintéressement et de sa générosité; le bourg près duquel était placée sa retraite se ressentit de l’influence bienfaisante de son voisinage, et la place de maire lui fut offerte.
Il ne dédaigna pas cet hommage rendu à ses vertus; il y fut au contraire extrêmement sensible, et presqu’à la fin de sa carrière, l’homme qui, si longtemps, avait illustré son arme et brillé dans nos camps, vint, nouveau Cincinnatus, labourer ses champs, aider, protéger la nouvelle famille qui l’adoptait en quelque sorte pour son père, et recueillir enfin une nouvelle et dernière moisson de louange, d’amour et de vénération.
Entrerai-je dans quelques détails concernant la vie simple et utile qu’il menait dans ce séjour de paix; non, Messieurs: nous laisserons parler ses voisins, tous les villageois qui furent sous son administration, et dont M. Jouet, adjoint de la commune, a été l’interprête, dans un discours qu’il eût prononcé sur la tombe de mon père, sans la modestie qui l’empêcha de parler après mon oncle, le général Kellermann, duc de Valmy.
La voici, cette preuve touchante de l’estime qu’il inspirait, et des regrets qu’il a laissés.
“Messieurs, chacun de nous vient, dans cette triste cérémonie, apporter son tribut de regrets pour l’homme de bien dont nous déplorons la perte.
“Qui l’eût dit, Messieurs, que ce pieux devoir nous rassemblerait sitôt, quand il y a quelques jours encore nous ressentions l’influence de son administration toute paternelle, qu’au lieu de sa présence qui nous était promise, nous serions réduits à n’accueillir que ses restes inanimés?
“La carrière dé M. le général vicomte de Léry a été marquée par d’illustres événemens.
“Né au Canada, la France le vît bientôt dans les rangs de ses défenseurs; peu de campagnes, peu de sièges mémorables ont eu lieu sans qu’il y ait participé: le maréchal Kellermann sut le distinguer et l’associer en quelque sorte à ses travaux et à sa gloire, en le faisant entrer dans sa famille.
“M. le vicomte de Léry avait aussi puissamment contribué à l’illustration de sa patrie adoptive; sa vie entière lui fut consacrée, et, après l’avoir servie de son épée, il vint parmi nous se dévouer à des fonctions civiles qu’il a si bien remplies.
“La commune d’Annet conservera toujours, de son administration, un souvenir plein de reconnaissance; nous chérirons sa mémoire, et, dans notre gratitude, nous nous féliciterons de ce qu’une de ses dernières pensées a été pour la commune, puisqu’il a voulu reposer parmi nous.
“Ses administrés lui conserveront après sa mort toute l’affection qu’ils lui portaient pendant que sa vie était employée à leur utilité.”
Je n’ajouterai rien à ce discours qui, selon moi, renferme en peu de phrases le plus bel éloge que l’on puisse faire du général de Léry. Oh mon père! votre mémoire est assez honorée par les regrets des bons et simples villageois, au milieu desquels vous aimiez tant à vous trouver; vous leur étiez bien cher. J’ai vu leurs larmes couler quand le général Kellermann, dans un discours touchant, fit l’énumération des titres que vous donnaient vos vertus guerrières et civiles à la reconnaissance de vos citoyens.
Reposez en paix, mânes sacrés; un encens toujours pur s’élèvera jusqu’à vous: il ne sera composé ni de louanges mercenaires, ni de regrets factices; nos vœux pour votre éternelle félicité vous accompagneront dans les célestes demeures, et l’espoir de vous retrouver un jour paré de vos vertus, environné de cette béatitude promise à tous les justes par un Dieu puissant, pourra seul nous faire supporter avec courage des jours flétris par votre absence.
François-Joseph Chaussegros de Léry, fils M. Gaspard-Joseph Chaussegros, écuyer, sieur de Léry, lieutenant de toutes les troupes de la marine du Canada, et de madame Louise de Brouagues son épouse, est né le 11 Septembre 1754, et a été baptisé le lendemain en l’église paroissiale de Notre-Dame de Québec.
Il eut pour parrain le sieur François Martel de Brouagues, commandant pour le roi de France en toute la côte de Labrador.
Il fut l’aîné de dix-sept enfans dont cinq seulement lui survivent.
A peine âgé de huit ans, on l’envoya au collège à Paris, où il fit lui-même son éducation.
Admis à l’Ecole du génie a quinze ans, il en sortit en qualité de lieutenant en 1773.
Aspirant en 1777, il fut promu au grade de lieutenant le 12 Octobre 1780. Il fut décoré de la croix de Saint-Louis dans le courant de Juin 1790; il fut nommé par le roi commandeur du même ordre en 1814; mais ensuite, malgré son ancienneté, ses droits reconnus, et ses justes réclamations, il n’a jamais pu obtenir du ministère d’être porté sur le travail qui se présentait tous les ans au Roi à la Saint-Louis, pour nommer les grands-croix de l’ordre. Pendant le mois qui précéda sa mort, il adressa de nouvelles demandes à ce sujet, dont le résultat eût sans doute été plus heureux, mais il n’a pas eu la consolation de voir l’avènement du roi Charles X, et toutes nos espérances se sont anéanties avec lui.
Le général vicomte de Léry avait été nommé chef de bataillon, sous-directeur des fortifications, le 1er. germinal an iii; promu extraordinairement chef de brigade, le 28 Février an iv, il fut nommé directeur des fortifications, le 5 ventôse an vi.
On le nomma encore extraordinairement général de brigade le 17 thermidor an vii.
Le premier consul le nomma inspecteur-général des fortifications, et commandant en chef du génie à l’armée expéditionnaire de Hollande, le 5 floréal an viii.
Il fut promu au grade de général de division, le 1er. Février 1805.
1781. Aux colonies d’Amérique.
1782. S’est trouvé au combat que l’escadre française livra à l’amiral Kempenfeld (1783, 1784.)
1785. S’est particulièrement trouvé aux combats des 9 et 12 Avril.
1782. A mis deux fois l’île de la Guadeloupe en état de défense (1786, 1787, 1788, 1789, 1790 1791 et 1792.)
Ans III. A disposé les ouvrages qui ont servi au passage du Rhin depuis Neuss et Dusseldorf jusqu’à Vadagen.
IV. A marché avec le corps d’armée qui a effectué le blocus de Cassel; a dirigé les ouvrages qui devaient assurer la possession de Morbach-Biberich et Carthorin.
V. S’est trouvé à la retraite du maréchal Jourdan depuis le Mein jusqu’à Dusseldorf; a marché avec ce général pour tenter le déblocus de Manheim.
VI et VII. Campagnes aux armées de Mayence, du Danube et du Rhin.
VIII et IX. Campagnes aux armées du Rhin et des Grisons.
XII. Armée des côtes de l’Océan.
XIII. Grande armée.
XIV. Prise d’Ulm. Bataille d’Austerlitz.
1805. Sa belle conduite l’a fait nommer grand-officier de la Légion-d’Honneur (1806 et 1807.)
Il est désigné pour commander le génie en Italie.
1809. Nommé commandant en chef du génie au grand état-major-général des armées d’Espagne, il montra en 1811 un talent consommé au siège de Badajoz, qu’il dirigea en personne (1810, 1811, 1812.)
1813. Commandant en chef du génie à l’armée d’Espagne.
1814. Commandant en chef du génie à la grande armée dans la campagne de France.
En 1814, le Roi de France le nomma membre de son conseil de la guerre, et grand-croix de la Légion d’Honneur.
Nommé baron en 1811 par Napoléon, qui lui donna une dotation en Westphalie, il fut nommé vicomte par le Roi, en 1814.
Il fut mis à la retraite en raison de l’ancienneté de ses services, et d’après la loi du 1er. Août 1815.
On verra par cette notice biographique que le lieutenant-général vicomte de Léry a servi pendant quarante-six années activement; qu’il s’est distingué plusieurs fois, a fait trente-cinq campagnes, a assisté à environ soixante-dix batailles combats ou sièges mémorables.
Tant de titres à la reconnaissance et à l’estime de ses contemporains me fout espérer que l’on accueillera favorablement cet écrit sur la vie de mon père.
En le publiant, mon but a été de satisfaire à la fois les vœux de ses anciens compagnons d’armes, les désirs de ses amis, et enfin le besoin que j’éprouvais de faire partager à toutes ses connaissances les regrets et la douleur que j’éprouverai toujours de sa perte.
Le général de Léry est mort à Chartrelle, près Melun, le 5 Septembre 1824, chez M. le comte de Marchais, son ami et son parent, qui lui a prodigué jusqu’à son dernier soupir les soins les plus empressés et les plus tendres. Je crois devoir payer ici à M. de Marchais le tribut d’éloges qu’il a mérités.
C’est finir dignement cette brochure que de la terminer en donnant une preuve de reconnaissance à celui qui soigna si bien, dans ses derniers momens, un homme qui professa toujours cette vertu au plus haut degré.
Les restes du vicomte de Léry ont été déposés, suivant ses désirs, dans un cimetière qu’il s’était réservé à Annet, près Clayes, département de Seine-et-Marne, à côté de la retraite qu’il habita pendant les neuf dernières années de sa vie.
|
Paris, imprimerie de Carpentier-Méricourt, 1824. |

Les plus vaillants hommes sont souvent affrayés d’un danger qu’ils n’ont pas eu occasion d’éprouver,—dont ils ne peuvent se former aucune idée précise, et dont les conséquences leur paraissent évidemment fatales. Le soldat va hardiment au-devant du canon et de l’arme à feu, parce qu’il y est accoutumé, et que jusqu’alors il a échappé à ces instrumens meurtriers, tandis qu’il fuit à l’aspect du coutre ou de la fourche dont un paysan le menace. Le plus brave capitaine serait saisi de terreur à la vue d’un animal monstrueux qui se présenterait sur le champ de bataille. Sa lance, son bouclier, son armure enfin, ne l’empêcherait pas de précipiter sa fuite.
On raconte du maréchal de Turenne, dont on ne saurait suspecter le courage et la bravoure, qu’étant dans la tente du roi, un jour qu’un célèbre mangeur de pierres vantait ses exploits et ses talens en ce genre, l’imposteur dit à sa majesté que, si elle le trouvait bon, il avalerait le maréchal, lui et toute son armure. Le maréchal n’eut pas plutôt entendu cette proposition extravagante, qu’il éprouva une grande frayeur et s’enfuit précipitamment. Ce ne fut pas sans peine que le roi vint à bout de le persuader qu’il pouvait sans crainte sortir de l’endroit où il s’était caché. La fuite du maréchal en cette occasion singulière n’était pas l’effet de la lâcheté, mais seulement de la crédulité. S’il croyait, ainsi qu’il l’a assuré, qu’il était possible que le fripon l’avalât lui et son armure, sa conduite n’était que l’effet de la prudence et le résultat du désir, aussi raisonnable que naturel, de sa propre conservation. Car à quoi lui auraient servi son épée et sa valeur pour se défendre d’un ennemi qui pouvait tout détruire d’un seul coup?
Le courage n’est donc véritablement qu’une disposition d’esprit que nous appellons bravoure et prudence, ou que nous taxons de témérité et de folie, suivant le succès de l’entreprise que l’on a hasardée, ou l’opinion que nous avons de son utilité.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire présente à l’Académie le dessin d’un monstre vivant à Turin dans les premiers jours du mois dernier. Ce dessin et la nouvelle de l’evénement lui ont été communiqués par M. le professeur Rolando et par M. Jules Arthaud, médecin français. L’individu représenté est une fille à deux têtes. Les parties inférieures seules sont communes aux deux individus; le reste est séparé, et offre la conformation propre à l’état normal. Voyant dans cet être deux individus séparés, le prêtre les a baptisés chacun à part; l’un a reçu le nom de Ritta, l’autre celui de Christina. Elles sont nées à Sassari, en Sardaigne, dans le commencement de mars 1829; leur taille commune est celle d’un enfant à terme. Ritta paraît souffrante. Le père a l’intention de les porter à Milan, d’où il doit se rendre à Genève.[1]
|
Il n’est pas sans exemple de voir des monstres semblables parvenir à un âge assez avancé. Sous le règne de Jacques III, roi d’Ecosse, et à sa cour, vivait un homme double a partir de l’ombilic, simple au-dessous de cette région. Le roi le fit élever avec soin. Il fit des progrès rapides dans la musique. Les deux têtes apprirent plusieurs langues; elles discutaient ensemble, et les deux moitiés supérieures se battaient même quelquefois. Le plus habituellement elles vivaient de bon accord. Lorsqu’on chatouillait ou piquait le train inférieur du corps, les deux individus le ressentaient en même tems. Quand, au contraire, on irritait fan des individus supérieurs, lui seul en éprouvait les effets. Cet être monstrueux mourut à l’âge de vingt-huit ans. Un des corps mourut plusieurs jours avant l’autre. (Rerum Scoticarum historia. L. XIII, page 444. fluct. G. Buchanan.) En 1723, M. Martinez observa à Madrid un homme bicéphale que l’on y montrait pour de l’argent. Sigebert dit aussi avoir vu un enfant double supérieurement, simple inférieurement. L’un mangeait, l’autre ne mangeait point. Souvent ils se battaient ensemble. L’un étant mort, l’autre survécut à peine quatre jours. |

Ceux que nous appelions sauvages ou barbares, le sont bien moins que certains Européens fiers de leurs lumières, et laissent souvent éclater des sentimens remplis de délicatesse et d’honneur. En voici un exemple frappant. Un Chactas parlait un jour fort mal des Français, et disait que les Indiens voisins de sa nation étaient leurs chiens, c’est-à-dire leurs esclaves. Un de ceux-ci, indigné de ces injures, le tua et se retira à la Nouvelle-Orléans. La nation des Chantas voulut en tirer vengeance, et envoya des députés au gouverneur pour réclamer le coupable. Elle refusa tous les présens qu’on lui offrit pour assoupir cette affaire, et menaça de brûler le village de l’assassin, si on refusait de le lui livrer. On fut donc obligé de le remettre entre leurs mains. Un officier français se chargea de cette triste commission, et le meurtrier fut conduit près de l’endroit où le crime venait d’être commis. Les Chactas assemblés reçurent leur victime en présence de la peuplade outragée, qui s’était rendue au même lieu. Le coupable d’un crime bien excusable aux yeux des Français, harangua de bout, suivant l’usage de ces peuples, et dit: “Je suis un homme (c’est-à-dire je ne crains point la mort;) mais je plains le sort d’une femme et de quatre enfans, que je laisse après moi dans un âge fort tendre; je plains mon père et ma mère, qui sont vieux, et que je faisais subsister par ma chasse. Je les recommande aux Français, puisque c’est pour avoir pris leur parti que je suis sacrifié.”
A peine eut-il achevé ce discours, que son père, qui était présent, se leva, s’avança au milieu de l’assemblée des deux nations, et parla en ces termes: “C’est avec justice que mon fils meurt, puisqu’il s’est rendu coupable d’un meurtre; mais étant jeune et vigoureux, il est plus capable que moi de nourrir sa femme, sa mère et quatre jeunes enfans. Il faut donc qu’il reste sur la terre pour en prendre soin. Quant à moi, je suis sur la fin de ma carrière; j’ai vécu assez; je souhaite même que mon fils parvienne à mon âge pour élever mes petits-enfans. Je ne suis plus bon à rien; quelques années de plus ou de moins me sont indifférentes. J’ai vécu en homme, je veux mourir de même; c’est pourquoi je vais prendre sa place.”
En entendant ces paroles, qui exprimaient l’amour paternel d’une manière aussi forte que touchante, se femme, son fils, sa belle-fille, et ses petits-enfans fondaient en larmes autour de ce tendre et courageux vieillard. Il les embrassa pour la dernière fois, et prenant ses petits-enfans dans ses bras, il les présenta aux Français et les leur recommanda. Il s’avança ensuite vers les parens du mort et leur offrit sa tête: elle fut acceptée. Ces sortes d’échanges sont ordinaires chez les sauvages. Le vieillard s’étendit sur un tronc d’arbre, et on lui abattit la tête d’un coup de hache. Tout fut assoupi par cette mort. Le jeune homme fut contraint de livrer lui-même la tête de son père; et en la ramassant, il lui adressa ces mots: “O mon père, pardonne-moi ta mort, et souviens-toi de ton fils dans le pays des âmes.” Tous les Français qui assistèrent à cette tragédie furent attendris jusqu’aux larmes, en admirant le sacrifice héroïque du vieillard. Les Chatas prirent la tête, la mirent au bout d’une perche, et l’emportèrent comme en triomphe dans leur village.

On nous a communiqué par lettre la description d’un diner donné, le 20 du courant, par quelques jeunes Messieurs de Berthier à leurs amis du village. Quoique nous ne croyons pas devoir mettre sous les yeux du public les détails que nous a fournis l’auteur de la lettre en question, nous dirons néanmoins que loin de regarder ces maniérés de se réunir amicalement, comme indifférentes en elles-mêmes, et absolument indignes d’occuper l’attention d’hommes graves et sensés, nous y voyons au contraire la commémoration du bonheur de nos ancêtres, la perpétuation de leurs mœurs et surtout de leur socialité. Nous entendons parler de celles de ces réunions où règnent, comme ont régné dans celle dont il s’agît ici, l’urbanité franche, la tant soit peu bruyante, mais toujours aimable hilarité, l’attrayante convivialité canadienne, en un mot, si l’on veut bien nous passer cette expression. Ce qui relève surtout un repas vraiment canadien, ce sont les bons-mots, les lardons, les reparties fines ou caustiques, les rétorsions de ceux qu’on agace ainsi, non dans la vue de les offenser, mais pour égayer la compagnie, et rehausser, pour ainsi dire, la qualité et le goût des mets et des boissons; ce sont les chansons, chantées quelquefois à gorge déployée, quand il ne s’y mêle rien de trop trivial, ni, ce qui pis serait, d’indécent. Sans nuire à la gaité, non plus qu’a l’honnête liberté des convives, la présidence, la vice-présidence et les santés viennent à propos donner un ton imposant à la réunion, mettre de l’ordre dans le repas, et restreindre dans les justes bornes de l’hilarité ceux qui autrement pourraient être tentés d’aller au-delà. Les jeunes Messieurs qui se sont assemblés en la présente occasion, ont mérité d’être loués de leur loyauté, de leur patriotisme, de leur retenue dans la joie et de leur sobriété. La première santé a été portée à notre Souverain George IV; la seconde à son Excellence Sir James Kempt, notre digne Administrateur; la troisième à la prospérité du Canada; la quatrième aux honorables membres de la Chambre d’Assemblée, &c. L’air national, God save, &c. a terminé le repas. Puissent tous ceux de nos jeunes compatriotes qui se réuniront dans le même but, se comporter toujours de manière à mériter des éloges, loin de se mettre en butte à la censure, et préserver les antiques, loyales, et honnêtement joviales manières canadiennes dans les repas.

Tel est le titre d’un Journal annoncé par un Prospectus qui a été publié, ces jours derniers, et qui doit être rédigé par MM. J. Labrie et A. N. Morin, déjà avantageusement connus parmi nous comme écrivains. Comme de Prospectus a été tiré, nous dit-on, à un très grand nombre d’exemplaires, les extraits que nous en pourrions faire ne seraient très probablement que des répétitions pour la presque totalité de nos lecteurs. Nous nous contenterons donc de reproduire ici les courts passages suivants, qui nous ont paru être du nombre des plus remarquables.
“Pour mettre de l’ordre dans la disposition des articles, disent les éditeurs, nous les passerons, ainsi que le titre l’indique, en quatre divisions.”
“La Politique, l’Histoire, l’Education, la critique des ouvrages qui y auront rapport, feront le sujet de la première partie. On aimera à y retrouver le souvenir de ceux de nos dévanciers qui ont honoré le nom Canadien, dans la guerre ou dans les conseils, ou qui se sont autrement illustrés par leurs travaux ou leurs vertus.”
La même partie qui traitera de l’agriculture “contiendra tout ce qui aura rapport aux sciences, au commerce, à l’économie domestique et à l’industrie.”
La troisième “partie se composera de traits remarquables de l’histoire ecclésiastique du Canada, de documens qui y auront rapport, d’extraits à l’avantage des mœurs, &c. Outre les avantages qui tiennent aux idées religieuses, disent ici joliment les éditeurs, le peuple Canadien a encore celui de trouver tous ses souvenirs historiques alliés à sa croyance. C’est la religion qui a créé et qui conserve les mœurs patriarchales de nos honnêtes habitans; on la retrouve dans tous les temps de la colonie, répandant ses bienfaits et ceux de la civilisation au milieu des peuplades sauvages et sous le chaume des premiers colons, au fond des déserts les plus reculés et dans la rustique habitation du cultivateur de nos jours.”
Le coin du feu paraîtra tous les trois mois, en cahiers de 144 à 160 pages in-8vo. proprement brochés. Le prix sera de quatre piastres par année.
Enfin le plan des éditeurs nous semble on ne peut mieux adapté aux circonstances où se trouve notre pays, et nous leur souhaitons bien cordialement tout le succès qu’ils nous paraissent mériter.

L’Angleterre n’offre rien de particulier: aucun des changemens dans le ministère annoncés par quelques uns des journaux de Londres n’avait eu lieu aux dernières dates. On disait que Mr. O’Connell avait été élu à Clare.
En France, tout le ministère a été bouleversé, et remplacé par un ministère plus ultra-royaliste que celui de Villèle. Le nouveau cabinet se compose de MM. le prince de Polignac, ministre des affaires étrangères; le général comte Bourmont, ministre de la guerre; le vice-amiral de Rigny, ministre de la marine; le comte de la Bourdonnaye, ministre de l’intérieur; le baron de Montbel, ministre des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique; le comte de Chabrol, ministre des finances.
D’après une lettre de Lisbonne, l’inquisition va être rétablie en Portugal, le décret à ce sujet ayant déjà été présenté à Don Miguel pour son approbation.
Le ministre de la police, réputé trop modéré, a été renvoyé, pour faire place à un homme plus énergique et plus au goût de Don Miguel et de la reine mère.
Il y a eu plusieurs arrêtations en Catalogne et en Arragon. Ferdinand était, disait-on, occupé des préparatifs de son nouveau mariage, quoique sa défunte épouse ne fût pas encore inhumée.
Une lettre de Syra, du 18 Juin, dit que les Grecs se sont emparés de Thèbes, et qu’Omer, pacha de Cariste, qui était venu au secours d’Athènes, a été défait et obligé de se retirer à Negrepont. La Gazette Universelle de la Grèce annonce que la garnison d’Athènes, forte de 3,000 hommes, a fait une sortie, et attaqué les Grecs sur une montagne à l’ouest de la ville, mais qu’elle été repoussée avec perte. Le Courier de Smyrne dit qu’on assurait qu’une frégate anglaise s’étant rencontrée, dans le golfe de Volo, avec la barque à vapeur grecque la Persévérance, elle l’a sommée de se retirer, et que sur le refus du capitaine grec, elle a tiré dessus et l’a coulée a fond! On ajoute que ce rapport est confirmé par des lettres d’Ancône. On disait que l’amiral Miaulis avait été nommé président de l’assemblée nationale de la Grèce.
Il paraît que les Russes ont passé le Balkan, ou se sont avancés dans ces montagnes, sur deux colones, sans rencontrer beaucoup d’opposition. Les généraux turcs n’ont pas fait dernièrement tous les mouvemens qu’ils auraient semblé devoir faire; d’où l’on conjecture qu’ils ont eu ordre de se tenir sur la défensive.
Tout la Méxique paraît être en mouvement pour repousser l’invasion espagnole.

Monseigneur l’évêque de Fussala est parti ce matin «le 21» pour aller bénir le nouveau collège de Ste. Anne.
M. Bouchette, arpenteur général, est parti samedi pour Liverpool, et l’honorable M. Percival, ce matin, pour Londres.
Le parti explorateur chargé d’explorer la seigneurie St. Gabriel, au nord-ouest de Québec, est de retour. Il rapporte qu’il y a de la bonne terre propre au défrichement à aller jusqu’à 30 à 40 milles des anciens établissemens, en montant la rivière Batiscan, et aussi quelques endroits de bonne terre le long de la rivière Ste. Anne, en arrière des concessions en seigneurie.
La partie des biens du receveur-général, en ce district, dont la vente avait été fixée pour aujourd’hui, si été vendue ce matin au bureau du schérif. La maison et le quai de la basse-ville £4,050 à John Jones, le jeune; la seigneurie de St. Etienne, environ £1700, à M. G. Pozer; la seigneurie de Gaspé environ £600, à Moses Hart, et la terre sur le chemin de Lorette, à M. Boyd; £240.—Gazette de Québec.
Ordinations. Le Samedi, 19 du courant, il y a eu 29 ordinations à l’église de St. Jacques, savoir:
MM. J. Quevillon, Oct. Boucher, Frs. L’heureux, Magl. Turcot, Prêtres; Et. Lavoie, Patrice Burke, J. B. Labelle, Diacres; Ig. Archambault, S. Lamarre, Sous-diacres; S. Raymond, Vict. Mignault, L. Vinet, D. Denis, P. Clairoux, Ol. Giroux, F. X. Deseve, V. Plinguet, Fél. Perrault, Et. Birs, Chs. Laroque, H. Aubertin, Acolythes;—Mefard, L. Deligny, Pasc. Brunet, J. Dupuis, J. Laroque, Ol. Archambault, G. Marchesseau, J. M’Kay, Clercs-tonsurés.
Son Excellence l’Administrateur en chef, qui parait bien désirer de connaître le local de la Province dont l’administration lui est confiée, après avoir visité dans le cours de l’été le district d’en haut et les townships de l’est, se mit en route le Dimanche 13 du courant, vers midi, accompagné de l’honble. Lieut. Col. Gore. D. Q. M. G. et du Lieut. Col. Duchesnay, un de ses A. de C. P. pour les établissemens le long de la rivière Chaudière et le chemin de Kenebec. A son arrivée à Ste. Marie de la Nouvelle Beauce, vers les quatres heures et demie du même jour, il y fut reçu par la Cavalerie Bourgeoise et par les principaux habitans du lieu, qui escortèrent Son excellence jusqu’à la maison de l’hon. Juge Taschereau, un des co-seigneurs de la paroisse, où il trouva une compagnie de Milices commandée par le Capitaine Réni, qui lui rendit les honneurs militaires.—Ayant mis pied à terre, une garde d’honneur fut placée à la porte de la maison, mais le général trouva bon d’en dispenser, et en conséquence elle fut retirée. Son Excellence dina et prit sa résidence pour la nuit chez l’honorable Juge; et le lendemain matin se remit en route, déjeuna à St. Joseph, chez le Révd. Mr. Decoigne, Curé du lieu, et après avoir procédé à la visite du chemin de Kenebec, revint sur ses pas et coucha ce soir là à St François. Le jour suivant, Mardi, Son Excellence dans son retour vers Québec, s’arrêta de nouveau à Ste. Marie pour visiter le dépôt des armes et le bureau des douanes à ce poste, et fit sa rentrée dans cette cité dans l’après midi du même jour. Gazelle Officielle.
Il parait par un article du Mercury de Québec, que le présent portail de la cathédrale catholique sera remplacé, probablement l’été prochain, par un portail en pierres de taille, sur un plan fait par Mr. Baillargé, fils, architecte, d’après le portail de l’église de Ste. Geneviève, de Paris. Nous en prendrons occasion, dit l’éditeur, de dire un mot du nouvel étui ou boite d’orgue placé la semaine dernière, et exécuté par Mr. Baillargé. L’ouvrage est en bois d’acajou (mahogany) joliment sculpté, et représentant, comme d’ordinaire, le devant d’un orgue, dont les tuyaux sont richement dorés. Les pilliers des côtés et le centre du front sont surmontés de dessins convenables d’instrumens de musique en dorure. Le tout a un effet agréable et va de pair avec les autres décorations ajoutées depuis peu à la cathédrale catholique.

Mariés:—A Montréal, le 21 du courant, Mr. A. Peltier à Dlle Henriette Dechantal;
A la Pointe aux Trembles, le 22, Mr. Jos. Viger, Sculpteur, de Boucherville, à Mad. veuve Beaudry;
A St. Charles, le même jour, Mr. S. Marchesseau, Instituteur, à Dlle Judith Maurin;
A St. Luc, le même jour, Mr. Aug. Gauthier, à Dlle Sophie Marchand;
A Québec, le 24, Mr. F. X. Drolet, Médecin et Chirurgien, de St. Nicholas, à Dlle E. Hedley Place.
Décédés:—A St. Vincent de Paul, le 13, Dame Josephte Demers, veuve Chenet, âgée, dit-on, de 96 ans et 9 mois et demi;
A Montréal, le 20, François Roy, écuyer, Avocat, âgé de 39 ans, universellement regretté pour ses connaissances, ses talens et ses vertus patriotiques et civiques;
Au même lieu, le 24, François Edouard, enfant de J. R. Rolland, écr. âgé de 4 ans et 4 mois et demi;
A Québec, le 25, à l’âge de 72 ans, l’hon. William Burns, membre du Conseil Législatif.
Commissionnés:—Théophile Bruneau, écr. Avocat et Procureur;
Mr. J. C. Fournier, Médecin et Chirurgien;
Samuel Hatt, William Macrae, Gabriel Marchand, Timothée Franchere et René Boileau, fils, écuyers, Commissaires pour faire un Canal navigable de la ville de St. Jean au Bassin de Chambly.
Printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Mis-spelled words and punctuation have been maintained except where obvious printer errors occur.
[The end of La Bibliothèque Canadienne, Tome IX, Numero 7, Octobre 1829. edited by Michel Bibaud]