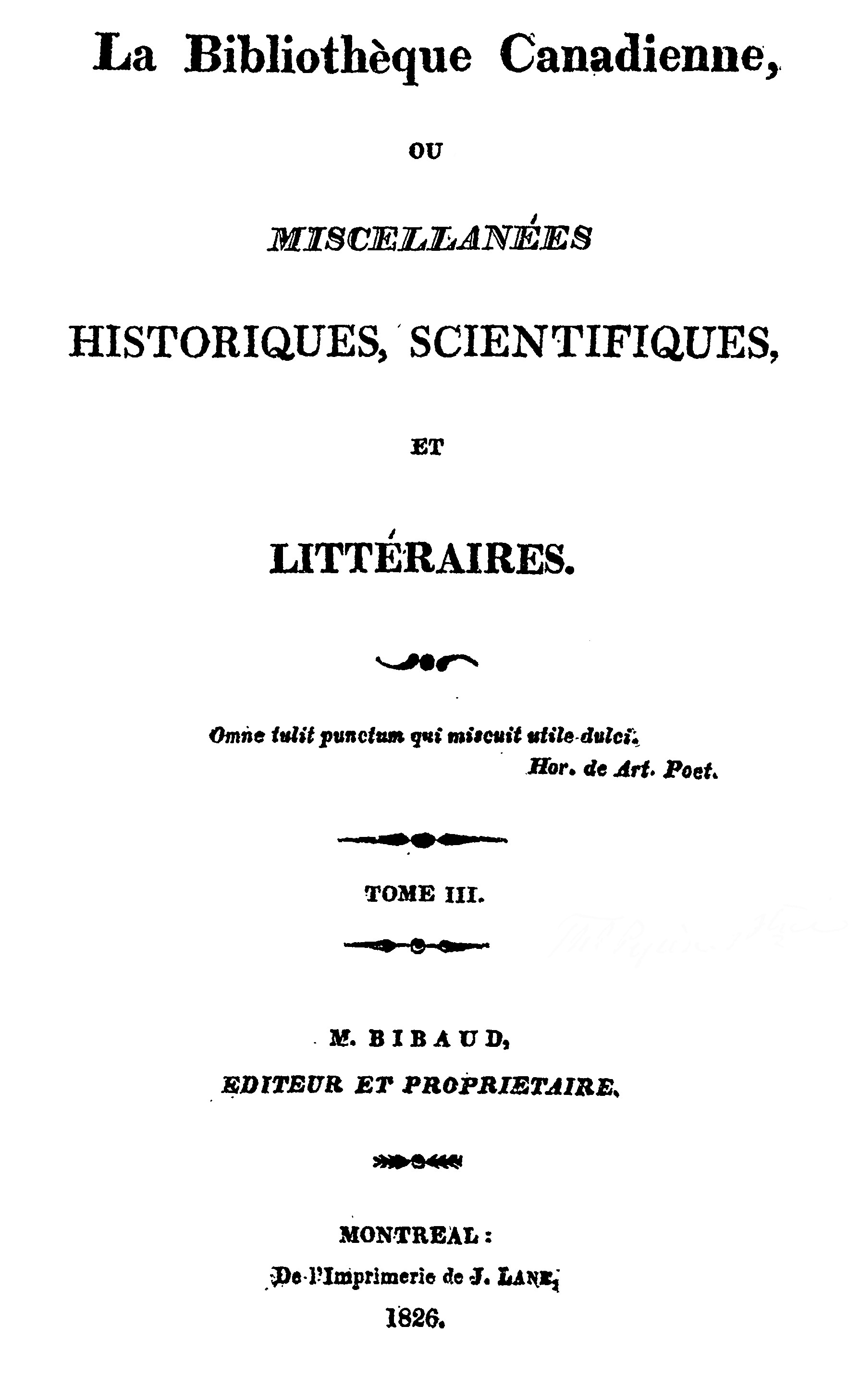
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome III, Numero 5, Octobre, 1826.
Date of first publication: 1826
Author: Michel Bibaud (editor)
Date first posted: Apr. 14, 2020
Date last updated: Apr. 14, 2020
Faded Page eBook #20200426
This eBook was produced by: Larry Harrison, David T. Jones, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
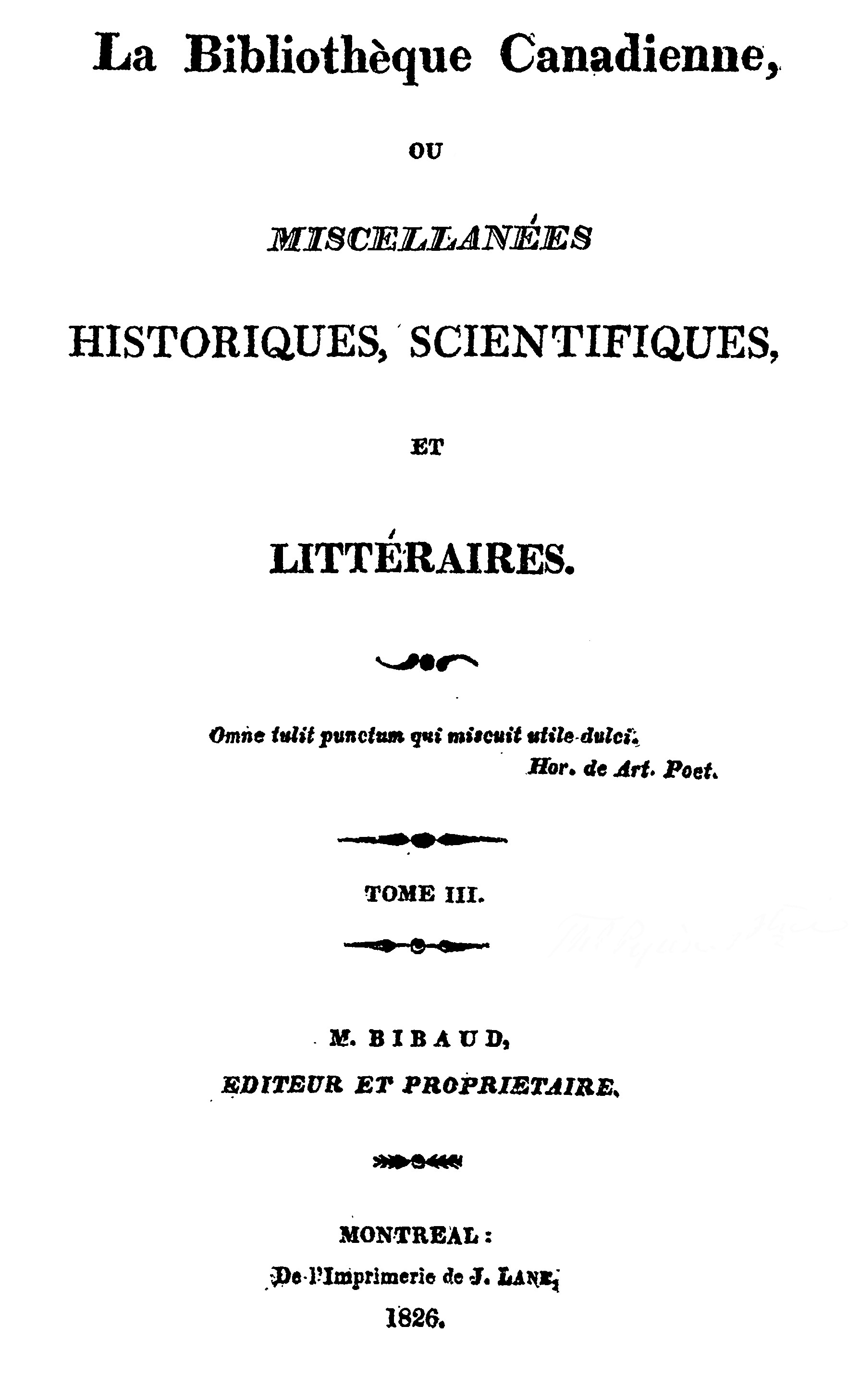
La Bibliothèque Canadienne
| Tome III. | OCTOBRE, 1826. | Numero 5. |
Au fléau de la guerre se joignit une maladie épidémique, qui attaqua indistinctement les Français et les Sauvages domiciliés dans la colonie, et enleva surtout un grand nombre d’enfans.—“C’était,” dit Charlevoix, “une manière de coqueluche qui se tournait en pleurésie. On s’imagina qu’il y avait du maléfice, et les médecins furent les premiers à donner cours à cette opinion. Quand le peuple est une fois frappé, son imagination le mène bien loin, et tout est peuple en certaines rencontres. On publia ensuite qu’on avait vu dans l’air une couronne de feu; qu’aux Trois-Rivières, on avait entendu des voix lamentables; qu’auprès de Québec, il avait paru un canot de feu, et dans un autre endroit, un homme tout embrasé, et environné d’un tourbillon de flammes; que dans l’île d’Orléans, une femme enceinte avait entendu son fruit se plaindre; et tout cela fut suivi de l’apparition d’une comète, qui acheva d’effrayer la multitude, pour laquelle ce phénomène n’est jamais indifférent, surtout dans un tems de calamité.”
Nous n’avons transcrit mot-à-mot ce récit de Charlevoix, (qui semblerait être une traduction libre, ou une imitation de la fin du premier livre des Géorgiques de Virgile,) que pour faire voir combien l’ignorance et la superstition étaient grandes et générales, dans le Canada, à l’époque dont il est ici question.
Toutefois, continue notre historien, au milieu de ces frayeurs, et au plus fort de l’orage, le calme parut tout-à-coup: les partis ennemis disparurent presqu’entièrement, et vers le mois de Juillet, (1661,) on apperçut deux canots avec un pavillon blanc. On les laissa approcher, et l’on vit débarquer des Iroquois, avec autant d’assurance qu’auraient pu le faire les alliés les plus fidèles. C’étaient des députés des cantons d’Onnontagué et de Goyogouin, qui ramenaient quatre Français, dont ils proposaient l’échange contre huit Goyogouins prisonniers à Montréal. Ils promettaient même que tous les autres Français seraient rendus, si l’on délivrait tous les sujets des deux cantons qui se trouvaient prisonniers dans la colonie. Ils remirent aussi à M. de Maisonneuve, une lettre signée de tous les Français captifs dans ces mêmes cantons; elle portait qu’on les traitait assez bien, et que tous les esprits paraissaient disposés à la paix; mais que si l’on refusait d’écouter les députés, tout ce qu’il y avait de Français dans le pays, seraient immanquablement mis à mort, à leur retour. Le gouverneur répondit aux députés, qu’il allait écrire à M. d’Argenson, à qui seul il appartenait d’accepter ou de rejetter de pareilles propositions, et qu’en attendant ses ordres, ils pouvaient rester dans le fort, où ils jouiraient d’une entière liberté.
Le gouverneur-général parut d’abord très peu disposé à entrer en négociation; mais il changea bientôt de pensée, en considérant que dans l’état où se trouvait la colonie, une mauvaise paix, pourvu qu’on se tînt sur ses gardes, valait encore mieux que la continuation d’une guerre qu’on n’était pas en état de soutenir. Une des conditions du traité était qu’on accorderait un missionnaire aux deux cantons; le P. Lemoyne accepta encore une fois cette mission dangereuse, et partit avec les députés.
Sur ces entrefaites, le baron d’Avaugour arriva de France, pour relever le vicomte d’Argenson, qui à cause de sa mauvaise santé, du peu de secours qu’il recevait de la compagnie de la Nouvelle-France, et de quelques chagrins particuliers qu’on lui avait fait essuyer dans la colonie, avait demandé son rappel avant le tems. Le nouveau gouverneur fut fort étonné de se voir chargé d’une colonie aussi délabrée. Il voulut commencer par visiter tous les postes; et après cette visite, il dit qu’il était charmé du Canada; qu’on ignorait en France ce qu’il pouvait valoir; mais qu’il ne comprenait point comment ses prédécesseurs s’étaient soutenus avec si peu de forces; qu’il allait informer le roi de toutes choses, et que si on ne lui envoyait pas incessamment les troupes et les munitions qu’on lui avait promises, il n’attendrait pas, pour retourner en France, qu’on lui eût donné un successeur.
Aux approches de l’automne, on reçut à Québec des lettres du P. Lemoyne, datées d’Onnontagué. Ce missionnaire avait couru dans sa route bien des dangers, de la part des sauvages qui n’étaient point entrés dans les vues pacifiques des deux cantons d’Onnontagué et de Goyogouin. Etant enfin arrivé à deux lieues de la principale bourgade du premier de ces cantons, il en rencontra le chef, qui venait au devant de lui, contre la coutume des sauvages, qui ne veut pas qu’on aille plus d’un quart de lieue à la rencontre des députés.
Ce chef, nommé Garakonthié, n’avait de sauvage que la naissance et l’éducation: aux bonnes qualités de ses compatriotes, (car ils en avaient de telles, nonobstant leur perfidie et leur férocité,) il joignait un excellent naturel, beaucoup de douceur et de droiture, et un génie vraiment supérieur. Ses belles actions à la guerre, et sa dextérité à manier les esprits dans les conseils, lui avaient acquis un grand crédit dans sa tribu; et le plus ordinaire emploi qu’il en fit fut d’empêcher les résolutions violentes, et de ménager la paix avec les Français, qu’il aimait sincèrement, comme il leur en avait donné des marques, en retirant un grand nombre d’entr’eux des mains de leurs ennemis, et particulièrement des Agniers. Dans la présente occasion, il fit preuve d’une délicatesse de politique, d’un tact des convenances, bien plus européen que sauvage: au lieu de mener de suite le P. Lemoyne dans sa cabanne, il commença par le conduire chez les différents chefs, qu’il croyait nécessaire d’amener à son avis: il voulait leur faire regarder à tous la paix comme leur propre ouvrage, sachant bien que s’il avait l’air d’en faire son affaire exclusive, plusieurs s’y opposeraient par jalousie. Cette déférence les lui concilia tellement, que pas un d’eux ne fut d’un avis différent du sien.
Ayant atteint son but, Garakonthié assembla dans sa cabanne les députés d’Onnontagué, de Goyogouin et de Tsonnonthouan. Le P. Lemoyne y fut invité; et après une courte prière, qu’il fit à haute voix, en langue iroquoise, il déclara qu’il était envoyé par Ononthio, dont il allait exposer les intentions. Il plaça ensuite au milieu de l’assemblée les présens dont il était chargé, et dit:
“C’est à toi, Onnontagué, que j’adresse la parole: le Goyogouin, ton fils, est venu me dire qu’il était député de ta part, pour réunir toute la nation avec moi. L’avais-tu envoyé?”
On répondit que le Goyogouin avait dit vrai, et il continua:
“Le Goyogouin m’a dit encore que si je délivrais tous les Iroquois retenus dans mes prisons, tu me rendrais tous les Français captifs. L’avais-tu autorisé à cela?”
“Le Goyogouin, lui repliqua-t-on, a eu ordre de parler ainsi, et il ne sera point désavoué.”
Après un second présent, le P. Lemoyne reprit:
“Tu m’as aussi fait prier d’enfoncer si avant dans la terre les os des Iroquois tués dans les combats, que personne ne songeât à les en tirer, ajoutant que tu souhaitais qu’il en fût ainsi des os des Français. Cette proposition était-elle dans ta pensée?”
—“Rien n’est plus sincère,” lui répondit-on.
—“Et toi, Tsonnonthouan, est-il vrai que tu désires d’être compris dans le traité de paix, et d’avoir dans ton pays des Français qui s’y établissent?”
Un chef tsonnonthouan répondit affirmativement, et l’orateur ayant fait un nouveau présent, continua:
“L’Agnier a toujours eu un mauvais esprit; je sais qu’il envoie secrètement des présens pour empêcher que la paix ne se fasse; je n’ai rien à lui dire, sinon que les Français l’attendent.”
Quelques jours après, on se rassembla, et l’orateur iroquois déclara, qu’on allait renvoyer neuf Français à Ononthio; que ce serait Garakonthié lui-même qui irait les lui remettre entre les mains; et que si on retenait les autres pendant l’hiver, ce n’était que pour tenir compagnie à Ondesson. Le missionnaire parut surpris de cette résolution, et représenta qu’on avait promis de rendre la liberté à tous les Français. On lui répondit que cela ne se pouvait point; et il ne jugea pas à-propos d’insister, persuadé que ç’aurait été peine perdue. D’ailleurs les prisonniers français étaient aussi bien traités, qu’ils pouvaient le souhaiter, à Onnontagué. Il n’en était pas de même de ceux que les Agniers retenaient dans leurs fers: ils avaient beaucoup à souffrir, et ne pouvaient se répondre d’un jour de vie. Le P. Charlevoix parle en particulier d’un jeune homme de bonne famille, nommé François Hertel, à qui ces sauvages brulèrent un doigt et coupèrent un pouce; mais qui revint pourtant ensuite dans la colonie, et y vécut jusqu’à un âge très avancé.
Garakonthié s’embarqua vers la mi-Septembre, et peu de jours après, il rencontra une troupe de guerriers de son canton, conduits par un chef de réputation, nommé Outreouhati. Ils étaient chargés de chevelures et dépouilles sanglantes. A cette vue, Garakonthié parut embarrassé: ses gens étaient d’avis de rebrousser chemin, ne pouvant se persuader qu’après ce qui venait de se passer, on les reçût en qualité d’ambassadeurs; mais, après avoir réfléchi à la chose, et avoir fait entendre à ses gens qu’il n’y avait rien à craindre pour eux, tandis qu’il y avait des Français et un missionnaire dans leur canton, il continua son voyage. Au bout de quelques jours, ayant rencontré une troupe d’Onneyouths qui allaient en course contre les Français, il les engagea, par ses discours et des présens, à s’en retourner dans leur pays. Enfin il arriva dans l’île de Montréal, où il fut reçu comme le méritaient les services qu’il avait rendus aux Français captifs dans son pays, et les mouvemens qu’il s’était donnés pour procurer la paix. Il eut avec le gouverneur-général des entretiens particuliers, où il fit paraître beaucoup d’esprit et de jugement. Il agréa toutes les propositions qui lui furent faites; il promit d’être de retour, avec tous les prisonniers français, avant la fin du printems, et l’on crut pouvoir compter tellement sur sa parole, qu’on lui remit tous les Iroquois qu’il demanda; sans faire assez d’attention que chez les sauvages, la parole du chef le plus accrédité, et le mieux intentionné, n’est pas toujours suffisante. Il est vrai de dire pourtant, que les cantons supérieurs étant alors en guerre avec les Andastes, et les Agniers avec les Mahingans, auxquels s’étaient jointes les tribus abénaquises, on devait croire qu’ils ne désiraient pas avoir sur les bras un troisième ennemi; mais on apprit bientôt que les Iroquois n’étaient ni aussi embarrassés, ni aussi disposés à la paix avec les Français, qu’on se l’était imaginé. Ils avaient repoussé, même assez loin, leurs ennemis; et bientôt une troupe d’Agniers et d’Onneyouths s’approcha de Montréal, et y tua, entr’autres, un ecclésiastique nommé M. Vignol. Peu après, deux cents Onnontagués parurent dans la même île, et attaquèrent, en plein jour, quelques habitans, qui travaillaient à la campagne. Le major de la ville sortit avec vingt-six hommes bien armés, pour leur faciliter la retraite; mais ayant pris sa route par les bois, pour n’être point apperçu des ennemis, il se trouva tout-à-coup entre deux feux, et périt avec tous ses gens, accablé par le nombre, après une résistance qui dura jusqu’au soir.
Garakonthié, à son retour, fut assez surpris de trouver une partie de ses compatriotes dans des dispositions si différentes de celles où il les avait laissés. Il s’apperçut même bientôt qu’on se mettait en garde contre lui, et sans son adresse et sa fermeté inébranlable, il courait risque d’être désavoué par ceux-là mêmes qui l’avaient député vers le gouverneur-général. Mais enfin sa prudence et sa dextérité le firent triompher de tous les obstacles, et lui rendirent son premier ascendant sur ses compatriotes. Le traité de paix fut ratifié par les trois cantons, et tous les prisonniers français furent remis au P. Lemoyne, qui les conduisit à Montréal. Un seul avait péri martyr de la fidélité conjugale. On avait voulu le forcer à se marier dans la cabanne où il était esclave: il s’en était défendu sur ce qu’il avait déjà une femme, et que sa religion ne lui permettait pas d’en avoir deux. On le menaça de la mort, s’il ne consentait à ce qu’on exigeait de lui; il demeura infléxible, et on lui cassa la tête.
Le retour des autres convainquit M. d’Avaugour que Garakonthié avait négocié de bonne foi; mais les avis qu’il recevait de ce qui se passait dans les cantons, lui donnaient de grandes inquiétudes. Ce général et tout ce qu’il y avait de personnes en place dans le pays, avaient fortement écrit en cour, par les derniers vaisseaux partis de Québec, pour supplier le roi de prendre sous sa protection une colonie qui se trouvait absolument abandonnée et réduite aux derniers abois. Ils avaient chargé de leurs mémoires M. Pierre Boucher, qui commandait aux Trois-Rivières; et ils espéraient beaucoup du zèle de cet officier, qui connaissait mieux que personne le Canada, et que sa vertu rendait très propre à se faire écouter favorablement. Il fut en effet très bien reçu du monarque, qui témoigna sa surprise, en apprenant qu’un si bon pays eût été si fort négligé. Il nomma M. De Monts commissaire, pour en faire la visite, et y intimer ses ordres, et commanda qu’on y envoyât incessamment quatre cents hommes de ses troupes, pour renforcer les garnisons des postes les plus exposés. M. De Monts s’embarqua, à la Rochelle, dès que la navigation fut libre; et chemin faisant, il prit possession, au nom du roi son maître, du fort de Plaisance, dans l’île de Terre-Neuve. Son arrivée à Québec y causa la plus grande joie, et par les secours présents qu’il amenait, et par l’espérance qu’il y donna, que l’année suivante, il en viendrait de nouveaux et de plus considérables.
Ce fut au printems de cette même année 1663, que fut érigé le Séminaire de Québec. L’année précédente, M. de Pétrée étant repassé en France, pour les raisons que nous exposerons bientôt, proposa au conseil du roi l’érection d’un Séminaire à Québec. Sa majesté y consentit, et les lettres patentes en furent expédiées au mois d’Avril de l’année suivante, en faveur de Messieurs du Séminaire des Missions étrangères. Comme le Séminaire devait, dans le systême d’alors, fournir des pasteurs à toute la colonie, le prélat obtint que les dîmes seraient payées aux directeurs de celui qu’on établissait à Québec, et les fit taxer au treizième de tout ce qui doit à l’église. On trouva que c’était beaucoup pour des colons qui n’étaient pas riches: il y eut des représentations de leur part, et elles furent écoutées, comme on le verra plus bas.
(A Continuer.)

OBSERVATIONS sur les Scioux, par Mr. De Boucherville; faisant suite à la Relation de ses Aventures, en 1728 et 29.
Les Scioux sont fort nombreux. Ils ont dix villages fort éloignés les uns des autres. Leur langue est fort difficile à apprendre; d’autant plus qu’on ne peut guères converser avec ces peuples errants, qui sont toujours à la chasse.
Les hommes sont assez bien faits, mais peu laborieux; aussi jeûnent-ils souvent. Les femmes sont laides, mais laborieuses.—La nécessité leur a fait connaître quantité de racines qui contribuent à leur subsistance. On distingue deux sortes de Scioux, à savoir les Scioux des Prairies, et les Scioux des Rivières, qui se servent des canots d’écorce très petits et commodes pour les fréquents portages qu’ils ont à faire.
Ils sont fort sujets au larcin; du reste, assez doux, dociles, craignant et respectant leurs chefs. On se fie peu à eux, parce qu’ils sont soupçonneux, jaloux de leurs femmes, qu’ils assassinent sans scrupule, sur un simple soupçon. On ne les laisse jamais entrer dans le fort; ils seraient trop importuns: par bonheur, le défaut de vivres les oblige à se séparer des Français, au bout de sept ou huit jours. Ils aiment fort le chant et la danse. Ils sont superstitieux au-delà de ce qu’on peut dire. Ils ont quantité de jongleurs et de charlatans, qui savent s’attirer toute leur confiance, et abuser de leur sotte crédulité.
Quoiqu’ils n’aient que depuis peu l’usage du fusil, ils s’en servent parfaitement bien. Ils sont fort généreux; et quand on va les voir, souvent ils font jeûner leurs femmes et leurs enfans, pour avoir de quoi régaler les Français.
La polygamie est tellement en usage chez eux, qu’ils ont quelquefois jusqu’à dix femmes, qu’ils n’épousent qu’après les avoir achetées de leurs pères, suivant la coutume des sauvages: aussi les traitent-ils comme des esclaves.
Les jeunes gens ne sont point obligés d’aller à la chasse; ils dansent: c’est là toute leur occupation, jusqu’à ce qu’ils soient mariés.
Le plus beau chemin que l’on puisse prendre pour aller aux Scioux, c’est de passer par la Baie, par la rivière des Renards; ensuite on fait le portage des Ouisconsins, et l’on entre dans le Mississipi, qu’on remonte jusqu’au Lac Pepin, où nous avons bâti notre fort.
De Montréal aux Scioux, il n’y a pas plus de 600 lieues. En descendant des Scioux aux Illinois, sur le Mississipi, je compte environ 300 lieues, et des Illinois à la mer, 400 lieues. Le Mississipi peut porter de grands bateaux, 750 lieues sans chûte d’eau. Quand on remonte ce grand fleuve, depuis l’embouchure de l’Ouisconsin, jusqu’au Sault St-Antoine, (ce qui fait cent lieues de cours,) on trouve quantité d’îles, et des deux côtés, on voit des montagnes qui s’opposent au débordement des eaux du Mississipi.
Nous, soussignés, témoins de tout ce qui est mentionné dans cette Relation, certifions qu’elle est juste et véritable, et que nous devons la vie à l’auteur, par ses travaux, fatigues et expérience. En foi de quoi, nous avons signé:—Campeau, forgeron; Ménard, interprète; Dumais, Capitaine de milice; Réaume, interprète; Boiselle, voyageur.

Dans le printems de 1733, la petite vérole fit de grands ravages dans le Canada. On ne connaissait point l’inoculation alors. Ce ne fut que quelques années après la conquête, que son usage s’introduisit dans la colonie. Cette maladie y fit périr un grand nombre de personnes de tout âge. Il y avait un peu plus d’un demi siècle qu’elle y avait paru pour la première fois, depuis que les Français avaient commencé à s’y établir. A ces deux époques, elle emporta un très grand nombre de personnes: des familles presque entières furent enlevées. Elle fit à peu près les mêmes ravages dans le Canada, que fit la fièvre jaune à Philadelphie, à la fin de l’année 1793. On fut obligé de recueillir des enfans au berceau, qui avaient survécu à des familles entières, père, mère, et enfans, descendues dans le tombeau.
Cette même année 1733, dans l’automne, il y eut un tremblement de terre des plus violents, dont les secousses se firent sentir successivement pendant quarante jours. Voici un petit trait, à ce sujet, que je tiens d’une de mes parentes. Mr. Ridday, son ayeul, était allé à Québec, en canot, dans le dessein de ramener une des ses filles, qui avaient eu la petite vérole. Il la ramenait, et traversait le lac St-Pierre, par un tems calme, clair et serein. Il se trouva extrêmement surpris de voir néanmoins, vers midi, le lac s’agiter tout d’un coup très considérablement; ce qui dura quelque tems. Il ne pouvait imaginer la cause d’un aussi singulier phénomène, dont il eut l’explication quand il eut fait la traversée. Arrivé vis-à-vis des lieux où les bords de la rivière étaient habités, il apperçut les habitans de ces campagnes aux portes de leurs maisons, dans une grande agitation, et allant et venant, comme des hommes affectés et troublés par la plus grande frayeur. Il débarqua, et apprit des premiers qu’il rencontra, la cause de la terreur qu’il voyait peinte sur tous les visages. C’était un choc violent de tremblement de terre, qui avait fait tomber les têtes des cheminées de plusieurs maisons.
Mr. Ridday continua sa route, et arriva à Montréal, où il demeurait. Il y trouva de même la ville toute en alarmes. On y avait éprouvé les mêmes terreurs et les mêmes accidens. Les secousses continuèrent à se faire sentir durant les quarante jours qui suivirent le premier choc, qu’on avait éprouvé, le jour que Mr. Ridday passait le lac St-Pierre; mais les premières avaient été les plus fortes. Celles qui les suivirent diminuèrent graduellement de violence, et enfin cessèrent, après cet intervalle, entièrement. Ce tremblement de terre se fit sentir dans toute la partie de la province qui était alors habitée. Plusieurs personnes furent blessées par la chûte des pierres qui tombaient des cheminées: une ou deux perdirent la vie par la même cause.
Dans la nuit du 22 au 23 Novembre 1755, on éprouva une très violente secousse de tremblement de terre. Je tiens de la même personne, qu’elle fut réveillée par le choc, quoiqu’elle eût un sommeil profond, et qu’elle se sentit extrêmement agitée dans son lit. La maison, qui était de bois, semblait se détraquer, tant était grand le bruit occasionné par le choc qui l’ébranlait.
La petite vérole fit encore des ravages, cette année. Elle avait paru dans la colonie, à la suite du retour des troupes et des milices qui avaient été à Carillon.

Le mélange de rochers stériles et de terres végétales forme, à Percé, un contraste qui se rencontre rarement ailleurs. Le sol, quoiqu’inégal, et montueux en plusieurs endroits, est bien boisé: il l’est jusqu’aux extrêmes bords de ces rochers nus, quelquefois de plusieurs centaines de pieds de hauteur, dont la base est incessamment battue par les flots. Le cap lui-même est d’une roche sablonneuse qui, minée par le choc des vagues, se détache et s’éboule par fois en grosses masses qui demeurent à sa base, jusqu’à ce qu’elles soient brisées par le travail continuel de la mer. La couche de la surface, plus dure, ou moins exposée à l’action des vagues, que celles qui sont au-dessous, s’élève ça et là en pointes, autour du cap. Cette surface est couverte d’une épaisse couche de terre rouge, qui nourrit une forêt de bois dur. Par un beau tems, le tout ensemble offre au spectateur un coup d’œil romantique; et ce serait, dans le fait, un lieu agréable, si ce n’était des idées sinistres que fait naître son histoire dans l’esprit de ceux qui l’entendent raconter.
Il y a lieu de croire que sur les caps, ou pointes de terre, ou plutôt de rocher, dont je viens de parler, il est arrivé plus d’un désastre dont le bruit ne s’est pas répandu au-delà de la cabanne du pêcheur, et qui, s’ils étaient publiés, pourraient au moins offrir un mélancolique soulagement à plus d’un cœur en proie aux angoisses du doute et de l’incertitude. On sait qu’il y a eu, au Cap Gaspé, des naufrages dont il est à peine resté une planche, et auxquels il était à peine possible qu’un seul homme pût échapper. Il en est arrivé d’autres, à des époques si reculées, et avec des circonstances si extraordinaires, qu’ils pourraient paraître surnaturels, ou fabuleux, s’il n’en restait pas des vestiges assez apparents pour ôter tout doute sur le fait. Sur le Cap d’Espoir, rocher élevé perpendiculairement d’au moins quarante pieds au-dessus de la plus grande hauteur, où aient été les eaux de la mer, à haute marée, de mémoire d’homme, et à quelque distance dans les bois, on voit les débris d’un vaisseau d’un port considérable, d’un peu moins de cent tonneaux, selon les uns, de beaucoup plus, selon les autres. Plusieurs morceaux de sa carcasse sont, dit-on, considérablement enfoncés dans la terre, et il est crû à travers des arbres de haute futaie. Quand et par quel hazard ce vaisseau a-t-il été jetté là, c’est un mystère qui paraît à-peu-près inexpliquable. Tout ce qu’en savent les plus anciens habitans du pays, c’est qu’il est là depuis qu’ils ont l’âge de connaissance, et que leurs grands-pères leur ont dit qu’ils se rappellaient de l’y avoir vu, dans leur enfance, et qu’ils croyaient qu’il y avait été jetté dans une grande tempête, dans laquelle la mer avait considérablement dépassé ses bornes ordinaires, et que la tradition l’a toujours caractérisé depuis comme un “naufrage anglais.”
On a fait plusieurs conjectures, comme on peut croire, sur ce naufrage mystérieux; et comme c’est réellement un sujet intéressant, le lecteur voudra bien me permettre d’exposer la mienne; libre à lui d’en former une meilleure, s’il le veut.
On doit observer que le golfe, dans le voisinage immédiat du Cap d’Espoir, est en mauvaise renommée, par ses vagues courtes et violentes, et par ses calmes agités, extrêmement fatiguants pour les vaisseaux, que les marins anglais appellent ground swells. Ils les attribuent aux inégalités du fond, et au grand nombre de courans qui se croisent dans les environs, et qui sont occasionnés par le confluent, ou l’abord du Saint Laurent, du Miramichi, du Ristigouche, et autres rivières qui se jettent dans la Baie des Chaleurs.
Les plus anciens descendans des premiers colons français, ainsi que les sauvages, qui, de tems immémorial, ont pêché et chassé, le long de cette côte, ont pour tradition, que quand leurs grands-pères étaient des petits garçons, elle fut accueillie d’une tempête terrible, comme on n’en avait pas vu auparavant, et comme on n’en a pas vu depuis. Les effets en avaient été particulièrement désastreux pour les pêches que les armateurs français faisaient alors dans le golfe, sur une échelle très étendue: l’approche en avait été aussi soudaine et aussi inattendue que les résultats en furent terribles; car on dit qu’à peine une seule barge, un seul bateau pêcheur échappa à la destruction; que plusieurs semaines après, la côte, à Percé, à l’Ance à Beau-Fils, et aux environs, était jonchée de débris, et que le nombre des noyés poussés sur le rivage, fut si grand, qu’il n’y avait pas assez de monde pour les enterrer. Toutes les cabannes érigées sur le rivage furent emportées, et les malheureux habitans furent contraints de se retirer sur les hauteurs et dans les bois, pour se soustraire à la fureur des élémens, dont l’action combinée répandait autour d’eux le dégat et la dévastation. C’est là le seul évènement, dont il y ait une tradition certaine, qui puisse expliquer comment le vaisseau dont je viens de parler, a pu être jetté à la hauteur extraordinaire où on le voit; car réellement, à l’apparence du rocher, je le croirais plutôt haut de quatre-vingts pieds que de quarante. Le nombre de lieux convenables qu’il y a dans les environs pour construire et lancer des vaisseaux, et l’impossibilité absolue de lancer un vaisseau quelconque, avec sureté, d’un tel précipice, ne permettent pas de conjecturer qu’il y ait été construit. Et cependant rien de plus certain que ce fait; quiconque en douterait, pourrait s’en convaincre par ses yeux, ou par le témoignage des gens de l’endroit qui l’ont vu, ou qui, s’ils ne l’ont pas vu, ne doutent pas plus, ou n’ont pas plus lieu de douter de son existence, qu’aucun de mes intelligents lecteurs n’a lieu de douter de celle des pyramides d’Egypte.
Les plus anciens habitans, comme je viens de l’observer, s’accordent à dire, que ce terrible évènement eut lieu, quand leurs grands-pères étaient très jeunes: supposant que les plus âgés de la présente génération soient nés une couple d’années avant l’époque de la conquête, c’est-à-dire, il y a 69 ans; ce ne sera pas trop d’accorder 50 ans pour la crûe des deux générations précédentes, et cela nous portera à 1711. Or nous savons avec certitude, qu’une escadre considérable sous le commandement de Sir Hovenden Walker, mit à la voile de Plymouth, dans le mois de Mai de cette même année, et que le 21 Août, ayant été assaillie d’un terrible coup de vent, dans le golfe, huit bâtimens de transport furent poussés sur les rochers de l’Ile aux Œufs, sur la rive septentrionale du St-Laurent, non loin des Sept-Iles; et il y a lieu de croire que d’autres vaisseaux de la même escadre dispersés par la même tempête, dans le golfe, eurent le même sort, sur d’autres points. Comparant toutes ces circonstances de faits authentiques et de traditions probables, je suis porté à croire que ce sont les débris de quelqu’un des vaisseaux de cette malheureuse flotte, qui, séparé des autres dans le golfe, et surpris par le même ouragan qui leur fut si fatal, peut avoir été jetté là où l’on en voit maintenant les restes.
Ayant offert ma conjecture, qui, si elle n’est pas fondée sur la réalité, ne peut pas du moins être regardée comme absurde, le lecteur voudra bien me permettre de lui raconter une de ces histoires merveilleuses qui ont cours parmi les pêcheurs de la côte, et que plusieurs d’entr’eux regardent comme une preuve évidente, que le naufrage dont je viens de parler fut celui d’un vaisseau anglais. En donnant ce récit, je ne prétends pas abuser de la crédulité de mes lecteurs, encore moins rendre compte de ces apparences extraordinaires, que des personnes d’un esprit et d’un jugement supérieurs n’ont pas dédaigné de croire réelles, même sur le témoignage d’hommes ignorants.
Le Cap d’Espoir est appellé en anglais, par corruption, Cape Dispair, et les Canadiens le nomment aujourd’hui, par traduction, Cap Désespoir; et il faut convenir que ce dernier nom lui convient beaucoup mieux que le premier; car il n’y a pas de lieu plus désespérant: à en juger par les apparences, le plus fort vaisseau, qui y serait poussé par un coup de vent, serait à l’instant mis en pièces. Près de ce cap, de chaque côté, il y a des ances assez profondes, et un bon ancrage, par un tems modéré; mais il serait très dangereux d’y attendre des coups de vent venant de la mer. De ces ances, et des habitations sur le rivage, on a l’entière perspective du cap, où, soit en conséquence du mirage déjà mentionné, de causes surnaturelles, ou des illusions de l’imagination déréglée du spectateur, on voit, d’après des rapports qui s’accordent tous, quant au tems et aux circonstances, des apparitions extraordinaires, et capables de faire frémir de frayeur. On dit qu’elles ont lieu par le tems le plus beau et le plus clair. Le golfe, à la hauteur du cap, prend tout à coup une apparence terrible; la mer pousse en avant des vagues brisées, avec une force et une vitesse prodigieuses; un nuage noir et épais couvre la surface de l’élément en furie; les nuages accumulés, et les vagues amoncelées sont poussés avec un surcroît de force et de vitesse, contre le rocher, qui semble menacé de l’anéantissement. Les arbres sur les bords du précipice semblent se plier comme des verges, et les vagues se perdre entre leurs troncs et dans leurs branches. Au milieu de ce terrible fracas, on apperçoit d’abord confusément une barque à demi engloutie, chancelant sur les vagues amoncelées, ses voiles et ses cordages délabrés, et allant donner par le travers sur l’horrible précipice: ses haubans semblent couverts des malheureuses victimes dévouées à une mort certaine, qui s’y attachent avec les démonstrations du trouble et du désespoir. Au haut du mât de misène flotte une croix rouge, et la plupart des hommes qu’on y voit sont vêtus de rouge. Elle avance presque renversée, jusqu’au point où elle va être précipitée sur le cap, lorsque le spectateur, glacé d’effroi, dans l’attente de la terrible catastrophe qui va suivre, est tout à coup délivré de sa pénible anxiété, par la disparition totale et instantanée de la vision. Le cap réfléchit de nouveau les rayons du soleil; la mer paraît comme dormir autour de sa base; l’horrison est sans nuages, et il ne reste pas un seul vestige de la commotion apparente qui vient d’avoir lieu.
Cette scène terrible est ordinairement remplacée par une autre d’une nature plus douce et plus recréative. Sur quelqu’une des nombreuses éminences formées par la couche de surface du rocher, on voit distinctement deux hommes, dont quelques uns se sont assez approchés pour en discerner les traits. D’abord on les voit ordinairement assis, engagés dans une conversation animée. L’un, d’après la description qu’on en donne, est évidemment un matelot anglais; l’autre, un jeune soldat de la même nation. Le matelot paraît être un homme de plus de 35 ans, de taille moyenne, robuste, d’un teint brun, d’une physionomie ouverte, rehaussée par des yeux noirs, d’épais favoris, et une longue chevelure pendante en queue, de même couleur. Il a des culottes de toile, un juste-au-corps d’étoffe rayée, et un chapeau à forme basse de toile goudronnée. On représente l’autre comme un homme bien fait et de haute stature, vêtu de culottes courtes de couleur blanche, avec des guêtres à boutons d’étaim, qui lui vont jusqu’aux genoux, d’une chemise de toile fine avec un jabot, d’un col noir et d’un petit chapeau bleu de fourageur, mais sans habit ni gilet: il a le teint blanc, de grands yeux bleus, des favoris blonds, et paraît âgé d’environ 25 ans.
Après un entretien de quelque durée et du plus grand intérêt, entre le matelot et le soldat, s’étant levés tous deux, le premier tire de son sein un flageolet, sur lequel, accompagné de la voix pleine et sonore de son compagnon, il joue des airs assez touchants, au dire de ceux qui les ont entendus, pour attendrir le rocher même sur lequel on les voit. Les récits ne s’accordent pas tous sur le sujet de la chanson, qui peut aussi n’être pas toujours le même: quelques uns disent qu’il a rapport à la guerre; d’autres, à l’éloignement de la patrie; d’autres enfin, aux périls de la mer et au naufrage. Les circonstances où le spectateur se trouve placé peuvent le mettre en état de recevoir tout l’effet de la musique, mais non de saisir le sens de toutes les paroles, que tous représentent néanmoins comme étant prononcées en anglais.
Une chose remarquable dans l’histoire de ces habitans visionnaires du cap, c’est que nul mortel n’a pu les approcher de moins de la distance qu’il y a du sommet du rocher à quelques pas de sa base; le précipice étant toujours interposé entr’eux et le spectateur. Lorsque celui-ci est en bas, il les voit en haut, et vice versa. En bas, on les voit, ordinairement sur un de ces massifs fragmens détachés du cap, qui, dans les gros tems, servent à diminuer la violence des vagues qui en frappent la base. En haut, ils disparaissent quelquefois d’une éminence, pour se remontrer sur une autre, un instant après.
Des personnes qui se trouvaient sur le cap, dans le tems de ces visions tumultueuses, disent qu’elles ne s’appercevaient de rien autour d’elles, si ce n’est d’une pesanteur de l’atmosphère presque suffoquante.
Le sujet a donné lieu à des chansons et à des vers qui ne sont pas dépourvus d’élégance, et qui, après avoir été relus à loisir, pourront être communiqués pour le coin du poëte, s’ils paraissent mériter de voir le jour.
Viator.

Lierre—Amitié.—L’amour fidèle retient avec une branche de lierre les roses passagères qui couronnent son front. L’amitié a choisi pour devise un lierre qui entourre de verdure un arbre renversé, avec ces mots: Rien ne peut m’en détacher. En Grèce, l’autel de l’hyménée était entourré d’un lierre, et l’on en présentait une tige aux nouveaux époux, comme le symbole d’un nœud indissoluble. Les bacchantes, le vieux Silène, et Bacchus lui-même, étaient couronnés de lierre. La verdure éternelle des feuilles du lierre était pour cette cour joyeuse l’emblême d’une constante ivresse. On a quelquefois représenté l’ingratitude sous la forme d’un lierre qui étouffe son soutien: l’auteur des Études de la Nature a repoussé cette calomnie; le lierre lui parait le modèle des amis: “Rien,” dit-il, “ne peut le séparer de l’arbre qu’il embrasse une fois; il le pare de son feuillage, dans la saison cruelle, où ses branches noircies ne soutiennent plus que des frimas; compagnon de ses destinées, il tombe quand on le renverse; la mort même ne l’en détache pas; et il décore de sa constante verdure, le tronc tout desséché de l’appui qu’il adopta.” Ces idées, aussi touchantes que gracieuses, ont encore le mérite d’être vraies; le lierre tient à la terre par ses propres racines, et ne tire point sa subsistance des corps qu’il environne; protecteur des ruines, il est l’ornement des vieux murs qu’il soutient; il n’accepte point tous les appuis; mais, ami constant, il meurt où il s’attache.
Laurier-amandier—Perfidie.—Aux environs de Trébisonde, sur les bords de la Mer Noire, croît naturellement le laurier perfide, qui cache sous sa douce et brillante verdure, le plus funeste de tous les poisons: cet arbre se charge, au printems, de nombreuses pyramides de fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits noirs, semblables à de petites cerises; ses fleurs, ses fruits et ses feuilles ont le goût et l’odeur de l’amande.
On raconte qu’une tendre mère, le jour de sa fête, voulant préparer un mets agréable à sa famille, jetta quelques livres de sucre et une poignée de feuilles de laurier-amandier, dans une chaudière de lait bouillant. A la vue du festin qui s’apprête, une innocente joie éclate dans tous les yeux. O surprise! à peine a-t-on gouté le mets fatal, que tous les visages changent, les cheveux se hérissent sur la tête des malheureux, leur respiration se précipite, mille cris confus sortent de leur poitrine, une fureur horrible les poursuit, les agite et s’empare de leurs sens. La mère désolée, veut appeller du secours; mais, saisie du même mal, elle partage le délire insensé auquel elle veut en vain apporter remède. Le sommeil calma enfin les vertiges de cette triste ivresse. Mais, que devint la pauvre mère, quand un habile homme lui apprit, le lendemain, qu’elle avait fait prendre à ses enfans un venin tout semblable à celui de la vipère.
Ce venin, concentré dans l’eau distillée, ou dans l’huile essentielle du laurier-amandier, est si violent, qu’il suffit de le mettre en contact avec la plus légère blessure, pour donner la mort à l’homme le plus robuste.
Tussilage odorant—On vous rendra justice.—Le génie, caché sous une modeste apparence, ne frappe pas les yeux du vulgaire. Mais si les regards d’un juge éclairé le rencontrent, aussitôt sa force est relevée, et il emporte l’admiration de ceux dont la stupide indifférence n’avait pu le comprendre. Un jeune meunier hollandais se sentant du goût pour la peinture, s’exerça, dans ses momens de loisir, à représenter le paysage au milieu duquel il vivait. Le moulin, les troupeaux de son maître, une verdure admirable, les effets du ciel, des nuages, de la vapeur, de la lumière et des ombres, voila ce que son naïf pinceau rendait avec une vérité exquise. A peine un tableau était-il fini, qu’il était porté chez un marchand de couleur, qui pour le prix, donnait de quoi en refaire un autre. Un jour de fête, l’aubergiste du lieu, voulant orner la salle où il recevait ses hôtes, fit emplète de deux de ces tableaux. Un grand peintre s’arrête dans cette auberge; il admire la vérité de ces paysages, offre cent florins de ce qui n’avait couté qu’un écu, et en payant, il promet de prendre au même prix, tous les ouvrages du même auteur. Voila la réputation du jeune peintre établie, voila sa fortune faite. Aussi sage qu’heureux, il n’oublia jamais son cher moulin; on en retrouve l’image dans tous ses tableaux, qui sont autant de chefs-d’œuvre.
Le tussilage odorant, malgré sa suave odeur, a vécu longtems ignoré, au pied du mont Pilat, où sans doute, il fleurirait encore sans gloire, si un savant botaniste, M. Villau, de Grenoble, n’avait su apprécier ses qualités bienfaisantes. Comme le grand artiste fit l’éloge du pauvre peintre, M. Villau fit celui de l’humble fleur, et lui donna un rang distingué dans ses ouvrages. Qui croirait que les plantes ont le même sort que les hommes, et qu’il leur faut aussi un patron pour être appréciées?
Cyprès—Deuil.—Dans tous les lieux où ces arbres frappent nos regards, leur aspect lugubre pénètre d’idées mélancoliques.—Leurs longues pyramides élevées vers le ciel, gémissent agitées pas les vents. La clarté du soleil ne saurait pénétrer leur sombre épaisseur; et lorsque ses derniers rayons viennent à projetter leur ombre sur la terre, on dirait un noir fantôme.
Les anciens avaient consacré le cyprès aux Parques, aux Furies et à Pluton: ils le plaçaient auprès des tombeaux. Les peuples de l’Orient ont conservé le même usage. Chez eux, les champs de la mort ne sont pas nus et dévastés: couverts d’ombre et de fleurs, ce sont des lieux de fêtes, ce sont des promenades publiques, qui rapprochent sans cesse les amis qui vivent de ceux qui les ont précédés. On sait quel respect les Chinois ont pour le tombeau des ancêtres. Souvent aux environs de Constantinople, on voit une famille d’Arméniens se presser dans l’enceinte d’un monument funèbre. Les vieillards y méditent, les enfans s’y livrent à la joie, et quelquefois de jeunes amans viennent se jurer un constant amour, en présence des amis qui leur restent et de ceux qu’ils ont perdus. Plus loin, on voit aussi l’orphelin solitaire assis auprès du cyprès qui couvre ses parens; à la vue de leurs tombeaux, il se croit encore protégé par eux. La chaste veuve, prosternée sur la pierre qui couvre son époux, prie, cherche dans cette image même de la mort, l’espérance qui la console; mais la triste mère, qui a perdu ses enfans, pleure, et ne veut pas être consolée.
........................Et toi, triste cyprès,
Fidèle ami des morts, protecteur de leur cendre,
Ta tige, chère au cœur mélancolique et tendre,
Laisse la joie au myrte et la gloire au laurier.
Tu n’es point l’arbre heureux de l’amant, du guerrier;
Je le sais, mais ton deuil compatit à nos peines.
Le Chêne—Hospitalité.—Les anciens croyaient que le chêne, né avec la terre, avait offert aux premiers hommes de la nourriture et un abri. Cet arbre, consacré à Jupiter, ombrageait le berceau de ce dieu, lorsqu’il prit naissance en Arcadie, sur le mont Lycée. La couronne de chêne, moins estimée par les Grecs que la couronne d’or, paraissait aux Romains la plus désirable des récompenses. Pour l’obtenir, il fallait être citoyen, avoir tué un ennemi, reconquis un champ de bataille, et sauvé la vie à un Romain. Scipion l’Africain refusa la couronne civique, après avoir sauvé son père, à la journée de Trébie: il refusa cette couronne; car son action portait en elle-même sa récompense. En Epire, les chênes de Dodone rendaient des oracles; ceux des Gaules couvraient les mystères des Druides. Les Celtes adoraient cet arbre: il était pour eux l’emblême de l’hospitalité; vertu qui leur fut si chère, qu’après le titre de brave, celui d’ami et d’étranger était le plus beau des titres.
Les hamadryades, les fées et les génies n’enchantent plus nos sombres forêts; mais l’aspect d’un chêne majestueux nous remplit encore d’admiration, de respect et de crainte. Plein de jeunesse et de force, lorsqu’il élève sa tête altière, et qu’il étend ses bras immenses, il paraît comme un protecteur, comme un roi. Dépouillé de verdure, immobile, frappé de la foudre, il ressemble au vieillard qui a vécu dans les siècles passés, et qui ne prend plus part aux agitations de la vie. Les vents impétueux luttent quelquefois contre ce fier athlète: d’abord il murmure, mais bientôt un bruit sourd, profond, mélancolique sort de ses robustes rameaux. On écoute, on croit entendre une voix confuse et mystérieuse, qui explique les vieilles superstitions du monde.
En Angleterre, on a vu un seul chêne couvrir de son ombre plus de quatre mille soldats. Dans le même pays, auprès de Shrewsbury, le chêne royal, encore tout verdoyant, rappelle les malheurs de Charles II, fugitif au milieu de son royaume. Ce prince trouva un abri, un sauveur, mais son père n’en trouva point..... Horrible souvenir, qui rappelle, hélas! que l’Angleterre n’a pas été seule altérée du sang des rois..... Eh! pourtant, on montre encore, à la porte de Paris, dans le bois de Vincennes, la place occupée, jadis, par le chêne sous lequel Louis IX, semblable à un tendre père, venait s’asseoir, pour rendre la justice à son peuple.
Colchique—Mes beaux jours sont passés.—Vers les derniers jours d’été, on voit sur la verdure des humides prairies, une fleur semblable au safran printanier: c’est le colchique d’automne; loin de nous inspirer, comme le safran, la joie et l’espérance, il annonce à toute la nature la perte des beaux jours.
Les anciens croyaient que cette plante, venue des champs de la Colchide, devait sa naissance à quelques gouttes de la liqueur magique que Médée prépara pour rajeunir le vieil Œson. Cette origine fabuleuse a fait longtems considérer le colchique comme un préservatif contre toutes sortes de maladies. Les Suisses attachent cette fleur au cou de leurs enfans, et les croient inaccessibles à tous les maux. La folle opinion des vertus merveilleuses de cette plante a même séduit les hommes les plus graves; et il a fallu toute l’expérience du célèbre Haller, pour faire disparaître ces vaines superstitions de l’ignorance.
Cependant le colchique intéressera toujours les vrais savans par les phénomènes botaniques les plus singuliers. Sa corolle, à six découpures glacées de violet, n’a ni feuilles ni tige; un long tube, blanc comme l’ivoire, qui n’est qu’un prolongement de la fleur, est son seul soutien; c’est au fond de ce tube que la nature a placé la graine, qui ne doit murir qu’au printems suivant. L’enveloppe qui la renferme, profondément ensevelie sous le gazon, brave les rigueurs de l’hiver; mais aux premiers beaux jours, cette espèce de berceau sort de terre, et vient se balancer aux rayons du soleil, environné d’une touffe de larges feuilles du plus beau vert. Ainsi, cette plante renversant l’ordre accoutumé des saisons, mêle ses fruits aux fleurs du printems, et ses fleurs aux fruits de l’automne. Mais dans tous les tems, les tendres agneaux fuient à son aspect; la jeune bergère s’attriste à sa vue; et si quelquefois la mélancolie tresse une couronne de ses fleurs d’un bleu mourant, elle la consacre aux jours heureux qui ont fui pour ne plus revenir.

Chant IV.
Les champs ayant perdu leurs brillantes beautés,
Damon retourne encor dans le sein des cités;
Se livrant tout entier aux paisibles études,
Il vivait seul, heureux et sans inquiétudes.
Un air affable et doux, un visage riant,
En lui nous faisaient voir un cœur toujours content.
Il fit pour son plaisir une chambre agréable,
Qui doit faire à Robin un sort plus supportable.
Cependant Adonis trouvant l’occasion
D’envoyer l’écureuil à l’aimable Damon,
Transporta renfermé dans son étroite cage
Robin tout épeuré sur les bords du rivage.
On l’embarque, et poussée aussitôt par les vents,
La nef, avec effort, fend les flots écumants.
Aux yeux des matelots, les bois et les campagnes
Vont, en fuyant, se joindre aux bleuâtres montagnes.
Déjà l’on apperçoit, au loin, l’antre fameux,[1]
Prodigue de beautés aux regards curieux.
Là, du haut d’un rocher, les ondes bouillonnantes
Lancent, avec fracas, leurs vagues blanchissantes;
L’eau se brise à l’instant, rejaillit dans les airs,
Retombe encore, et va se perdre dans les mers.
Enfin, depuis longtems, obscurcie à la vue,
Le mont semble élever la ville dans la nue.
Avec légèreté s’avançant, dans le port
La prompte nef arrive, et l’équipage en sort.
Alors le bel Iphis, garçon prudent et sage,
Suivant un ordre exprès, en sa main prend la cage,
Et s’avance à grands pas vers l’auguste maison,
Qu’habitait, en ce tems, l’estimable Damon.
Celui-ci l’apperçoit; pour lui quelle allégresse!
Il voit son cher Robin, l’objet de sa tendresse;
Il court, il le saisit, et le met à l’instant,
En pleine liberté, dans son logis charmant.
Lors, comme un trait lancé par un chasseur avide,
Le craintif écureuil part tremblant et timide;
Et pour fuir de ces lieux, cherchant quelque détour,
De cet appartement il fait cent fois le tour.
Mais pour le rassurer, prenant une noisette,
Damon légèrement sur le plancher la jette:
L’écureuil affamé, pour appaiser sa faim,
S’approche à petits pas, et d’un air incertain.
Mais la peur le surprend, l’abat, le décourage;
De Damon même il craint le paisible visage.
Il part encore, if fuit, et sa grande frayeur
Augmente de ses sauts l’étonnante vigueur.
De nouveau, Damon prend quelques noix qu’il lui jette:
L’écureuil, à ce bruit, tout interdit, s’arrête:
Il apperçoit ces noix, il apperçoit Damon;
Il veut manger, la peur suspend son action:
Rassuré néanmoins par le profond silence
Qui règne dans ces lieux, à pas lents il s’avance;
Et prenant de ces fruits, qu’il gruge en tremblottant,
Bientôt jusqu’à Damon, sans frayeur, il se rend.
Chant V.
Enlevé des forêts, à la fleur de son âge,
Robin avait longtems soupiré dans sa cage.
Resserré tristement, hélas! aucuns plaisirs
N’avaient pu contenter un seul de ses désirs!
Mais il goute à présent, cet animal agile,
En pleine liberté, dans son nouvel asile,
Mille plaisirs nouveaux, mille agrémens divers,
Qui lui font oublier ses bois et ses déserts.
En moins de quatre jours, Damon, par sa constance,
Sut de son écureuil vaincre la défiance:
Il l’attirait à lui, lui montrant sous ses doigts,
Ces fruits qu’il aimait tant, quelques glands, quelques noix;
Passant comme un éclair, et craignant ces tendresses,
L’écureuil évitait ses premières caresses:
Mais bientôt rassuré par la grande bonté
Qu’il voyait en Damon, avec agilité,
On le voyait sauter sur cet aimable maître,
Prendre une noix, s’enfuir, aussitôt disparaître.
C’était un grand plaisir pour l’aimable Damon,
De passer, chaque jour, sa recréation,
Avec ce cher Robin, dont la grande vitesse
Trompait cent fois des yeux qui l’observaient sans cesse.
Tantôt il l’admirait, sous ses légères dents,
Ronger, en les tournant, ou des noix, ou des glands;
Tantôt il le voyait avec joie en sa roue,
Où, d’un pied sautillant, il tourne, monte et joue,
Faisant sous lui rouler avec rapidité,
Les barreaux qu’il repousse avec légèreté.
De plus, Damon avait par un soin agréable,
Exercé pour un jeu son écureuil aimable.
De son pied doucement il frappait le plancher,
Aussitôt on voyait l’écureuil s’approcher,
Dresser son petit col, et plein de confiance,
S’arrêter, regarder avec impatience;
Sans sortir de l’endroit jusqu’au second signal;
Alors on le voyait, cet agile animal,
Se jetter sur Damon, y prendre une noisette,
Et se glorifiant d’une telle conquête,
La porter dans un coin, aussitôt revenir,
Cent fois recommençant, par un nouveau plaisir,
A ce même signal, un jeu si propre à plaire.
Par un travail constant que ne sait-on pas faire?
Robin avait, goutant le plus doux agrément,
Déjà vécu huit mois dans ce séjour charmant.
Il oublia ses bois, il le pouvait sans crime.
Il n’en fut pas ainsi de son petit intime;
Il ne peut l’oublier; et la nuit et le jour,
Lui seul pour ses plaisirs manque dans ce séjour.
Souvent il croit le voir l’objet de sa tendresse;
Mais cette image fuit, et le trompe sans cesse.
Les dieux puissants, Robin, ont exaucé tes vœux,
Tu verras ton ami, tu seras donc heureux.
Mais quoi! tout ennivré de sa douce présence,
Tu gémiras bientôt de sa nouvelle absence.
Chant VI.
Ce tendre compagnon ayant perdu Robin,
Parcourait les forêts, consumé de chagrin.
Mais comme son ami, le destin déplorable
Le fit tomber, hélas! dans un piége exécrable.
Asthyne l’ayant vu, pour finir son malheur,
Au plutôt, l’acheta du funeste chasseur.
Comme Damon, Asthyne ayant le cœur sensible,
Le mit en liberté, dans un séjour paisible.
Cet aimable écureuil à son cœur était cher;
Il l’appellait toujours son cher Oléaster:[2]
Nom tendre, nom charmant, par sa belle origine.
Un bon jour que Damon était avec Asthyne,
De leurs petits mignons ils discouraient tous deux;
L’un et l’autre du sien vantait les tours, les jeux.
Pour complaire à Damon, Asthyne favorable,
Lui promet d’apporter son écureuil aimable;
Fidèle à sa promesse, il l’apporte en effet;
Et Damon tout joyeux près de Robin le met.
De joie, en se voyant, l’un et l’autre s’arrête;
Puis l’un à l’autre court: ah! leur joie est complète!
Ils ne déplorent plus leurs peines, leurs malheurs;
Ils goutent maintenant le plus doux des bonheurs.
La gaité, le plaisir, tout charme leur présence;
Tout les console alors de leur cruelle absence:
Ils goutent le bonheur qu’ils goutaient autrefois,
Et pour une heure, au moins, ils ont trouvé leurs bois.
Mais bientôt au plaisir succède la tristesse;
On enlève à Robin l’objet de sa tendresse;
Et le même jour voit leur joie et leur douleur..
Robin va succomber à ce cruel malheur.
Damon, voyez Robin, considérez sa peine;
Un noir chagrin, hélas! au Cocyte l’entraîne.
Vous l’ignorez, Damon, vous êtes dans les champs;
Vous jouissez, au frais, des plaisirs du printemps:
Et Robin accablé, dans sa douleur soupire;
Sa force l’abandonne, il succombe, il expire....
Damon revient, il voit... Oh! quelle est sa douleur!
Il voit ce cher Robin, que chérissait son cœur,
Etendu sur la place... il le voit... mais sans vie!
A ce funeste aspect, son âme est attendrie:
Damon pleure, il soupire, il se livre au chagrin:
Dans sa douleur extrême, il appelle Robin.
“Robin, hélas! Robin, l’agrément de ma vie,
Ah! tu n’existes plus! O toi, parque ennemie,
Pourquoi finir les jours de ses premiers printems?”
Ce chagrin de Damon continua longtems.
Rien ne pouvait calmer ses ennuis et ses peines:
Ni les riants jardins, ni les superbes plaines,
Ni l’herbe verdoyante et le parfum des fleurs
Ne pouvaient adoucir ses regrets, ses douleurs.
EPILOGUE.
Je dépose à vos pieds, écolier téméraire,
Ces vers que je rimai, Damon, pour vous complaire.
Que si vous agréez ce fruit de mes travaux,
Tenez le bien longtems caché, pour mon repos;
Et pour le vôtre aussi; je vous le dis sans crainte:
Car Damon, ce chagrin, cette éternelle plainte,
Feraient peut-être dire à des esprits mal faits:
“Quoi! Damon a pleuré, formé mille souhaits,
Pour un pauvre écureuil, un animal sauvage!
On avait toujours cru que Damon était sage.”
Peut-être bien encor quelques noirs médisants
Dans leur humeur, diront, en lisant ces six chants:
“Ce petit écolier, des bancs de la troisième,
Fait larmoyer Damon, dans un nouveau poëme,
Qu’il composa tout seul, malgré son Apollon,
Dans les sales bourbiers du glissant Hélicon.
Eh, quoi! l’impertinent, voyez donc son audace!
Pour un vil écureuil fait faire la grimace
Et répandre des pleurs à l’aimable Damon.”
Voila ce qu’ils diront. Mais dans l’occasion,
Je leur crîrai bien haut: “La muse mensongère
A la vérité nue a toujours fait la guerre.”
Un bon esprit toujours sait à quoi s’en tenir;
Et c’était là, damon, où j’en voulais venir.
|
Le Sault de Montmorency. |
|
Oléaster, Olivier sauvage: Asthyne appella ainsi son écureuil du nom d’un de ses amis, qui se nommait Olivier. |

Dans le mois d’Août dernier, M. le Dr. Blanchet, voyageant de St. Thomas à Kamouraska, a eu l’occasion de faire quelques recherches, ou observations géologiques, qu’il a communiquées au public, dans une lettre aux rédacteurs de la Gazette de Québec. Nous pensons que nos lecteurs ne seront pas fâchés de les voir transcrites ici.
“J’étais seul dans ma voiture,” dit le Docteur, “le temps était sombre, et j’aurais voulu arriver au bout de ma carrière dans un seul instant. Je cheminais donc aussi vite que possible, ayant à contempler à ma gauche, un des plus grands fleuves du monde, et à ma droite, une chaîne de montagnes, dont la formation et l’arrangement surpassaient mon intelligence; néanmoins j’examinais attentivement ce que je voyais; et j’ai été étonné de voir que toute la côte du sud, à partir du fleuve à basse mer, jusqu’à la chaîne de montagnes, se compose de lits ou couches de pierres argilleuses de différentes couleurs, lesquelles sont presque verticales et dans la direction de l’est à l’ouest. J’ai visité aussi les rochers, dont les uns s’élèvent à plus de cent pieds au-dessus de cette côte; leurs lits se trouvent inclinés aussi dans la même direction; de sorte que ce banc immense de terre pétrifiée aurait été autrefois, durant sa formation, précipité du sein des eaux, et que son poids énorme, joint à des causes souterraines, lui aurait fait éprouver un mouvement de bascule du côté du sud, ce qui aurait formé l’océan atlantique. Que les couches argilleuses et granitiques aient été précipitées du sein des eaux, c’est ce dont il ne peut y avoir le moindre doute. Chaque substance a agi d’après les lois des attractions chimiques. En examinant ce banc de pierre, on voit des précipités, des cristallisations, des incrustations, des aggrégations, des cavités à l’infini, dans le corps des pierres, causées par le dégagement de l’air; enfin des corps étrangers qui se sont trouvés engagés durant la pétrification. Ce banc a été submergé pendant longtemps, et les plaines ou les vallées sont toutes de terres alluviales. Ce fait s’établit par les coquilles que l’on trouve, après avoir creusé cinq à six pieds dans la terre. On rencontre d’abord l’argille ou la glaise, et ensuite du gravier où se trouvent les coquilles. Enfin, après avoir examiné et réfléchi longtemps sur tout ce que je voyais autour de moi, je n’ai pu m’empêcher d’en venir à cette conclusion, que le banc de pierre au sud du fleuve, dont les lits vont de l’est à l’ouest, est de formation neptunienne; que ce même banc a éprouvé un mouvement de bascule, de manière que ses lits sont presque verticaux; enfin que toutes les terres que cultivent maintenant les habitans sont des alluvions subséquentes à ce mouvement de bascule. Mais je me propose d’examiner la chaîne de montagnes du côté nord du fleuve, pour voir si je suis correct ou erronné dans mes conclusions.”
Monsieur Bibaud,
Si le morceau ci-inclus peut plaire à quelques géologistes, je le laisse à votre disposition, et suis, &c.
J. G. M.
St. Paul, 21 Sept. 1826.
A St. Paul, dans le haut de rivière de L’Assomption, il s’est fait, dernièrement, un éboulement de terre d’environ sept ou huit arpens de longueur, sur un et demi environ de largeur, entrainant avec soi plusieurs milliers d’arbres, dont la plupart sont restés debout, sans être aucunement endommagés. Cet éboulement, en glissant près du lit de la rivière, l’a tellement resserré, qu’il s’est élevé à trente ou trente cinq pieds plus haut que la surface de l’eau; ce que je ne pouvais croire, pensant au contraire, que cette élévation provenait des terres éboulées; mais mon guide me fit voir, à n’en point douter, que nous marchions sur l’ancien lit de la rivière, par plusieurs marques sensibles, telles que les coquillages, qui n’étaient pas encore desséchés, par les graviers, et la glaise, qui était différente de celle des terres adjacentes, et surtout par les embarras qui séparaient les terres déboulées d’avec le lit de la rivière, qui est une glaise nette, sans aucuns bois ni racines, mais partagée en différentes petites monticules; ce qui fait voir l’effort du travail de la nature. Qui l’aurait cru, me disais-je, qu’en passant ici, il n’y a que quelques semaines, je marcherais aujourd’hui sur le lit de cette rivière, qui avait plus de quinze pieds de profondeur en cet endroit? Le côté d’où est parti le débouli, (côté N. E. de la rivière,) a plus de cent vingt pieds de haut. La secousse a dû être très considérable, lorsque les terres se sont affaissées, puisqu’on a remarqué sur le bord de la côte qui est restée, une grosse pièce de pin non équarrie, qui a été entièrement chassée de son lit, à deux ou trois pieds plus loin. Cette espèce de tremblement de terre paraît avoir été occasionnée par plusieurs cours d’eau, dont un a une odeur très forte de souffre. La rivière, au-dessous de l’éboulement, est restée deux jours à sec, jusqu’à ce que l’eau d’en haut ait été assez forte pour rompre sa digue, et se faire un nouveau passage. Du côté opposé, c’est-a dire du côté du débouli, il s’est formé une espèce de lac ou marais, où l’eau séjourne sans aucun cours apparent, couvrant le pied des arbres qui sont descendus de la côte; ce qui formera, sans doute, par la suite, une île, lorsque la rivière, dans la force des eaux, se fera un nouveau chemin, de ce côté. Par une faveur singulière de la providence, ce débouli s’est fait dans un endroit, où il n’y avait point d’habitans, y en ayant cependant plus haut et plus bas; et quoiqu’il y eût aux environs, des troupeaux considérables de bœufs, vaches et moutons, aucun n’a été entrainé dans l’abîme.

En approchant Castleton, où nous allâmes passer la nuit, les ruines du château qui lui donne son nom, se montrent sur le sommet d’un rocher perpendiculaire. C’était déjà du temps des Romains, une ruine appellée Arx diaboli, et son origine, alors comme à présent, était inconnue. En descendant de voiture, un guide s’est présenté, et nous nous sommes mis en marche pour aller voir la fameuse caverne de Peak’s hole, au pied du rocher qui sert de base au château. J’ai été frappé en l’approchant, de la ressemblance de ce rocher avec celui d’où sort la fontaine de Vaucluse. L’entrée a 120 pieds de large et 70 pieds de haut.—En avançant sous ce dôme spacieux, on est surpris de découvrir plusieurs petites maisons perdues dans l’immensité, et un nombre considérable de cordiers à l’ouvrage, établis dans ce lieu de temps immémorial. Ces objets, au lieu de dégrader sa majesté, y ajoutent par la comparaison de leur humble petitesse.
Nous reçûmes ici chacun une chandelle allumée, et descendant par un passage étroit, à l’extrémité de la première caverne, nous arrivâmes sur le bord d’un petit lac, d’une eau fort claire, qui couvre tout le fond d’une seconde caverne; nous l’avons traversé l’un après l’autre, au moyen d’un petit bateau, dans lequel il faut se coucher, la caverne étant ici extrêmement basse. Débarqués sur l’autre bord, nous nous sommes trouvés dans un autre appartement de cette suite souterraine; celui-ci encore plus spacieux que le dernier, a deux cent cinquante pieds de long et de large, et cent vingts pieds de haut. Le guide, au fait de son métier, vous prépare ici une surprise agréable. Quelques enfans, dressés à ce manége, vont se placer d’avance dans une espèce de tribune naturelle, à une grande hauteur; leurs altitudes et les lumières qu’ils portent, forment un tableau d’un effet aussi pittoresque, qu’inattendu, et comme surnaturel. Puis on suit une longue galerie et une descente de cent cinquante pieds de longueur, fort glissante, dont le plafond est si bas que l’on court risque de se blesser la tête, à tous momens, contre ses inégalités aiguës, et d’après ma propre expérience, je ne conseillerais à personne de laisser son chapeau à l’entré de la caverne, quelque répugnance que l’on se sente à gâter le lustre d’un chapeau neuf.
Un petit ruisseau coule ici rapidement, et l’on est obligé de le traverser plusieurs fois, sur quelques pierres, ou sur le dos du guide; l’eau se perd ensuite, tout-à-coup, par une ouverture du rocher. Enfin après une marche d’un demi-mille au moins, on arrive à l’extrémité de la caverne, et il faut se hâter de retourner sur ses pas, avant de voir finir les chandelles, ce qui serait un accident assez sérieux. Le même coup de théâtre du groupe de petits anges vous attend au retour, dans une situation nouvelle et encore plus frappante, quoique moins inattendue. Le retour de la lumière du jour est admirable, aperçu au loin, dorant l’entrée de la caverne et les stalactites qui pendent de son sommet. L’eau remplit quelquefois tout l’intérieur, qui devient alors inaccessible. Après sa retraite, on trouve souvent des pierres d’une nature tout-à-fait différente du rocher, et même des plantes et des morceaux de bois apportés et déposés par les eaux dans leur cours souterrain. On vous montre dans un endroit de la caverne, le corps d’un serpent ou d’une anguille incrusté dans la masse du rocher calcaire.
Après diner, nous nous sommes remis en marche pour une autre expédition souterraine, pénétrés comme nous le sommes de l’étendue de nos devoirs de touristes, et déterminés à ne pas mollir dans leur exécution. Il était nuit close, et notre guide nous précédait, sa lanterne à la main; les étoiles brillaient sur un ciel sans nuage, et les montagnes étaient illuminées, au loin, du feu des genêts que l’on brûle, à ce que nous apprenons, dans cette saison.
Arrivés à l’entrée de la mine appelée Speed-well, lead mine, ou navigation mine, on nous mit à la main chacun notre chandelle, et nous avons descendu cent six marches ou inégalités raboteuses, boueuses et glissantes, pratiquées dans le rocher. Au bas de cette espèce d’escalier, nous avons trouvé une galerie horizontale d’environ sept pieds de large, couverte de deux pieds d’eau, formant un canal souterrain, sur lequel nous nous sommes embarqués dans un long bateau plat, pourvu de bancs. Les mineurs, poussant de temps en temps contre le roc, faisaient avancer le bateau avec beaucoup de vitesse; ils nous montraient dans quelques endroits des indications du métal, pour la recherche duquel ce grand ouvrage a été exécuté. Bientôt un bruit sourd et continuel s’est fait entendre de loin; c’était une chûte d’eau, une grande cataracte vers laquelle notre bateau glissait avec une rapidité qui eût pu être inquiétante: nous reposant pourtant entièrement sur l’expérience de nos guides, nous avons attendu l’événement avec curiosité seulement. Tout à coup, au plus fort du bruit, la galerie s’est terminée, et au lieu d’un mur de roc à toucher de la main, ce n’était plus qu’un vaste espace ténébreux; à sa gauche un abîme où l’eau se précipitait par-dessus un petit mur de pierre sèche, qui seul nous garantissait, ainsi que notre bateau, de la même chûte; à droite on pouvait mettre pied à terre, et l’un des mineurs, pourvu d’une poignée de bois sec, a grimpé parmi les rochers. Il est allé faire du feu sur une hauteur: au moyen de ce feu nous avons distingué quelques portions de cette excavation gigantesque, que la main de la nature a formée en se jouant; car ceci n’est point, comme on peut bien le croire, un ouvrage de mineurs; l’un de ceux qui nous accompagnaient était ici lors de la découverte de cette caverne: il nous raconta sa terreur et celle de ses compagnons, lorsqu’après six ou sept ans de travail, un dernier coup de marteau entr’ouvrit cette immensité à leurs regards, avec tout le bruit de sa cataracte. Les hommes tirent parti de tout, et non seulement on se familiarisa bientôt ici avec la cataracte, mais bâtissant le petit mur dont j’ai parlé, à travers son lit, sur un rebord plat, qui en facilitait la construction, les mineurs jetèrent, au moyen de cette digue, deux pieds d’eau dans leur galerie, et en firent un canal commode et sûr, dans lequel il n’y a jamais ni plus ni moins d’eau. Afin de découvrir la hauteur de la caverne, on y a jeté des fusées qui n’ont montré que le vide; et pour reconnaître sa profondeur, quelques mineurs se sont laissés dévaler par une corde: à quatre-vingt-dix pieds de profondeur, ils ont trouvé un grand réservoir, dans lequel la sonde a donné trois cents pieds. Quoique si haute et profonde, la caverne a peu de largeur. Les entrepreneurs, sans être découragés par tant d’années de travail infructueux, continuèrent leur galerie horizontale; environ un demi-mille dans la même direction, une seconde caverne s’ouvrit encore sous le marteau des mineurs; elle est infiniment plus vaste que la première, mais peu élevée; on y pénétra trois milles sans en découvrir l’extrémité; elle est extrêmement rude et irrégulière, et il serait facile de s’y égarer. Comme il ne restait aucun espoir de succès, on a discontinué un travail qui avait duré onze ans, et qui attestera à jamais la patience et l’industrie humaine, non moins que le risque de ces sortes d’entreprises. Il fournit au naturaliste l’occasion d’étudier l’anatomie des montagnes calcaires, et cette circulation des eaux intérieures qui alimente les rivières. Il y a dans ces cavernes un courant d’air régulier, qui fait que la flamme des chandelles incline toujours d’un côté, et que la respiration des hommes n’y est guère gênée. Tous les décombres de la seconde galerie ont été jetés dans le grand réservoir sans en diminuer sensiblement la profondeur. Au lieu du plomb que l’on cherchait, on a trouvé beaucoup de carbonate de chaux en beaux cristaux, dont on fait les vases et ornemens divers si connus en Angleterre sous le nom de Derbyshire spar. A notre retour dans le bateau, un des mineurs, petit vieillard rabougri, nous a régalés d’une chanson; il avait une voix de tonnerre, et aussi peu harmonieuse qu’elle était imposante.
Il y a d’autres galeries de mines dans le Derbyshire encore plus langues que celle-ci; mais sans doute plus productives: l’une d’elles a quatre milles de longueur.

Extrait.—On a trouvé quelquefois convenable de semer le bled sur une terre non engraissée. Au commencement de Février, on ramasse vingt boisseaux de chaux non refroidie pour chaque acre de terre, et quarante boisseaux de sable ou de gravois de briquerie; alors vers la fin du même mois, on fait refroidir la chaux, ce qui en double la quantité: aussitôt après, on la répand sur le grain vert, au moyen d’un appareil. La pluie survenant ordinairement ensuite, la plante est lavée jusqu’à la racine; et cette lessive lui donne une vigueur et une force étonnantes pour ceux qui n’en ont jamais fait l’épreuve. La chaux, le sable et les gravois servent principalement à amollir la dureté des terres fortes.—Dans les terres grasses, là où le charbon de terre est à très bas prix, il faut le bruler légèrement dans les champs, et le répandre sur la surface du sol; c’est le moyen le moins couteux de vaincre la dureté de ce sol. D’après le même principe, on a souvent brulé, et employé avec un égal avantage, le rebut ou les scories des mines du voisinage.
Remarque.—L’ouvrage d’où ce procédé est tiré, est écrit pour le climat d’un pays différent du nôtre. On sent qu’ici, il faudrait faire ce qui s’y trouve prescrit, dans d’autres mois; et choisir le tems convenable et qui puisse, à raison de la différence de la saison, répondre au mois de Février en Angleterre.
L’herbe rayée recommandée pour en faire du foin.
Extrait.—L’herbe des Indes rayée, ou à forme de ruban, que l’on cultive dans les jardins, est admirable pour la quantité de foin qu’elle donne. Dans les terrains fertiles, cette plante s’élève souvent à une hauteur de quatre pieds. Quelle récolte de foin ne doit pas produire un champ ainsi ensemencé? Le bétail en est excessivement avide. On en conserve aisément les graines; aussi, quelqu’un qui en aurait assez pour une perche, et qui en réserverait peu-à-peu en aurait bientôt pour autant d’acres qu’il voudrait ensemencer. Il est probable que la récolte en deviendrait beaucoup trop abondante pour le champ sur lequel elle croîtrait: mais si cela arrivait, on en tirerait bon parti, en reportant l’excédant sur un champ voisin.
Remarque.—Cette plante se trouve maintenant dans un grand nombre de jardins en ce pays. On lui donne le nom de ruban. Comme elle se propage avec la plus grande facilité, l’expérience serait peu couteuse; et il faut convenir que si elle réussissait, ce fourage pourrait devenir d’une grande ressource, d’autant que la plante est vivace et paraît très vigoureuse.
Moyen d’empêcher les meules de foin de prendre feu.
Extrait.—Quand on a quelque sujet de craindre que le foin, si on veut l’engranger, ou le mettre en meules, ne soit assez sec, il suffit de répandre quelques poignées de sel commun, (muryate de soude) entre les couches. On aurait tort de regretter une si modique dépense; car le sel, en absorbant l’humidité du foin, en prévient la fermentation, et par conséquent l’inflammation. De plus, il donne du goût à ce fourrage, et c’est un stimulant pour l’appétit du bétail, qui aide à la digestion, et le préserve de plusieurs maladies.
Remarque.—Beaucoup de cultivateurs ont adopté cette méthode, dans le Bas-Canada, depuis une vingtaine d’années; et elle leur a parfaitement réussi. Il est bon d’observer qu’il suffit, à peu près d’un minot de sel, pour quinze cents livres pesant, ou environ cent bottes de foin.
Comment on graisse la laine des moutons, pour la faire croître.
Aussitôt après la tonte, imbibez les racines de la laine qui reste, d’huile ou de beurre et de souffre; et trois ou quatre jours après, lavez-la avec de l’eau et du sel: la laine en deviendra beaucoup plus belle pour la tonte suivante, et elle sera plus abondante.—Cette précaution empêche encore que les moutons ne soient attaqués de la gale, ou par la vermine, pendant l’année. L’eau salée est un préservatif certain contre les vers.

Le pourquoi.—A une assemblée des électeurs d’un de nos comtés, convoquée pour faire choix de deux représentans, (en 1810,) un des électeurs, en présentant un de ses amis comme candidat, en faisait ainsi l’éloge: “Il est un de vos vieux serviteurs, messieurs; depuis longtems, il vous rend les plus grands services, et s’use pour soutenir vos droits”......—“Et voila pourquoi,” interrompit quelqu’un, “il est hors de service, et que nous n’en voulons plus.” Il fut néanmoins réélu.
Le défunt qui comparaît.—Un cultivateur fut trouver un notaire, pour avoir un acte de concession d’une terre: “Monsieur, lui dit-il, mon seigneur est mort: il m’avait de son vivant concédé une terre; malheureusement il est décédé sans m’en passer l’acte. Que faire?”—“Ceci ne souffre point de difficulté,” répondit notre garde-note: “Mr. votre seigneur vous l’a concédée de son vivant; il vous la concéderait bien encore: asseyez-vous, mon bon ami.”—Et de suite, il s’approche de son bureau, et dresse un contrat conçu en ces termes: “Pardevant moi, &c. fut présent feu Sieur N—, lequel a déclaré avoir concédé, dès avant la passation du présent, et de son vivant même, à Paul R—, une terre, &c. &c. &c. lequel Sieur N—, étant requis de signer, a déclaré ne le pouvoir faire, attendu qu’il est mort, et décédé, de sa dernière maladie! ... ... Et voila comme...... Paul R— eut un contrat, et le notaire ses neuf francs.”
La prévoyance.—Un digne abbé de ce diocèse, qui sait allier aux vertus de son état, l’amabilité de l’homme de société, se trouvait assis à une table bien fournie. Il sait manger bon, quand il l’a, et gruger bien, quand il y a de quoi. Quel mal à tout cela?—“Que vous servira-t-on, Mr. l’abbé,” demanda l’hôte? “Voici des poulets, du faisan, de la perdrix...... que voulez-vous?—Oh! monsieur, ce qu’il vous plaira.—Non pas, Mr. l’abbé; votre goût, s’il vous plaît, votre goût.—Monsieur, je ne saurais choisir, en vérité ...—Pardonnez, vous dis-je.—Eh bien, monsieur, du meilleur, de crainte de mort subite, du meilleur.”
George II, et son cousin.—George II, roi d’Angleterre, était contrarié par ses ministres, dans la nomination d’un vice-roi d’Irlande. Ils insistaient pour que le roi préférât le lord Harrington au duc de Dorset, que George eût beaucoup mieux aimé. Il s’était levé avec dépit de la salle du conseil, et avait passé dans sa chambre, laissant les ministres dans le plus grand embarras; car il n’avait point porté de décision. Enfin voyant que sa majesté ne revenait point, ils lui députèrent lord Chesterfield, comptant sur les ressources de son esprit, pour calmer l’agitation du roi, et obtenir ce qu’ils désiraient. Ce seigneur ouvrit la porte avec précaution, et s’approcha, d’un air très respectueux, du fauteuil où le roi s’était jeté. “Je suis chargé, dit-il, Sire, de savoir de quel nom V. M. veut qu’on remplisse le blanc, laissé sur la patente?”—“Mettez-y le diable,” répondit le roi, en colère.—“Mais, Sire,” reprit le ministre, du ton le plus sérieux. “il sera donc qualifié le féal et bien-aimé cousin de votre majesté?.......” George éclata de rire, et la paix fut faite.
Sur les poissons gelés.—Le capitaine Franklin, dans son voyage autour du monde, assure que pendant le rude hiver qu’il passa près de la rivière Coppermine, le poisson gelait au fur et à mesure qu’on le retirait des filets; en un instant, il se convertissait matériellement en glace; et d’un ou deux coups de hache, on le fendait facilement. Si, dans l’état de congélation complète, on le faisait dégeler au feu, le poisson se ranimait. Ce fait prouve jusqu’à quel point le mouvement de la vie peut se trouver suspendu dans les animaux qui ont le sang froid. Le capitaine Franklin ajoute qu’une carpe, gelée depuis vingt-quatre heures, se ranima par le même moyen, et reprit ses forces, au point de bondir avec autant de vigueur qu’auparavant.
Weekly Register, 8 Août 1824.
Kingston, 11 Mai 1814.
(*) Le cœur agité, la tête pesante, l’œil abattu, la bouche écumante de tabac, je reviens d’Oswego, mon cher ami, et......... et quoi?......... Hé! nous nous sommes bien conduits:—Tués, 10; blessés, 18; égarés, point.
Le lieutenant Victor May, blessé dangereusement; il était bon ami, &c. &c. &c. Le capitaine Ledergerw, blessé à la main droite.
Les deux flottes sont dehors. Si le Prince Regent atteint la flotte américaine......... il la pulvérise.—A tantôt.
Votre bon ami,
UN WATTEVILLE.
Montréal, 16 Mai 1814.
Savez-vous bien, mon brave, que votre—“Nous nous sommes bien conduits: tués, 10; blessés, 18; égarés point, vaut presque le veni, vidi, vici de César. Il y a toujours dans ces grands hommes des originalités qui les rapprochent et les décèlent, sans qu’ils s’en doutent. Mais je n’aime point ce laconisme chez eux, quand surtout ils ont votre esprit: or lisez patiemment cette épître, puis exercez vos doigts en réponse.”
Première prise d’Oswego, ou Chouéguen.[1] “Malgré l’infériorité prodigieuse de leurs forces,” dit un historien fidèle, “les Français ôsèrent, au mois d’Août 1756, se présenter devant Oswego. C’était originairement un magazin fortifié, à l’embouchure de la rivière Chouéguen,[2] sur le lac Ontario. Situé presque au centre du Canada, l’avantage de sa position y avait fait élever plusieurs ouvrages, qui l’avaient rendu un des meilleurs postes de ces contrées. Il était défendu par 1800 hommes, qui avaient 121 pièces d’artillerie et une grande abondance de munitions de toutes les espèces. Malgré tant de soutiens, il se rendit, après quelques jours d’une attaque vive et audacieuse, à 3000 hommes, qui en formaient le siège: Montcalm commandait cette expédition. Son heureux succès augmenta sa réputation et celle des armes françaises.”
Vous avez fait plus, mon brave ami; et je suis d’autant plus aise que moins de 1000 hommes aient emporté d’assaut, en dix minutes, le 6 Mai 1814, le fort important d’Oswego, que vous avez eu part à la gloire qui en revient à nos troupes: je me réjouis d’autant plus de ce succès brillant, que votre régiment était de l’expédition, et qu’il s’est comporté d’une manière particulièrement distinguée; que votre intrépide Hercule,[3] s’y est fait remarquer de la manière la plus honorable, (en cela rien de bien étonnant, sans doute,) et que tous ceux de nos amis qui ont partagé avec vous le péril et la gloire de cette journée mémorable, en sont tous revenus sains et saufs, et sans le moindre accident. Hélas! que dis-je? qu’est devenu l’intéressant lieutenant Victor May? Il n’est peut-être plus à l’instant où j’écris! Je n’ai eu le plaisir de le voir qu’une seule fois; ce n’a été que pour regretter de ne l’avoir pas connu plutôt, et désirer, mais en vain, de me rencontrer plus souvent avec lui. Quel beau, quel aimable jeune homme! C’est bien lui, n’est-ce pas, avec qui j’ai passé une des plus agréables soirées du monde, à Prescott, au mois d’Août 1813. Ah! s’il vit encore, que vous me ferez de plaisir de me l’apprendre! Mais s’il doit échapper à la tombe; si l’habileté, le zèle infatigable, les soins impayables et assidus du savant, du respectable, du sensible Millet[4] ont déjà amélioré sa situation et fait présager sa guérison; dites donc au jeune héros que je partage ses souffrances, et au vénérable Esculape, que je l’honore et respecte toujours, autant que j’en suis capable.
Mes respects, mes félicitations à l’intrépide capitaine De Bersy. Comment le fils ne se serait-il pas montré brave, avec un tel modèle sous les yeux! Que ne devait pas attendre d’un digne fils la valeur exemplaire d’un tel père! Le capitaine De Bersy sait-il la joie que j’ai éprouvée, en voyant son nom mentionné séparément dans l’Ordre-général? Mon cher ami, saluez pour moi, félicitez pour moi le malheureux capitaine Ledergerw, que je n’ai pas l’honneur de connaître intimement, et les trois fois heureux De Bersy, fils, Lapierre, Gingins, Pelichodi, Rigaud et Mermet,[5] qui, je crois, sont tous de mes connaissances, et dans cette circonstance, tous enfans-gâtés de Bellone.
Nos vieux pères aimaient le chant, et sous ce rapport, au moins, nous tenons encore un peu d’eux. Ils ne remportaient pas à la guerre quelque avantage, que vite on ne le mît en chanson.—Toute maussade qu’elle fût, (dame! vous n’étiez pas de ce tems-jadis!) la pièce circulait en dépit du goût et d’Apollon: que serait devenu sans cela le caractère national? Vous imaginez bien que l’honneur canadien eût reçu un sanglant affront, si de méchantes rimes n’eussent signalé les hauts faits des guerriers d’alors! Voici donc les couplets, tels quels, que fit éclorre en 1756, la prise d’Oswego, appellé plus communément alors Chouaguen ou Chouéguen.
Sur l’air: Aussitôt que la lumière.
LE FRANÇAIS.
Anglais, le chagrin t’étouffe,
Dis-moi, mon ami, qu’as-tu?
Tes souliers sont en pantouffe,
Ton chapeau est rabattu!
As-tu quelque maladie
Que tu n’ôses découvrir?
Apprends-le moi, je te prie;
Car je pourrai te guérir.
L’ANGLAIS.
Une mauvaise pituite
Qui m’a tombé sur le cœur,
M’assure que, dans la suite,
Je ne mourrai qu’en langueur.
N’as-tu pas quelque racine
Qui puisse guérir mon mal?
Fais-moi prendre médecine
Sans aller à l’hopital.
LE FRANÇAIS.
Je vois bien que tu me railles,
Tu ne me plais qu’à demi;
Tu m’arraches les entrailles,
Me citant mes ennemis;
Tu me parle,’ en ironie,
Sous le masque d’Arlequin;
Je vois ton subtil génie,...
Tu veux parler de Chouaguen.
LE FRANÇAIS.
Quoi! t’a-t-on pris cette place,
Qui est d’un si grand renom!
Fortifiée sur toutes faces,
De mortiers et de canons!
Environnée d’une voute
Faite en forme de lambris,
Et gardée d’une redoute
Qui te mettait à l’abri.
L’ANGLAIS.
Il est vrai qu’en Angleterre,
Nous avions toujours compté
De vous renverser par terre,
Mais nous nous sommes trompés;
Car vous avez tant d’adresse,
Et vos coups portent si bien!...
Les uns tuent, les autres blessent,
Et les nôtres......ne font rien.
Que dites-vous de ce feuillet de notre histoire militaire? Je vous vois sourire de cet élan de verve de notre muse guerrière! Eh bien, je me joins volontiers à vous. Or ça, mon cher ami, si certain poëte de Kingston ne veut pas, ou ne peut pas nous favoriser d’une chanson de son crû, sur la dernière prise de Chouaguen, priez-le de vouloir bien rajuster celle du troubadour canadien de 1756, Mais une chose que je vous demande à genoux; une chose à laquelle j’attacherais le plus grand prix, que j’appellerais une faveur, (et j’espère que vous ne me la refuserez pas;) c’est, et ce serait de me faire un récit exact, très circonstancié, minutieux même, de votre expédition contre Oswego: mais cela, à tems perdu, à tête reposée, et quand vous aurez pu arracher la vérité seule, entière et pure. Je ne veux point que vous passiez la plus petite circonstance; les plus minces détails, doivent trouver place dans votre Journal, qui commencera sans doute du 3 de Mai, et ne finira que le 8, le 9 ou le 10. Vous rappellez-vous de ma narration de l’affaire de Sackett’s Harbour? Eh bien, imitez-en, non la diction, mais le babil: j’écrivais à une dame; figurez-vous que je suis aussi curieux qu’elle.
Dites-moi, par exemple, avant le départ, quelles raisons secrettes et politiques ont porté à cet armement; quelles étaient les troupes qui le formaient; leur nombre, les commandans. Puis viendront des détails sur la flotte; je veux connaître jusqu’aux noms des vaisseaux et leur force; l’embarquement, le trajet, la tempête, le beau tems, la vue des côtes ou des îles, les écueils évités, la vie à bord, &c. Devant Chouaguen, le débarquement, les obstacles opposés et surmontés; force anecdotes surtout, sur cet officier qui a fait ceci, sur ce pauvre soldat, qui en particulier a fait tel prodige, ou telle autre action digne de remarque. Dites-moi ouvertement: “Le plan était mal conçu; il a été plus mal exécuté;” ou le contraire. Voilà encore un sujet de babil, et bien important sans doute. Enfin les renseignemens sur la place même; le site, les fortifications; votre séjour, votre départ, votre arrivée à Kingston, les morts, les blessés, les lacunes de l’Ordre-général.
Remarquez que je vous demande des Mémoires sur une action qui appartient à l’histoire de mon pays; que par conséquent, ils prendront place dans mes archives, s’ils contiennent des vérités qu’il serait de la prudence de ne point encore dévoiler.
P. S. Le 16 au soir.—Nous avons vu le drapeau pris à Oswego; il a été exposé dans la cour de la maison du gouvernement, Jeudi, le 12 du courant, à 2 heures P. M. On a tiré un salut royal de notre citadelle, en mémoire de l’action du 6.
J’apprends la mort du lieutenant May. Nous nous y attendions.
Pourriez-vous joindre à votre relation de l’affaire d’Oswego, un petit plan figuratif des lieux, pour l’intelligence des mouvemens des deux armées; mais fait à la plume, sans compas ni mesure précise, en un mot, à la diable? Relisez bien ma lettre avant d’écrire, en écrivant, et après avoir écrit votre récit. N’éludez aucune de mes questions. Rappellez-vous bien que les faits, les raisonnemens, les informations importantes seront pour l’historien; les détails pour l’ami curieux.
Il est grandement tems d’aller tâter mon oreiller. Au revoir. Saluts, amitiés à tout le monde.
UN VOLTIGEUR.
La réponse au No. prochain.
de manière à la faire servir à l’occasion actuelle: la scène est à-peu-près la même; il n’y a que changement d’acteurs.
|
Ce fort, situé sur la rive sud-est du lac Ontario, à l’embouchure de la rivière Chouaguen avait été bâti par Mr. Burnet, gouverneur de l’état de New-York, en 1727. Les Anglais le nommaient Oswego, et les Français, Chouaguen. |
|
Quelques manuscrits canadiens, que j’ai en ma possession, écrivent Chouéguen, et l’auteur remarque que ce mot signifie noir, en langue iroquoise. |
|
Le capitaine (depuis major) De Bersy, était désigné sous ce nom, au régiment de Watteville, à raison de sa stature et de sa force extraordinaire. Voyez à son sujet, la Bib. Can. Vol. II, No. 4, page 135. |
|
Chirurgien du régiment de Watteville; grand-croix de l’ordre de St. Michel. |
|
Officier du régiment de Watteville. |
|
M. Rigaud de Vaudreuil, gouverneur des Trois-Rivières, commandait en second les troupes de l’expédition contre Chouaguen. Il était frère du marquis de Vaudreuil, alors gouverneur-général de la Nouvelle-France. |
|
Le marquis de Montcalm, alors maréchal de camp, avait le commandement en chef de l’armée. Le rimeur a écrit Montcalme, mais l’historien doit écrire Montcalm. |
|
M. Coulon de Villiers, officier canadien, commandait la colonne de droite de l’armée. |
|
M. de Ligneries, officier canadien, commandait la colonne de centre; et celle de gauche était commandée par M. Chossegros de Lery, autre officier canadien. |
|
Ou d’après cette variante: Tu crèveras pour certain. |

“J’ai souvent entendu, dans notre pays, des plaintes sur la longueur du temps qu’un cours d’études exige dans nos collèges canadiens, comparé à ceux des Etats-Unis. En effet, il faut ordinairement huit années dans nos collèges, tandis que le cours se fait en quatre ans chez nos voisins. Au premier coup d’œil, ces murmures sont appuyés sur un prétexte plausible. Il est pourtant très vrai que ce n’est qu’une illusion. On ne reçoit dans les collèges des Etats-Unis, que des jeunes gens qui savent assez de latin pour entrer dans les classes qui correspondent à ce que nous appellons chez nous les Humanités, et même un peu de grec, dont l’étude fait généralement partie d’une éducation de collège dans les Etats-Unis, ce qui exige quatre à cinq années d’études préalables, que l’on fait ordinairement dans des écoles à peu près élémentaires dont on vient de parler. Au contraire, dans nos collèges on prend le jeune homme au moment où il sort de l’école proprement dite. Pendant ces quatre premières années, en même temps qu’on lui fait étudier les élémens de la langue latine, on lui donne des leçons de grammaire, de chronologie, d’histoire sacrée et profane, ancienne et moderne, de géographie, &c., choses que l’on sait déjà et que l’on est supposé avoir étudiées, avant d’entrer dans ce qu’on appelle un collège dans les Etats-Unis; raison pour laquelle on n’y entre que pour faire les Humanités, la Rhétorique et les cours ordinaires de Philosophie, ce que l’on fait ici dans les quatre dernières années qu’exige le cours d’études de nos collèges. Aussi n’entre-t-on dans ceux de nos voisins, qu’après avoir subi un examen. On n’est admis à faire les cours qu’après avoir donné la preuve que l’on a acquis les connaissances pour le faire avec avantage. Autrement l’aspirant est obligé de se retirer, pour se mettre en état d’obtenir l’entrée du collège, dans une année subséquente. A ce sujet, je dois observer qu’il est un point sur lequel on est en défaut dans les nôtres, c’est l’étude de la minéralogie, devenue si universelle dans les Etats-Unis, dont on reçoit des leçons dans tous leurs collèges, et sur laquelle on y a déjà publié plusieurs ouvrages, dont un, entr’autres, a mérité l’approbation et a obtenu de justes éloges de la part des savans européens. Il ne me serait pas difficile de mettre au jour les raisons qui ont retardé les progrès de cette science parmi nous, si c’était le lieu de le faire; je me contenterai de remarquer que l’on a déjà commencé à s’en occuper. Il y a déjà quelques collections de commencées dans les collèges de Québec et de Montréal. Dans ce dernier, on s’est procuré même une suite d’échantillons de minéralogie avec une nomenclature du célèbre Haüy. Le temps n’est pas sans doute éloigné, où on donnera à cette partie de l’enseignement l’attention qu’elle mérite, ainsi qu’aux autres parties de l’histoire naturelle, surtout celle du pays, qui a fait à peine un pas depuis la conquête.”
Nous osons espérer qu’on ne trouvera pas mauvais que nous ajoutions ce qui suit à ce que nous avons dit, dans notre précédent numéro, concernant nos principales Écoles de la campagne; d’autant plus que nous nous conformons par là à la demande de plusieurs de nos abonnés.
Les exercices publics de l’École des Dames Brousseau et Vaillancourt, de Chambly, ont eu lieu le 29 Août, en présence de MM. Mignault, Robitaille, Paquin, Bélanger et Giroux, prêtres, et d’un grand nombre de citoyens respectables de cette paroisse et de celles d’alentour. Les progrès rapides que les écolières, commençantes, à l’exception d’un très petit nombre, ont faits, en moins d’une année, tant dans la lecture et l’écriture, que dans la grammaire française, l’arithmétique, la géographie, l’histoire, &c. prouvent, non seulement beaucoup de talens et d’application de leur part, mais aussi quelque chose de bien, extraordinaire dans la manière d’enseigner de leurs respectables institutrices. Il est vraiment étonnant que quelques unes de ces écolières, qui, au mois d’Octobre dernier, connaissaient à peine les lettres de l’alphabeth, ou ne les connaissaient point du tout, aient pu répondre sur la grammaire d’une manière raisonnée, en faire l’application des règles sans hésitation, dans leur lecture, et écrire sous la dictée d’une manière très correcte. Ces exercices furent mêlés de petits drames et de dialogues, dont l’auditoire parut très satisfait.
Nous avons le plaisir de pouvoir ajouter, que le mérite des Dames Brousseau et Vaillancourt paraît être justement apprécié: l’encouragement qui leur est donné, dit la notice d’où ceci est extrait en substance, est tel, qu’elles se sont trouvées dans la dure nécessité de refuser un grand nombre d’écolières, faute de les pouvoir loger.
Les exercices littéraires de l’École Latine de St-Eustache, ont eu lieu le 5 Septembre dernier, en présence d’un auditoire nombreux, composé des principaux habitans du village et des paroisses circonvoisines. Les élèves y ont répondu avec avantage, sur les différentes branches de l’éducation classique, principalement sur les belles-lettres et la rhétorique, et ont prouvé, par la facilité avec laquelle ils ont traduit plusieurs auteurs latins, l’application qu’ils avaient portée à l’étude, ainsi que les soins qui leur avaient été donnés par leur digne instituteur. L’élégance des pièces qui ont été représentées, et surtout le naturel et la morale d’un entretien sur l’éducation, font honneur aux talens reconnus de M. Laviolette. Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur mettant sous les yeux, le passage suivant d’un entretien entre plusieurs élèves, composé par Messire Paquin, curé de la paroisse, pour l’occasion.
“Si un habile jardiner fait d’une terre sans culture et hérissée d’épines, un jardin délicieux, où règne une éternelle fraicheur sous l’ombre des arbres plantés par ses soins, où les fleurs naissent et se reproduisent sous mille formes différentes, sur un fond artistement préparé, où enfin les fruits de l’automne enchérissent sur ceux des autres saisons, mérite l’estime et la récompense de son maître; si le statuaire qui sait tirer par son art, d’un bloc de marbre, les traits, les formes et l’image d’un homme célèbre, d’un ami, d’un bienfaiteur, est digne d’estime et de récompense, que ne mérite pas le précepteur de la jeunesse, qui travaille sur un fond autrement riche et fertile, et capable, comme dit Rollin, de productions immortelles, et dignes de l’attention du roi de la nature.”
Le 22 de Septembre dernier, les jeunes Élèves des Demoiselles Lemoine, à L’Assomption, furent examinées, en présence de M. Gaulin, curé du lieu, de M. le Lieut-Col. Faribault, et de la plupart des citoyens du village et des environs. Outre la lecture, l’écriture, la broderie en coton, plusieurs des jeunes demoiselles répondirent sur la grammaire française, la géographie et l’usage des globes, d’une manière si satisfaisante, qu’elles méritèrent les plus vifs applaudissemens de la part de tous les auditeurs. Rien, en effet, n’était plus flatteur que de voir de jeunes enfans, qui toutes, excepté une seule, sont au-dessous de douze ans, répondre avec facilité et précision sur toutes les parties de la grammaire; décrire sans hésiter les différents pays de l’univers; dire un mot de l’histoire de chacun, &c. aussi l’auditoire ne put s’empêcher de témoigner hautement son approbation tant aux jeunes élèves qu’à leurs respectables institutrices: M. le curé surtout, leur exprima sa satisfaction de la manière la plus flatteuse.
L’École élémentaire établie chez Mgr. de Telmesse, depuis moins d’un an, compte déjà, nous dit-on, de 70 à 80 écoliers.—On y enseigne, ou l’on doit y enseigner la grammaire et l’arithmétique.

Mr. Bibaud.—En voyant votre article Fossilisation, &c. j’ai cru vous faire plaisir, en vous adressant ce qui suit:—
Dans un voyage à Pictou, avec le capitaine Frédéric Dugas, de Tracadiache, ou Carleton, nous trouvâmes, à dix lieues environ plus bas que Pictou, (je crois que ce lieu se nomme Meragommisch,) un arbre d’une longueur et d’une grosseur considérables. Cet arbre était assez sain au pied; ayant l’écorce enlevée; il paraissait usé, ou rongé, par l’action de l’eau de la marée montante. Plus haut, il devenait en putréfaction: ensuite, il se perdait sous un rocher isolé sur la grève. Ce rocher pouvait avoir dix à douze pieds de long, cinq ou six de large, et autant de hauteur. Sous le rocher, autant qu’on put y pénétrer à la longueur du bras, le bois se trouvait minéralisé. En suivant parfaitement la ligne ou le fil du bois, j’en tirai quantité de feuillets les uns sur les autres, épais de deux à trois lignes: ils étaient pesants, à petits grains argentés, mais bien brillants, à-peu-près semblables à l’intérieur des pyrites qu’on trouve à la Canardière, près de Québec. Du côté opposé du rocher, c’est-à-dire, du côté de la mer, on trouvait le bout du même arbre, changé en pierre très dure, de couleur presque noire; et comme il y en avait quelques morceaux de cassés, sur le travers de l’arbre, j’en sous-pesai un, que je trouvai plus pesant qu’une pierre ordinaire de même volume. Cette pierre ayant un grain très fin, le capitaine Dugas en emporta pour faire des pierres à rasoir.
Mr. Blanchard croit que pour qu’un corps se pétrifie, il faut qu’il soit à l’abri de l’air et de l’eau courante: cet arbre prouverait le contraire, puisqu’il était en plein air, et battu deux fois par jour par les eaux de la mer. Une autre observation, c’est qu’il a fallu peu de tems à la nature pour faire tout cet ouvrage, puisqu’une partie de l’arbre était encore saine. L’espèce de rocher qui était dessus l’arbre, paraissait se former par des sables apportés par la mer; car j’en pris des morceaux que je réduisis facilement en gros sable; mais d’autres parties résistaient, et étaient déjà en pierre véritable.
Votre île de Montréal peut figurer aussi pour les pétrifications; on dirait que c’est un banc de coquillages. Etant résident à St. Laurent, j’en ai trouvé dans toutes les carrières de pierres à chaux; et aussi à Ste. Geneviève; sur les bords du fleuve, à La Chine; et enfin sur la montagne. Pour cela, il n’y a qu’à casser des pierres, et vous en trouverez en quantité, ainsi que des vers pétrifiés, qui se défont par anneaux piqués dans le centre. Mais comme vous êtes sur les lieux, vous pourrez vous en convaincre par vous-même.
Votre, &c.
J. M.

Quand on a parlé au public, d’une source saline située dans la paroisse de L’Assomption, j’avais déjà découvert, par le secours de l’analyse chimique, les principaux ingrédiens qu’elle contient. Cependant, je m’abstiendrais très volontiers d’en reparler, si on eût donné les informations qui pouvaient intéresser le plus, et inciter les personnes indisposées à en faire usage. Au reste, si je prends sur moi cette tâche, ce n’est qu’à l’instigation polie de plusieurs personnes éclairées.
L’eau de la source en question est un peu blanche, a un goût très salin, quoique assez agréable, pèse plus que l’eau douce, et laisse appercevoir, en la transvidant d’un vaisseau en un autre, une infinité de globules de l’air fixe (gaz acide carbonique) qui s’en échappe. Telles sont ses principales propriétés physiques.
Sans mentionner ici les expériences que j’ai faites pour découvrir ses divers ingrédiens, je me contenterai de dire que cette eau paraît contenir un peu de muriate de chaux, beaucoup de muriate de soude (sel commun de table) et une grande quantité d’air fixe. Tels sont ses principaux constituans chimiques, qui, sans parler de proportion exacte, sont précisément ceux qui constituent l’eau de Sarratoga ce qu’elle est.
D’après ces données, il est très aisé, pour le médecin, de prévoir quelles doivent être les vertus médicinales de l’eau saline de L’Assomption; et l’essai que plusieurs personnes en ont déjà fait, peut servir à confirmer d’avance l’opinion favorable qu’il doit en former. En effet, l’usage modéré de cette eau peut coopérer dans la guérison d’un grand nombre de maladies, et contribuer beaucoup au rétablissement parfait de la santé des personnes convalescentes. Mais il ne faut pas se laisser tromper, comme le fait souvent le vulgaire à l’égard de tout remède nouveau, par l’espoir flatteur qu’elle peut guérir de tous maux. Ce n’est que dans les maladies qui sont accompagnées de faiblesse, surtout des organes digestifs, telles que le scrofule, la dyspepsie, &c. ou à la suite de celles qui ont laissé le système dans un état très faible, que l’on doit s’attendre au bien que cette eau peut faire: car dans les cas de maladie où il y aurait de l’inflammation ou de la congestion, à cause de sa propriété tonique et stimulante, elle pourrait produire des effets très injurieux. C’est pourquoi, pour ne pas entrer ici dans les règles particulières de l’hygiène, je conseillerais aux personnes qui pourraient désirer faire usage de cette eau saline de L’Assomption, ou de toute autre possédant des vertus semblables, de le faire toujours de l’avis, et avec les directions spéciales d’un médecin éclairé.
J. B. Meilleur, Licencié et Docteur en Médecine.
L’Assomption, 10 Septembre, 1826.

Un homme d’une naissance obscure, et exerçant le métier de maréchal, devint éperdument amoureux de la fille du fameux Rubens. Ayant été refusé, avec dédain, par le père de sa maitresse, l’amour excita son courage. Il apprit secrètement à dessiner, et fit un voyage de quelques années. De retour à Rome, il entra chez Rubens, qui était alors absent de son attelier, et peignit une mouche sur un tableau qui était commencé, et qui était sur le chevalet; après quoi il sortit. Rubens voulant continuer son travail, le lendemain, fut trompé par la mouche que le maréchal avait peinte sur son tableau, et voulut d’abord la chasser avec la main; mais ayant vu que cette mouche n’était rien moins que naturelle, il l’admira, et demanda qui était entré chez lui. Le maréchal, devenu peintre, se présenta le jour même, et obtint le prix qu’il avait ambitionné.
On connait une infinité de traits de Gluck, dit Madame De Genlis, qui prouvent le génie de cet admirable compositeur.—En voici un qu’on n’a jamais cité et qui surpasse tous les autres.
Durant son séjour en France, il faisait répéter son opéra d’Iphigénie en Tauride. Après le meurtre de Clitemnestre, Oreste, épuisé par ses remords, tombe dans une espèce de sommeil causé par l’accablement; il se réveille, et dit avec égarement:
“Le calme renait dans mon âme..........”
Tandis qu’il chante lentement ce vers, Gluck crie à l’orchestre, qui jouait pianissimo “forté, forté.” Les musiciens trouvant que c’était un contre-sens avec les paroles, s’obstinent à jouer piano.—Gluck réitère avec colère le même ordre; les musiciens lui représentent que cela est contradictoire avec ce que dit Oreste, que le calme renait dans son âme. Gluck s’écrie: “Il ment, il a tué sa mère!” Il n’y a rien de plus sublime que ce mot échappé du fond de l’âme, et que l’idée de faire démentir ces trompeuses paroles d’Oreste cherchant à s’abuser, par l’accompagnement violent et bruyant qui exprime le trouble et l’horreur. Les sons brusques, rapides, coupés et tumultueux de cet accompagnement, représentent à l’imagination les furies rassemblées dans son cœur. On croit les entendre et les voir lui donner mille coups de poignard; jamais pensée musicale et même pensée dramatique n’a montré plus de génie.
On tient ce trait de M. Porta, compositeur distingué.
Mon cœur, disait un Gascon, est une horloge dont mon visage est le cadran: on voit toujours au vrai, sur l’un, quelle heure il est dans l’autre.
Mis-spelled words and printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Inconsistency in hyphenation has been retained.
Inconsistency in accents has been corrected or standardised.
Space between paragraphs varied greatly. The thought-breaks which have been inserted attempt to agree with the larger paragraph spacing, but it is quite possible that this was simply the methodology used by the typesetter, and that there should be no thought-breaks.
[The end of La Bibliothèque Canadienne, Tome III, Numero 5, Octobre, 1826. edited by Michel Bibaud]