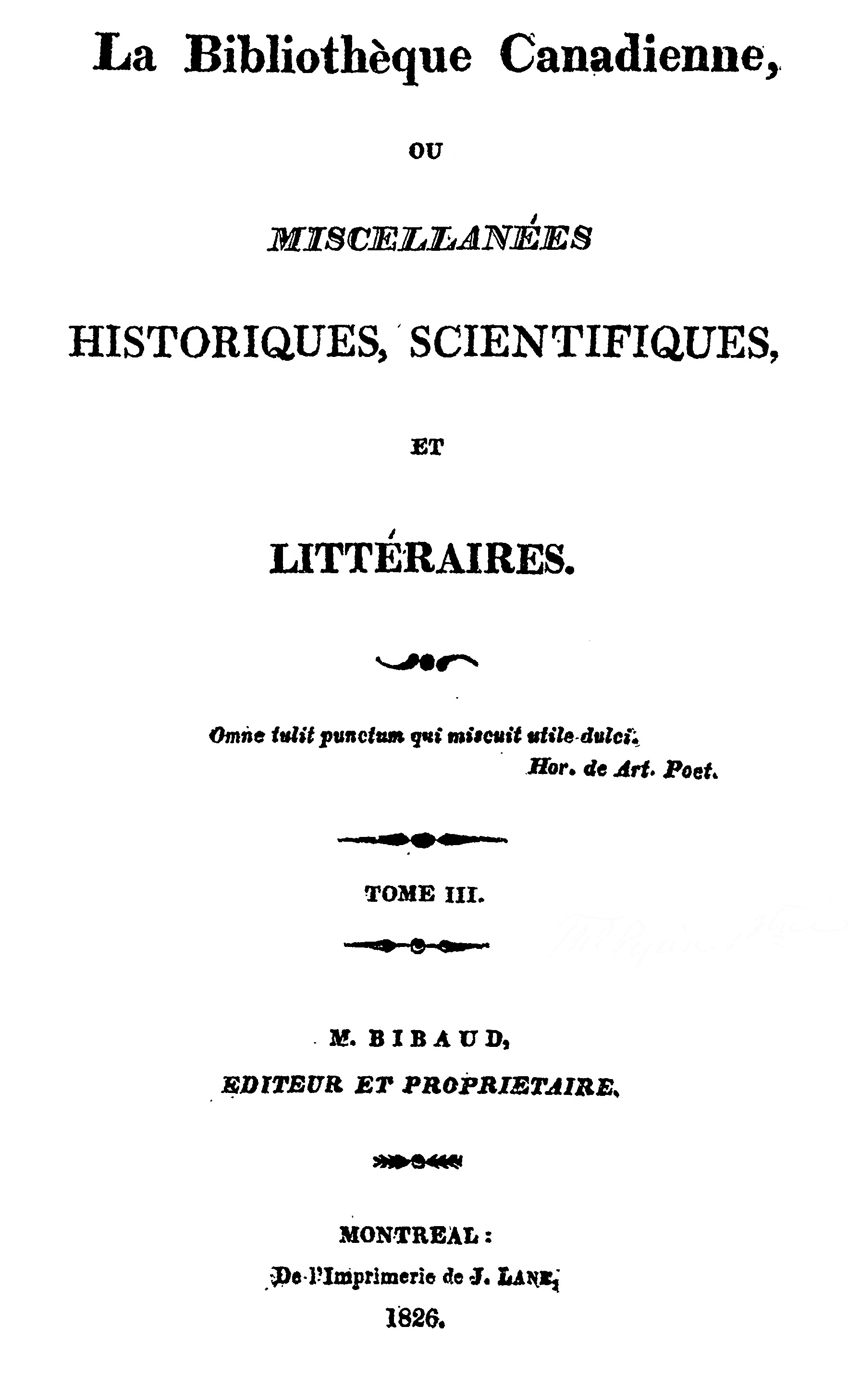
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome III, Numero 3, Aout, 1826.
Date of first publication: 1826
Author: Michel Bibaud (editor)
Date first posted: Apr. 5, 2020
Date last updated: Apr. 5, 2020
Faded Page eBook #20200404
This eBook was produced by: Larry Harrison, David T. Jones, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
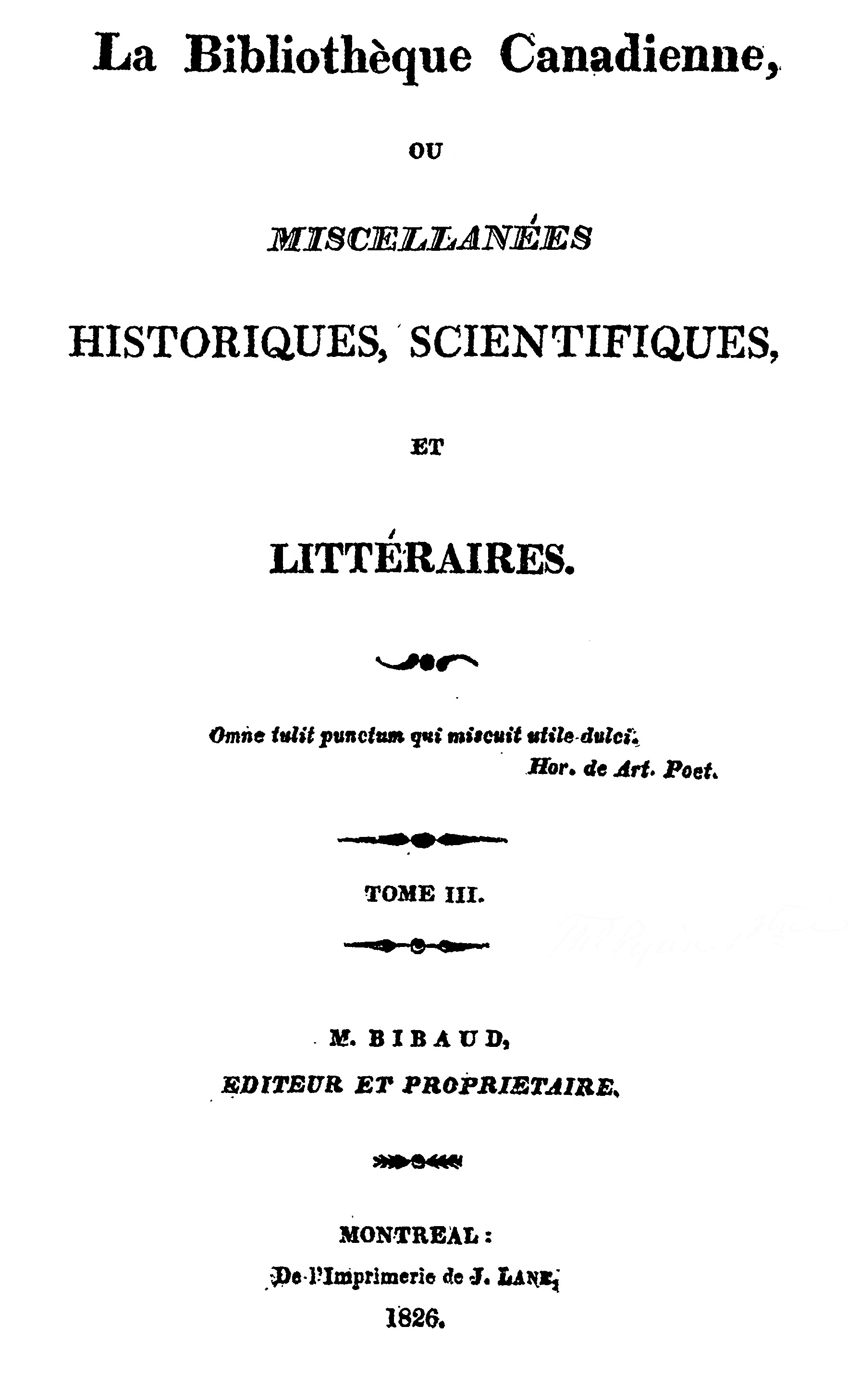
La Bibliothèque Canadienne
| Tome III. | AOUT, 1826. | Numero 3. |
Cependant les Agniers toujours inquiets, et jaloux des avantages que la paix procurait aux autres cantons, remuaient sous main, et cherchaient à troubler le repos, dont tous, Français et Sauvages, à l’exception d’eux seuls, paraissaient vouloir jouir. Ils parurent par petites troupes dans les environs des habitations, commirent des déprédations et des meurtres, et se remirent par là en état de guerre avec les Français et leurs alliés. Mais se repentant ensuite de leurs démarches hostiles, qui quelquefois leur avaient couté cher, ils demandèrent de nouveau la paix, et un missionnaire, et on leur accorda l’une et l’autre. Le P. Lemoyne partit avec leurs députés. Les Onnontagués demandèrent aussi des missionnaires, et on leur envoya les PP. Chaumonot et Dablon. Ces religieux partirent de Québec, le 19 Septembre 1655, avec les députés du canton. Ils furent parfaitement bien reçus, et travaillèrent avec succès à répandre le christianisme parmi ces sauvages.
Ce fut à-peu-près dans le même tems que les Iroquois achevèrent de détruire la tribu des Eriés, ou du Chat, comme les appelle le P. Charlevoix. Les commencemens de cette guerre, dit cet historien, n’avaient pas été favorables aux Iroquois; mais ils ne se rebutèrent point, et ils prirent à la fin tellement le dessus, que sans le grand lac qui porte encore aujourd’hui le nom d’Erié, on ignorerait que cette tribu eût jamais existé.
On craignit que ces nouveaux succès ne fissent reprendre aux Iroquois leur première fierté à l’égard des Français; mais les Onnontagués n’en parurent que plus disposés à s’unir étroitement avec eux. Ils firent des avances qu’on jugea d’autant plus sincères, qu’elles paraissaient d’accord avec leurs intérêts. Enfin, le P. Dablon fit de concert avec eux le voyage de Québec, pour tâcher d’engager le gouverneur à envoyer un bon nombre de Français dans leur pays.
Il partit le 10 Mars 1656, avec une nombreuse escorte, et arriva à Québec, au commencement d’Avril. Il n’eut aucune peine à faire entrer M. de Lauzon dans les vues des Iroquois. Cinquante Français furent choisis pour aller former l’établissement proposé; et le sieur Dupuys, officier de la garnison, leur fut donné pour commandant. Le P. François Lemercier, qui avait succédé au P. Lallemant, dans la charge de supérieur général des missions, voulut conduire lui-même ceux de ses religieux qu’il destinait à accompagner le sieur Dupuys, et qui étaient les PP. Dablon, Fremin et Mesnard.
Cependant la nouvelle de cette entreprise, qui était parvenue de bonne heure aux Agniers, en apparence avant le départ du P. Dablon d’Onnontagué, avait réveillé toute leur jalousie contre ce canton. Il y avait eu une assemblée générale pour délibérer sur cette affaire, qui paraissait des plus importantes, et l’on y avait conclu qu’il fallait mettre tout en œuvre pour s’opposer au nouvel établissement. En conséquence quatre cents hommes s’étaient mis en campagne pour attaquer la troupe de M. Dupuys, qui était partie de Québec, le 17 Mai; mais ils la manquèrent, et s’en vengèrent sur quelques canots écartés qui furent pillés. Quelques uns mêmes de ceux qui les conduisaient furent blessés; après quoi, faisant semblant de s’être mépris, les Agniers leur dirent: “Nous ne savions pas que vous fussiez des Français; nous vous avons pris pour des Hurons ou des Algonquins.”
On ne jugea pas à-propos de tirer alors raison de cette insulte, dans l’espérance qu’on serait bientôt en état d’en tirer une vengeance plus sûre et plus éclatante, si les Agniers ne réparaient pas par eux-mêmes leur faute. Mais loin, de la réparer, ils en commirent bientôt une plus grave encore. Un matin, avant le lever du soleil, ils s’approchèrent de l’île d’Orléans, et tombèrent sur une troupe de quatre-vint-dix Hurons de tout âge et de tout sexe, qui travaillaient dans un champ; en tuèrent d’abord six, lièrent les autres, les embarquèrent dans leurs canots, et les conduisirent dans leurs villages. Les principaux furent brulés, et les autres distribués comme esclaves dans les cantons. En passant fièrement devant le fort de Québec, ils avaient fait chanter leurs prisonniers, comme pour défier le gouverneur de les venir tirer de leurs mains.
On a beaucoup blâmé M. de Lauzon de s’être laissé ainsi arracher d’entre les bras des alliés dont la conservation intéressait également l’honneur du nom français et celui de la religion chrétienne; et de n’avoir fait aucune démarche pour punir l’insolence des Agniers. On peut dire néanmoins pour le disculper, qu’il ne s’était pas attendu à un tel coup de hardiesse de leur part, et qu’avant qu’il eût pu rassembler cinq ou six cents hommes pour les poursuivre, ils auraient pu prendre tant d’avance, qu’il n’aurait plus été possible de les joindre.
Pour revenir à la troupe destinée à former un établissement à Onnontagué, après avoir fait quelque séjour aux Trois-Rivières et à Montréal, elle partit de cette île, le 8 Juin, rencontra un parti ennemi qu’elle battit et pilla par représailles, et fit le reste du voyage assez heureusement, quoique souffrant de la disette des vivres, dont elle s’était abondamment pourvue, en partant, mais qu’elle n’avait pas su ménager assez sur la route. Les Français furent bien reçus à Onnontagué: on les régala de chants, de danses et de festins, et les anciens firent à leur chef les présens accoutumés. Peu après, des députés du canton de Goyogouin vinrent demander un missionnaire, et on leur donna le P. Mesnard.
Une quinzaine de jours après l’enlèvement des Hurons d’Orléans, trente Outaouais que deux Français avaient trouvés sur les bords du lac Michigan, vinrent débarquer à Québec. On a déja vu que par suite de la destruction et de la dispersion des Hurons, les bords de la grande rivière dite des Outaouais étaient devenus tout-à-coup presque déserts. En effet, ces sauvages ne se croyant pas en état de résister aux vainqueurs d’une des plus puissantes tribus de ce continent, n’avaient pas jugé à-propos d’attendre qu’ils vinssent les égorger dans leurs villages. Une partie s’étaient retirés dans la baie de Sanguinan, d’autres dans l’Anse du Tonnerre; plusieurs dans l’île, ou plutôt dans les îles Manitoualin, ou comme d’autres disent, Manitoulines,[1] et dans celle de Michilimakinac. Le reste avaient gagné les régions méridionales, ou erraient ça et là par petites troupes, afin de mieux échapper à la vigilance de leurs ennemis.
C’était une de ces troupes errantes qui venait d’arriver à Québec. Le gouverneur, qui espérait pouvoir étendre par le moyen des Outaouais le commerce de la Nouvelle France, fit à ceux-ci un fort bon accueil, et à leur retour, trente jeunes gens, tant Français ou Canadiens, que Hurons, s’offrirent pour les accompagner. Le P. Le Quien, qui gouvernait la mission, en l’absence du P. Lemercier, fit même partir avec eux les P. Dreuillettes et Gareau et un frère. Arrivés près des Trois-Rivières, ils furent avertis qu’un parti d’Agniers s’était montré dans les environs. Au lieu de se tenir sur leurs gardes, les Outaouais, qui avaient acheté des armes à feu à Québec, s’amusaient à tirer, sur la route, et avertissaient ainsi de leur marche les Agniers, qui les suivaient, et qui eurent tout le loisir de choisir un endroit propre pour les surprendre, ou les combattre avec avantage. Ils le trouvèrent sur le bord du Lac des deux Montagnes, là où la Grande Rivière se décharge dans le fleuve St. Laurent. Ils se retranchèrent derrière une éminence d’où ils pouvaient découvrir de très loin, et postèrent une grosse troupe de fusilliers dans des broussailles, sur une pointe avancée que les Outaouais devaient ranger de fort près. Six canots, où il n’y avait que des Hurons avec le P. Gareau, étaient à la tête du convoi: quand ils furent à portée, les Iroquois firent sur eux une décharge qui en tua, ou en blessa un grand nombre. Ils parurent ensuite, le casse-tête à la main, et tous ceux qui ne périrent pas furent faits prisonniers. Le P. Gareau, qui avait eu l’épine du dos cassée d’une balle de fusil, fut du nombre de ces derniers.
Au premier bruit de cette attaque, les Outaouais firent force d’avirons, pour secourir ou venger leurs compagnons. Arrivés à la pointe où les canots hurons étaient restés avec les cadavres de ceux qui avaient été tués, ils firent leur descente sans opposition, et attaquèrent les Iroquois avec beaucoup de résolution; mais après qu’il y eut eu beaucoup de sang répandu de part et d’autre, les assaillans furent contraints de faire retraite. Ils se retranchèrent pourtant, bien résolus, à ce qu’il semblait, de ne point partir de là qu’ils n’eussent eu raison des Iroquois. Mais le lendemain matin, les missionnaires et les Français de leur suite se trouvèrent seuls dans le retranchement, les Outaouais ayant décampé secrètement pendant la nuit.
Dès que le chef du parti ennemi, (le Batard flamand dont il a déja été parlé,) eut été informé de cette désertion, il vint trouver les missionnaires, et leur fit des protestations aussi énergiques que peu sincères: il regrettait beaucoup, disait-il, de n’avoir pas su qu’il y avait des Français dans les canots, et d’avoir tiré sur le P. Gareau sans le connaître. Ce religieux fut reconduit, le lendemain, à Montréal, où il mourut au bout de quatre jours, dans les bras du P. Claude Pijart, qui lui prodigua tons les soins spirituels et corporels qu’exigeait sa situation. Le P. Dreuillettes et ses compagnons reprirent la route de Québec.
Cependant les Hurons qui restaient dans l’île d’Orléans, ne s’y croyant plus en sureté, s’étaient retirés à Québec, et dans un moment de dépit d’avoir été abandonnés des Français, ils avaient envoyé secrètement proposer aux Agniers de les recevoir dans leur canton, pour ne plus faire qu’un seul peuple avec eux. Les Agniers acceptèrent: mais bientôt, les Hurons s’étant repentis de leur démarche, retirèrent leur parole. Les Agniers furieux, massacrèrent ou enlevèrent tous ceux qu’ils trouvèrent errants dans la campagne; et quand ils crurent que ces hostilités les avaient rendus plus traitables, ils envoyèrent à Québec trente députés pour les emmener.
Ces députés se conduisirent avec une hauteur et une fierté dont on trouve peu d’exemples même chez les barbares. S’adressant d’abord au gouverneur-général, ils lui demandèrent à être entendus dans une assemblée de Hurons et de Français. M. de Lauzon y ayant consenti, le chef de la députation s’adressa d’abord au chef des Hurons, et lui dit: “Mon frère, il y a déja du tems que tu m’as tendu les bras, pour me prier de te conduire dans mon pays; mais toutes les fois que je me suis mis en devoir de le faire, tu t’es retiré; et c’est pour te punir de ton inconstance que je t’ai frappé de ma hache. Crois-moi, ne me donne plus lieu de te traiter de la sorte; lève-toi, et me suis.” En achevant ces mots, il présenta deux colliers; l’un, dit-il, pour aider les Hurons à se lever; l’autre, pour les assurer que désormais les Agniers vivraient avec eux comme frères.
Se tournant ensuite vers le gouverneur, il lui parla ainsi: “Ononthio, lève tes bras, et laisse aller tes enfans, que tu tiens pressés contre ton sein; car s’ils venaient à faire quelque sottise, il serait à craindre qu’en voulant les châtier, mes coups ne tombassent sur toi-même. Voila pour élargir tes bras, (dit-il, en présentant un collier.) Je sais que le Huron est ami de la prière, et qu’il adore le grand Esprit des Français. Je veux en faire autant: agrée qu’Ondesson, (nom donné par les sauvages au P. Lemoyne,) qui m’a quitté, je ne sais pourquoi, revienne avec lui pour m’instruire; et comme je n’ai pas assez de canots pour tant de monde, fais-moi le plaisir de me prêter les tiens.” Il présenta deux nouveaux colliers, pour appuyer ces deux dernières demandes, et se retira.
L’ambassadeur romain auprès des rois barbares, dit un historien, n’était pas plus fier que ce barbare ambassadeur d’un peuple sauvage. Par une singulière faiblesse, le gouverneur ne réprima point cette fierté, ou pour mieux dire, cette insolence qui, plus tard, devait être funeste à la colonie. Pour les Hurons, ils se partagèrent, les uns préférant demeurer avec les Français; d’autres aimant mieux se livrer aux Onnontagués, avec lesquels ils avaient déja contracté une espèce d’engagement. La seule tribu, ou famille de l’Ours, tint à la parole qu’elle avait donnée aux Agniers.
Ces résolutions prises, le conseil s’assembla de nouveau, et le gouverneur-général y assista comme la première fois. Le P. Lemoyne, qui lui servait d’interprète, parla le premier, et dit: “Ononthio aime les Hurons; ce sont ses enfans; mais il ne les tient pas en tutèle; ils sont d’âge à prendre leur parti d’eux-mêmes: il ouvre ses bras, et il leur laisse la liberté d’aller où ils voudront. Pour moi, je les suivrai quelque part qu’ils aillent. S’il vont avec toi, Agnier, je t’instruirai aussi de quelle manière il faut prier, et adorer l’auteur de toutes choses; mais je connais ton indocilité; je n’ôse espérer que tu m’écoutes: mais je m’en consolerai avec les Hurons. Quant aux canots que tu demandes, tu vois bien que nous en avons à peine ce qu’il nous en faut. Si tu n’en as pas assez, fais-en.”
Le chef des Hurons de l’Ours prit ensuite la parole, et dit:—“Mon frère, je suis à toi; je me jette, les yeux fermés, dans tes canots, résolu à tout, même à la mort. Cependant je veux aller seul avec ma cabanne: je ne souffrirai point que d’autres s’embarquent avec moi. Que le reste de ma nation voie comment tu me traites, et qu’elle vienne ensuite me rejoindre, si elle le veut.” Il jetta ensuite trois colliers, qui demandaient un bon accueil, une hospitalité assez cordiale pour lui faire oublier les amis qu’il laissait, et les moyens de voyager sans péril. Les députés parurent satisfaits; ils travaillèrent aux canots, et quand ils les eurent achevés, ils s’embarquèrent avec les Hurons de l’Ours et le P. Lemoyne.
(A continuer.)
|
C’est par inadvertence que dans les deux numéros précédents, nous avons dit, d’après Charlevoix, l’île et non les Iles Manitoualin, ou Manitoulines. Ce nom s’applique, non à une seule île de 40 lieues de longueur, mais à un groupe, ou plutôt à une chaîne d’îles, de six à dix lieues de longueur, et de trois, quatre, ou cinq, de largeur, placées dans le lac Huron, à la suite les unes des autres. |

RELATION des Aventures de M. de Boucherville, à son retour des Scioux, en 1728 et 1729, suivie d’Observations sur les mœurs, coutumes, &c. de ces Sauvages.
Ce meurtre causa bien du trouble chez les Renards. “Nous, sommes perdus sans ressource,” s’écrièrent les vieillards. “Quoi donc, jeunesse insensée, c’est peu pour vous d’avoir soulevé contre nous toutes les nations, qui ont juré notre perte; il faut encore que vous massacriez nos parens! Que ferons-nous pour réparer ce meurtre?”
Ils dépêchent aussitôt cinq hommes pour aller pleurer les deux morts, et s’offrir comme victimes d’expiation au vieillard affligé, qui n’était pas loin du village renard. Dès qu’ils parurent devant lui, ils étendirent une robe blanche sur laquelle deux Renards se couchèrent nus. “Venge-toi, mon frère,” lui dirent-ils, en cette posture humiliée: “on a tué tes enfans, mais nous te présentons nos corps: décharge sur nous ta fureur et ta juste indignation.” Le vieillard leur répond: “Notre village est informé de votre crime; ce n’est plus moi qui suis le maître de cette affaire: la décision dépend des jeunes chefs kikapous.” A ces mots, les Renards prosternés se relèvent et retournent chez eux.
Deux jeunes Kikapous arrivent, peu après, au bord du fleuve et font, la nuit, des cris de mort. On les va chercher en pirogue, et ils racontent la triste aventure de leurs camarades. Cette nouvelle répandit la consternation dans tout le village. Ce n’était partout que pleurs, que cris lamentables, que hurlemens affreux. On dépêche aussitôt des couriers, pour avertir les Kikapous dispersés dans les bois, de se réfugier promptement dans l’île.
Les anciens ne manquèrent pas de me venir reprocher la mort de leurs gens. “Vous êtes cause,” me dirent-ils, “qu’on nous a massacrés, et nous payons bien cher le plaisir de vous posséder.” Je leur répondis: “Si vous aviez voulu me croire, accepter mon présent et consentir à notre séparation, ce malheur ne vous serait pas arrivé. Ne vous en avais-je pas avertis?” “Tu as raison,” me répondirent-ils; “mais que faire dans l’embarras où nous sommes? Nous voila entre deux feux: le Renard nous a tués, l’Illinois nous a tués, le Français nous en veut; qu’allons-nous devenir?”
“Vos affaires,” leur répliquai-je, “ne sont pas si difficiles à débrouiller que vous l’imaginez. Donnez-moi deux chefs pour m’accompagner; je pars pour aller aux Illinois, et je me fais fort de conclure votre paix avec ces nations.” “C’est fort bien penser,” me dirent-ils; mais l’embarras était de trouver des gens assez hardis pour me suivre. Après bien des pourparlers, un Kikapou et un Mascoutin, nés de mères illinoises, s’offrirent à moi. Un d’eux avait perdu son fils à la guerre.
Nous partîmes le 27 Décembre, malgré la rigueur insupportable de la saison; et après bien des peines et des fatigues, qu’on ne connaît bien qu’en les éprouvant, nous arrivâmes, le neuvième jour, chez les Péöaria, dans la rivière des Illinois, à vingt lieues du Mississipi. Plusieurs nations étaient réunies dans ce village, se tenant toujours sur le qui-vive, et inquiètes de savoir des nouvelles des Kikapous.
Deux chasseurs nous apperçurent, et les pavillons que tenaient mes gens les ayant rassurés, ils nous abordèrent. Un de mes compagnons, qui parlait illinois, leur dit que nous venions traiter de la paix; que les Français détenus chez eux se portaient bien; que les Renards, pour se venger du refus qu’on avait fait de leur livrer les Français, avaient tué deux Kikapous.
Dès que les Péöaria surent notre arrivée, ils dépêchèrent trente jeunes Illinois au-devant de nous. Mes deux sauvages les attendirent, et après avoir pleuré leurs morts, après qu’on eut essuyé leurs larmes, qu’on leur eût présenté en cérémonie un grand calumet rouge, où chacun fuma, on nous déchargea de notre bagage; on nous conduisit dans une grande cabanne, à travers une si grande foule de spectateurs, qu’à peine pouvions-nous passer; on nous fit asseoir sur une belle natte toute neuve et sur une peau d’ours. Deux jeunes Illinois bien parés, nous vinrent déchausser et nous graisser les pieds. On nous fit manger ce qu’il y avait de plus ragoutant dans le village. Celui de mes Kikapous qui avait perdu son fils, le pleura pour la seconde fois; tous les chefs se levèrent tour-à-tour pour venir essuyer ses larmes; et après avoir appris tout ce qui s’était passé, ils leur dirent: “Prenez courage, mes frères, nous vous aiderons à venger vos morts.”
Le lendemain, dès la pointe du jour, on vint nous prendre pour nous mener au festin; et nous ne cessâmes d’aller tout le jour de cabanne en cabanne, de festin en festin. Ces pauvres gens ne savaient quelle chère me faire, tant ils étaient charmés des bonnes nouvelles que je leur apportais.
Mon dessein était d’aller au plutôt au village français, qui est à quatre journées des Péöaria; mais il me fallut renoncer à ce voyage, à cause d’une enflure au pied causée par une longue marche dans des eaux extrêmement froides. J’envoyai donc par un exprès les lettres du R. P. Guignas. J’écrivis à M. Desliettes, commandant, et je lui adressai les présens des Kikapous. C’étaient ce fameux calumet ensanglanté, et les deux brasses de porcelaine teinte de sang que les Renards avaient offerts pour obtenir qu’on nous livrât à eux.
Parole des Kikapous et des Mascoutins, accompagnée des présens mentionnés ci-dessus.
“1o. Nos paroles et nos actions ne sont conduites que par le bras d’Ononthio, auquel nous sommes attachés.
“2o. Nous avons été tués, mon père, par les Renards, pour avoir voulu soutenir les Français. Si tu voulais nous envoyer des Français pour nous aider, tu nous ferais plaisir.
“3o. Nous demandons la paix avec les Illinois et avec toi; et que nous fumions désormais dans le même calumet.
“4o. Nous nous sommes dépouillés, en donnant aux Renards, ce que nous avions, afin de les appaiser. Nous te serions obligés, si tu nous envoyais des marchandises, et surtout de la poudre.
“5o. Nous nous flattons qu’on aura conservé notre chair; et nous te prions d’engager les Illinois à nous rendre ceux de nos parens qui sont esclaves chez eux.”
Parole de M. Desliettes, par un calumet rouge et quelques aunes de drap.
“1o. Je suis fâché que le chef français et celui de vos gens ne soient pas venus jusqu’ici. Ils m’ont envoyé votre Parole; je l’ai reçue avec joie, parce que vous m’assurez que vous vous attachez au bras d’Ononthio.
“2o. Je fume avec plaisir votre calumet. Je penserai, en fumant, à tout ce que vous me dites; et je verrai, par les marques que vous me donnerez de votre droiture, si je dois vous envoyer des Français.
“3o. Vous avez déja des Français chez vous, et je n’ai ici aucun de vos gens sur ma natte. Si vous désirez sincèrement, comme vous le dites, de vivre en paix avec nous, je vous invite à ramener ici la Robe-noire et les autres Français: par là je connaîtrai que vous êtes enfans d’Ononthio.
“4o. Si vous faites cela, je vous réponds que je vous donnerai des Français qui iront vous reconduire; et vous serez bien reçus des Illinois et des Français.
“5o. Je vous enverrais volontiers dès à présent des marchandises, mais j’en ai très peu; j’en attends beaucoup dans deux lunes.
“6o. Si les Renards vous ont tués, comme vous l’assurez, vous voyez qu’ils ne vous regardent plus comme leurs parens. Je vous exhorte à vous venger. Vous pouvez compter que cette méchante nation ne peut plus longtems vivre: le Roi veut qu’ils meurent.
“7o. Quand vous serez ici avec la Robe-noire et avec les autres Français, nous prendrons des mesures ensemble; en attendant, nous nous disposons, les Illinois et nous, à nous venger de toutes les insultes qu’ils nous ont faites. Ils ne s’échapperont pas toujours par une lâche fuite à la vengeance des Français.
“8o. Voila les Français qui partent demain pour porter vos paroles à l’Ononthio du bas du Mississipi. Je lui mande qu’elles sont sincères. Je vous prie, Mascoutins et Kikapous, de ne me point faire mentir.
“9o. Vous m’avez envoyé votre calumet; je vous envoie le mien. En fumant dedans, pensez à ce que je vous dis.
“10o. Quand vous serez arrivés ici avec les Français, je parlerai aux Illinois, qui vous rendront votre chair qu’ils ont depuis l’été; car ils n’en ont pas d’autres du tems passé.
“11o. Ononthio n’oubliera pas ce que vous avez fait en faveur des Français, que vous avez refusé de livrer aux Renards.—Continuez à avoir bien soin d’eux; respectez la Robe-noire.—Quand il sera ici, nous n’oublierons pas les soins que vous avez eus de lui, du chef et des Français.”
Nos couriers revinrent le septième jour après leur départ, et m’apportèrent des lettres de M. Desliettes, de quelques officiers et des R. PP. Jésuites, qui me conseillaient de ne point retourner chez les Kikapous, où nos affaires avaient peut-être changé de face depuis mon départ.
(La suite au Numéro prochain.)

Giroflée des jardins.—Beauté durable. Les Grecs, qui chérissaient les fleurs, ignorèrent toujours l’art de les cultiver et de les embellir: ils les cueillaient dans les champs, et les recevaient simples des mains de la nature. On vit les Romains prendre, avec les arts de la Grèce, le goût des fleurs, et même une passion si vive pour les couronnes, qu’on fut obligé d’en défendre l’usage aux particuliers. Ces maîtres du monde ne cultivèrent que les violettes et les roses, et des champs entiers, couverts de ces fleurs, empiétèrent bientôt sur les droits de Cérès. Les braves Gaulois ignorèrent longtems toute espèce de délices: leurs mains guerrières dédaignaient même le soc de la charrue. Chez eux, le jardin, domaine de la mère de famille, ne contenait que des plantes aromatiques et des plantes potagères. Mais enfin les mœurs s’adoucirent, et Charlemagne, qui fut la terreur du monde, et le père de son peuple, aima les fleurs. Dans un de ses capitulaires, il recommande la culture des lis, des roses et des giroflées.
Les fleurs étrangères ne s’introduisirent chez nous qu’au treizième siècle. Au tems des croisades, nos guerriers en apportèrent plusieurs espèces nouvelles de l’Egypte et de la Syrie. Les moines, alors seuls habiles cultivateurs, en prirent soin. Elles firent d’abord le charme de leurs paisibles retraites; puis ils les répandirent dans nos parterres: elles devinrent la joie des festins et le luxe des châteaux. Cependant la rose est encore restée la reine des bosquets, et le lis le roi des vallées. La rose, il est vrai, dure peu, et le lis, qui fleurit plus tard, passe presque aussi vite. La giroflée, moins gracieuse que la rose, moins superbe que le lis, a un éclat plus durable: constante dans ses bienfaits, elle nous offre toute l’année ses belles fleurs rouges et pyramidales, qui répandent sans cesse une odeur qui charme les sens. Les plus belles giroflées sont rouges: elles ont donné leur nom à la couleur qui les pare, couleur qui le dispute en éclat à la pourpre de Tyr. On voit aussi des giroflées blanches qui sont très belles: on en voit de violettes et de panachées, qui ne sont point sans agrémens: mais depuis que l’Amérique, l’Asie et l’Afrique nous envoient leurs brillants tributs, nous avons négligé la giroflée, cette fille de nos climats, si chère à nos bons ayeux. Cependant on a vu en Allemagne des effets surprenants dont cette belle fleur avait toute la gloire. Dans un antique château, près de Luxembourg, on avait disposé, le long d’une immense terrasse, quatre rangs de vases du plus beau blanc, et d’une forme agréable, quoique d’une fayence solide et grossière: ces vases, rangés en amphithéâtre des deux côtés de la terrasse, étaient tous couronnés des plus belles giroflées rouges. Je puis assurer que je n’ai rien vu d’égal à cette charmante et rustique décoration. Vers le coucher du soleil, surtout, on aurait dit que de vives flammes sortaient du centre de ces vases blancs comme la neige, et brillaient à perte de vue sur des touffes de verdure. Alors une odeur balsamique et bienfaisante parfumait tous les environs. Les femmes les plus délicates, loin de s’en trouver fatiguées, en étaient réjouies et fortifiées.—Cette belle fleur s’élève donc, dans nos parterres, comme une beauté vive et fraiche, qui verse la santé autour d’elle; la santé, ce premier des biens, sans lequel il n’y a ni bonheur ni beauté durable.
Bled—Richesse. Les botanistes assurent qu’on ne trouve nulle part le bled dans son état primitif. Cette plante semble avoir été confiée par la providence aux soins de l’homme, avec l’usage du feu, pour lui assurer le sceptre de la terre. Avec le bled et le feu, on peut se passer de tous les autres biens, on peut tous les acquérir. L’homme, avec le bled seul, peut nourrir tous les animaux domestiques qui soutiennent sa vie, et partagent ses travaux: le porc, la poule, le canard, le pigeon, l’âne, la brebis, le cheval, le chat et le chien, qui par une métamorphose merveilleuse, rendent, en retour, des œufs, du lait, du lard, de la laine, des services, des affections et de la reconnaissance. Le bled est le premier lien des sociétés, parce que sa culture et ses préparations exigent de grands travaux, et des services mutuels: aussi les anciens avaient-ils appellé la bonne Cérès, législatrice.
Un Arabe, égaré dans le désert, n’avait pas mangé depuis deux jours: il se voyait menacé de mourir de faim. En passant près d’un puits, où les caravanes s’arrêtent, il apperçoit sur le sable un petit sac de cuir: il le ramasse. “Dieu soit béni,” dit-il, “c’est, je crois, un peu de farine.” Il se hâte d’ouvrir le sac; mais, à la vue de ce qu’il contenait, il s’écrie: “Que je suis malheureux! Ce n’est que de la poudre d’or!”
Souci des jardins—Peine, chagrin. On a vu dans une riche collection un joli petit tableau de madame Lebrun. Cette aimable artiste avait représenté le chagrin sous la forme d’un jeune homme pâle, languissant, dont la tête penchée semblait accablée sous le poids d’une guirlande de soucis. Tout le monde connaît cette fleur dorée, qui est l’emblême des peines de l’âme: elle offre à l’observateur plusieurs singularités remarquables: on la voit fleurir toute l’année: c’est pourquoi les Romains l’appellaient fleur des kalandes, c’est-à-dire de tous les mois. Ses fleurs ne sont ouvertes que depuis neuf heures du matin jusqu’à trois heures de l’après-midi; cependant elles se tournent toujours vers le soleil, et suivent son cours d’orient en occident. Pendant les mois de Juillet et d’Août, ces fleurs laissent échapper, durant la nuit, de petites étincelles lumineuses: elles ont cela de commun avec la fleur de la capucine, et plusieurs autres de la même couleur.
On peut modifier de cent façons la triste signification du souci. Uni aux roses, il est le symbole des douces peines de l’amour; seul, il exprime l’ennui; tressé avec diverses fleurs, il représente la chaîne inconstante de la vie, toujours mêlée de biens et de maux; en orient, un bouquet de soucis et de pavots exprime cette pensée: “Je calmerai vos peines.” C’est surtout par des modifications semblables, que le langage des fleurs devient l’interprête de tous nos sentimens.
Marguerite d’Orléans, ayeule maternelle de Henri IV, avait pour devise un souci tournant son calice vers le soleil, et pour âme:
Je ne veux suivre que lui seul.
Cette vertueuse princesse entendait, par cette devise, que toutes ses pensées, toutes ses affections, se tournaient vers le ciel, comme la fleur du souci vers le soleil.
Datura-Charmes trompeurs. Souvent arrêtée par la mollesse, une indolente beauté languit tout le jour, et se cache aux rayons du soleil. La nuit, brillante de coquetterie, elle se montre à ses amans. La lumière incertaine des bougies, complice de ses artifices, lui prête un éclat trompeur; elle séduit, elle enchante.—Cependant son cœur ne connaît plus l’amour; il lui faut des esclaves, des victimes. Jeune homme imprudent, fuyez à l’approche de cette enchanteresse; pour aimer et pour plaire, la nature suffit, l’art est inutile. Celle qui l’emploie est toujours perfide et dangereuse.
Les fleurs du datura, semblables à ces beautés nocturnes, languissent sous un feuillage sombre et fané, tant que le soleil nous éclaire. Mais à l’entrée de la nuit, elles se raniment, déploient leurs charmes, et étalent ces cloches immenses que la nature a revêtues de pourpre doublée d’ivoire, et auxquelles elle a confié un parfum qui attire, qui ennivre; mais qui est si dangereux, qu’il asphyxie, même en plein air, ceux qui le respirent.

Dans l’automne de l’année qui suivit celle où la paix vint délivrer le Canada des privations, des fatigues et des maux de la guerre, je me trouvai engagé dans une partie de chasse aux chevreuils, avec un chef sauvage du village de Cognawaga. Nous partîmes ensemble seuls, et après avoir rodé ça et là, pendant une huitaine de jours, sans beaucoup de succès, le hasard porta nos pas sur les bords de la petite rivière mentionnée ci-dessus. Nous en suivîmes le cours, en cherchant du gibier, jusqu’à ce que nous fûmes arrivés à la redoute de la position militaire que nous avions occupée pendant la guerre. Comme j’avais présente à la mémoire la circonstance mystérieuse qui avait fixé notre attention et excité notre surprise, en cet endroit même, il y avait quelques années, je résolus, puisque l’occasion s’en présentait, d’en pénétrer le secret, en m’enfonçant dans les détours et les recoins de ce petit vallon. Faisant donc remarquer à mon compagnon, que vu la profonde solitude du lieu, il devait s’y trouver beaucoup de bêtes fauves, car je ne voulais pas lui faire part de mon véritable motif, qu’il aurait pu ne pas comprendre, ou dont il aurait ri, s’il l’avait compris, nous dirigeâmes en avant nos pas explorateurs.
L’espace d’environ un mille, nous suivîmes le cours du ruisseau, au milieu d’herbes hautes et épaisses, sans que ni pierre, ni souche, ni tronc d’arbre arrêtassent nos pas, jusqu’à l’endroit où le vallon fait soudainement un détour, se rétrécit, et se hérisse d’obstacles qui retardent la marche même des aborigènes de ce continent. Nous franchîmes cet espace, d’environ un demi mille, et parvînmes au point où se termine le vallon. Ce point est une espèce d’aire d’un peu plus d’un demi acre en superficie, entourrée de hauts bancs de granit, des crevasses desquels sortent, à peine nourris par la petite portion de terre qui s’y trouve, le sycomore et le pin rabougri, dont le noir feuillage jette une ombre lugubre sur l’espace ouvert qui est au-dessous, laquelle combinée avec le morne et éternel silence qui y régnait, me faisait tressaillir, toutes les fois que l’écho de nos voix était répété par les cavernes du rocher. De derrière une masse de pierres et de terres éboulées, jaillissait une source d’eau vive qui, s’ouvrant un passage par le centre de ce sombre amphithéâtre, formait une espèce d’étang d’où, prenant la forme d’un ruisseau, elle coulait avec un léger murmure, jusqu’au bas de la partie inégale et rabotteuse du vallon, après quoi devenant une petite rivière, elle continuait à couler, sans bruit et moins rapidement. Le tout ensemble de ce petit espace semblait particulièrement propre à la résidence d’un être surnaturel. J’étais pourtant extrêmement fâché de voir ma course exploratrice arrêtée si soudainement, et devenue par conséquent inutile. Il n’était plus possible d’avancer, à moins que ce ne fût en grimpant sur les rochers qui projetaient de toutes parts autour de nous leurs pointes repoussantes; tentative où le sauvage même le plus alerte et le plus agile n’aurait pu réussir.
Convaincu de cette impossibilité, j’allais rebrousser chemin, dans le doute et la perpléxité, quand les yeux perçants de mon compagnon, en cherchant, dans les environs, la reposée d’une loutre, dont il avait apperçu la trace, découvrirent un passage caché par la pointe avancée d’un rocher, et les buissons et vignes sauvages répandus profusément à l’entour. Nous y pénétrâmes, et le mystère, jusqu’alors incompréhensible, commença à s’éclaircir et s’expliquer en partie. Après nous être avancés, non sans efforts, dans ce sentier, à peine assez large pour admettre le corps d’un homme, hérissé de ronces et de broussailles, nous nous trouvâmes dans un espace ouvert, où le soleil brillait sans obstacles, et dont la clarté contrastait avec la lugubre obscurité de celui que nous venions de quitter. Une variété de plantes et d’arbustes qui sortaient des flancs du rocher taillés presque perpendiculairement, à une grande hauteur, adoucissait un peu ce qu’ils avaient de rude et de choquant pour la vue.
L’objet le plus remarquable, ou plutôt, le plus singulièrement intéressant qui s’offrit à mes regards, dans cette retraite écartée, ce fut, dans un coin, une cabanne faite de troncs et branches d’arbres, dont le toît d’écorce était en partie tombé, et qui était presque entièrement cachée par les herbes et les ronces qui croissaient à l’entour; indice certain qu’elle n’était point habitée et qu’elle était abandonnée depuis plusieurs années. En examinant l’intérieur de cette cabanne, et en penchant et écartant, avec la crosse de mon fusil, l’abondante végétation dont elle était remplie, je découvris les restes pourrissants de quelques hardes de prix, et les couvertures rongées des vers de livres dont les matériaux moins durables avaient été détruits par le tems et la vermine. Il y avait un article que je contemplai avec un vif sentiment d’intérêt, en songeant à l’amabilité supposable et au sort probable de la personne à laquelle il avait appartenu; c’était un chapeau de femme de castor blanc avec ses plumets. Suspendu à un des côtés de la hutte, et sous la partie de la couverture qui n’était pas tombée, il avait été peu endommagé par le tems, si ce n’est qu’il avait perdu son lustre, et avait pris une teinte jaunâtre. Les superbes plumes d’autruche qui avaient flotté en ondoyant au-dessus d’un front qu’on ne regarda peut-être jamais sans admiration, pendaient flétries le long des murs mousseux de la cabanne; leur élasticité avait été détruite par leur longue exposition à l’air et à l’humidité, et l’acier poli qui leur avait servi de lien, autrefois aussi brillant que l’œil qu’il ornait, était maintenant couvert de rouille.
Il y avait quelque chose de singulièrement frappant dans le fragile mémorial que j’avais sous les yeux de l’être mystérieux qui avait habité cette solitaire retraite. L’homme peut être assailli et abattu par une complication de maux divers; il peut être la triste victime de passions flétrissantes, et cherchant un frein à leur tumulte perturbateur, s’aller enfouir dans une solitude, pour s’entretenir de leur souvenir, ou déplorer l’effet pernicieux de leur influence, et devenir un ascète que ses semblables ne plaidront ni ne regretteront. Mais qu’une femme, qu’une femme aimable, entrainée par une tendre et douce impulsion, par un sentiment délicat et exquis particulier à son sexe; ou mûe par son profond dévouement à l’objet légitime de l’affection de son âme, renonce aux plaisirs et aux attraits d’un monde qu’elle était destinée à embellir et à recréer, pour s’ensevelir dans une morne solitude, soit dans les murs d’un cloître, pour se préparer à sa transmigration angélique dans le ciel, sa patrie désirée; soit dans l’étroite enceinte d’une humble chaumière, ou dans les tristes cellules d’une sombre prison, pour adoucir par ses soins affectionnés les maux cuisants, ou dissiper par sa présence et ses douces consolations, les chagrins rongeurs, de celui qu’elle chérit uniquement, ou par-dessus tout, dans la vie; qu’une femme, dis-je, se montre, dans ces situations, toute bonté, toute bienveillance, tout amour, nous ne pouvons qu’être profondément et extraordinairement intéressés; car nous contemplons en elle le prototype de ces êtres supérieurs qui chantent éternellement des cantiques de louanges et d’actions de grâces autour du trône de leur créateur.
Je m’étais assis sur un petit tertre, et j’étais absorbé dans des idées comme les précédentes, excitées par la découverte dont je viens de parler, et qui donnèrent graduellement lieu à une suite de conjectures dans lesquelles je me perdais; mais je fus tiré de ma rêverie par une exclamation de mon compagnon, et son perçant coup d’œil me révéla une circonstance dont je ne m’étais pas apperçu: je m’étais assis sur un tombeau.. .. .. ..
Quelle est la personne, ou quelles sont les personnes qui ont habité cette étrange retraite; et quelle était la source de l’harmonie plus que terrestre qui en provenait évidemment; c’est un mystère qui, probablement, ne sera jamais expliqué. Quoiqu’il en soit, le souvenir de cette musique instrumentale, si pleine de sentiment, si enchanteresse, ne s’effacera jamais de ma mémoire. Souvent même depuis, dans mes promenades nocturnes et solitaires, je suis tombé dans une rêverie fantastique et agréable, et me suis imaginé entendre une douce et touchante mélodie, que j’avais de la peine à ne pas croire produite par la Harpe de la Fée, même après qu’averti de mon erreur par le souffle du zéphire, j’avais repris l’usage libre de mes sens égarés.
H.

Les gouvernemens auxquels les peuples ne prennent aucune part, sont toujours prodigues, autant qu’ils manquent ordinairement d’énergie. S’ils en montrent dans quelques occasions, c’est une vigueur passagère, et les efforts qu’ils font alors les épuisent. En général, ils n’ont de force que pour écraser. Les dépenses qu’entrainait le faste de la cour de Louis XV, et celui de ses maîtresses, absorbaient des sommes beaucoup plus considérables que celles qui auraient été nécessaires pour subvenir à la dépense du Canada. Les administrateurs ici dont rien ne pouvait contre-balancer l’autorité dans la colonie, nageaient dans le luxe et fesaient en même temps des fortunes prodigieuses. Celles des plus petits commis dans les bureaux du gouvernement préposés à l’approvisionnent et aux fournitures des troupes et autres objets de cette espèce, étaient un scandale pour les habitans du pays, et surtout pour ses défenseurs, réduits à manger de la chair de cheval. On avait épuisé la campagne de bestiaux: on les enlevait aux cultivateurs; on les payait au taux d’un maximum, fixé d’une manière aussi arbitraire que se fesait tout le reste; à-peu-près comme on l’avait épuisé d’hommes, avec la plus aveugle imprévoyance, au lieu de travailler à leur multiplication, en encourageant l’industrie, l’agriculture et le commerce.
Le respectable Bourglamarque, qui fut depuis gouverneur à la Guadeloupe, homme vertueux et austère dans ses mœurs, alors l’un des généraux des troupes dans le pays, non plus qu’aucun des autres militaires qui commandaient en second, ne pouvait rien pour arrêter le torrent des injustices et la rapacité des gens d’affaires que la France avait lâchés sur ce pays. L’intendant était chargé à la fois des départemens de la justice et de la police et surtout des finances. Bourglamarque ne pouvait que gémir sur ces désordres. N’ayant aucun moyen d’adoucir les privations de l’armée, non plus que des habitans, il voulait au moins les partager. Il faisait servir du cheval sur sa table, tous les jours, et disait à ce sujet, que puisque l’on en nourrissait les soldats, il était juste qu’il en mangeât comme eux.
Le gouvernement français payait ici ses dépenses en billets ou lettres de change sur la France. Ils soutinrent leur crédit jusqu’à la prise de Québec. Mais ces rescriptions s’étaient multipliées dans une proportion vraiment énorme. Après la conquête, elles perdaient beaucoup. La liquidation de ces dettes prit du temps en France. Les déprédations qui s’étaient commises dans ce département, et qui n’étaient inconnues de personne dans la colonie, inspirèrent des craintes à ceux entre les mains desquels ces billets se trouvaient parmi les Canadiens. Ceux-ci avaient d’ailleurs plus ou moins besoin de réaliser dans les circonstances qui suivirent immédiatement la conquête, et ils le firent à tout prix. Eux-seuls aussi supportèrent tout le fardeau de la perte. Elle fut à-peu-près entière, et occasionna dans le pays une ruine universelle.
On pourra se former une idée des dilapidations qui s’étaient commises dans la colonie, par quelques faits que je crois devoir signaler entre une multitude d’autres. Le célèbre Necker, qui n’était encore que simple commis, à l’époque de cet agiotage en France, commença sa fortune en se servant du crédit de son maître, riche financier de ce tems, qui le favorisa dans cette spéculation, pour acheter de ces rescriptions, sur lesquelles il fit un gain de plusieurs millions.
L’excessive richesse du fermier-général Beaujon découlait en partie de la même source. Il avait lui aussi fait acheter de ces rescriptions, sur lesquelles il eut en 1767 un bénéfice de dix-sept à dix-huit millions de francs.
Ce qui fut laissé aux employés du gouvernement de la colonie, qu’on appellait alors publiquement en France comme ici, les Voleurs du Canada, put suffire, après de fortes déductions, pour leur permettre de vivre dans la plus grande opulence.
Remarquons, maintenant que le Canada fut perdu pour la France sous le règne de Louis XV. Il fallait alors, chaque année, tirer du trésor public des millions pour subvenir non seulement aux dépenses des maîtresses en titre du monarque, mais encore à celles du parc aux cerfs. C’est le nom qu’on avait donné à un établissement destiné à fournir journellement à ce Sardanapale moderne, de nouveaux objets pour assouvir ses passions. A la fin de son règne, une femme sortie d’une maison de débauche possédait en entier le cœur du roi, et tenait le premier rang à la cour. Des intriguans se servaient de son crédit pour gouverner la France sous le nom de son amant.
Il est peut-être à propos de remarquer ici, qu’on se fait quelquefois illusion sur l’état des choses en France, pendant le dix-huitième siècle, parce que le tableau des crimes que la révolution a enfantés a pour ainsi dire jetté dans l’ombre l’époque qui l’a précédé. L’horreur qu’ils inspirent remplit l’âme. On perd de vue la véritable cause de ce grand bouleversement. Il fut l’ouvrage de l’immoralité de ceux qui étaient à la tête du gouvernement. Qui peut ignorer les dilapidations des finances, la conduite scandaleuse de tous ceux qui approchaient du trône, presque sans exception, la manière arbitraire dont on établissait et prélevait les impots, l’humiliation de ceux qui n’appartenaient pas aux classes privilégiées? Citons quelques traits pris au hazard, qui me reviennent dans la mémoire. Un des membres d’un corps qui se croyait destiné à appuyer les droits de la nation contre l’autorité royale, soutenait, presqu’encore au moment où la révolution était prête d’éclater, que le peuple français était taillable et corvéable à la volonté de ses maîtres, et c’était dans une assemblée d’hommes revêtus des fonctions les plus augustes, préposés à consacrer les règles de la justice, qu’il tenait ce langage. Sous le règne de Louis XV, les roturiers ne pouvaient que rarement surmonter les difficultés qui s’opposaient à leur entrée comme officiers dans l’armée et dans la marine royale. Ces faveurs étaient réservées à la caste nobiliaire. Sous le règne de Louis XVI lui-même, un règlement proposé par le ministre de la guerre, prescrivait de prouver qu’on avait quatre degrés de noblesse, pour être admis comme officier dans les troupes du roi. Les évêques eux-mêmes étaient à peu près tirés exclusivement des familles nobles. Comme dans l’étendue du royaume, ils étaient presque tous nommés par le roi, en vertu du concordat, c’était la faveur qui les élevait à cette dignité; aussi n’étaient-ils trop souvent que des courtisans. La nomination du célèbre abbé de Beauvais à l’évêché de Sens, fut également l’objet de la surprise et des conversations de la cour et de la ville, parce qu’il était d’une famille bourgeoise, et n’avait pour le recommander que de la piété et du savoir, de grandes vertus et une noble éloquence.—On voyait les talents prostituer l’hommage au vice triomphant.—Bernis et Voltaire encensaient également la marquise de Pompadour, dans leurs poësies.
Le maréchal de Saxe avait engagé une jeune personne pour entrer dans l’espèce de sérail qu’il se formait toujours, quand il laissait Paris pour entrer en campagne. Soit amour, soit remords, elle s’échappe de la maison où l’on tenait ces victimes du libertinage du général, en attendant le départ, et alla se marier à un jeune homme qui était pour elle un parti sortable. Le maréchal obtint une lettre de cachet, au moyen de laquelle il put l’enlever à son mari. Un parti de grenadiers fut chargé de cette expédition infamante. Si quelque chose peut peindre la corruption des idées et l’absence de tout principe de morale publique, à cette époque, c’est le sang froid, le ton léger de l’écrivain qui rapporte ce trait, comme une anecdote badine, au lieu de s’élèver contre cet acte de lâcheté.
Postérieurement à cette dernière époque, il était devenu du bon ton de ne représenter plus les prêtres d’un côté que comme des cagots et des hypocrites, et de l’autre comme des ennemis de l’autorité, ou comme des perturbateurs du repos de l’état. Un prêtre de province fut traduit en justice, pour quelques propos blâmables sans doute; mais qui, après tout, ne pouvaient être considérés que comme un de ces délits qu’une punition modérée pouvait réprimer, comme elle aurait suffi pour prévenir la récidive. Il fut pendu!
Combien de traits tout aussi odieux je pourrais ajouter à ceux que je viens de signaler! Le gouvernement qui pouvait commettre ou autoriser des excès ou des crimes de ce genre, devait nécessairement succomber sous le poids de ses propres iniquités.—Sa chûte était inévitable. Il s’affaissa et fut englouti dans l’abîme qu’il avait creusé.
Au commencement du règne de Louis XV, le Régent Duc d’Orléans, digne au moins, par ses débauches, d’être la tige de ce trop célèbre Philippe Egalité, que l’on a vu figurer parmi ceux qui votèrent la mort de Louis XVI, avait tout ensemble ruiné la France par ses prodigalités suivies d’une banqueroute honteuse, et l’avait démoralisée par ses exemples.
Louis XIV, avant lui, avait assis l’adultère sur le trône; il avait fait servir le pouvoir que les rois de France exerçaient alors sans contrôle, et prostitué l’autorité des lois, qui émanaient de sa seule autorité, à imprimer le sceau de la légitimité aux fruits de son double adultère avec la duchesse de Montespan. Il avait ensuite marié les enfans de ses criminelles amours avec les membres de sa propre famille, et il avait fallu les enrichir à même les revenus de l’état.—Ce n’était pas assez d’une maîtresse enlevée à son époux, et qui nageait dans le faste aux dépens du trésor public, il fallait puiser à la même source de quoi satisfaire les goûts passagers du voluptueux monarque. Une de celles auxquelles il s’attacha, dans le même temps que l’empire de la duchesse de Montespan se soutenait encore, Mademoiselle de Fontanges, dépensait cent mille écus par mois, et fut pendant le cours d’une faveur, que la mort termina, la dispensatrice de toutes les grâces. Le roi la fit duchesse. Elle donna le ton à toutes les modes, et son nom resta attaché à certaine manière d’attacher sa coîffe avec un ruban, fruit d’un hazard, et qui plus tard devint dans le Canada une marque de distinction affectée aux dames qui appartenaient aux familles nobles.
Le monarque ne borna pas sa dépense à payer des plaisirs de ce genre: les palais somptueux qu’il fit élever sont encore aujourd’hui un monument de la vanité, de même que de la prodigalité de celui qui, sur la fin de son règne, se trouvait hors d’état de solder ses armées, afin de repousser l’Europe liguée contre lui, pour se venger de l’abus qu’il avait fait de la puissance et des richesses d’une nation qu’il avait foulée aux pieds, au lieu de la gouverner d’après des principes de justice, et d’assurer sa prospérité par la sagesse de son administration.
Voilà des faits qui peuvent servir de termes de comparaison pour juger de quel côté on doit pencher dans la discussion des règles auxquelles l’emploi des deniers publics doit être assujetti, même indépendamment des principes de notre gouvernement, et du droit positif, comme du droit commun constitutionnel.
Avant la conquête, on aurait sans doute regardé comme le plus grand des malheurs qui pût arriver à la colonie, de voir les fonctionnaires publics assujettis au contrôle du peuple, dans la personne de ses représentants, pour le règlement de leurs salaires. Quelle idée! quel état de dégradation pour ces dignitaires, que de se voir à la discrétion de bourgeois hargneux, dont la mauvaise humeur, les vues courtes, la lésine surtout, la sordide économie, auraient, aux yeux de ces enfans de la faveur, paralisé l’administration, auraient mis la province dans un danger inévitable de succomber, à tout moment, sous les attaques du dehors, l’auraient minée au dedans, et auraient précipité sa ruine.
En France, à la même époque, c’eût été un crime de lèze-majesté que d’élever la voix contre la dilapidation des deniers publics, et de susciter le plus léger doute sur le droit du roi d’établir des impots et de disposer de leur produit à son gré. Le citoyen qui aurait ôsé mettre au jour des idées de cette nature aurait payé sa témérité de la perte de sa liberté, ou même de sa vie. Ce n’est pas tout; des écrivains courtisans auraient fait leur cour à ceux qui entouraient le trône, et qui laissaient par fois tomber quelques unes des faveurs du monarque sur ceux qui encensaient sa puissance et la divinisaient, et auraient employé des talents dignes d’une meilleure cause à flétrir le nom de ce vertueux citoyen, à transmettre à la postérité son nom marqué du sceau de l’infamie. Malheur à qui eût ôsé prendre en mains sa défense! Il aurait partagé ses malheurs. Celui qui avait le pouvoir en mains avait aussi le privilège d’enfermer les victimes de son ressentiment, et de les immoler à sa vengeance, comme il pouvait sacrifier le peuple à son ambition. Enfin il pouvait étouffer la voix de ceux qui auraient ôsé tenter de repousser les traits de la calomnie. Telle est la marche du despotisme, ne pouvant convaincre, il écrase; incapable de réfuter ses adversaires, il les enferme dans des cachots, ou les proscrit. C’est un acte de clémence de sa part que de les laisser vivre dans l’opprobre. C’est pourtant l’espèce de gouvernement qu’une foule d’hommes décorent du nom de paternel, qu’ils appellent le plus parfait des gouvernemens! Quelque chose de plus étonnant encore, c’est celui que des hommes, venus de l’autre côté de l’océan, ont désiré, qu’ils ont demandé à grands cris, qu’ils auraient voulu établir sur les ruines de notre constitution! Et ce sont ces mêmes hommes qui, pendant un temps, peignaient les Canadiens comme indignes de participer à un gouvernement libre, parce qu’ils étaient, disait-on, incapables d’en apprécier les avantages!
Avant la conquête du Canada, le peuple anglais avec une chambre de communes, luttait sans cesse avec ceux qui avaient l’autorisé en mains, pour les forcer à mettre de l’économie dans toutes les dépenses relatives à l’administration. Dans les colonies qui nous avoisinaient, de misérables bourgeois qui composaient les assemblées, étaient constamment aux prises avec leurs gouverneurs, relativement à l’emploi du revenu public, sur lequel ils avaient une jurisdiction immédiate, et qui ne leur était pas contestée. Mais tous se réunissaient en Angleterre pour fournir aux dépenses des armemens qui anéantissaient en Europe la marine et le commerce de la France; on en faisait autant dans le nouveau monde, pour faire tomber successivement toutes les colonies. Et la dernière de celles que la France possédait dans cette partie de l’Amérique du Nord, lui fut enfin arrachée en 1759. Il est aisé de voir dans ces évènemens la différence des fruits que la liberté ou le despotisme font éclore.

Je m’étonne que dans un pays comme le nôtre, où les abeilles peuvent se multiplier avec tant de facilité, où le produit de leurs travaux est si abondant, on ne s’empresse pas d’encourager parmi ses habitans une branche d’industrie si facile à saisir. On ne saurait avoir trop d’obligations à quelques uns de nos citoyens, surtout à Montréal, d’avoir travaillé à leur multiplication, et à en répandre dans les campagnes des environs, autant qu’il a été en leur pouvoir.[1] L’éducation des abeilles serait une ressource assurée pour une foule de pauvres familles. On peut dire, sans exagération, qu’elle pourrait diminuer de beaucoup les privations et les maux de l’indigence, en même tems qu’elle ajouterait au plaisir de ceux qui vivent dans l’aisance.
Une seule ruche produit jusqu’à quatre et cinq essaims dans le cours d’un été. Ceux-ci même souvent en produisent d’autres dans la même saison. Chacune de ces ruches est ordinairement pleine en automne, à moins que l’essaim ne soit venu absolument trop tard, ce qui est d’ailleurs à prévenir. Chaque ruche peut donner au moins l’une dans l’autre de 15 à 30 livres de miel, et quelquefois davantage, avec une livre ou deux de cire dans la même proportion. Supposons qu’un habitant industrieux eût laissé multiplier deux ou trois ruches pendant trois ans; il aurait au moins 40 ruches au printems de la quatrième année, et même davantage.[2] En supposant que cette année, elles ne donnassent que deux essaims chacune, au lieu de quatre qu’elles peuvent ordinairement fournir, il est clair que le propriétaire en gardant pour l’année suivante encore le même nombre de ruches, pourrait, en automne, vendre le miel et la cire de 80 ruches, produit des 40 du printems, sans diminuer en rien son capital. Supposons seulement 15 livres de miel par ruche;[3] supposons même qu’elles n’eussent produit que dix livres de miel chacune; ce qui est à-peu-près le terme moyen, au plus la moitié du produit ordinaire, il pourrait vendre 800 livres de miel en automne et environ 80 livres de cire. Le miel se vend de 20 à 30 sols la livre, la cire brute de trois à quatre francs au moins; quand on la clarifie, opération très-facile à faire, six à sept francs; quand ils se vendraient la moitié de ce prix, ce serait encore un gain de grande importance. Ce calcul qui est un des plus modéré, et qui est absolument juste, prouve qu’aucune branche d’économie rurale ne mérite plus que celle-là d’être encouragée parmi nous.
Dans les campagnes éloignées des villes, elle mériterait d’autant plus l’attention des personnes éclairées et qui désirent le bien, que les plus pauvres familles, si on pouvait leur procurer des abeilles, pourraient les élever sans frais. Leur éducation d’ailleurs ne demande que des soins et n’exige aucuns travaux durs. Les enfans et les femmes surtout pourraient seuls se charger de les conduire, sans déranger en rien les travaux de la culture, sans compter que le transport et le débit du produit en seraient extrêmement faciles et très peu dispendieux.
Les curés, les seigneurs, les marchands, enfin toutes les personnes aisées et instruites dans les campagnes, ne sauraient mieux employer leurs momens de loisirs, qu’en travaillant à répandre le goût de cette branche d’industrie dans les paroisses où ils résident. Un petit ouvrage clair et concis sur cette matière pourrait produire un grand bien et en accélérer les progrès. Les bons citoyens s’empresseraient sans doute d’accueillir et d’encourager la publication d’un ouvrage de cette nature. C’est en commençant par de pareils moyens faciles à saisir qu’on accoutumera les habitans de ce pays à voir de nouvelles sources de profits dans un genre de travaux différents de ceux auxquels ils sont accoutumés dès l’enfance. Il est vrai qu’il y a loin de là à d’autres genres de produits plus importants pour notre pays et pour la mère-patrie. Mais c’est en faisant envisager au peuple de nouvelles sources de gains faciles à suivre, qu’on peut espérer de leur ouvrir les yeux, et de leur en faire adopter d’autres plus difficiles à saisir, sur lesquels je reviendrai peut-être quelqu’un de ces jours.
UN VOYAGEUR.
Depuis que ce morceau a été écrit, les ruches se sont multipliées dans le district de Montréal. Il s’en trouve dans plusieurs des paroisses de l’île de ce nom: on en voit dans Longueil et dans Boucherville, et l’on dit qu’il y en a aussi dans plusieurs autres endroits.—Nous citons ceux-ci en particulier, parce que nous en avons eu des renseignemens certains sur le sujet. Nous devons observer en outre, que ce pays, malgré la rigueur de son climat, n’est pas défavorable aux abeilles. On en trouve maintenant très communément dans les bois, où elles se multiplient journellement, comme dans quelques pays de l’Europe situés plus au nord que la partie cultivée du Bas-Canada la plus septentrionale.
Il est sans doute à désirer que les vues philanthropiques de l’auteur du petit écrit que nous venons de transcrire se réalisent. Que de moyens d’étendre la sphère de leur activité pour les cultivateurs de ce pays, si les lumières éclairaient leur industrie et guidaient leur travail! Il est pourtant vrai de dire, qu’en dépit des obstacles, les Canadiens ont fait, depuis quelques années, des progrès considérables sous tous ces rapports, et qu’ils ne peuvent qu’avancer rapidement dans la carrière qu’ils commencent à parcourir. L’impulsion est maintenant donnée, et le pays la suivra indubitablement.
|
Il y a tel citoyen à Montréal qui a eu la générosité d’en envoyer et d’en donner gratis à plusieurs habitans, pour le seul plaisir de se rendre utile, et de faire du bien. |
|
C’est ce qui a été presque littéralement exécuté par la personne que je viens de citer. |
|
Un de mes amis a dernièrement fait passer les abeilles d’une vieille ruche dans une nouvelle et a tiré le miel de l’ancienne vers le milieu de Juillet, sans perdre les abeilles. Il a eu près de cinquante livres de miel et deux de cire. |

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, c’est-à-dire, celui qui représentait mieux le démon dans sa malice, dans ses embûches et ensuite dans son supplice.
Le serpent a été souvent l’objet de nos observations, et si nous ôsons le dire, nous avons cru reconnaître en lui cet esprit pernicieux et cette subtilité que lui attribue l’écriture. Tout est mystérieux, caché, étonnant, dans cet incompréhensible reptile. Ses mouvemens diffèrent de ceux de tous les autres animaux; on ne saurait dire où gît le principe de son déplacement, car il n’a ni nageoires, ni pieds, ni ailes, et cependant il fuit comme une ombre, il s’évanouit magiquement; il reparaît, disparaît encore, semblable à une petite fumée d’azur, ou aux éclairs d’un glaive dans les ténèbres. Tantôt il se forme en cercle, et darde une langue de feu; tantôt, debout sur l’extrémité de sa queue, il marche dans une attitude perpendiculaire, comme par enchantement. Il se jette en orbe, monte et s’abaisse en spirale, roule ses anneaux comme une onde, circule sur les branches des arbres, glisse sous l’herbe des prairies, ou sur la surface des eaux. Ses couleurs sont aussi peu déterminées que sa marche; elles changent à tous les aspects de la lumière, et comme ses mouvemens, elles ont le faux brillant et les variétés trompeuses de la séduction.
Il sait, ainsi qu’un homme souillé de meurtre, jetter à l’écart sa robe tachée de sang. Il sommeille des mois entiers, fréquente les tombeaux, habite des lieux inconnus, compose des poisons qui glacent, brûlent ou tachent le corps de sa victime des couleurs dont il est lui-même marqué. Là, il lève deux têtes menaçantes; ici, il fait entendre une sonnette; il siffle comme un aigle de montagne, il mugit comme un taureau.
A l’approche de son ennemi, le superbe reptile se forme en spirale, applatit sa tête, enfle ses joues, contracte ses lèvres, découvre ses dents empoisonnées et sa gueule sanglante; sa double langue brandit comme deux flammes, ses yeux sont deux charbons ardens; son corps gonflé de rage s’abaisse et s’élève comme les soufflets d’une forge, sa peau dilatée devient terne et écailleuse, et sa queue, dont il sort un bruit sinistre, oscille avec tant de rapidité, qu’elle ressemble à une légère vapeur.
Il s’associe naturellement à toutes les idées morales et religieuses, comme par une suite de l’influence qu’il eut sur nos destinées: objet d’horreur ou d’adoration, les hommes ont pour lui une haine implacable ou tombent devant son génie; le mensonge l’appelle, la prudence le réclame, l’envie le porte dans son cœur, et l’éloquence à son caducée; aux enfers, il arme les fouets des furies; au ciel, l’éternité en fait son usage; il possède encore l’art de séduire l’inocence; ses regards enchantent les oiseaux dans les airs, et sous la fougère de la crèche, la brebis lui abandonne son lait. Mais il se laisse lui-même charmer par de doux sons, et pour le dompter, le berger n’a besoin que de sa flûte.
In Serpentem.
Callidior serpens cunctis animalibus; artes
Dæmonis, insidias, tormentaque deindè figurans:
Reptile mirificum, ignotum, subtile, nocivum:
Sic scriptura refert, sic experientia novit.
Mysterium quoddam serpens. Quis non stupeat? Quis
Explicet, undè movetur? ei haud pes, penna nec ala:
At levis umbra fugit magicè; micat ensis ut ardens
In tenebris; evanescit, rursusque videtur
Cœruleus vapor. In varios se colligit orbes,
Flammantemque vibrat linguam; nunc se erigit; undœ
Nunc simulans gygros, sinuosa volumina fingit;
Circuit arboreas frondes, sub pratorum effluit herbis,
Intactas aut radit aquas. Variare colorem,
Ut variat gressus, doctus seducere, novit;
Novit et exuere, ut fur, sparsam sanguine pellem.
Incolit aut tumulos, incognita vel loca, menses
Longos sopitus: componit toxica, prœdam
Frigore quæ perimant, æstuve, coloreve tingant
Ipse quo inficitur; capita hîc minitantia bina
Erigit, arguto hîc tinnit crepitaculo; acutè
Sibilat hîc aquila ut montana, hîc mugit et ut bos.
Torquet se in spiras; hunc si lassaverit hostis,
Inflatisque genis distindit tempora; labra
Contrahit, infectos et dentes, osque cruentum
Pandit; lingua duplex, duplex ut flamma vibratur.
Ardescunt oculi, pectus par follibus, irâ,
Dejicitur surgitque; cutis squammosa, subatra,
Se expandit, celerique sonant crepitacula motu.
Notio serpentis pietati haud dissona. Tantùm
Humani generis fatis influxit! . . . . abhorrent,
Sive colunt homines: fallit prudensve docebit.
Invidus hunc in corde gerit, caduceo et Hermes.
Anguibus armantur Furiarum verbera in orco.
Circulus anguineus cœlo ævi emblema perennis.
Attrahit aspectu volucres ex aere serpens:
Sub filice huic prœsepis ovis seducta relinquit
Lac dulce agnorum; incantatur musicâ et ipse.

On demande, pour la Bibliothèque Canadienne, des renseignemens sur les établissemens qui se forment dans le pays, sur les progrès de l’industrie, de l’éducation, et autres objets de cette nature. En voici quelques uns qui pourront, je me flatte, plaire à ceux qui désirent le succès d’une publication à laquelle tous les amis du pays doivent prendre un vif intérêt.
Le village de St-Denis établi sur les bords riants de la Rivière Richelieu au sud, à peu près à mi distance entre Sorel et Chambly, mérite d’être remarqué par sa situation agréable et par ses établissemens. On y voit plusieurs maisons qui ne dépareraient pas nos capitales. L’Église est une de celles qui sont bâties avec le plus de goût dans la province. Elle a deux tours. Elle ne manque que d’être un peu plus longue. Ce n’est pas la faute de feu Mr. Cherrier, alors curé de cette paroisse, qui la fit bâtir, il y a environ trente ans. Il aurait voulu lui donner des proportions exactes. L’Évêque n’ôsa lui permettre de la bâtir de la longueur qu’il désirait, parce qu’il craignait que cela n’entrainât de trop grandes dépenses. Il semble que l’évêque n’aurait pas dû être arrêté par cette considération, d’autant qu’une très grande proportion de ces dépenses a été supportée par le curé seul.—Malgré ce défaut, cette église est encore un des plus beaux édifices que l’on voie dans le pays, et a été admiré par quelques uns des étrangers qui ont eu occasion de voyager le long de cette belle rivière. L’architecture de l’intérieur est d’un goût simple et pur. Un rang de colonnes d’ordre ionique soutient une galerie qui règne dans toute l’étendue de la nef. Au-dessus de celui-ci se trouve un autre rang de colonnes d’ordre corinthien, qui supporte la voute. Tout cela est seulement peint en blanc, sans dorure, et fait un très bon effet. Six tableaux, sur neuf qui se trouvent dans cette église, et qui font partie de ceux dont nous avons obligation à Mr. Desjardins, qui les a envoyés dans ce pays, depuis son retour en France, méritent l’attention des connaisseurs. Celui du maître-autel, peint dans le pays, leur est de beaucoup inférieur; mais la tête de St-Denis, sous le nom duquel l’église, est dédiée, est fort belle. Pour deux autres tableaux, qui sont dans les trumeaux des chapelles, ils devraient en être bannis.
Une excellente école pour les filles, tenue par les respectables Sœurs de la Congrégation, est près de l’église. Cet excellent établissement est encore dû aux soins, et en très grande partie, à la générosité du curé Cherrier, dont on vient de parler, qui avait bâti cet édifice, avant d’entreprendre la bâtisse de l’église actuelle. Encouragés par les exhortations et l’exemple de leur digne pasteur, les habitans y contribuèrent par des corvées, et en charoyant ou fournissant des bois, de la pierre et autres matériaux. Environ soixante jeunes filles de la paroisse et des paroisses voisinnes apprennent, entre autres, là les principes de la religion, à bien lire et bien écrire, l’orthographe, l’arithmétique, et à faire, des ouvrages propres à leur sexe.
Ce même curé avait aussi commencé à former une école pour les garçons; mais il n’a pas vécu assez longtemps pour consolider cet établissement. Pourtant le curé actuel, Mr. Bedard, a une maison et un maître pour y enseigner à lire et écrire. Mais cette école n’est pas encore dans un état très florissant. C’est pourtant déjà un grand bien, un noyau pour quelque chose de mieux.—J’ignore pourquoi on ne travaille pas plus généralement à profiter des moyens que la loi passée, il y a un peu plus de deux ans, pour encourager l’éducation dans les paroisses à la campagne, offre maintenant pour étendre les avantages de l’instruction à un plus grand nombre d’enfans. Cela viendra sans doute. N’y aurait-il pas un peu d’apathie dans ceux qui pourraient avoir de l’influence sur les paroissiens et sur les marguilliers, qui, en vertu de cette loi, peuvent employer le quart du revenu de la fabrique au soutien d’une ou plusieurs écoles?
On trouve dans ce village une belle manufacture de chapeaux, sur un grand plan pour ce pays. Elle appartient à Mr. Gazaille dit St-Germain. C’est une maison d’à peu près quatre-vingt pieds de front, à deux étages, pour m’exprimer suivant l’usage du pays, c’est-à-dire à un étage au-dessus du rez de chaussée, qui lui-même est fort élevé. C’est, après l’église, le plus grand édifice de l’endroit. Il est de fort bonne apparence. Le propriétaire emploie au moins quinze ouvriers, sans compter les personnes de sa propre famille, et outre un grand nombre d’autres hors de son attelier, dont plusieurs sont logés dans des maisons qui lui appartiennent dans le voisinage.
Il fournit une grande quantité de chapeaux à la ville de Montréal, et aux marchands d’un grand nombre de paroisses du district. Je crois même qu’il en envoie dans d’autres endroits de la province. Le tout est conduit avec beaucoup d’ordre. Je voudrais pouvoir dire que Mr. St-Germain, imitant le restaurateur de la sculpture parmi nous, feu Mr. Quevillon, fait donner à ses apprentifs des leçons de lecture, d’écriture et d’arithmétique. Je l’ignore. Je souhaite qu’il le fasse. Ce serait une obligation de plus que lui aurait la paroisse où il exerce son industrie, d’une manière si digne d’éloges, et on peut ajouter, si utile à son pays.
On ne pourrait, en parlant de St-Denis, omettre le nom d’un Mr. Bourdages, fils du représentant de ce nom. Ce jeune homme a de grands talens pour la méchanique. Il s’était appliqué à l’horlogerie avec succès, sans, je crois, avoir jamais été dans une boutique. Depuis, il a exercé son industrie dans un genre plus utile aux habitans des campagnes. Il a bâti un moulin à carder que des chevaux font tourner. Il en a fait, dit-on, plusieurs autres, en différens endroits, même jusque dans le district de Québec. Il a trouvé dans son propre génie toutes les ressources nécessaires pour exécuter ces ouvrages. Si je suis bien informé, il a été seul son propre maître.
Le sol de St-Denis est assez généralement un argile gras, et il s’y trouve plusieurs potiers. Ils fournissent une grande partie du district des produits de leurs atteliers. Il serait à souhaiter que quelques personnes éclairées pussent les aider de leurs lumières, pour les mettre en état de préparer leur terre avec plus de soin, et mettre plus de perfection dans leurs ouvrages, tant pour la forme que pour la solidité et le vernis des vases. Un homme instruit, avec des capitaux, pourrait peut être opérer cette révolution heureuse.
Il est, entre autres, à St-Denis, une chose que l’on aimerait à rencontrer plus souvent dans ce pays; ce sont des arbres auprès de l’église et en différents endroits, dans le village et dans les environs. On y voit des ormes superbes, arbre qu’on ne saurait trop multiplier ici, à cause de son élévation, de sa beauté et de l’abondance de son feuillage; et qu’on peut appeller, avec raison, le roi des forêts du Bas-Canada.
D.
———————
Montréal, Juillet 1826.
Vous savez, Mr. Bibaud, ce que c’est qu’une Saberdache: son emploi, son utilité vous sont aussi connus. Eh bien, j’en ai une, à deux compartimens, bien remplie. Elle est d’un de vos compatriotes et des miens, qui a vu du service et du pays. Sa saberdache l’accompagnait partout; ergo.. .. .—Mais de grâce, monsieur, abrégez, s’il vous plaît. De quoi est-elle remplie, cette saberdache? et où voulez-vous en venir, avec tout ce préambule?—Eh bien, soit. J’aimerais à causer pourtant, et à vous dire tout ce que je sais, (et que vous ne saurez pas, s’il faut abréger,) de cette fameuse saberdache, avant d’en venir à ce qu’elle contient: vous y perdrez, je vous jure; mais enfin.. ..—Enfin, Mr. l’imprimeur me presse; vîte, s’il vous plaît.—Un peu moins de vivacité, de grâce, Mr. B—, ou vous ne mettrez pas la main dans ma saberdache: et pourtant, quelle mine à exploiter que cette saberdache, pour votre Bibliothèque Canadienne! Vous y trouverez, d’un côté, des vers.. .. bons, quoiqu’ils ne soient pas de moi; de la prose—comme je n’en écrirais pas de meilleure; bref, une correspondance inédite (que cette chère saberdache tient sous boucle,) entre Canadiens et Européens; et, de l’autre côté, divers essais et lettres encore vierges, mêlés à des anecdotes bien connues; des extraits de bouquins caducs ou entièrement oubliés; des in-promptu faits à loisir, et qui valent bien.. .. ce qu’ils valent: ce n’est pas trop en dire, au moins. Ah! vous souriez maintenant: Eh bien, prenez donc ma saberdache; elle est à votre disposition pleine et entière. Vous y trouverez de tout, Mr. Bibaud; mais rappellez-vous bien ce vers de Delisle,
On lit tout dans Racine, on choisit dans Voltaire, et n’allez pas inconsidérément publier toute ma saberdache; car il y a dedans, par-ci par-là, du grivois et de l’ennuyant. Certes! prenez bien garde; soyez sobre à cet égard, et choisissez bien.—Votre serviteur,
P. S. J’oubliais une chose essentielle: depuis le legs à moi fait par mon ami défunt de sa saberdache et de son contenu, j’ai continué moi-même, jusqu’à ce jour, de la grossir de copieux larcins littéraires, qui ne m’ont couté que le prix d’une paire de ciseaux, et le soin de les faire jouer: je l’ai aussi enrichie de quelques unes de mes productions, qui ne sont pas à mépriser.. . hem! et je me propose de le faire encore de tems en tems. Oh! à propos, vous trouverez toutes les pièces de la double collection—timbrées et signées, et toutes celles inédites qui ne seront pas du cru du pays, marquées d’un astérisque, ainsi—(*). Mais voyons.
Mr. Blondeau. A une escarmouche qu’il y eut, près de Montréal, dans l’automne de 1775, Mr. Blondeau ayant fait un prisonnier américain, un Ecossais de la ville le pria de le lui confier, pour l’y conduire; “De tout mon cœur,” dit le brave sexagénaire, “cela fera que je pourrai prendre un autre de ces Yankés, pendant que vous conduirez celui-ci en lieu de sureté.”
Le Capitaine de milice Beauchamp. Un Mr. Hazen, officier à la demi solde anglaise, et résidant à Montréal en 1775, avait quitté la ville, à cette époque, et était allé prendre du service chez les rebelles. Il fut pris, les armes à la main, près de St-Jean, par un capitaine de la milice canadienne, dans un retranchement américain, enfoncé à la bayonnette, par un parti de Canadiens, commandé par Mr. de Belestre.—“Comment, c’est vous, Mr. Hazen! Eh! que faites-vous ici?” lui demande le capitaine Beauchamp, tout étonné de le trouver là: Hazen confus, tâchait de se justifier du mieux qu’il lui était possible, et faisait de grandes protestations de loyauté.—“Oui, oui,” interrompit le capitaine, en se saisissant de lui, “nous n’avons pas de peine à vous croire, mais au bout du compte, voila ce que c’est, monsieur, que de se trouver en mauvaise compagnie! Allons, marchez.”
Amour fraternel. Il est arrivé en 1808, à Beauport, près Québec, un accident qui prouve que l’amour fraternel a ses héros dans tous les âges.
Une petite fille, âgée de 3 ans, tomba dans un étang d’environ 8 pieds de profondeur, à la vue de deux de ses frères, âgés l’un de 6 ans, et l’autre de 7. Sans envisager le danger, ils se jettèrent tous deux à l’eau, pour sauver leur petite sœur; mais ne pouvant la retirer, ils crièrent au secours; et leur père, qui travaillait à une petite distance, étant accouru, avec trois autres personnes, ils parvinrent à retirer l’enfant, 5 à 6 minutes après qu’elle y fut tombée. Elle ne donnait aucun signe de vie; mais par les soins des personnes présentes, elle fut retirée des portes du tombeau.
Compliment d’un Iroquois. Un officier d’un mérite rare par ses talens militaires, &c. mais d’une figure petite et malfaite, ayant été nommé Gouverneur du Canada, les Iroquois lui envoyèrent des députés, pour renouveller leur alliance avec les Français. Arrivés à Québec, ils furent introduits chez le gouverneur. Le chef de l’ambassade avait préparé un discours, dans lequel il employait tout ce que sa langue avait de plus riche et de plus pompeux, pour faire l’éloge de la force du corps, de la hauteur de la taille, et de la bonne mine du général, qualités que ces sauvages estiment de préférence. Surpris de voir tout autre chose que ce qu’il avait imaginé, il sentit que sa harangue ne câdrait point au personnage. Sans se déconcerter, “il faut que tu aies une grande âme, lui dit-il, puisque le grand roi des Français t’envoie ici avec un si petit corps.”
Lettre d’un Gascon à son fils. Je viens de recevoir votre lettre, dans laquelle vous me souhaitez la bonne année, ce qui est bien; et où vous me demandez de l’argent, ce qui est mal. Si l’on pouvait envoyer dans une lettre cent coups de bâton tournois, vous les recevriez avec la présente; car vous êtes un fripon, et je suis votre père.
Foulignac.
Aphorisme médical. Hippocrate a dit: Ars longa, vita brevis: Pétrarque a ajouté: Vitam medici dùm brevem dixerunt, brevissimam effecerunt.
Quel homme! Quel homme! Le 14 Novembre 1724, on présenta au roi d’Angleterre, un fermier du comté de Lincoln, qui pesait 580 livres, avait 17 pieds de circonférence, et 6 pieds 4 pouces de haut. Il était âgé de 28 ans, et avait 7 enfans. Il mangeait 16 à 18 livres de bœuf par jour. Il baisa la main du roi, qui voulut bien le dispenser de se mettre à genoux, parce qu’il n’aurait pu se relever.
Extrait d’une lettre de Mr. J. S. R. à Mr. J. D. M. Montréal, 1er. Février 1814.
.. .. .. . Mais mon domestique ne se borne pas là.—Finfin, qui salue fort respectueusement, qui fait le mort, qui court si bien après les chats, qui saute si bien aux jambes du monde sans les mordre, qui fait tant de bruit et si peu de mal;—Azor, gros et gras à plein cuir, qui présente si bien sa patte blanche et luisante, qui fait si bien la belle, et se traîne si humblement à vos pieds, pour demander des caresses; Fidèle, qui remue si joyeusement la queue, à la venue d’un ami en visite, dont le pelage de soie est si doux au toucher;—Lion, l’énorme Lion, au pas lourd et pesant, au regard mâle, mais obligeant et hospitalier.. .. .. . ces quatre pauvres créatures.. .. . vous le dirai-je? Elles ne vous connaissent pourtant pas, et néanmoins, (tel maître, tels valets,) elles désirent vous être introduites. Vous en offenserez-vous? Oh! vous ne le sauriez faire, si vous voyiez avec quelle gentillesse Finfin vous fait la revérence! avec quelle bonne grâce Azor, d’aplomb sur ses pays-bas, vous présente sa patte pommelée! Si vous voyiez le charmant petit Fidèle se tortillant en tous sens, agitant vivement sa belle queue, grattant ma chaise à s’en user les ongles; et le fier Lion debout devant moi, avec toute la gravité d’un pédagogue et le flegme d’un Hollandais, qui me dit à sa manière: “Et moi aussi, je salue l’ami de mon maître.”—Allons vite, Apollon, une satire, une épigramme, ou pour le moins, un mot pour rire; n’épargnons pas le téméraire; quos ego!
Dormez bien; faites de jolis vers; et demain, revenu à des sentimens plus humains, calme, tranquille, le front déridé, le sourcil haut, le cœur dans la main, faites vos civilités à mes quatre bons amis, et les remerciez de leurs honnêtetés. Bon soir donc. Tout à vous.
J. S. R.
(La Réponse au Numéro prochain.)

C’est à Chippawa même que ce grand spectacle commence.[1] Le fleuve, qui depuis le fort Erié s’est toujours étendu, est large en cet endroit de plus de trois milles; mais il se resserre promptement; la rapidité de son cours, déjà considérable, redouble encore, et par la grande inclinaison du terrain sur lequel il coule, et par le rétrécissement de son lit. Bientôt la nature de ce lit change; c’est un fond de roc, dont les débris amoncelés ne présentent des obstacles à ces eaux impétueuses que pour en augmenter la violence. Après un pays presque plat, une chaine de rocs très blancs s’élève ici aux deux côtés du fleuve, réduit à la largeur d’un mille; ce sont les monts Alléganys qui ont, pour arriver à ce point, traversé tout le continent de l’Amérique, depuis la Floride. Le fleuve St-Laurent, ici nommé rivière Niagara, resserré par les rochers de sa droite, se divise; une branche suit les bords de ces rochers, dont la projection la jette elle-même fort en avant; l’autre, et c’est la plus considérable, séparée de la première par une petite île, se jette brusquement sur la gauche, s’y fait, au milieu des pierres, une espèce de bassin, qu’elle remplit de ses tourbillons, de son écume et de son bruit; enfin arrêtée par les nouveaux rochers qu’elle trouve à gauche, elle change son cours plus brusquement encore, à angle droit, pour se précipiter en même tems que la branche de droite, de 160 pieds de hauteur, par-dessus une table de rochers presque demi-circulaire, applanie sans doute par la violence de cette immense masse d’eau, qui roule depuis la naissance du monde.
Là, elle tombe en formant une nappe presqu’égale dans toute son étendue, et dont l’uniformité n’est interrompue que par l’île qui, séparant les deux branches, reste inébranlable sur son roc, et comme suspendue entre ces deux torrens, qui versent à la fois dans cet énorme gouffre les eaux des lacs Erié, Michigan, St.-Clair, Huron, Supérieur, et celles des rivières nombreuses qui alimentent ces espèces de mers, et fournissent sans relâche à leur immense consommation.
Les eaux des deux cascades tombent à pic sur les rocs; leur couleur en tombant, souvent d’un vert foncé, souvent d’un blanc écumeux, quelquefois absolument limpide, reçoit mille modifications de la manière dont elles sont frappées par le soleil, de l’heure du jour, de l’état de l’atmosphère, de la force des vents. Précipitée sur les rocs, une partie des eaux s’élève en une vapeur épaisse qui surpasse souvent de beaucoup la hauteur de leur chûte, et se mêle alors avec les nuages. Les autres, se brisant sur des monceaux de rochers, sont dans une continuelle agitation; longtems en écume, longtems en tourbillon, elles jettent contre le rivage des troncs, des bateaux, des arbres entiers, des débris de toutes les espèces, qu’elles ont reçus ou entraînés dans leur cours prolongé. Le lit du fleuve, maintenu entre les deux chaînes de montagnes d’un roc vif, qui continuent assez loin au-dessous, est encore plus resserré après la chûte, comme si une partie de ce fleuve immense était évanouie dans cette chûte, ou engloutie dans les entrailles de la terre; le bruit, l’agitation, le cours irrégulier, les rapides s’en prolongent 7 à 8 milles plus loin; et ce n’est qu’à Queenstown, distant de 9 milles de la chûte, que le courant ayant repris plus de largeur et de calme, peut être passé avec sécurité.
J’ai descendu jusqu’au bas de cette chûte; les abords en sont difficiles; des descentes à pic, des échelles pratiquées dans les arbres, des pierres roulantes, des rocs menaçants, et qui par les débris qui couvrent la terre, avertissent les voyageurs du danger auquel ils s’exposent, aucun appui pour se tenir que des arbres morts prêts à rester dans la main de l’imprudent qui oserait y prendre confiance, tout y semble fait pour inspirer l’effroi. Mais la curiosité a sa folie, comme toutes les autres passions, et elle en est une véritable; ce qu’elle me faisait faire dans ce moment, la certitude d’une grande fortune n’eût pu, je crois, m’y déterminer. Enfin, me traînant souvent sur les mains, d’autres fois trouvant dans mon ardeur une adresse que j’étais bien loin de me soupçonner; souvent m’abandonnant au hasard, je suis parvenu, après un mille et demi de marche, dans le plus pénible travail, sur ces bords difficiles, au pied de cette immense cataracte; l’amour-propre de l’avoir atteint y compense seul la peine des efforts que le succès a couté; il est plus d’une situation pareille dans la vie.
Là on se trouve dans un tourbillon d’eau dont on est percé.—Les vapeurs qui s’élèvent de la chûte se confondent avec les flots qui en tombent; le bassin est caché par cet épais nuage; le bruit seul, plus violent que partout ailleurs, est une jouissance particulière à cette place. On peut avancer quelques pas sur les rocs, entre l’eau qui tombe, et le pied du rocher d’où elle se précipite; mais on est alors séparé du monde entier, même du spectacle de cette chûte, par cette muraille d’eau qui, par son mouvement et son épaisseur, intercepte tellement la communication de l’air intérieur, qu’on serait entièrement suffoqué, si on y restait longtems.
Il est impossible de rendre l’effet que cette cataracte nous a fait éprouver; notre imagination longtems nourrie de l’espérance de la voir, nous en traçait des peintures qui nous semblaient exagérées; elles étaient au-dessous de la réalité: chercher à décrire ce beau phénomène et l’impression qu’il cause, ce serait tenter au-dessus du possible.
J’étais tellement rempli de l’enthousiasme qu’il avait produit en moi, que cette émotion m’a adouci la difficulté du retour, et que ce n’est qu’arrivé au fort que je me suis apperçu de ma fatigue, de mes contusions, de ma faim, du déplorable état de mes vêtemens, et que j’ai pu soupçonner l’heure qu’il était: il était huit-heures. (Excursion dans le Haut-Canada, par le Duc La Rochefoucault-Liancourt, année 1795.)
Augustus Porter, Ecr. propriétaire du côté américain du Saut de Niagara, a acheté depuis peu l’Ile au Chevreuil, qui est dans la rivière de Niagara, et qui partage la chûte. Comme cette île est située dans les rapides, on en a jusqu’à présent regardé l’abord comme très difficile et très-dangereux, n’y ayant qu’un seul point par où on puisse en approcher; encore faut-il s’embarquer à un mille au moins au-dessus de la chûte, et puis descendre entre les rapides jusqu’à la pointe de l’île. Cette voie n’est pas même très sûre, car si le canot n’était pas conduit comme il faut, il périrait infailliblement. Afin donc de rendre l’approche de l’île aisée, et d’en augmenter en conséquence la valeur, l’entreprenant propriétaire a fait construire un pont de 34 perches de longueur, sur onze piles, dont chacune contiendra, lorsqu’elles seront remplies, 50 tonneaux de pierres. La masse de ces piles et les fondemens sur lesquelle elles sont appuyées, qui sont un roc solide, font espérer que le pont sera permanent. On dit que le juge Porter a dessein de cultiver cette île charmante, et d’y construire les bâtimens convenables pour les étrangers et autres qui voudront voir une des plus grandes curiosités de la nature, d’un nouveau point de vue. L’île contient environ 80 acres de terre.—Elle est de 100 perches de largeur, excepté à l’extrémité inférieure entre les rapides, où elle n’en a que 90. (Journal américain, de l’année 1817.)
|
Chippawa en est à un mile et demi en ligne droite; mais les bords de la rivière font un si grand détour, que le chemin qui les suit parcourt une distance de plus de trois miles. |

La société polytechnique a tenu, le 30 Avril, sa séance extraordinaire, qui a été très-intéressante. M. Viennet a lu une scène de sa tragédie de La Ligue, qui étincelle de verve et de patriotisme; M. Berville, une charmante dissertation sur la Vérité; et M. Bouilly, une scène de sa comédie intitulée: Une Matinée de Louis XIV. Ces trois lectures, où brille un mérite différent, ont obtenu un succès unanime dans une assemblée digne d’apprécier le talent. M. de Pongerville a lu un fragment de sa traduction en vers des Métamorphoses. L’interprète de Lucrece s’est emparé de la grâce légère et facile de la muse d’Ovide; sa poésie est pleine de force, de fraîcheur et d’harmonie.
Le Globe and Traveller annonce qu’il a été fait à la tour de Londres une expérience très-intéressante sur la plus puissante lumière que l’industrie humaine soit parvenue à produire. On l’obtient en dirigeant sur un morceau de chaux, à l’aide d’un courant de gaz oxigène, de l’alcohol enflammé, ou, en d’autres termes, la flamme d’une lampe à l’esprit de vin. Cette lumière a quatre-vingts fois plus d’intensité que celle du quinquet d’une égale grandeur. On dit qu’elle peut être aperçue à une distance de 120 milles. La cause de ce phénomène n’est point encore connue; mais il paraît que d’autres substances terreuses deviennent également lumineuses par le même procédé: celle qu’on nomme zercon a cette propriété au plus haut degré. On conçoit l’avantage qu’on peut tirer de cette découverte pour les signaux.
On a présenté dernièrement au roi de France, un sanctuaire égyptien découvert dans la ville de Saïs, et qui sera déposé au Louvre. Cet antique monument est en granit et d’une seule pièce. Ses quatre côtés sont ornés de scènes religieuses et d’hiéroglyphes. Une notice publiée à ce sujet dit, que dans la niche de ce sanctuaire était enfermé et nourri un vautour, oiseau consacré à la divinité tutélaire de Saïs, et que c’est le roi d’Egypte détrôné par Cambyse qui lui dédia ce monument, 570 ans avant l’ère chrétienne.
Le libraire Ladvocat a acheté pour la somme de 550,000 francs les œuvres de M. de Chateaubriand.
M. Morel de Beauvine, propriétaire de carrières dans l’île d’Elbe, a offert à Sa Sainteté de fournir gratuitement tous les marbres et granits nécessaires à la reconstruction de l’église de Saint-Paul. Une commission d’hommes habiles est envoyée de Rome pour examiner ces carrières.
M. Dupin ainé, vient de publier un Précis historique du Droit français, par l’abbé Fleury. L’ouvrage de Fleury finit au siècle de Louis XIV; M. Dupin l’a continué jusqu’à l’époque de la révolution. C’est l’histoire ancienne du droit français.
Un nouvel ouvrage vient de paraître sur Napoléon, et son titre annonce qu’il est destiné à tenir lieu de la plupart de ceux qui ont été publiés jusqu’à ce jour. Napoléon devant ses contemporains; tel est ce titre énergique dans sa simplicité. L’auteur, qui garde l’anonyme, mais dont le talent distingué brille à chaque page, paraît avoir eu l’intention de s’ériger en juge impartial de son personnage. C’est une histoire complète de Napoléon, depuis sa naissance jusqu’à sa mort; elle renferme des détails et des faits qui avaient jusqu’ici échappé à tous les historiens de l’ex-empereur.
Par une ordonnance du roi en date du 15 Mai, M. Champollion le jeune, est nommé conservateur des monumens égyptiens et orientaux de toute origine, au musée des antiques du Louvre, et est chargé d’un cours public et gratuit sur les écritures et les antiquités égyptiennes en présence des monumens mêmes. L’enseignement des hiéroglyphes s’établit déjà dans les universités étrangères, d’après les doctrines fondées par M. Champollion; le cours nouvellement établi en sera comme l’école normale pour l’Europe savante. Le ministère de la maison du roi et le département des beaux arts assurent aussi par-la à la France la conservation d’un savant qui l’honore par ses brillantes découvertes.
MM. Darcy et Gay-Lussac, membres de l’Académie des sciences, viennent d’arriver à Douai avec M. le général d’artillerie Marion, pour continuer les essais commencés à la fonderie de cette ville, dans le but de connaître le meilleur alliage pour la fabrication des canons de siége.
La fabrication des chapeaux de paille d’Italie est actuellement naturalisée en France. A quinze lieues de Lyon, à Moyrant, il existe une fabrique qui prend chaque année plus d’importance; elle emploie maintenant 3 à 400 ouvriers, et l’on y confectionne des chapeaux qui ne le cèdent en rien à ceux de Livourne et de Florence. Il y en a dont le prix s’élève à 600 francs.
Quatre bâtimens de guerre français, le brick le Cygne, la gabarre l’Arriége, la frégate la Thétis, et la corvette l’Espérance, sont chargés de faire un voyage autour du monde.
Le grand travail de M. C. Lacretelle, sur l’Histoire de la
Révolution française, est terminé, et les deux derniers volumes de cet ouvrage, consacrés à l’histoire du Directoire exécutif, ont paru le 5 Juin, à la librairie de Treuttel et Wurtz.
(Des journaux acadiens et canadiens.)
Halifax, 22 Juin. Nous annonçons, avec un vrai plaisir, que Mr. John M’Kay, habile artisan de Pictou, a reçu dernièrement de la Société des Arts, de Londres, la Médaille d’Or de Cérès, évaluée à £100 sterling, pour prix de la découverte qu’il a faite d’une méthode perfectionnée pour enlever les souches et les racines des arbres, dans les terres neuves. Mr. M’Kay a reçu en même tems le 23e. volume des Transactions de la Société.
Québec, le 20 Juillet. Plusieurs lots de la cargaison de l’Eunice, importée de Boston et vendue à l’encan, ont donné un bénéfice de 50 à 200 pour cent. Les cotonnades sont considérées, sous le rapport de la durabilité, comme fort supérieures à celles d’Angleterre. Il n’est que juste d’observer que nous devons cette spéculation à l’esprit d’entreprise d’un jeune Canadien, M. Hypolite Dubord, de cette ville.
Québec, le 5 Août. Cet infatigable collecteur de curiosités naturelles, Mr. Chasseur, a découvert à St. François du Sud, un corps humain, dans un état de pétrification, ou plutôt d’ossification. Ayant obtenu l’autorisation requise, il se propose de l’exhiber dans cette ville, pour la gratification des curieux. On pense que ce corps sera ici, au commencement de la semaine prochaine, et nous serons alors en état de donner une description détaillée de cet objet singulier.
Nouvellement publié et à vendre chez Neilson et Cowan, rue de la Montagne, No. 3, Québec, en deux vol. in-8vo., prix 16s., un ouvrage en anglais, intitulé: Histoire du Canada, depuis sa découverte, jusqu’à l’année 1791; par William Smith. Cet ouvrage, qui, outre la narration historique, contient une masse de documens qui ne se trouve nulle part ailleurs, a été imprimé en 1815; mais des circonstances inévitables en avaient empêché la publication jusqu’à ce moment.
Les gazettes annoncent plusieurs autres publications en anglais; entr’autres, Défense du Droit exclusif de l’Eglise (anglicane) aux Réserves du Clergé; brochure de 30 pages, publiée à Kingston, dans le Haut-Canada; et Appel au public impartial, &c. par Elmer Cushing; brochure de 88 pages 8vo., imprimée à Stanstead, dans les townships de l’Est.

RONDEAU.
Le bel esprit, au siècle de Marot,
Des dons du ciel passait pour le gros lot;
Des grands seigneurs il donnait l’accointance;
Menait parfois à double jouissance;
Et, qui plus est, faisait bouillir le pot.
Or est passé ce tems où, d’un bon mot,
Stance ou dixain, on payait son écot;
Plus n’en voyons qui prennent pour finance
Le bel esprit.
A prix d’argent, l’auteur comme le sot,
Boit sa chopine et mange son gigot;
Heureux encor d’en avoir suffisance!
Maints ont le chef plus rempli que la panse:
Dame ignorance a fait enfin capot
Le bel esprit.
———————
SUR LES LARMES DES FEMMES.—CHANSON.
Air: Du souvenir de notre amour.
Tel homme ne trouve plus d’armes
Contre une belle femme en pleurs;
Tel autre ne voit dans ses larmes
Qu’imposture et pièges trompeurs:
Moi, ni défiant, ni crédule,
Je vais vous dire dans quel cas,
Calculant tout avec scrupule,
J’y croirais, ou n’y croirais pas.
Quand ses pleurs en perle brillante
Roulent dans ses yeux toujours beaux,
Quand sa bouche, toujours charmante,
S’ouvre à d’harmonieux sanglots;
Enfin quand sa douleur mortelle
Semble ajouter à ses appas,
Je me dis: Mon Dieu, qu’elle est belle!
Mais à ses pleurs je ne crois pas.
Mais que son œil gonflé rougisse,
Et par torrent laisse courir,
Sur un nez couleur d’écrevisse,
Des pleurs que rien ne peut tarir;
Que sa douleur à qui tout cède
Efface les charmes qu’elle a,
Je me dis: Mon Dieu, qu’elle est laide!
Mais je crois à ces larmes-là.
———————
LE FER ET L’AIMANT.—FABLE.
Aux lois de la nature, amis, soumettons-nous;
Toujours sa volonté l’emporta sur la nôtre.
L’aimant disait au fer: pourquoi me cherchez-vous?
Pourquoi m’attirez-vous? soudain répondit l’autre.
Notre faiblesse et ton pouvoir,
Sexe enchanteur, s’expliqueraient de même:
Ainsi tu plais sans le vouloir;
Sans le vouloir, ainsi l’on t’aime.
———————
LE JOUR DU SABBAT.—ANECDOTE.
Une dame ayant acheté
D’un juif certaine marchandise,
Et son argent étant compté,
Dit: à-propos, maître Moïse,
J’oubliais net que c’est jour de sabbat:
Chez vous c’est un point délicat,
Et je vous sais trop plein de conscience
Pour recevoir aujourd’hui cet argent:
Excusez mon inadvertence;
Une autre fois je ferai ce paîment.
Notre juif, à cette apostrophe,
Recompte et ramasse en disant:
Madame, je suis philosophe.
———————
LES TROIS AVEUGLES.
Sur la terre, aux cieux et sur l’onde,
Tout suit le caprice du sort;
Trois aveugles mènent le monde,
L’Amour, la Fortune et la Mort.
La vie est un bal que commence
La Fortune, tant bien que mal:
Vient l’Amour qui mène la danse;
Et puis la Mort ferme le bal.
———————
WOLFE MOURANT.
O quam decoro pulvere Wolfius
Perfusus ensem fulmineum rotat!
Irrumpit, hostiles catervas
Cædit, agit, rapit, urget instans!
Ah! dulce pignus! ne nimis ardeas,
Fatalis error fortibus et bonis!
Quin laudo, si corpus fatiscat,
Fama supervolitabit astra;
Terrisque præstans commemorabere
Virtute verâ, nec reticebitur
Suprema vox singultientis,
Cùm “fugiunt, fugiunt,” relatum est:
Ad vocis horrens ambiguæ sonum
Arrectus ille, “Ah! qui fugiunt?” rogat.
Tùm doctus aufugisse Gallos,
“Jam satis est, moriamur,” inquit.
Sic certus hostes tergo dare in fugam
Thebanus heros, “extrahe telum,” ait;
Vultuque subridens amœno,
Magnam animam exhilaratus est.

L’empereur Joseph II écoutait tous ceux qu’il croyait pouvoir lui découvrir quelque chose d’utile, et il perdait souvent par là beaucoup de tems.
Le baron Calisius demanda un jour une audience, pour proposer à l’empereur un projet de grande importance; elle lui fut accordée, et la conversation suivante eut lieu:
Calisius. La ville de Comorn en Hongrie a le malheur d’éprouver presque tous les cinq ans, des tremblemens de terre, qui y ont souvent causé de grands dommages, l’exposent encore au danger le plus imminent, et la menacent même d’une ruine totale. Or j’ai remarqué que les tremblemens de terre étaient inconnus en Egypte; mais l’Egypte ne diffère des autres pays qu’en ce qu’elle a des pyramides; donc les pyramides sont des préservatifs infaillibles contre les tremblemens de terre.
L’Empereur. De sorte qu’il serait à propos de construire quelques uns de ces édifices en Hongrie?
Calisius. C’est l’humble proposition que je fais à votre majesté, à laquelle je présente en même tems le plan sur lequel on pourrait les construire.
L’Empereur. Mais avez-vous calculé les dépenses?
Calisius. Non; mais je crois qu’avec 3 ou 400,000 florins on pourrait construire deux jolies pyramides: un peu moins grandes, il est vrai, que celles d’Egypte.
L’Empereur. La ville de Comorn a-t-elle autant d’argent que cela?
Calisius. Non; mais j’espère que votre majesté y contribuera; et l’on pourra obtenir le reste au moyen d’une souscription.
L’Empereur. Eh bien, je n’ai rien à redire à cela. Si vous pouvez trouver un lieu qui ne soit propre qu’à cela, et à rien autre chose, et que vous vouliez entreprendre l’ouvrage par souscription, vous pouvez commencer quand vous voudrez; mais je ne puis fixer le montant de ma souscription, avant que je n’aie vu au moins une des pyramides achevée.
L’orgue de l’église cathédrale de Harleim passe pour le premier du monde. Il contient 8000 tuyaux, dont quelques uns ont 38 pieds de longueur et 16 pouces de diamètre, et 64 touches, 4 séparations, 2 tremblements, 2 accompagnements, et 12 soufflets. Les notes de cet instrument étonnant peuvent rendre tous les sons depuis le plus doux jusqu’au plus sublime; depuis le gazouillement d’un oiseau éloigné, jusqu’au bruit terrible du tonnerre; et peut faire trembler dans toutes ses parties le massif édifice qui le renferme. Il a une touche appellée vox humana, qui imite parfaitement la voix humaine.
Handel passant par Harleim, ne put, comme on pense bien, résister à l’envie de voir des orgues si fameuses. Il en obtint les clefs, et s’amusa à jouer pendant quelque tems, et à la fin, tombant sur les tons qui imitent le tonnerre, il fit un tel bruit, qu’il ébranla tout le bâtiment, et fit trembler jusqu’au clocher même.
A la répétition de l’opéra comique, Les Fêtes publiques, mademoiselle S. .. ., connue sous le nom de Mamie Babichon, s’étant glissée derrière le banc des musiciens, rangés sur une ligne dans l’orchestre, attacha avec adresse à leurs perruques des hameçons, qui se réunissaient à un fil de rappel fixé à une des troisièmes loges.
Mamie Babichon monte aux troisièmes, et attend avec impatience le signal de l’ouverture. Au premier coup d’archet, la toile se lève, et en même tems les perruques s’envolent. Grande surprise, grands éclats de rire d’une part, grande rumeur de l’autre. On cherche l’auteur de cette espièglerie; un grave musicien, qui présidait à la répétition, veut en avoir raison.
Cependant la jeune espiègle avait eu le tems de descendre, elle s’était placée auprès du plaignant, et criait plus fort que lui. Mais elle fut bientôt reconnue à son air hypocrite et malin; elle avoua sa faute, et, s’adressant au sermoneur: “Hélas, monsieur, lui dit-elle, je vous supplie de me pardonner; c’est un effet de l’antipathie insurmontable que j’ai pour les perruques; et même dans ce moment, malgré le respect que je vous dois, je ne puis m’empêcher de me jetter sur la votre;” ce qu’elle fit en prenant la la fuite aussitôt.
Tous les musiciens, courroucés de cette injure, tiennent conseil, et forment la résolution de venger l’honneur des têtes à perruques. On porta plainte: Babichon fut mandée devant le commissaire. Elle parut en riant, et raconta si plaisamment son histoire, que le juge, l’accusée, les accusateurs et les auditeurs étouffèrent de rire, et terminèrent gaîment ce procès burlesque.
Parmi les anciennes figurantes de l’opéra, on nommait mesdames Château-Neuf, Château-Fort, Château-Briand, Château-Vieux, &c. “Tous ces Châteaux là”, disait mademoiselle Arnould, “ne sont que des châteaux branlants.”
Un peintre pauvre et gai ne montait ni ne payait de gardes; il est mandé au district: “Vous devez,” lui dit gravement le président, “payer votre garde, ou la monter.—Ni l’un ni l’autre, messieurs: pour la payer, je suis trop gueux; et pour la monter, je suis à moi seul plus poltron que tout le district ensemble.”
L’empereur Napoléon se rendait à cheval de Wittemberg à Potzdam. Un orage le surprit, et le força de mettre pied à terre et de se réfugier dans la maison du grand-veneur de Saxe. A peine y était-il entré, qu’il s’entendit appeller par une jolie Egpytienne, veuve d’un officier français de l’armée d’Egypte, et qui demeurait depuis près de trois mois chez le grand-veneur, où elle était honorablement traitée. Aussi satisfait qu’étonné d’une rencontre si inattendue, l’empereur assura à la belle Egyptienne une pension de douze cents francs, et lui promit de prendre soin de son enfant. “C’est la première fois, dit le monarque aux généraux qui l’entourraient, que je mets pied à terre pour un orage. J’avais le pressentiment qu’une bonne action m’attendait-là.”
Mis-spelled words and printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Inconsistency in hyphenation has been retained.
Inconsistency in accents has been corrected or standardised.
When nested quoting was encountered, nested double quotes were changed to single quotes.
[The end of La Bibliothèque Canadienne, Tome III, Numero 3, Aout, 1826. edited by Michel Bibaud]