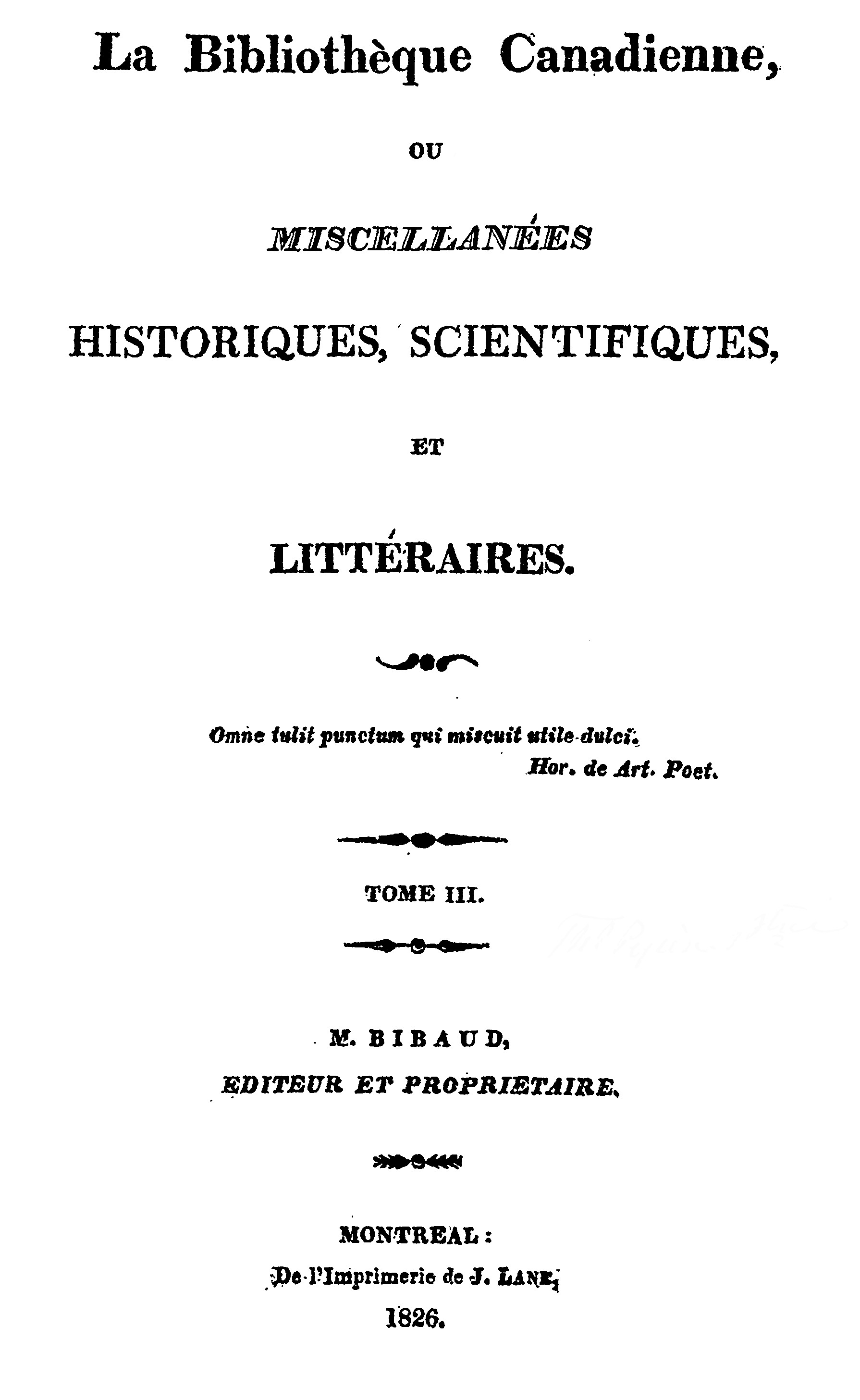
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome III, Numero 2, Juillet, 1826.
Date of first publication: 1826
Author: Michel Bibaud (editor)
Date first posted: Apr. 3, 2020
Date last updated: Apr. 3, 2020
Faded Page eBook #20200401
This eBook was produced by: Larry Harrison, David T. Jones, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
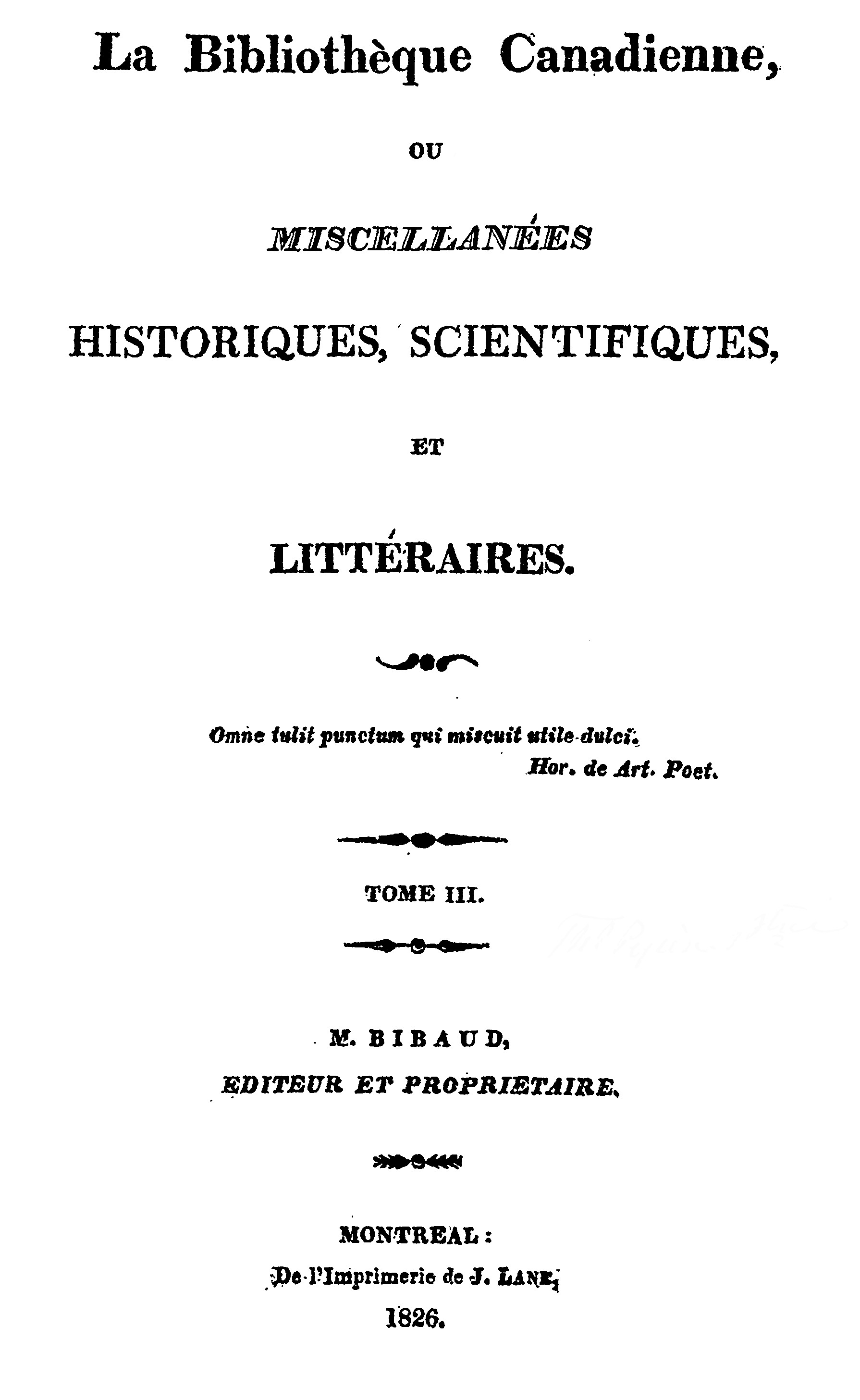
La Bibliothèque Canadienne
| Tome III. | JUILLET, 1826. | Numero 2. |
À-peu-près dans le même tems, trois cents Iroquois s’étant mis en campagne, les guerriers de la bourgade de St Jean, une des plus fortes du pays des Hurons, en eurent avis, et ôsèrent aller à leur rencontre. Ils laissaient ainsi St. Jean absolument sans défense, et les Iroquois ne manquèrent pas de profiter d’une aussi fausse démarche: ils prirent une route détournée, et arrivèrent, au point du jour, à la vue de St. Jean. Il n’y restait que des vieillards, des femmes et des enfans, et les Iroquois firent d’eux tous une horrible boucherie. Le P. Garnier périt au milieu du massacre. Ainsi que les autres missionnaires martyrisés avant lui, il refusa de se sauver par la fuite, et lorsque le coup mortel le frappa, il administrait aux mourans qui l’entourraient, les secours de la religion. Le P. Chabanel, autre missionnaire de St. Jean, qui avait été appellé ailleurs deux jours avant le désastre de cette bourgade, ne reparut plus, soit qu’il eût été tué, soit qu’il se fût noyé, ou qu’il eût péri égaré dans les bois.
Les malheurs de la nation huronne, qui semblaient déjà être à leur comble, ne s’arrêtèrent pourtant pas là. La famine et la crainte avaient contraint un grand nombre de ceux qui s’étaient réfugiés dans l’île St. Joseph, à aller chercher ailleurs des vivres et des retraites éloignées, où ils pussent être à l’abri des poursuites de leurs ennemis. Cependant la plupart d’entr’eux furent découverts et massacrés. Enfin, ceux qui étaient restés dans l’île, craignant aussi que les Iroquois ne pénétrassent jusqu’à eux, résolurent d’aller à Québec, sous la conduite de leurs missionnaires, se mettre sous la protection des Français.
On rassembla donc tous les Hurons que l’on put trouver, et les malheureux débris d’une nation naguère si florissante, s’acheminèrent tristement vers la capitale du Canada: c’étaient des malades que l’on portait, des blessés qui se traînaient à peine, des femmes dont la mammelle desséchée par la faim, n’avait plus de lait pour leurs enfans. Si cette multitude confuse avait rencontré quelque troupe d’Iroquois, tant soit peu nombreuse, elle aurait été massacrée sans résistance. Elle rencontra sur sa route d’autres Hurons qui escortaient le P. Bressani, retournant à sa mission, et qui ignoraient l’état déplorable de leur pays. Ils crurent n’avoir rien de mieux à faire que de retourner sur leurs pas, et d’accompagner à Québec leurs compatriotes fugitifs. Ils y trouvèrent enfin un asile, et tous les secours de la charité hospitalière.
Quelques Hurons, fidèles à leur patrie désolée, n’avaient pu encore se résoudre à l’abandonner. Poursuivis avec acharnement par les Iroquois, les uns se jettèrent dans les bras des tribus voisines, sur lesquelles ils attirèrent par là les armes de leurs ennemis; d’autres se réfugièrent dans les forêts de la Pensylvanie. D’autres, après avoir fait tomber un nombre d’Iroquois dans une embuscade que ceux-ci leur avaient tendue, allèrent se cantonner dans l’île Manitoualin, et descendirent de là à Québec. Enfin ceux des bourgades de St. Michel et de St. Jean Baptiste, au lieu de fuir comme les autres, allèrent se présenter aux Iroquois, et leur dirent qu’ils voulaient vivre avec eux comme frères. Ces derniers furent, cette fois, assez généreux pour les recevoir et les traiter comme ils le désiraient.
Les Hurons réfugiés à Québec étaient un fardeau pour la colonie, dans l’état de pénurie et d’abandon où elle était; mais ils pouvaient lui devenir utiles avec le tems, surtout s’ils étaient guidés par les conseils de la sagesse et de la prudence. Mais, selon la remarque d’un historien, l’extrême présomption succède presque toujours chez les sauvages à l’extrême découragement. Aussitôt que les réfugiés se crurent protégés par le canon du fort de Québec, ils passèrent de l’abattement à l’insolence. Il leur restait peu de guerriers, et cependant ils osèrent, après avoir engagé les habitans de Sylleri à se joindre à eux, aller attaquer les Agniers chez eux. Les Algonquins des Trois-Rivières et quelques Hurons, qu’ils rencontrèrent en chemin, les accompagnèrent. Tous ces guerriers étaient chrétiens, et leur expédition avait quelque air de croisade; mais elle fut malheureuse.
Comme ils approchaient du village où ils avaient résolu de faire leur première attaque, un Huron et un Algonquin furent détachés pour aller à la découverte. Ces deux hommes s’étant séparés, le premier tomba dans un parti iroquois, et pour sauver sa vie, il ne fit point difficulté de trahir sa foi, sa nation et ses alliés. “Mes frères,” dit-il, “en abordant les ennemis, il y a longtems que je cherchais quelqu’un de vous: je me suis mis en chemin pour aller dans mon pays, où je sais que présentement les Iroquois et les Hurons ne sont plus qu’un peuple, et n’ont plus qu’une même terre. Pour marcher plus surement, je me suis joint à un parti algonquin, que j’ai rencontré, et qui vient vous attaquer. Il y a deux jours que je l’ai quitté pour venir vous avertir de vous tenir sur vos gardes.”
Le perfide fit pis encore; il servit de guide aux Agniers, qui allèrent au-devant des chrétiens et les trouvèrent tous endormis. Ils ne s’éveillèrent qu’au bruit d’une décharge de mousqueterie, et comme l’ennemi avait eu le tems et la facilité de choisir ceux sur qui il ferait tomber ses premiers coups, les plus braves des confédérés restèrent morts sur la place, avant qu’aucun de leur troupe eût eu le tems de prendre ses armes. Ceux qui survécurent ne laissèrent pas de se bien battre; d’autres, à la faveur de cette résistance, se sauvèrent dans les bois. Tout le reste fut tué, ou pris et livré au feu. Très peu revinrent à Québec donner des nouvelles de ce désastre.
L’année 1650, où ces choses se passèrent, fut une des plus funestes à la Nouvelle France, par la destruction presque complète de la nation huronne, et par les malheurs qui en furent les suites. Cette même année, M. d’Aillebout fut remplacé, dans le gouvernement général, par M. de Lauzon, un des principaux membres de la Compagnie du Canada, mais qui n’arriva pourtant à Québec que l’année suivante. M. d’Aillebout laissa sans regret une place dont on ne le mettait pas en état de soutenir la dignité, et où il ne pouvait être que le témoin de la désolation de la colonie. Le nouveau gouverneur avait toujours eu plus de part que personne aux affaires de la Compagnie. C’était lui principalement qui avait ménagé en Angleterre la restitution de Québec. Sa religion, sa droiture et ses bonnes intentions étaient connues, et il avait toujours paru s’intéresser beaucoup à ce qui regardait le Canada. Mais il trouva ce pays dans une situation plus déplorable encore que ne l’avait représenté le P. J. Lallemant, dans un voyage en France, et empirant de jour en jour. Les Iroquois devenus plus hardis depuis leurs dernières victoires, ne regardaient plus les forts et les retranchemens des Français comme des barrières capables de les arrêter: ils parcouraient le pays en tous sens, et se répandaient en grandes troupes dans les environs des habitations; de sorte que l’on n’était plus nulle part en sureté contre leurs insultes. Un événement funeste venait d’accroître encore leur insolence. Un de leurs partis s’étant approché des Trois-Rivières, M. Duplessis Bochart, qui en était gouverneur, voulut marcher contre eux en personne. Il fut tué dans le combat, et sa mort ne priva pas seulement la colonie d’un honnête homme et d’un bon officier, elle donna encore un nouveau relief aux armes des Iroquois.
La guerre qu’ils continuaient de faire avec acharnement contre les faibles restes de la nation huronne, et contre les peuples qui leur avaient donné retraite, augmentait de jour en jour la terreur de leur nom, et leurs forces croissaient par le nombre des captifs qu’ils emmenaient de toutes parts, et au moyen desquels ils remplaçaient ceux des leurs qu’ils perdaient. Enfin la bourgade de Sylleri n’étant plus en sureté avec des palissades, on avait été obligé de l’enfermer de murailles et d’y placer du canon. Les plus affreux déserts, et les plus impénétrables cantons du nord n’étaient plus des retraites sûres contre la rage de ces barbares, et contre leur soif hydropique du sang humain.
Le P. Jacques Buteux avait employé tout le printems de cette année 1651, à parcourir ces vastes contrées. Les Attikamègues, et autres sauvages chrétiens, ou catéchumènes qu’il y rencontra, le conduisirent chez une tribu plus éloignée, où ce religieux se promettait bien de pouvoir exercer tranquillement ses travaux évangéliques. Mais bientôt les Iroquois firent une irruption dans ces lieux écartés, les remplirent de sang et de carnage, et n’y laissèrent pas un seul village dont ils n’eussent égorgé ou dissipé les habitans. La nouvelle en ayant été portée à M. de Lauzon, il comprenait qu’il aurait été nécessaire d’opposer une digue à ce torrent; mais il n’avait amené aucun renfort de France, et il s’en fallait bien qu’il eût trouvé dans la colonie des forces capables d’y rétablir la sureté et la tranquillité.
Le P. Buteux étant retourné dans le nord, le printems suivant, avec un jeune Français et un Huron, sur l’invitation que lui en avaient faite quelques familles attikamègues, il périt avec le premier par la main des Iroquois; le troisième fut assez heureux pour échapper aux ennemis, et venir porter aux Trois-Rivières la nouvelle de la mort de ses compagnons. Cette même année, plusieurs missionnaires, que la destruction des bourgades huronnes laissait sans occupations, repassèrent en Europe. Le P. Bressani fut de ce nombre.
L’île de Montréal ne souffrait guère moins des incursions des Iroquois que les autres parties de la Nouvelle France; et M. de Maisonneuve fut obligé d’aller à Paris chercher en personne les secours qu’il ne pouvait obtenir par ses lettres. Il en revint l’année suivante 1653, avec un renfort de cent hommes, amenant avec lui Mademoiselle Marguerite Bourgeois, Institutrice des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, qui ont rendu, et continuent encore à rendre, à la colonie, des services importants, sous le rapport de l’éducation.
Peu après le retour de M. de Maisonneuve, deux cents Iroquois surprirent dans son île vingt-six Français, et les enveloppèrent de toutes parts. Cependant ces derniers firent si bonne contenance et se battirent avec tant d’ordre et de résolution, qu’ils mirent les barbares en fuite, après en avoir tué un grand nombre. Comme le gouverneur prenait ses mesures pour se mettre à l’abri de pareilles surprises, soixante Onnontagués parurent à la vue de son fort. Quelques uns s’approchèrent ensuite avec confiance, et firent signe qu’ils voulaient parler. Ils accompagnèrent cette proposition de présens. M. de Maisonneuve, en les acceptant, leur reprocha la perfidie de leur nation; leur faisant remarquer en même tems la différence qu’il y avait, à cet égard, entre eux et les Français.
Ils convinrent de tout, et assurèrent que dans peu on aurait des preuves certaines de leur sincérité. Ils partirent aussitôt pour aller communiquer à leurs anciens les propositions du gouverneur; et ayant pris leur route par Onneyouth, ils engagèrent les chefs de ce canton à se joindre à eux. Celui de Goyogouin en fit de même, et envoya en son nom des députés à Montréal, pour avertir le gouverneur que cinq cents Agniers étaient en campagne, et en voulaient aux Trois-Rivières. M. de Lauzon, à qui M. de Maisonneuve fit part de ces nouvelles, arma en diligence tout ce qu’il put rassembler de Hurons. Ceux-ci ayant joint une troupe nombreuse d’Agniers, les attaquèrent avec tant de courage, qu’ils en tuèrent un grand nombre, firent le chef et plusieurs des principaux prisonniers, et mirent les autres en fuite.
Un autre parti de ces barbares fut plus heureux. S’étant avancé jusqu’aux portes de Québec, il donna pendant tout l’été de fréquentes alarmes, fit partout de grands dégats, massacra plusieurs Français, et fit quelques prisonniers, parmi lesquels se trouva le P. Poncet. Ce jésuite était fort aimé dans la colonie, et l’on n’eut pas plutôt appris dans la capitale, qu’il était entre les mains des Agniers, que quarante Français et quantité de sauvages se mirent aux trousses de ces barbares, résolus de ne point revenir qu’ils ne l’eussent délivré. Mais on les retint aux Trois-Rivières, pour renforcer la garnison de ce poste, que les ennemis tenaient bloqué de toutes parts.
La nouvelle des négociations de la paix, dont la liberté du P. Poncet devait être un des préliminaires, délivra ce missionnaire des mains des Iroquois, et il redescendit à Québec, accompagné d’un député de cette nation. La paix était déjà conclue, lorsqu’ils arrivèrent; et quelque expérience qu’on eût de la légèreté et de la perfidie de ces barbares, on voulait bien se flatter qu’elle serait durable; d’autant plus que les cinq cantons s’y étaient portés sans concert, et que les Agniers en avaient fait les avances, dans le tems qu’ils paraissaient les plus animés contre les Français, et qu’ils n’avaient rien à craindre de leur part.
L’année suivante, le P. Lemoyne fut envoyé à Onnontagué, pour y ratifier le traité au nom du gouverneur général, et tout s’y passa avec beaucoup de satisfaction de part et d’autre. Le missionnaire dit à ces sauvages qu’il voulait avoir sa cabanne dans leur canton; et non seulement son offre fut acceptée, mais on lui marqua même un emplacement dont il prit possession. Il fut ensuite régalé dans plusieurs bourgades, chargé de présens par les chefs, et reconduit à Québec, comme on s’y était engagé. Cependant ce père pensa être dans la route, victime de la perfidie des Agniers. Il était dans un canot avec deux Onnontagués; des Hurons et des Algonquins le suivaient dans d’autres. Comme ils approchaient de Montréal, ils se virent environnés de plusieurs canots remplis d’Agniers qui firent sur eux une décharge de tous leurs fusils. Les Hurons et les Algonquins furent tous tués. Un des deux Onnontagués le fut aussi, et le jésuite fut pris et lié, comme prisonnier de guerre. Cependant sur les remontrances de son conducteur, ils le lui remirent entre les mains, et il le mena à Montréal. Cet attentat fut désavoué par le canton d’Agnier, qui en rejetta le blâme sur un métis, né d’un Hollandais et d’une Agnière, et connu sous le nom de Batard Flamand; et le gouvernement jugea à-propos de fermer les yeux sur cette insulte, comme il avait déjà fait et fit encore sur beaucoup d’autres.
(A continuer.)

RELATION des Aventures de M. de Boucherville, à son retour des Scioux, en 1728 et 1729, suivie d’Observations sur les mœurs, coutumes, &c. de ces Sauvages.
Parole de Mr. De Boucherville, accompagnée de 4 barils de poudre, 2 fusils, 30 lbs. de chaudière, 7 lbs. de vermillon, 12 haches, 2 douzaines de grands couteaux, 7 capots galonnés, 2 couvertures de drap, 2 couvertures blanches, 7 sacs de plomb, &c. &c.
“Mes frères, enfans d’Ononthio,
“J’ai appris par six Français et deux Folles-avoines, que les Français et leurs alliés avaient chassé les Renards de leur pays, pour les punir d’avoir ensanglanté la terre, et d’avoir, ce printems, rougi les eaux du Mississipi du sang de plusieurs Français. Les perfides, lorsque nous passâmes chez eux, il y a un an, nous avaient promis de se tenir tranquilles et de réparer le passé. Nous leur déclarâmes qu’ils avaient tout à espérer de la clémence de leur nouveau père Ononthio; et que nous allions, de notre côté, travailler à tranquilliser la terre, et à disposer les Scioux à la paix. J’ai tenu ma parole, et j’ai arrêté plusieurs partis de Sauteux et de Scioux, qui ne respiraient que la guerre. Je suis parti de mon fort pour aller donner avis de tout à notre père Ononthio, et pour savoir ses intentions. C’est là le sujet de mon voyage. Aujourd’hui, je vous demande par ces présens que mon chemin soit libre; je serais bien fâché de vous quitter sans vous soulager dans votre disette, en vous faisant part de nos effets. J’ai lieu de craindre le Renard; je sais qu’il n’est pas loin d’ici. Il vous jetterait et nous aussi dans l’embarras, s’il s’avisait de venir en ce village. Je vous prie donc, Kikapous et Mascoutins, de ne me pas refuser une demande si raisonnable.”
Leur réponse fut, qu’on allait mettre à part mes présens, et qu’ils ne me répondraient que le lendemain.
Il se tint en effet, le jour suivant, une grande assemblée. L’on invita le R. P. Guignas et moi et quelques Français. On mit, sur une robe blanche de castor, un esclave de sept à huit ans, qu’on nous offrit, avec un peu de castor sec.
Parole des Kikapous.
“C’est à notre père Ononthio que nous adressons cette parole, ce petit esclave et ce peu de castor, pour le prier de ne pas nous savoir mauvais gré, si nous arrêtons le chef français, la robe-noire et leur suite. Après la fuite des Renards, l’incendie de leurs cabannes et le ravage de leurs champs, on nous a avertis de nous retirer sur les rivages du Mississipi, parce que notre père Ononthio nous en veut, et que toutes les nations qui hivernent dans notre voisinage tomberont bientôt sur nous. C’est donc pour sauver la vie à nos enfans que nous vous arrêtons: vous serez notre sauve-garde.
“Vous craignez, dites-vous, les Renards! Eh! mes frères, qu’avez-vous à craindre? Les Renards sont loin d’ici: vous ne les verrez pas. Quand même ils viendraient vous chercher: pensez-vous qu’ils puissent réussir? Regardez ces guerriers et cette brave jeunesse qui vous environnent; tous promettent de mourir avec vous, et leurs corps vous serviront de ramparts. Disposez-vous donc à hiverner avec nous, et commencez à bâtir des cabannes pour votre usage.”
“Avez-vous bien pensé,” leur répliquai-je, “à tout ce que je vous représentai hier? Songez-vous que vous répondrez de nous corps pour corps, et que s’il nous arrive quelque accident, on s’en prendra à vous?”
“Nous le savons, nous y pensons, me répondirent-ils: c’est après un mûr examen que nous avons pris notre parti.”
Ce fut donc une nécessité de mettre la hache au bois; et, à l’aide des jeunes Kikapous, nous achevâmes en huit jours nos maisons. Déjà nous commencions à nous arranger; nous n’avions plus de querelle à essuyer; nous vivions en bonne intelligence: mais le 2 Novembre, un Kikapou vint m’avertir que dix Renards étaient arrivés au village. Un moment après, Kansekoé, chef de ces nouveaux venus, entre chez-moi, me tend la main, me dit: “Je te salue, mon père:” et pour me mieux tromper, il m’assura qu’il avait ordre de loger chez-moi. Je fis bonne contenance, malgré ma surprise; et je présentai à manger à ce traître. Notre fidèle Chaouénon me dit que Kansekoé travaillait à débaucher les Kikapous, par des présens. Mais par bonheur, j’avais déjà gagné les jeunes gens par un baril de poudre, 2 couvertures, 2 lbs. de vermillon, et par d’autres présens.
Les Kikapous, après avoir refusé le calumet et la porcelaine des Renards, intimidés néanmoins par leurs menaces, me prièrent de les aider par des présens à couvrir les derniers morts des Renards. Je leur donnai 2 capots galonnés, 2 couvertures de drap 50 lbs. de poudre, 50 lbs. de plomb, 2 lbs. de vermillon, &c.
Le lendemain, il se tint un grand conseil, où j’assistai avec le P. Guignas: ce qui me donna occasion de préparer un présent pour envoyer aux Renards en mon nom.
Parole des Kikapous et Mascoutins, par un baril de 5 lbs. de poudre, 5 lbs. de plomb, 2 lbs. de vermillon, 2 capots galonnés et une couverture.
“Mes frères.—Il y a longtems que nous avons vu le soleil.—
———————
(Il manque ici deux pages du manuscrit dont celui-ci est copié; ce qui est cause de cette lacune.)
———————
“Ne craignez rien,” leur dis-je; “mes cousins vous rendront justice, et ils feront valoir les services que vous nous avez rendus.” Cette promesse les rassura, et ils résolurent de nous sauver, à quelque prix que ce fût. “Car, s’ils périssent, nous sommes morts,” se disaient-ils les uns aux autres, “et puisque nous sommes ici trop exposés aux attaques des Renards, allons nous établir dans l’île voisine, où ils n’aborderont pas malgré nous.” Cette décision était fort sage. J’engageai par des présens les jeunes Kikapous à décamper au plutôt; et dès que nous fûmes placés dans l’île, on envoya des couriers pour en donner avis aux Kikapous dispersés dans les bois.
Vers ce même tems, nous fûmes avertis du dessein barbare de Pechigamengoa, chef Kikapou, grand guerrier, redoutable par son crédit, et par le grand nombre de frères et de parens et de jeunes Kikapous soumis à ses ordres. Comme il avait épousé une femme renarde, Kansekoé et ses consorts obtinrent de lui sans peine qu’il assassinerait le R. P. Guignas, et lui firent promettre qu’il n’irait au village des Renards, que pour y porter la chevelure de ce père.
Pour ne point manquer son coup, il cacha, quelques jours, son malheureux projet. Une belle nuit, il invita deux de ses jeunes gens à lui tenir compagnie dans une suerie; non pas tant pour suer, que pour faire transpirer finement son secret, suivant la coutume des sauvages dans ces sueries, et pour engager ces jeunes gens à le seconder. Dieu ne permit pas que ce traitre réussît. La suerie étant finie, les jeunes Kikapous indignés d’une si noire trahison, allèrent en donner avis aux chefs bien intentionnés.
On peut juger combien cette nouvelle conspiration alarma le village. “Eh quoi,” s’écriaient-ils, “nous pensions n’avoir à craindre que les Renards; aujourd’hui nos frères nous trahissent, et ils veulent ensanglanter nos nattes par le massacre des Français! Que faire en cette occasion? Si c’était un Renard qui eût attenté à la vie du père, nous en serions quittes pour lui casser la tête; mais le coupable est un chef de notre nation!... Tâchons de l’appaiser par des présens.” On lui en offre, il les accepte, et promet de se désister de son lâche projet.
Mais, pour éviter de pareilles trahisons, on nous logea dans des cabannes moins suspectes, où dix hommes veillaient nuit et jour à notre sûreté. Nous fûmes en cet état dix-huit jours.
Kansekoé et ses neuf collègues trouvèrent, trois jours après leur départ, cent Renards qui venaient nous chercher. Ils avaient ordre de menacer les Kikapous, en cas de refus, de l’arrivée de six cents tant Renards que Puants, bien résolus à se venger de l’affront qu’on leur faisait. Kansekoé apperçut dans cette escouade le père du jeune Renard que les Français avaient depuis peu tué à la Baie. Il lui dit: “Je vois bien, mon père, que tu vas demander un Français pour remplacer ton fils; mais reviens avec nous au village: viens écouter les paroles que l’on adresse à ton mort, et ne refuse pas les présens qu’on t’offre.” Le vieillard, touché de cette marque de distinction, se laissa gagner. “Je suis bien aise,” dit-il, “que vous raccommodiez mon esprit mal fait; je vous suivrai.” Plusieurs pensaient comme lui; d’autres disaient qu’il fallait continuer la marche, et forcer les Kikapous à livrer les Français. Enfin, après bien des disputes, soixante-dix Renards retournèrent chez eux, et trente arrivèrent sur les bords du Mississipi. Les Kikapous les voyant en si petit nombre, crurent pouvoir les admettre sans danger dans l’île; mais ils renforcèrent la garde qui veillait à notre sûreté. En entrant dans le village, un Renard s’avisa de haranguer, contre la coutume des sauvages, qui ne haranguent que dans les cabannes. Cet insolent nous parla ainsi:
“Nous sommes malheureux, mes frères; nous avons été chassés de nos terres par les Français. Le chagrin que nous causent nos maux, nous fait venir ici, pour vous prier d’essuyer nos larmes. Vous êtes nos parens; ne nous refusez pas la grâce que nous vous demandons. Vous nous donnerez le nombre de Français qu’il vous plaira; nous ne les demandons pas tous.”
Ils entrent chez notre ami Chaouénon, persuadés que s’ils le pouvaient gagner, ils gagneraient aisément les autres chefs. Tout le monde étant assemblé, les Renards commencent à pleurer leurs morts, faisant retentir l’air de leurs hurlemens, et étendent une robe toute ensanglantée, une coquille toute rouge de sang, un calumet rouge avec ses plumes toutes dégoutantes de sang. Cet affreux spectacle devait naturellement faire impression; et tout ce sang demandait le nôtre d’une manière bien éloquente. Un grand jeune homme renard, bien mataché, se leva, alluma son calumet, et le présenta à Chaouénon, au Bœuf-noir, et aux jeunes chefs, qui ne daignèrent presque pas y toucher du bout des lèvres, et ne tirèrent qu’une gorgée ou deux. Les anciens chefs fumèrent de bon cœur, et vidèrent le calumet renard, pour marquer la conformité de leurs sentimens. Le jeune Renard reprit son calumet, et le présenta aux jeunes chefs avec aussi peu de succès que la première fois. Enfin, après avoir de rechef pleuré leurs morts, ils laissèrent leurs présens, et on leur dit: “A demain la réponse.” Les jeunes Kikapous passèrent toute la nuit sans dormir. Les Renards rodaient sans cesse, et tâchaient de les intimider par de grandes menaces, mais inutilement.
Le lendemain, on s’assembla, et voici la réponse des Kikapous: “Mes frères; vous n’ignorez pas que c’est sans aucun mauvais dessein que nous avons arrêté les Français. Nous voulons qu’ils vivent. Eh! que deviendrions-nous, s’ils périssaient entre nos mains? Retournez en paix; acceptez notre présent; nous mourrons plutôt que de vous livrer un seul de ces Français.”
Les Renards choqués de cette réponse, se lèvent le feu dans les yeux, menacent de se venger, font leurs paquets, traversent la rivière; et ayant rencontré, à trois journées de chemin du village renard, un Kikapou et un Mascoutin qui chassaient, ils les massacrèrent impitoyablement, et ils emportèrent chez eux leurs chevelures.
(La suite au Numéro prochain.)

Me voilà donc sur la route de St. Jean à Montréal, après une longue absence de mon pays. Il était tard, et nous nous empressâmes de monter dans la voiture, pour pouvoir nous rendre à Laprairie. Le coche était plein. Nous étions au moins quinze. Il n’y avait de Canadiens que mes deux compagnes de voyage, l’ami que nous avions eu le plaisir de trouver à bord en embarquant à Plattsburgh le matin, et moi. On s’arrêta à l’auberge que l’on nomme de Mi-chemin, pour faire prendre haleine aux chevaux. C’était un dimanche, jour auquel la loi prohibe la vente, surtout des boissons ennivrantes. Mais le désœuvrement avait rassemblé un assez grand nombre d’habitans des environs sur l’espace vide qui se trouvait entre le chemin et la voiture. La plupart causaient par groupes devant la porte. Le plaisir de me retrouver avec des compatriotes, de causer avec des Canadiens, me fit mettre pied à terre. Je restai pourtant auprès de la voiture, et j’entamai successivement conversation avec ceux qui se trouvaient à ma portée. Enfin l’on donna le signal du départ, et je remontai aussi bien que ceux qui étaient descendus comme moi du coche.
Nous n'avions guères fait plus d’une demi-lieue, quand une des roues se détachant de la voiture, nous mit en danger d’être renversés. Heureusement nous en fûmes quittes pour la peur, car elle se soutint par les trois autres, quoique penchée. Nous pûmes descendre tranquillement pour l’alléger et replacer la roue. La cheville qui la retenait à l’essieu était perdue. On en mit une autre, de bois, que l’on fabriqua du mieux qu’il nous fut possible, avec un couteau, à la lueur d’une lanterne, empruntée à la maison la plus prochaine. Pendant ce travail, de l’avis d’une de nos dames qui craignait le retour de l’accident, je fis la revue des autres roues, et bien nous en prit. J’en trouvai une au côté opposé à laquelle il manquait aussi une cheville. C’eût été la cause de nouvel encombre. On fit la même chose pour celle-ci que pour celle qui était échappée. Au milieu du bruit et de la confusion que cette aventure avait occasionnée, plusieurs de nos compagnons formaient, comme c’est l’ordinaire, des conjectures sur la source de ce malheur. Quelqu’un dit que c’était les Canadiens de Mi-chemin, où nous nous étions arrêtés, qui avaient volé les chevilles. Cet avis ouvert, il n’y eût bientôt qu’une opinion à ce sujet: on fut d’accord. Il fut constant que les Canadiens de Mi-chemin avaient volé les chevilles. On imagine bien que le cocher, et un autre, qui était aussi de la même maison, dont la négligence était probablement cause de l’accident, ne manquèrent pas d’appuyer ceux qui avaient mis au jour une idée qui détournait des soupçons qui tombaient naturellement sur eux. Au moins un motif d’intérêt les conduisait. Ce qui me surprit, ce fut de voir presque tous les autres passagers dire la même chose et la répéter à plusieurs reprises, en appuyant sur le mot de Canadiens, d’un ton et avec un accent qui respirait la haine, chose qui m’étonnait d’autant plus, que les manières et la conversation de quelques uns d’eux, semblaient devoir les mettre au-dessus de ce sentiment odieux.—M’étant toujours tenu près de la voiture, comme je l’ai dit plus haut, et du côté de la roue qui avait manqué, je savais à quoi m’en tenir. Je les avais laissé parler. Je voulais voir s’il se trouverait quelqu’un d’eux qui repoussât cette accusation. Au contraire, on applaudit à la découverte, et on enchérit sur ce prétendu vol des Canadiens de Mi-chemin, et le tout était accompagné d’expressions qui annonçaient qu’on parlait d’eux comme de French dogs. Mais je crus devoir rompre le silence que j’aurais continué de garder, si ces propos s’étaient bornés aux valets. Je dois dire qu’aucun de ceux qui étaient dans la voiture, excepté les deux dames et l’ami qui nous avait rejoint à Plattsbourg, ne me connaissait. Il se peut qu’ils ignorassent même que je susse l’anglais, m’étant entretenu presqu’uniquement en français, n’ayant eu que très peu d’occasion de causer avec d’autres depuis mon entrée dans le vaisseau qui nous avait amené à Saint Jean, et dans lequel nous ne nous étions embarqués que fort tard, dans la matinée. M’adressant d’abord au cocher et à son compagnon de service, je lui dis en anglais un peu vivement, que je croyais moi que c’était à sa propre négligence que nous devions le danger que nous avions couru de nous tordre le col; qu’il aurait dû, avant de partir, regarder aux essieux et examiner s’ils étaient garnis de chevilles, et que je croyais qu’il n’en avait pas pris la peine. Puis m’adressant en général aux autres interlocuteurs, je leur fis part de ma surprise de les avoir vu attribuer un vol aux Canadiens de la maison de Mi-chemin, et de s’exprimer à ce sujet avec autant d’assurance, que s’ils avaient été témoins du délit, et d’insister et de répéter que ces Canadiens nommément l’avaient commis à Mi-chemin. Que moi, je pouvais leur dire que j’étais resté près de la voiture du côté même, et près d’une des roues qui avait manqué, tout le temps que l’on avait été arrêté à Mi-chemin, qu’aucun de ces Canadiens ne s’en était approché, et que personne n’aurait pu se mettre entre elle et moi, sans que je l’eusse vu; que ce qui m’engageait à appuyer sur ces observations était le ton dont tout cela avait été dit.............Nos accusateurs se trouvèrent déconcertés; plusieurs d’entre eux paraissaient aussi sentir ce que les préjugés qu’ils avaient laissé percer devaient avoir de honteux. Aussi personne ne s’avisa de répliquer ou de reclamer. Nous remontâmes en voiture et nous soupâmes ensemble à Laprairie. Il ne fut plus question des Canadiens de Mi-chemin, ni du prétendu vol dont on les avait chargés, avec tant de légèreté, pour ne pas dire d’étourderie et d’injustice.

Jasmin blanc commun—Amabilité.—Il y a des personnes douées d’un si heureux caractère, qu’elles semblent être jettées dans le monde pour être le lien des sociétés: elles ont dans les manières tant de facilité et de grâce, qu’elles supportent toutes les positions, s’accommodent à tous les goûts, et font valoir tous les esprits: elles sont si obligeantes, que toujours elles s’intéressent à ce que vous dites, s’oublient pour vous servir, se taisent pour vous entendre: elles ne flattent personne, n’affectent rien, n’offensent jamais: leur mérite est un don du ciel, comme celui d’un joli visage; elles plaisent, en un mot, parce que la nature les a faites aimables.
Le jasmin semble avoir été créé tout exprès pour être l’emblême de l’amabilité. Lorsque vers 1560, il fut apporté des Indes par des navigateurs espagnols, on admira la légèreté de ses rameaux, le lustre délicat de ces fleurs étoilées; et on crut que, pour conserver une plante si élégante et si mignonne, il fallait la mettre en serre chaude; elle parut s’en accommoder: on l’essaya en orangerie; elle y crût à merveille; on la risqua en pleine terre, où maintenant, sans demander aucun soin, elle brave nos plus rigoureux hivers. Partout on voit l’aimable jasmin diriger à notre gré ses rameaux souples et faciles; il les étend en palissades, les arrondit en tonnelles, les jette en buissons, les élève en massifs, et souvent les déploie en verts tapis le long de nos terrasses et de nos murailles. D’autres fois encore, obéissant aux caprices et aux ciseaux du jardinier, il élève, sur une faible tige, une tête arrondie, semblable à celle d’un jeune oranger: sous toutes ces formes, il nous prodigue des moissons de fleurs qui embaument, rafraichissent et purifient l’air de nos bosquets: ces fleurs délicates et charmantes offrent au léger papillon des coupes dignes de lui, et à nos diligentes abeilles un miel exquis, abondant et parfumé. Le berger amoureux unit le jasmin aux roses, pour parer le sein de sa bergère; et souvent, ce simple bouquet, tressé en guirlande, couronne le front de la princesse.
On raconte qu’avant d’arriver en France, le jasmin séjourna en Italie: un duc de Toscane en fut le premier possesseur: tourmenté d’une jalouse envie, ce duc bizarre voulut jouir seul d’un bien si charmant; il défendit à son jardinier d’en donner une seule tige, une seule fleur. Le jardinier aurait été fidèle, s’il n’avait connu l’amour: mais le jour de la fête de sa maîtresse, il lui présenta un bouquet; et, pour rendre ce bouquet plus précieux, il l’orna d’une branche de jasmin. La jeune fille, pour conserver la fraicheur de cette fleur étrangère, la mit dans la terre fraiche; la branche resta verte toute l’année, et le printems suivant, on la vit croître et se couvrir de fleurs. La jeune fille avait reçu des leçons de son amant; elle cultiva son jasmin; il se multiplia sous ses mains habiles. Elle était pauvre; son amant n’était pas riche: une mère prévoyante refusait d’unir leur misère; mais l’amour venait de faire un miracle pour eux; la jeune fille sut en profiter: elle vendit ses jasmins, et les vendit si bien, qu’elle amassa un petit trésor, dont elle enrichit son amant. Les filles de la Toscane, pour conserver le souvenir de cette aventure, portent toujours, le jour de leurs noces, un bouquet de jasmin; et elles ont un proverbe qui dit, qu’une jeune fille digne de porter ce bouquet, est assez riche pour faire la fortune de son mari. Pour moi, j’aime à penser que tous nos jasmins descendent de celui qui fut heureusement cultivé par les mains des amours.
Verveine—Enchantement.—Je voudrais que nos botanistes attachassent une idée morale à toutes les plantes qu’ils décrivent. Ils formeraient ainsi une sorte de dictionnaire universel, entendu de tous les peuples, et durable comme le monde, puisque chaque printems le fait renaître, sans jamais en altérer les caractères.—Les autels du grand Jupiter sont renversés; les forêts témoins des mystères des druides n’existent plus; les pyramides d’Egypte disparaîtront un jour ensevelies comme le sphinx sous les sables du désert; mais toujours le lotus et l’acanthe fleuriront sur les bords du Nil; toujours le gui croîtra sur le chêne, et la véritable verveine sur les collines arides.
La verveine servait chez les anciens à diverses sortes de divinations; on lui attribuait mille propriétés, entr’autres celle de reconcilier les ennemis; et toutes les fois que les Romains envoyaient des hérauts d’armes porter chez les nations la paix ou la guerre, l’un d’eux était porteur de verveine. Les druides avaient pour cette plante la plus grande vénération; avant de la cueillir, ils faisaient un sacrifice à la terre. C’est ainsi que les mages, en adorant le soleil, tenaient dans leurs mains des branches de verveine. Venus victorieuse portait une couronne de myrte entrelacée de verveine, et les Allemands donnent encore aujourd’hui un chapeau de verveine aux nouvelles mariées, comme pour les mettre sous la protection de cette déesse. Dans le nord de la France, les bergers recueillent cette plante sacrée, avec des cérémonies et des paroles connues d’eux seuls. Ils en expriment les sucs à certaines phases de la lune. On les voit, docteurs et sorciers du village, guérir tour-à-tour leurs maîtres et s’en faire redouter; car s’ils savent calmer leurs maux, ils peuvent par les mêmes moyens, jetter des sorts sur leurs troupeaux et sur le cœur des jeunes filles. On assure que la verveine leur donne cette dernière puissance, surtout quand ils sont jeunes et beaux. Ainsi l’on voit que la verveine est encore chez nous, comme elle le fut chez les anciens, l’herbe des enchantemens.
Ivraie—Vice.—L’ivraie est l’emblême du vice; sa tige ressemble à celle du froment; elle croît avec les plus belles moissons.—La main du cultivateur sage et habile, arrache cette mauvaise herbe avec précaution, pour ne pas la confondre avec le bon grain. Ainsi un sage instituteur doit employer la patience pour déraciner les mauvais penchans qui naissent dans un jeune cœur. Mais il doit craindre d’étouffer les germes de la vertu, en croyant déraciner ceux du vice. La mère de Duguesclin se plaignait de voir son fils rentrer chaque jour au château, souillé de poussière et couvert de blessures; un matin, comme elle se préparait à le punir, une bonne religieuse l’ayant considéré, dit: Gardez-vous bien de le punir, car il viendra un tems où les défauts dont vous vous plaignez, feront la gloire de sa famille et le salut de son pays.—Pour une mère qui se trompe ainsi, combien d’autres s’empressent de cultiver l’ivraie dans le cœur de leurs enfans, et ne s’apperçoivent qu’il y a pris racine qu’au tems de la moisson.
Adonide—Douloureux Souvenirs.—Adonis fut tué par un sanglier. Vénus, qui avait quitté pour lui les délices de Cythère, versa des larmes sur son sort; elles ne furent point perdues; la terre les reçut, et produisit aussitôt une plante légère, qui se couvrait de fleurs semblables à des gouttes de sang. Fleurs brillantes et passagères, trop fidèles emblêmes des plaisirs de la vie, vous fûtes consacrées par la beauté même aux douloureux souvenirs.
Je n’ai jamais chanté que l’ombrage des bois,
Flore, Echo, les Zéphires et leurs molles haleines,
Le vert tapis des prés et l’argent des fontaines.
C’est parmi les forêts qu’a vécu mon héros;
C’est dans les bois qu’Amour a troublé son repos.
Ma muse en sa faveur de myrte s’est parée;
J’ai voulu célébrer l’amant de Cythérée,
Adonis dont la vie eut des termes si courts,
Qui fut pleuré des Ris, qui fut plaint des Amours.
Lafontaine, Poëme d’Adonis.

Le chardon, est-il dit dans le Dictionnaire de l’Industrie, est le plus grand ennemi de l’agriculture: après avoir ravi au froment l’engrais de la terre, il l’étouffe. Les laboureurs n’ont pu jusqu’à présent qu’en diminuer la quantité. Le Sieur Chevalier, vigneron à Argenteuil, leur offre, pour l’extirper entièrement, un moyen qu’il tient d’une expérience longue et réitérée.
C’est surtout dans les terres en jachère que le chardon prend son accroissement. Lorsqu’elles en sont affectées, il faut dans les premiers beaux jours du mois de Mars, (en France,) époque à laquelle le chardon pousse et montre quatre à cinq feuilles, labourer à sillons étroits, afin qu’il n’en échappe aucun au tranchant du soc. Quelques jours après, on herse. On labourera de nouveau, quelques semaines après, pour détruire ce qui n’était pas sorti de terre à la première pousse, et on hersera. Enfin, on répétera, s’il le faut, une troisième fois, et à la St. Jean d’été, il n’y aura pas un vestige de chardon. On observera qu’il suffit que le labour ait quatre pouces de profondeur, et il n’est pas nécessaire de prendre une charrue dossée. Mieux valent les labours donnés dans le croissant de la lune, le chardon étant alors plus en sève. Ces légers labours n’empêchent pas de semer la même année en bled. L’intervalle de la St. Jean au mois d’Octobre suffit pour raffermir la terre.
Un journal de Salem, dans l’état de Massachusett, disait, il y a quelques années: “Nous sommes redevables de ce qui suit à un habile cultivateur de cette ville, au sujet du chardon du Canada. Il nous assure qu’il l’a vérifié de la manière la plus satisfesante: ‘Si l’on coupe, nous a-t-il dit, le chardon du Canada, deux ou trois ans de suite, dans les prés et les pâturages, au mois de Juillet, à la pleine lune, il disparaîtra bientôt.’ C’est là sans doute un moyen facile et peu couteux. Quand donc le tems sera venu, que le cultivateur examine son champ, qu’il prenne sa faux, et qu’il fasse l’expérience.”
Nous avons entendu dire à des cultivateurs, qu’un moyen sûr de détruire les chardons, ce serait de les couper avec un couteau, ou autre instrument semblable, à fleur de terre, ou même un peu au-dessous de l’extrême surface du sol, en creusant dans le milieu de la partie restant en terre une espèce d’entonnoir, afin que l’eau de la pluie pût y pénétrer et la faire pourrir. Peut-être pourtant cela est-il plus beau à dire que facile à faire: car d’abord, sur une terre où il y aurait beaucoup de chardons, le procédé serait extrêmement long, à moins qu’il n’y fût employé un très grand nombre de bras: et il y a cet autre inconvénient, qu’il faudrait que l’opération se fît, si elle n’avait pu se faire le printems, avant que les graines de chardons fussent mûres et pussent être portées par le vent dans le voisinage, c’est-à-dire, longtems avant la saison pluvieuse de l’automne. Il nous paraît en outre, sinon tout-à-fait, du moins à-peu-près inutile à un cultivateur d’employer, soit une méthode, soit une autre, pour essayer de détruire les chardons sur sa terre, si ses voisins immédiats n’en font pas autant sur les leurs.

William Livingston, gouverneur du New-Jersey, descendait d’une famille anglaise, qui avait été obligée d’émigrer, et qui s’était rendue recommandable par ses talens, et par son attachement à la liberté. Livingston naquit à New-York en 1723. Il fit pressentir de bonne heure le rôle qu’il devait jouer dans le monde. Un travail opiniâtre, joint à beaucoup de mémoire et à une grande pénétration, lui facilitèrent l’étude de la littérature et celles des lois. Bientôt l’occasion se présenta de faire briller ses connaissances; ce fut à l’époque où la Grande-Bretagne souleva ses colonies par ses prétentions arbitraires. Livingston se déclara en faveur de la cause de la liberté, et consacra sa plume à défendre les droits de sa patrie. Après avoir rempli plusieurs places importantes à New-York, il fut nommé membre du congrès par le Nouveau-Jersey. Après l’établissement de la constitution et le départ de Benjamin Franklin pour le continent, Livingston fut placé à la tête de la Législature, et mérita, par ses vertus, d’y être conservé jusqu’à sa mort. Dans la guerre de l’indépendance, il vendit les services les plus signalés, par ses écrits: l’indignation dont ils animèrent les milices du Nouveau-Jersey contre la tyrannie anglaise, excita à un tel point leur courage, qu’aucune troupe ne fut aussi redoutable aux ennemis de l’Amérique. Livingston fut envoyé en 1787, à la fameuse convention qui établit la constitution des Etats-Unis; et, trois ans après, en 1790, il termina sa glorieuse carrière, dans sa terre d’Elisabethtown, après avoir occupé pendant douze ans, la place de gouverneur du New-Jersey.
On a de Livingston plusieurs ouvrages: 1o. Un poëme intitulé, La Solitude Philosophique; 2o. L’Éloge Funèbre du révérend Burr, cité comme un fort beau morceau d’éloquence, en 1758; 3o. Lettre à l’évêque Landaff, sur plusieurs passages de son sermon du 20 Février, 1767; 4o. Revue des opérations militaires au nord de l’Amérique, de 1753 à 1758. Enfin, il existe encore de lui un grand nombre de pièces fugitives, publiées dans différents ouvrages périodiques. Livingston est rangé au nombre des auteurs classiques. L’excellence de ses mœurs répondait à ses autres qualités; doux, affable, il était sans faste, plein d’humanité, et passait pour un modèle d’intégrité.—Journal de New-York.

Un journaliste français faisant mention de l’Atlas géographique, statistique, historique et chronologique des deux Amériques, publié récemment, à Paris, par M. A. Buchon, s’exprime ainsi:
Les plus vastes destinées commencent au-delà de l’Atlantique. Un monde nouveau, plein de jeunesse et d’avenir, s’élève en face de la vieille Europe, dont il a brisé les fers. Là où notre présomption croyait ne voir toujours que des colons dociles ou des esclaves soumis, des nations nouvelles se sont montrées tout-à-coup, et ont pris enfin possession pour leur compte de cette riche terre, que nous semblions leur prêter pour la cultiver à notre profit. A la place des comptoirs européens, neuf républiques et une monarchie se sont annoncées au monde. Les Etats-Unis, le Méxique, Guatemala, la Colombie, le Pérou, le Chili, le Haut-Pérou, Buénos-Ayres, le Paraguay, le Brésil, se sont distribué le vaste continent qui s’étend d’un pôle à l’autre, entre les deux océans.
Sur ce sol colossal tout, il est vrai, commence à peine. La terre semble sortir des eaux; trente millions d’hommes au plus occupent les bords des cinq lacs, les rives du Saint Laurent, les vallées de l’Ohio, du Missouri et du Mississipi, les grands plateaux du Méxique, les flancs des Cordilières du Pérou et du Chili, les immenses vallées de l’Orénoque, de l’Amazone et de la Plata. Tandis que dans notre Europe, nous avons vu des armées de six cent mille hommes se disputer des coins de terre, des armées de sept à huit mille hommes ont décidé du sort de ce vaste continent, et ont suffi pour le rendre à la liberté. Ainsi, chez lui tout n’est qu’avenir, mais cet avenir est immense. La terre vierge et féconde n’attend que la première semence pour produire; les hommes, les villes, les empires vont naître et se multiplier; et si on a vu, en trente années, la population triplée sur le sol des Etats-Unis, sous des latitudes septentrionales, que ne doit-on pas espérer sous le délicieux climat du Méxique et de la Colombie, sous le régime de la liberté, à l’ombre des lois les plus sages, et loin de nos vieux préjugés politiques? Plus heureuses que nous, ces deux jeunes Amériques vont hériter de notre savoir, de nos lois, de nos découvertes, sans avoir subi les cruelles expériences auxquelles nous les devons. Ces belles constitutions fédératives, ces pouvoirs sagement pondérés, cette égalité si désirée, tout ce qui nous a coûté à nous tant de sang et de larmes sans l’obtenir, ces machines puissantes, ces navires mus par la vapeur, ces routes merveilleuses qui abrègent les espaces, elles auront tout cela sans les efforts qu’il nous en a coûté; il semble même que le génie, éclairé chez elles par nos fautes, n’ôsera plus attenter à la liberté, qu’elles pourront avoir un grand homme sans qu’il devienne un usurpateur.
Tout ce qui se rattache à un pays si nouveau et si riche d’avenir, doit intéresser vivement la curiosité publique. Les deux Amériques sont peu connues, si ce n’est dans certaines parties parcourues par un voyageur célèbre. Encore peu de gens ont-ils lu les ouvrages de ce voyageur, et on manque de notions complètes sur les nouveaux états, que la politique, le commerce, doivent faire entrer dans leurs calculs. On ne pouvait donc rien imaginer de mieux aujourd’hui que de nous donner un atlas qui, exécuté d’après celui de Lesage, nous présentât, à côté de la description géographique des deux Amériques, le tableau de leur histoire, celui de leur population, de leurs productions, de leur commerce, etc. Aux Etats-Unis, où les sciences sont cultivées avec tant de succès, et ramenées surtout avec tant de soin à l’utilité pratique, on n’avait pas manqué d’exécuter un atlas des deux Amériques sur le plan dont nous parlons. Tout ce qui est relatif aux vingt-quatre états composant l’Union, y a été traité avec l’exactitude et la connaissance du sujet qu’on devait naturellement attendre de savans scrupuleux, placés sur les lieux mêmes dont ils donnaient la description. Les autres parties de l’Amérique, quoique fort bien traitées d’ailleurs, ne l’étaient pas d’une manière aussi satisfaisante peut-être, ni d’une manière aussi complète, puisque le temps n’a cessé d’amener depuis de nouveaux événemens.
M. Buchon, auquel nous devions déjà la grande entreprise de la Collection des Chroniques de Froissart et de Monstrelet, a imaginé de rendre au public français un nouveau service en traduisant l’atlas américain, et en le complétant, au moyen de documens nouveaux et plus récents. M. Buchon n’a rien pu ajouter à ce que renfermait l’atlas américain relativement aux Etats-Unis; mais il a complété tout ce qui touche aux colonies françaises; il a profité des savans ouvrages de M. de Humboldt, pour l’article du Méxique; il a donné des détails nouveaux sur Guatemala et le Paraguay; il a enfin ajouté à la partie historique les événemens importants arrivés depuis la confection de l’atlas américain, et il y a joint le texte de toutes les constitutions et un tableau comparatif de leurs différences. En un mot, l’ouvrage qu’il vient de donner est le monument géographique, statistique et chronologique, le plus complet que l’on puisse posséder aujourd’hui sur les deux Amériques.
Ce système d’atlas qui présente en regard la topographie, l’histoire, la statistique, est plus utile qu’on ne le pense. D’une part, l’aspect de la localité, de l’autre, le tracé net et rapide des événemens; le tableau des productions et du commerce, la quantité numérique de chaque chose en étendue, en population, en forment un ensemble de notions qui satisfait tous les besoins de l’esprit à la fois. Quelqu’un qui étudierait avec soin les belles cartes composant l’atlas américain de M. Buchon, qui aurait ensuite l’attention de lire les textes placés en marge et sur les cartes supplémentaires; qui ne serait point rebuté par les chiffres, qui suivrait tout le calcul comparatif des différentes quantités, aurait une idée suffisante de l’Amérique.

C’était, si je m’en rappelle bien, dans le mois d’Août 181-, que par un ordre spécial du quartier-général, alors à Montréal, les compagnies de flanc d’un régiment provincial se rendirent à une station particulière, sur la frontière du Bas-Canada, et furent jointes, sur la route, par une grosse troupe de guerriers sauvages du village de St. François, qui devaient leur aider à construire une redoute, et d’autres ouvrages propres à rendre la position tenable. C’était au milieu de bois touffus, sur les bords d’une petite rivière qui porte le tribut de ses eaux à l’énorme et majestueux fleuve St. Laurent, et dont le passage devait être commandé par les fortifications qu’on se proposait d’ériger. Pendant quelque tems, les fatigues du devoir, jointes à la paucité des vivres, dans ces lieux écartés, absorbèrent toutes nos pensées et tous nos soins; elles commençaient même à exciter les murmures de plusieurs, quand notre attention et notre intérêt furent portées, au moins en partie, sur un autre objet.
Notre campement, qui était un composé grotesque et bisarre de huttes de branches d’arbres et de cabannes d’écorce, était placé dans l’aire formée par l’extension subite, au point où il atteignait la rivière, d’un petit défilé, ou vallon, qui se prolongeait l’espace d’un mille, ou plus, à-peu-près en ligne directe, et qui ensuite prenait soudainement un détour qui empêchait qu’on pût le voit au-delà, de la rivière. Les bords en étaient élevés, et leurs sommités toutes couvertes d’arbres, parmi lesquels on remarquait surtout le sumach, avec ses riches touffes pourprées, et le bouleau à blanche écorce, dont le gracieux feuillage jettait une ombre tremblante sur les eaux du ruisseau, qui coulaient lentement et sans bruit, au milieu d’herbes hautes et épaisses, dont elles étaient par intervalles entièrement couvertes et cachées.
Nous étions stationnés depuis quelque tems dans cet endroit, quand, dans une nuit claire et sereine, le son lointain d’un instrument de musique, sortant en apparence des profondeurs de ce lieu retiré, fut entendu des diverses sentinelles postées autour du camp. Il ne se fit entendre que quelques minutes, et se termina par une lugubre cadence qui fut faiblement répétée par les échos d’alentour. Ceux qui dormaient alors se montrèrent un peu incrédules, quand on leur parla, le matin, de ce qui était arrivé, la nuit; mais leurs doutes furent bientôt dissipés: la nuit du surlendemain, la même musique instrumentale se fit entendre, mais plus longtems, et sur un ton plus élevé.
Cet étrange incident ne causa pas peu de surprise, et donna lieu à plus d’une conjecture parmi nous; car le témoignage de nos sens ne nous permettait plus aucun doute sur le sujet. Il n’y avait, à notre connaissance, ni maisons, ni habitans, à huit ou dix milles à la ronde; et la profonde solitude de la vallée enfoncée d’où paraissait venir cette mélodie nocturne, était de nature à ne pas laisser douter qu’elle ne pouvait servir de demeure qu’aux sauvages habitans des forêts. Des ordres positifs nous défendant de nous éloigner de notre camp, sous quelque prétexte que ce fût, nous ne pouvions trouver l’occasion d’explorer le lieu; et pour dire vrai, personne ne se sentait très enclin à le faire, dans la crainte de tomber entre les mains des sauvages ennemis, dont nous savions que des partis d’éclaireurs rodaient occasionnellement dans les environs.
Pourtant, un officier, accompagné de deux sauvages, ôsa, un jour, s’enfoncer dans le vallon; mais comme son exploration ne se faisait que furtivement et à la dérobée, elle ne put être que très imparfaite, et ne découvrit aucun vestige qui pût donner le moindre indice de la source d’où pouvait provenir cette harmonie magique que nous entendions, et qui par son exécution et son effet, semblait être passée du monde spirituel au temporel, pour l’enchanter, par sa beauté céleste. Cette harmonie avait un effet singulièrement frappant sur tous ceux qui l’entendaient, bien que par sa fréquente répétition, elle leur fût devenue familière. Cette répétition était néanmoins assez irrégulière; car on l’entendait quelquefois plusieurs nuits de suite; puis, toutes les deux ou trois nuits; quelquefois même elle cessait de se faire entendre pendant une semaine entière.
Les soldats canadiens, nationalement superstitieux, attribuaient cette musique à des êtres surnaturels, et l’appellaient la Harpe de la Fée, nom par lequel elle devint généralement connue et désignée parmi nous; et toutes les fois que ses tons enchanteurs s’élevaient au-dessus de la brise nocturne, tout discours, toute altercation et tout tapage étaient bannis d’entr’eux; et faisant le signe de la croix, ils écoutaient avec une attention mêlée d’une crainte respectueuse, effet ordinaire produit par tout ce qui tient du merveilleux, sur des âmes crédules. Je remarquais particulièrement l’impression qu’elle faisait sur les sauvages de notre camp: quoiqu’étrangers à l’harmonie musicale, ils prêtaient néanmoins à celle-ci une oreille attentive, en fumant assis autour de leurs feux; et j’ai observé plus d’un de ces hommes à visage tanné et fortement marqué des traits de la férocité, perdre quelque chose de sa fierté rechignée, quand, charmé par le début de cette mélodie, et en même tems intimidé par l’incertitude de son origine, il se tournait avec une espèce de circonspection, pour jetter un coup d’œil hagard, mais pourtant curieux et perçant, sur le vallon supposé enchanté, dont les parties élevées étaient éclairées par la lune, et les autres couvertes d’ombres épaisses, s’attendant probablement à voir le Manitou, ou l’esprit du lieu, employé à produire ces sons charmants, qui avaient littéralement le pouvoir d’apprivoiser son cœur farouche.
Quant à moi, bien que les sensations que j’éprouvais différassent de la superstitieuse vénération des Canadiens, et de l’étonnement silencieusement expressif de nos alliés incivilisés, je dois dire pourtant qu’elles étaient mêlées d’un enthousiasme qu’il me serait absolument impossible de définir. C’étaient des momens d’une délicieuse jouissance, que ceux où je prêtais une oreille attentive à cette musique plus que terrestre, qui se faisait ainsi entendre dans l’obscurité et le silence de la nuit, et répandait son charme enchanteur sur la solitude agreste qui nous environnait. Elle préludait ordinairement par une mélodie d’une douceur séraphique, qui devenait graduellement une harmonie abondante et sonore, si je puis parler ainsi, et se changeait tout-à-coup en une suite de sons forts et irrégulièrement énergiques et expressifs de sentimens passionnés; en des tons précipités, qui étaient portés au loin par les vents, et ressemblaient à ce que l’imagination pourrait se représenter comme la voix d’un ange dans l’agonie du désespoir. Cessant pendant quelques instans, cette musique recommençait par des tons de lamentation si lugubrement harmonieux, si mélancoliquement doux, que le cœur le plus dur ne pouvait demeurer insensible, et que l’œil le plus avare de pleurs, ne pouvait refuser une larme d’attendrissement, à ces touchants accords qui, par la douce impression qu’ils faisaient sur l’âme, semblaient être l’expiation de l’excès de la passion exprimé d’abord. Il y avait dans leur ravissante harmonie un enchantement indiscible, qui pénétrait dans les profondeurs de mon âme, et en absorbait toutes les facultés dans la ferveur de l’enthousiasme auquel il donnait lieu; et tant que durait la délicieuse illusion, cette partie de mon être n’était que le rêve romantique d’un homme éveillé, que la jouissance fantastique de plaisirs imaginaires.
Cette merveilleuse musique nocturne continua à nous charmer pendant un mois ou deux, puis elle cessa entièrement, et nous ne l’entendîmes plus jusqu’à l’époque de notre départ, qui eut lieu peu de tems après, en conséquence de l’ordre de prendre part à un mouvement offensif, qu’on devait faire, avant d’entrer en quartiers d’hiver.
(La fin au Numéro prochain.)

Mr. Green, l’aéronaute, rend compte de la manière suivante, des phénomènes observés par lui dans sa dernière ascension aérostatique. Il dit qu’en conséquence du grand vent qu’il faisait, ils craignaient beaucoup (lui et ses compagnons de voyage,) que l’aérostat ne fût poussé, en partant de terre, contre quelqu’un des bâtimens environnants; et que pour se mettre en garde contre un tel accident, il fit enfler le ballon beaucoup plus qu’il ne s’était proposé de le faire d’abord. Ils obtinrent, par ce moyen, une puissance d’ascension, qui les porta rapidement et presque perpendiculairement, à une hauteur considérable; après quoi, ils entrèrent dans un nuage qui leur déroba la vue de la terre. Ils continuèrent, pendant quelques minutes, à passer par une succession de nuages placés les uns au-dessus des autres, les plus bas étant, comme d’ordinaire, les plus denses et les plus opaques, et se trouvèrent enfin dans un espace pur, où il n’y avait ni nuée ni vapeur, et où le soleil brillait du plus grand éclat. Ils éprouvèrent bientôt une chaleur excessive, les rayons du soleil étant concentrés et réfléchis sur eux par les nuages qui étaient au-dessous, et le thermomètre qui, quelques instans auparavant, était à 50 degrés au-dessus de zéro, se trouva à 70 au-dessus. L’expansion du gaz, produite par cette augmentation de chaleur, fut si considérable, que quoique la soupape fût toute grande ouverte pour le laisser sortir, ils continuèrent à monter; et dix-sept minutes après qu’ils eurent laissé la terre, ils se trouvèrent à près de deux milles au-dessus de sa surface. Le baromètre, qui était à 29 degrés, lorsqu’ils avaient commencé à s’élever, n’était plus alors qu’à 21. En jettant les yeux, de cette élévation, sur les nuages par lesquels ils avaient passé, ils leur parurent comme une vaste étendue de pays couverte de neige. Ils apperçurent aussi alors dans les nuages opposés au soleil, une belle et parfaite réflexion de leur ballon et de ses entours, environnée de deux beaux cercles présentant, dans le plus grand éclat, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Le cercle le plus proche était à environ cent verges du ballon réfléchi, et l’autre à environ deux fois cette distance. Le premier était le plus brillant. Les nuages où s’observait cette curieuse illusion, étaient éloignés d’environ mille pieds de l’aérostat. Mr. Green dit que l’apparence n’était rien moins qu’extraordinaire: mais il ne se rappelle pas de l’avoir vue, lorsque le soleil était à plus de 50, ou à moins de 40 degrés au-dessus de l’horison. Il est peu ordinaire pourtant, dit-il, que les couleurs soient aussi vives qu’elles l’étaient, cette fois. L’illusion ne cessa pas tant qu’ils furent à cette élévation; mais elle suivit le progrès du ballon, et fournit aux aéronautes, par son mouvement, un moyen facile de s’assurer de la direction qu’ils suivaient.
On a dit que les oiseaux lâchés à cette hauteur, montrent des symptômes de crainte, et s’épuisent bientôt par la rareté de l’air. Au contraire, dit Mr. Green, il en fut lâché trois en cette occasion; ils volèrent d’abord en tous sens autour du ballon, et se mirent ensuite à descendre, et on les retrouva, le soir, à la maison, ne paraissant nullement fatigués de leur voyage. Il ajoute qu’il a observé plusieurs fois la même chose. Le cas pourrait cependant n’être pas le même, si l’on s’était élevé à une plus grande hauteur, et s’il n’y avait pas de nuages entre l’aérostat et la terre.
Après être demeurés environ une heure à cette élévation, ils commencèrent à descendre, et au bout d’un quart d’heure, ils se trouvèrent assez près de terre pour s’assurer qu’ils flottaient au-dessus d’une partie du comté de Kent. Étant descendu environ cent pieds plus bas, le ballon entra dans un courant d’air qui le porta au-dessus du comté d’Essex, de l’autre côté de la rivière; et quelques minutes après, ils avaient descendu facilement et sûrement sur les terres de Joseph Martin, de Rainham.
Mr. Green rapporte comme observation générale, qu’à une élévation de trois milles pieds, la terre semble être un niveau continu, les maisons et les arbres ne paraissant que comme autant de points colorés à sa surface. L’illusion est effectivement si parfaite, que Mr. Green, fils, dans sa première ascension, prit une plantation d’arbres pour un champ de fêves. Les rivières et les lacs sont en tout tems des objets faciles à distinguer: lorsque le soleil brille dessus, ils ont l’apparence d’un métal extrêmement bien poli. Mr. Green compare les premières à des veines d’argent courant sur la surface de la terre. Lorsque le soleil ne luit pas sur ces objets, ils ont une apparence triste et sombre. L’aspect de la mer, lorsque le soleil luit dessus, est extrêmement grand, au dire de Mr. Green, présentant, autant que l’œil peut atteindre, une vaste feuille d’acier poli.
Nous devons ajouter que Mr. Green a le mérite d’avoir perfectionné les aérostats, en construisant la soupape sur un nouveau plan, qui lui permet de vider le ballon du gaz qu’il contient, en beaucoup moins de tems qu’il n’en fallait auparavant.

Ce qui suit est extrait d’un discours prononcé par M. de Puymaurin, à la chambre des députés, le 12 Avril.
(L’ordre du jour est la continuation de la délibération sur les articles du projet de loi des douanes.
M. le Président lit les paragraphes 3 et 4 de l’article 1er. Parmi les articles compris dans ce paragraphe, se trouve le thé, qui, venant de l’Inde par navires français, est imposé à 1 fr. 50 cent. par kilog.; d’ailleurs, à 5 fr.; et par navires étrangers, à 6 fr.)
M. de Puymaurin demande que les droits sur les thés venant de l’Inde par les vaisseaux français, continuent à payer comme avant l’ordonnance de 1825; que ceux venant d’ailleurs paient un droit de 5 fr.; par vaisseaux étrangers, 6 fr. L’honorable membre déclare que si l’usage du thé devenait trop général, il nuirait beaucoup à nos vins. (Éclats de rire.)
Messieurs, s’écrie M. de Puymaurin, je vous prie de croire que je n’aime pas du tout à parler avec cet accompagnement-là. (On rit plus fort.) Si vous voulez m’entendre, je vous prie de m’écouter; sans cela, je descends de la tribune. (Le silence se rétablit un instant.)
Messieurs, reprend l’orateur, lorsque la compagnie des Indes anglaises fit présent à Charles II. roi d’Angleterre, de deux livres de thé, dont le cuisinier de la duchesse de Monmouth fit un détestable ragoût, (nouveaux éclats de rire,) on ne pouvait prévoir que, cent ans après, la consommation du thé en Angleterre lui donnerait un revenu de 50 millions. Charles II, en recevant ce thé, ne se doutait pas que le monopole de cette même feuille, par la compagnie des Indes anglaises, enlèverait à un de ses successeurs treize colonies importantes, formant actuellement la république des Etats-Unis. L’incendie, dans le port de Boston, d’une cargaison de thé arbitrairement taxé, fut le signal de l’incendie politique appellé insurrection de l’Amérique septentrionale, importée en France sous le nom de révolution; après l’avoir dévastée, elle a étendu ses fureurs sur le Piémont, le royaume de Naples, a désolé l’Espagne, et lui a fait perdre la domination du Pérou, du Chili et du Méxique. La Russie a échappé à peine à ses fureurs, et ses partisans conservent encore et fomentent de tout leur pouvoir de funestes espérances.
M. de Puymaurin veut que les Français, comme leurs vieux ancêtres, jouissent des bienfaits dont la Providence a comblé la France, sans aller acheter de la seconde main, dit-il, une plante étrangère dont l’usage pernicieux peut altérer cette gaîté, ce caractère franc et jovial de la nation française, pour nous gratifier du spleen et de tous ses agrémens. (Marques générales de gaîté.)
Chaulieu, Chapelle, Panard, Vadé, enfin tous nos chansonniers du 17. et du 18e. siècle, continue M. de Puymaurin, n’ont jamais bu de thé. Inspirés par le jus de la treille, ils chantaient les jeux et les plaisirs; et, par leurs joyeux refrains, ils entretenaient la gaîté et le bonheur. On ne connaissait pas alors de chansonniers politiques.
Si l’usage du thé devenait trop fréquent par la modicité de son prix, le caractère de la nation française changerait; le triste et fumeux estaminet remplacerait le joyeux cabaret (hilarité redoublée,) et les Français, tenant à la main la tasse de thé, aspireraient en même temps la fumée du tabac et la triste politique. (Rires continuels.) Abandonnons l’usage du thé aux penseurs par excellence, nos tristes voisins. J’ai déjà mérité l’animadversion d’un de leurs journaux en faisant mettre le droit actuel sur le thé. Il s’exprimait ainsi: “Un député gascon, ivre de vin et d’eau-de-vie, a fait l’éloge de ces détestables liqueurs, et fait taxer le thé.” Je désire continuer à mériter l’animadversion britannique. Je persiste dans mon amendement.
Ce que dit M. Puymaurin de l’influence du thé en France, pourrait se dire, au moins en partie, de l’influence de ce breuvage en Canada. Si le thé n’ôte pas aux Canadiens leur gaîté naturelle, il leur occasionne un surcroît de dépense auquel leurs pères étaient étrangers. Peut-être aussi la livre de thé bouillie, présentée à un voyageur anglais, par la femme d’un aubergiste canadien, comme un plat de légumes, vaut-elle le “détestable ragoût” du cuisinier de la duchesse de Monmouth.

Le général Gourgaud vient de faire paraître chez les frères Baudouin un discours que Napoléon écrivit à l’âge de vingt-un ans pour l’académie de Lyon. Il a pour titre: Sur les vérités et les sentimens qu’il importe le plus d’appliquer aux hommes pour leur bonheur. Cet ouvrage, extrêmement curieux, est suivi de pièces sur l’administration de Napoléon et sur ses projets en faveur des Grecs. Des rapports confidentiels du général Clarke au directoire exécutif, qui l’avait envoyé auprès du général en chef de l’armée d’Italie, ajoutent encore à l’intérêt de cette collection.
Les deux premiers volumes de l’Histoire générale de l’Europe, par M. de Lacépède, viennent de paraître. Ils confirment tout ce que l’annonce d’un si important ouvrage avait fait espérer.
On vient de publier un Mémoire très-curieux sur les événemens qui ont précédé la mort de Joachim I. roi des Deux-Siciles, par le général Franceschetti, suivi de la correspondance privée de ce général avec la comtesse de Lipano.
M. Briffaut, peu connu par les tragédies de Ninus et de Jeanne Gray, qui ne sont restées ni l’une ni l’autre au répertoire, a été nommé aujourd’hui membre de l’Académie française. Il avait pour concurrens M. Pougerville, traducteur de Lucrèce; M. de Barante, auteur de l’Histoire des ducs de Bourgogne, qui défend les libertés publiques avec tant de sagesse et de talent à la chambre des pairs; M. Vienne, auteur de plusieurs ouvrages dramatiques et d’une multitude de pièces étincellantes de verve et de patriotisme: mais ce n’étaient pas là des titres à la faveur ministérielle.
M. Sgricci, le plus célèbre improvisateur de l’Italie, le premier qui ait appliqué l’art, ou plutôt le don de l’improvisation au genre dramatique, se trouve en ce moment à Paris; il se propose de donner une séance publique dans la salle de la rue Cléry; il improvisera une tragédie en cinq actes et en vers sur un sujet donné par l’assemblée. On se rappelle l’admirable improvisation qu’il fit, il y a dix-huit mois, sur la mort de Charles I. Cette tragédie, recueillie par un sténographe, n’a rien perdu à l’impression, de la beauté du langage et des effets si profondément dramatiques qui avaient ému les spectateurs.
La comtesse Beniowsky, veuve de Maurice-Auguste Beniowsky, magnat de Hongrie et de Pologne, si connu par ses aventures extraordinaires, son exil au Kamschatka, son évasion, son voyage à travers l’océan Pacifique; par les mémoires publiés sous son nom, qui ont fait tant de bruit dans toute l’Europe, et plus en France par l’opéra dont un épisode de sa vie a fourni le sujet, vient de mourir à l’âge de 79 ans, dans sa terre de Virszka en Pologne.
M. Dubois, directeur des missions étrangères, a été admis à présenter à S. M. une traduction de fables indiennes.
Le roi vient d’acquérir, aux frais de la liste civile, la magnifique collection de monumens égyptiens déposée à Livourne. Le prix a été fixé à 250,000 francs. La France trouvera dans cette acquisition, dont l’importance historique et monumentale avait été exposée par M. Champollion le jeune, un ample dédommagement pour la collection Drovetti, qui est aujourd’hui à Turin, et qui avait excité tant de regrets.
La nouvelle collection française se compose d’environ trois mille morceaux; elle remplit cent dix-sept caisses, non compris les grands monumens de sculpture, où l’on remarque des sphynx de formes colossales, le sanctuaire monolithe de Philêe, un magnifique sarcophage royal tiré d’un tombeau de Thèbes, et la fameuse muraille numérique du palais de Karnac toute entière, bas-relief immense relatif aux conquêtes de Sésostris. Il y a aussi près de quatre-vingts manuscrits sur papyrus, qui sont égyptiens, grecs, coptes ou arabes; beaucoup de morceaux en or ou en pierres fines, notamment cinq figurines royales en or massif; de belles inscriptions égyptiennes ou grecques, et les plus rares productions de la peinture des anciens, telles que, 1o. les fresques entières d’un tombeau égyptien de Thèbes, où sont représentées des scènes d’agriculture, de chasse, etc.; 2o. plusieurs portraits du temps des Grecs, peints sur bois, et l’un d’eux sur toile.
M. le duc de Doudeauville, ministre de la maison du roi, a chargé M. Champollion le jeune de reconnaître la collection sur l’inventaire qui en avait été préalablement dressé, et de l’expédier à Paris. Elle sera bientôt un nouvel ornement pour la capitale, et un sujet inépuisable d’études pour les savans et les artistes.
MM. Rogron et Firback, avocats, rendent aujourd’hui à l’immortel Pothier un nouvel hommage; ils en publient une nouvelle édition en un seul volume in-8vo. Cette idée est heureuse; les avocats porteront Pothier au barreau comme ils y portent le code civil. Le meilleur des commentaires se trouvera ainsi à côté de la loi. L’exécution typographique nous paraît au-dessus de tout éloge. L’imprimeur, au moyen des espaces et des interlignes, a rendu ce livre aussi lisible que s’il était imprimé en caractères ordinaires; c’est le triomphe de l’art.
M. Pope a fait à la boussole un perfectionnement qui paraît consister à faire servir la même aiguille à indiquer la déclinaison et l’inclinaison dans toutes les latitudes; ce qui dispense de l’obligation d’avoir sur les navires, des boussoles différentes pour observer ces effets.
M. Rotch a inventé une clef à levier au moyen de laquelle les bâtimens peuvent abattre leurs mâts de hune et de perroquet en moins d’une minute, et les remettre en place en cinq minutes, sans amener une ride et sans démonter aucune autre partie des agrès qui dépendent de ces mâts: et cela avec le travail de deux hommes. Le gouvernement anglais a accordé une récompense de 3000 livres sterling à M. Rotch.
Une des plus grandes machines à vapeur maintenant en activité se trouve à la mine dite United-Mine, en Cornouaille. Elle élève 80,000 livres pesant à 1000 pieds d’élévation, par minute, au moyen d’environ 30 livres de charbon également par minute, et sa force est égale à celle d’environ 250 chevaux.
Voici une nouvelle qui va intriguer bien des savans; une peinture à fresque, découverte à Pompéia, représente le Vésuve en éruption et vomissant des flammes et des torrens de laves; des processions religieuses ont lieu au pied de la montagne; on distingue parfaitement dans le lointain le cap Misène et la ville de Néapolis. (Naples.) Il faut que le Vésuve soit aujourd’hui bien affaissé: il est évident que la montagne dite la Somma a été formée par les éruptions subséquentes, puisqu’elle ne figure pas dans le tableau.
Dans le mois de Juillet de l’année dernière, 1825, le capitaine Eeg, commandant la corvette hollandaise, Pollux, découvrit, dans l’océan pacifique, une nouvelle île, à laquelle il donna le nom de Nederlandich, ou Ile des Pays-Bas. Cette île est située par les 7° 10´ de latitude méridionale, et les 177° 33´ de longitude orientale, du méridien de Greenwich. La variation du compas y était de 7° à l’est. Il y a environ 50´ de différence entre la latitude de cette nouvelle île et celle du groupe d’îles appellées de Peyster. Elle est basse et a la figure d’un fer à cheval. Sa longueur est d’environ huit milles de 60 au degré. Elle est bordée de bancs de corail dont quelques uns s’avançent assez loin dans la mer. Cette île offre un aspect agréable et le terroir y paraît fertile. Les cocotiers et autres arbres fruitiers de ces climats y sont abondants. Les naturels sont de haute taille, fiers et, ajoute le capitaine Eeg, grands voleurs. Ils vont nus, à l’exception d’un petit tablier ou ceinturon d’écorce ou de feuilles passé autour des reins. Quelques uns avaient la tête ornée de plumes. Il y en avait environ 300, tant hommes que femmes d’assemblés sur le rivage. Ils paraissaient ignorer l’usage des armes à feu, c’est-à-dire, n’avoir point vu encore d’Européens, et même l’art de la navigation; car le capitaine Eeg ne vit aucune pirogue sur le rivage. Cette île ne paraît pas faire partie d’un groupe: car quoique le tems fût clair, on n’en apperçevait aucune autre dans les environs.
La Gazette Littéraire, (Literary Gazette,) des Etats-Unis, parlant des langues qui se parlent dans les deux Amériques, dit que les langues sauvages, ou indigènes, sont parlées par sept millions et demi d’habitans, et les langues européennes, comme suit, savoir: l’anglaise, par onze millions et demi; l’espagnole, par dix millions; la portugaise, par trois millions; la française, par douze cent mille; la hollandaise, la danoise et la suédoise, par deux cent mille.
Si la Gazette Littéraire rencontre juste, quant aux autres langues parlées en Amérique, elle se trompe évidemment, par rapport à la française: car d’abord, si la population d’Hayti n’était pas tout-à-fait d’un million d’âmes, celle de la Guiane et des Iles françaises est assez-au-dessus de cent mille, pour remplir le déficit, et former, en total, au moins onze cent mille individus: et puis, la population française du Bas-Canada, du Haut-Canada, et des autres colonies de l’Amérique britannique, ainsi que des territoires sauvages appellés Pays d’en haut, ne peut pas être de moins d’un demi million d’âmes, ni celle de la haute et basse Louisiane, de moins de cent mille; faisant un total de six cent mille, qui joint à onze cent mille, donne un grand total de dix-sept cent mille individus parlant la langue française dans les deux Amériques. Si l’on faisait entrer dans le calcul les Français établis dans les grandes villes des Etats-Unis, et dans les divers états de l’Amérique ci-devant espagnole, le nombre total ne s’éloignerait pas beaucoup de 1,800,000.
La Gazette Littéraire parait se tromper aussi par rapport à la langue portugaise. Le Brésil est en effet peuplé, suivant les géographes, de trois millions d’habitans; mais il s’en faut de beaucoup que tous ces habitans parlent la langue des Portugais.

En voyant les charmantes coiffures en cheveux que nos artistes inventent tous les jours, on a peine à concevoir comment il fut des femmes qui aient pu échanger les précieux ornemens que la nature leur donne, contre la ridicule manie des perruques! L’antiquité cependant nous prouve que le goût était assez dégénéré chez notre sexe, pour voir la plus belle chevelure sacrifiée à un usage baroque. Il est évident qu’à Rome, la mode des perruques était devenue générale sur les derniers tems de la république.—Tibulle, Ovide, Properce et Gallus ont chanté les perruques de leurs maîtresses. Ce fut Plautine, femme de Trajan, qui introduisit à Rome les perruques à l’Andromaque, dont parle Juvénal dans sa sixième satyre. Elles s’élevaient par étage sur le devant de la tête, et formaient une espèce de turban à triple rouleau. L’illustre Adrien Valois a recueilli quatorze médailles d’impératrices romaines, et sur chacune de ces médailles on voit une perruque différente.
Les petites-maîtresses romaines avaient sur leur toilette diverses perruques, pour les différentes heures du jour: elles portaient en chenille le galéricon, espèce de petit casque: le corymbion était pour les visites d’étiquette, les promenades et le spectacle.—Othon, au rapport de Suétone, se servait du galéricon pour cacher sa calvitie; mais la perruque la plus fameuse de l’antiquité fut, sans contredit, celle de l’empereur Commode: c’était le corymbion dans tout son éclat; et Lampride en a fait une description qui mérite de passer à la postérité. Il faut voir, dit l’historien, ce prince, apparemment seul avec ses remords et sans craintes, n’osant confier son cou royal au rasoir d’un barbier, ni son front à l’aiguille du coiffeur, se brûlant lui-même les cheveux et la barbe, apportant devant son miroir sa vaste perruque, imprégnée de parfums et d’essences, et la rendant d’un blond si ardent avec de la poudre d’or, que lorsqu’elle était frappée des rayons du soleil, on eût dit que le feu prenait à sa tête.
Les perruques étaient certainement d’usage chez les Phéniciennes. Qui ne sait en effet qu’aux funérailles d’Adonis, elles devaient à la déesse Ergetto, la Vénus de Tyr, le sacrifice de leur pudeur ou celui de leurs cheveux.
Mausole, roi de Carie, aimait beaucoup l’argent, et ses peuples aimaient presqu’autant leurs cheveux. Que fit Mausole?......Aristote nous l’apprend: il remplit ses magasins de perruques achetées au rabais chez les nations voisines, et condamna ensuite, par un édit solennel, toutes les têtes lyciennes, sans distinction d’âge ni de sexe, à se faire tondre en vingt-quatre heures. Les perruques furent bientôt achetées à un prix excessif et le trésor du prince s’enrichit en un instant de plusieurs millions. Plaisant impôt, qui dut faire rire beaucoup de contribuables!
A Babylone, les mariages se faisaient en perruque, car les lois assyriennes défendaient aux jeunes gens des deux sexes de se marier avant d’avoir coupé leurs cheveux, et de les avoir appendus dans le temple de Bélus, en l’honneur de l’immortel brochet Oannès.
En Egypte, les perruques, au rapport de Bellon, s’élevaient tantôt en pyramides, tantôt en forme de tours, et ressemblaient, assez à cette espèce de coiffure dont les poètes et les peintres ont affublé Cybèle.
P. C.

Quoique nous soyons en paix, l’Ode suivante sur la Guerre, d’un de nos compatriotes, que nous trouvons dans le Vol. III du Courier de Québec, nous a paru mériter de trouver place ici, ne serait-ce que pour être conservée plus surement. D’ailleurs, la guerre ne fait que de se terminer dans l’Inde: elle exerce encore ses ravages dans le beau pays de Grèce, et elle est peut-être sur le point d’ensanglanter les fertiles plaines du Brésil et du Paraguay. Et puis, la description d’une chose qui, par malheur, arrive si souvent, nous semble venir toujours à-propos, surtout quand on y trouve le mérite d’un bon style, et comme ici, d’une bonne versification.
LA GUERRE.
Bellone, jusqu’à quand ta rage frénétique
Veut-elle désoler nos peuples malheureux?
Et pourquoi voyons-nous de leur sang héroïque
En tous lieux prodiguer les torrens généreux?
La terre infortunée est livrée au pillage,
Aux flammes, aux combats, aux meurtres, au carnage;
Et la mer n’apperçoit sur ses immenses bords
Que des naufrages et des morts.
Ce monstre au front d’airain, le démon de la guerre,
Monstre avide de sang et de destruction,
Ne s’est donc arrogé l’empire de la terre
Que pour l’abandonner à la proscription?
Jamais le vieux Caron n’a tant chargé sa barque;
De ses funestes mains, la redoutable Parque
N’a jamais à la fois rompu tant de fuseaux,
Où tenaient les jours des héros.
La discorde barbare encor toute sanglante,
Secouant ses flambeaux, excitant ses serpens,
De l’antique chaos sombre et farouche amante,
Ebranle la nature et poursuit les vivans:
Elle guide leurs pas d’abymes en abymes;
Le désespoir, la mort, la trahison, les crimes,
Complices et vengeurs de ces cruels forfaits,
Couvrent la terre de cyprès.
Quel transport inoui? quel nouveau feu m’anime?
Un dieu subitement s’empare de mes sens;
Apollon me possède, et son esprit sublime
Va prêter à ma voix ses immortels accens.
Que l’univers se taise aux accords de ma lyre;
Rois, peuples, écoutez ce que je dois vous dire;
Appaisez les transports de vos sens agités,
Pour recevoir ces vérités.
Vous, juges des humains, vous nés dieux de la terre,
Oppresseurs orgueilleux de ce triste univers,
Si vos bras menaçants sont armés du tonnerre,
Si vous tenez captifs ces peuples dans vos fers,
Modérez la rigueur d’un pouvoir arbitraire;
Ces humains sont vos fils; ayez un cœur de père:
Ces glaives enfoncés dans leur malheureux flanc,
Sont teints de votre propre sang.
———————
BOUTS RIMÉS.
Un des amis de l’auteur lui ayant donné les rimes suivantes, entrer, pénétrer, &c. il les remplit comme il suit:
Dans tes champs,[1] cher Tircis, je voudrais bien entrer;
Mais qui m’empêche, hélas! d’y pouvoir pénétrer?
Nous jouirions tous deux d’une agréable vie:
Une vraie amité, c’est là ma seule envie.
Ah! malgré tes rigueurs, tu me vois revenir:
Contre tous mes souhaits crois-tu longtems tenir?
Au prix de l’amitié, j’abhorre la richesse;
L’amitié, selon moi, fait la seule noblesse.
Soyons toujours unis, Tircis, un jour viendra,
Où peut-être sur nous la foudre éclatera.
Mais nous pouvons nous mettre à l’abri de l’orage:
Oui, par notre amité, nous fuirons le naufrage.
Un autre ayant vu ces vers, reprocha à l’auteur qu’il avait attaqué l’amitié sincère de Tircis; puis, lui ayant donné, à son tour, quelques rimes, il les remplit de la manière suivante:
De Tircis, dites-vous, j’accuse l’amitié?
Quels vains soupçons, Alcas, dites-moi, par pitié.
Pourquoi me blâmez-vous? Faut-il donc entreprendre
Ces vers pour vous prouver que j’ai toujours su rendre
Justice au cher Tircis. Loin de m’encourager,
Pour douze pauvres vers, vous voulez m’affliger.
Eh! si mes vers ont dit qu’à ma grande tendresse
Tircis ne répond pas, Muse blâme et caresse,
Sans raison: mais mon cœur dit qu’à mes tendres vœux
Tircis répond toujours; et je m’en trouve heureux.
———————
Monsieur M. Bibaud.
Monsieur—Si vous croyez que ces petites pièces amuseront vos souscripteurs, vous les insérerez dans votre Bibliothèque Canadienne.
Je suis, &c.
UN SOUSCRIPTEUR.
LE MÉNAGE TROUBLÉ.—FABLE.
Après six ans de mariage,
Blaise avec sa femme Isabeau,
Faisait encore bon ménage.
Pour prix d’un exemple si beau,
Dans la maison chacun fut sage;
L’enfant, le chien, le chat, l’écureuil et l’oiseau.
Noé, quand il sauva de l’eau
Les restes de l’humaine engeance,
Ne vit jamais régner si bonne intelligence,
Dans l’enceinte de son bateau.
Or il advint, qu’un jour de fête,
Blaise but tant qu’il en perdit la tête!
Devinez-vous ce qu’il fit en rentrant?
Notre ivrogne battit sa femme.
Pour calmer son dépit, le soir, la belle dame
A son tour étrilla l’enfant;
L’enfant pinça le chien; le chien mordit la chatte;
La chatte à l’écureuil riposta de la patte,
Et l’écorcha, je ne sais où.
Enfin d’un coup de dent, l’écureuil en colère,
Au pauvre oiseau tordit le cou.
Ainsi, la faute d’un seul fou
Trouble une république entière,
Et le forfait du coupable puissant
Est toujours expié par le faible innocent.
———————
LE BON MÉNAGE.—CONTE.
Le Mari.
Pourquoi toujours à la maison
Es-tu triste, ma chère amie?
Ailleurs tu prends un autre ton,
Et tu parais plus réjouie.
La Femme.
La femme et le mari ne font qu’un, nous dit-on;
Quand je suis seule je m’ennuie.
———————
LE LIEUTENANT GASCON.—CONTE.
Figeac, savez-vous la nouvelle?...
Non, mon général; quelle est-elle?...
Une étoile que l’on mettra
Sur l’habit du preux le plus digne,
Dorénavant annoncera
Chaque trait de valeur insigne....
Sandis, pour cet arrangement
Combien je dois au ministère!
Avant qu’il soit un an de guerre,
Je semblerai le firmament.
(Mercure français.)
———————
MADRIGAL.
Rossignols, n’est-ce point assez?
Et voulez-vous toujours par un chant doux et tendre,
Rappeller mes tourmens passés?
Non, non, je ne puis vous entendre;
Mes ennuis par le tems ne sont point effacés.
———————
STANCES MAROTIQUES À MON ESPRIT.
(Par feu M. Q.....l.)
Non, mon esprit, vous n’êtes sot;
Mais onc ne fûtes philosophe:
Point n’est sagesse votre lot;
Pourtant ne manquez pas d’étoffe.
Point trop mal vous dites le mot;
Assez bien raillez sans déplaire;
Or un sot ne le pourrait faire;
Non, mon esprit, nous n’êtes sot.
Mais flatter ne fut mon métier:
Par tant souffrez cette apostrophe;
Bien êtes un peu singulier;
Mais onc ne fûtes philosophe.
Triste, gai, libertin, dévot,
Sans fin variez votre assiète;
Et donc à bon droit je répète,
Point n’est sagesse votre lot.
Or évitez des esprits vains
Commune et triste catastrophe;
Car certes n’êtes des plus fins;
Pourtant ne manquez pas d’étoffe.
|
On fait ici allusion à l’éloge de Tircis et Palêmon, (inséré dans le No. 6, du Tome II.) |

Je m’étonne que les environs de Québec, et les paroisses qui l’avoisinent en remontant, ne soient pas couronnés de vergers. Le terrain est très propre aux pommiers: leur multiplication serait une source inépuisable de richesses pour le cultivateur. Par ce moyen, il retirerait les plus grands avantages de l’exploitation d’un terrain, trop sec et trop pierreux, en beaucoup d’endroits, pour être susceptible de rien produire autre chose.[1] La nature semble inviter les habitants à se livrer à ce genre de culture. En bien des endroits, ces arbres croissent d’eux mêmes, sans éprouver aucun soin, et comme malgré ceux qui les possèdent sur leurs terres. Le peu que l’on en voit le long des routes et près des maisons, accusent les propriétaires de négligence et d’incurie: ils ne sont point taillés, ou ne le sont que très mal, aussi bien que mal placés et mal soignés; cependant les habitans se plaignent de leurs terres, et crient hautement qu’elles sont stériles. N’est-ce pas leur faute? Ne serait-ce pas aussi celle de ceux qui peuvent avoir quelqu’influence sur le peuple, qui négligent de l’exercer comme les habitans eux-mêmes négligent de cultiver leurs terres? La meilleure pomme de Montréal vient de Québec, où elle croissait naturellement.[2] Elle se trouve à présent à peine dans son pays natal. Pourquoi les personnes aisées de ce district, qui ont des lumières, ne travaillent-elles pas à faire naître le goût de la culture des pommiers, et à l’éclairer? Outre le profit qui en serait le résultat, et qui centuplerait le produit de certaines terres, l’abondance du fruit mettrait les habitans à même de faire beaucoup de cidre. On pourrait en transporter d’une extrémité de la province à l’autre, et il pourrait devenir un objet d’exportation.
Il faut observer que le cidre de ce pays est excellent, quand il est fait avec un peu de précaution; il est sinon supérieur, du moins égal au meilleur que l’on boit en Europe et dans les Etats-Unis, au jugement des connaisseurs. Cette boisson saine et peu couteuse pourrait tenir lieu, jusqu’à un certain point, des boissons fortes, dont le goût est malheureusement trop répandu en ce pays: source funeste et empoisonnée de la misère d’un grand nombre de cultivateurs, et la ruine, dans beaucoup de familles, de l’industrie, du travail et des mœurs. L’usage du cidre pourrait encore diminuer la consommation excessive du rhum ou eau-de-vie des Iles. Ce serait autant de gagné pour la province, et pour les familles industrieuses. Quelques uns diront peut-être que le commerce en souffrirait; car on le dit aussi mal-à-propos en bien des occasions. Mais sa ressource la plus assurée et son appui le plus ferme, c’est la richesse et l’industrie du cultivateur, qui achète et paie bien quand il est aisé, sage et laborieux; qui fait tout le contraire quand il est vicieux, pauvre et malheureux. Les angoisses où est réduit le commerce même, dans quelques parties de cette province, ont leur cause dans la misère des campagnes; et c’est une preuve assez frappante de ce que j’avance. Beaucoup de gens feraient en ce pays comme font ces sauvages d’Afrique qui abattent l’arbre pour en cueillir les fruits.....je m’arrête: j’aurais une foule d’idées à mettre au jour sur cet objet qui me mèneraient trop loin. Je n’ai ni le loisir ni les talens nécessaires pour le mettre en œuvre. Je laisse à des mains plus habiles le sujet à manier. Il est fécond autant que les terres de ce pays qu’on néglige, et qui par cette raison deviennent quelquefois stériles.—UN VOYAGEUR.
Nous ne saurions dire si depuis que ce morceau a été écrit, c’est-à-dire, si depuis une vingtaine d’années, il s’est opéré un changement pour le pis ou pour le mieux, par rapport à la culture des arbres fruitiers, et particulièrement des pommiers. Nous savons que depuis lors, il s’est formé un grand nombre de vergers là où il n’y en avait point; mais aussi plusieurs anciens vergers, ou n’existent plus, ou ne sont presque plus rien. Quoiqu’il en soit, nous ne pourrons croire que les habitans de Montréal en particulier aient tiré le meilleur parti des avantages que la nature leur a donnés sous le rapport de culture en question, que quand nous aurons vu le terrain inculte ou peu utilement cultivé des environs de leur montagne, tout couvert de vergers.
|
Je pourrais citer entr’autres un Mr. Roy, qui soigne environ trois milles pommiers en rapport dans un terrain situé au pied de la montagne qui avoisine Montréal, Mis en grains, il ne rendrait pas à ce laborieux cultivateur les frais de sa culture; mais au moyen des pommiers, il lui paie abondamment ses peines et ses travaux, et le fait vivre d’une manière honorable. |
|
Le Bourassa.—La culture des pommiers passe pour être extrêmement négligée dans l’île d’Orléans, où elle serait, dit-on, plus profitable, plus nécessaire que partout ailleurs, et où, dit-on, elle a été autrefois florissante. |

Pour moi, je voudrais qu’on n’eût pas pris l’aigle pelé pour l’emblême de notre pays: c’est un oiseau d’un mauvais caractère moral: il ne se procure pas sa nourriture honnêtement. Vous devez l’avoir vu perché sur un arbre où, trop paresseux pour pêcher lui-même, il regarde pêcher le faucon; et lorsque cet oiseau diligent a enfin pris un poisson, et le porte à son nid, pour le soutien de sa compagne et de ses petits, il le poursuit et lui ravit sa proie. Malgré toutes ses rapines, il n’est jamais bien dans ses affaires; et comme ceux qui, parmi les hommes, vivent de vol et de pillage, il est ordinairement très pauvre, et souvent très pouilleux. C’est en outre un franc poltron; le roi, qui n’est pas plus gros qu’un moineau, l’attaque hardiment et le chasse de l’endroit. Il ne peut donc être un emblême pour les braves et honnêtes Américains, qui ont chassé de notre pays tous les rois, bien qu’il convienne parfaitement à cet ordre de chevaliers que les Français appellent “chevaliers d’industrie.” A cause de tout cela, je suis bien-aise que la figure ne soit pas connue pour être celle d’un aigle pelé, mais ressemble assez à celle d’un dinde. Car, dans le fond, le dinde est un oiseau plus respectable que l’aigle pelé; et après tout, c’est un oiseau originaire d’Amérique. On trouve des aigles dans tous les pays; mais le dinde est particulier au nôtre, le premier oiseau de cette espèce qui ait été vu en Europe, ayant été porté en France par les jésuites du Canada, et servi au repas de noces de Charles IX. Le dinde est en outre, (quoiqu’à la vérité un peu vain et un peu sot, ce qui ne rend pas l’emblême pire,) un oiseau courageux, qui n’hésiterait pas d’attaquer un grenadier des gardes anglaises, s’il ôsait envahir sa cour en habit rouge.

Parva rogas magnos, sed non dant haec quoque magni:
Ut pudeat leviùs te, Matho, magna roga.
Esse nihil dicis quicquid petis, improbe Cinna:
Si nil, Cinna, petis, nil tibi, Cinna, nego.
Semper eris pauper, si pauper es, Æmiliane;
Dantur opes nullis nunc nisi divitibus.
Difficilis, facilis, jucundus, acerbus es idem;
Nec tecum possum vivere, nec sine te.
Versiculos in me narratur scribere Cinna;
Non scribit cujus carmina nemo legit.
Ta lettre, Merlin, me propose
Qu’un gros sot en rythme compose
Des vers par lesquels il me poinct;
Tien-toy seur qu’en rythme, n’en prose,
Celui n’écrit aucune chose
Duquel l’ouvrage on ne lit point.

La Grèce est encore aujourd’hui la galerie la plus magnifique de l’univers. Là l’imagination ouvre le volume des siècles, et déchire le voile qui en cache les beautés. Chaque pas offre un tableau, chaque tableau un trait sublime d’histoire, chaque trait d’histoire une leçon. Quel malheur que les habitans de cette terre, riche en souvenirs, n’aient conservé de leurs pères que les défauts, et non les vertus! Ils ont encore cependant des traces brillantes de leur ancienne grandeur, dans leur langage et dans leur esprit. La langue grecque, quoique corrompue, peint encore mieux que toute autre de l’Europe l’image du sentiment; et l’esprit des Grecs, quoique paralysé par l’ignorance, s’élève quelquefois, et ne dément point le caractère de son origine. Mais, ô avilissement de l’esprit humain! les descendans d’Aristide et d’Epaminondas tremblent devant un Turc!
P. S.—Il y a déjà plusieurs années qu’il n’en est plus ainsi.

Valère Maxime nous apprend qu’au second triumvirat, les trois assassins, maîtres de Rome, avides d’or, après avoir épuisé toutes les formes de brigandages et toutes les manières de piller, s’avisèrent de taxer les femmes, et d’imposer par tête une forte contribution. Les femmes cherchèrent un orateur pour les défendre, et n’en purent trouver; personne n’est tenté d’avoir raison contre ceux qui proscrivent. La fille du célèbre Hortensius se présenta seule; elle fit revivre les talens de son père, et défendit la cause des femmes avec intrépidité. Les tyrans rougirent, et révoquèrent leurs ordres. Hortensia fut reconduite en triomphe; et une femme, dans ces tems malheureux, eut la gloire d’avoir donné un example de courage aux hommes, un modèle d’éloquence aux femmes, et une leçon d’humanité aux tyrans.
[Thomas, Essai sur les Femmes.

Un jour que vêtu d’une redingotte boutonnée, qu’accompagné d’un seul domestique sans livrée, Joseph II. était allé dans une calèche à deux places qu’il conduisait lui-même, faire une promenade du matin aux environs de Vienne, il fut surpris par la pluie, comme il reprenait le chemin de la ville. Il en était encore éloigné, lorsqu’un piéton, qui regagnait aussi la capitale, entendant derrière lui le bruit d’une voiture, se retourne, l’attend, s’en approche, et fait signe au conducteur d’arrêter. Joseph arrête ses chevaux. Monsieur, lui dit le militaire, car c’était un sergent invalide, y aurait-il de l’indiscrétion à vous demander une place à côté de vous? Cela ne vous gênerait pas prodigieusement, puisque vous êtes seul dans votre calèche, et cela ménagerait mon uniforme, que je mets aujourd’hui pour la première fois. Ménageons votre uniforme, mon brave, lui dit l’empereur, et mettez-vous là. D’où venez-vous comme cela? Ah! ah! d’où je viens, dit le sergent, je viens de chez un garde-chasse de mes amis, où j’ai fait un fier déjeuné.—Qu’avez-vous donc mangé de si bon?—Devinez.—Que sais-je, moi; une soupe à la bière?—Ah! bien oui, une soupe! Mieux que ça.—De la choucroute?—Mieux que ça.—Une longe de veau?—Mieux que ça, vous dit-on.—Oh! ma foi, je ne sais plus que deviner, dit Joseph.—Un faisan, mon digne homme, un faisan tué sur les plaisirs de sa majesté, dit le camarade, en lui frappant sur l’épaule.—Ah! tué sur les plaisirs de sa majesté; il n’en devait être que meilleur.—Je vous en réponds.
Comme on approchait de la ville et que la pluie tombait de plus belle, Joseph demanda au compagnon dans quel quartier il logeait, et où il voulait qu’il le descendît.—Monsieur, c’est trop de bonté; je craindrais d’abuser de......—Non, non, votre rue? Le sergent indiquant sa demeure, demanda à connaître celui dont il recevait tant d’honnêtetés.—A votre tour, dit Joseph, devinez.—Monsieur est militaire, sans doute?—Comme dit monsieur.—Lieutenant?—Ah! bien oui, lieutenant; mieux que ça.—Capitaine?—Mieux que ça.—Colonel, peut-être?—Mieux que ça, vous dit-on. Comment, diable, dit l’autre, en se rencognant dans un coin de la calèche, seriez-vous feld-maréchal?—Mieux que ça.—Ah! mon dieu: c’est l’empereur!—Lui-même, dit Joseph, en se déboutonnant pour montrer ses décorations.
Il n’y avait pas moyen de tomber à genoux dans la calèche. Le sergent se confond en excuses, et supplie l’empereur d’arrêter, pour qu’il puisse descendre. Non pas, non pas, lui dit Joseph; après avoir mangé mon faisan, vous seriez trop heureux, malgré la pluie, de vous débarrasser de moi aussi promptement; j’entends bien que vous ne me quittiez qu’à votre porte; et il l’y descendit.

Le Journal de Médecine de Québec, No. III, contient, outre un nombre d’articles communiqués sur des sujets importants, plusieurs morceaux qui font honneur à l’application et aux talens de l’éditeur, et comme médecin et comme écrivain. Le peu de place qui nous reste ne nous permet pas d’en faire présentement des extraits longs et variés; mais nous pourrons revenir, une autre fois, sur le sujet. Les passages suivants sont extraits de l’Analyse critique d’un ouvrage important de feu P. A. Béclar, ci-devant Professeur d’Anatomie, intitulé, Elémens d’Anatomie générale, ou Description de tous les organes qui composent le corps humain.
“L’homme se distingue des autres mammifères, par quelques différences peu importantes dans les organes des fonctions végétatives, par quelques autres plus marquées dans les organes des fonctions animales, mais surtout par l’intelligence.
“L’intelligence qui constitue l’homme, est surtout caractérisée par la conscience, par la raison, par une volonté libre, par le sentiment moral et par celui d’une cause divine.”
“Les actes intellectuels et moraux différent tellement des phénomènes organiques, qu’ils ne peuvent dépendre de la même cause: ils seraient en effet aveugles et nécessaires, au lieu d’être éclairés et libres. La physiologie, qui d’un côté se rencontre avec la physique ou la philosophie naturelle, se rencontre ici avec la philosophie morale ou la métaphysique.”
“L’Espèce humaine présente des différences d’organisation héréditaires dans les races ou variétés répandues sur le globe, et qu’on peut rapporter à cinq, dont trois principales; savoir la caucasienne, la mongole et l’éthiopienne, et les races malaie et américaine.
“La race caucasienne, à laquelle nous appartenons, se fait remarquer par la beauté de la forme et des proportions de la tête, dans laquelle le crâne l’emporte de beaucoup sur la face; ce dont on se convainc par la plus simple inspection comme par l’application des méthodes céphalométriques. Le crâne est arrondi et élevé, la face est ovale, ses parties sont peu saillantes. La coloration de la peau est généralement blanche et rosée, celle des yeux est bleue ou brune, celle des cheveux, en général nombreux, fins et longs, varie du blanc au noir.
“Cette race se fait particulièrement remarquer par le développement de son intelligence, par la civilisation et par la culture de la philosophie, des sciences et des arts. Les races colorées, au contraire, l’emportent par la perfection plus grande des sens.
“La race mongole se reconnaît à la force du tronc, à la petitesse des membres, à la forme presque carrée de la tête et à la saillie des pommettes, à l’écartement, à l’étroitesse et à l’obliquité des yeux; la couleur de la peau est olivâtre; les cheveux sont droits, noirs et courts; la barbe est rare, et manque quelquefois tout-à-fait.
“La race nègre a le tronc mince, surtout aux limbes et au bassin; les membres supérieurs sont longs, surtout l’avant-bras; les mains sont petites, les pieds grands et aplatis; le genou et le pied sont tournés en dehors; la tête est étroite et allongée; la partie inférieure de la face est saillante; le nez est écrasé; les dents antérieures sont obliques et les lèvres saillantes; la peau, l’iris et les cheveux sont noirs: ceux-ci sont crépus, et la barbe est peu épaisse.
“La race américaine a des caractères anatomiques moins tranchés, et semble intermédiaire à la race caucasienne et à la race nègre. La peau est d’un rouge cuivré; les cheveux sont noirs, droits et fins, et la barbe rare ou nulle.
“La race malaie est, comme la précédente, peu distincte par des caractères tirés de l’anatomie: elle paraît intermédiaire aux premières. Dans cette race la peau est brune ou basanée, et les cheveux épais et frisés.”
Mis-spelled words and printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Inconsistency in hyphenation has been retained.
Inconsistency in accents has been corrected or standardised.
When nested quoting was encountered, nested double quotes were changed to single quotes.
Space between paragraphs varied greatly. The thought-breaks which have been inserted attempt to agree with the larger paragraph spacing, but it is quite possible that this was simply the methodology used by the typesetter, and that there should be no thought-breaks.
[The end of La Bibliothèque Canadienne, Tome III, Numero 2, Juillet, 1826. edited by Michel Bibaud]