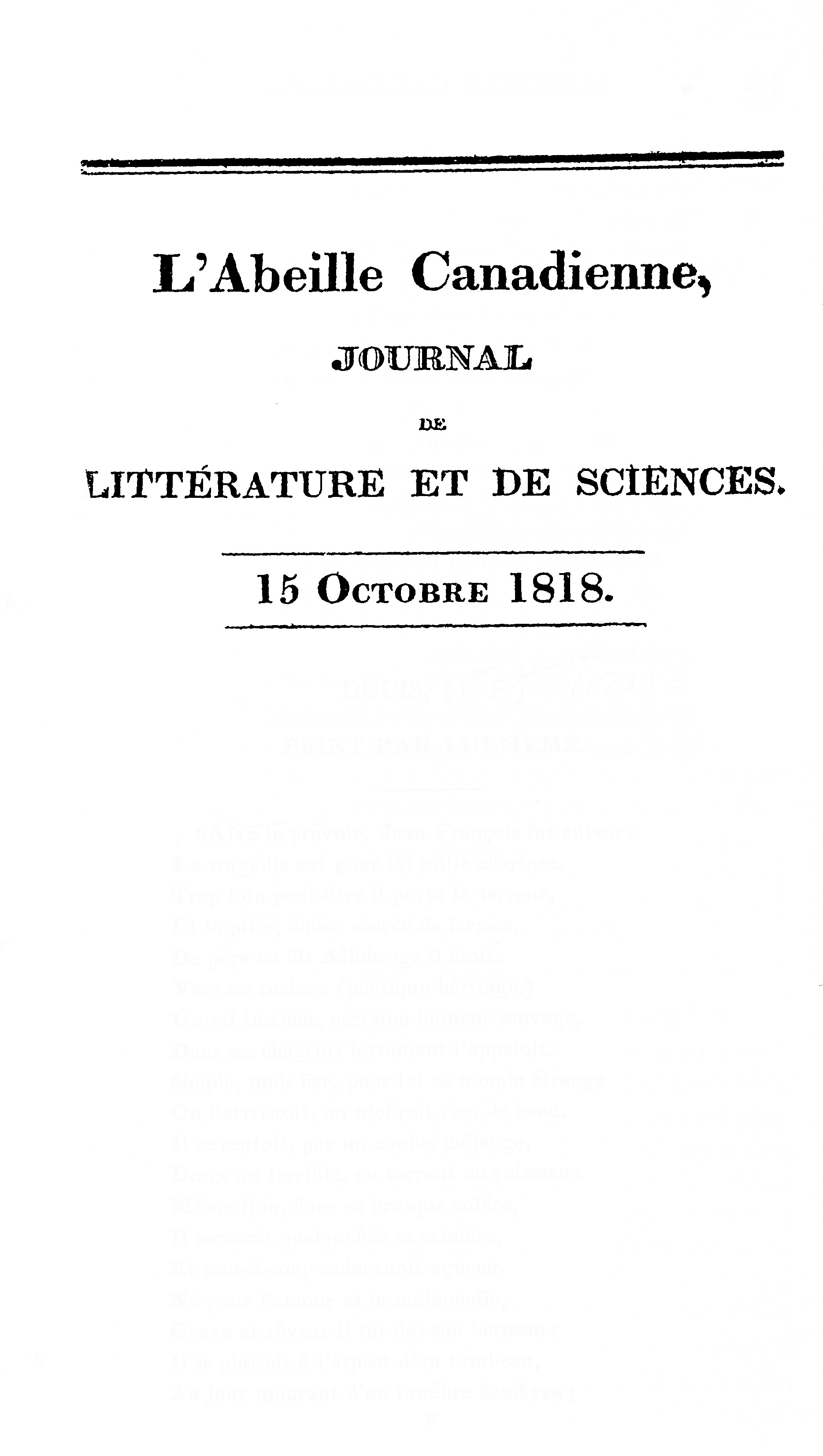
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: L'Abeille Canadienne Issue 06 of 12
Date of first publication: 1818
Author: Henri-Antoine Mézière (editor)
Date first posted: Mar. 14, 2020
Date last updated: Mar. 14, 2020
Faded Page eBook #20200329
This eBook was produced by: Marcia Brooks, David T. Jones, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
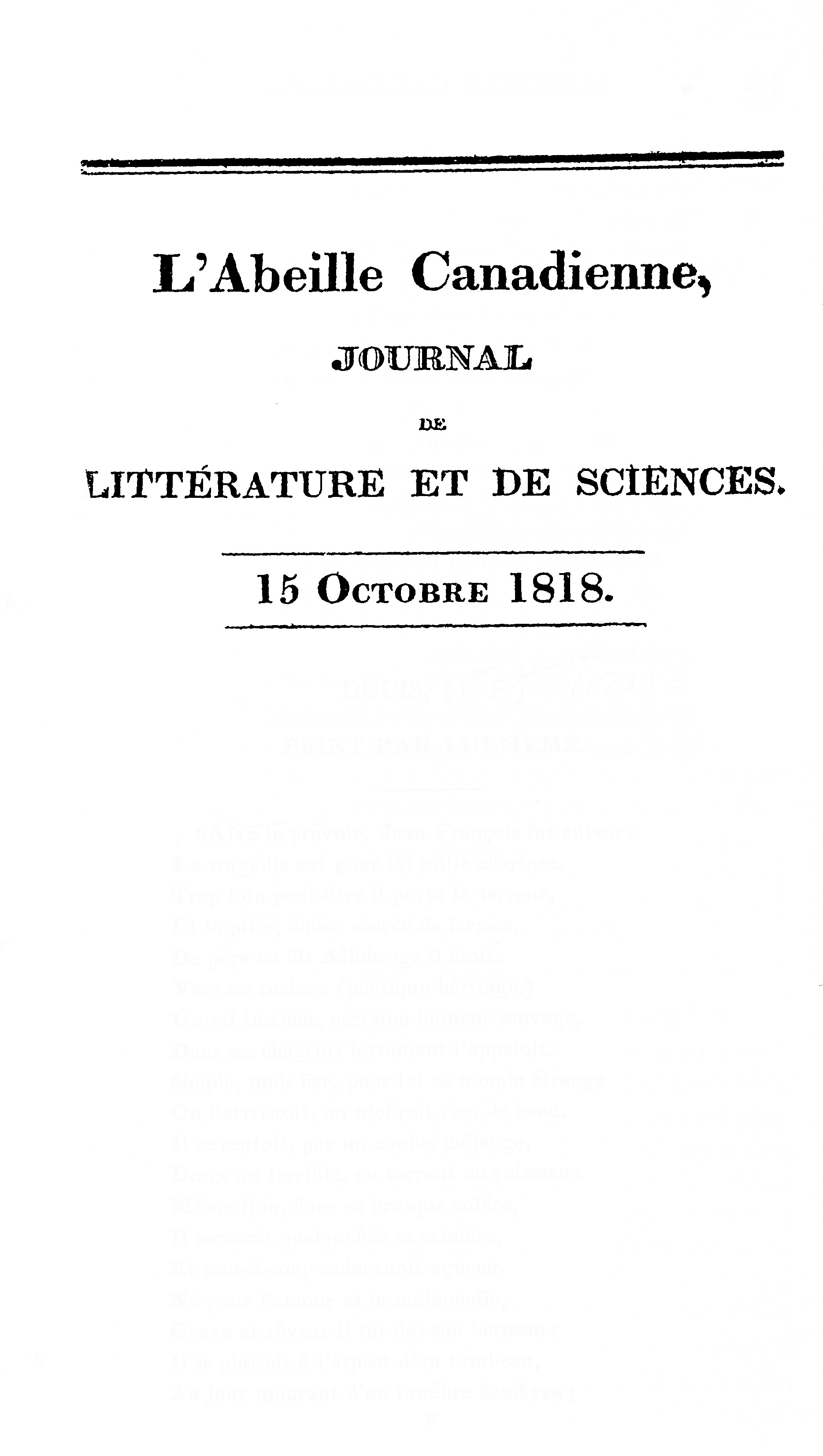
Sans le prévoir, Jean François fut auteur:
La tragédie eut pour lui mille charmes.
Trop loin peut-être il porta la terreur,
Et la pitié, douce source de larmes.
De père en fils Allobroge il étoit.
Vers ses rochers (poétique héritage,)
Un vif instinct, certaine humeur sauvage,
Dans ses chagrins fortement l’appeloit.
Simple, mais fier, pour lui ce monde étrange
Ou l’attristoit, ou n’offroit rien de beau.
Il se sentoit, par un confus mélange,
Doux ou terrible, ou torrent ou ruisseau;
Même lion, dans sa brusque colère,
Il secouoit quelquefois sa crinière,
Et tout-à-coup redevenoit agneau.
Né pour l’amour et la mélancolie,
Grave et rêveur il fut dès son berceau;
Il se plaisoit à l’aspect d’un tombeau,
Au jour mourant d’un funèbre flambeau;
Il l’invoquoit......... et sa mère attendrie,
Craignant son cœur, trembla pour son cerveau.
Il a parfois semé dans ses ouvrages
De petits riens, de jolis badinages.
Parfois bons vins, bons mots, jolis repas,
Gentils minois, égayoient son visage;
Son cœur ardent lui dictoit son langage.
Le sèxe aimable eut pour lui tant d’appas,
Qu’en le craignant il lui rendit hommage.
Le cœur surtout aima la vérité.
Rarement triste, et souvent attristé,
Plus d’un malheur exerça son courage;
Plus d’un chagrin, sa sensibilité.
Sage, il aima la sage liberté:
Il détestoit plus que tout l’esclavage.
Vieux, sa vieillesse eut l’esprit de son âge.
Pour des monts d’or il n’eut point fait un pas.
Pour lui, détour, ruse étoit lettre close;
De toute intrigue il vécut ennemi.
Trop peu de tems, dans la plus douce chose,
Il fut heureux............. Thomas fut son ami.
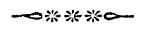
————————
Un grand poëte a dit que les bois sont la chevelure de la terre: ne pourroit-on pas ajouter que les fleurs en sont, pour ainsi dire, le teint, la douce haleine? Leur culture charma souvent les momens de loisir des plus grands hommes. On connoît la prédilection de Lamoignon de Malesherbes pour les roses; on sait quelle fut l’ivresse de J. J. Rousseau en revoyant une pervenche, qui lui rappeloit et ses beaux jours et sa patrie: le vénérable chancelier de l’Hopital trouvoit un charme inexprimable à cultiver, au Marais, les plus belles jacinthes de tout Paris; le grand Condé donnoit, à Chantilly, des soins assidus à la riche collection d’œillets qu’il y avoit formée; et plus d’une fois on vit Henri IV. arroser lui-même les beaux lis dont Gabrielle d’Estrées aimoit à parer la fenêtre où chaque jour elle attendoit son arrivée. Faut-il donc s’étonner de l’amour que leur portoit ce peintre fidèle des douces illusions et des vertus sociales, ce poëte dramatique si simple dans ses goûts, si pur en amitié, si indulgent pour ses rivaux, Collin-d’Harleville, en un mot, que Thalie regrette encore comme l’un de ses plus chers favoris?
Il possédoit près de Maintenon, à quelques lieues de Chartres, sa patrie, une maison de campagne, où, à l’exemple d’Horace, il aimoit à fuir le tumulte de la ville, pour goûter ce repos si nécessaire à l’homme de bien, pour respirer cet air vivifiant de la nature, qui seul pouvoit ranimer ses organes affoiblis et prolonger son existence.
De tous les parfums que le printemps exhale sur la terre, aucun n’avoit autant d’attraits pour Collin-d’Harleville, que l’odeur suave et pénétrante du lilas. Elle portoit dans ses sens une ivresse qui ranimoit ses forces, excitoit sa verve, et sembloit, disoit-il, le reporter aux plus beaux jours de sa vie. Dès que les fleurs printanières commençoient à s’entr’ouvrir, il quittoit la capitale, ses amis les plus intimes, les aimables réunions dont il étoit un des plus chers initiés, et couroit à Maintenon saluer le beau ciel du premier de mai, et rendre hommage à un superbe bosquet de lilas, qui faisoit ses délices. Heureux et vivement inspiré sous ce dôme de verdure, d’où s’échappoient mille touffes élégantes et parfumées, il se livroit à tout l’élan de son imagination. Ce fut dans ce nouvel Eden qu’il composa ses meilleurs ouvrages, qu’il écrivit l’Optimiste et les Châteaux en Espagne, où l’on retrouve la fraîcheur et l’abondance dont il étoit entouré sous ses arbres; le Vieux Célibataire, où il retrace avec tant d’expression les regrets de n’avoir pu s’unir aux destinées d’un sexe qu’il adoroit; et les Querelles des deux Frères, que sa modestie l’empêcha de mettre au jour, mais que la postérité classera peut-être parmi les plus aimables productions du dix-neuvième siècle.
La prédilection de Collin-d’Harleville pour son bosquet de lilas, étoit signalée par les ornemens qu’il se plaisoit à y réunir. Là se trouvoient les bustes de Plaute et de Térence; ici l’on voyoit la tête expressive de Molière auprès de celle du bon La Fontaine; plus loin on remarquoit le joyeux masque de Préville. Un grand nombre d’inscriptions retraçoient les goûts, les affections, les souvenirs de leur aimable auteur.
On présume aisément que de tout ce qui composoit la charmante retraite de Collin-d’Harleville, ce petit temple de mémoire attiroit tous ses soins. Il ne cessoit de le recommander particulièrement à son jardinier. “Marcelin, lui disoit-il, ne vous lassez point, je vous prie, de donner à ce bosquet tout l’éclat dont il est susceptible: négligez plutôt, s’il le faut, les autres parties de mon jardin. Vous voyez le bonheur dont je jouis sous mes chers lilas; il semble que ma vie soit attachée à leur conservation.” Un mariage eut lieu dans la famille de Collin-d’Harleville, et sa présence étant indispensable, il lui fallut quitter sa jolie solitude pour se rendre à Chartres, le jour indiqué. C’étoit vers le milieu du mois de mai, époque où ses lilas étoient encore parés de toutes leurs richesses. Ce poëte aimable les quitta donc un matin, non sans quelque regret, se promettant bien de revenir le lendemain jouir des dernières faveurs du printemps. Le jour même de son départ, survint un ouragan si terrible, que d’épaisses murailles s’écroulèrent; des toitures entières furent enlevées, et les plus gros arbres déracinés. La terre étoit jonchée de fleurs et de feuilles, qui n’avoient pu résister à la fureur des vents, à la violence de la grêle. Partout on en voyoit la trace et les effets affligeans; pas une seule chaumière qui ne fût endommagée: les ruisseaux débordés emportoient dans leur cours rapide des gerbes, des berceaux et des débris de toute espèce; on ne rencontroit dans les champs que des troupeaux égarés, des agneaux bêlans, des oiseaux écrasés ou noyés dans leurs nids; tout en un mot présentoit l’image de la destruction.
Le bosquet de Collin-d’Harleville ne fut pas garanti de cette horrible tempête. Tout ce que put faire le prudent et fidèle Marcelin, ce fut d’abriter les bustes qui le décoroient, ainsi qu’il avoit coutume de le faire, à l’approche de l’hiver; mais pendant qu’il se livroit à cette importante occupation, tous les lilas furent dévastés: ils ne formèrent plus qu’une masse informe de branchages, qui encombroit le bosquet.
La douleur de Marcelin fut inexprimable, et des pleurs s’échappèrent de ses yeux. Cependant dès que l’orage fut dissipé, il se mit à ramasser à la hâte tous ces débris auxquels restoient encore attachées quelques touffes de lilas, et craignant que leur vue n’augmentât le chagrin qu’éprouveroit son maître, il résolut de les transporter derrière les murs qui formoient l’enceinte du village. Comme il traversoit le grand chemin, chargé de cette ramée qu’il portoit avec tristesse, il est abordé par la dame du lieu, petite-nièce de la digne amie de Louis XIV, et qui, à l’exemple de cette femme célèbre, avoit coutume de parcourir les hameaux voisins, pour y goûter en secret les charmes de la bienfaisance. “Qu’avez-vous, brave homme? dit-elle à Marcelin; l’affreuse tempête que nous venons d’essuyer vous a sans doute fait éprouver quelque malheur?—Le plus grand d’tous, Madame la duchesse: elle a détruit d’fond en comble le bosquet d’M. Collin: i’ prétendoit qu’sa vie étoit attachée à la conservation d’ses chers lilas, et vous en voyez les débris.... Oh! mon Dieu, si c’étoit l’présage d’la fin d’mon bon maître, je n’m’en consol’rois jamais.—Eh! bien, suivez-moi, réplique la duchesse frappée d’une idée, peut-être n’est-il pas impossible de réparer ce malheur: secondez-moi bien, et surtout soyez discret....”
A ces mots, elle conduit Marcelin dans l’immense parc de Maintenon, qu’elle parcourt à travers les débris nombreux dont l’orage a rempli toutes les issues, et découvre, sous de grands marroniers, un massif de lilas de toute espèce que la grêle n’avoit atteints que foiblement. Presque tous avoient conservé leur parure sous les grands arbres qui les abritoient. “Voyez, dit-elle, ivre de joie, voyez si, parmi ces lilas, vous ne trouveriez pas de quoi renouveler le bosquet de votre maître, sans qu’il pût s’en appercevoir.—Ah! j’vous comprends, madame la duchesse; vraiment oui; j’trouvons à peu près c’qu’i’ nous faut, si c’nest queuqu’tiges d’lilas d’perse qui formiont d’si belles guirlandes en d’dans du bosquet; mais à ça près...... —Il faut absolument que la restauration soit complète, répond cette dame; cherchons encore. J’ai l’espoir que, derrière les serres chaudes, où l’ouragan semble avoir frappé avec moins de violence, nous pourrons trouver ce qui nous est nécessaire.” En effet, ils aperçurent de loin de longues touffes de lilas, que le poids des fleurs encore mouillées, faisoit pencher vers la terre; mais qui déjà reprenoient leurs formes élégantes, et leurs doux balancemens aux rayons du soleil. “On diroit, s’écria Marcelin, qu’ce sont les lilas d’not jardin qu’les vents ont transplantés cheux vous.—Maintenant, brave homme, allez avertir les jardiniers du château de se rendre ici, et portez l’ordre à mes gens d’atteler tous mes chevaux aux chariots de l’orangerie. Il ne faut pas que l’illusion de votre maître ne soit que passagère; ce ne seroit l’obliger qu’à demi....mais le jour baisse: nous n’avons pas de temps à perdre, allez: vous me rejoindrez tous ici.”
Marcelin s’empresse d’exécuter les ordres qui lui sont donnés, et revient bientôt auprès de la duchesse avec ses jardiniers; ils enlèvent, avec les plus grandes précautions, chaque pied de lilas, autour duquel ils laissent une masse de terre suffisante pour en couvrir toutes les racines: plusieurs chariots atelés s’avancent, et reçoivent ces masses énormes. Pendant cette longue et difficile opération, Marcelin, accompagné de plusieurs ouvriers du château, va déraciner entièrement le bosquet de son maître, et dispose des fosses profondes pour recevoir les nouveaux lilas. Enfin la nuit étant venue, et chaque habitant de Maintenon commençant à se livrer au sommeil, la duchesse fait transporter, à l’insu de tout le village, le nouveau bosquet roulant; elle commande elle-même cette mystérieuse caravane, dirige tout avec tant de zèle, d’adresse et de bonté, que, le lendemain, l’aurore salue et dore de ses rayons le bosquet chéri de Collin-d’Harleville, tel absolument qu’il étoit avant l’orage. Chaque ouvrier, bien payé de son travail, l’est encore pour le secret, que lui recommande la duchesse.
Cependant le plaisir que goûtoit Collin-d’Harleville au sein de sa famille, étoit troublé par le souvenir de la tempête dont il avoit essuyé, la veille, une partie dans le voyage. Dès le lendemain il quitte Chartres, et s’empresse de rejoindre sa solitude; il ne trouve sur la route que des traces effrayantes de l’orage de la veille: plus il approche de Maintenon, plus elles se multiplient. Enfin il descend de voiture, frappe en tremblant à sa porte, et les premiers mots qu’il adresse à son jardinier, sont pour s’informer de son bosquet.
“Ah, sans doute, j’ai tout perdu; tout doit être anéanti.—Non, non, Monsieur, rassurez-vous.—Eh, comment aurois-je été plus épargné que mes voisins dont je viens d’apercevoir le désastre épouvantable?—Vous savez ben c’que c’est qu’un nuage qui crève: rien d’sauvé où qu’ça donne; mais à deux pas d’là, pas le moindre mal....” Tout en causant ainsi, Collin-d’Harleville s’élance vers son bosquet, et ne peut en croire ses yeux. “Quoi, s’écrie-t-il avec ivresse, pas un lilas déraciné, pas une fleur endommagée, et tout auprès le potager détruit, les cloches brisées, les arbres fracassés!—C’n’est pas pour dire, reprend vivement Marcelin, cherchant à l’affermir dans son illusion, mais j’avons fait preuve d’adresse et d’courage. Quand j’ons vu que l’orage allait fondre ici, je m’suis hâté d’dresser mon échelle double en face du grand noyer, et au moyen d’plusieurs gaules enlacées, et sur quoi j’avons entassé tous les paillassons du jardin, j’ons eu le bonheur de préserver, c’bosquet de la tempête.—Ce n’est point avec de l’or, dit Collin-d’Harleville, qu’on peut payer un tel service: je n’oublierai jamais que je vous dois la conservation de mes chers lilas.... Enfin ils sont sauvés!” répétoit-il sans cesse à tous ses voisins qu’il amenoit les admirer, et qui ne pouvoient revenir de leur étonnement. Le vieux jardinier jouissoit du bonheur et de l’illusion de son maître.
La première fois que Collin-d’Harleville fut au château, où toujours sa présence répandoit un nouveau charme, il s’empressa de raconter son heureuse aventure. La duchesse, qui partageoit en secret toute sa joie, ne fit rien paroître; elle feignit même de pousser l’incrédulité jusqu’à vouloir visiter le bosquet, dont l’aspect lui causa néanmoins une émotion qu’elle eut beaucoup de peine à dissimuler. “Vraiment, dit-elle à Collin-d’Harleville, avec sa grâce ordinaire, on croiroit que la Providence a voulu réaliser pour vous les ingénieux mensonges de la mythologie. Apollon sera descendu pendant l’orage conjurer Eole de respecter vos lilas: il devoit bien ce miracle à l’un de ses plus chers favoris.”
Pendant tout le reste du printemps et une grande partie de l’été, Collin-d’Harleville ne cessa de croire que c’étoit au zèle et à la prévoyance de son jardinier qu’il devoit la conservation de son bosquet; mais un jour qu’après s’être promené dans le parc de Maintenon, il se reposoit précisément, sous le massif de lilas où l’on avoit renouvelé les siens, il entendit derrière une palissade plusieurs ouvriers qui, ne le croyant pas si près d’eux, s’entretenoient du secret qu’on leur avoit tant recommandé. “Est-il assez crédule, disoit l’un, d’s’imaginer qu’ses lilas ont été préservés d’l’orage par le vieux Marcelin?—Faut avouer, dit un autre, qu’nous avons rudement travaillé c’te nuit-là: en moins d’six heures transporter, du fond du parc, chez monsieur Collin, plus d’trente pieds d’lilas avec les masses de terre qui couvroient leux racines! aussi pas un n’a manqué.—Jarni! ajoute un troisième ouvrier, c’est un joli tour qu’madame la duchesse a joué à c’monsieu Collin; mais i’mérite ça: c’est un homme si bon, si simple! et pourtant c’est un savant. On dit qu’i fait courir tout Paris à ses ouvrages.”
Le poëte, ému, surpris, se rend à l’instant même à sa solitude, interroge Marcelin, qui lui confirme ce qu’il vient d’entendre, et lui fait le récit fidèle, de tout ce qui s’étoit passé. Collin recommande à son tour le plus grand secret à son jardinier: il parvint à cacher, pendant tout l’hiver qu’il passa à Paris, le trouble délicieux qu’il éprouvoit chaque fois qu’il y rencontroit la duchesse; et dès le retour du printemps il s’empresse d’aller à Maintenon cueillir les premières fleurs du bosquet, revient aussitôt à Paris, se présente à l’hôtel de la duchesse le jour même où la fête de cette dernière y avoit réuni beaucoup de monde, l’aborde, et lui dit avec émotion: “Voici les prémices du bienfait le plus délicat, le plus ingénieux que je connoisse: Madame, ces lilas vous diront beaucoup plus que tout ce que je pourrois exprimer......” Ces mots furent pour l’assemblée une énigme dont la duchesse voulut faire encore un mystère; mais Collin-d’Harleville ne put résister au plaisir de divulguer cette intéressante anecdote, en déclarant que toutes les fois qu’il reverroit ses lilas, il les salueroit comme le gage d’une estime qui lui étoit chère, et comme lui retraçant le souvenir le plus délicieux de sa vie.
J. N. Bouilly.
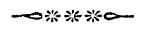
Ce fut vers ce tems que je formai le hardi et difficile projet de parvenir à la perfection morale. Je desirois de passer ma vie sans commettre aucune faute dans aucun moment; je voulois me rendre maître de tout ce qui pouvoit m’y entraîner, la pente naturelle, la société, ou l’usage. Comme je connoissois ou croyois connoître le bien et le mal, je ne voyois pas pourquoi je ne pouvois pas toujours faire l’un et éviter l’autre; mais je m’apperçus bientôt que j’avois entrepris une tâche plus difficile que je ne l’avois d’abord imaginé. Pendant que j’appliquois mon attention et que je mettois mes soins à me préserver d’une faute, je tombois souvent, sans m’en appercevoir, dans une autre. L’habitude se prévaloit de mon inattention, ou bien le penchant étoit trop fort pour ma raison.
Je conclus à la fin que, quoique nous soyons spéculativement persuadés qu’il est de notre intérêt d’être complètement vertueux, cette conviction est insuffisante pour prévenir nos faux pas; qu’il faut rompre les habitudes contraires, en acquérir de bonnes et s’y affermir, avant de pouvoir compter sur une constante et uniforme rectitude de conduite. En conséquence, pour y parvenir, j’imaginai la méthode suivante.
Dans les différentes énumérations des vertus morales que j’avois vues dans mes lectures, le catalogue étoit plus ou moins nombreux, suivant que les écrivains renfermoient plus ou moins d’idées sous la même dénomination. La tempérance, par exemple, suivant quelques-uns, n’avoit de rapport qu’au manger et au boire, tandis que d’autres en étendoient le sens jusqu’à la modération dans tous les appétits, inclinations ou passions du corps ou de l’ame, et même jusqu’à l’avarice et à l’ambition. Je me proposai, pour plus de clarté, de faire plutôt usage d’un plus grand nombre de mots, en attachant à chacun peu d’idées que de me servir de moins de termes, en les liant à plus d’idées. Je renfermai, sous quatorze noms de vertus, toutes celles qu’alors je regardois comme nécessaires ou desirables, et j’attachai à chacune d’elles un court précepte qui montroit pleinement l’étendue que je donnois à leur signification.
Voici ces noms de vertus, avec leurs préceptes.
Sobriété. Ne mangez pas jusqu’à être appesanti; ne buvez pas assez pour que votre tête en soit affectée.
Silence. Ne dites que ce qui peut-être utile aux autres et à vous-même.—Evitez les conversations frivoles.
Ordre. Que chaque chose ait chez vous sa place, et chaque partie de vos affaires son tems.
Résolution.—Soyez résolu de faire, ce que vous devez, et faites sans y manquer ce que vous avez résolu.
Économie.—Ne faites aucune dépense que pour le bien des autres ou pour le vôtre: c’est-à-dire, ne dépensez, pas mal à-propos.
Application.—Ne perdez point de tems; soyez toujours occupé à quelque chose d’utile; abstenez-vous de toute action qui ne l’est pas.
Sincerité.—N’usez d’aucuns déguisemens nuisibles; que vos pensées soient innocentes et justes, et conformez-vous y quand vous parlez.
Justice.—Ne nuisez à personne, soit en lui faisant du tort, soit en négligeant de lui faire le bien auquel vous oblige votre devoir.
Modération.—Evitez les extrêmes; gardez-vous de vous offenser des torts d’autrui, autant que vous croyez en avoir sujet.
Propreté.—Ne souffrez aucune malpropreté sur votre corps, sur vos habits et dans votre maison.
Tranquillité.—Ne vous laissez troubler, ni par des bagatelles, ni par des accidens ordinaires ou inévitables.
Chasteté. Livrez-vous rarement aux plaisirs de l’amour; n’en usez jamais au point de vous abrutir ou de perdre vos forces, et jusqu’à nuire au repos et à la réputation de vous ou des autres.
Humilité (modestie). Imitez Jésus.
Humanité. Vous êtes homme; rien de ce qui intéresse vos semblables n’est étranger pour vous.
Mon intention étant d’acquérir l’habitude de toutes ces vertus, je pensai qu’il serait bon, au lieu de diviser mon attention en entreprenant de les acquérir toutes à la fois, de la fixer pendant un tems sur une d’elles; et, lorsque je m’en serois assuré, de passer à une autre, et ainsi de suite, jusqu’à ce que je les eusse parcourues toutes. Comme l’acquisition préalable de quelques-unes pouvoit faciliter celle de quelques autres, je les rangeai dans cette vue, comme on vient de le voir. La Sobriété étoit la première, parce qu’elle tend à procurer le sang-froid et la netteté d’esprit si nécessaires, lorsqu’il faut observer une vigilance constante, et se tenir en garde contre l’attrait toujours subsistant des anciennes habitudes, et la force des tentations continuelles.
Cette vertu une fois obtenue et affermie, le Silence devenoit beaucoup plus aisé. Mon desir étant d’acquérir des connoissances, en même-tems que je me perfectionnois dans la vertu, je considérai que, dans la conversation, on y parvenoit plutôt par le secours de l’oreille que par celui de la langue; et voulant, en conséquence, rompre l’habitude qui me venoit de babiller, de faire des pointes et des plaisanteries qui ne pouvoient me rendre admissible que dans des compagnies frivoles, je donnai la seconde place au Silence.
J’espérois, par son moyen, et avec l’Ordre qui vient après, obtenir plus de tems, pour suivre mon projet et mes études. La Résolution, une fois devenue habituelle, devoit m’affermir dans mes efforts pour obtenir les autres vertus. L’Économie et l’Application, en me délivrant de ce qui me restoit de dettes, et me procurant l’abondance et l’indépendance, devoient me rendre plus aisée la pratique de la Sincérité et de la Justice, etc.
Je conclus alors que, conformément aux avis de Pythagore, contenus dans ses vers d’or,[1] un examen journalier étoit nécessaire; et, pour le diriger, j’imaginai la méthode suivante:
Je fis un petit livre, dans lequel j’assignai, pour chacune des vertus, une page que je réglai avec de l’encre rouge, de manière qu’elle eût sept colonnes, une pour chaque jour de la semaine, que je marquai de la lettre initiale de ce jour; je fis sur ces colonnes quatorze lignes rouges transversales, plaçant, au commencement de chacune, la première lettre d’une des vertus. Dans cette ligne, et la colonne convenable, je pouvois marquer avec un petit trait d’encre toutes les fautes que, d’après mon examen, je reconnoîtrois avoir commises ce jour là contre cette vertu.
Je pris la résolution de donner, pendant une semaine, une attention rigoureuse à chacune des vertus successivement. Ainsi, dans la première, je pris grand soin d’éviter de donner la plus légère atteinte à la Sobriété, abandonnant les autres vertus à leur chance ordinaire; seulement je remarquai les fautes du jour. Dans le cas où j’aurois pu, pendant la première semaine, tenir nette ma première ligne, marquée sobriété, je regardois l’habitude de cette vertu comme assez fortifiée, et ses ennemis, les penchans contraires, assez affoiblis, pour pouvoir hasarder d’étendre mon attention, d’y réunir la suivante, et d’obtenir, la semaine d’après, deux lignes exemptes de marques.
En procédant ainsi jusqu’à là dernière, je pouvois faire un cours complet, en quatorze semaines, et près de quatre cours en un an. J’imitois l’homme qui a un jardin à mettre en ordre, et qui n’entreprend pas d’arracher toutes les mauvaises herbes en une seule fois, ce qui excéderoit le pouvoir de ses forces; il ne travaille en même tems que sur une planche, et lorsqu’il a fini la première, il passe à la seconde. Je devois jouir (je m’en flattois du moins) du plaisir encourageant de voir sur mes pages mes progrès dans la vertu, en effaçant successivement les marques de mes lignes, jusqu’à ce qu’à la fin, après plusieurs répétions, j’eusse le bonheur de voir, mon livre entièrement blanc, au bout d’un examen journalier de quatorze semaines.
Mon petit livre avoit pour épigraphe ces vers du Caton d’Adisson:
“Here will hold: if there is a power above us
(And that there is, all nature cries aloud
Thro’ all her works) he must delight in virtue,
And that which he delights in, must be happy.
“Je persévérerai; s’il y a un pouvoir au-dessus de nous (et la nature entière crie à haute voix, dans toutes ses œuvres, qu’il y en a un), la vertu doit faire ses délices; et ce qui fait ses délices doit être le bonheur.”
Une autre de Cicéron:
“O vitæ philosophia dux! ô virtutum indagatrix, expultrixque vitiorum! Unus dies benè et ex præceptis tuis actus, peccanti immortalitati est anteponendus.”
“O philosophie! guide de la vie, source des vertus et fléau des vices! Un seul jour employé au bien, et suivant tes préceptes, est préférable à l’immortalité dans le vice.”
Une autre, d’après les proverbes de Salomon, parlant de la sagesse et de la vertu:
La longueur des jours est dans sa main droite, et dans sa gauche les richesses et les honneurs; ses voies sont des voies de douceur, et tous ses sentiers sont ceux de la paix. Prov. chap. 3. v. 16 et 17.
Et considérant Dieu comme la source de la sagesse, je pensai qu’il étoit juste et nécessaire de solliciter son assistance pour l’obtenir. Je composai en conséquence la courte prière qui suit, et je la mis en tête de mes tables d’examen, pour m’en servir tous les jours.
“O bonté puissante! père bienfaisant! guide miséricordieux! augmente en moi la sagesse, pour que je puisse connoître mes vrais intérêts; fortifie ma résolution pour exécuter ce qu’elle prescrit; agrée mes bons offices à l’égard de tes autres enfans, comme le seul acte de reconnoissance qui soit en mon pouvoir pour les faveurs continuelles que tu m’accordes.”
Je me servois aussi de cette prière tirée des poëmes de Thompson:
“Father of light and life, thou good supreme!
O teach me what is good, teach me thy self.
Save me from folly, vanity and vice,
From every low pursuit, and fill my soul
With knowledge, conscious peace and virtue pure
Sacred, substancial, never fading bliss.
“Père de la lumière et de la vie! ô toi, le bien suprême, instruis-moi de ce qui est bien, instruis-moi de toi-même; sauve-moi de la folie, de la vanité, du vice, de toutes les inclinations basses, et remplis mon ame de savoir, de paix intérieure, et de vertu pure; bonheur sacré, véritable, et qui ne se ternit jamais.”
Le précepte de l’ordre demandant que chaque partie de mes affaires eût son tems assigné, une page de mon livret contenoit le plan de l’emploi des vingt-quatre heures du jour naturel; il commençoit par cette question du matin: Quel bien puis-je faire aujourd’hui? Et il se terminoit par cette question du soir: Quel bien ai-je fait aujourd’hui? En me levant, je devois me laver et invoquer la bonté suprême; régler les affaires et prendre les résolutions du jour; continuer les études actuelles; déjeûner. Cela devoit prendre trois heures, de 5 à 7 inclusivement.—Ensuite, le travail jusqu’à midi.—De midi à 2 heures, lecture ou examen de mes comptes, et dîner.—De 2 heures à 6, travail.—De 6 à 9, ranger tout à sa place; souper, musique et récréation, ou conversation; examen du jour; Prière.—Puis, 7 heures de sommeil.
J’entamai l’exécution de ce plan par mon examen, et je continuai pendant un certain tems, l’interrompant dans quelques occasions. Je fus surpris de trouver combien j’étois plus rempli de défauts que je ne l’avois imaginé; mais j’eus la satisfaction de les voir diminuer.
Pour éviter l’embarras de renouveler, de tems en tems, mon livret, qui, en grattant le papier pour effacer les marques des vieilles fautes, afin de faire place aux nouvelles dans un nouveau cours, étoit devenu rempli de trous, je transcrivis mes tables et mes préceptes sur les feuilles d’ivoire d’un souvenir: les lignes y furent tracées, d’une manière durable, avec de l’encre rouge, et j’y marquai mes fautes avec un crayon de mine de plomb, dont je pouvois effacer les traces aisément, en y passant une éponge mouillée.
Après un tems, je ne fis plus qu’un cours pendant l’année, et par la suite un seul en plusieurs années, jusqu’à ce qu’à la fin je n’en fisse plus du tout, étant employé, hors de chez moi, par des voyages, des occupations et une multitude d’affaires. Cependant je portois toujours mon petit livre avec moi. Mon projet d’ordre me donna le plus de peine, et je trouvai que, quoiqu’il fût praticable, lorsque les affaires d’un homme sont de nature à lui laisser la disposition de son tems, comme celles d’un ouvrier imprimeur, par exemple, il l’étoit moins pour un maître qui doit avoir des relations avec le monde, et recevoir souvent les gens à qui il a affaire à l’heure qu’il leur convient. Je trouvai très-difficile aussi d’observer l’ordre, en mettant à leur place les effets et papiers, &c. Je n’avois pas été accoutumé de bonne heure à cette règle; et comme j’avois une excellente mémoire, je sentois peu l’inconvénient qui résulte de manquer d’ordre. Cet article me contraignit à une attention pénible; mes fautes à cet égard me tourmentèrent tellement, mes progrès étoient si faibles et mes rechûtes si fréquentes, que je me décidai presque à prendre mon parti sur ce défaut.
Quelque chose aussi, qui prétendoit être la raison, me suggéroit, de tems en tems, que cette extrême délicatesse, que j’exigeois de moi-même, pouvoit bien être une espèce de sottise en morale, qui me rendroit ridicule, si elle étoit connue; qu’un caractère parfait pouvoit éprouver l’inconvénient d’être un objet d’envie et de haine, et que celui qui veut le bien doit se souffrir un petit nombre de défauts, pour mettre ses amis à leur aise.
Dans le vrai, je me trouvai incorrigible, par rapport à l’ordre, et à-présent que je suis devenu vieux et que ma mémoire est mauvaise, j’en sens vivement le besoin; mais après tout quoique je ne sois jamais arrivé au degré de perfection auquel j’avois tant d’envie de parvenir, et que j’en sois même resté bien loin, cependant mes efforts m’ont rendu meilleur et beaucoup plus heureux que je n’aurois été, si je n’avois pas formé cette entreprise; comme celui qui tâche de se faire une écriture parfaite, en imitant une exemple gravée, quoiqu’il ne puisse jamais atteindre à la même perfection, rend néanmoins, par les efforts qu’il fait, sa main meilleure et son écriture passable.
Il peut-être utile à ma postérité de savoir que c’est à ce petit artifice, à l’aide de Dieu, que leur ancêtre a dû le bonheur constant de sa vie, jusqu’à sa soixante et dix-neuvième année, pendant laquelle ceci est écrit. Les revers, qui peuvent accompagner le reste de ses jours, sont entre les mains de la Providence; mais, s’ils arrivent, la pensée de son bonheur passé doit l’aider à les supporter avec résignation. Il attribue à la sobriété sa longue et constante santé, et ce qui lui reste encore d’une bonne constitution; à l’application et à l’économie, l’aisance qu’il s’est procurée de bonne heure, l’acquisition de sa fortune et des connoissances qui l’ont mis en état d’être un citoyen utile et lui ont donné quelque réputation parmi les savans; à la sincérité et à la justice, la confiance de son pays et les emplois honorables dont on l’a revêtu. Enfin, c’est à l’influence de toutes ces vertus, quelqu’imparfaitement qu’il ait pu les atteindre, qu’il croit devoir cette égalité d’humeur et cette gaîté dans la conversation, qui fait encore rechercher sa compagnie, même par des gens plus jeunes que lui. Il espère que quelques-uns de ses descendans suivront cet exemple et s’en trouveront bien.
On remarquera que, quoique mon plan ne fut pas entièrement sans rapport avec la religion, on n’y trouvoit les traces d’aucun dogme: je l’avois évité à dessein; car j’étois persuadé de l’utilité et de l’excellence de ma méthode; je croyois qu’elle devoit être utile aux hommes, quelle que fût leur religion, et je me proposois de la publier un jour.
J’avois dessein d’écrire un petit commentaire sur chaque vertu, dans lequel j’aurois fait voir l’avantage de les posséder, et les maux qui suivent les voies qui leur sont opposées: j’aurois intitulé mon livre l’Art de la vertu.
Je me proposois de prouver, dans cet ouvrage, qu’en considérant seulement la nature de l’homme, les actions vicieuses ne sont pas nuisibles, parce qu’elles sont défendues, mais qu’elles sont défendues, parce qu’elles sont nuisibles; qu’il est de l’intérêt de ceux même qui ne souhaitent que le bonheur d’ici-bas, d’être vertueux; et considérant, dans le monde, beaucoup de riches commerçans, de princes, de républiques, qui ont besoin, pour l’administration de leurs affaires, d’agens honnêtes, et qu’ils sont rares, j’aurois entrepris de convaincre les jeunes gens qu’il n’y a point de qualités plus capables de conduire un homme pauvre à la fortune, que la probité et l’intégrité. Mais je n’ai pas eu le loisir de me livrer à ce travail, une succession imprévue d’emplois ayant absorbé tout mon tems.
Ma liste des vertus n’en contenoit d’abord que douze; mais un quaker de mes amis m’avertit avec bonté, que je passois généralement pour être orgueilleux; que j’en donnois souvent des preuves; que, dans la conversation, non content d’avoir raison, lorsque je disputois quelque point, je voulois encore prouver aux autres qu’ils avoient tort; que j’étois, de plus, insolent; ce dont il me convainquit, en me rapportant différens exemples. Je résolus d’entreprendre de me guérir, s’il étoit possible, de ce vice ou de cette folie, en même tems que des autres, et j’ajoutai sur ma liste l’humilité.
Je ne puis pas me vanter d’un grand succès pour l’acquisition réelle de cette vertu; mais j’ai beaucoup gagné, quant à son apparence. Je me prescrivis la règle d’éviter de contredire directement l’opinion des autres, et je m’interdis toute assertion positive en faveur de la mienne. J’allai même, conformément aux anciennes lois de notre Junto[2] jusqu’à m’interdire l’usage d’aucune expression définitivement arrêtée, comme certainement, indubitablement, et j’adoptai à leur place, je conçois, je soupçonne ou j’imagine qu’une chose est ainsi, ou il me paroît, en ce moment, que, etc. Quand quelqu’un affirmoit une chose qui me paroissoit être une erreur, je me refusois le plaisir de le contredire brusquement, et de lui montrer sur-le-champ quelque absurdité dans sa proposition; et, dans ma réponse, je commençois par observer que, dans certains cas ou certaines circonstances, son opinion seroit juste; mais que, dans celle dont il étoit question, il me sembloit qu’il y avoit quelque différence.
Je reconnus bientôt l’avantage de ce changement dans mes manières: les conversations dans lesquelles je m’engageois, en devinrent plus agréables; le ton modeste, avec lequel je proposois mes opinions, leur procuroit un plus prompt accueil et moins de contradictions; je n’éprouvois pas autant de mortifications, lorsqu’il se trouvoit que j’avois tort, et j’obtenois plus facilement des autres d’abandonner leurs erreurs et de se réunir à moi, lorsqu’il arrivoit que j’avois raison.
Cette disposition, à laquelle je ne pus pas d’abord m’assujétir sans faire quelque violence à mon penchant naturel, me devint, à la fin, si facile et si habituelle, que personne, depuis cinquante ans peut-être, n’a pu, je crois, s’appercevoir qu’il me soit échappé une seule expression tranchante. C’est à cette habitude, jointe à ma réputation d’intégrité, que je dois principalement d’avoir obtenu, de bonne heure, une grande confiance parmi mes concitoyens, lorsque je leur ai proposé de nouvelles institutions, ou quelques changemens aux anciennes, et une si grande influence dans les assemblées publiques, lorsque j’en suis devenu membre; car, je n’étois qu’un mauvais orateur, jamais éloquent, souvent sujet à hésiter, rarement correct dans mes expressions; et cependant, je faisois généralement prévaloir mon avis.
Aucune de nos dispositions naturelles n’est peut-être plus difficile à dompter que l’orgueil. Qu’on le mortifie, qu’on lui fasse la guerre, qu’on le terrasse, qu’on l’étouffe vivant, il perce de nouveau; il se montre de tems en tems. Vous l’appercevrez, sans doute, souvent dans cette histoire, peut-être au moment même où je parle de le subjuguer, et vous pourrez me retrouver orgueilleux jusques dans mon humilité.
|
Quand l’heure du sommeil vient fermer ta paupière, Sur le jour écoulé porte un regard sévère; Sur le bien, sur le mal interroge ton cœur; Le repentir du mal te rendra l’innocence, Le souvenir du bien sera ta récompense. (Traduction de Mr. La Chabeaussière.) |
|
Nom du club formé à Philadelphie par Franklin. |
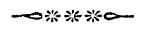
————————
————————
La Phénicie, sur les côtes de la Méditerranée, étoit un pays stérile qui ne pouvoit fournir à la subsistance de ses habitans. Le besoin rend industrieux: c’est l’origine des premiers arts, auxquels l’expérience, la réflexion et même les hasards, ont ajouté tant d’utiles découvertes.
De temps immémorial, les Phéniciens sentirent que la navigation devoit leur procurer des ressources: profitant des avantages qu’offraient leurs ports et les forêts du Mont-Liban, ils bravèrent tous les périls de la mer. Sans autre guide que les étoiles du pôle, ils étendirent prodigieusement leur commerce.
Les îles de Chypre et de Rhodes, la Grèce, la Sicile, la Sardaigne, reçurent leurs colonies. Ils parvinrent jusqu’à l’Espagne, ils pénétrèrent dans l’Océan. Cadix devint leur entrepôt. Ils tiroient de la Bétique, en particulier, d’immenses richesses. Surchargés d’argent dans un voyage, ils furent obligés d’en mettre à leurs ancres, au lieu de plomb. Le commerce enfin les faisoit jouir de tout ce que les autres peuples avoient d’utile et de précieux.
Ils cachoient avec soin le secret de leur navigation, de peur qu’on en partageât le profit. Leur voyage autour de l’Afrique est d’autant plus admirable, que leurs vaisseaux ne pouvoient guère s’éloigner des côtes. La boussole rend facile aujourd’hui ce qui étoit alors presque impossible.
Le hasard procura aux Phéniciens leur précieuse teinture de pourpre. Un chien de berger, pressé par la faim, brise un coquillage; il en a la gueule teinte; cette couleur paroît admirable: on trouve le moyen de l’extraire de coquillages de la même espèce, et de l’appliquer aux étoffes; la pourpre est bientôt l’ornement des rois. Voilà comme le hasard peut contribuer aux découvertes de l’industrie.
Une invention sublime, dont on fait honneur aux Phéniciens, c’est l’écriture alphabétique, par laquelle les idées se transmettent si aisément. Leur alphabet semble avoir donné naissance à celui des Européens: car les lettres grecques en dérivoient, et de ces lettres sont venues celles des Latins, qui sont les nôtres. L’art de tout exprimer avec un petit nombre de caractères, pouvoit seul accélérer les progrès des connoissances humaines.
Malgré leurs lumières et leur commerce les Phéniciens eurent des superstitions, mais beaucoup moins que l’Egypte. On leur reproche d’avoir sacrifié des hommes à la Divinité; sacrifices exécrables, dont les exemples ont été communs dans plusieurs pays du monde.
Sidon fut leur première capitale. La fameuse Tyr devint ensuite plus florissante. Enfin Carthage, colonie de Tyr, fondée vers l’an 890 avant J. C., surpassa la Phénicie en richesses et en puissance.
La méchanceté de Pygmalion, roi de Tyr, fit en quelque sorte naître Carthage. Il avoit tué l’époux de Didon, sa sœur, pour s’emparer de ses biens: Didon prit la fuite, emporta ses trésors, et alla fonder en Afrique cette ville qui devoit un jour être la rivale de Rome.
La Mésopotamie, située entre le Tigre et l’Euphrate, dans un des plus beaux climats du monde, devoit être habitée par un peuple également ancien et célèbre.
Selon la plupart des historiens, Babylone sur l’Euphrate, et Ninive sur le Tigre, furent les capitales de deux grands empires; mais on a lieu de croire que les Babyloniens et les Assyriens ne furent bientôt qu’un même peuple, et que ces deux noms se prenoient indifféremment l’un pour l’autre.
Si l’on en croit les historiens grecs, Ninus, après avoir fondé Ninive, dont l’enceinte est d’environ vingt-cinq lieues, va faire des conquêtes, suivi d’un million de combattans. Sémiramis, femme d’un de ses officiers, se distingue par des exploits héroïques: il l’épouse et lui laisse la couronne.
Pour s’immortaliser, cette princesse construit en peu d’années Babylone, plus grande que Ninive. Des murs où six chars peuvent aller de front, de magnifiques jardins suspendus, des prodiges d’architecture et de sculpture, le temple de Bélus renfermant une statue d’or de quarante pieds de haut, tout cela est l’ouvrage de Sémiramis. Elle fait bâtir d’autres villes; elle va conquérir des royaumes; elle marche contre le roi de l’Inde avec une armée innombrable; elle est vaincue et mise en fuite; elle meurt quelque temps après dans ses états. De pareilles histoires sont évidemment fabuleuses.
On ne trouve aucun fait remarquable, dans un espace de plus de huit cents ans, jusqu’au voluptueux Sardanapale, roi d’Assyrie, qui, assiégé par les Mèdes, se brûla avec ses femmes. Contentons-nous de savoir que Nemrod, arrière petit fils de Noé, fonda Babylone, selon l’Ecriture-Sainte, et que les savans ne peuvent éclaircir les antiquités de cet empire.
Les Babyloniens, ou plutôt les Chaldéns leurs prêtres, observoient soigneusement les astres sous un beau ciel; ils devinrent astronomes. Ils firent des progrès dans cette science; ils inventèrent les cadrans solaires. Mais ils s’attachèrent surtout à une science fausse et absurde, que la vraie religion a toujours proscrite. Ils prétendoient connoître l’avenir par l’inspection des astres: c’est ce qu’on appelle l’astrologie judiciaire. Ils en tiroient de grands avantages, puisqu’on se livroit par crédulité à tous leurs caprices. Ils établirent le culte des astres, qui furent les divinités du pays. Leur dieu Bélus étoit le soleil. Cette idolâtrie ne les empêchoit pas de reconnoître un Dieu suprême, dont la connoissance ne parvenoit point au peuple.
Les arts florissoient de temps immémorial en Assyrie et à Babylone. Le luxe, la mollesse et la débauche y régnoient également. Mais cette corruption de mœurs devint surtout excessive, après la conquête de Babylone par Cyrus. La propagation des mauvaises doctrines en fut la principale cause; car souvent un faux savoir inspire plus de vices que l’ignorance. Il fit perdre aux femmes toute pudeur, et aux hommes tout sentiment de morale.
Au-delà du Tigre, la Médie et la Perse, la première au nord, la seconde au midi, s’étendoient dans un vaste pays entrecoupé de montagnes. Les Mèdes étoient soumis à l’empire des Assyriens, lorsque Sardanapale sacrifiant aux plaisirs tous les devoirs de la royauté, ils profitèrent de l’occasion pour se rendre libres. Ils furent d’abord sans chef, sans gouvernement, et la licence multiplia les désordres. Enfin, ils se donnèrent un roi, vers l’an 600 avant J. C.
Déjocès les gouverna au commencement avec sagesse; mais enivré de sa grandeur, ou voulant contenir ses sujets par la crainte, il devint extrêmement sévère: il se renferma dans un palais inaccessible; il ne se laissa voir qu’aux officiers de sa maison, et c’étoit un crime capital, selon Hérodote, que de rire ou de cracher en sa présence. Il sembloit ne vouloir régner que par la terreur. Étrange manière de gouverner des hommes!
Ecbatane, qu’il bâtit pour en faire sa capitale, avoit sept enceintes de murailles élevées les unes sur les autres. Le faste asiatique devoit y énerver en peu de temps le monarque et les sujets. L’éducation des princes ne fut confiée qu’à des femmes ignorantes et à des eunuques: elle n’étoit donc propre qu’à inspirer la mollesse au lieu des vertus mâles dont les hommes, et surtout les princes, ont besoin pour ne pas se déshonorer. Aussi les Mèdes furent-ils bientôt assujettis par les Perses, qui conservoient encore les mœurs antiques.
La monarchie des Perses étoit une des plus anciennes du monde. Ils eurent long-temps des lumières et de la sagesse, une religion même sans idolâtrie. Ils connoissoient l’unité de Dieu. Le soleil qu’ils sembloient adorer, le feu sacré qu’ils conservoient soigneusement, n’étoient que des symboles de la puissance divine. On ne voyoit chez eux ni temples ni simulacres; ils disoient qu’on insultoit la divinité en voulant la renfermer dans une enceinte de murs.
Les prêtres, connus sous le nom de Mages, se rendoient respectables par la science, par des mœurs austères. Mais, comme les prêtres égyptiens, ils avoient acquis trop de pouvoir; et, pour le maintenir, ils faisoient de leur science un mystère. Ils tenoient de Zoroastre, ancien législateur des Perses, la doctrine des deux principes, par laquelle ils expliquoient l’origine du mal. Le bon principe, Oromaze, étoit l’Etre-Suprême, créateur de la lumière et des ténèbres. Ils appeloient le mauvais principe Arimane; ils le faisoient naître des ténèbres, et c’étoit l’auteur du mal.[1]
La législation punissoit les vices, tels que l’ingratitude; elle inspiroit l’amour de la justice, la haine du mensonge et de l’oisiveté; elle honorait l’agriculture; et le prince même se faisoit un devoir de manger une fois l’an avec les laboureurs. Des lois si sages devoient rendre ce peuple aussi heureux que respectable. Il suffiroit de dire à sa louange que le mensonge étoit à ses yeux une infamie.
On donnoit aux enfans une éducation publique, propre à former des hommes sages et courageux. Jusqu’à l’âge de dix-sept ans ils étoient entre les mains de maîtres habiles, qui leur apprenoient tout ce que doivent savoir et pratiquer de bons citoyens. On ne pouvoit être admis aux emplois sans avoir été nourri dans cette école. L’éducation même des princes étoit réglée, et consistoit en exercices autant qu’en préceptes.
Cyrus, roi de Perse, rendit cette monarchie très célèbre et très puissante. Son règne est une grande époque, vers l’an 560 avant J. C. Cependant, ni sa naissance, ni ses expéditions, ni sa mort, ne sont bien connues. Les anciens se contredisent sur tous ces points.
Dans Xénophon, c’est un héros vertueux; dans Hérodote, c’est un conquérant ambitieux et injuste. Il fonda certainement un vaste empire. Son courage, son habileté, la discipline de ses troupes, leur armure qu’il perfectionna, lui procurèrent des succès rapides. Il défit Crésus, roi de Lydie, fameux par son opulence; il s’empara de Babylone après un long siége, et rendit la liberté aux Juifs, captifs depuis soixante-dix ans; il étendit sa domination jusqu’à l’Inde, d’une part, et de l’autre, jusqu’à la mer Caspienne et à l’Archipel.
Selon le recit d’Hérodote, Cyrus fut défait par Tomyris, reine des Massagètes, et périt dans cette bataille. Tomyris plongea sa tête dans un vase plein de sang: Abreuve-toi de sang, dit-elle, puisque tu en as toujours eu soif. Xénophon, au contraire, le fait mourir dans son lit, après un règne glorieux de trente ans. L’histoire ancienne est remplie de pareilles contradictions.
Ce qu’il importe de savoir, c’est que les conquêtes de Cyrus firent le malheur plutôt que le bonheur de son peuple. Les Perses s’amollirent dans le repos et les richesses. Le roi lui-même se laissa corrompre par le luxe des Mèdes, il négligea l’éducation de ses fils; il reçut avec orgueil des adorations serviles, et tout dégénéra sous ses premiers successeurs. Des eunuques, de vils esclaves eurent tout crédit dans le palais. Les Satrapes, gouverneurs des provinces, foulèrent les peuples impunément, et les rois ne pensèrent qu’à jouir.
Le despotisme s’établit dans cet empire. On nomme ainsi le gouvernement tyrannique d’un prince qui ne connoît d’autres lois que ses volontés particulières, qui se croit le maître absolu de la liberté, des biens et de la vie de ses sujets, qui les traite réellement en esclaves.
Cambyse, fils de Cyrus, fut un monstre sur le trône. Il assassina, par jalousie, son frère Smerdis; il épousa, au mépris des lois, sa propre sœur. Les juges, consultés pour la forme sur ce mariage incestueux, répondirent lâchement que la loi permettoit aux monarques de faire tout ce qu’ils vouloient.
Il entreprit sans raison la conquête de l’Egypte. On raconte que voulant prendre Péluse d’assaut, il mit au premier rang de ses troupes une multitude d’animaux sacrés pour les Egyptiens, et que ceux-ci, de peur de blesser leurs dieux, ne se défendirent point. Si c’est une fable, elle s’accorde du moins avec la superstition de ce peuple. Cambyse fit tuer leur bœuf Apis, renversa leurs temples, se rendit exécrables par ses excès. Il se flatta de conquérir de même l’Ethiopie, peuplée d’hommes robustes et belliqueux. Il y marcha en téméraire qui ne prend aucune précaution, et fut contraint de revenir honteusement. Une conspiration s’étoit formée contre lui en Perse. Il alloit se venger lorsqu’il mourut d’un accident, l’an 522 avant J. C.
Un mage avoit usurpé la couronne, se donnant pour le prince Smerdis. On découvrit l’imposture, on le tua; on mit à sa place Darius, fils d’Hystaspe. Celui-ci imita le despotisme et la témérité de Cambyse. Il attaqua les Scythes, nation pauvre, libre et indomptable: il n’y gagna que la honte d’être repoussé. A la nouvelle de son entreprise, ils lui envoyèrent, dit-on, un oiseau, une souris, une grenouille et cinq flèches, sans s’expliquer autrement. Un seigneur interpréta ainsi leur pensée: “Si les Perses ne s’envolent comme les oiseaux, ou ne se cachent dans la terre, comme les souris, ou ne s’enfoncent dans l’eau comme les grenouilles, ils n’échapperont point aux flèches des Scythes.” C’étoit l’usage en Orient d’employer des figures allégoriques; mais il paroît que celle-ci fut inventée après coup pour répandre du merveilleux dans l’histoire.
Nous verrons ce même Darius en guerre avec les Grecs.
L’Inde, partie méridionale de l’Asie, arrosée par l’Indus et le Gange, est un des pays les plus riches en productions de la nature. Outre les diamans et les pierres de toutes espèces, on y trouve en abondance la soie, le coton, le riz, le sucre, les épiceries, des fruits délicieux, des animaux rares et utiles, tels que le chameau et l’éléphant. Le climat est si chaud, qu’à peine on y a besoin de vêtemens, et la terre si fertile, qu’à peine on y a besoin de travail.
L’Inde, avec de tels avantages, devoit être habitée et policée avant la plupart des autres pays. Ses commencemens se perdent dans l’obscurité des siècles.
Les Indiens étoient divisés en plusieurs classes ou castes, qui ne se confondoient jamais ensemble. Il y en avait une de surveillans, destinée à rendre compte au prince de la conduite des autres. Celle des laboureurs jouissoit d’une tranquillité favorable à l’agriculture; on ne les tiroit jamais des campagnes pour les employer ailleurs; on se faisoit une loi de ne toucher ni à leurs personnes ni à leurs biens. Celle des Brames ou Brachmanes avoit la prééminence sur toute les autres, parcequ’elle étoit dépositaire de la religion et de la science. Ils tirèrent leur nom de Brama, dont ils faisoient ou un dieu, ou un génie du premier ordre. Leur autorité fut la même que celle des mages de Perse et des prêtres d’Egypte.
Quelques-uns de ces Brachmanes excitoient l’admiration par l’austérité de leur vie. On les voyoit se tenir debout au soleil le plus ardent, exercer leur corps à la douleur, mépriser la mort et plus d’une fois se la donner à eux-mêmes avec une ostentation qui nous décèle l’un des motifs les plus puissans de leur suicide. Plusieurs ne portoient point d’habits; on les nomma, par cette raison, Gymnosophistes.
L’ancienne doctrine des Indiens est remarquable. Ils croyoient que le monde a commencé et qu’il finira; que Dieu le remplit de sa présence; que les premiers hommes, ayant abusé de leur bonheur, furent condamnés à vivre de leur travail; qu’après la mort il se fait une mètempsycose, c’est-à-dire que les ames passent dans d’autres corps; qu’elles sont punies de leurs crimes en passant dans le corps d’animaux immondes et malheureux; que, purifiées par une suite de transmigrations et d’épreuves, elles se réuniront à leur origine pour jouir d’une éternelle félicité.
Cette doctrine mettoit un frein au vice; elle empêchoit de manger les animaux. Les imaginations, échauffées par le climat et par la vie contemplative, enfantèrent dans l’Inde beaucoup de folies superstitieuses. Les femmes se firent un devoir de se brûler après la mort de leurs maris. On en voit encore aujourd’hui des exemples.
Les chiffres arabes, le jeu d’échecs, ont été probablement inventés par les Indiens. Ces inventions supposent beaucoup de génie. Du reste, en fait de science, et surtout d’astronomie, les Egyptiens et les Chaldéens paroissent fort supérieurs. Dans l’Inde, on regardoit la terre comme une surface plate, ayant au milieu une montagne, autour de laquelle tournent les astres. Tels sont les égaremens de l’esprit, quand il n’est pas éclairé par des études solides.
(A continuer.)
|
Quelques savans prétendent qu’Oromaze ou Orasmades et Arimane n’étoient que deux êtres scondaires, produits par le dieu suprême appelé le Temps sans bornes ou l’Eternel. Quoi qu’il en soit, à cet égard, de l’opinion des savans, ce qu’il nous importe d’établir, c’est qu’Oromaze, dans l’opinion des Perses, devoit triompher, à la fin des siècles, d’Arimane, et détruire de fond en comble son désastreux empire sur la terre. Remarquez que dans cette doctrine le nom d’Arimane, loin de rappeler à l’esprit des Perses des idées de respect et de vénération, ne leur présentoit tout au contraire que des idées de mépris et d’infamie. De-là l’indignation des disciples de Zoroastre contre le mauvais principe, qui ne leur permettoit pas d’écrire son nom comme les autres noms. Ils l’écrivoient le plus souvent les lettres ainsi à l’envers Arimane. A Jauffret, Recherch. de la Relig. t. L. |
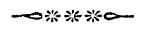
On a dit quelque part, que de l’état du bétail dans une contrée, on peut conclure l’état de ceux qui l’habitent, et réciproquement.[1] Cette observation est d’autant plus juste que la nature, toujours prête à seconder l’activité éclairée, abandonne à elle-même la lourde incurie.
Le lecteur, déjà au fait des landes et du peuple demisauvage qui parque au milieu d’elles, ne s’étonnera donc plus de ce qui nous reste à dire des animaux domestiques; placés sur le second plan du tableau, ils accompagneront parfaitement les principaux personnages.
Tandis que les bœufs des contrées environnantes se font remarquer par leur haute taille, leurs reins larges et pleins, leur fanon long et pendant, leurs jambes, élevées et nerveuses, la variété qui appartient aux landes, petite, maigre et sèche, mais robuste et vivace, rachète ses formes étiques par des jarrets infatigables; sa sobriété égale presque celle des chameaux. Cette race, que la nature, suivant l’heureuse expression d’un poëte Latin, semble avoir été pressée de finir,[2] docile au joug, traîne, à travers les buissons rampans, des voitures petites, basses et sans fer; le bois en feuilles courbées double le bois plus massif des jantes à peine dégrossies. Dans ces cars à quatre roues, tout est à l’unisson avec l’animal rapetissé qui les traîne.[3]
Le charretier Landais conduit ses bœufs à l’aide d’un long fût, qui, sans corde ni lanière, est armé seulement, et à l’un de ses bouts, d’une pointe très-aiguë. Coiffés de l’occiput aux narines par un réseau de cordes recouvert quelquefois d’une peau de brebis, ces animaux obéissent à un petit nombre de signes qui suffisent à tous les commandemens. Rarement le bouvier les gourmande à la voix; son stupide silence forme un contraste remarquable avec les blasphêmes assourdissans des voituriers de Provence que l’on rencontre quelquefois sur la même direction.
Les vaches Landaises plus petites encore que les bœufs, mais plus sales et souvent hideuses, de maigreur, rapellent le songe prophétique de Joseph. Leur lait prend très-souvent l’odeur de la bruyère.
Tel est donc ce bétail, qui, dans la dégradation commune à toutes les landes, moins abâtardi que ses maîtres, conserve une grande aptitude au travail; qualité qui garantit ces animaux de quelques-unes des influences du sol, et nous explique pourquoi ils ne succombent pas chaque année au milieu de tous les élémens des épizooties.
L’âne est de tous nos animaux domestiques celui qui se ressent le moins du sol et du climat des landes; sa sobriété et sa dure enveloppe lui servent de préservatif; patient et résigné, il fait partout et fort bien le travail des terres légères. Les Languedociens, et les Provençaux l’attèlent à leurs araires: cet exemple pourroit être imité dans ce département. Nos races, généralement petites et chétives, seroient facilement améliorées par les belles espèces de l’Espagne et du Poitou. Je ne dois pas omettre que le phitolacca decandra, si commun sur la plupart des route qui traversent les landes, est un poison pour les ânes, sur lesquels il agit comme drastique.
Sous une atmosphère extrême dans ses vicissitudes, les landes, sans cesse ou brûlantes ou submergées, ne cessent dans aucun temps d’être incommodes au malheureux forcé de les parcourir: en changeant de saison ou de température, il ne fait que changer de désagrémens.
Le sable, glissant sous les pieds de sa monture, lui annonce bientôt l’entrée du désert. Dès ce moment, les idées riantes et les sensations gracieuses l’abandonnent sans retour: son esprit se dessèche ou se décolore; l’espace, qui presque partout étonne par son étendue, l’afflige par sa nudité; plus mortel que la tristesse, l’ennui cheminant lourdement avec lui, ajoute encore à la fatigue de sa course.
Enfin, après plusieurs heures alongées par leur insipidité, quelques sommités d’arbres perçant l’atmosphère, semblent promettre au voyageur un terrain plus couvert et des sites moins monotones. Il demande alors un dernier effort au compagnon haletant de son long martyre; mais à leur approche, la forêt fantastique disparoît; quelques pins isolés fuient en arrière, et un second désert s’arrondit en un autre horizon plus fastidieux encore que celui qu’il vient de quitter.
Telle est la fidèle peinture d’un voyage dans les landes, véritable traversée sur de piètres montures qui remplacent très-mal le vaisseau du désert.[4] De temps en temps, quelques pins secs, élevés en enseigne, permettent au voyageur une halte abritée; mais pour comble de maux, au moment où il croit toucher à quelqu’une de ces relâches, des sentiers retournant sur eux-mêmes le rejettent au loin; fourvoyé presque à chaque pas par des chemins d’une conformité trompeuse, il regrette cent fois par heure de n’avoir pas pris une boussole.
Mais puisqu’il n’est pas tout à fait décidé que la rouille de l’antiquité soit une tache pour nos écrits modernes, je me hasarderai de citer encore cette fois les Romains, qui, en fait de routes surtout, ont je crois assez bien fait leurs preuves. Les Romains avoient bonnement aperçu que les plus affreux déserts cessoient bientôt de l’être, lorsqu’on pouvoit y établir des chemins fixes et durables; surtout ils ne désespérèrent pas de nos landes, qui gagnèrent beaucoup sous leur domination.
Déjà, du temps de Strabon, les Aquitains s’étoient rapprochés des côtes maritimes; les Boïens, placés entre l’Océan et les Biturges Vivisques, à la fois pêcheurs, laboureurs et résiniers, exerçoient en grand ces trois branches d’industrie qu’ils conservent encore; leur nom, transformé en celui de Bougés, continue de distinguer les pêcheurs de la Teste, des autres Landais plus méridionaux.
Un commerce s’ouvrit, des comptoirs s’établirent sur le rivage où s’éleva, depuis, le chef-lieu du captalat de Buch. Ausone se moque, dans ses épîtres, de son lourd ami Théon, qui, marchand de grains et grand commissionnaire de résine, préludoit par sa table et ses dépenses au luxe qui devoit distinguer un jour la capitale des Vivisques.
Sur la côte occidentale du Médoc, avoit aussi brillé et disparu Noviomagus, dont le nom Gaulois répond à celui de Villeneuve; enfin Bordeaux venoit d’être colonisé et embelli par les Romains, qui y apportèrent les lettres et y choisirent un consul.
Ainsi, dès la fin du troisième siècle, les landes, déjà cultivées en grande partie, possédoient une ville maritime, et sur les bords du bassin d’Arcachon, un marché rival de celui de Bordeaux.
La poix navale se préparoit dans le Médoc, pour les cordages Gaulois, Grecs et Romains; la résine de Narisse venoit s’y mêler avec celle du pays; La cire brute et la graisse en grumeaux s’y embarquoient pour les pays lointains.[5]
Le pampre serpentant sur les côtes, coloroit de ses reflets les eaux de la Garonne.[6] Bien que la liqueur de nos premiers vignobles n’eût pas encore toute la gloire qu’Ausone ne lui attribue que par le besoin d’un dactyle,[7]
Non laudata minus nostri quàm gloria vini.
on seroit peut-être tenté de croire que le vin de Bordeaux alloit dès-lors soutenir en Italie la réputation des vignes Gauloises;[8] mais comme il faut être vrai lorsqu’on prétend au titre d’historien, je suis forcé de dire que Columelle, et Pline après lui, loin de faire un très-grand cas du cep Bituripe, l’ont classé au contraire parmi les variétés ignobles, dont le seul mérite étoit de réussir dans les lieux froids et humides.
C’est donc à tort que les panégyristes de Bordeaux ont voulu lui faire honneur de ce plant de famille. Quelques-uns d’eux ont porté l’enthousiasme jusqu’à le donner comme la souche précieuse de nos vignobles les plus fameux: leur gloire actuelle n’a pas besoin de cette fausse généalogie.
Tel étoit l’état des landes aux environs de Bordeaux, lorsque les Romains, dont la main hardie ne créoit que pour des siècles, y tracèrent, de l’Océan aux bords de l’Adour, et de l’Adour aux rives de la Garonne, quatre grandes routes, dont les restes presque indestructibles prouvent la sagesse de ce peuple et la grandeur de ses vues, plus encore peut-être que la patiente habileté de ses ouvriers dans les constructions importantes.
Nos livres classiques sont remplis de l’ambition sanguinaire et de la puissance colossale des Romains. Nous étudions avec soin leurs nombreuses révolutions. Semblables aux enfans, qui se complaisent par instinct à la destruction, nous savons tout ce qu’ils ont fait de violent et de cruel; mais l’histoire de leur administration nous est presque inconnue. Cependant, si l’expérience est-quelque part un guide sûr et sans danger, c’est dans les choses que le temps ne change pas, et par conséquent lorsqu’il s’agit de pourvoir aux besoins du peuple, qui demeurent toujours les mêmes.
Ce seroit donc un bon livre que celui qui nous feroit connoître à fond les vues et les succès, les erreurs et les fautes de l’administration Romaine. Utile aux hommes qui nous gouvernent, il deviendroit la base de notre éducation politique, nouveau besoin né du nouveau devoir que nous impose notre association à la puissance législative; et pour rentrer de suite dans mon sujet par une application plus spéciale, on verroit, par le rapprochement des lois et des réglemens de Rome sur la construction des routes, comment avec bien moins de revenus que n’en perçoit aujourd’hui la France,[9] et pourvoyant en même temps avec largesse à tous ses besoins de l’état, ils construisoient quatre fois plus de longueur de routes que n’en renferme ce royaume. On apprendroit encore dans quels cas ils employoient ou rejetoient l’usage des barrières et des taxes sur les transports; adoptoient ou repoussoient les prestations en nature; comment ils parvenoient à répartir avec égalité, et à commander avec succès, l’entretien des chemins vicinaux, dont le mauvais état fait aujourd’hui la honte de nos provinces et le désespoir des administrateurs. On verroit enfin, que plus les routes s’éloignoient de leur capitale, plus les Romains les construisoient solidement, parcequ’ils ne pouvoient veiller à leur entretien avec autant de suite; idée administrative extrêmement simple, qui explique historiquement les dépenses inouies qu’ils ont faites plusieurs fois pour leurs routes dans le fond des déserts et aux extrémités les plus reculées de leur empire.
|
Voyage en Italie, du comte de Stolberg, tom. 2, let. 103. |
|
Hic audax surgit ordo pumilionum Quos natura brevis statim peracta Nodosum semel in globum ligavit. Papinius, in Sile. |
|
Nana per salicta Bisgis rheda capit citata nanis. Helvius-Cinna. |
|
C’est le nom que les Arabes donnent au chameau. |
|
Auson. ep. 5. |
|
Sic mea flaventem pingunt vineta Garumnam. Auson. ep. 5. |
|
Ep. Paul. 13. |
|
In Italia Gallicam placere (uvam) trans Alpes vero Pioenam. Plin. 14. 3. |
|
Vespasien, à son élévation à l’empire, trouva que huit cents millions de notre monnoie (quadringenties millies sestertium) lui suffiroient pour toutes les dépenses de l’état. (Suet. Vosp. 15.) |
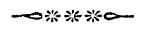
Sur la Topographie de la Lune, et sur ses institutions. (Extrait
des voyages du fameux Cousin-Jacques dans la lune.)
————————
La lune n’est pas précisément une planète; et les astronomes de France se sont constamment trompés en la comptant parmi les sept planètes connues jusqu’à la découverte d’Herschell, qu’ils comptent à présent pour la huitième. Il n’y a point de milieu; ou nous devons compter maintenant sept planètes, y compris Herschell, ou nous en devons compter dix-sept; car, comme la lune n’est que le satellite de la terre, si on la regarde comme une planète, il faut regarder de même les quatre satellites de Jupiter, et les cinq satellites de Saturne.
Quelques astronomes modernes veulent que la lune ne soit que la soixante et dixième partie de la masse du globe terrestre. Je ne conteste point leur mérite et leur science. M. de la Lande qui me connoît très bien, et qui a quelqu’estime pour moi; M. de la Lande, à qui je rends la pareille avec usure, n’aura plus rien à répliquer, je l’espère, si je lui dis qu’il est dans l’erreur, ainsi que M. le Moine et tous ceux qui ont écrit récemment sur le système de Copernic, système qui a prévalu, comme on sait; car enfin, qui connoît mieux que moi le globe lunaire, ses attributs, sa banlieue et toutes ses dépendances; puisqu’aucun de ceux qui en parlent, ne l’ont visité, tandis que moi, voilà tout à l’heure le trois cent trente-neuvième voyage que j’y fais. Et qu’a-t-on à repliquer à un homme qui vous dit: cela n’est pas comme vous le dites; j’y ai été, j’en reviens, je l’ai vu, je l’ai parcouru? Cet argument est irrésistible; aussi ne puis-je attribuer les visites que m’ont faites et les marques d’amitié que m’on données les plus célèbres astronomes de la capitale, qu’au désir qu’ils avoient d’en savoir des nouvelles de la première-main; les tenir du Cousin-Jacques, c’est assurément ce qui s’appele les tenir bu bon coin.
Eh! non, messieurs, eh! non; vous n’y êtes pas, vous dis-je; c’est sur la distance que vous vous êtes mépris. La lune, dites-vous, dans sa moyenne distance, est à quatre-vingt-six mille trois cent vingt-quatre lieues de la terre. Eh bien, c’est une erreur, elle en est beaucoup plus près, infiniment plus près; il faut que votre télescope soit trouble, ou qu’il y ait une souris, comme dit la Fontaine, entre les verres. Sans cette proximité que j’atteste, comment cet astre influeroit-il de si près sur nos têtes? comment les femmes s’apercevroient-elles si bien de ses phases? comment pourrois-je moi-même être servi par elle avec tant de célérité? comment aurois-je mis si peu de temps à y parvenir, toutes les fois que j’ai franchi pour cela l’intervalle des airs? Ecoutez donc la vérité.
La lune a, tout au juste, quatre cent trente-trois lieues et demie, sept toises, cinq pieds onze pouces huit lignes et un point de diamètre. Elle est parfaitement ronde, différente en cela de la terre, qui est ovale; elle a par conséquent treize cens lieues et demie, vingt-trois toises cinq pieds onze pouces et trois points de circonférence, puisque la circonférence a trois fois le diamètre; et la terre qui a deux mille huit cent soixante-cinq lieues de diamètre, l’emporte sur la lune, comme on voit, de près des sept huitièmes, par sa masse et par sa superficie.
La lune est un globe très-fertile; et ce qui contribue surtout à le fertiliser, ce sont les nombreux volcans qui s’y trouvent. Ces volcans, loin de causer, comme les nôtres, des ravages et des incendies, dispersent au loin sur les terres lunaires, leurs cendres vivifiantes, comme le Nil féconde les plaines de l’Egypte par ses débordemens salutaires. C’est peut-être en raison de cette différence, qui existe entre les volcans de la lune et les volcans de la terre, que les têtes sont si bien organisées là haut, et si bien volcanisées ici bas.
La lune a encore deux grands avantages sur la terre; le premier, en ce que les rayons du soleil la pénètrent partout; car il n’y a point d’équateur, de zône torride, de zône tempérée, ni de pole glacial. La température y est partout la même, et en tout temps. Le second avantage, c’est que les nuits, (elles à la vérité y sont un peu plus longues que chez nous, vu la masse de la terre, qui, à raison de sa grosseur, lui intercepte plus long-temps la lumière du soleil) y sont presque toujours claires, belles et sereines; car on s’y promène au clair de terre, comme en plein jour; et la terre qui est la lune de la lune, étant beaucoup plus volumineuse, fait pour elle une grosse lune, qui l’éclaire admirablement bien.
La lune est remplie de forêts, de pâturages, d’étangs, de lacs, rivières, de ruisseaux, de vignobles et de vergers. C’est un jardin continuel; elle est si montueuse que la plus large plaine n’a pas cinq lieues d’étendue en planimetrie. Ce n’est partout que vallons tortueux, montagnes escarpées, sinuosités et défilés. Les points de vue y sont charmans, les sites très-pittoresques, et les paysages délicieux. Il y a des mines de toute espèce, et les grains y sont en abondance sur la croupe et le sommet des collines.
Cette disposition du terrain augmente la récolte annuelle; car on sait que les pays montagneux out plus de superficie que les pays plats; et la salubrité de l’air contribue à la population, comme à la durée de la vie. Il y a moins d’eau que de terre; mais la mer n’y est jamais orageuse, et la navigation y est si commode et si facile, qu’on passe d’une île dans une autre, aussi promptement et sans plus d’embarras que d’une chambre à coucher dans une salle à manger.
Les habitans de la lune sont très-curieux de monumens; l’architecture est surtout en honneur dans ce pays; mais ils savent adopter à chaque genre la forme qui lui est propre. Un temple ne ressemble pas à une salle de comédie; et l’hôtel d’une courtisanne n’a point la forme et l’extérieur d’un hospice de charité. On reconnoît à tous ces signes, minutieux en apparence, le caractère et le génie des nations.
Les villes y sont grandes, bien aérées, bien bâties, toutes tirées au cordeau, mais situées dans les vallons, parce que les édifices publics y sont d’une hauteur extraordinaire. On ne voit sur les côteaux et sur le haut des collines, que des métairies ou des hameaux, dans les maisons, éparses dans des groupes d’arbres touffus, forment l’aspect le plus riant.
La ville capitale de la Lune se nomme Lunol. Elle étoit depuis plusieurs siècles, avant la révolution lunaire, le séjour des empéreurs, et les empéreurs furent long-temps les plus puissans monarques de ce globe; tous les autres princes étoient leurs vassaux. Cette ville joint à une population de 1,600,000 âmes, qui est le double de celle de Paris, une étendue de près de onze lieues de circuit, y compris ses fauxbourgs. Tous les édifices publics y sont en marbre noir et blanc, ou en belle pierre bleue aussi polie et plus dure que le marbre. Elle est située sur trois ports de mer, et est encore traversée par deux fleuves qui la divisent en vingt cantons ou petites iles. Elle a plus de sept-cents beaux ponts, environ dix mille palais, cent hopitaux ou maisons nationales, vingt paroisses magnifiques, cent quatre-vingt-dix places publiques, ornées d’arbres et de statues, treize cents fontaines supérieurement ornées et sculptées, dix-sept cents quais, gardés par des parapets de marbre blanc, surmontés de balcons d’or moulu, et quatre mille rues, larges, spacieuses, avec balcons dorés à toutes les fenêtres, et pilastres cannelés entre chaque croisée.
Le palais des empéreurs, aujourd’hui palais législatif ou temple de la loi, et le palais des impératrices, aujourd’hui palais du conseil exécutif, sont deux monumens d’une rare beauté, et dont il seroit inutile de prétendre donner à mes lecteurs une juste idée.[1]
Mais ce qui surpasse l’imagination, ce qui confond les connoisseurs et les artistes, c’est surtout la Grande Eglise du Dieu des nations, autrement appelée la grande métropole nationale et patriarchale de la lune. Cette Eglise que je ne puis me lasser d’admirer et d’observer toutes les fois que je vais à Lunol, contient à l’aise, rien que sur la planimétrie intérieure de ses trois nefs, cinq cent mille personnes; autant dans ses nombreuses galeries intérieures, et autant à l’extérieur. Elle a quinze cent soixante et dix pieds de longueur intérieure, sur trois cent vingt-cinq de hauteur et quatre cent de largeur par le bas; cinq jeux d’orgues, vingt-trois tours richement sculptées, dont la moins élevée à six cents pieds, cent trente cloches énormes, et plus de dix mille croisées et de trois mille colonnes. Elle est revêtue d’or et d’argent au-dedans, et de lames de cuivre au-dehors. Trente mille deux cent trois ouvriers ont été occupés à la bâtir, et elle a coûté cent quarante-cinq milliars; l’ouvrage a duré quatre cents ans, sous onze règnes; mais eût-il duré 6 mille ans, on ne concevroit pas d’avantage que la main des hommes eût pu construire un chef-d’œuvre de cette hardiesse et de cette magnificence. Il est clair que trente mille deux cent trois familles ont vécu pendant quatre cents ans, de la seule bâtisse de cette superbe Eglise.
Le patriarche de Lunol, qui est le chef visible du culte de la Lune, y assiste régulièrement aux offices le jour et la nuit, avec son chapitre, composé des anciens évêques et des anciens pasteurs trop âgés, à qui leur canonicat sert de retraite. Ce patriarche vit en communauté avec son chapitre, et le séminaire des jeunes ecclésiastiques, dont il a la surveillance. Tous ces prêtres sont humbles, modestes, charitables, réservés, exacts et scrupuleux pour leurs devoirs; aussi le peuple les a-t-il toujours chéris et révérés. Leurs vêtemens sacerdotaux sont d’une richesse éblouissante; mais une fois sortis de l’église, on les voit simples dans leur extérieur et leur maintien, se cacher dans la foule comme les derniers des hommes, visiter les hopitaux et les prisons ou s’isoler dans leur cellule pour travailler ou prier.
Quand le patriarche va par la ville, ce qui lui arrive rarement, et toujours pour un acte de bienfaisance, il est suivi d’une foule d’habitans qui sortent de leurs maisons pour l’accabler de respects et de bénédictions. Il a toujours à sa table, au réfectoire du chapitre, douze pauvres qu’on sert avant lui, et qui sont choisis parmi les familles les plus vertueuses de la classe indigente.
On ne peut-être promu au patriarchat avant l’âge de soixante-cinq ans; le patriarche actuel en a quatre-vingt-dix-sept. Ses cheveux sont blancs comme la neige, il est droit comme un jonc, a le regard encore plein de vivacité, mais tempéré par la douceur. Il a conservé toutes ses dents, et la justesse de son esprit ne l’a point abandonné. Le calme de la bonne conscience répand sur sa figure respectable cette sérénité qui n’est jamais le fruit de l’ambition ni du libertinage. Il a droit aux séances du corps législatif: mais sans pouvoir y voter. Il y va rarement; mais quand il arrive, tous les législateurs se lèvent, et s’inclinent en silence, rendant ainsi un hommage exemplaire à la vertu, à la vieillesse et au culte religieux. C’est lui qui reçoit dans sa métropole la nouvelle législature, lors de son installation; et il officie solennellement à toutes les cérémonies nationales, où assiste le corps législatif; car les lunatiques ont pour principe de marier sans cesse les idées religieuses avec les institutions civiles.
J’étois présent à la dernière installation du conseil général de la nation; le patriarche, à la tête du nombreux clergé de la grande métropole et de celui de Lunol, vint en habits pontificaux, recevoir le corps législatif sous le grand portail métropolitain. Les législateurs furent conduits et placés dans le grand-chœur des chanoines; j’admirai leur contenance respectueuse pendant toute la cérémonie. Le patriarche fit un discours plein de civisme et d’humanité, sans flatterie et sans bassesse; il mit ensuite, au bas du grand autel, la couronne de chêne sur la tête du président de la législature, lui donna le baiser de paix, et embrassa tous les législateurs l’un après l’autre, en disant à chacun d’eux:
“Dieu vous bénira, mon fils, parce que vous aimez le peuple sans le flatter; il vous bénira, parce que vos intentions sont pures, et votre cœur vertueux. Il vous bénira enfin, et il bénira aussi cette heureuse nation que vous réprésentez, parceque vous mettez, comme elle, la religion au rang des premiers devoirs de l’homme.”
Après la cérémonie, il reconduisit le cortège sous le grand portail, et le congédia par ces paroles:
“Allez en paix, mes frères et mes concitoyens; allez maintenir par des loix sages la prospérité de cet empire; et, tandis que le peuple bénira vos travaux, nous prierons l’Eternel de nous donner toujours des législateurs qui sachent le connoître et l’implorer.”
Le président lui répondit:
“Vénérable vieillard, qui as blanchi dans l’exercice des vertus les plus pures et des fonctions les plus saintes, ton existence est précieuse à la patrie, par l’exemple et les consolations que tu lui donnes! ne crains pas que les législateurs oublient jamais ce qu’ils doivent à Dieu; ils sont trop pénétrés du bonheur du peuple, pour violer le premier de tous leurs devoirs; ils savent que la sainte humanité est la base des fonctions législatives, et que la religion, mieux que toute la philosophie moderne des peuples exaltés, rend les cœurs sensibles et bons. Nous protégerons les ministres des autels sans flatter leurs vices; nous maintiendrons le Culte, sans lequel il n’y a point de gouvernement sous le ciel. Puisses-tu renouveler encore plusieurs fois la même cérémonie!”
J’avoue que ce spectacle me fit grand plaisir, car je suis une bonne bête, qui crois encore en Dieu; et je ne démordrois pas pour un diable (attendu que les bêtes sont entêtées, comme on sait,) de l’idée fortement gravée dans ma lunatique cervelle, que l’athéisme et l’impiété sont la source de toutes les calamités des empires.
Cependant, je vis là des gens d’esprit parmi les spectateurs (et c’étaient des Vénuriens ou des gens de la planète de Vénus, peuple très-philosophe,) qui blâmoient hautement cette cérémonie: En vérité, disoient-ils, c’est une capucinade; c’est une horreur; ce sont des cagots, des esprits foibles, des petites gens: il n’y a pas là l’ombre de philosophie: ces gens-là n’ont pas l’attitude d’un peuple libre; cette nation-là ne s’est pas encore levée toute entière; ce peuple-là n’est pas encore debout; on n’est pas encore ici à la hauteur des Révolutions, etc. etc. etc. Le Patriarche qui les entendit, se contenta de sourire avec bonté, en leur disant d’un ton de voix très-doux: Mon fils, chaque pays a ses usages; nous ne censurons pas les vôtres; laissez-nous les nôtres.
Mais un habitant de la planète de Mars, qui se trouvoit-là pour des affaires de commerce, entreprit les grondeurs et les critiqueurs, d’un ton fort dur et avec fort peu de courtoisie. Il faut savoir que les peuples de Mars sont très-francs, et même très-brusques; ils passent dans cette région du firmament pour des butors et des imbécilles.
“Messieurs les rhéteurs, leur dit-il d’une voix rauque, apprenez que toutes les nations ne se ressemblent pas. Nous aimons les capucinades, qui rappellent le peuple à son Créateur; et les esprits foibles qui bravent tous les périls avec le courage et l’héroïsme de la vertu, nous plaisent infiniment mieux que les esprits forts, qui déclarent à l’univers qu’ils ne craignent pas la mort, tout en fesant des bassesses pour éviter une égratignure. Sachez, messieurs les gens subtils, que l’attitude d’un peuple libre est celle de la décence: que la hauteur d’une révolution ne peut se mesurer, que par ce qu’y ont gagné la Religion et les mœurs, et que se tenir debout, pour opprimer le foible et pour vexer la vertu, vaut moins que d’être assis pour mesurer, avec sang-froid, l’étendue des devoirs de l’homme. A qui cela s’adresse-t-il, répliqua l’un des Vénuriens, au nom de ses compatriotes? est-ce une allusion que vous voulez faire? Vous calomniez le peuple de Vénus. Vous trahissez la nation Vénurienne. Vous êtes...” Que sais-je, moi, et beaucoup d’autres excellentes raisons qu’il lui donna; mais mon homme, insensible à tout l’étalage de cette philosophie, lui tourna le dos avec un rire moqueur, et s’éloigna en levant les épaules. Peut-être aussi, car il faut être juste, peut-être ne savoit-il pas bien encore ce que signifioit tout cela. Mais je viens bien vîte à la révolution lunaire.
(A continuer.)
|
Je me suis amusé, sans règles, ni compas, ni modèle, et sans avoir jamais appris le dessein, à exquisser sur le papier, avec une plume et de l’encre ordinaire, la vue latérale dans toute sa longueur, de la Grande Métropole de la Lune; il n’y manque pas un iota; et les artistes qui l’ont vue, tout en blamant les défauts de ce genre de travail très-singulier et très-original, n’ont pas pu s’empêcher d’en louer avec surprise les proportions et les détails; j’ai fait aussi de même, le palais législatif, la carte de la lune, le plan de lunol et une infinité d’églises, qu’on jureroit être gravées ou faites à la planche. Il y a dans chaque dessin plus de dix-huit cent mille traits de plume. On m’a offert déjà un prix considérable de ces curiosités, faites seulement pour les amateurs; mais il faudroit que je fusse bien à l’étroit pour les vendre. |
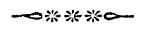
————————
On parle beaucoup à Bordeaux d’une nouvelle méthode pour l’enseignement de la musique vocale, dont l’inventeur est M. Galin, instituteur à l’école royale des Sourds-Muets de cette ville.
Celle méthode produit des effets surprenans et rapides. Plusieurs élèves encore fort jeunes, dont les plus avancés n’ont que sept mois d’étude, non-seulement chantent à la première vue, et très-correctement, tous les airs qu’on écrit devant eux, mais encore exécutent des morceaux d’ensemble avec une précision d’intonation et de mesure qui a beaucoup étonné d’habiles connoisseurs.
Le résultat le plus frappant de cette méthode, est sans contredit celui de l’intonation, que ces enfans possèdent comme s’ils en avoient une très-longue habitude. On se rend d’autant moins compte de la manière dont M. Galin peut les amener à ce haut degré de pratique, que le professeur n’emploie, pour instruire ses élèves, ni la voix, ni aucun instrument. Il suit de là que les élèves sont naturellement conduits à tout découvrir par eux-mêmes; sorte d’avantage qu’on doit considérer comme le cachet d’une méthode éminemment analytique.
——On se disposoit enfin à vendre la bibliothèque de l’ex-conventionnel Courtois; et la notice de cette riche bibliothèque semble annoncer un savant très-distingué. On y trouve, en effet, tous les auteurs classiques Grecs et Latins, et deux mille volumes de commentaires sur leurs ouvrages. Dans ce nombre, on distingue, par exemple, vingt-cinq editions d’Homere et quarante-cinq volumes de traductions Latines ou Françaises de l’Iliade et de l’Odyssée.
Cette bibliothèque contient encore des collections précieuses ou singulières. On cite celle de tous les auteurs de la moyenne et basse latinité, au nombre de plus de trois mille volumes; celles des anthologies, des apophthegmes, des sentences, des proverbes et des Flores Poetarum, formant cinq cents volumes; celle de toutes les poésies Latines, tragédies, comédies, &c. composées par des Jésuites de tous les pays, et qui forme plus de six cents volumes. Cette dernière collection est peut-être unique.
On remarque, dans les classiques, le choix des éditions, leur belle conservation, le luxe des reliûres. Parmi les manuscrits, se trouvent quarante-cinq lettres autographes et inédites de Voltaire à Mademoiselle Quinault, célèbre actrice de la Comédie Française.
On doit publier incessament le catalogue raisonné de cette bibliothèque, également riche dans les deux littératures ancienne et moderne.
——On vient de mettre en vente chez Mme. Bergeret, chez M. Melon et chez les principaux libraires de Bordeaux, les tomes 5, 6, 7 et 8 de la Gaule poétique, par M. de Marchangy. Ces quatre nouveaux volumes complètent un ouvrage d’un très-haut intérêt, où l’histoire de France se trouve considérée dans ses rapports avec la poésie, l’éloquence et les beaux arts. Nos lecteurs nous sauront gré sans doute de leur faire connoître cette production d’un des écrivains les plus remarquables de l’époque actuelle.
——M. Emmel de Hull vient de découvrir qu’en convertissant divers huiles en gaz, au moyen de la distillation, on en obtenoit un éclairage qui n’avoit point, comme les huiles elles-mêmes, les désavantages d’une odeur et d’une vapeur désagréables. Cet éclairage est plus brillant que celui obtenu par le gaz extrait du charbon de terre, et il importe peu au succès du procédé, qu’on se serve de bonnes ou de mauvaises huiles.
Mis-spelled words and printer errors have been corrected or standardised. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Inconsistency in hyphenation has been retained.
Inconsistency in accents has been corrected or standardised.
[The end of L'Abeille Canadienne Issue 06 of 12 edited by Henri-Antoine Mézière]