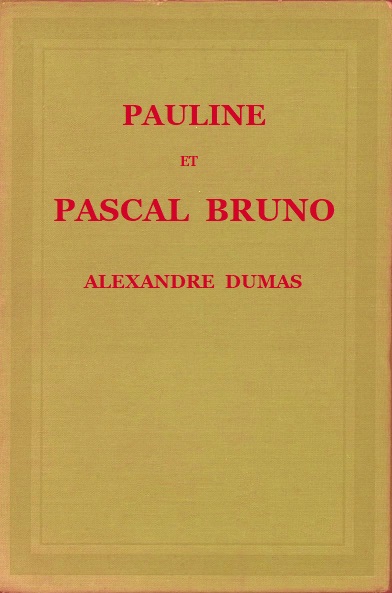
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: Pauline et Pascal Bruno
Date of first publication: 1848
Author: Alexandre Dumas (1802-1870)
Date first posted: Nov. 10, 2019
Date last updated: Nov. 10, 2019
Faded Page eBook #20191116
This eBook was produced by: Claudine Corbasson, Cindy Beyer & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
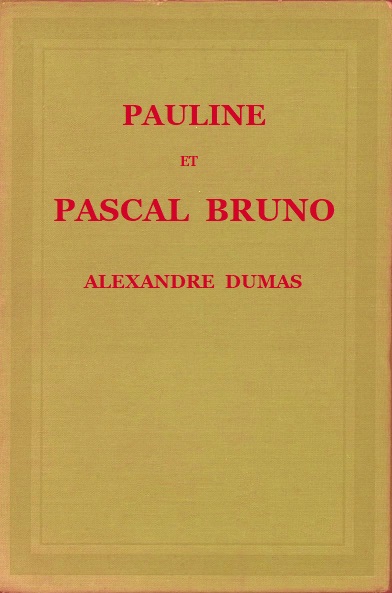
ŒUVRES COMPLÈTES
D’ALEXANDRE DUMAS
CHEZ LES MÊMES EDITEURS:
BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE
ŒUVRES COMPLÈTES D’ALEXANDRE DUMAS
Format in-18 anglais, à 2 francs le volume.
EN VENTE:
| Le Comte de Monte-Cristo | 6 vol. |
| Le Capitaine Paul | 1 — |
| Le Chevalier d’Harmental | 2 — |
| Les Trois Mousquetaires | 2 — |
| Vingt Ans après | 3 — |
| La Reine Margot | 2 — |
| La Dame de Monsoreau | 3 — |
| Quinze jours au Sinaï | 1 — |
| Jacques Ortis | 1 — |
| Le Chevalier de Maison-Rouge | 1 — |
| Souvenirs d’Antony | 1 — |
| Pauline et Pascal Bruno | 1 — |
| Une fille du Régent | 1 — |
| Ascanio | 2 — |
| Sylvandire | 1 — |
| Georges | 1 — |
| Cécile | 1 — |
| Isabel de Bavière | 2 — |
| Fernande | 1 — |
| Amaury | 1 — |
SOUS PRESSE:
| Le Maître d’Armes | 1 vol. |
Paris.—Imp. Lacrampe fils et Comp., rue Damiette, 2.
PAULINE
ET
PASCAL BRUNO
PAR
ALEXANDRE DUMAS

PARIS
MICHEL LÉVY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
des Œuvres complètes d’Alexandre Dumas,
DE LA BIBLIOTHÈQUE DRAMATIQUE ET DU THÉATRE DE VICTOR HUGO,
Rue Vivienne, 1.
1848

Vers la fin de l’année 1834, nous étions réunis un samedi soir dans un petit salon attenant à la salle d’armes de Grisier, écoutant, le fleuret à la main et le cigare à la bouche, les savantes théories de notre professeur, interrompues de temps en temps par des anecdotes à l’appui, lorsque la porte s’ouvrit, et que Alfred de Nerval entra.
Ceux qui ont lu mon Voyaqe en Suisse se rappelleront peut-être ce jeune homme qui servait de cavalier à une femme mystérieuse et voilée qui m’était apparue pour la première fois à Fluélen, lorsque je courais avec Francesco pour rejoindre la barque qui devait nous conduire à la pierre de Guillaume Tell: ils n’auront point oublié alors que, loin de m’attendre, Alfred de Nerval, que j’espérais avoir pour compagnon de voyage, avait hâté le départ des bateliers, et, quittant la rive au moment où j’en étais encore éloigné de trois cents pas, m’avait fait de la main un signe, à la fois d’adieu et d’amitié, que je traduisis par ces mots: «Pardon, cher ami, j’aurais grand plaisir à te voir, mais je ne suis pas seul, et....» A ceci j’avais répondu par un autre signe qui voulait dire: «Je comprends parfaitement.» Et je m’étais arrêté et incliné en marque d’obéissance à cette décision, si sévère qu’elle me parût; de sorte que, faute de barque et de bateliers, ce ne fut que le lendemain que je pus partir; de retour à l’hôtel, j’avais alors demandé si l’on connaissait cette femme, et l’on m’avait répondu que tout ce qu’on savait d’elle, c’est qu’elle paraissait fort souffrante, et qu’elle s’appelait Pauline.
J’avais oublié complétement cette rencontre, lorsqu’en allant visiter la source d’eau chaude qui alimente les bains de Pfeffers, je vis venir, peut-être se le rappellera-t-on encore, sous la longue galerie souterraine, Alfred de Nerval, donnant le bras à cette même femme que j’avais déjà entrevue à Fluélen, et qui, là, m’avait manifesté son désir de rester inconnue de la manière que j’ai racontée. Cette fois encore elle me parut désirer garder le même incognito, car son premier mouvement fut de retourner en arrière. Malheureusement le chemin sur lequel nous marchions ne permettait de s’écarter ni à droite ni à gauche: c’était une espèce de pont composé de deux planches humides et glissantes, qui, au lieu d’être jetées en travers d’un précipice, au fond duquel grondait la Tamina sur un lit de marbre noir, longeaient une des parois du souterrain, à quarante pieds à peu près au-dessus du torrent, soutenues par des poutres enfoncées dans le rocher. La mystérieuse compagne de mon ami pensa donc que toute fuite était impossible; alors, prenant son parti, elle baissa son voile, et continua de s’avancer vers moi. Je racontai alors la singulière impression que me fit cette femme blanche et légère comme une ombre, marchant au bord de l’abîme sans plus paraître s’en inquiéter que si elle appartenait déjà à un autre monde. En la voyant s’approcher, je me rangeai contre la muraille, afin d’occuper le moins de place possible. Alfred voulut la faire passer seule; mais elle refusa de quitter son bras, de sorte que nous nous trouvâmes un instant à trois sur une largeur de deux pieds tout au plus; mais cet instant fut prompt comme un éclair: cette femme étrange, pareille à une de ces fées qui se penchent au bord des torrens et font flotter leur écharpe dans l’écume des cascades, s’inclina sur le précipice, et passa comme par miracle, mais pas si rapidement encore que je ne pusse entrevoir son visage calme et doux, quoique pâle et amaigri par la souffrance. Alors il me sembla que ce n’était point la première fois que je voyais cette figure; il s’éveilla dans mon esprit un souvenir vague d’une autre époque, une réminiscence de salons, de bals, de fêtes; il me semblait que j’avais connu cette femme, au visage si défait et si triste aujourd’hui, joyeuse, rougissante et couronnée de fleurs, emportée au milieu des parfums et de la musique dans quelque valse langoureuse ou quelque galop bondissant: où cela? je n’en savais plus rien; à quelle époque? il m’était impossible de le dire; c’était une vision, un rêve, un écho de ma mémoire, qui n’avait rien de précis et de réel, et qui m’échappait comme si j’eusse voulu saisir une vapeur. Je revins en me promettant de la revoir, dussé-je être indiscret pour parvenir à ce but; mais, à mon retour, quoique je n’eusse été absent qu’une demi-heure, ni Alfred ni elle n’étaient déjà plus aux bains de Pfeffers.
Deux mois s’étaient écoulés depuis cette seconde rencontre; je me trouvais à Baveno, près du lac Majeur: c’était par une belle soirée d’automne; le soleil venait de disparaître derrière la chaîne des Alpes, et l’ombre montait à l’orient, qui commençait à se parsemer d’étoiles. La fenêtre de ma chambre donnait de plain-pied sur une terrasse toute couverte de fleurs; j’y descendis, et je me trouvai au milieu d’une forêt de lauriers-roses, de myrtes et d’orangers. C’est une si douce chose que les fleurs, que ce n’est point encore assez d’en être entouré, on veut en jouir de plus près, et, quelque part qu’on en trouve, fleurs des champs, fleurs des jardins, l’instinct de l’enfant, de la femme et de l’homme, est de les arracher à leur tige, et d’en faire un bouquet dont le parfum les suive, et dont l’éclat soit à eux. Aussi ne résistai-je pas à la tentation; je brisai quelques branches embaumées, et j’allai m’appuyer sur la balustrade de granit rose qui domine le lac, dont elle n’est séparée que par la grande route qui va de Genève à Milan. J’y fus à peine, que la lune se leva du côté de Sesto, et que ses rayons commencèrent à glisser aux flancs des montagnes qui bornaient l’horizon et sur l’eau qui dormait à mes pieds, resplendissante et tranquille comme un immense miroir: tout était calme; aucun bruit ne venait de la terre, du lac, ni du ciel, et la nuit commençait sa course dans une majestueuse et mélancolique sérénité. Bientôt, d’un massif d’arbres qui s’élevait à ma gauche, et dont les racines baignaient dans l’eau, le chant d’un rossignol s’élança harmonieux et tendre; c’était le seul son qui veillât; il se soutint un instant, brillant et cadencé, puis tout-à-coup il s’arrêta à la fin d’une roulade. Alors, comme si ce bruit en eût éveillé un autre d’une nature bien différente, le roulement lointain d’une voiture se fit entendre venant de Doma d’Ossola, puis le chant du rossignol reprit, et je n’écoutai plus que l’oiseau de Juliette. Lorsqu’il cessa, j’entendis de nouveau la voiture plus rapprochée; elle venait rapidement; cependant, si rapide que fût sa course, mon mélodieux voisin eut encore le temps de reprendre sa nocturne prière. Mais cette fois, à peine eut-il lancé sa dernière note, qu’au tournant de la route j’aperçus une chaise de poste qui roulait, emportée par le galop de deux chevaux, sur le chemin qui passait devant l’auberge. A deux cents pas de nous, le postillon fit claquer bruyamment son fouet, afin d’avertir son confrère de son arrivée. En effet, presque aussitôt la grosse porte de l’auberge grinça sur ses gonds, et un nouvel attelage en sortit; au même instant, la voiture s’arrêta au-dessous de la terrasse à la balustrade de laquelle j’étais accoudé.
La nuit, comme je l’ai dit, était si pure, si transparente et si parfumée, que les voyageurs, pour jouir des douces émanations de l’air, avaient abaissé la capote de la calèche. Ils étaient deux, un jeune homme et une jeune femme: la jeune femme enveloppée dans un grand châle ou dans un manteau, et la tête renversée en arrière sur le bras du jeune homme qui la soutenait. En ce moment le postillon sortit avec une lumière pour allumer les lanternes de la voiture, un rayon de clarté passa sur la figure des voyageurs, et je reconnus Alfred de Nerval et Pauline.
Toujours lui et toujours elle! il semblait qu’une puissance plus intelligente que le hasard nous poussait à la rencontre les uns des autres. Toujours elle, mais si changée encore depuis Pfeffers, si pâle, si mourante, que ce n’était plus qu’une ombre; et cependant ces traits flétris rappelèrent encore à mon esprit cette vague image de femme qui dormait au fond de ma mémoire, et qui, à chacune de ces apparitions, montait à sa surface et glissait sur ma pensée comme sur le brouillard une rêverie d’Ossian. J’étais tout près d’appeler Alfred, mais je me rappelai combien sa compagne désirait ne pas être vue. Et pourtant un sentiment de si mélancolique pitié m’entraînait vers elle, que je voulus qu’elle sût du moins que quelqu’un priait pour que son âme tremblante et prête à s’envoler n’abandonnât pas sitôt avant l’heure le corps gracieux qu’elle animait. Je pris une carte de visite dans ma poche; j’écrivis au dos avec mon crayon: «Dieu garde les voyageurs, console les affligés et guérisse les souffrans.» Je mis la carte au milieu des branches d’orangers, de myrtes et de roses que j’avais cueillies, et je laissai tomber le bouquet dans la voiture. Au même instant le postillon repartit, mais pas si rapidement que je n’aie eu le temps de voir Alfred se pencher en dehors de la voiture afin d’approcher ma carte de la lumière. Alors il se retourna de mon côté, me fit un signe de la main, et la calèche disparut à l’angle de la route.
Le bruit de la voiture s’éloigna, mais sans être interrompu cette fois par le chant du rossignol. J’eus beau me tourner du côté du buisson et rester une heure encore sur la terrasse, j’attendis vainement. Alors une pensée profondément triste me prit: je me figurai que cet oiseau qui avait chanté, c’é-l’âme de la jeune fille qui dit son cantique d’adieu à la terre, et que, puisqu’il ne chantait plus, c’est qu’elle était déjà remontée au ciel.
La situation ravissante de l’auberge, placée entre les Alpes qui finissent et l’Italie qui commence, ce spectacle calme et en même temps animé du lac Majeur, avec ses trois îles, dont l’une est un jardin, l’autre un village et la troisième un palais; ces premières neiges de l’hiver qui couvraient les montagnes, et ces dernières chaleurs de l’automne qui venaient de la Méditerranée, tout cela me retint huit jours à Baveno; puis je partis pour Arona, et d’Arona pour Sesto Calende.
Là m’attendait un dernier souvenir de Pauline; là, l’étoile que j’avais vue filer à travers le ciel s’était éteinte; là, ce pied si léger au bord du précipice avait heurté la tombe; et jeunesse usée, beauté flétrie, cœur brisé, tout s’était englouti sous une pierre, voile du sépulcre, qui, fermé aussi mystérieusement sur ce cadavre que le voile de la vie avait été tiré sur le visage, n’avait laissé pour tout renseignement à la curiosité du monde que le prénom de Pauline.
J’allai voir cette tombe: au contraire des tombes italiennes, qui sont dans les églises, celle-ci s’élevait dans un charmant jardin, au haut d’une colline boisée, sur le versant qui regardait et dominait le lac. C’était le soir; la pierre commençait à blanchir aux rayons de la lune; je m’assis près d’elle, forçant ma pensée à ressaisir tout ce qu’elle avait de souvenirs épars et flottans de cette jeune femme; mais cette fois encore ma mémoire fut rebelle; je ne pus réunir que des vapeurs sans forme, et non une statue aux contours arrêtés, et je renonçai à pénétrer ce mystère jusqu’au jour où je retrouverais Alfred de Nerval.
On comprendra facilement maintenant combien son apparition inattendue, au moment où je songeais le moins à lui, vint frapper tout à la fois mon esprit, mon cœur et mon imagination d’idées nouvelles; en un instant je revis tout: cette barque qui m’échappait sur le lac; ce pont souterrain, pareil à un vestibule de l’enfer, où les voyageurs semblent des ombres; cette petite auberge de Baveno, au pied de laquelle était passée la voiture mortuaire; puis enfin cette pierre blanchissante, où, aux rayons de la lune glissant entre les branches des orangers et des lauriers-roses, on peut lire, pour toute épitaphe, le prénom de cette femme morte si jeune et probablement si malheureuse.
Aussi m’élançai-je vers Alfred comme un homme enfermé depuis longtemps dans un souterrain s’élance à la lumière qui entre par une porte que l’on ouvre; il sourit tristement en me tendant la main, comme pour me dire qu’il me comprenait; et ce fut alors moi qui fis un mouvement en arrière et qui me repliai en quelque sorte sur moi-même, afin que Alfred, vieil ami de quinze ans, ne prît pas pour un simple mouvement de curiosité le sentiment qui m’avait poussé au-devant de lui.
Il entra. C’était un des bons élèves de Grisier, et cependant depuis près de trois ans il n’avait point paru à la salle d’armes. La dernière fois qu’il y était venu, il avait un duel pour le lendemain, et, ne sachant encore à quelle arme il se battrait, il venait, à tout hasard, se refaire la main avec le maître. Depuis ce temps, Grisier ne l’avait pas revu; il avait entendu dire seulement qu’il avait quitté la France et habitait Londres.
Grisier, qui tient à la réputation de ses élèves autant qu’à la sienne, n’eut pas plutôt échangé avec lui les complimens d’usage, qu’il lui mit un fleuret dans la main, lui choisit parmi nous un adversaire de sa force; c’était, je m’en souviens, ce pauvre Labattut, qui partait pour l’Italie, et qui, lui aussi, allait trouver à Pise une tombe ignorée et solitaire.
A la troisième passe, le fleuret de Labattut rencontra la poignée de l’arme de son adversaire, et, se brisant à deux pouces au-dessous du bouton, alla en passant à travers la garde, déchirer la manche de sa chemise, qui se teignit de sang. Labattut jeta aussitôt son fleuret; il croyait, comme nous, Alfred sérieusement blessé.
Heureusement ce n’était qu’une égratignure; mais, en relevant la manche de sa chemise, Alfred nous découvrit une autre cicatrice qui avait dû être plus sérieuse; une balle de pistolet lui avait traversé les chairs de l’épaule.
—Tiens! lui dit Grisier avec étonnement, je ne vous savais pas cette blessure?
C’est que Grisier nous connaissait tous, comme une nourrice son enfant; pas un de ses élèves n’avait une piqûre sur le corps dont il ne sût la date et la cause. Il écrirait une histoire amoureuse bien amusante et bien scandaleuse, j’en suis sûr, s’il voulait raconter celle des coups d’épée dont il sait les antécédens; mais cela ferait trop de bruit dans les alcôves, et, par contre-coup, trop de tort à son établissement; il en fera des mémoires posthumes.
—C’est, lui répondit Alfred, que je l’ai reçue le lendemain du jour où je suis venu faire assaut avec vous, et que, le jour où je l’ai reçue, je suis parti pour l’Angleterre.
—Je vous avais bien dit de ne pas vous battre au pistolet. Thèse générale: l’épée est l’arme du brave et du gentilhomme, l’épée est la relique la plus précieuse que l’histoire conserve des grands hommes qui ont illustré la patrie: on dit l’épée de Charlemagne, l’épée de Bayard, l’épée de Napoléon, qui est-ce qui a jamais parlé de leur pistolet? Le pistolet est l’arme du brigand; c’est le pistolet sous la gorge qu’on fait signer de fausses lettres de change; c’est le pistolet à la main qu’on arrête une diligence au coin d’un bois; c’est avec un pistolet que le banqueroutier se brûle la cervelle.... Le pistolet!... fi donc!... L’épée, à la bonne heure! c’est la compagne, c’est la confidente, c’est l’amie de l’homme; elle garde son honneur ou elle le venge.
—Eh bien! mais, avec cette conviction, répondit en souriant Alfred, comment vous êtes-vous battu il y a deux ans au pistolet?
—Moi, c’est autre chose: je dois me battre à tout ce qu’on veut; je suis maître d’armes; et puis il y a des circonstances où l’on ne peut pas refuser les conditions qu’on vous impose....
—Eh bien! je me suis trouvé dans une de ces circonstances, mon cher Grisier, et vous voyez que je ne m’en suis pas mal tiré....
—Oui, avec une balle dans l’épaule.
—Cela valait toujours mieux qu’une balle dans le cœur.
—Et peut-on savoir la cause de ce duel?
—Pardonnez-moi, mon cher Grisier, mais toute cette histoire est encore un secret; plus tard, vous la connaîtrez.
—Pauline?... lui dis-je tout bas.
—Oui, me répondit-il.
—Nous la connaîtrons, bien sûr?... dit Grisier.
—Bien sûr, reprit Alfred; et la preuve, c’est que j’emmène souper Alexandre, et que je la lui raconterai ce soir; de sorte qu’un beau jour, lorsqu’il n’y aura plus d’inconvénient à ce qu’elle paraisse, vous la trouverez dans quelque volume intitulé: Contes bruns ou Contes bleus. Prenez donc patience jusque-là.
Force fut donc à Grisier de se résigner. Alfred m’emmena souper comme il me l’avait offert, et me raconta l’histoire de Pauline.
Aujourd’hui le seul inconvénient qui existât à sa publication a disparu. La mère de Pauline est morte, et avec elle s’est éteinte la famille et le nom de cette malheureuse enfant, dont les aventures semblent empruntées à une époque ou à une localité bien étrangères à celles où nous vivons.
—Tu sais, me dit Alfred, que j’étudiais la peinture lorsque mon brave homme d’oncle mourut et nous laissa, à ma sœur et à moi, chacun trente mille livres de rente.
Je m’inclinai en signe d’adhésion à ce que me disait Alfred, et de respect pour l’ombre de celui qui avait fait une si belle action en prenant congé de ce monde.
—Dès lors, continua le narrateur, je ne me livrai plus à la peinture que comme à un délassement: je résolus de voyager, de voir l’Écosse, les Alpes, l’Italie; je pris avec mon notaire des arrangemens d’argent, et je partis pour le Havre, désirant commencer mes courses par l’Angleterre.
Au Havre, j’appris que Dauzats et Jadin étaient de l’autre côté de la Seine, dans un petit village nommé Trouville; je ne voulus pas quitter la France sans serrer la main à deux camarades d’atelier. Je pris le paquebot; deux heures après j’étais à Honfleur et le lendemain matin à Trouville: malheureusement ils étaient partis depuis la veille.
Tu connais ce petit port avec sa population de pêcheurs; c’est un des plus pittoresques de la Normandie. J’y restai quelques jours, que j’employai à visiter les environs; puis, le soir, assis au coin du feu de ma respectable hôtesse, madame Oseraie, j’écoutais le récit d’aventures assez étranges dont, depuis trois mois, les départemens du Calvados, du Loiret et de la Manche étaient le théâtre. Il s’agissait de vols commis avec une adresse ou une audace merveilleuse: des voyageurs avaient disparu entre le village du Buisson et celui de Sallenelles. On avait retrouvé le postillon les yeux bandés et attaché à un arbre, la chaise de poste sur la grande route et les chevaux paissant tranquillement dans la prairie voisine. Un soir que le receveur général de Caen donnait à souper à un jeune homme de Paris nommé Horace de Beuzeval, et à deux de ses amis qui étaient venus passer avec lui la saison des chasses dans le château de Burcy, distant de Trouville d’une quinzaine de lieues, on avait forcé sa caisse et enlevé une somme de 70,000 francs. Enfin, le percepteur de Pont-l’Évêque, qui allait faire un versement de 12,000 francs à Lisieux, avait été assassiné, et son corps, jeté dans la Touques et repoussé par ce petit fleuve sur son rivage, avait seul révélé le meurtre, dont les auteurs étaient restés parfaitement inconnus, malgré l’activité de la police parisienne, qui, ayant commencé à s’inquiéter de ces brigandages, avait envoyé dans ces départemens quelques-uns de ses plus habiles suppôts.
Ces événemens, qu’éclairait de temps en temps un de ces incendies dont on ignorait la cause, et qu’à cette époque les journaux de l’opposition attribuaient au gouvernement, jetaient par toute la Normandie une terreur inconnue jusqu’alors dans ce bon pays, très renommé pour ses avocats et ses plaideurs, mais nullement pittoresque à l’endroit des brigands et des assassins. Quant à moi, j’avoue que je n’ajoutais pas grande foi à toutes ces histoires, qui me paraissaient appartenir plutôt aux gorges désertes de la Sierra ou aux montagnes incultes de la Calabre qu’aux riches plaines de Falaise et aux fertiles vallées de Pont-Audemer, parsemées de villages, de châteaux et de métairies. Les voleurs m’étaient toujours apparus au milieu d’une forêt ou au fond d’une caverne. Or, dans tous les trois départemens, il n’y a pas un terrier qui mérite le nom de caverne et pas une garenne qui ait la présomption de se présenter comme une forêt.
Cependant force me fut bientôt de croire à la réalité de ces récits: un riche Anglais, venant du Havre et se rendant à Alençon, fut arrêté avec sa femme à une demi-lieue de Dives, où il venait de relayer; le postillon, bâillonné et garrotté, avait été jeté dans la voiture à la place de ceux qu’il conduisait, et les chevaux, qui savaient leur route, étaient arrivés au train ordinaire à Ranville, et s’étaient arrêtés à la poste, où ils étaient restés tranquillement jusqu’au jour, attendant qu’on les dételât; au jour, un garçon d’écurie, en ouvrant la grande porte, avait trouvé la calèche encore attelée et ayant pour tout maître le pauvre postillon bâillonné. Conduit aussitôt chez le maire, cet homme déclara avoir été arrêté sur la grande route par quatre hommes masqués qui, par leur mise, semblaient appartenir à la dernière classe de la société, lesquels l’avaient forcé de s’arrêter et avaient fait descendre les voyageurs; alors l’Anglais ayant essayé de se défendre, un coup de pistolet avait été tiré; presque aussitôt il avait entendu des gémissemens et des cris; mais il n’avait rien vu, ayant la face contre terre: d’ailleurs, un instant après, il avait été bâillonné et jeté dans la voiture, qui l’avait amené à la poste aussi directement que s’il eût conduit ses chevaux, au lieu d’être conduit par eux. La gendarmerie se porta aussitôt vers l’endroit désigné comme le lieu de la catastrophe; en effet on retrouva le corps de l’Anglais dans un fossé: il était percé de deux coups de poignard. Quant à sa femme, on n’en découvrit aucune trace. Ce nouvel événement s’était passé à dix ou douze lieues à peine de Trouville; le corps de la victime avait été transporté à Caen: il n’y avait donc plus moyen de douter, eussé-je même été aussi incrédule que saint Thomas, car je pouvais, en moins de cinq ou six heures, aller mettre comme lui le doigt dans les blessures.
Trois ou quatre jours après cet événement, et la veille de mon départ, je résolus de faire une dernière visite aux côtes que j’allais quitter: je fis appareiller le bateau que j’avais loué pour un mois, comme à Paris on loue un remise; puis, voyant le ciel pur et la journée à peu près certaine, je fis porter à bord mon dîner, mon bristol et mes crayons, et je mis à la voile, composant à moi seul tout mon équipage.
—En effet, interrompis-je, je connais tes prétentions comme marin, et je me rappelle que tu as fait ton apprentissage entre le pont des Tuileries et le pont de la Concorde, dans une embarcation au pavillon d’Amérique.
—Oui, continua Alfred en souriant; mais cette fois ma prétention faillit m’être fatale: d’abord tout alla bien; j’avais une petite barque de pêcheur à une seule voile, que je pouvais manœuvrer du gouvernail; le vent venait du Havre et me faisait glisser sur la mer à peine agitée avec une rapidité vraiment merveilleuse. Je fis ainsi à peu près huit ou dix lieues dans l’espace de trois heures; puis tout-à-coup le vent tomba, et l’Océan devint calme comme un miroir. J’étais justement en face de l’embouchure de l’Orne: j’avais à ma droite le raz de Langrune et les rochers de Lyon, et à ma gauche les ruines d’une espèce d’abbaye attenante au château de Burcy; c’était un paysage tout composé; je n’avais qu’à copier pour faire un tableau. J’abattis ma voile et je me mis à l’ouvrage.
J’étais tellement occupé de mon dessin, que je ne saurais dire depuis combien de temps je travaillais, lorsque je sentis passer sur mon visage une de ces brises chaudes qui annoncent l’approche d’un orage; en même temps la mer changea de couleur, et, de verte qu’elle était, devint gris de cendre. Je me retournai vers le large: un éclair sillonnait le ciel couvert de nuages si noirs et si pressés, qu’il sembla fendre une chaîne de montagnes; je jugeai qu’il n’y avait pas un instant à perdre: le vent, comme je l’avais espéré en venant le matin, avait tourné avec le soleil; je hissai ma petite voile et je mis le cap sur Trouville, en serrant la côte afin de m’y faire échouer en cas de danger. Mais je n’avais pas fait un quart de lieue, que je vis ma voile fasier contre le mât; j’abattis aussitôt l’un et l’autre, car je me défiais de ce calme apparent. En effet, au bout d’un instant, plusieurs courans se croisèrent, la mer commença à clapoter, un coup de tonnerre se fit entendre; c’était un avertissement à ne pas mépriser: en effet, la bourrasque s’approchait avec la rapidité d’un cheval de course. Je mis bas mon habit, je pris un aviron de chaque main et je commençai à ramer vers le rivage.
J’avais à peu près deux lieues à faire avant de l’atteindre; heureusement c’était l’heure du flux, et, quoique le vent fût contraire, ou plutôt qu’il n’y eût réellement point de vent, mais seulement des rafales qui se croisaient en tous sens, la vague me poussait vers la terre. De mon côté, je faisais merveille en ramant de toutes mes forces; cependant la tempête allait encore plus vite que moi, de sorte qu’elle me rejoignit. Pour comble de disgrâce, la nuit commençait à tomber; cependant j’espérais encore toucher le rivage avant que l’obscurité fût complète.
Je passai une heure terrible: mon bateau, soulevé comme une coquille de noix, suivait toutes les ondulations des vagues, remontant et retombant avec elles. Je ramais toujours; mais voyant bientôt que je m’épuisais inutilement, et prévoyant le cas où je serais obligé de me sauver à la nage, je tirai mes deux avirons de leurs crochets, je les jetai au fond de la barque, auprès de la voile et du mât, et, ne gardant que mon pantalon et ma chemise, je me débarrassai de tout ce qui pouvait gêner mes mouvemens. Deux ou trois fois je fus sur le point de me jeter à la mer; mais la légèreté de la barque même me sauva; elle flottait comme un liége, et n’embarquait pas une goutte d’eau; seulement il y avait à craindre que d’un moment à l’autre elle ne chavirât; une fois je crus sentir qu’elle touchait; mais la sensation fut si rapide et si légère, que je n’osai l’espérer. L’obscurité était d’ailleurs tellement profonde, que je ne pouvais distinguer à vingt pas devant moi; de sorte que j’ignorais à quelle distance j’étais encore du rivage. Tout-à-coup, j’éprouvai une violente secousse: il n’y avait plus de doute cette fois, j’avais touché; mais était-ce contre un rocher? était-ce contre le sable? Une vague m’avait remise à flot, et pendant quelques minutes je me trouvai emporté avec une nouvelle violence. Enfin la barque fut poussée en avant avec tant de force, que, lorsque la mer se retira, la quille se trouva engravée. Je ne perdis pas un instant, je pris mon paletot et sautai par-dessus bord, abandonnant tout le reste; j’avais de l’eau seulement jusqu’aux genoux, et, avant que la vague, que je voyais revenir comme une montagne, m’eût rejoint, j’étais sur la grève.
Tu comprends que je ne perdis pas de temps: je mis mon paletot sur mes épaules, et je m’avançai rapidement vers la côte. Bientôt je sentis que je glissais sur ces cailloux ronds, qu’on appelle du galet, et qui indiquent les limites du flux; je continuai de monter quelque temps encore; le terrain avait de nouveau changé de nature; je marchais dans ces grandes herbes qui poussent sur les dunes: je n’avais plus rien à craindre, je m’arrêtai.
C’est une magnifique chose que la mer vue la nuit à la lueur de la foudre et pendant une tempête: c’est l’image du chaos et de la destruction; c’est le seul élément à qui Dieu ait donné le pouvoir de se révolter contre lui en croisant ses vagues avec ses éclairs. L’Océan semblait une immense chaîne de montagnes mouvantes, aux sommets confondus avec les nuages, et aux vallées profondes comme des abîmes; à chaque éclat de tonnerre, une lueur blafarde serpentait de ces cimes à ces profondeurs, et allait s’éteindre dans des gouffres aussitôt fermés qu’ouverts, aussitôt ouverts que fermés. Je contemplais avec une terreur pleine de curiosité ce spectacle prodigieux, que Vernet voulut voir et regarda inutilement du mât du vaisseau où il s’était fait attacher; car jamais pinceau humain n’en pourra rendre l’épouvantable grandiose et la terrible majesté. Je serais resté toute la nuit peut-être, immobile, écoutant et regardant, si je n’avais senti tout-à-coup de larges gouttes de pluie fouetter mon visage. Quoique nous ne fussions encore qu’au milieu de septembre, les nuits étaient déjà froides; je cherchais dans mon esprit où je pourrais trouver un abri contre cette pluie: je me souvins alors des ruines que j’avais aperçues de la mer, et qui ne devaient pas être éloignées du point de la côte où je me trouvais. En conséquence, je continuai de monter par une pente rapide; bientôt je me trouvai sur une espèce de plateau; j’avançais toujours, car j’apercevais devant moi une masse noire que je ne pouvais distinguer, mais qui, quelle qu’elle fût, devait m’offrir un couvert. Enfin un éclair brilla, je reconnus le porche dégradé d’une chapelle; j’entrai, et je me trouvai dans un cloître; je cherchai l’endroit le moins écroulé, et je m’assis dans un angle à l’ombre d’un pilier, décidé à attendre là le jour; car, ne connaissant pas la côte, je ne pouvais me hasarder par le temps qu’il faisait à me mettre en quête d’une habitation. D’ailleurs j’avais, dans mes chasses de la Vendée et des Alpes, dans une chaumière bretonne ou dans un chalet suisse, passé vingt nuits plus mauvaises encore que celle qui m’attendait; la seule chose qui m’inquiétait était un certain tiraillement d’estomac qui me rappelait que je n’avais rien pris depuis dix heures du matin, quand tout-à-coup je me rappelai que j’avais dit à madame Oseraie de songer aux poches de mon paletot: j’y portai vivement la main; ma brave hôtesse avait suivi ma recommandation: je trouvai dans l’une un petit pain et dans l’autre une gourde pleine de rhum. C’était un souper parfaitement adapté à la circonstance: aussi, à peine l’eus-je achevé, que je sentis une douce chaleur renaître dans mes membres, qui commençaient à s’engourdir; mes idées, qui avaient pris une teinte sombre dans l’attente d’une veille affamée, se ranimèrent dès que le besoin fut éteint; je sentis le sommeil qui allait venir, conduit par la lassitude: je m’enveloppai dans mon paletot, je m’établis contre mon pilier, et bientôt je m’assoupis, bercé par le bruit de la mer qui venait se briser contre le rivage et le sifflement du vent qui s’engouffrait dans les ruines.
Je dormais depuis deux heures à peu près, lorsque je fus réveillé par le bruit d’une porte qui se refermait en grinçant sur ses gonds et en battant la muraille. J’ouvris d’abord les yeux tout grands, comme il arrive lorsqu’on est d’un sommeil inquiet; puis je me levai aussitôt, en prenant la précaution instinctive de me cacher derrière mon pilier.... Mais j’eus beau regarder autour de moi, je ne vis rien, je n’entendis rien; cependant je n’en restai pas moins sur mes gardes, convaincu que le bruit qui m’avait réveillé s’était bien réellement fait entendre, et que l’illusion d’un rêve ne m’avait pas trompé.
L’orage était apaisé, et, quoique le ciel fût toujours chargé de nuages noirs, de temps en temps, dans leur intervalle, la lune parvenait à glisser un de ses rayons. Pendant un de ces momens de clarté rapide que l’obscurité venait bientôt éteindre, je détournai mes regards de cette porte que je croyais avoir entendue crier, pour les étendre autour de moi. J’étais, comme j’avais cru le distinguer malgré les ténèbres, au milieu d’une vieille abbaye en ruines: autant qu’on en pouvait juger par les restes encore debout, je me trouvais dans la chapelle: à ma droite et à ma gauche s’étendaient les deux corridors du cloître, soutenus par des arcades basses et cintrées, tandis qu’en face, quelques pierres brisées et posées à plat au milieu de grandes herbes indiquaient le petit cimetière où les anciens habitans de ce cloître venaient se reposer de la vie au pied de la croix de pierre, mutilée et veuve de son Christ, mais encore debout.
Tu le sais, continua Alfred, et tous les hommes véritablement braves l’avoueront, les influences physiques ont un immense pouvoir sur les impressions de l’âme. Je venais d’échapper, la veille, à un orage terrible; j’étais arrivé à moitié glacé au milieu de ruines inconnues; je m’étais endormi d’un sommeil de fatigue, troublé bientôt par un bruit extraordinaire dans cette solitude; enfin, à mon réveil, je me trouvais sur le théâtre même de ces vols et de ces assassinats qui, depuis deux mois, désolaient la Normandie; je m’y trouvais seul, sans armes, et, comme je te le dis, dans une de ces dispositions d’esprit où les antécédens physiques empêchent le moral engourdi de reprendre toute son énergie. Tu ne trouveras donc rien d’étonnant à ce que tous ces récits du coin du feu me revinssent en mémoire et à ce que je restasse immobile et debout contre mon pilier, au lieu de me recoucher et d’essayer de me rendormir. Au reste, ma conviction était si grande, qu’un bruit humain m’avait réveillé, que, tout en interrogeant les ténèbres des corridors et l’espace plus éclairé du cimetière, mes yeux revenaient constamment se fixer sur cette porte enfoncée dans la muraille, où j’étais certain que quelqu’un était entré: vingt fois j’eus le désir d’aller écouter à cette porte si je n’entendrais pas quelque bruit qui pût éclaircir mes doutes; mais il fallait, pour arriver jusqu’à elle, franchir un espace que les rayons de la lune éclairaient en plein. Or, d’autres hommes pouvaient comme moi être cachés dans ce cloître, et n’échapper à mes regards que comme j’échappais aux leurs, c’est-à-dire en restant dans l’ombre et sans mouvement. Néanmoins, au bout d’un quart d’heure, tout ce désert était redevenu si calme et si silencieux, que je résolus de profiter du premier moment où un nuage obscurcirait la lune, pour franchir l’intervalle de quinze à vingt pas qui me séparait de cet enfoncement, et aller écouter à cette porte: ce moment ne se fit pas attendre; la lune se voila bientôt, et l’obscurité fut si profonde, que je pensai pouvoir me hasarder sans danger à accomplir ma résolution. Je me détachai donc lentement de ma colonne, à laquelle jusque-là j’étais resté adhérent comme une sculpture gothique; puis, de pilier en pilier, retenant mon haleine, écoulant à chaque pas, je parvins enfin jusqu’au mur du corridor. Je le suivis un instant en m’appuyant contre lui; enfin j’arrivai aux degrés qui conduisaient sous la voûte, je descendis trois marches, et je touchai la porte.
Pendant dix minutes j’écoutai sans rien entendre, et peu à peu ma première conviction s’éteignit pour faire place au doute. J’en revenais à croire qu’un rêve m’avait trompé, et que j’étais le seul habitant de ces ruines qui m’avaient offert un asile: j’allais quitter la porte et rejoindre mon pilier, lorsque la lune reparut en éclairant de nouveau l’espace qu’il me fallait traverser pour retourner à mon poste; j’allais me mettre en route, malgré cet inconvénient, qui pour moi avait cessé d’en être un, lorsqu’une pierre se détacha de la voûte et tomba. J’entendis le bruit qu’elle fit, et, quoique j’en connusse la cause, je tressaillis comme à un avertissement, et, au lieu de suivre mon premier sentiment, je demeurai encore un instant dans l’ombre que projetait la voûte en avançant au-dessus de ma tête. Tout-à-coup je crus distinguer derrière moi un bruit lointain et prolongé, pareil à celui que ferait une porte en se fermant au fond d’un souterrain; bientôt des pas éloignés encore se firent entendre, puis se rapprochèrent; on montait l’escalier profond auquel appartenaient les trois marches que j’avais descendues. En ce moment la lune disparut de nouveau. D’un seul bond je m’élançai dans le corridor, et, à reculons, les bras étendus derrière moi, l’œil fixé sur l’enfoncement que je venais de quitter, je regagnai ma colonne protectrice, et je repris ma place. Au bout d’un instant, le même grincement qui m’avait réveillé se fit entendre de nouveau; la porte s’ouvrit et se referma; puis un homme parut, sortant à moitié de l’ombre, s’arrêta un instant pour écouter et regarder autour de lui; et, voyant que tout était tranquille, il entra dans le corridor et s’avança vers l’extrémité opposée à celle où je me trouvais. Il n’eut pas fait dix pas que je le perdis de vue, tant l’obscurité était épaisse. Au bout d’un instant la lune reparut de nouveau, et à l’extrémité du petit cimetière j’aperçus le mystérieux inconnu, une bêche à la main. Il enleva une ou deux pelletées de terre, jeta un objet que je ne pus distinguer dans le trou qu’il avait creusé, et, sans doute pour que toute trace de ce qu’il venait de faire fût cachée aux hommes, il laissa retomber sur l’endroit auquel il avait confié son dépôt la pierre d’une tombe qu’il avait soulevée. Ces précautions prises, il regarda de nouveau autour de lui, et, ne voyant rien, n’entendant rien, il alla reposer sa bêche contre un des piliers du cloître, et disparut sous une voûte.
Ce moment avait été court, et la scène que je viens de raconter s’était passée à quelque distance de moi; cependant, malgré la rapidité de l’exécution et l’éloignement de l’acteur, j’avais pu distinguer un jeune homme de vingt-huit à trente ans, aux cheveux blonds et de moyenne taille. Il était vêtu d’un simple pantalon de toile bleue, pareil à celui que portent habituellement les paysans les jours de fête; mais ce qui indiquait qu’il appartenait à une autre classe que celle que l’apparence première lui assignait, c’était un couteau de chasse pendu à sa ceinture, et dont je vis briller aux rayons de la lune la garde et l’extrémité. Quant à sa figure, il m’eût été difficile d’en donner le signalement précis; mais cependant j’en avais vu assez pour le reconnaître, s’il m’arrivait de le rencontrer.
Tu comprends que cette scène étrange suffisait à chasser pour le reste de la nuit, non-seulement tout espoir, mais encore toute idée de sommeil. Je restai donc debout sans éprouver un moment de fatigue, tout entier aux mille pensées qui se croisaient dans mon esprit, et bien résolu à approfondir ce mystère; mais pour le moment la chose était impossible: j’étais sans armes, comme je l’ai dit; je n’avais ni la clef de cette porte ni une pince pour l’enfoncer; puis il fallait penser si mieux ne valait pas faire une déposition que tenter par moi-même une aventure au bout de laquelle je pourrais bien, comme Don Quichotte, trouver quelque moulin à vent. En conséquence, dès que je vis blanchir le ciel, je repris le chemin du porche par lequel j’étais entré; bientôt je me retrouvai sur la déclivité de la montagne: un vaste brouillard couvrait la mer; je descendis sur la plage, et je m’assis en attendant qu’il fût dissipé. Au bout d’une demi-heure, le soleil se leva, et ses premiers rayons fondirent la vapeur qui couvrait l’Océan encore ému et furieux de l’orage de la veille.
J’avais espéré retrouver ma barque, que la marée montante avait dû jeter à la côte: en effet je l’aperçus échouée au milieu des galets; j’allai à elle. Mais, outre qu’en se retirant, la mer me mettait dans l’impossibilité de la lancer à flot, une des planches du fond s’était brisée à l’angle d’une roche: il était donc inutile de penser à m’en servir pour retourner à Trouville. Heureusement la côte est abondante en pêcheurs, et une demi-heure ne s’était pas écoulée, que j’aperçus un bateau. Bientôt il fut à portée de la voix, je fis signe et j’appelai: je fus vu et entendu, le bateau se dirigea de mon côté; j’y transportai le mât, la voile et les avirons de ma barque, qu’une nouvelle marée pouvait emporter; quant à la carcasse, je l’abandonnai: son propriétaire viendrait voir lui-même si elle était encore en état de servir, et j’en serais quitte pour en payer la réparation partielle ou la perte entière. Les pêcheurs, qui me recueillaient comme un nouveau Robinson Crusoé, étaient justement de Trouville. Ils me reconnurent et me témoignèrent leur joie de me retrouver vivant: ils m’avaient vu partir la veille, et, sachant que je n’étais pas revenu, ils m’avaient cru noyé. Je leur racontai mon naufrage; je leur dis que j’avais passé la nuit derrière un rocher, et à mon tour je leur demandai comment on nommait ces ruines qui s’élevaient sur le sommet de la montagne, et que nous commencions à apercevoir en nous éloignant du rivage. Ils me répondirent que c’étaient celles de l’abbaye de Grand-Pré, attenantes au parc du château de Burcy, qu’habitait le comte Horace de Beuzeval.
C’était la seconde fois que ce nom était prononcé devant moi, et faisait tressaillir mon cœur en y rappelant un ancien souvenir. Le comte Horace de Beuzeval était le mari de mademoiselle Pauline de Meulien.
—Pauline de Meulien! m’écriai-je en interrompant Alfred, Pauline de Meulien!.... Et toute ma mémoire me revint.... Oui, c’est bien cela... c’est bien la femme que j’ai rencontrée avec toi en Suisse et en Italie. Nous nous étions trouvés ensemble dans les salons de la princesse B., du duc de F., de madame de M. Comment ne l’ai-je pas reconnue, toute pâle et défaite qu’elle était? Oh! mais une femme charmante, pleine de talens, de charmes et d’esprit! De magnifiques cheveux noirs, avec des yeux doux et fiers! Pauvre enfant! pauvre enfant! Oh! je me la rappelle et je la reconnais maintenant.
—Oui, me dit Alfred d’une voix émue et étouffée, oui... c’est cela.... Elle aussi t’avait reconnu, et voilà pourquoi elle te fuyait avec tant de soin. C’était un ange de beauté, de grâce et de douceur: tu le sais, car, ainsi que tu l’as dit, nous l’avons vue plus d’une fois ensemble; mais ce que tu ne sais pas, c’est que je l’aimais alors de toute mon âme, que j’eusse certes tenté d’être son époux, si, à cette époque, j’avais eu la fortune que je possède aujourd’hui, et que je me suis tu, parce que j’étais pauvre comparativement à elle. Je compris donc que, si je continuais de la voir, je jouais tout mon bonheur à venir contre un regard dédaigneux ou un refus humiliant. Je partis pour l’Espagne; et pendant que j’étais à Madrid, j’appris que mademoiselle Pauline de Meulien avait épousé le comte Horace de Beuzeval.
Les nouvelles pensées que le nom que ces pêcheurs venaient de prononcer avait fait naître en moi commencèrent à effacer les impressions qu’avait jusqu’alors laissées dans mon esprit l’accident étrange de la nuit; d’ailleurs le jour, le soleil, le peu d’analogie qu’il y a entre notre vie habituelle et de pareilles aventures contribuaient à me faire regarder tout cela comme un songe. L’idée de faire une déposition était complétement évanouie; celle de tenter de tout éclaircir par moi-même m’était seule restée au fond du cœur; d’ailleurs je me reprochais cette terreur d’un moment dont je m’étais senti saisi, et je voulais me donner à moi-même une réparation qui me satisfît.
J’arrivai à Trouville vers les onze heures du matin. Tout le monde me fit fête! on me croyait ou noyé ou assassiné, et l’on était enchanté de voir que j’en étais quitte pour une courbature; en effet, je tombais de fatigue, et je me couchai en recommandant qu’on me réveillât à cinq heures du soir, et qu’on me tînt une voiture prête pour me conduire à Pont-l’Évêque, où je comptais aller coucher. Mes recommandations furent ponctuellement suivies, et à huit heures j’étais arrivé à ma destination. Le lendemain, à six heures du matin, je pris un cheval de poste, et, précédé de mon guide, je partis à franc-étrier pour Dives. Mon intention était, arrivé à cette ville, de m’en aller en simple promeneur au bord de la mer, de suivre la côte jusqu’à ce que je rencontrasse les ruines de l’abbaye de Grand-Pré, et alors de visiter le jour, en simple amateur de paysage, ces localités que je désirais parfaitement étudier, afin de les reconnaître et d’y revenir pendant la nuit. Un incident imprévu détruisit ce plan, et me conduisit au même but par un autre chemin.
En arrivant chez le maître de poste de Dives, qui était en même temps le maire, je trouvai la gendarmerie à sa porte et toute la ville en révolution. Un nouveau meurtre venait encore d’être commis, mais cette fois avec une audace sans pareille. Madame la comtesse de Beuzeval, arrivée quelques jours auparavant de Paris, venait d’être assassinée dans le parc même de son château, habité par le comte et deux ou trois de ses amis. Comprends-tu? Pauline... la femme que j’avais aimée, celle dont le souvenir, réveillé dans mon cœur, y vivait tout entier... Pauline, assassinée... assassinée pendant la nuit, assassinée dans le parc de son château, tandis que j’étais, moi, dans les ruines de l’abbaye attenante, c’est-à-dire à cinq cents pas d’elle! C’était à n’y pas croire.... Mais tout-à-coup cette apparition, cette porte, cet homme, tout cela me revint à l’esprit; j’allais parler, j’allais tout dire, lorsque je ne sais quel pressentiment me retint; je n’avais pas encore assez de certitude, et je résolus, avant de rien révéler, de pousser mon investigation jusqu’au bout.
Les gendarmes, qui avaient été prévenus à quatre heures du matin, venaient chercher le maire, le juge de paix et deux médecins pour dresser le procès-verbal; le maire et le juge de paix étaient prêts; mais un des deux médecins, absent pour affaires de clientèle, ne pouvait se rendre à l’invitation de l’autorité: j’avais fait pour la peinture quelques études d’anatomie à la Charité, je m’offris comme élève en chirurgie. Je fus accepté à défaut de mieux, et nous partîmes pour le château de Burcy: toute ma conduite était instinctive; j’avais voulu revoir Pauline avant que les planches du cercueil ne se fermassent pour elle, ou plutôt j’obéissais à une voix intérieure qui me venait du ciel.
Nous arrivâmes au château; le comte en était parti le matin même pour Caen: il allait solliciter du préfet la permission de faire transporter le cadavre à Paris, où étaient les caveaux de sa famille, et il avait profité, pour s’éloigner, du moment où la justice remplirait ses froides formalités, si douloureuses pour le désespoir.
Un de ses amis nous reçut et nous conduisit à la chambre de la comtesse. A peine si je pouvais me soutenir, mes jambes pliaient sous moi, mon cœur battait avec violence; je devais être pâle comme la victime qui nous attendait. Nous entrâmes dans la chambre, elle était encore toute parfumée d’une odeur de vie. Je jetai autour de moi un regard effaré: j’aperçus sur un lit une forme humaine que trahissait le linceul déjà étendu sur elle; alors je sentis tout mon courage s’évanouir, je m’appuyai contre la porte: le médecin s’avança vers le lit avec ce calme et cette insensibilité incompréhensible que donne l’habitude. Il souleva le drap qui recouvrait le cadavre et découvrit la tête: alors je crus rêver encore, ou bien que j’étais sous l’empire de quelque fascination. Ce cadavre étendu sur le lit, ce n’était pas celui de la comtesse de Beuzeval; cette femme assassinée et dont nous venions constater la mort, ce n’était pas Pauline!
C’était une femme blonde et aux yeux bleus, à la peau blanche et aux mains élégantes et aristocratiques; c’était une femme jeune et belle, mais ce n’était pas Pauline.
La blessure était au côté droit; la balle avait passé entre deux côtes et était allée traverser le cœur; de sorte que la mort avait dû être instantanée. Tout ceci était un mystère si étrange, que je commençais à m’y perdre; mes soupçons ne savaient où se fixer: mais ce qu’il y avait de certain dans tout cela, c’est que cette femme, ce n’était pas Pauline, que son mari déclarait morte, et sous le nom de laquelle on allait enterrer une étrangère.
Je ne sais trop à quoi je fus bon pendant toute cette opération chirurgicale; je ne sais trop ce que je signai sous le titre de procès-verbal; heureusement que le docteur de Dives, tenant sans doute à établir sa supériorité sur un élève, et la prééminence de la province sur Paris, se chargea de toute la besogne, et ne réclama que ma signature. L’opération dura deux heures à peu près; puis nous descendîmes dans la salle à manger du château, où l’on nous avait préparé quelques rafraîchissemens. Pendant que mes compagnons répondaient à cette politesse en s’attablant, j’allai m’appuyer la tête contre le carreau d’une fenêtre qui donnait sur le devant. J’y étais depuis un quart d’heure à peu près, lorsqu’un homme couvert de poussière rentra au grand galop de son cheval dans la cour, se jeta en bas de sa monture sans s’inquiéter si quelqu’un était là pour la garder, et s’élança rapidement vers le perron. J’avançais de surprise en surprise: cet homme, quoique je n’eusse fait que l’entrevoir, je l’avais reconnu malgré son changement de costume. Cet homme, c’était celui que j’avais vu au milieu des ruines sortant du caveau; c’était l’homme au pantalon bleu, à la bêche et au couteau de chasse. J’appelai un domestique et lui demandai quel était le cavalier qui venait de rentrer.—C’est mon maître, me dit-il, le comte de Beuzeval, qui revient de Caen, où il était allé chercher l’autorisation de transfert. Je lui demandai s’il comptait repartir bientôt pour Paris.—Ce soir, me dit-il, car le fourgon qui doit transporter le corps de madame est préparé, et les chevaux de poste commandés pour cinq heures. En sortant de la salle à manger, nous entendîmes des coups de marteau; c’était le menuisier qui clouait la bière. Tout se faisait régulièrement, mais en hâte, comme on le voit.
Je repartis pour Dives: à trois heures j’étais à Pont-l’Évêque, et à quatre heures à Trouville.
Ma résolution était prise pour cette nuit. J’étais décidé à tout éclaircir moi-même, et, si ma tentative était inutile, à tout déclarer le lendemain, et à laisser à la police le soin de terminer cette affaire.
En conséquence, la première chose dont je m’occupai en arrivant fut de louer une nouvelle barque; mais cette fois je retins deux hommes pour la conduire, puis je montai dans ma chambre, je passai une paire d’excellens pistolets à deux coups dans ma ceinture de voyage, qui supportait en même temps un couteau-poignard; je boutonnai mon paletot par-dessus, pour déguiser à mon hôtesse ces préparatifs formidables; je fis porter dans la barque une torche et une pince, et j’y descendis avec mon fusil, donnant pour prétexte à mon excursion le désir de tirer des mouettes et des guillemots.
Cette fois encore le vent était bon; en moins de trois heures nous fûmes à la hauteur de l’embouchure de la Dive: arrivé là, j’ordonnai à mes matelots de rester en panne jusqu’à ce que la nuit fût tout-à-fait venue; puis, lorsque je vis l’obscurité assez complète, je fis mettre le cap sur la côte et j’abordai.
Alors je donnai mes dernières instructions à mes hommes: elles consistaient à m’attendre dans un creux de rocher, à veiller chacun à leur tour, et à se tenir prêts à partir à mon premier signal. Si, au jour, je n’étais pas revenu, ils devaient se rendre à Trouville et remettre au maire un paquet cacheté: c’était ma déposition écrite et signée, les détails de l’expédition que je tentais et les renseignemens à l’aide desquels on pourrait me retrouver mort ou vivant. Cette précaution prise, je mis mon fusil en bandoulière; je pris ma pince et ma torche, un briquet pour l’allumer au besoin, et j’essayai de reprendre le chemin que j’avais suivi lors de mon premier voyage.
Je ne tardai pas à le retrouver, je gravis la montagne, et les premiers rayons de la lune me montrèrent les ruines de la vieille abbaye; je franchis le porche, et comme la première fois je me trouvai dans la chapelle.
Cette fois encore mon cœur battait avec violence; mais c’était plus d’attente que de terreur. J’avais eu le temps d’asseoir ma résolution, non pas sur cette excitation physique que donne le courage brutal et momentané, mais sur cette réflexion morale qui fait la résolution prudente, mais irrévocable.
Arrivé au pilier au pied duquel je m’étais couché, je m’arrêtai pour jeter un coup d’œil autour de moi. Tout était calme, aucun bruit ne se faisait entendre, si ce n’est ce mugissement éternel, qui semble la respiration bruyante de l’Océan; je résolus de procéder par ordre, et de fouiller d’abord l’endroit où j’avais vu le comte de Beuzeval, car j’étais bien convaincu que c’était lui, cacher un objet que je n’avais pu distinguer. En conséquence, je laissai la pince et la torche contre le pilier, j’armai mon fusil pour être prêt à la défense en cas d’événement; je gagnai le corridor, je suivis ses arcades sombres; contre une des colonnes que les soutenaient était appuyée la bêche, je m’en emparai; puis, après un instant d’immobilité et de silence, qui me convainquit que j’étais bien seul, je me hasardai à gagner l’endroit du dépôt; je soulevai la pierre de la tombe, comme l’avait fait le comte, je vis la terre fraîchement remuée, je couchai mon fusil à terre, j’enfonçai ma bêche dans la même ligne déjà découpée, et, au milieu de la première pelletée de terre, je vis briller une clef; je remplis le trou, replaçai la pierre sur la tombe, ramassai mon fusil, remis la bêche où je l’avais trouvée, et m’arrêtai un instant dans l’endroit le plus obscur, pour remettre un peu d’ordre dans mes idées.
Il était évident que cette clef ouvrait la porte par laquelle j’avais vu sortir le comte; dès lors je n’avais plus besoin de la pince: en conséquence, je la laissai derrière le pilier, je pris seulement la torche, je m’avançai vers la porte voûtée, je descendis les trois marches, je présentai la clef à la serrure, elle y entra, au second tour le pêne s’ouvrit, j’entrai; j’allais refermer la porte, lorsque je pensai qu’un accident quelconque pouvait m’empêcher de la rouvrir avec la clef; j’allai rechercher la pince, je la couchai dans l’angle le plus profond de la quatrième à la cinquième marche; je refermai la porte derrière moi; me trouvant alors dans l’obscurité la plus profonde, j’allumai, ma torche, et le souterrain s’éclaira.
Le passage dans lequel j’étais engagé ressemblait à l’entrée d’une cave, il avait tout au plus cinq ou six pieds de large, les murailles et la voûte étaient de pierre; un escalier d’une vingtaine de marches se déroulait devant moi; au bas de l’escalier je me trouvai sur une pente inclinée qui continuait de s’enfoncer sous la terre; devant moi, à quelques pas, je vis une seconde porte, j’allai à elle, j’écoutai en appuyant l’oreille contre ses parois de chêne, je n’entendis rien encore; j’essayai la clef, elle ouvrait ainsi qu’elle avait ouvert l’autre; comme la première fois j’entrai, mais sans la refermer derrière moi, et je me trouvai dans les caveaux réservés aux supérieurs de l’abbaye: on enterrait les simples moines dans le cimetière.
Là, je m’arrêtai un instant: il était évident que j’approchais du terme de ma course; ma résolution était trop bien prise pour que rien lui portât atteinte; et cependant, continua Alfred, tu comprendras facilement que l’impression des lieux n’était pas sans puissance; je passai la main sur mon front couvert de sueur, et je m’arrêtai un instant pour me remettre. Qu’allais-je trouver? sans doute quelque pierre mortuaire, scellée depuis trois jours; tout-à-coup je tressaillis! J’avais cru entendre un gémissement.
Ce bruit, au lieu de diminuer mon courage, me le rendit tout entier; je m’avançai rapidement; mais de quel côté ce gémissement était-il venu? Pendant que je regardais autour de moi, une seconde plainte se fit entendre; je m’élançai du côté d’où elle venait, plongeant mes regards dans chaque caveau, sans y rien voir autre chose que les pierres funèbres, dont les inscriptions indiquaient le nom de ceux qui dormaient à leur abri; enfin, arrivé au dernier, au plus profond, au plus reculé, j’aperçus dans un coin une femme assise, les bras tordus, les yeux fermés et mordant une mèche de ses cheveux; près d’elle, sur une pierre, était une lettre, une lampe éteinte et un verre vide. Étais-je arrivé trop tard? était-elle morte? J’essayai la clef, elle n’était pas faite pour la serrure; mais au bruit que je fis la femme ouvrit des yeux hagards, écarta convulsivement les cheveux qui lui couvraient le visage, et d’un mouvement rapide et mécanique se leva debout comme une ombre. Je jetai à la fois un cri et un nom: Pauline!
Alors la femme se précipita vers la grille et tomba à genoux.
—Oh! s’écria-t-elle avec l’accent de la plus affreuse agonie, tirez-moi d’ici. Je n’ai rien vu, je ne dirai rien, je le jure par ma mère.
—Pauline! Pauline! répétai-je en lui prenant les mains à travers la grille, Pauline, vous n’avez rien à craindre, je viens à votre aide, à votre secours: je viens vous sauver.
—Oh! dit-elle en se relevant, me sauver, me sauver!... oui, me sauver. Ouvrez cette porte, ouvrez-la à l’instant; tant qu’elle ne sera pas ouverte, je ne croirai à rien de ce que vous me direz. Au nom du ciel, ouvrez cette porte.—Et elle secouait la grille avec une puissance dont j’aurais cru une femme incapable.
—Remettez-vous, remettez-vous, lui dis-je, je n’ai pas la clef de cette porte, mais j’ai des moyens de l’ouvrir; je vais aller chercher....
—Ne me quittez pas! s’écria Pauline en me saisissant le bras à travers la grille avec une force inouïe; ne me quittez pas, je ne vous reverrais plus.
—Pauline, lui dis-je en rapprochant la torche de mon visage, ne me reconnaissez-vous pas? Oh! regardez-moi, et songez si je puis vous abandonner.
Pauline fixa ses grands yeux noirs sur les miens, chercha un instant dans ses souvenirs; puis tout-à-coup:
—Alfred de Nerval! s’écria-t-elle.
—Oh! merci, merci, lui répondis-je, ni vous non plus, vous ne m’avez pas oublié. Oui, c’est moi qui vous ai tant aimée, qui vous aime tant encore. Voyez si vous pouvez vous confier à moi.
Une rougeur subite passa sur son visage pâle, tant la pudeur est inhérente au cœur de la femme; puis elle lâcha mon bras.
—Serez-vous longtemps? me dit-elle.
—Cinq minutes.
—Allez donc, mais laissez-moi cette torche, je vous en supplie, les ténèbres me tueraient.
Je lui donnai la torche: elle la prit, passa son bras à travers la grille, appuya son visage entre deux barreaux afin de me suivre des yeux le plus longtemps possible, et je me hâtai de reprendre le chemin par lequel j’étais venu. Au moment de franchir la première porte, je me retournai et je vis Pauline dans la même posture, immobile comme une statue qui eût tenu un flambeau avec son bras de marbre.
Au bout de vingt pas je trouvai le second escalier et à la quatrième marche la pince que j’y avais cachée; je revins aussitôt: Pauline était toujours à la même place. En me revoyant elle jeta un cri de joie. Je me précipitai vers la grille.
La serrure en était tellement solide, que je vis qu’il fallait me tourner du côté des gonds: je me mis donc à attaquer la pierre; Pauline m’éclairait; au bout de dix minutes, les deux attaches de l’un des battans étaient descellées, je le tirai, il céda. Pauline tomba à genoux: ce n’était que de ce moment qu’elle se croyait libre.
Je la laissai un instant à son action de grâces, puis j’entrai dans le caveau. Alors elle se retourna vivement, saisit la lettre ouverte sur la pierre et la cacha dans son sein. Ce mouvement me rappela le verre vide; je m’en emparai avec anxiété, un demi-pouce de matière blanchâtre restait au fond.
—Qu’y avait-il dans ce verre? dis-je épouvanté.
—Du poison, me répondit Pauline.
—Et vous l’avez bu! m’écriai-je.
—Savais-je que vous alliez venir? me dit Pauline en s’appuyant contre la grille; car alors seulement elle se rappela qu’elle avait vidé ce verre une heure ou deux avant mon arrivée.
—Souffrez-vous? lui dis-je.
—Pas encore, me répondit-elle.
Alors un espoir me vint.
—Et y avait-il longtemps que le poison était dans ce verre?
—Deux jours et deux nuits à peu près, car je n’ai pas pu calculer le temps.
Je regardai de nouveau le verre, le détritus qui en couvrait le fond me rassura un peu: pendant ces deux jours et ces deux nuits, le poison avait eu le temps de se précipiter. Pauline n’avait bu que de l’eau, empoisonnée il est vrai, mais peut-être pas à un degré assez intense pour donner la mort.
—Il n’y a pas un instant à perdre, lui dis-je en l’enlevant sous un de mes bras, il faut fuir pour trouver du secours.
—Je pourrai marcher, dit Pauline en se dégageant avec cette sainte pudeur qui avait déjà coloré son visage.
Aussitôt nous nous acheminâmes vers la première porte, que nous refermâmes derrière nous; puis nous arrivâmes à la seconde, qui s’ouvrit sans difficulté, et nous nous retrouvâmes sous le cloître. La lune brillait au milieu d’un ciel pur; Pauline étendit les bras, et tomba une seconde fois à genoux.
—Partons, partons, lui dis-je, chaque minute est peut-être mortelle.
—Je commence à souffrir, dit-elle en se relevant. Une sueur froide me passa sur le front, je la pris dans mes bras comme j’aurais fait d’un enfant, je traversai les ruines, je sortis du cloître et je descendis en courant la montagne: arrivé sur la plage, je vis de loin le feu de mes deux hommes.
—A la mer, à la mer! criai-je de cette voix impérative qui indique qu’il n’y a pas un instant à perdre.
Ils s’élancèrent vers la barque et la firent approcher le plus près qu’ils purent de la rive, j’entrai dans l’eau jusqu’aux genoux; ils prirent Pauline de mes bras et la déposèrent dans la barque. Je m’y élançai après elle.
—Souffrez-vous davantage?
—Oui, me dit Pauline.
Ce que j’éprouvais était quelque chose de pareil au désespoir: pas de secours, pas de contre-poison; tout-à-coup je pensai à l’eau de mer, j’en remplis un coquillage qui se trouvait au fond de la barque, et je le présentai à Pauline.
—Buvez, lui dis-je.
Elle obéit machinalement.
—Qu’est-ce que vous faites donc? s’écria un des pêcheurs; vous allez la faire vomir, c’te p’tite femme.
C’était tout ce que je voulais: un vomissement seul pouvait la sauver. Au bout de cinq minutes elle éprouva des contractions d’estomac d’autant plus douloureuses que, depuis trois jours, elle n’avait rien pris que ce poison. Mais, ce paroxisme passé, elle se trouva soulagée; alors je lui présentai un verre plein d’eau douce et fraîche, qu’elle but avec avidité. Bientôt les douleurs diminuèrent, une lassitude extrême leur succéda. Nous fîmes au fond de la barque un lit des vestes de mes pêcheurs et de mon paletot: Pauline s’y coucha, obéissante comme un enfant; presque aussitôt ses yeux se fermèrent, j’écoutai un instant sa respiration; elle était rapide, mais régulière: tout était sauvé.
—Allons, dis-je joyeusement à mes matelots, maintenant à Trouville, et cela le plus vite possible: il y a vingt-cinq louis pour vous en arrivant.
Aussitôt mes braves bateliers, jugeant que la voile était insuffisante, se penchèrent sur leurs rames, et la barque glissa sur l’eau comme un oiseau de mer attardé.
Pauline rouvrit les yeux en rentrant dans le port; son premier mouvement fut tout à l’effroi; elle croyait avoir fait un rêve consolant; et elle étendit les bras comme pour s’assurer qu’ils ne touchaient plus les murs de son caveau; puis elle regarda autour d’elle avec inquiétude.
—Où me conduisez-vous? me dit-elle.
—Soyez tranquille, lui répondis-je; ces maisons que vous voyez devant vous appartiennent à un pauvre village; ceux qui l’habitent sont trop occupés pour être curieux; vous y resterez inconnue aussi longtemps que vous voudrez. D’ailleurs, si vous désirez partir, dites-moi seulement où vous allez, et demain, cette nuit, à l’instant, je pars avec vous, je vous conduis, je suis votre guide.
—Même hors de France?
—Partout!
—Merci, me dit-elle; laissez-moi seulement songer une heure à cela; je vais essayer de rassembler mes idées, car en ce moment j’ai la tête et le cœur brisés; toute ma force s’est usée pendant ces deux jours et ces deux nuits, et je sens dans mon esprit une confusion qui ressemble à de la folie.
—A vos ordres; quand vous voudrez me voir, vous me ferez appeler. Elle me fit un geste de remercîment. En ce moment nous arrivions à l’auberge.
Je fis préparer une chambre dans un corps de logis entièrement séparé du mien, pour ne pas blesser la susceptibilité de Pauline; puis je recommandai à notre hôtesse de ne lui monter que du bouillon coupé, toute autre nourriture pouvant devenir dangereuse dans l’état d’irritation et d’affaiblissement où devait être l’estomac de la malade. Ces ordres donnés, je me retirai dans ma chambre.
Là, je pus me livrer tout entier au sentiment de joie qui remplissait mon âme, et que, devant Pauline, je n’avais point osé laisser éclater. Celle que j’aimais encore, celle dont le souvenir, malgré une séparation de deux ans, était resté vivant dans mon cœur, je l’avais sauvée, elle me devait la vie. J’admirais par combien de détours cachés et de combinaisons diverses le hasard ou la Providence m’avait conduit à ce résultat; puis tout-à-coup il me passait un frisson mortel par les veines en songeant que, si une de ces circonstances fortuites avait manqué; que si un seul de ces petits événemens dont la chaîne avait formé le fil conducteur qui m’avait guidé dans ce labyrinthe n’était pas venu au devant de moi, à cette heure même, Pauline, enfermée dans un caveau, se tordrait les bras dans les convulsions du poison ou de la faim; tandis que moi, moi, dans mon ignorance, occupé ailleurs d’une futilité, d’un plaisir peut-être, je l’eusse laissée agonisante ainsi, sans qu’un souffle, sans qu’un pressentiment, sans qu’une voix fût venue me dire: Elle se meurt, sauve-la!... Ces choses sont affreuses à penser, et la peur de réflexion est la plus terrible. Il est vrai que c’est aussi la plus consolante, car, après nous avoir fait épuiser le cercle du doute, elle nous ramène à la foi, qui arrache le monde des mains aveugles du hasard pour le remettre à la prescience de Dieu.
Je restai une heure ainsi, et, je te le jure, continua Alfred, pas une pensée qui ne fût pure ne me vint au cœur ou à l’esprit. J’étais heureux, j’étais fier de l’avoir sauvée; cette action portait avec elle sa récompense, et je n’en demandais pas d’autre que le bonheur même d’avoir été choisi pour l’accomplir. Au bout de cette heure elle me fit demander: je me levai vivement, comme pour m’élancer vers sa chambre, mais à la porte les forces me manquèrent, je fus obligé de m’appuyer un instant contre le mur, et il fallut que la fille d’auberge revînt sur ses pas en m’invitant à entrer, pour que je prisse sur moi de surmonter mon émotion.
Elle s’était jetée sur son lit, mais sans se déshabiller. Je m’approchai d’elle avec l’apparence la plus calme que je pus: elle me tendit la main.
—Je ne vous ai pas encore remercié, me dit-elle: mon excuse est dans l’impossibilité de trouver des termes qui expriment ma reconnaissance. Faites la part de la terreur d’une femme dans la position où vous m’avez trouvée, et pardonnez-moi.
—Écoutez-moi, madame, lui dis-je en essayant de réprimer mon émotion, et croyez à ce que je vais vous dire. Il est de ces situations si inattendues, si étranges, qu’elles dispensent de toutes les formes ordinaires et de toutes les préparations convenues. Dieu m’a conduit vers vous et je l’en remercie; mais ma mission n’est point accomplie, je l’espère, et peut-être aurez-vous encore besoin de moi. Écoutez-moi donc et pesez chacune de mes paroles.
Je suis libre... je suis riche... rien ne m’enchaîne sur un point de la terre plutôt que sur un autre. Je comptais voyager, je partais pour l’Angleterre sans aucun but; je puis donc changer mon itinéraire, et me diriger vers telle partie de ce monde où il plaira au hasard de me pousser. Peut-être devez-vous quitter la France? Je n’en sais rien, je ne demande aucun de vos secrets, et j’attendrai que vous me fassiez un signe pour former même uns supposition. Mais, soit que vous restiez en France, soit que vous la quittiez, disposez de moi, madame, à titre d’ami ou de frère; ordonnez que je vous accompagne de près, ou que je vous suive de loin, faites-vous de moi un défenseur avoué, ou exigez que j’aie l’air de ne pas vous connaître, et j’obéirai à l’instant; et cela, madame, croyez-le bien, sans arrière-pensée, sans espoir égoïste, sans intention mauvaise. Et maintenant que j’ai dit, oubliez votre âge, oubliez le mien, ou supposez que je suis votre frère.
—Merci, me dit la comtesse avec une voix pleine d’une émotion profonde; j’accepte avec une confiance pareille à votre loyauté; je me remets tout entière à votre honneur, car je n’ai que vous au monde: vous seul savez que j’existe.
Oui, vous l’avez supposé avec raison, il faut que je quitte la France. Vous alliez en Angleterre, vous m’y conduirez; mais je n’y puis pas arriver seule et sans famille; vous m’avez offert le titre de votre sœur; pour tout le monde désormais je serai mademoiselle de Nerval.
—Oh! que je suis heureux! m’écriai-je. La comtesse me fit signe de l’écouter.
—Je vous demande plus que vous ne croyez peut-être, me dit-elle; moi aussi j’ai été riche, mais les morts ne possèdent plus rien.
—Mais je le suis, moi, mais toute ma fortune...
—Vous ne me comprenez pas, me dit-elle, et, en ne me laissant pas achever, vous me forcez à rougir.
—Oh! pardon.
—Je serai mademoiselle de Nerval, une fille de votre père, si vous voulez, une orpheline qui vous a été confiée. Vous devez avoir des lettres de recommandation; vous me présenterez comme institutrice dans quelque pensionnat. Je parle l’anglais et l’italien comme ma langue maternelle; je suis bonne musicienne, du moins on me le disait autrefois, je donnerai des leçons de musique et de langues.
—Mais c’est impossible! m’écriai-je.
—Voilà mes conditions, me dit la comtesse; les refusez-vous, monsieur, ou les acceptez-vous, mon frère?
—Oh! tout ce que vous voudrez, tout, tout, tout!
—Eh bien! alors il n’y a pas de temps à perdre, il faut que demain nous partions; est-ce possible?
—Parfaitement.
—Mais un passeport?
—J’ai le mien.
—Au nom de monsieur de Nerval?
—J’ajouterai: Et de sa sœur.
—Vous ferez un faux?
—Bien innocent. Aimez-vous mieux que j’écrive à Paris qu’on m’envoie un second passeport?...
—Non, non... cela entraînerait une trop grande perte de temps. D’où partirons-nous?
—Du Havre.
—Comment?
—Par le paquebot, si vous voulez.
—Et quand cela?
—A votre volonté.
—Pouvons-nous tout de suite?
—N’êtes-vous pas bien faible?
—Vous vous trompez, je suis forte. Dès que vous serez disposé à partir, vous me trouverez prête.
—Dans deux heures.
—C’est bien. Adieu, frère.
—Adieu, madame.
—Ah! reprit la comtesse en souriant, voilà déjà que vous manquez à nos conventions.
—Laissez-moi le temps de m’habituer à ce nom si doux.
—M’a-t-il donc tant coûté, à moi?
—Oh! vous!... m’écriai-je. Je vis que j’allais en dire trop. Dans deux heures, repris-je, tout sera préparé selon vos désirs. Puis je m’inclinai et je sortis.
Il n’y avait qu’un quart d’heure que je m’étais offert, dans toute la sincérité de mon âme, à jouer le rôle de frère, et déjà j’en ressentais toute la difficulté. Être le frère adoptif d’une femme jeune et belle est déjà chose difficile; mais lorsqu’on a aimé cette femme, lorsqu’on l’a perdue, lorsqu’on l’a retrouvée seule et isolée, n’ayant d’appui que vous; lorsque le bonheur auquel on n’aurait osé croire, car on le regardait comme un songe, est là près de vous en réalité, et qu’en étendant la main on le touche, alors, malgré la résolution prise, malgré la parole donnée, il est impossible de renfermer dans son âme ce feu qu’elle couve, et il en sort toujours quelque étincelle par les yeux ou par la bouche.
Je retrouvai mes bateliers soupant et buvant; je leur fis part de mon nouveau projet de gagner le Havre pendant la nuit, afin d’y être arrivé au moment du départ du paquebot; mais ils refusèrent de tenter la traversée dans la barque qui nous avait amenés. Comme ils ne demandaient qu’une heure pour préparer un bâtiment plus solide, nous fîmes prix à l’instant, ou plutôt ils laissèrent la chose à ma générosité. J’ajoutai cinq louis aux vingt-cinq qu’ils avaient déjà reçus; pour cette somme ils m’eussent conduit en Amérique.
Je fis une visite dans les armoires de mon hôtesse. La comtesse s’était sauvée avec la robe qu’elle portait au moment où elle fut enfermée, et voilà tout. Je craignais pour elle, faible et souffrante comme elle l’était encore, le vent et le brouillard de la nuit; j’aperçus sur la planche d’honneur un grand tartan écossais dont je m’emparai, et que je priai madame Oseraie de mettre sur ma note; grâce à ce châle et à mon manteau, j’espérais que ma compagne de voyage ne serait pas incommodée de la traversée. Elle ne se fit pas attendre, et lorsqu’elle sut que les bateliers étaient prêts, elle descendit aussitôt. J’avais profité du temps qu’elle m’avait donné pour régler tous mes petits comptes à l’auberge; nous n’eûmes donc qu’à gagner le port et à nous embarquer.
Comme je l’avais prévu, la nuit était froide, mais calme et belle. J’enveloppai la comtesse de son tartan, et je voulus la faire entrer sous la tente que nos bateliers avaient faite à l’arrière du bâtiment avec une voile; mais la sérénité du ciel et la tranquillité de la mer la retinrent sur le pont; je lui montrai un banc, et nous nous assîmes l’un près de l’autre.
Tous deux nous avions le cœur si plein de nos pensées, que nous demeurâmes ainsi sans nous adresser la parole. J’avais laissé retomber ma tête sur ma poitrine, et je songeais avec étonnement à cette suite d’aventures étranges qui venaient de commencer pour moi, et dont la chaîne allait probablement s’étendre dans l’avenir. Je brûlais de savoir par quelle suite d’événemens la comtesse de Beuzeval, jeune, riche, aimée en apparence de son mari, en était arrivée à attendre, dans un des caveaux d’une abbaye en ruines, la mort à laquelle je l’avais arrachée. Dans quel but et pour quel résultat son mari avait-il fait courir le bruit de sa mort et exposé sur le lit mortuaire une étrangère à sa place? Était-ce par jalousie?... ce fut la première idée qui se présenta à mon esprit, elle était affreuse.... Pauline aimer quelqu’un!.... Oh! alors voilà qui désenchantait tous mes rêves; car pour cet homme qu’elle aimait elle reviendrait à la vie sans doute; quelque part qu’elle fût, cet homme la rejoindrait. Alors je l’aurais sauvée pour un autre; elle me remercierait comme un frère, et tout serait dit; cet homme me serrerait la main en me répétant qu’il me devait plus que la vie; puis ils seraient heureux d’un bonheur d’autant plus sûr, qu’il serait ignoré!... Et moi, je reviendrais en France pour y souffrir comme j’avais déjà souffert, et mille fois davantage; car cette félicité, que d’abord je n’avais entrevue que de loin, s’était rapprochée de moi, pour m’échapper plus cruellement encore; et alors il viendrait un moment peut-être où je maudirais l’heure où j’avais sauvé cette femme, où je regretterais que, morte pour tout le monde, elle fût vivante pour moi, loin de moi; et pour un autre, près de lui.... D’ailleurs, si elle était coupable, la vengeance du comte était juste.... A sa place je ne l’eusse pas fait mourir... mais certes... je l’eusse tuée... elle et l’homme qu’elle aimait.... Pauline aimant un autre!... Pauline coupable!... Oh! cette idée me rongeait le cœur.... Je relevai lentement le front; Pauline, la tête renversée en arrière, regardait le ciel, et deux larmes coulaient le long de ses joues.
—Oh! m’écriai-je... qu’avez-vous donc, mon Dieu?
—Croyez-vous, me dit-elle en gardant son immobilité, croyez-vous que l’on quitte pour toujours sa patrie, sa famille, sa mère, sans que le cœur se brise? Croyez-vous qu’on passe, sinon du bonheur, mais du moins de la tranquillité au désespoir, sans que le cœur saigne? Croyez-vous qu’on traverse l’Océan à mon âge pour aller traîner le reste de sa vie sur une terre étrangère, sans mêler une larme aux flots qui vous emportent loin de tout ce qu’on a aimé?...
—Mais, lui dis-je, est-ce donc un adieu éternel?
—Éternel! murmura-t-elle en secouant doucement la tête.
—De ceux que vous regrettez ne reverrez-vous personne?
—Personne....
—Et tout le monde doit-il ignorer à jamais, et... sans exception, que celle que l’on croit morte et qu’on regrette est vivante et pleure?
—Tout le monde... à jamais... sans exception....
—Oh!... m’écriai-je, oh! que je suis heureux, et quel poids vous m’enlevez du cœur!...
—Je ne vous comprends pas, dit Pauline.
—Oh! ne devinez-vous point tout ce qui s’éveille en moi de doutes et de craintes?... N’avez-vous point hâte de savoir vous-même par quel enchaînement de circonstances je suis arrivé jusques auprès de vous?... Et rendez-vous grâce au ciel de vous avoir sauvée, sans vous informer à moi de quels moyens il s’est servi?...
—Vous avez raison, un frère ne doit point avoir de secrets pour sa sœur.... Vous me raconterez tout... et, à mon tour, je ne vous cacherai rien....
—Rien.... Oh! jurez-le-moi.... Vous me laisserez lire dans votre cœur comme dans un livre ouvert?...
—Oui... et vous n’y trouverez que le malheur, la résignation et la prière.... Mais ce n’est ni l’heure ni le moment. D’ailleurs je suis trop près encore de toutes ces catastrophes pour avoir le courage de les raconter....
—Oh! quand vous voudrez... à votre heure... à votre temps.... J’attendrai....
Elle se leva.—J’ai besoin de repos, me dit-elle: ne m’avez vous pas dit que je pourrais dormir sous cette tente?
Je l’y conduisis; j’étendis mon manteau sur le plancher; puis elle me fit signe de la main de la laisser seule. J’obéis, et je retournai m’asseoir sur le pont, à la place qu’elle avait occupée; je posai ma tête où elle avait posé la sienne, et je demeurai ainsi jusqu’à notre arrivée au Havre.
Le lendemain soir nous abordions à Brighton; six heures après nous étions à Londres.
Mon premier soin en arrivant fut de me mettre en quête d’un appartement pour ma sœur et pour moi; en conséquence je me présentai le même jour chez le banquier auprès duquel j’étais accrédité: il m’indiqua une petite maison toute meublée, qui faisait parfaitement l’affaire de deux personnes et de deux domestiques; je le chargeai de terminer la négociation, et le lendemain il m’écrivit que le cottage était à ma disposition.
Aussitôt, et tandis que la comtesse reposait, je me fis conduire dans une lingerie: la maîtresse de l’établissement me composa à l’instant un trousseau d’une grande simplicité, mais parfaitement complet et de bon goût; deux heures après, il était marqué au nom de Pauline de Nerval et transporté tout entier dans les armoires de la chambre à coucher de celle à qui il était destiné: j’entrai immédiatement chez une modiste, qui mit, quoique française, la même célérité dans sa fourniture; quant aux robes, comme je ne pouvais me charger d’en donner les mesures, j’achetai quelques pièces d’étoffe, les plus jolies que je pus trouver, et je priai le marchand de m’envoyer le soir même une couturière.
J’étais de retour à l’hôtel à midi: on me dit que ma sœur était réveillée et m’attendait pour prendre le thé: je la trouvai vêtue d’une robe très simple qu’elle avait eu le temps de faire faire pendant les douze heures que nous étions restés au Havre. Elle était charmante ainsi.
—Regardez, me dit-elle en me voyant entrer, n’ai-je pas déjà bien le costume de mon emploi, et hésiterez-vous maintenant à me présenter comme une sous-maîtresse?
—Je ferai tout ce que vous m’ordonnerez de faire, lui dis-je.
—Oh! mais ce n’est pas ainsi que vous devez me parler, et si je suis à mon rôle, il me semble que vous oubliez le vôtre: les frères, en général, ne sont pas soumis aussi aveuglément aux volontés de leur sœur, et surtout les frères aînés. Vous vous trahirez, prenez garde.
—J’admire vraiment votre courage, lui dis-je, laissant tomber mes bras et la regardant:—la tristesse au fond du cœur, car vous souffrez de l’âme; la pâleur sur le front, car vous souffrez du corps; éloignée pour jamais de tout ce que vous aimez, vous me l’avez dit, vous avez la force de sourire. Tenez, pleurez, pleurez, j’aime mieux cela, et cela me fait moins de mal.
—Oui, vous avez raison, me dit-elle, et je suis une mauvaise comédienne. On voit mes larmes, n’est-ce pas, à travers mon sourire? Mais j’avais pleuré pendant que vous n’y étiez pas, cela m’avait fait du bien; de sorte qu’à un œil moins pénétrant, à un frère moins attentif, j’aurais pu faire croire que j’avais déjà tout oublié.
—Oh! soyez tranquille, madame, lui dis-je avec quelque amertume, car tous mes soupçons me revenaient, soyez tranquille, je ne le croirai jamais.
—Croyez-vous qu’on oublie sa mère quand on sait qu’elle vous croit morte et qu’elle pleure votre mort?... O ma mère, ma pauvre mère! s’écria la comtesse en fondant en larmes et en se laissant retomber sur le canapé.
—Voyez comme je suis égoïste, lui dis-je en m’approchant d’elle, je préfère vos larmes à votre sourire. Les larmes sont confiantes et le sourire est dissimulé; le sourire, c’est le voile sous lequel le cœur se cache pour mentir. Puis, quand vous pleurez, il me semble que vous avez besoin de moi pour essuyer vos pleurs.... Quand vous pleurez, j’ai l’espoir que lentement, à force de soins, d’attentions, de respect, je vous consolerai; tandis que, si vous étiez consolée déjà, quel espoir me resterait-il?
—Tenez, Alfred, me dit la comtesse avec un sentiment profond de bienveillance et en m’appelant pour la première fois par mon nom, ne nous faisons pas une vaine guerre de mots; il s’est passé entre nous des choses si étranges, que nous sommes dispensés, vous de détours envers moi, moi de ruse envers vous. Soyez franc, interrogez-moi; que voulez-vous savoir? je vous répondrai.
—Oh! vous êtes un ange, m’écriai-je, et moi je suis un fou: je n’ai le droit de rien savoir, de rien demander. N’ai-je pas été aussi heureux qu’un homme puisse l’être, quand je vous ai retrouvée dans ce caveau, quand je vous ai emportée dans mes bras en descendant cette montagne, quand vous vous êtes appuyée sur mon épaule dans cette barque? Aussi je ne sais, mais je voudrais qu’un danger éternel vous menaçât, pour vous sentir toujours frissonner contre mon cœur: ce serait une existence vite usée qu’une existence pleine de sensations pareilles. On ne vivrait qu’un an peut-être ainsi, puis le cœur se briserait; mais quelle longue vie ne changerait-on pas pour une pareille année? Alors vous étiez toute à votre crainte, et moi j’étais votre seul espoir. Vos souvenirs de Paris ne vous tourmentaient pas. Vous ne feigniez pas de sourire pour me cacher vos larmes; j’étais heureux!... je n’étais pas jaloux.
—Alfred, me dit gravement la comtesse, vous avez fait assez pour moi pour que je fasse quelque chose pour vous. D’ailleurs, il faut que vous souffriez, et beaucoup, pour me parler ainsi; car en me parlant ainsi vous me prouvez que vous ne vous souvenez plus que je suis sous votre dépendance entière. Vous me faites honte pour moi; vous me faites mal pour vous.
—Oh! pardonnez-moi, pardonnez-moi! m’écriai-je en tombant à ses genoux; mais vous savez que je vous ai aimée jeune fille, quoique je ne vous l’aie jamais dit; vous savez que mon défaut de fortune seul m’a empêché d’aspirer à votre main; et vous savez encore que depuis que je vous ai retrouvée, cet amour, endormi peut-être, mais jamais éteint, s’est réveillé plus ardent, plus vif que jamais. Vous le savez, car on n’a pas besoin de dire de pareilles choses pour qu’elles soient sues. Eh bien! voilà ce qui fait que je souffre également à vous voir sourire et à vous voir pleurer; c’est que, quand vous souriez, vous me cachez quelque chose; c’est que, quand vous pleurez, vous m’avouez tout. Ah! vous aimez, vous regrettez quelqu’un.
—Vous vous trompez, me répondit la comtesse; si j’ai aimé, je n’aime plus; si je regrette quelqu’un, c’est ma mère!
—Oh! Pauline! Pauline! m’écriai-je, me dites-vous vrai? ne me trompez-vous pas? Mon Dieu, mon Dieu!
—Croyez-vous que je sois capable d’acheter votre protection par un mensonge?
—Oh! le ciel m’en garde!... Mais d’où est venue la jalousie de votre mari? car la jalousie seule a pu le porter à une pareille infamie.
—Ecoutez, Alfred, un jour ou l’autre il aurait fallu que je vous avouasse ce terrible secret; vous avez le droit de le connaître. Ce soir vous le saurez, ce soir vous lirez dans mon âme; ce soir, vous disposerez de plus que de ma vie, car vous disposerez de mon honneur et de celui de toute ma famille, mais à une condition.
—Laquelle? dites, je l’accepte à l’avance.
—Vous ne me parlerez plus de votre amour; je vous promets, moi, de ne pas oublier que vous m’aimez.
Elle me tendit la main; je la baisai avec un respect qui tenait de la religion.
—Asseyez-vous là, me dit-elle, et ne parlons plus de tout cela jusqu’au soir: qu’avez-vous fait?
—J’ai cherché une petite maison bien simple et bien isolée, où vous soyez libre et maîtresse, car vous ne pouvez rester dans un hôtel.
—Et vous l’avez trouvée?
—Oui, à Piccadilly. Et, si vous voulez, nous irons la voir après le déjeuner.
—Alors, tendez donc votre tasse.
Nous prîmes le thé; puis nous montâmes en voiture, et nous nous rendîmes au cottage.
C’était une jolie petite fabrique à jalousies vertes, avec un jardin plein de fleurs; une véritable maison anglaise, à deux étages seulement. Le rez-de-chaussée devait nous être commun; le premier était préparé pour Pauline. Je m’étais réservé le second.
Nous montâmes à son appartement: il se composait d’une antichambre, d’un salon, d’une chambre à coucher, d’un boudoir et d’un cabinet de travail, où l’on avait réuni tout ce qu’il fallait pour faire de la musique et dessiner. J’ouvris les armoires; la lingère m’avait tenu parole.
—Qu’est-ce cela? me dit Pauline.
—Si vous entrez dans une pension, lui répondis-je, on exigera que vous ayez un trousseau. Celui-ci est marqué à votre nom, un P et un N, Pauline de Nerval.
—Merci, mon frère, me dit-elle en me serrant la main. C’était la première fois qu’elle me redonnait ce titre depuis notre explication; mais cette fois ce titre ne me fit pas mal.
Nous entrâmes dans la chambre à coucher; sur le lit étaient deux chapeaux d’une forme toute parisienne et un châle de cachemire fort simple.
—Alfred, me dit la comtesse en les apercevant, vous eussiez dû me laisser entrer seule ici, puisque j’y devais trouver toutes ces choses. Ne voyez-vous pas que j’ai honte devant vous de vous avoir donné tant de peine?... Puis vraiment je ne sais s’il est convenable....
—Vous me rendrez tout cela sur le prix de vos leçons, interrompis-je en souriant: un frère peut prêter à sa sœur.
—Il peut même lui donner lorsqu’il est plus riche qu’elle, dit Pauline, car, dans ce cas-là, c’est celui qui donne qui est heureux.
—Oh! vous avez raison, m’écriai-je, et aucune délicatesse du cœur ne vous échappe.... Merci, merci!...
Nous passâmes dans le cabinet de travail; sur le piano étaient les romances les plus nouvelles de madame Duchange, de Labarre et de Plantade; les morceaux les plus à la mode de Bellini, de Meyerbeer et de Rossini. Pauline ouvrit un cahier de musique et tomba dans une profonde rêverie.
—Qu’avez-vous? lui dis-je, voyant que ses yeux restaient fixés sur la même page, et qu’elle semblait avoir oublié que j’étais là.
—Chose étrange! murmura-t-elle, répondant à la fois à sa pensée et à ma question, il y a une semaine au plus que je chantais ce même morceau chez la comtesse M.; alors j’avais une famille, un nom, une existence. Huit jours se sont passés... et je n’ai plus rien de tout cela.... Elle pâlit et tomba plutôt qu’elle ne s’assit sur un fauteuil, et l’on eût dit que véritablement elle allait mourir. Je m’approchai d’elle, elle ferma les yeux; je compris qu’elle était tout entière à sa pensée, je m’assis près d’elle, et lui appuyant la tête sur mon épaule:
—Pauvre sœur! lui dis-je.
Alors elle se reprit à pleurer; mais cette fois sans convulsions ni sanglots: c’étaient des larmes mélancoliques et silencieuses, de ces larmes enfin qui ne manquent pas d’une certaine douceur, et qu’il faut que ceux qui les regardent sachent laisser couler. Au bout d’un instant elle rouvrit les yeux avec un sourire.
—Je vous remercie, me dit-elle, de m’avoir laissée pleurer.
—Je ne suis plus jaloux, lui répondis-je.
Elle se leva.—N’y a-t-il pas un second étage? me dit-elle.
—Oui; il se compose d’un appartement tout pareil à celui-ci.
—Et doit-il être occupé?
—C’est vous qui en déciderez.
—Il faut accepter la position qui nous est imposée par la destinée avec toute franchise. Aux yeux du monde vous êtes mon frère, il est tout simple que vous habitiez la maison que j’habite, tandis qu’on trouverait sans doute étrange que vous allassiez loger autre part. Cet appartement sera le vôtre. Descendons au jardin.
C’était un tapis vert avec une corbeille de fleurs. Nous en fîmes deux ou trois fois le tour en suivant une allée sablée et circulaire qui l’enveloppait; puis Pauline alla vers le massif et y cueillit un bouquet.
—Voyez donc ces pauvres roses, me dit-elle en revenant à moi, comme elles sont pâles et presque sans odeur. N’ont-elles pas l’air d’exilées qui languissent après leur pays? Croyez-vous qu’elles aussi ont une idée de ce que c’est que la patrie, et qu’en souffrant elles ont le sentiment de leur souffrance?
—Vous vous trompez, lui dis-je, ces fleurs sont nées ici; cet air est l’atmosphère qui leur convient; ce sont des filles du brouillard et non de la rosée; un soleil plus ardent les brûlerait. D’ailleurs, elles sont faites pour parer des cheveux blonds et pour s’harmonier avec le teint mat des filles du Nord. A vous, à vos cheveux noirs il faudrait de ces roses ardentes comme il en fleurit en Espagne. Nous irons en chercher là quand vous en voudrez.
Pauline sourit tristement.—Oui, dit-elle, en Espagne... en Suisse... en Italie... partout... excepté en France.... Puis elle continua de marcher sans parler davantage, effeuillant machinalement les roses sur le chemin.
—Mais, lui dis-je, avez-vous donc à tout jamais perdu l’espoir d’y rentrer?
—Ne suis-je pas morte?
—Mais en changeant de nom?...
—Il me faudrait aussi changer de visage.
—Mais c’est donc bien terrible, ce secret?
—C’est une médaille à deux faces, qui porte d’un côté du poison et de l’autre un échafaud. Écoutez, je vais vous raconter tout cela; il faut que vous le sachiez, et le plus tôt est le mieux. Mais vous, dites-moi d’abord par quel miracle de la Providence vous avez été conduit vers moi?
Nous nous assîmes sur un banc au-dessous d’un platane magnifique, qui couvrait de sa tente de feuillage une partie du jardin. Alors je commençai mon récit à partir de mon arrivée à Trouville. Je lui racontai tout: comment j’avais été surpris par l’orage et poussé sur la côte; comment, en cherchant un abri, j’étais entré dans les ruines de l’abbaye; comment, réveillé au milieu de mon sommeil par le bruit d’une porte, j’avais vu sortir un homme du souterrain; comment cet homme avait enfoui quelque chose sous une tombe, et comment, dès lors, je m’étais douté d’un mystère que j’avais résolu de pénétrer. Puis je lui dis mon voyage à Dives, la nouvelle fatale que j’y appris, la résolution désespérée de la revoir une fois encore, mon étonnement et ma joie en reconnaissant que le linceul couvrait une autre femme qu’elle; enfin mon expédition nocturne, la clef sous la tombe, mon entrée dans le souterrain, mon bonheur et ma joie en la retrouvant; et je lui racontai tout cela avec cette expression de l’âme, qui, sans prononcer le mot d’amour, le fait palpiter dans chaque parole que l’on dit; et pendant que je parlais, j’étais heureux et récompensé, car je voyais ce récit passionné l’inonder de mon émotion, et quelques-unes de mes paroles filtrer secrètement jusqu’à son cœur. Lorsque j’eus fini, elle me prit la main, la serra entre les siennes sans parler, me regarda quelque temps avec une expression de reconnaissance angélique; puis enfin, rompant le silence:
—Faites-moi un serment, me dit-elle.
—Lequel? parlez.
—Jurez-moi, sur ce que vous avez de plus sacré, que vous ne révélerez à qui que ce soit au monde ce que je vais vous dire, à moins que je ne sois morte, que ma mère ne soit morte, que le comte ne soit mort.
—Je le jure sur l’honneur, répondis-je.
—Et maintenant, écoutez, dit-elle.
—Je n’ai pas besoin de vous dire quelle était ma famille, vous la connaissez; ma mère, puis des parens éloignés, voilà tout. J’avais quelque fortune.
—Hélas! oui, interrompis-je, et plût au ciel que vous eussiez été pauvre!
—Mon père, continua Pauline sans paraître remarquer le sentiment qui m’avait arraché mon exclamation, laissa en mourant quarante mille livres de rentes à peu près. Comme je suis fille unique, c’était une fortune. Je me présentai donc dans le monde avec la réputation d’une riche héritière.
—Vous oubliez, dis-je, celle d’une grande beauté, jointe à une éducation parfaite.
—Vous voyez bien que je ne puis pas continuer, me répondit Pauline en souriant, puisque vous m’interrompez toujours.
—Oh! c’est que vous ne pouvez pas dire comme moi tout l’effet que vous produisîtes dans ce monde; c’est que c’est une partie de votre histoire que je connais mieux que vous-même; c’est que, sans vous en douter, vous étiez la reine de toutes les fêtes. Reine à la couronne d’hommages, invisible à vos seuls regards. C’est alors que je vous vis. La première fois, ce fut chez la princesse de Bel.... Tout ce qu’il y avait de talens et de célébrités était réuni chez cette belle exilée de Milan. On chanta; alors nos virtuoses de salon s’approchèrent tour à tour du piano. Tout ce que l’instrumentation a de science et le chant de méthode se réunirent d’abord pour charmer cette foule de dilettanti, étonnés toujours de rencontrer dans le monde ce fini d’exécution que l’on demande et qu’on trouve si rarement au théâtre; puis quelqu’un parla de vous et prononça votre nom. Pourquoi mon cœur battit-il à ce nom que j’entendais pour la première fois? La princesse se leva, vous prit par la main, et vous conduisit presque en victime à cet autel de la mélodie: dites-moi encore pourquoi, en vous voyant si confuse, eus-je un sentiment de crainte comme si vous étiez ma sœur, moi qui vous avais vue depuis un quart d’heure à peine. Oh! je tremblai plus que vous, peut-être, et certes vous étiez loin de penser que, dans toute cette foule, il y avait un cœur frère de votre cœur, qui battait de votre crainte et allait s’enivrer de votre triomphe. Votre bouche sourit, les premiers sons de votre voix, tremblans et incertains, se firent entendre; mais bientôt les notes s’échappèrent pures et vibrantes; vos yeux cessèrent de regarder la terre et se fixèrent vers le ciel. Cette foule qui vous entourait disparut, et je ne sais même si les applaudissemens arrivèrent jusqu’à vous, tant votre esprit semblait planer au-dessus d’elle; c’était un air de Bellini, mélodieux et simple, et cependant plein de larmes, comme lui seul savait les faire. Je ne vous applaudis pas, je pleurai. On vous reconduisit à votre place au milieu des félicitations; moi seul n’osai m’approcher de vous; mais je me plaçai de manière à vous voir toujours. La soirée reprit son cours, la musique continua d’en faire les honneurs, secouant sur son auditoire enchanté ses ailes harmonieuses et changeantes; mais je n’entendis plus rien: depuis que vous aviez quitté le piano, tous mes sens s’étaient concentrés en un seul. Je vous regardais. Vous souvenez-vous de cette soirée?
—Oui, je crois me la rappeler, dit Pauline.
—Depuis, continuai-je, sans penser que j’interrompais son récit, depuis, j’entendis encore une fois, non pas cet air lui-même, mais la chanson populaire qui l’inspira. C’était en Sicile, vers le soir d’un de ces jours comme Dieu n’en a fait que pour l’Italie et la Grèce; le soleil se couchait derrière Girgenti, la vieille Agrigente. J’étais assis sur le revers d’un chemin; j’avais à ma gauche, et commençant à se perdre dans l’ombre naissante, toute cette plage couverte de ruines, au milieu desquelles ses trois temples seuls restaient debout. Au delà de cette plage, la mer, calme et unie comme un miroir d’argent; j’avais à ma droite la ville se détachant en vigueur sur un fond d’or, comme un de ces tableaux de la première école florentine, qu’on attribue à Gaddi, ou qui sont signés de Cimabué ou de Giotto. J’avais devant moi une jeune fille qui revenait de la fontaine, portant sur sa tête une de ces longues amphores antiques à la forme délicieuse; elle passait en chantant, et elle chantait cette chanson que je vous ai dite. Oh! si vous saviez quelle impression je ressentis alors! Je fermai les yeux, je laissai tomber ma tête dans mes mains: mer, cité, temples, tout disparut, jusqu’à cette fille de la Grèce, qui venait comme une fée de me faire reculer de trois ans et de me transporter dans le salon de la princesse Bel.... Alors je vous revis; j’entendis de nouveau votre voix; je vous regardai avec extase; puis tout-à-coup une profonde douleur s’empara de mon âme, car vous n’étiez déjà plus la jeune fille que j’avais tant aimée, et qu’on appelait Pauline de Meulien: vous étiez la comtesse Horace de Beuzeval. Hélas!... hélas!
—Oh! oui, hélas! murmura Pauline.
Nous restâmes tous deux quelques instans sans parler, Pauline se remit la première.
—Oui, ce fut le beau temps, le temps heureux de ma vie, continua-t-elle. Oh! les jeunes filles, elles ne connaissent pas leur félicité; elles ne savent pas que le malheur n’ose toucher au voile chaste qui les enveloppe et dont un mari vient les dépouiller. Oui, j’ai été heureuse pendant trois ans; pendant trois ans ce fut à peine si ce soleil brillant de mes jeunes années s’obscurcit un jour, et si une de ces émotions innocentes que les jeunes filles prennent pour de l’amour y passa comme un nuage. L’été, nous allions dans notre château de Meulien; l’hiver, nous revenions à Paris. L’été se passait au milieu des fêtes de la campagne, et l’hiver suffisait à peine aux plaisirs de la ville. Je ne pensais pas qu’une vie si pure et si sereine pût jamais s’assombrir. J’avançais joyeuse et confiante; nous atteignîmes ainsi l’automne de 1830.
Nous avions pour voisine de villégiature madame de Lucienne, dont le mari avait été grand ami de mon père; elle nous invita un soir, ma mère et moi, à passer la journée du lendemain à son château. Son mari, son fils et quelques jeunes gens de Paris s’y étaient réunis pour chasser le sanglier, et un grand dîner devait célébrer la victoire du moderne Méléagre. Nous nous rendîmes à son invitation.
Lorsque nous arrivâmes, les chasseurs étaient déjà partis; mais comme le parc était fermé de murs, nous pouvions facilement les rejoindre; d’ailleurs, de temps en temps, nous devions entendre le son du cor, et en nous rendant vers lui nous pouvions prendre tout le plaisir de la chasse sans en risquer la fatigue; monsieur de Lucienne était resté pour nous tenir compagnie, à sa femme, à sa fille, à ma mère et à moi; Paul, son fils, dirigeait la chasse.
A midi, le bruit du cor se rapprocha sensiblement; nous entendîmes sonner plus souvent le même air: monsieur de Lucienne nous dit que c’était l’à vue; que le sanglier se fatiguait, et que, si nous voulions, il était temps de monter à cheval; dans ce moment, un des chasseurs arrive au grand galop, venant nous chercher de la part de Paul, le sanglier ne pouvant tarder à faire tête aux chiens. Monsieur de Lucienne prit une carabine qu’il pendit à l’arçon de sa selle; nous montâmes à cheval tous trois et nous partîmes. Nos deux mères, de leur côté, se rendirent à pied dans un pavillon autour duquel tournait la chasse.
Nous ne tardâmes point à la rejoindre, et quelle qu’ait été ma répugnance d’abord à prendre part à cet événement, bientôt le bruit du cor, la rapidité de la course, les aboiemens des chiens, les cris des chasseurs, nous atteignirent nous-mêmes, et nous galopâmes, Lucie et moi, moitié riant, moitié tremblant, à l’égal des plus habiles cavaliers. Deux ou trois fois nous vîmes le sanglier traverser des allées, et chaque fois les chiens le suivaient plus rapprochés. Enfin il alla s’appuyer contre un gros chêne, se retourna et fit tête à la meute. C’était au bord d’une clairière sur laquelle donnaient justement les fenêtres du pavillon; de sorte que madame de Lucienne et ma mère se trouvèrent parfaitement pour ne rien perdre du dénoûment.
Les chasseurs étaient placés en cercle à quarante ou cinquante pas de distance du lieu où se livrait le combat; les chiens, excités par une longue course, s’étaient jetés tous sur le sanglier, qui avait presque disparu sous leur masse mouvante et tachetée. De temps en temps, un des assaillans était lancé à huit ou dix pieds de hauteur, et retombait en hurlant et tout ensanglanté; puis il se rejetait au milieu de la meute, et, tout blessé qu’il était, revenait contre son ennemi. Ce combat dura un quart d’heure à peine, et plus de dix ou douze chiens étaient déjà blessés mortellement. Ce spectacle sanglant et cruel devenait pour moi un supplice, et le même effet était produit, à ce qu’il paraît, sur les autres spectateurs, car j’entendis la voix de madame de Lucienne qui criait:—Assez, assez! je t’en prie, Paul, assez.—Aussitôt Paul sauta en bas de son cheval, sa carabine à la main, fit quelques pas à pied vers le sanglier, l’ajusta au milieu des chiens et fit feu.
Au même instant, car ce qui se passa fut rapide comme un éclair, la meute s’ouvrit, le sanglier blessé passa au milieu d’elle, et avant que madame de Lucienne elle-même eût eu le temps de jeter un cri, il était sur Paul; Paul tomba renversé, et l’animal furieux, au lieu de suivre sa course, s’arrêta acharné sur son nouvel ennemi.
Il y eut alors un silence terrible; madame de Lucienne, pâle comme la mort, les bras tendus vers son fils, essayait de parler et murmurait d’une voix presque inintelligible: Sauvez-le! sauvez-le! Monsieur de Lucienne, qui était le seul armé, prit sa carabine et voulut ajuster l’animal; mais Paul était dessous, la plus légère déviation de la balle, et le père tuait le fils. Un tremblement convulsif s’empara de lui; il vit son impuissance, et, laissant tomber son arme, il courut vers Paul en criant: Au secours! au secours! Les autres chasseurs le suivirent. Au même instant, un jeune homme s’élança à bas de cheval, sauta sur le fusil, et de cette voix ferme et puissante qui commande: Place! cria-t-il. Les chasseurs s’écartèrent pour laisser passer le messager de mort qui devait arriver avant eux. Ce que je viens de vous dire s’était passé en moins d’une minute.
Tous les yeux se fixèrent aussitôt sur le tireur et sur le terrible but qu’il avait choisi; quant à lui, il était ferme et calme, comme s’il eût eu sous les yeux une simple cible. Le canon de la carabine se leva lentement de terre; puis, arrivé aune certaine hauteur, le chasseur et le fusil devinrent immobiles comme s’ils étaient de pierre; le coup partit, et le sanglier blessé à mort roula à deux ou trois pas de Paul, qui, débarrassé de son adversaire, se releva sur un genou, son couteau de chasse à la main. Mais c’était inutile, la balle avait été guidée par un œil trop sûr pour qu’elle ne fût pas mortelle. Madame de Lucienne jeta un cri et s’évanouit, Lucie s’affaissa sur son cheval et serait tombée, si l’un des piqueurs ne l’eût soutenue: je sautai à bas du mien et je courus vers madame de Lucienne; quant aux chasseurs, ils étaient tous autour de Paul et du sanglier mort, à l’exception du tireur, qui, le coup parti, reposa tranquillement sa carabine contre le tronc d’un arbre.
Madame de Lucienne revint à elle dans les bras de son fils et de son mari: Paul n’avait qu’une légère blessure à la cuisse, tant s’était passé rapidement ce que je viens de vous raconter. La première émotion effacée, madame de Lucienne regarda autour d’elle: elle avait toute sa gratitude maternelle à exprimer à un homme; elle cherchait le chasseur qui avait sauvé son fils. Monsieur de Lucienne devina son intention et le lui amena. Madame de Lucienne lui saisit la main, voulut le remercier, fondit en larmes, et ne put prononcer que ces mots: Oh! Monsieur de Beuzeval!...
—C’était donc lui? m’écriai-je.
—Oui, c’était lui. Je le vis ainsi pour la première fois, entouré de la reconnaissance d’une famille entière et de tout le prestige de l’émotion que m’avait causée cette scène dont il avait été le héros. C’était un jeune homme pâle, et plutôt petit que grand, avec des yeux noirs et des cheveux blonds. Au premier aspect, il paraissait à peine avoir vingt ans; puis, en regardant plus attentivement, on voyait quelques légères rides partir du coin de la paupière en s’élargissant vers les tempes, tandis qu’un pli imperceptible lui traversait le front, indiquant, au fond de son esprit ou de son cœur, la présence habituelle d’une pensée sombre; des lèvres pâles et minces, de belles dents et des mains de femme complétaient cet ensemble, qui, au premier abord, m’inspira plutôt un sentiment de répulsion que de sympathie, tant était froide, au milieu de l’exaltation générale, la figure de cet homme qu’une mère remerciait de lui avoir conservé son fils.
La chasse était finie: on revint au château. En rentrant au salon, le comte Horace de Beuzeval s’excusa de ne pouvoir rester plus longtemps; mais il avait un engagement pris pour dîner à Paris. On lui fit observer qu’il avait quinze lieues à faire et quatre heures à peine pour arriver à temps; le comte répondit en souriant que son cheval avait pris à son service l’habitude de ces sortes de courses, et donna ordre à son domestique de le lui amener.
Ce domestique était un Malais que le comte Horace avait ramené d’un voyage qu’il avait fait dans l’Inde pour recueillir une succession considérable, et qui avait conservé le costume de son pays. Quoiqu’il fût en France depuis trois ans, il ne parlait que sa langue maternelle, dont le comte savait quelques mots à l’aide desquels il se faisait servir; il obéit avec une promptitude merveilleuse, et à travers les carreaux du salon nous vîmes bientôt piaffer les deux chevaux, sur la race desquels tous ces messieurs se récrièrent: c’était en effet, autant que j’en pus juger, deux magnifiques animaux; aussi le prince de Condé avait eu le désir de les avoir; mais le comte Horace avait doublé le prix que l’altesse royale voulait y mettre, et il les lui avait enlevés.
Tout le monde reconduisit le comte jusqu’au perron. Madame de Lucienne semblait n’avoir pas eu le temps de lui exprimer toute sa reconnaissance, et elle lui serrait les mains en le suppliant de revenir. Le comte le promit en jetant un regard rapide qui me fit baisser les yeux comme un éclair, car, je ne sais pourquoi, il me sembla qu’il m’était adressé; lorsque je relevai la tête, le comte était à cheval, il s’inclina une dernière fois devant madame de Lucienne, nous fit un salut général, adressa de la main un signe d’amitié à Paul, et lâchant la bride à son cheval, qui l’emporta au galop, il disparut en quelques secondes au tournant du chemin.
Chacun était resté à la même place, le regardant en silence; car il y avait dans cet homme quelque chose d’extraordinaire qui commandait l’attention. On sentait une de ces organisations puissantes que souvent la nature, comme par caprice, s’amuse à enfermer dans un corps qui semble trop faible pour la contenir: aussi le comte paraissait-il un composé de contrastes. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, il avait l’apparence faible et languissante d’un homme atteint d’une maladie organique; pour ses amis et ses compagnons, c’était un homme de fer, résistant à toutes les fatigues, surmontant toutes les émotions, domptant tous les besoins: Paul l’avait vu passer des nuits entières, soit au jeu, soit à table; et le lendemain, tandis que ses convives de table ou de jeu dormaient, partir, sans avoir pris une heure de sommeil, pour une chasse ou pour une course avec de nouveaux compagnons, qu’il lassait comme les premiers, sans que la fatigue se manifestât chez lui autrement que par une pâleur plus grande et une toux sèche qui lui était habituelle, mais qui, dans ce cas, devenait plus fréquente.
Je ne sais pourquoi j’écoutai tous ces détails avec un intérêt infini; sans doute la scène dont j’avais été témoin, le sang-froid dont le comte avait fait preuve, l’émotion toute récente que j’avais éprouvée, étaient cause de cette attention que je prêtais à tout ce qu’on racontait de lui. Au reste, le calcul le plus habile n’eût rien inventé de mieux que ce départ subit, qui laissait en quelque sorte le château désert, tant celui qui s’était éloigné avait produit une immense impression sur ses habitans.
On annonça que le dîner était servi. La conversation, interrompue pendant quelque temps, reprit au dessert une nouvelle activité, et, comme pendant toute l’après-midi, le comte en fut l’objet; alors, soit que cette constante attention pour un seul parût à quelques-uns désobligeante pour les autres, soit qu’en effet plusieurs des qualités qu’on lui accordait fussent contestables, une légère discussion s’éleva sur son existence étrange, sur sa fortune, dont la source était inconnue, et sur son courage, que l’un des convives attribuait à sa grande habileté à manier l’épée et le pistolet. Paul se fit alors tout naturellement le défenseur de celui qui lui avait sauvé la vie. L’existence du comte Horace était celle de presque tous les hommes à la mode; sa fortune venait de la succession d’un oncle de sa mère, qui était resté quinze ans dans l’Inde. Quant à son courage, c’était, à son avis, la chose la moins contestable; car non-seulement il avait fait ses preuves dans quelques duels dont il était toujours sorti à peu près sain et sauf, mais encore en d’autres circonstances. Paul alors en raconta plusieurs, dont une surtout se grava profondément dans mon esprit.
Le comte Horace, en arrivant à Goa, trouva son oncle mort; mais un testament avait été fait en sa faveur, de sorte qu’aucune contestation n’eut lieu, et quoique deux jeunes Anglais, parens du défunt, car la mère du comte était Anglaise, se trouvassent héritiers au même degré que lui, il se vit seul en possession de l’héritage qu’il venait réclamer. Au reste, ces deux jeunes Anglais étaient riches; tous deux au service et occupant des grades dans l’armée britannique en garnison à Bombay. Ils reçurent donc leur cousin, sinon avec affection, du moins avec politesse, et, avant son départ pour la France, ils lui offrirent avec leurs camarades, officiers du régiment où ils servaient, un dîner d’adieu que le comte Horace accepta.
Il était plus jeune de quatre ans à cette époque, et en paraissait à peine dix-huit, quoiqu’il en eût réellement vingt-cinq; sa taille élégante, son teint pâle, la blancheur de ses mains, lui donnaient l’apparence d’une femme déguisée en homme. Aussi, au premier coup d’œil, les officiers anglais mesurèrent-ils le courage de leur convive à son apparence. Le comte, de son côté, avec cette rapidité de jugement qui le distingue, comprit aussitôt l’effet qu’il avait produit, et certain de l’intention railleuse de ses hôtes, se tint en garde, résolu à ne pas quitter Bombay sans y laisser un souvenir quelconque de son passage. En se mettant à table, les deux jeunes officiers demandèrent à leur parent s’il parlait anglais; mais, quoique le comte connût cette langue aussi bien que la nôtre, il répondit modestement qu’il n’en entendait pas un mot, et pria ces messieurs de vouloir bien, lorsqu’ils désireraient qu’il y prît part, soutenir la conversation en français.
Cette déclaration donna une grande latitude aux convives, et, dès le premier service, le comte s’aperçut qu’il était l’objet d’une raillerie continue. Cependant il dévora tout ce qu’il entendit, le sourire sur les lèvres et la gaîté dans les yeux; seulement ses joues devinrent plus pâles, et deux fois ses dents brisèrent les bords du verre qu’il portait à sa bouche. Au dessert, le bruit redoubla avec le vin de France, et la conversation tomba sur la chasse; alors on demanda au comte quel genre de gibier il chassait en France, et de quelle manière il le chassait. Le comte, décidé à poursuivre son rôle jusqu’au bout, répondit qu’il chassait tantôt en plaine et avec le chien d’arrêt la perdrix et le lièvre, tantôt au bois et à courre, le renard et le cerf.
—Ah! ah! dit en riant un des convives, vous chassez le lièvre, le renard et le cerf! Eh bien! nous, ici, nous chassons le tigre.
—Et de quelle manière? dit le comte Horace avec une bonhomie parfaite.
—De quelle manière? répondit un autre; mais montés sur des éléphans, et avec des esclaves, dont les uns, armés de piques et de haches, font face à l’animal, tandis que les autres nous chargent nos fusils, et que nous tirons.
—Ce doit être un charmant plaisir, répondit le comte.
—Il est malheureux, dit l’un des jeunes gens, que vous partiez si vite, mon cher cousin... nous aurions pu vous le procurer.
—Vrai, reprit Horace, je regrette bien sincèrement de manquer une pareille occasion; et s’il ne fallait pas attendre trop longtemps, je resterais.
—Mais, répondit le premier, cela tombe à merveille. Il y a justement à trois lieues d’ici, dans un marais qui longe les montagnes et qui s’étend du coté de Surate, une tigresse et ses petits. Des Indiens à qui elle a enlevé des moutons nous en ont prévenus hier seulement; nous voulions attendre que les petits fussent plus forts, afin de faire une chasse en règle, mais puisque nous avons une si bonne occasion de vous être agréables, nous avancerons l’expédition d’une quinzaine de jours.
—Je vous en suis tout-à-fait reconnaissant, dit en s’inclinant le comte; mais est-il bien certain que la tigresse soit où on la croit?
—Il n’y a aucun doute.
—Et sait-on précisément à quel endroit est son repaire?
—C’est facile à voir en montant sur un rocher qui domine le marais; ses chemins sont tracés au milieu des roseaux brisés, et tous aboutissent à un centre, comme les rayons d’une étoile.
—Eh bien! dit le comte en remplissant son verre et en se levant comme pour porter une santé,—à celui qui ira tuer la tigresse au milieu de ses roseaux, entre ses deux petits, seul, à pied, et sans autre arme que ce poignard! A ces mots, il prit à la ceinture d’un esclave un poignard malais, et le posa sur la table.
—Êtes-vous fou? dit un des convives.
—Non, messieurs, je ne suis pas fou, répondit le comte avec une amertume mêlée de mépris, et la preuve, c’est que je renouvelle mon toast. Écoutez donc bien, afin que celui qui voudra l’accepter sache à quoi il s’engage en vidant son verre: A celui, dis-je, qui ira tuer la tigresse au milieu de ses roseaux, entre ses deux petits, seul, à pied, et sans autre arme que ce poignard!
Il se fit un moment de silence, pendant lequel le comte interrogea successivement tous les yeux, qui tous se baissèrent.
—Personne ne répond? dit-il avec un sourire; personne n’ose accepter mon toast... personne n’a le courage de me faire raison.... Eh bien! alors, c’est moi qui irai... et si je n’y vais pas, vous direz que je suis un misérable, comme je dis que vous êtes des lâches.
A ces mots, le comte vida son verre, le reposa tranquillement sur la table, et, s’avançant vers la porte:—A demain, Messieurs, dit-il, et il sortit.
Le lendemain, à six heures du matin, il était prêt pour cette terrible chasse, lorsque ses convives entrèrent dans sa chambre. Ils venaient le supplier de renoncer à son entreprise, dont le résultat ne pouvait manquer d’être mortel pour lui. Mais le comte ne voulut rien entendre. Ils reconnurent d’abord qu’ils avaient eu tort la veille; que leur conduite était celle de jeunes fous. Le comte les remercia de leurs excuses, mais refusa de les accepter. Ils lui offrirent alors de choisir l’un d’eux, et de se battre avec lui, s’il se croyait trop offensé pour que la chose pût se passer sans réparation. Le comte répondit avec ironie que ses principes religieux lui défendaient de verser le sang de son prochain; que, de son côté, il retirait les paroles amères qu’il avait dites; mais que, quant à cette chasse, rien au monde ne pouvait l’y faire renoncer. A ces mots, il invita ces messieurs à monter à cheval et à le suivre, les prévenant, au reste, que s’ils ne voulaient pas l’honorer de leur compagnie, il n’irait pas moins attaquer la tigresse tout seul. Cette décision était prononcée d’une voix si ferme, et paraissait tellement inébranlable, qu’ils ne tentèrent même plus de l’y faire renoncer, et que, montant à cheval de leur côté, ils vinrent le rejoindre à la porte orientale de la ville, où le rendez-vous avait été donné.
La cavalcade s’achemina en silence vers l’endroit indiqué; chacun des cavaliers s’était muni d’un fusil à deux coups ou d’une carabine. Le comte seul était sans armes; son costume, parfaitement élégant, était celui d’un jeune homme du monde qui va faire sa promenade du matin au bois de Boulogne. Tous les officiers se regardaient avec étonnement, ne pouvant croire qu’il conserverait ce sang-froid jusqu’à la fin.
En arrivant sur la lisière du marais, les officiers firent un nouvel effort pour dissuader le comte d’aller plus avant. Au milieu de la discussion, et comme pour leur venir en aide, un rugissement se fit entendre, parti de quelques centaines de pas à peine; les chevaux, inquiets, piaffèrent et hennirent.
—Vous voyez, messieurs, dit le comte, il est trop tard, nous sommes reconnus, l’animal sait que nous sommes là; et je ne veux pas, en quittant l’Inde, que je ne reverrai probablement jamais, laisser une fausse opinion de moi, même à un tigre. En avant, messieurs!—Et le comte poussa son cheval pour gagner, en longeant les marais, le rocher du haut duquel on dominait les roseaux où la tigresse avait mis bas.
En arrivant au pied du rocher, un second rugissement se fit entendre, mais si fort et si rapproché, que l’un des chevaux fit un écart et que son cavalier manqua d’être désarçonné; tous les autres, l’écume à la bouche, les naseaux ouverts et l’œil hagard, frissonnaient et tremblaient sur leurs quatre pieds comme s’ils venaient de sortir de l’eau glacée. Alors les cavaliers descendirent, les montures furent confiées aux domestiques, et le comte, le premier, commença de gravir le point élevé du haut duquel il comptait examiner le terrain.
En effet, du sommet du rocher il suivait des yeux, aux roseaux brisés, la trace du terrible animal qu’il allait combattre; des espèces de chemins, larges de deux pieds à peu près, étaient frayés dans les hautes herbes, et chacun, comme l’avaient dit les officiers, aboutissait à un centre, où les plantes, tout-à-fait battues, formaient une clairière. Un troisième rugissement, qui partait de cet endroit, vint dissiper tous les doutes, et le comte sut où il devait aller chercher son ennemi.
Alors le plus âgé des officiers s’approcha de nouveau du comte; mais celui-ci, devinant son intention, lui fit froidement signe de la main que tout était inutile. Puis il boutonna sa redingote, pria l’un de ses cousins de lui prêter l’écharpe de soie qui lui serrait la taille pour s’envelopper le bras gauche; fit signe au Malais de lui donner son poignard, se le fit assurer autour de la main avec un foulard mouillé; alors, posant son chapeau à terre, il releva gracieusement ses cheveux, et, par le chemin le plus court, s’avança vers les roseaux, au milieu desquels il disparut à l’instant, laissant ses compagnons s’entre-regardant épouvantés, et ne pouvant croire encore à une pareille audace.
Quant à lui, il s’avança lentement et avec précaution par le chemin qu’il avait pris, et qui était tracé si directement qu’il n’y avait à s’écarter ni à droite ni à gauche. Au bout de deux cents pas à peu près, il entendit un rauquement sourd, qui lui annonçait que son ennemie était sur ses gardes, et que, s’il n’avait point été vu encore, il était déjà éventé; cependant il ne s’arrêta qu’une seconde, et aussitôt que le bruit eut cessé, il continua de marcher. Au bout de cinquante pas à peu près, il s’arrêta de nouveau; il lui semblait que, s’il n’était pas arrivé, il devait au moins être bien près, car il touchait à la clairière, et cette clairière était parsemée d’ossemens, dont quelques-uns conservaient encore des lambeaux de chair sanglante. Il regarda donc circulairement autour de lui, et, dans un enfoncement pratiqué dans l’herbe et pareil à une voûte de quatre ou cinq pieds de profondeur, il aperçut la tigresse couchée à moitié, la gueule béante et les yeux fixés sur lui; ses petits jouaient sous son ventre comme de jeunes chats.
Ce qui se passa dans son âme à cette vue, lui seul peut le dire; mais son âme est un abîme d’où rien ne sort. Quelque temps la tigresse et lui se regardèrent immobiles; et, voyant que, de peur de quitter ses petits sans doute, elle ne venait pas à lui, ce fut lui qui alla vers elle.
Il en approcha ainsi jusqu’à la distance de quatre pas; puis, voyant qu’enfin elle faisait un mouvement pour se soulever, il se rua sur elle. Ceux qui regardaient et écoutaient entendirent à la fois un rugissement et un cri; ils virent pendant quelques secondes les roseaux s’agiter; puis le silence et la tranquillité leur succédèrent: tout était fini.
Ils attendirent un instant pourvoir si le comte reviendrait; mais le comte ne revint pas. Alors ils eurent honte de l’avoir laissé entrer seul, et se décidèrent, puisqu’ils n’avaient pas sauvé sa vie, à sauver du moins son cadavre. Ils s’avancèrent dans le marais tous ensemble et pleins d’ardeur, s’arrêtant de temps en temps pour écouter, puis se remettant aussitôt en chemin; enfin ils arrivèrent à la clairière et trouvèrent les deux adversaires couchés l’un sur l’autre: la tigresse était morte, et le comte évanoui. Quant aux deux petits, trop faibles pour dévorer le corps, ils léchaient le sang.
La tigresse avait reçu dix-sept coups de poignard, le comte un coup de dent qui lui avait brisé le bras gauche, et un coup de griffe qui lui avait déchiré la poitrine.
Les officiers emportèrent le cadavre de la tigresse et le corps du comte; l’homme et l’animal rentrèrent à Bombay couchés à côté l’un de l’autre, et portés sur le même brancard. Quant aux petits tigres, l’esclave malais les avait garrottés avec la percale de son turban, et ils pendaient aux deux côtés de sa selle.
Lorsqu’au bout de quinze jours le comte se leva, il trouva devant son lit la peau de la tigresse avec des dents en perles, des yeux en rubis et des ongles d’or; c’était un don des officiers du régiment dans lequel servaient ses deux cousins.
Ces récits firent une impression profonde dans mon esprit. Le courage est une des plus grandes séductions de l’homme sur la femme: est-ce à cause de notre faiblesse et parce que, ne pouvant rien par nous-mêmes, il nous faut éternellement un appui? Aussi, quelque chose que l’on eût dite au désavantage du comte Horace, le seul souvenir qui resta dans mon esprit fut celui de cette double chasse, à l’une desquelles j’avais assisté. Cependant ce n’était pas sans terreur que je pensais à ce sang-froid terrible auquel Paul devait la vie. Combien de combats terribles s’étaient passés dans ce cœur avant que la volonté fût arrivée à comprimer à ce point ses pulsations, et un bien long incendie avait dû dévorer cette âme avant que sa flamme ne devînt toute cendre et que sa lave ne se changeât en glace.
Le grand malheur de notre époque est la recherche du romanesque et le mépris du simple. Plus la société se dépoétise, plus les imaginations actives demandent cet extraordinaire, qui tous les jours disparaît du monde pour se réfugier au théâtre ou dans les romans; de là, cet intérêt fascinateur qu’exercent sur tout ce qui les entoure les caractères exceptionnels. Vous ne vous étonnerez donc pas que l’image du comte Horace, s’offrant à l’esprit d’une jeune fille entourée de ce prestige, soit restée dans son imagination, où si peu d’événemens avaient encore laissé leur trace. Aussi, lorsque, quelques jours après la scène que je viens de vous raconter, nous vîmes arriver deux cavaliers par la grande allée du château, et qu’on annonça monsieur Paul de Lucienne et monsieur le comte Horace de Beuzeval, pour la première fois de ma vie je sentis mon cœur battre à un nom, un nuage me passa sur les yeux, et je me levai avec l’intention de fuir; ma mère me retint, ces messieurs entrèrent.
Je ne sais ce que je leur dis d’abord; mais certes je dus paraître bien timide et bien gauche; car lorsque je levai les yeux, ceux du comte Horace étaient fixés sur moi avec une expression étrange et que je n’oublierai jamais: cependant, peu à peu j’écartai cette préoccupation et je redevins moi-même, alors je pus le regarder et l’écouter comme si je regardais et j’écoutais Paul.
Je lui retrouvai la même figure impassible, le même regard fixe et profond qui m’avait tant impressionnée, et de plus une voix douce qui, comme ses mains et ses pieds, paraissait bien plus appartenir à une femme qu’à un homme; cependant, lorsqu’il s’animait, cette voix prenait une puissance qui semblait incompatible avec les premiers sons qu’elle avait proférés: Paul, en ami reconnaissant, avait mis la conversation sur un sujet propre à faire valoir le comte: il parla de ses voyages. Le comte hésita un instant à se laisser entraîner à cette séduction d’amour-propre: on eût dit qu’il craignait de s’emparer de la conversation et de substituer le moi aux généralités banales des premières entrevues; mais bientôt le souvenir des lieux parcourus se présenta à sa mémoire, la vie pittoresque des contrées sauvages entra en lutte avec l’existence monotone des pays civilisés et déborda sur elle; le comte se retrouva tout entier au milieu de la végétation luxuriante de l’Inde et des aspects merveilleux des Maldives. Il nous raconta ses courses dans le golfe du Bengale, ses combats avec les pirates malais; il se laissa emporter à la peinture brillante de cette vie animée, où chaque heure apporte une émotion à l’esprit ou au cœur; il fit passer sous nos yeux les phases tout entières de cette existence primitive, où l’homme dans sa liberté et dans sa force, étant, selon qu’il veut l’être, esclave ou roi, n’a de liens que son caprice, de bornes que l’horizon, et lorsqu’il étouffe sur la terre, déploie les voiles de ses vaisseaux, comme les ailes d’un aigle, et va demander à l’Océan la solitude et l’immensité: puis, il retomba d’un seul bond au milieu de notre société usée, où tout est mesquin, crimes et vertus, où tout est factice, visage et âme, où, esclaves emprisonnés dans les lois, captifs garrottés dans les convenances, il y a pour chaque heure du jour de petits devoirs à accomplir, pour chaque partie de la matinée des formes d’habits et des couleurs de gants à adopter, et cela sous peine de ridicule, c’est-à-dire de mort: car le ridicule, en France, tache un nom plus cruellement que ne le fait la boue ou le sang.
Je ne vous dirai pas ce qu’il y avait d’éloquence amère, ironique et mordante contre notre société dans cette sortie du comte: c’était véritablement, aux blasphèmes près, une de ces créations de poètes, Manfred ou Karl Moor; c’était une de ces organisations orageuses se débattant au milieu des plates et communes exigences de notre société; c’était le génie aux prises avec le monde, et qui, vainement enveloppé dans ses lois, ses convenances et ses habitudes, les emporte avec lui, comme un lion ferait de misérables filets tendus pour un renard ou pour un loup.
J’écoutais cette philosophie terrible, comme j’aurais lu une page de Byron ou de Goëthe: c’était la même énergie de pensée, rehaussée de toute la puissance de l’expression. Alors cette figure si impassible avait jeté son masque de glace; elle s’animait à la flamme du cœur, et ses yeux lançaient des éclairs; alors cette voix si douce prenait successivement des accens éclatans et sombres; puis, tout-à-coup, enthousiasme ou amertume, espérance ou mépris, poésie ou matière, tout cela se fondait dans un sourire comme je n’en avais point vu encore, et qui contenait à lui seul plus de désespoir et de dédain que n’aurait pu le faire le sanglot le plus douloureux.
Après une visite d’une heure, Paul et le comte nous quittèrent. Lorsqu’ils furent sortis, nous nous regardâmes un instant ma mère et moi, en silence, et je me sentis le cœur soulagé d’une oppression énorme: la présence de cet homme me pesait comme celle de Méphistophélès à Marguerite: l’impression qu’il avait produite sur moi était si visible, que ma mère se mit à le défendre sans que je l’attaquasse; depuis longtemps elle avait entendu parler du comte, et, comme sur tous les hommes remarquables, le monde émettait sur lui les jugemens les plus opposés. Ma mère, au reste, le regardait d’un point de vue complètement différent du mien: tous ces sophismes émis si hardiment par le comte lui paraissaient un jeu d’esprit, et voilà tout; une espèce de médisance contre la société, comme tous les jours on en dit contre les individus. Ma mère ne le mettait donc ni si haut ni si bas que je le faisais intérieurement; il en résulta que cette différence d’opinion que je ne voulais pas combattre me détermina à paraître ne plus m’occuper de lui. Au bout de dix minutes, je prétextai un léger mal de tête, et je descendis dans le parc; là rien ne vint distraire mon esprit de sa préoccupation, et je n’avais pas fait cent pas, que je fus forcée de m’avouer à moi-même que je n’avais pas voulu parler du comte afin de mieux penser à lui. Cette conviction m’effraya; je n’aimais pas le comte cependant, car, à l’annonce de sa présence, mon cœur eût certes plutôt battu de crainte que de joie; pourtant je ne le craignais pas non plus, ou logiquement je ne devais pas le craindre, car enfin en quoi pouvait-il influer sur ma destinée? Je l’avais vu une fois par hasard, une seconde fois par politesse, je ne le reverrais peut-être jamais; avec son caractère aventureux et son goût des voyages, il pouvait quitter la France d’un moment à l’autre, alors son passage dans ma vie était une apparition, un rêve, et voilà tout; quinze jours, un mois, un an écoulés, je l’oublierais. En attendant, lorsque la cloche du dîner retentit, elle me surprit au milieu des mêmes pensées et me fit tressaillir de sonner si vite: les heures avaient passé comme les minutes.
En rentrant au salon, ma mère me remit une invitation de la comtesse M..., qui était restée à Paris malgré l’été, et qui donnait, à propos de l’anniversaire de la naissance de sa fille, une grande soirée, moitié dansante, moitié musicale. Ma mère, toujours excellente pour moi, voulait me consulter, avant de répondre. J’acceptai avec empressement: c’était une distraction puissante à l’idée qui m’obsédait; en effet, nous n’avions que trois jours pour nous préparer, et ces trois jours suffisaient si strictement aux préparatifs du bal, qu’il était évident que le souvenir du comte se perdrait, ou du moins s’éloignerait dans les préoccupations si importantes de la toilette. De mon côté, je fis tout ce que je pus pour arriver à ce résultat: je parlai de cette soirée avec une ardeur que ne m’avait jamais vue ma mère; je demandai à revenir le même soir à Paris, sous prétexte que nous avions à peine le temps de commander nos robes et nos fleurs, mais en effet parce que le changement de lieu devait, il me le semblait du moins, m’aider encore dans ma lutte contre mes souvenirs. Ma mère céda à toutes mes fantaisies avec sa bonté ordinaire: après le dîner nous partîmes.
Je ne m’étais pas trompée; les soins que je fus obligée de donner aux préparatifs de cette soirée, un reste de cette insouciance joyeuse de jeune fille, que je n’avais pas perdue encore, l’espoir d’un bal, dans une saison où il y en a si peu, firent diversion à mes terreurs insensées, et éloignèrent momentanément le fantôme qui me poursuivait. Le jour désiré arriva enfin; il s’écoula pour moi dans une espèce de fièvre d’activité que ma mère ne m’avait jamais connue; elle était tout heureuse de la joie que je me promettais. Pauvre mère!
Dix heures sonnèrent, j’étais prête depuis vingt minutes, je ne sais comment cela c’était fait: moi, toujours en retard, c’était moi qui, ce soir-là, attendais ma mère. Nous partîmes enfin; presque toute notre société d’hiver était revenue comme nous à Paris pour cette fête. Je retrouvai mes amies de pension, mes danseurs d’habitude, et jusqu’à ce plaisir vif et joyeux de jeune fille, qui, depuis un an ou deux déjà, commençait à s’amortir.
Il y avait un monde fou dans les salons de danse; pendant un moment de repos, la comtesse M... me prit par le bras, et pour fuir la chaleur étouffante qu’il faisait, m’emmena dans les chambres de jeu; c’était en même temps une inspection curieuse à faire; toutes les célébrités artistiques, littéraires et politiques de l’époque étaient là; j’en connaissais beaucoup déjà, mais cependant quelques-unes encore m’étaient étrangères. Madame M... me les nommait avec une complaisance charmante, accompagnant chaque nom d’un commentaire que lui eût souvent envié le plus spirituel feuilletoniste, quand tout-à-coup, en entrant dans un salon, je trèssaillis en laissant échapper malgré moi ces mots:—Le comte Horace!
—Eh bien! oui, le comte Horace, me dit madame M... en souriant; le connaissez vous?
—Nous l’avons rencontré chez madame de Lucienne, à la campagne.
—Ah! oui, reprit la comtesse, j’ai entendu parler d’une chasse, d’un accident arrivé à monsieur de Lucienne fils, n’est-ce pas? En ce moment le comte leva les yeux et nous aperçut. Quelque chose comme un sourire passa sur ses lèvres.
—Messieurs, dit-il aux trois joueurs qui faisaient sa partie, voulez-vous me permettre de me retirer? Je me charge de vous envoyer un quatrième.
—Allons donc, dit Paul; tu nous gagnes quatre mille francs, et tu nous enverras un remplaçant qui se cavera de dix louis. Non pas, non pas.
Le comte, à moitié levé, se rassit; mais au premier tour, un des joueurs ayant engagé le jeu, le comte fit son argent. Il fut tenu. L’adversaire du comte abattit son jeu; le comte jeta le sien sans le montrer en disant: J’ai perdu, poussa l’or et les billets de banque qu’il avait devant lui en face du gagnant, et, se levant de nouveau:
—Suis-je libre de me retirer cette fois? dit-il à Paul.
—Non, pas encore, cher ami, répondit Paul qui avait relevé les cartes du comte et regardé son jeu, car tu as cinq carreaux, et monsieur n’a que quatre piques.
—Madame, dit le comte en se retournant de notre côté et en s’adressant à la maîtresse de la maison, je sais que mademoiselle Eugénie doit quêter ce soir pour les pauvres, voulez-vous me permettre d’être le premier à lui offrir mon tribut? A ces mots, il prit un panier à ouvrage qui se trouvait sur un guéridon à côté de la table de jeu, y mit les huit mille francs qu’il avait devant lui, et les présenta à la comtesse.
—Mais je ne sais si je dois accepter, répondit madame M...; cette somme est vraiment si considérable....
—Aussi, reprit en souriant le comte Horace, n’est-ce point en mon nom seul que je vous l’offre; ces messieurs y ont largement contribué, c’est donc eux plus encore que moi que mademoiselle M... doit remercier au nom de ses protégés. A ces mots, il passa dans la salle de bal, laissant le panier plein d’or et de billets de banque aux mains de la comtesse.
—Voilà bien une de ses originalités, me dit madame M...; il aura aperçu une femme avec laquelle il a envie de danser, et voilà le prix dont il paie ce plaisir. Mais il faut que je serre ce panier; laissez-moi donc vous reconduire dans le salon de danse.
Madame M... me ramena près de ma mère. A peine y étais-je assise, que le comte s’avança vers moi et m’invita à danser.
Ce que venait de me dire la comtesse se présenta aussitôt à mon esprit; je me sentis rougir, je compris que j’allais balbutier; je lui tendis mon calepin, six danseurs y avaient pris rang; il retourna le feuillet, et comme s’il ne voulait pas que son nom fût confondu avec les autres noms, il l’inscrivit au haut de la page pour la septième contredanse; puis il me rendit le livret en prononçant quelques mots que mon trouble m’empêcha d’entendre, et alla s’appuyer contre l’angle de la porte. Je fus sur le point de prier ma mère de quitter le bal, car je tremblais si fort, qu’il me semblait impossible de me tenir debout; heureusement un accord rapide et brillant se fit entendre. Le bal était suspendu. Listz s’asseyait au piano.
Il joua l’invitation à la valse de Weber.
Jamais l’habile artiste n’avait poussé si haut les merveilles de son exécution, ou peut-être jamais ne m’étais-je trouvée dans une disposition d’esprit aussi parfaitement apte à sentir cette composition si mélancolique et si passionnée; il me sembla que c’était la première fois que j’entendais supplier, gémir et se briser l’âme souffrante, dont l’auteur du Freyschütz a exhalé les soupirs dans ses mélodies. Tout ce que la musique, cette langue des anges, a d’accens, d’espoir, de tristesse et de douleur, semblait s’être réuni dans ce morceau, dont les variations, improvisées selon l’inspiration du traducteur, arrivaient à la suite du motif comme des notes explicatives. J’avais souvent moi-même exécuté cette brillante fantaisie, et je m’étonnais, aujourd’hui que je l’entendais reproduire par un autre, d’y trouver des choses que je n’avais pas soupçonnées alors; était-ce le talent admirable de l’artiste qui les faisait ressortir? était-ce une disposition nouvelle de mon esprit? La main savante qui glissait sur les touches avait-elle si profondément creusé la mine, qu’elle y trouvait des filons inconnus? ou mon cœur avait-il reçu une si puissante secousse, que des fibres endormies s’y étaient réveillées? En tout cas, l’effet fut magique; les sons flottaient dans l’air comme une vapeur, et m’inondaient de mélodie; en ce moment je levai les yeux, ceux du comte étaient fixés de mon côté; je baissai rapidement la tête, il était trop tard; je cessai de voir ses yeux, mais je sentis son regard peser sur moi, le sang se porta rapidement à mon visage, et un tremblement involontaire me saisit. Bientôt, Listz se leva; j’entendis le bruit des personnes qui se pressaient autour de lui pour le féliciter; j’espérai que, dans ce mouvement, le comte avait quitté sa place; en effet, je me hasardai à relever la tête, il n’était plus contre la porte; je respirai, mais je me gardai de pousser la recherche plus loin; je craignais de retrouver son regard, j’aimais mieux ignorer qu’il fût là.
Au bout d’un instant le silence se rétablit; une nouvelle personne s’était mise au piano; j’entendis aux chuts prolongés jusque dans les salles attenantes que la curiosité était vivement excitée; mais je n’osai lever les yeux. Une gamme mordante courut sur les touches, un prélude large et triste lui succéda, puis une voix vibrante, sonore et profonde, fit entendre ces mots sur une mélodie de Schubert:
«J’ai tout étudié, philosophie, droit et médecine; j’ai fouillé dans le cœur des hommes, je suis descendu dans les entrailles de la terre, j’ai attaché à mon esprit les ailes de l’aigle pour planer au-dessus des nuages; où m’a conduit cette longue étude? au doute et au découragement. Je n’ai plus, il est vrai, ni illusion ni scrupule, je ne crains ni Dieu ni Satan: mais j’ai payé ces avantages au prix de toutes les joies de la vie.»
Au premier mot, j’avais reconnu la voix du comte Horace. On devine donc facilement quelle singulière impression durent faire sur moi ces paroles de Faust dans la bouche de celui qui les chantait: l’effet fut général, au reste. Un moment de silence profond succéda à la dernière note, qui s’envola plaintive comme une âme en détresse; puis des applaudissemens frénétiques partirent de tous côtés. Je me hasardai alors à regarder le comte; pour tous peut-être sa figure était calme et impassible, mais pour moi le léger froncement de sa bouche indiquait clairement cette agitation fiévreuse dont un des accès l’avait pris pendant sa visite au château. Madame M... s’approcha de lui pour le féliciter à son tour; alors son visage prit l’aspect souriant et insoucieux que commandent aux esprits les plus préoccupés les convenances du monde; le comte Horace lui offrit le bras et ne fut plus qu’un homme comme tous les hommes; à la manière dont il la regardait, je jugeai que de son côté il lui faisait des complimens sur sa toilette. Tout en causant avec elle, il jeta rapidement de mon côté un regard qui rencontra le mien; je fus sur le point de laisser échapper un cri, j’avais en quelque sorte été surprise; il vit sans doute ma détresse et en eut pitié, car il entraîna madame M... dans la salle voisine et disparut avec elle. Au même moment, les musiciens donnèrent de nouveau le signal de la contredanse; le premier inscrit de mes danseurs s’élança vers moi, je pris machinalement sa main et je me laissai conduire à la place qu’il voulut; je dansai, voilà tout ce dont je me souviens, puis deux ou trois contredanses se suivirent, pendant lesquelles je repris un peu de calme; enfin une nouvelle pause destinée à un nouvel intermède musical leur succéda.
Madame M... s’avança vers moi; elle venait me prier de de faire ma partie dans le duo du premier acte de Don Juan; je refusai d’abord, car je me voyais incapable en ce moment, toute timidité naturelle à part, d’articuler une note. Ma mère vit ce débat, et, avec son amour-propre de mère, vint se joindre à la comtesse, qui s’offrait pour accompagner; j’eus peur, si je continuais à résister, que ma mère ne se doutât de quelque chose; j’avais chanté si souvent ce duo, que je ne pouvais opposer une bonne raison à leurs instances; je finis donc par céder. La comtesse M... me prit par la main et me conduisit au piano, où elle s’assit: j’étais derrière sa chaise, debout et les yeux baissés, sans oser regarder autour de moi, de peur de retrouver encore ce regard qui me suivait partout. Un jeune homme vint se placer de l’autre côté de la comtesse, je me hasardai à lever les yeux sur mon partner; un frisson me courut par tout le corps: c’était le comte Horace qui chantait le rôle de don Juan.
Vous comprendrez quelle fut mon émotion; cependant il était trop tard pour me retirer, tous les yeux étaient fixés sur nous; madame M... préludait. Le comte commença; c’était une autre voix, c’était un autre homme qui chantait, et lorsqu’il commença: Là ci darem la mano, je tressaillis, espérant que je m’étais trompée, et ne pouvant pas croire que la voix puissante qui venait de nous faire frémir avec la mélodie de Schubert pouvait se plier à des intonations d’une gaîté si fine et si gracieuse. Aussi, dès la première phrase, un murmure d’applaudissement courut-il par toute la salle; il est vrai que, lorsqu’à mon tour je dis en tremblant: Vorrei e non vorrei mi trema un poco il cor, il y avait dans ma voix une telle expression de crainte, que les applaudissemens contenus éclatèrent; puis on fit tout-à-coup un silence profond pour nous écouter. Je ne puis vous dire ce qu’il y avait d’amour dans la voix du comte, lorsqu’il reprit: Vieni, mio bel diletto, et ce qu’il mit de séduction et de promesses dans cette phrase: Io cangieró tua sorte; tout cela était si applicable à moi, ce duo semblait si bien choisi pour la situation de mon cœur, qu’effectivement je me sentis prête à m’évanouir, en disant: Presto non so più forte: certes la musique avait ici changé d’expression; au lieu de la plainte coquette de Zerline, c’était le cri de la détresse la plus profonde; en ce moment je sentis que le comte s’était rapproché de mon côté, sa main toucha ma main pendante près de moi, un voile de flamme s’abaissa sur mes yeux, je saisis la chaise de la comtesse M... et je m’y cramponnai; grâce à ce soutien, je parvins à me tenir debout; mais lorsque nous reprîmes ensemble: Andiamo, andiam mio bene, je sentis son haleine passer dans mes cheveux, son souffle courir sur mes épaules; un frisson me passa par les veines, je jetai en prononçant le mot amor un cri dans lequel s’épuisèrent toutes mes forces, et je m’évanouis....
Ma mère s’élança vers moi; mais elle serait arrivée trop tard, si la comtesse M... ne m’avait reçue dans ses bras. Mon évanouissement fut attribué à la chaleur; on me transporta dans une chambre voisine, des sels qu’on me fit respirer, une fenêtre qu’on ouvrit, quelques gouttes d’eau qu’on me jeta au visage me rappelèrent à moi; madame M... insista pour me faire rentrer au bal, mais je ne voulus entendre à rien; ma mère, inquiète elle-même, fut cette fois de mon avis, on fit avancer la voiture et nous rentrâmes à l’hôtel.
Je me retirai aussitôt, dans ma chambre; en ôtant mon gant je fis tomber un papier qui y avait été glissé pendant mon évanouissement, je le ramassai et je lus ces mots écrits au crayon: Vous m’aimez!... merci, merci!
Je passai une nuit affreuse, une nuit de sanglots et de larmes. Vous ne savez pas, vous autres hommes, vous ne saurez jamais quelles angoisses sont celles d’une jeune fille élevée sous l’œil de sa mère, dont le cœur, pur comme une glace, n’a encore été terni par aucune haleine, dont la bouche n’a jamais prononcé le mot amour, et qui se voit tout-à-coup, comme un pauvre oiseau sans défense, prise et enveloppée dans une volonté plus puissante que sa résistance; qui sent une main qui l’entraîne, si fort qu’elle se raidisse contre elle, et qui entend une voix qui lui dit: Vous m’aimez, avant qu’elle n’ait dit: Je vous aime.
Oh! je vous le jure, je ne sais comment il se fit que je ne devins pas folle pendant cette nuit; je me crus perdue. Je me répétais tout bas et incessamment:—Je l’aime! je l’aime! et cela avec une terreur si profonde, qu’aujourd’hui encore je ne sais si je n’étais pas en proie à un sentiment tout-à-fait contraire à celui que je croyais ressentir. Cependant il était probable que toutes ces émotions que j’avais éprouvées étaient des preuves d’amour, puisque le comte, à qui aucune d’elles n’était échappée, les interprétait ainsi. Quant à moi, c’étaient les premières sensations de ce genre que je ressentais. On m’avait dit que l’on ne devait craindre ou haïr que ceux qui vous ont fait du mal; je ne pouvais alors ni haïr ni craindre le comte, et si le sentiment que j’éprouvais pour lui n’était ni de la haine ni de la crainte, ce devait donc être de l’amour.
Le lendemain matin, au moment où nous nous mettions à table pour déjeuner, on apporta à ma mère deux cartes du comte Horace de Beuzeval: il avait envoyé s’informer de ma santé et demander si mon indisposition avait eu des suites. Cette démarche, toute matinale qu’elle était, parut à ma mère une simple manifestation de politesse. Le comte chantait avec moi lorsque l’accident m’était arrivé: cette circonstance excusait son empressement. Ma mère s’aperçut alors seulement combien je paraissais fatiguée et souffrante; elle s’en inquiéta d’abord; mais je la rassurai en lui disant que je n’éprouvais aucune douleur, et que d’ailleurs l’air et la tranquillité de la campagne me remettraient, si elle voulait que nous y retournassions. Ma mère n’avait qu’une volonté, c’était la mienne: elle ordonna que l’on mît les chevaux à la voiture; vers les deux heures nous partîmes.
Je fuyais Paris avec l’empressement que, quatre jours auparavant, j’avais mis à fuir la campagne; car ma première pensée, en voyant les cartes du comte, avait été qu’aussitôt que l’heure où l’on est visible serait arrivée, il se présenterait en personne. Or, je voulais le fuir, je voulais ne plus le revoir; après l’idée qu’il avait prise de moi, après la lettre qu’il m’avait écrite, il me semblait que je mourrais de honte en me retrouvant avec lui. Toutes ces pensées qui se heurtaient dans ma tête faisaient passer sur mes joues des rougeurs si subites et si ardentes, que ma mère crut que je manquais d’air dans cette voiture fermée, et ordonna au cocher d’arrêter, afin que le domestique pût abaisser la couverture de la calèche. On était aux derniers jours de septembre, c’est-à-dire au plus doux moment de l’année; les feuilles de certains arbres commençaient à rougir dans les bois. Il y a quelque chose du printemps dans l’automne, et les derniers parfums de l’année ressemblent parfois à ses premières émanations. L’air, le spectacle de la nature, tous ces bruits de la forêt qui n’en forment qu’un, prolongé, mélancolique, indéfinissable, commençaient à distraire mon esprit, lorsque tout-à-coup, à l’un des détours de la route, j’aperçus devant nous un cavalier. Quoiqu’il fût encore à une grande distance, je saisis le bras de ma mère dans l’intention de lui dire de retourner vers Paris,—car j’avais reconnu le comte;—mais je m’arrêtai aussitôt. Quel prétexte donner à ce changement de volonté, qui paraîtrait un caprice sans raison aucune? Je rassemblai donc tout mon courage.
Le cavalier allait au pas, aussi le rejoignîmes-nous bientôt. Comme je l’ai dit, c’était le comte.
A peine nous eut-il reconnues, qu’il s’approcha de nous, s’excusa d’avoir envoyé de si bonne heure pour savoir de mes nouvelles; mais devant partir dans la journée pour la campagne de monsieur de Lucienne, où il allait passer quelques jours, il n’avait pas voulu quitter Paris avec l’inquiétude où il était; si l’heure eût été convenable, il se serait présenté lui-même. Je balbutiai quelques mots, ma mère le remercia.—Nous aussi nous retournions à la campagne, lui dit-elle, pour le reste de la saison.—Alors vous me permettrez de vous servir d’escorte jusqu’au château, répondit le comte. Ma mère s’inclina en souriant; la chose était toute simple: notre maison de campagne était de trois lieues plus rapprochée que celle de monsieur de Lucienne, et la même route conduisait à toutes les deux.
Le comte continua donc de galoper près de nous pendant les cinq lieues qui nous restaient à faire. La rapidité de notre course, la difficulté de se tenir près de la portière, fit que nous n’échangeâmes que quelques paroles. Arrivé au château, il sauta à bas de son cheval, aida ma mère à descendre, puis m’offrit sa main à mon tour. Je ne pouvais refuser; je tendis la mienne en tremblant; il la prit sans vivacité, sans affectation, comme il eût pris celle de toute autre; mais je sentis qu’il y laissait un billet. Avant que je n’aie pu dire un mot ni faire un mouvement, le comte s’était retourné vers ma mère et la saluait; puis il remonta à cheval, résistant aux instances qu’elle lui faisait pour qu’il se reposât un instant; alors, reprenant le chemin de Lucienne, où il était attendu, disait-il, il disparut au bout de quelques secondes.
J’étais restée immobile à la même place; mes doigts crispés retenaient le billet, que je n’osais laisser tomber, et que cependant j’étais bien résolue à ne pas lire. Ma mère m’appela, je la suivis. Que faire de ce billet? Je n’avais pas de feu pour le brûler; le déchirer, on en pouvait trouver les morceaux: je le cachai dans la ceinture de ma robe.
Je ne connais pas de supplice pareil à celui que j’éprouvai jusqu’au moment où je rentrai dans ma chambre: ce billet me brûlait la poitrine; il semblait qu’une puissance surnaturelle rendait chacune de ses lignes lisibles pour mon cœur, qui le touchait presque; ce papier avait une vertu magnétique. Certes, au moment où je l’avais reçu, je l’eusse déchiré, brûlé à l’instant même sans hésitation; eh bien! lorsque je rentrai chez moi, je n’en eus plus le courage. Je renvoyai ma femme de chambre en lui disant que je me déshabillerais seule; puis je m’assis sur mon lit, et je restai ainsi une heure, immobile et les yeux fixes, le billet froissé dans ma main fermée.
Enfin je l’ouvris et je lus:
«Vous m’aimez, Pauline, car vous me fuyez. Hier vous avez quitté le bal où j’étais, aujourd’hui vous quittez la ville où je suis; mais tout est inutile. Il y a des destinées qui peuvent ne se rencontrer jamais, mais qui, dès qu’elles se rencontrent, ne doivent plus se séparer.
»Je ne suis point un homme comme les autres hommes: à l’âge du plaisir, de l’insouciance et de la joie, j’ai beaucoup souffert, beaucoup pensé, beaucoup gémi; j’ai vingt-huit ans. Vous êtes la première femme que j’aie aimée, car je vous aime, Pauline.
»Grâce à vous, et si Dieu ne brise pas cette dernière espérance de mon cœur, j’oublierai mon passé et j’espérerai dans l’avenir. Le passé est la seule chose pour laquelle Dieu est sans pouvoir et l’amour sans consolation. L’avenir est à Dieu, le présent est à nous, mais le passé est au néant. Si Dieu, qui peut tout, pouvait donner l’oubli du passé, il n’y aurait dans le monde ni blasphémateurs, ni matérialistes, ni athées.
»Maintenant tout est dit, Pauline; car que vous apprendrais-je que vous ne sachiez pas, que vous dirais-je que vous n’ayez pas deviné? Nous sommes jeunes tous deux, riches tous deux, libres tous deux; je puis être à vous, vous pouvez être à moi: un mot de vous, je m’adresse à votre mère, et nous sommes unis. Si ma conduite, comme mon âme, est en dehors des habitudes du monde, pardonnez-moi ce que j’ai d’étrange et acceptez-moi comme je suis, vous me rendrez meilleur.
»Si, au contraire de ce que j’espère, Pauline, un motif que je ne prévois pas, mais qui cependant peut exister, vous faisait continuer à me fuir comme vous avez essayé de le faire jusqu’à présent, sachez bien que tout serait inutile: partout je vous suivrais comme je vous ai suivie; rien ne m’attache à un lieu plutôt qu’à un autre, tout m’entraîne au contraire où vous êtes; aller au devant de vous ou marcher derrière vous sera désormais mon seul but. J’ai perdu bien des années et risqué cent fois ma vie et mon âme pour arriver à un résultat qui ne me promettait pas le même bonheur.
»Adieu, Pauline! je ne vous menace pas, je vous implore; je vous aime, vous m’aimez. Ayez pitié de vous et de moi.»
Il me serait impossible de vous dire ce qui se passa en moi à la lecture de cette étrange lettre; il me semblait être en proie à un de ces songes terribles où, menacé d’un danger, on tente de fuir; mais les pieds s’attachent à la terre, l’haleine manque à la poitrine; on veut crier, la voix n’a pas de son. Alors l’excès de la peur brise le sommeil, et l’on se réveille le cœur bondissant et le front mouillé de sueur.
Mais là, là, il n’y avait pas à me réveiller; ce n’était point un rêve que je faisais, c’était une réalité terrible qui me saisissait de sa main puissante et qui m’entraînait avec elle; et cependant qu’y avait-il de nouveau dans ma vie? Un homme y avait passé, et voilà tout. A peine si avec cet homme j’avais échangé un regard et une parole. Quel droit se croyait-il donc de garrotter comme il le faisait ma destinée à la sienne, et de me parler presque en maître, lorsque je ne lui avais pas même accordé les droits d’un ami? Cet homme, je pouvais demain ne plus le regarder, ne plus lui parler, ne plus le connaître. Mais non, je ne pouvais rien... j’étais faible... j’étais femme... je l’aimais.
En savais-je quelque chose, au reste? ce sentiment que j’éprouvais était-ce de l’amour? l’amour entre-t-il dans le cœur précédé d’une terreur aussi profonde? Jeune et ignorante comme je l’étais, savais-je moi-même ce que c’était que l’amour? Cette lettre fatale, pourquoi ne l’avais-je pas brûlée avant de la lire? n’avais-je pas donné au comte le droit de croire que je l’aimais en la recevant? Mais aussi que pouvais-je faire? un éclat devant des valets, des domestiques. Non; mais la remettre à ma mère, lui tout dire, lui tout avouer... Lui avouer quoi? des terreurs d’enfant, et voilà tout. Puis ma mère, qu’eût-elle pensé à la lecture d’une pareille lettre? Elle aurait cru que d’un mot, d’un geste, d’un regard, j’avais encouragé le comte. Sans cela, de quel droit me dirait-il que je l’aimais? Non, je n’oserais jamais rien dire à ma mère....
Mais cette lettre, il fallait la brûler d’abord et avant tout. Je l’approchai de la bougie, elle s’enflamma, et ainsi que tout ce qui a existé et qui n’existe plus, elle ne fut bientôt qu’un peu de cendre. Puis je me déshabillai promptement, je me hâtai de me mettre au lit, et je soufflai aussitôt mes lumières afin de me dérober à moi-même et de me cacher dans la nuit. Oh! comme malgré l’obscurité je fermai les yeux, comme j’appuyai mes mains sur mon front, et comme, malgré ce double voile, je revis tout! Cette lettre fatale était écrite sur les murs de la chambre. Je ne l’avais lue qu’une fois, et cependant elle s’était si profondément gravée dans ma mémoire, que chaque ligne, tracée par une main invisible, semblait paraître à mesure que la ligne précédente s’effaçait; et je lus et relus ainsi cette lettre dix fois, vingt fois, toute la nuit. Oh! je vous assure qu’entre cet état et la folie il y avait une barrière bien étroite à franchir, un voile bien faible à déchirer.
Enfin, au jour je m’endormis, écrasée de fatigue. Lorsque je me réveillai, il était déjà tard; ma femme de chambre m’annonça que madame de Lucienne et sa fille étaient au château. Alors une idée subite m’illumina; je devais tout dire à madame de Lucienne: elle avait toujours été parfaite pour moi; c’était chez elle que j’avais vu le comte Horace, le comte Horace était l’ami de son fils; c’était la confidente la plus convenable pour un secret comme le mien; Dieu me l’envoyait. En ce moment la porte de la chambre s’ouvrit, et madame de Lucienne parut. Oh! alors je crus vraiment à cette mission; je me soulevai sur mon lit et je lui tendis les bras en sanglotant: elle vint s’asseoir près de moi.
—Allons, enfant, me dit elle après un instant et en écartant mes mains dont je me voilais le visage, voyons, qu’avons-nous?
—Oh! je suis bien malheureuse! m’écriai-je.
—Les malheurs de ton âge, mon enfant, sont comme les orages du printemps, ils passent vite et font le ciel plus pur.
—Oh! si vous saviez!
—Je sais tout, me dit madame de Lucienne.
—Qui vous l’a dit?
—Lui.
—Il vous a dit que je l’aimais!
—Il m’a dit qu’il avait cet espoir, du moins; se trompe-t-il?
—Je ne sais moi-même; je ne connaissais de l’amour que le nom, comment voulez-vous que je voie clair dans mon cœur, et qu’au milieu du trouble que j’éprouve j’analyse le sentiment qui l’a causé?
—Allons, allons, je vois que Horace y lit mieux que vous.—Je me mis à pleurer.—Eh bien! continua madame de Lucienne, il n’y a pas là dedans une grande cause de larmes, ce me semble. Voyons, causons raisonnablement. Le comte Horace est jeune, beau, riche, voilà plus qu’il n’en faut pour excuser le sentiment qu’il vous inspire. Le comte Horace est libre, vous avez dix-huit ans, ce serait une union convenable sous tous les rapports.
—Oh! Madame!...
—C’est bien, n’en parlons plus; j’ai appris tout ce que je voulais savoir. Je redescends près de madame de Meulien et je vous envoie Lucie.
—Oh!... mais pas un mot, n’est-ce pas?
—Soyez tranquille, je sais ce qui me reste à faire; au revoir, chère enfant. Allons, essuyez ces beaux yeux et embrassez-moi....
Je me jetai une seconde fois à son cou. Cinq minutes après, Lucie entra; je m’habillai et nous descendîmes.
Je trouvai ma mère sérieuse, mais plus tendre encore que d’ordinaire. Plusieurs fois, pendant le déjeuner, elle me regarda avec un sentiment de tristesse inquiète, et à chaque fois je sentis la rougeur de la honte me monter au visage. A quatre heures, madame de Lucienne et sa fille nous quittèrent; ma mère fut la même avec moi qu’elle avait coutume d’être; pas un mot sur la visite de madame de Lucienne, et le motif qui l’avait amenée ne fut prononcé. Le soir, comme de coutume, j’allai, avant de me retirer dans ma chambre, embrasser ma mère: en approchant mes lèvres de son front, je m’aperçus que ses larmes coulaient; alors je tombai à genoux devant elle en cachant ma tête dans sa poitrine. En voyant ce mouvement, elle devina le sentiment qui me le dictait, et, abaissant ses deux mains sur mes épaules, et me serrant contre elle: —Sois heureuse, ma fille, dit-elle, c’est tout ce que je demande à Dieu.
Le surlendemain, madame de Lucienne demanda officiellement ma main à ma mère.
Six semaines après, j’épousai le comte Horace.
Le mariage se fit à Lucienne, dans les premiers jours de novembre; puis nous revînmes à Paris au commencement de la saison d’hiver.
Nous habitions l’hôtel tous ensemble. Ma mère m’avait donné vingt-cinq mille livres de rentes par mon contrat de mariage, le comte en avait déclaré à peu près autant; il en restait quinze mille à ma mère. Notre maison se trouva donc au nombre, sinon des maisons riches, du moins des maisons élégantes du faubourg Saint-Germain.
Horace me présenta deux de ses amis, qu’il me pria de recevoir comme ses frères: depuis six ans ils étaient liés d’un sentiment si intime, qu’on avait pris l’habitude de les appeler les inséparables. Un quatrième, qu’ils regrettaient tous les jours et dont ils parlaient sans cesse, s’était tué au mois d’octobre de l’année précédente en chassant dans les Pyrénées, où il avait un château. Je ne puis vous révéler le nom de ces deux hommes, et à la fin de mon récit vous comprendrez pourquoi; mais comme je serai forcée parfois de les désigner, j’appellerai l’un Henri et l’autre Max.
Je ne vous dirai pas que je fus heureuse: le sentiment que j’éprouvais pour Horace m’a été et me sera toujours inexplicable: on eût dit un respect mêlé de crainte; c’était, au reste, l’impression qu’il produisait généralement sur tous ceux qui l’approchaient. Ses deux amis eux-mêmes, si libres et si familiers qu’ils fussent avec lui, le contredisaient rarement et lui cédaient toujours, sinon comme à un maître, du moins comme à un frère aîné. Quoique adroits aux exercices du corps, ils étaient loin d’être de sa force. Le comte avait transformé la salle de billard en une salle d’armes, et une des allées du jardin était consacrée à un tir: tous les jours ces messieurs venaient s’exercer à l’épée ou au pistolet. Parfois j’assistais à ces joùtes: Horace alors était plutôt leur professeur que leur adversaire; il gardait dans ces exercices ce calme effrayant dont je lui avais vu donner une preuve chez madame de Lucienne, et plusieurs duels, qui tous avaient fini à son avantage, attestaient que, sur le terrain, ce sang-froid, si rare au moment suprême, ne l’abandonnait pas un instant. Horace, chose étrange! restait donc pour moi, malgré l’intimité, un être supérieur et en dehors des autres hommes.
Quant à lui, il paraissait heureux, il affectait du moins de répéter qu’il l’était, quoique souvent son front soucieux attestât le contraire. Parfois aussi des rêves terribles agitaient son sommeil, et alors cet homme, si calme et si brave le jour, avait, s’il se réveillait au milieu de pareils songes, des instans d’effroi où il frissonnait comme un enfant. Il en attribuait la cause à un accident qui était arrivé à sa mère pendant sa grossesse: arrêtée dans la Sierra par des voleurs, elle avait été attachée à un arbre, et avait vu égorger un voyageur qui faisait la même route qu’elle; il en résultait que c’étaient habituellement des scènes de vol et de brigandage qui s’offraient ainsi à lui pendant son sommeil. Aussi, plutôt pour prévenir le retour de ces songes que par une crainte réelle, posait-il toujours avant de se coucher, quelque part qu’il fût, une paire de pistolets à portée de sa main. Cela me causa d’abord une grande terreur, car je tremblais toujours que, dans quelque accès de somnambulisme il ne fît usage de ces armes; mais peu à peu je me rassurai, et je contractai l’habitude de lui voir prendre cette précaution. Une autre plus étrange encore, et dont seulement aujourd’hui je me rends compte, c’est qu’on tenait constamment, jour ou nuit, un cheval sellé et prêt à partir.
L’hiver se passa au milieu des fêtes et des bals. Horace était fort répandu de son côté; de sorte que, ses salons s’étant joints aux miens, le cercle de nos connaissances avait doublé. Il m’accompagnait partout avec une complaisance extrême, et, chose qui surprenait tout le monde, il avait complétement cessé de jouer. Au printemps nous partîmes pour la campagne.
Là nous retrouvâmes tous nos souvenirs. Nos journées s’écoulaient moitié chez nous, moitié chez nos voisins; nous avions continué de voir madame de Lucienne et ses enfans comme une seconde famille à nous. Ma situation de jeune fille se trouvait donc à peine changée, et ma vie était à peu près la même. Si cet état n’était pas du bonheur, il y ressemblait tellement que l’on pouvait s’y tromper. La seule chose qui le troublât momentanément, c’étaient ces tristesses sans cause dont je voyais Horace de plus en plus atteint; c’étaient ces songes qui devenaient plus terribles à mesure que nous avancions. Souvent j’allais à lui pendant ces inquiétudes du jour, ou je le réveillais au milieu de ces rêves de la nuit; mais dès qu’il me voyait, sa figure reprenait cette expression calme et froide qui m’avait tant frappée; cependant il n’y avait point à s’y tromper, la distance était grande de cette tranquillité appareille à un bonheur réel.
Vers le mois de juin, Henri et Max, ces deux jeunes gens dont je vous ai parlé, vinrent nous rejoindre. Je savais l’amitié qui les unissait à Horace, et ma mère et moi les reçûmes, elle comme des enfans, moi comme des frères. On les logea dans des chambres presque attenantes aux nôtres; le comte fit poser des sonnettes, avec un timbre particulier, qui allaient de chez lui chez eux, et de chez eux chez lui, et ordonna que l’on tint constamment trois chevaux prêts au lieu d’un. Ma femme de chambre me dit en outre qu’elle avait appris des domestiques que ces messieurs avaient la même habitude que mon mari, et ne dormaient qu’avec une paire de pistolets au chevet de leur lit.
Depuis l’arrivée de ses amis, Horace était livré presque entièrement à eux. Leurs amusemens étaient, au reste, les mêmes qu’à Paris: des courses à cheval et des assauts d’armes et de pistolet. Le mois de juillet s’écoula ainsi; puis, vers la moitié d’août, le comte m’annonça qu’il serait obligé de me quitter dans quelques jours pour deux ou trois mois. C’était la première séparation depuis notre mariage: aussi m’effrayai-je à ces paroles. Le comte essaya de me rassurer en me disant que ce voyage, que je croyais peut-être lointain, était au contraire dans une des provinces de la France les plus proches de Paris, c’est-à-dire en Normandie: il allait avec ses amis au château de Burcy. Chacun d’eux possédait une maison de campagne, l’un dans la Vendée, l’autre entre Toulon et Nice; celui qui avait été tué avait la sienne dans les Pyrénées, et le comte Horace en Normandie; de sorte que, chaque année, ils se recevaient successivement pendant la saison des chasses, et passaient trois mois les uns chez les autres. C’était au tour d’Horace, cette année, à recevoir ses amis. Je m’offris aussitôt à l’accompagner pour faire les honneurs de sa maison, mais le comte me répondit que le château n’était qu’un rendez-vous de chasse, mal tenu, mal meublé, bon pour des chasseurs habitués à vivre tant bien que mal, mais non pour une femme accoutumée à tout le confortable et à tout le luxe de la vie. Il donnerait, au reste, des ordres pendant son prochain séjour afin que toutes les réparations fussent faites, et pour que désormais, quand son année viendrait, je pusse l’accompagner et faire en noble châtelaine les honneurs de son manoir.
Cet incident, tout simple et tout naturel qu’il parût à ma mère, m’inquiéta horriblement. Je ne lui avais jamais parlé des tristesses ni des terreurs d’Horace; mais, quelque explication qu’il eût tenté de m’en donner, elles m’avaient toujours paru si peu naturelles, que je leur supposais un autre motif qu’il ne voulait ou ne pouvait dire. Cependant il eût été si ridicule à moi de me tourmenter pour une absence de trois mois, et si étrange d’insister pour suivre Horace, que je renfermai mon inquiétude en moi-même et que je ne parlai plus de ce voyage.
Le jour de la séparation arriva: c’était le 27 d’août. Ces messieurs voulaient être installés à Burcy pour l’ouverture des chasses, fixée au 1er septembre. Ils partaient en chaise de poste et se faisaient suivre de leurs chevaux, conduits en main par le Malais, qui devait les rejoindre au château.
Au moment du départ, je ne pus m’empêcher de fondre en larmes; j’entraînai Horace dans une chambre et le priai une dernière fois de m’emmener avec lui: je lui dis mes craintes inconnues, je lui rappelai ces tristesses, ces terreurs incompréhensibles qui le saisissaient tout-à-coup. A ces mots, le sang lui monta au visage, et je le vis me donner pour la première fois un signe d’impatience. Au reste, il le réprima aussitôt, et, me parlant avec la plus grande douceur, il me promit, si le château était habitable, ce dont il doutait, de m’écrire d’aller le rejoindre. Je me repris à cette promesse et à cet espoir; de sorte que je le vis s’éloigner plus tranquillement que je ne l’espérais.
Cependant les premiers jours de notre séparation furent affreux; et pourtant, je vous le répète, ce n’était point une douleur d’amour: c’était le pressentiment vague, mais continu, d’un grand malheur. Le surlendemain du départ d’Horace, je reçus de lui une lettre datée de Caen: il s’était arrêté pour dîner dans cette ville et avait voulu m’écrire, se rappelant dans quel état d’inquiétude il m’avait laissée. La lecture de cette lettre m’avait fait quelque bien, lorsque le dernier mot renouvela toutes ces craintes, d’autant plus cruelles qu’elles étaient réelles pour moi seule, et qu’à tout autre elles eussent paru chimériques: au lieu de me dire au revoir, le comte me disait adieu. L’esprit frappé s’attache aux plus petites choses: je faillis m’évanouir en lisant ce dernier mot.
Je reçus une seconde lettre du comte, datée de Burcy; il avait trouvé le château, qu’il n’avait pas visité depuis trois ans, dans un délabrement affreux; à peine s’il y avait une chambre où le vent et la pluie ne pénétrassent point; il était en conséquence inutile que je songeasse pour cette année à aller le rejoindre; je ne sais pourquoi, mais je m’attendais à cette lettre, elle me fit donc moins d’effet que la première.
Quelques jours après, nous lûmes dans notre journal la première nouvelle des assassinats et des vols qui effrayèrent la Normandie; une troisième lettre d’Horace nous en dit quelques mots à son tour; mais il ne paraissait pas attacher à ces bruits toute l’importance que leur donnaient les feuilles publiques. Je lui répondis pour le prier de revenir le plus tôt possible: ces bruits me paraissaient un commencement de réalisation pour mes pressentimens.
Bientôt les nouvelles devinrent de plus en plus effrayantes; c’était moi qui, à mon tour, avais des tristesses subites et des rêves affreux; je n’osais plus écrire à Horace, ma dernière lettre était restée sans réponse. J’allai trouver madame de Lucienne, qui depuis le soir où je lui avais tout avoué, était devenue ma conseillère: je lui racontai mon effroi et mes pressentimens; elle me dit alors ce que m’avait dit vingt fois ma mère, que la crainte que je ne fusse mal servie au château avait seule empêché Horace de m’emmener; elle savait mieux que personne combien il m’aimait, elle à qui il s’était confié tout d’abord, et que si souvent depuis il avait remerciée du bonheur qu’il disait lui devoir. Cette certitude qu’Horace m’aimait me décida tout-à-fait; je résolus, si le prochain courrier ne m’annonçait pas son arrivée, de partir moi-même et d’aller le rejoindre.
Je reçus une lettre: loin de parler de retour, Horace se disait forcé de rester encore six semaines ou deux mois loin de moi; sa lettre était pleine de protestations d’amour; il fallait ces vieux engagemens pris avec des amis pour l’empêcher de revenir, et la certitude que je serais affreusement dans ces ruines, pour qu’il ne me dît pas d’aller le retrouver; si j’avais pu hésiter encore, cette lettre m’aurait déterminée: je descendis près de ma mère, je lui dis que Horace m’autorisait à aller le rejoindre, et que je partirais le lendemain soir; elle voulait absolument venir avec moi, et j’eus toutes les peines du monde à lui faire comprendre que, s’il craignait pour moi, à plus forte raison craindrait-il pour elle.
Je partis en poste, emmenant avec moi ma femme de chambre qui était de la Normandie; en arrivant à Saint-Laurent-du-Mont, elle me demanda la permission d’aller passer trois ou quatre jours chez ses parens qui demeuraient à Crèvecœur; je lui accordai sa demande sans songer que c’était surtout au moment où je descendrais dans un château habité par des hommes que j’aurais besoin de ses services; puis aussi je tenais à prouver à Horace qu’il avait eu tort de douter de mon stoïcisme.
J’arrivai à Caen vers les sept heures du soir; le maître de poste, apprenant qu’une femme qui voyageait seule demandait des chevaux pour se rendre au château de Burcy, vint lui-même à la portière de ma voiture: là il insista tellement pour que je passasse la nuit dans la ville et que je ne continuasse ma route que le lendemain, que je cédai. D’ailleurs, j’arriverais au château à une heure où tout le monde serait endormi, et peut-être, grâce aux événemens au centre desquels il se trouvait, les portes en seraient-elles si bien closes, que je ne pourrais me les faire ouvrir: ce motif, bien plus que la crainte, me détermina à rester à l’hôtel.
Les soirées commençaient à être froides; j’entrai dans le salon du maître de poste, tandis qu’on me préparait une chambre. Alors l’hôtesse, pour ne me laisser aucun regret sur la résolution que j’avais prise et le retard qui en était la suite, me raconta tout ce qui se passait dans le pays depuis quinze jours ou trois semaines; la terreur était à son comble: on n’osait pas faire un quart de lieue hors de la ville, dès que le soleil était couché.
Je passai une nuit affreuse; à mesure que j’approchais du château, je perdais de mon assurance; le comte avait peut-être eu d’autres motifs de s’éloigner de moi que ceux qu’il m’avait dits, comment alors accueillerait-il ma présence? Mon arrivée subite et inattendue était une désobéissance à ses ordres, une infraction à son autorité; ce geste d’impatience qu’il n’avait pu retenir, et qui était le premier et le seul qu’il eût jamais laissé échapper, n’indiquait-il pas une détermination irrévocablement prise? J’eus un instant l’envie de lui écrire que j’étais à Caen, et d’attendre qu’il vint m’y chercher; mais toutes des craintes, inspirées et entretenues par ma veille fiévreuse, se dissipèrent lorsque j’eus dormi quelques heures et que le jour vint éclairer mon appartement. Je repris donc tout mon courage, et je demandai des chevaux. Dix minutes après, je repartis.
Il était neuf heures du matin, lorsqu’à deux lieues du Buisson, le postillon s’arrêta et me montra le château de Burcy, dont on apercevait le parc, qui s’avance jusqu’à deux cents pas de la grande route. Un chemin de traverse conduisait à une grille. Il me demanda si c’était bien à ce château que j’allais: je répondis affirmativement, et nous nous engageâmes dans les terres.
Nous trouvâmes la porte fermée: nous sonnâmes à plusieurs reprises sans que l’on répondit. Je commençais à me repentir de ne point avoir annoncé mon arrivée. Le comte et ses amis pouvaient être allés à quelque partie de chasse: en ce cas, qu’allais-je devenir dans ce château solitaire, dont je ne pourrais peut-être même pas me faire ouvrir les portes? Me faudrait-il attendre dans une misérable auberge de village qu’ils fussent revenus? C’était impossible. Enfin, dans mon impatience, je descendis de voiture et sonnai moi-même avec force. Un être vivant apparut alors à travers le feuillage des arbres, au tournant d’une allée; je reconnus le Malais, je lui fis signe de se hâter, il vint m’ouvrir.
Je ne pris pas la peine de remonter en voiture, je suivis en courant l’allée par laquelle je l’avais vu venir; bientôt j’aperçus le château: au premier coup-d’œil, il me parut en assez bon état; je m’élançai vers le perron, j’entrai dans l’antichambre, j’entendis parler, je poussai une porte, et je me trouvai dans la salle à manger, en face d’Horace, qui déjeunait avec Henri; chacun d’eux avait à sa droite une paire de pistolets sur la table.
Le comte, en m’apercevant, se leva tout debout et devint pâle à croire qu’il allait se trouver mal. Quant à moi, j’étais si tremblante que je n’eus que la force de lui tendre les bras; j’allais tomber, lorsqu’il accourut à moi et me retint.
—Horace, lui dis-je, pardonnez-moi; je n’ai pas pu rester loin de vous... j’étais trop malheureuse, trop inquiète... je vous ai désobéi.
—Et vous avez eu tort, dit le comte d’une voix sourde.
—Oh! si vous voulez, m’écriai-je effrayée de son accent, je repartirai à l’instant même.... Je vous ai revu... c’est tout ce qu’il me faut....
—Non, dit le comte, non; puisque vous voilà, restez... restez, et soyez la bienvenue.
A ces mots, il m’embrasa, et, faisant un effort sur lui-même, il reprit immédiatement cette apparence calme qui parfois m’effrayait davantage que n’eût pu le faire le visage le plus irrité.
Cependant peu à peu ce voile de glace que le comte semblait avoir tiré sur son visage se fondit; il m’avait conduite dans l’appartement qu’il me destinait: c’était une chambre entièrement meublée dans le goût Louis XV.
—Oui, je la connais, interrompis-je, c’est celle où je suis entré. O mon Dieu, mon Dieu, je commence à tout comprendre!...
—Là, reprit Pauline, il me demanda pardon de la manière dont il m’avait reçue; mais la surprise que lui avait causée mon arrivée inattendue, la crainte des privations que j’allais éprouver en passant deux mois dans cette vieille masure, avaient été plus fortes que lui. Cependant, puisque j’avais tout bravé, c’était bien, et il tâcherait de me rendre le séjour du château le moins désagréable qu’il serait possible; malheureusement il avait, pour le jour même ou le lendemain, une partie de chasse arrêtée, et il serait peut-être obligé de me quitter pour un ou deux jours; mais il ne contracterait plus de nouvelles obligations de ce genre, et je lui serais un prétexte pour les refuser. Je lui répondis qu’il était parfaitement libre et que je n’étais pas venue pour gêner ses plaisirs, mais bien pour rassurer mon cœur effrayé du bruit de tous ces assassinats. Le comte sourit.
J’étais fatiguée du voyage, je me couchai et je m’endormis. A deux heures, le comte entra dans ma chambre et me demanda si je voulais faire une promenade sur mer: la journée était superbe, j’acceptai.
Nous descendîmes dans le parc, l’Orne le traversait. Sur une des rives de ce petit fleuve une charmante barque était amarrée; sa forme était longue et étrange; j’en demandai la cause. Horace me dit qu’elle était taillée sur le modèle des barques javanaises, et que ce genre de construction augmentait de beaucoup sa vitesse. Nous y descendîmes, Horace, Henri et moi; le Malais se mit à la rame, et nous avançâmes rapidement, aidés par le courant. En entrant dans la mer, Horace et Henri déroulèrent la longue voile triangulaire qui était liée autour du mât, et, sans le secours des rames, nous marchâmes avec une rapidité extraordinaire.
C’était la première fois que je voyais l’Océan: ce spectacle magnifique m’absorba tellement, que je ne m’aperçus pas que nous gouvernions vers une petite barque qui nous avait fait des signaux. Je ne fus tirée de ma rêverie que par la voix d’Horace, qui héla un des hommes de la barque.
—Holà! hé! monsieur le marinier, lui cria-t-il, qu’avons-nous de nouveau au Havre?
—Ma foi, pas grand’chose, répondit une voix qui m’était connue; et à Burcy?
—Tu le vois, un compagnon inattendu qui nous est arrivé, une ancienne connaissance à toi: madame Horace de Beuzeval, ma femme.
—Comment! madame de Beuzeval? s’écria Max, que je reconnus alors.
—Elle-même; et si tu en doutes, cher ami, viens lui présenter tes hommages.
La barque s’approcha; Max la montait avec deux matelots: il avait un costume élégant de marinier, et sur l’épaule un filet qu’il s’apprêtait à jeter à la mer. Arrivé près de nous, nous échangeâmes quelques paroles de politesse; puis Max laissa tomber son filet, monta à bord de notre canot, parla un instant à voix basse avec Henri, me salua et redescendit dans son embarcation.
—Bonne pêche! lui cria Horace.
—Bon voyage! répondit Max; et la barque et le canot se séparèrent.
L’heure du dîner s’approchait, nous regagnâmes l’embouchure de la rivière; mais le flux s’était retiré, il n’y avait plus assez d’eau pour nous porter jusqu’au parc: nous fûmes obligés de descendre sur la grève et de remonter par les dunes.
Là, je fis le chemin que vous-même fîtes trois ou quatre nuits après: je me trouvai sur les galets d’abord, puis dans les grandes herbes; enfin je gravis la montagne, j’entrai dans l’abbaye, je vis le cloître et son petit cimetière, je suivis le corridor, et de l’autre côté d’un massif d’arbres je me retrouvai dans le parc du château.
Le soir se passa sans aucune circonstance remarquable; Horace fut très gai, il parla pour l’hiver prochain d’embellissemens à faire à notre hôtel de Paris, et pour le printemps d’un voyage: il voulait emmener ma mère et moi en Italie, et peut-être acheter à Venise un de ses vieux palais de marbre, afin d’y aller passer les saisons du carnaval. Henri était beaucoup moins libre d’esprit, et paraissait préoccupé et inquiet au moindre bruit. Tous ces petits détails, auxquels je fis à peine attention dans le moment, se représentèrent plus tard à mon esprit avec toutes leurs causes qui m’étaient cachées alors, et que leur résultat me fit comprendre depuis.
Nous nous retirâmes laissant Henri au salon; il avait à veiller pour écrire, nous dit-il. On lui apporta des plumes et de l’encre: il s’établit près du feu.
Le lendemain matin, comme nous étions à déjeuner, on entendit sonner d’une manière particulière à la porte du parc:—Max!... dirent ensemble Horace et Henri; en effet, celui qu’ils avaient nommé entra presque aussitôt dans la cour au grand galop de son cheval.
—Ah! te voilà, dit en riant Horace, je suis enchanté de te revoir; mais une autre fois ménage un peu plus mes chevaux, vois dans quel état tu as mis ce pauvre Pluton.
—J’avais peur de ne pas arriver à temps, répondit Max; puis, s’interrompant et se retournant de mon côté:—Madame, me dit-il, excusez-moi de me présenter ainsi botté et éperonné devant vous; mais Horace a oublié, et je conçois cela, que nous avons pour aujourd’hui une partie de chasse à courre, avec des Anglais, continua-t-il, en appuyant sur ce mot: ils sont arrivés hier soir exprès par le bateau à vapeur; de sorte qu’il ne faut pas que nous, qui sommes tout portés, nous nous trouvions en retard en leur manquant de parole.
—Très bien, dit Horace, nous y serons.
—Cependant, reprit Max en se retournant de mon côté, je ne sais si maintenant nous pouvons tenir notre promesse; cette chasse est trop fatiguante pour que madame nous accompagne.
—Oh! tranquillisez-vous, messieurs, m’empressai-je de répondre, je ne suis pas venue ici pour être une entrave à vos plaisirs: allez, et en votre absence je garderai la forteresse.
—Tu vois, dit Horace, Pauline est une véritable châtelaine des temps passés. Il ne lui manque vraiment que des suivantes et des pages, car elle n’a pas même de femme de chambre; la sienne est restée en route, et ne sera ici que dans huit jours.
—Au reste, dit Henri, si tu veux demeurer au château, Horace, nous t’excuserons auprès de nos insulaires: rien de plus facile.
—Non pas, reprit vivement le comte; vous oubliez que c’est moi qui suis le plus engagé dans le pari: il faut donc que je le soutienne en personne. Je vous l’ai dit, Pauline nous excusera.
—Parfaitement, repris-je, et, pour vous laisser toute liberté, je remonte dans ma chambre.
—Je vous y rejoins dans un instant, me dit Horace; et, venant à moi avec une galanterie charmante, il me conduisit jusqu’à la porte et me baisa la main.
Je remontai chez moi; au bout de quelques instans, Horace m’y suivit; il était déjà en costume de chasse, et venait me dire adieu. Je redescendis avec lui jusqu’au perron, et je pris congé de ces messieurs; ils insistèrent alors de nouveau pour que Horace restât près de moi. Mais j’exigeai impérieusement qu’il les accompagnât: ils partirent enfin en me promettant d’être de retour le lendemain matin.
Je restai seule au château avec le Malais: cette singulière société eût peut-être effrayé une autre femme que moi; mais je savais que cet homme était tout dévoué à Horace depuis le jour où il l’avait vu avec son poignard aller attaquer la tigresse dans ses roseaux: subjugué par cette admiration puissante que les natures primitives ont pour le courage, il l’avait suivi de Bombay en France, et ne l’avait pas quitté un instant depuis. J’eusse donc été parfaitement tranquille, si je n’avais eu pour cause d’inquiétude que son air sauvage et son costume étrange; mais j’étais au milieu d’un pays qui, depuis quelque temps, était devenu le théâtre des accidens les plus inouïs, et quoique je n’en eusse entendu parler ni à Horace ni à Henri qui, en leur qualité d’hommes, méprisaient ou affectaient de mépriser un semblable danger, ces histoires lamentables et sanglantes me revinrent à l’esprit dès que je fus seule; cependant, comme je n’avais rien à craindre pendant le jour, je descendis dans le parc, et je résolus d’occuper ma matinée à visiter les environs du château que j’allais habiter pendant deux mois.
Mes pas se dirigèrent naturellement vers la partie que je connaissais déjà: je visitai de nouveau les ruines de l’abbaye, mais cette fois en détail. Vous les avez explorées, je n’ai pas besoin de vous les décrire. Je sortis par le porche ruiné, et j’arrivai bientôt sur la colline qui domine la mer.
C’était la seconde fois que je voyais ce spectacle: il n’avait donc encore rien perdu de sa puissance; aussi restai-je deux heures assise, immobile et les yeux fixes, à le contempler. Au bout de ce temps, je le quittai à regret; mais je voulais visiter les autres parties du parc. Je redescendis vers la rivière, j’en suivis quelque temps les bords; je retrouvai amarrée à sa rive la barque sur laquelle nous avions fait la veille notre promenade, et qui était appareillée de manière à ce qu’on pût s’en servir au premier caprice. Elle me rappela, je ne sais pourquoi, ce cheval toujours sellé dans l’écurie. Cette idée en éveilla une autre: c’était celle de cette défiance éternelle qu’avait Horace et que partageaient ses amis, ces pistolets qui ne quittaient jamais le chevet de son lit, ces pistolets sur la table quand j’étais arrivée. Tout en paraissant mépriser le danger, ils prenaient donc des précautions contre lui? Mais alors, si deux hommes croyaient ne pas pouvoir déjeuner sans armes, comment me laissaient-ils seule, moi qui n’avais aucune défense? Tout cela était incompréhensible; mais, par cela même, quelque effort que je fisse pour chasser ces idées sinistres de mon esprit, elles y revenaient sans cesse. Au reste, comme tout en songeant je marchais toujours, je me trouvai bientôt dans le plus touffu du bois. Là, au milieu d’une véritable forêt de chênes, s’élevait un pavillon isolé et parfaitement fermé: j’en fis le tour; mais portes et volets étaient si habilement joints, que je ne pus, malgré ma curiosité, rien en voir que l’extérieur. Je me promis, la première fois que je sortirais avec Horace, de diriger la promenade de ce côté; car j’avais déjà, si le comte ne s’y opposait pas, jeté mon dévolu sur ce pavillon pour en faire mon cabinet de travail, sa position le rendant parfaitement apte à cette destination.
Je rentrai au château. Après l’exploration extérieure vint la visite intérieure: la chambre que j’occupais donnait d’un côté dans un salon, de l’autre dans la bibliothèque; un corridor régnait d’un bout à l’autre du bâtiment et le partageait en deux. Mon appartement était le plus complet; le reste du château était divisé en une douzaine de petits logemens séparés, composés d’une antichambre, d’une chambre et d’un cabinet de toilette, le tout fort habitable, quoi que m’en eût dit et écrit le comte.
Comme la bibliothèque me paraissait le plus sûr contre-poison à la solitude et à l’ennui qui m’attendaient, je résolus de faire aussitôt connaissance avec les ressources qu’elle pouvait m’offrir: elle se composait en grande partie de romans du dix-huitième siècle, qui annonçaient que les prédécesseurs du comte avaient un goût décidé pour la littérature de Voltaire, de Crébillon fils et de Marivaux. Quelques volumes plus nouveaux, et qui paraissaient achetés par le propriétaire actuel, faisaient tache au milieu de cette collection: c’étaient des livres de chimie, d’histoire et de voyages; parmi ces derniers, je remarquai une belle édition anglaise de l’ouvrage de Daniel, sur l’Inde; je résolus d’en faire le compagnon de ma nuit, pendant laquelle j’espérais peu dormir. J’en tirai un volume de son rayon, et je le portai dans ma chambre.
Cinq minutes après, le Malais vint m’annoncer par signes que le dîner était servi. Je descendis et trouvai la table dressée dans cette immense salle à manger. Je ne puis vous dire quel sentiment de crainte et de tristesse s’empara de moi quand je me vis forcée de dîner ainsi seule, éclairée par deux bougies dont la lumière n’atteignait pas la profondeur de l’appartement, et permettait à l’ombre d’y donner aux objets sur lesquels elle s’étendait les formes les plus bizarres. Ce sentiment pénible s’augmentait encore de la présence de ce serviteur basané, à qui je ne pouvais communiquer mes volontés que par des signes auxquels, du reste, il obéissait avec une promptitude et une intelligence qui donnaient encore quelque chose de plus fantastique à ce repas étrange. Plusieurs fois j’eus envie de lui parler, quoique je susse qu’il ne pourrait pas me comprendre; mais, comme les enfans qui n’osent crier dans les ténèbres, j’avais peur d’entendre le son de ma propre voix. Lorsqu’il eut servi le dessert, je lui fis signe d’aller me faire un grand feu dans ma chambre; la flamme du foyer est la compagnie de ceux qui n’en ont pas; d’ailleurs, je comptais ne me coucher que le plus tard possible, car je me sentais une terreur à laquelle je n’avais pas songé pendant la journée, et qui était venue avec les ténèbres.
Lorsque je me trouvai seule dans cette grande salle à manger, ma terreur s’augmenta: il me semblait voir s’agiter les rideaux blancs qui pendaient devant les fenêtres, pareils à des linceuls; cependant ce n’était pas la crainte des morts qui m’agitait: les moines et les abbés dont j’avais foulé en passant les tombes dormaient de leur sommeil béni, les uns dans leur cloître, les autres dans leurs caveaux; mais tout ce que j’avais lu à la campagne, tout ce qu’on m’avait raconté à Caen, me revenait à la mémoire, et je tressaillais au moindre bruit. Le seul qu’on entendit cependant était le frémissement des feuilles, le murmure lointain de la mer, et ce bruit monotone et mélancolique du vent qui se brise aux angles des grands édifices et s’abat dans les cheminées, comme une volée d’oiseaux de nuit. Je restai ainsi immobile pendant dix minutes à peu près, n’osant regarder ni à droite ni à gauche, lorsque j’entendis un léger bruit derrière moi; je me retournai: c’était le Malais. Il croisa les mains sur sa poitrine et s’inclina: c’était sa manière d’annoncer que les ordres qu’il avait reçus étaient accomplis. Je me levai; il prit les bougies et marcha devant moi; mon appartement, du reste, avait été parfaitement préparé pour la nuit par ma singulière femme de chambre, qui posa les lumières sur une table et me laissa seule.
Mon désir avait été exécuté à la lettre: un feu immense brûlait dans la grande cheminée de marbre blanc supportée par des amours dorés; sa lueur se répandait dans la chambre et lui donnait un aspect gai, qui contrastait si bien avec ma terreur, qu’elle commença à se passer. Cette chambre était tendue de damas rouge à fleurs, et ornée au plafond et aux portes d’une foule d’arabesques et d’enroulemens plus capricieux les uns que les autres, représentant des danses de faunes et de satyres dont les masques grotesques riaient d’un rire d’or au foyer qu’ils reflétaient. Je n’étais cependant pas rassurée au point de me coucher; d’ailleurs, il était à peine huit heures du soir. Je substituai donc simplement un peignoir à ma robe, et, comme j’avais remarqué que le temps était beau, je voulus ouvrir ma fenêtre afin d’achever de me rassurer par la vue calme et sereine de la nature endormie; mais, par une précaution dont je crus pouvoir me rendre compte en l’attribuant à ces bruits d’assassinats répandus dans les environs, les volets en avaient été fermés en dedans. Je revins donc m’asseoir près de la table, au coin de mon feu, m’apprêtant à lire mon voyage dans l’Inde, lorsqu’en jetant les yeux sur le volume, je m’aperçus que j’avais apporté le tome second au lieu du tome premier. Je me levai pour aller le changer, lorsqu’à l’entrée de la bibliothèque ma crainte me reprit. J’hésitai un instant; enfin je me fis honte à moi-même d’une terreur aussi enfantine: j’ouvris hardiment la porte, et je m’avançai vers le panneau où était le reste de l’édition.
En approchant ma bougie des autres tomes pour voir leurs numéros, mes regards plongèrent dans le vide causé par l’absence du volume que, par erreur, j’avais pris d’abord, et derrière la tablette je vis briller un bouton de cuivre pareil à ceux que l’on met aux serrures, et que cachaient aux yeux les livres rangés sur le devant du panneau. J’avais souvent vu des portes secrètes dans les bibliothèques, et dissimulées par de fausses reliures; rien n’était donc plus naturel qu’une porte du même genre s’ouvrît dans celle-ci. Cependant la direction dans laquelle elle était placée rendait la chose presque impossible: les fenêtres de la bibliothèque étaient les dernières du bâtiment; ce bouton était scellé au lambris en retour de la seconde fenêtre: une porte pratiquée à cet endroit se serait donc ouverte sur le mur extérieur.
Je me reculai pour examiner, à l’aide de ma bougie, si je n’apercevais pas quelque signe qui indiquât une ouverture; mais j’eus beau regarder, je ne vis rien. Je portai alors la main sur le bouton, et j’essayai de le faire tourner, mais il résista; je le poussai et je le sentis fléchir; je le poussai plus fortement, alors une porte s’échappa avec bruit, renvoyée vers moi par un ressort. Cette porte donnait sur un petit escalier tournant, pratiqué dans l’épaisseur de la muraille.
Vous comprenez qu’une pareille découverte n’était point de nature à calmer mon effroi. J’avançai ma bougie au-dessus de l’escalier, et je le vis s’enfoncer perpendiculairement. Un instant j’eus l’intention de m’y engager, je descendis même les deux premières marches; mais le cœur me manqua. Je rentrai à reculons dans la bibliothèque, et je repoussai la porte, qui se referma si hermétiquement, que même, avec la certitude qu’elle existait, je ne pus découvrir ses jointures. Je replaçai aussitôt le volume, de peur qu’on ne s’aperçût que j’y avais touché, car je ne savais qui intéressait ce secret. Je pris au hasard un autre ouvrage, je rentrai dans ma chambre, je fermai au verrou la porte qui donnait sur la bibliothèque, et je revins m’asseoir près du feu.
Les événemens inattendus acquièrent ou perdent de leur gravité selon les dispositions d’esprit tristes ou gaies, ou selon les circonstances plus ou moins critiques dans lesquelles on se trouve. Certes, rien de plus naturel qu’une porte cachée dans une bibliothèque et qu’un escalier tournant pratiqué dans l’épaisseur d’un mur; mais si l’on découvre cette porte et cet escalier la nuit, dans un château isolé, qu’on habite seule et sans défense; si ce château s’élève au milieu d’une contrée qui retentit chaque jour du bruit d’un vol ou d’un assassinat nouveau, si toute une mystérieuse destinée vous enveloppe depuis quelque temps, si des pressentimens sinistres vous ont, vingt fois, fait passer, au milieu d’un bal, un frisson mortel dans le cœur, tout alors devient, sinon réalité, du moins spectre et fantôme; et personne n’ignore par expérience que le danger inconnu est mille fois plus saisissant et plus terrible que le péril visible et matérialisé.
C’est alors que je regrettai bien vivement ce congé imprudent que j’avais donné à ma femme de chambre. La terreur est une chose si peu raisonnée qu’elle s’excite ou se calme sans motifs plausibles. L’être le plus faible, un chien qui nous caresse, un enfant qui nous sourit, quoique ni l’un ni l’autre ne puissent nous défendre, sont, en ce cas, des appuis pour le cœur, sinon des armes pour le bras. Si j’avais eu près de moi cette fille, qui ne m’avait pas quittée depuis cinq ans, dont je connaissais le dévoûment et l’amitié, sans doute que toute crainte eût disparu, tandis que seule comme j’étais, il me semblait que j’étais dévouée à l’avance, et que rien ne pouvait me sauver.
Je restai ainsi deux heures immobile, la sueur de l’effroi sur le front. J’écoutai sonner à ma pendule dix heures, puis onze heures; et à ce bruit si naturel cependant, je me cramponnais chaque fois au bras de mon fauteuil. Entre onze heures et onze heures et demie, il me sembla entendre la détonation lointaine d’un coup de pistolet, je me soulevai à demi, appuyée sur le chambranle de la cheminée; puis, tout étant rentré dans le silence, je retombai assise et la tête renversée sur le dossier de ma bergère. Je restai encore ainsi quelque temps les yeux fixes et n’osant les détourner du point que je regardais, de peur qu’ils ne rencontrassent, en se retournant, quelque cause de crainte réelle. Tout-à-coup il me sembla, au milieu de ce silence absolu, que la grille qui était en face du perron et qui séparait le jardin du parc grinçait sur ses gonds. L’idée que Horace rentrait chassa à l’instant toute ma terreur; je m’élançai à la fenêtre, oubliant que mes volets étaient clos; je voulus ouvrir la porte du corridor; soit maladresse, soit précaution, le Malais l’avait fermée en se retirant: j’étais prisonnière. Je me rappelai alors que les fenêtres de la bibliothèque donnaient comme les miennes sur le préau, je tirai le verrou, et, par un de ces mouvemens bizarres qui font succéder le plus grand courage à la plus grande faiblesse, j’y entrai sans lumière, car ceux qui venaient à cette heure pouvaient n’être pas Horace et ses amis, et ma lumière dénonçait que ma chambre était habitée. Les volets étaient poussés seulement, j’en écartai un, et au clair de la lune j’aperçus distinctement un homme qui venait d’ouvrir l’un des battans de la grille et le tenait entrebâillé, tandis que deux autres, portant un objet que je ne pouvais distinguer, franchissaient la porte que leur compagnon referma derrière eux. Ces trois hommes ne s’avançaient pas vers le perron, mais tournaient autour du château; cependant, comme le chemin qu’ils suivaient les rapprochait de moi, je commençai à reconnaître la forme du fardeau qu’ils portaient; c’était un corps enveloppé dans un manteau. Sans doute, la vue d’une maison qui pouvait être habitée donna quelque espoir à celui ou à celle qu’on enlevait. Une espèce de lutte s’engagea sous ma fenêtre; dans cette lutte un bras se dégagea, ce bras était couvert d’une manche de robe; il n’y avait plus de doute, la victime était une femme.... Mais tout ceci fut rapide comme l’éclair; le bras, saisi vigoureusement par un des trois hommes, rentra sous le manteau; l’objet reprit l’apparence informe d’un fardeau quelconque; puis tout disparut à l’angle du bâtiment et dans l’ombre d’une allée de marronniers, qui conduisait au petit pavillon fermé que j’avais découvert la veille au milieu du massif de chênes.
Je n’avais pas pu reconnaître ces hommes; tout ce que j’en avais distingué, c’est qu’ils étaient vêtus en paysans: mais, s’ils étaient véritablement ce qu’ils paraissaient être, comment venaient-ils au château? comment s’étaient-ils procuré une clef de la grille? Était-ce un rapt? était-ce un assassinat? Je n’en savais rien. Mais certainement c’était l’un ou l’autre: tout cela, d’ailleurs, était si incompréhensible et si étrange, que parfois je me demandais si je n’étais pas sous l’empire d’un rêve; au reste, on n’entendait aucun bruit, la nuit poursuivait son cours calme et tranquille, et moi j’étais restée debout à la fenêtre, immobile de terreur, n’osant quitter ma place, de peur que le bruit de mes pas n’éveillât le danger, s’il en était qui me menaçât. Tout-à-coup je me rappelai cette porte dérobée, cet escalier mystérieux; il me sembla entendre un bruit sourd de ce côté; je m’élançai dans ma chambre, refermai et verrouillai la porte; puis j’allai retomber dans mon fauteuil sans remarquer que, pendant mon absence, une des deux bougies s’était éteinte.
Cette fois ce n’était plus une crainte vague et sans cause qui m’agitait, c’était quelque crime bien réel qui rôdait autour de moi et dont j’avais de mes yeux distingué les agens. Il me semblait à tout moment que j’allais voir s’ouvrir une porte cachée, ou entendre glisser quelque panneau inaperçu, tous ces petits bruits si distincts pendant la nuit et que cause un meuble qui craque ou un parquet qui se disjoint, me faisaient bondir d’effroi, et j’entendais, dans le silence, mon cœur battre à l’unisson du balancier de la pendule. A ce moment, la flamme de ma bougie consumée atteignit le papier qui l’entourait, une lueur momentanée se répandit par toute la chambre, puis s’en alla décroissante; un pétillement se fit entendre pendant quelques secondes; puis la mèche s’enfonçant dans la cavité du flambeau, s’éteignit tout-à-coup et me laissa sans autre lumière que celle du foyer.
Je cherchai des yeux autour de moi si j’avais du bois pour l’alimenter: je n’en aperçus point. Je rapprochai les tisons les uns des autres, et pour un moment le feu reprit une nouvelle ardeur; mais sa flamme tremblante n’était point une lumière propre à me rassurer: chaque objet était devenu mobile comme la lueur nouvelle qui l’éclairait, les portes se balançaient, les rideaux semblaient s’agiter, de longues ombres mouvantes passaient sur le plafond et sur les tapisseries. Je sentais que j’étais près de me trouver mal, et je n’étais préservée de l’évanouissement que par la terreur même; en ce moment, ce petit bruit qui précède le tintement de la pendule se fit entendre, et minuit sonna.
Cependant je ne pouvais passer la nuit entière dans ce fauteuil; je sentais le froid me gagner lentement. Je pris la résolution de me coucher tout habillée, je gagnai le lit sans regarder autour de moi, je me glissai sous la couverture, et je tirai le drap par-dessus ma tête. Je restai une heure à peu près ainsi sans songer même à la possibilité du sommeil. Je me rappellerai cette heure toute ma vie: une araignée faisait sa toile dans la boiserie de l’alcôve, et j’écoutais le travail incessant de l’ouvrière nocturne: tout-à-coup il cessa, interrompu par un autre bruit; il me sembla entendre le petit cri qu’avait fait, lorsque j’avais poussé le bouton de cuivre, la porte de la bibliothèque; je sortis vivement ma tête de la couverture, et, le cou raidi, retenant mon haleine, la main sur mon cœur pour l’empêcher de battre, j’aspirai le silence, doutant encore; bientôt je ne doutai plus.
Je ne m’étais pas trompée, le parquet craqua sous le poids d’un corps; des pas s’approchèrent et heurtèrent une chaise; mais sans doute celui qui venait craignit d’être entendu, car tout bruit cessa aussitôt, et le silence le plus absolu lui succéda. L’araignée reprit sa toile.... Oh! tous ces détails, voyez-vous!... tous ces détails, ils sont présens à ma mémoire comme si j’étais là encore, couchée sur ce lit et dans l’agonie de la terreur.
J’entendis de nouveau un mouvement dans la bibliothèque, on se remit en marche en s’approchant de la boiserie à laquelle était adossé mon lit; une main s’appuya contre la cloison: je n’étais plus séparée de celui qui venait ainsi que par l’épaisseur d’une planche. Je crus entendre glisser un panneau. Je me tins immobile et comme si je dormais: le sommeil était ma seule arme; le voleur, si c’en était un, comptant que je ne pourrais ni le voir ni l’entendre, m’épargnerait peut-être, jugeant ma mort inutile; mon visage tourné vers la tapisserie était dans l’ombre, ce qui me permit de garder les yeux ouverts. Alors je vis remuer mes rideaux, une main les écarta lentement; puis, encadrée dans leur draperie rouge, une tête pâle s’avança; en ce moment la dernière lueur du foyer, tremblante au fond de l’alcôve, éclaira cette apparition. Je reconnus le comte Horace, et je fermai les yeux!...
Lorsque je les rouvris, la vision avait disparu; quoique mes rideaux fussent encore agités, j’entendis le frôlement du panneau qui se refermait, puis le bruit décroissant des pas, puis le cri de la porte; enfin tout redevint tranquille et silencieux. Je ne sais combien de temps je restai ainsi sans haleine et sans mouvement; mais vers le commencement du jour à peu près, brisée par cette veille douloureuse, je tombai dans un engourdissement qui ressemblait au sommeil.
Je fus réveillée par le Malais, qui frappait à la porte que j’avais fermée en dedans; je m’étais couchée tout habillée, comme je vous l’ai dit; j’allai donc tirer les verrous, le domestique ouvrit mes volets, et je vis rentrer dans ma chambre le jour et le soleil. Je m’élançai vers la fenêtre.
C’était une de ces belles matinées d’automne où le ciel, avant de se couvrir de son voile de nuages, jette un dernier sourire à la terre; tout était si calme et si tranquille dans ce parc, que je commençai à douter presque de moi-même. Cependant les événemens de la nuit étaient demeurés bien vivans dans mon cœur; puis les lieux mêmes qu’embrassait ma vue me rappelaient leurs moindres détails. Je revoyais la grille qui s’était ouverte pour donner passage à ces trois hommes et à cette femme, l’allée qu’ils avaient suivie, les pas dont l’empreinte était restée sur le sable, plus visibles à l’endroit où la victime s’était débattue, car ceux qui l’emportaient s’étaient cramponnés avec force pour maîtriser ses mouvemens; ces pas suivaient la direction que j’ai déjà indiquée, et disparaissaient sous l’allée de tilleuls. Je voulus voir alors, pour renforcer encore, s’il était possible, le témoignage de mes sens, si quelques nouvelles preuves se joindraient à celle-ci; j’entrai dans la bibliothèque, le volet était à demi ouvert comme je l’avais laissé, une chaise renversée au milieu de la chambre était celle que j’avais entendue tomber; je m’approchai du panneau, et, regardant avec une attention profonde, je vis la rainure imperceptible sur laquelle il glissait; j’appuyai ma main sur la moulure, il céda; en ce moment on ouvrit la porte de ma chambre; je n’eus que le temps de repousser le panneau et de saisir un livre dans la bibliothèque.
C’était le Malais, il venait me chercher pour déjeuner, je le suivis.
En entrant dans la salle à manger je tressaillis de surprise; je comptais y trouver Horace, et non-seulement il n’y était pas, mais encore je ne vis qu’un couvert.—Le comte n’est-il point rentré? m’écriai-je.
Le Malais me fit signe que non.
—Non! murmurai-je stupéfaite.
—Non, répéta-t-il encore du geste. Je tombai sur ma chaise: le comte n’était pas rentré!... et cependant je l’avais vu, moi, il était venu à mon lit, il avait soulevé mes rideaux une heure après que ces trois hommes.... Mais ces trois hommes.., n’étaient-ce pas le comte et ses deux amis; Horace, Max et Henri, qui enlevaient une femme!... Eux seuls en effet pouvaient avoir la clef du parc, entrer ainsi librement sans être vus ni inquiétés; plus de doute, c’était cela. Voilà pourquoi le comte n’avait pas voulu me laisser venir au château; voilà pourquoi il m’avait reçue si froidement; voilà pourquoi il avait prétexté une partie de chasse. L’enlèvement de cette femme était arrêté avant mon arrivée; l’enlèvement était accompli. Le comte ne m’aimait plus, il aimait une autre femme, et cette femme était dans le château: dans le pavillon, sans doute!
Oui; et le comte, pour s’assurer que je n’avais rien vu, rien entendu, que j’étais enfin sans soupçons, était remonté par l’escalier de la bibliothèque, avait poussé la boiserie, écarté mes rideaux, et certain que je dormais, était retourné à ses amours. Tout m’était expliqué, clair et précis comme si je l’eusse vu. En un instant, ma jalousie avait percé l’obscurité, abattu les murailles; rien ne me restait plus à apprendre: je sortis, j’étouffais!
On avait déjà effacé la trace des pas; le râteau avait nivelé le sable. Je suivis l’allée de tilleuls, je gagnai le massif de chênes, je vis le pavillon, je tournai autour: il était clos et semblait inhabité, comme la veille. Je rentrai au château, je montai dans ma chambre, je me jetai dans cette bergère où la nuit précédente j’avais passé de si cruelles heures, et je m’étonnai de mon effroi!... C’était l’ombre, c’étaient les ténèbres, ou plutôt c’était l’absence d’une passion violente, qui avait ainsi affaibli mon cœur!...
Je passai une partie de la journée à me promener dans ma chambre, à ouvrir et fermer la fenêtre, attendant le soir avec autant d’impatience que j’avais, la veille, de crainte de le voir venir. On vint m’annoncer que le dîner était servi. Je descendis; je vis, comme le matin, un seul couvert, et près du couvert une lettre. Je reconnus l’écriture d’Horace, et je brisai vivement le cachet.
Il s’excusait auprès de moi de me laisser deux jours ainsi seule; mais il n’avait pu revenir, sa parole était engagée avant mon arrivée, et il avait dû la tenir, quoiqu’il lui en coûtât. Je froissai la lettre entre mes mains sans l’achever, et je la jetai dans ma cheminée; puis je m’efforçai de manger pour détourner les soupçons du Malais, et je remontai dans ma chambre.
Ma recommandation de la veille n’avait pas été oubliée: je trouvai grand feu; mais ce soir, ce n’était plus cela qui me préoccupait. J’avais tout un plan à arrêter; je m’assis pour réfléchir. Quant à la peur de la veille, elle était complétement oubliée!
Le comte Horace et ses amis étaient rentrés par la grille; car ces hommes, c’étaient bien eux et lui. Ils avaient conduit cette femme au pavillon; puis le comte était remonté par l’escalier dérobé pour s’assurer si j’étais bien endormie, et si je n’avais rien vu ni entendu. Je n’avais donc qu’à suivre l’escalier; à mon tour, je faisais le même chemin que lui, j’allais là d’où il était venu: j’étais décidée à suivre l’escalier.
Je regardai la pendule, elle marquait huit heures un quart; j’allai à mes volets, ils n’étaient pas fermés. Sans doute il n’y avait rien à voir cette nuit, puisque la précaution de la veille n’avait pas été prise: j’ouvris la fenêtre.
La nuit était orageuse, j’entendais le tonnerre au loin, et le bruit de la mer qui se brisait sur la plage venait jusqu’à moi. Il y avait dans mon cœur une tempête plus terrible que celle de la nature, et mes pensées se heurtaient dans ma tête plus sombres et plus pressées que les vagues de l’Océan. Deux heures s’écoulèrent ainsi sans que je fisse un mouvement, sans que mes yeux quittassent une petite statue perdue dans un massif d’arbres: il est vrai que je ne la voyais pas.
Enfin je pensai que le moment était venu: je n’entendais plus aucun bruit dans le château; cette même pluie qui, pendant cette même soirée du 27 au 28 septembre, vous fit chercher un abri dans les ruines, commençait à tomber par torrens: je laissai un instant ma tête exposée à l’eau du ciel, puis je rentrai, refermant ma fenêtre et repoussant mes volets.
Je sortis de ma chambre et fis quelques pas dans le corridor. Aucun bruit ne veillait dans le château; le Malais était couché sans doute, ou il servait son maître dans une autre partie de l’habitation. Je rentrai chez moi et je mis les verrous; il était dix heures et demie: on n’entendait que les plaintes de l’ouragan, dont le bruit me servait en couvrant celui que je pourrais faire. Je pris une bougie, et je m’avançai vers la porte de la bibliothèque: elle était fermée à clef!...
On m’y avait vue le matin, on craignait que je ne découvrisse l’escalier: on m’en avait clos l’issue. Heureusement que le comte avait pris la peine de m’en indiquer une autre.
Je passai derrière mon lit, je pressai la moulure mobile, la boiserie glissa, et je me trouvai dans la bibliothèque.
J’allai droit, d’un pas ferme et sans hésiter, à la porte dérobée; j’enlevai le volume qui cachait le bouton, je poussai le ressort, le panneau s’ouvrit.
Je m’engageai dans l’escalier; il offrait juste passage à une personne; je descendis trois étages. A chaque étage j’écoutai, je n’entendis rien.
Je me trouvai sous une voûte qui s’enfonçait hardiment et en droite ligne. Je la suivis pendant cinq minutes à peu près; puis je trouvai une troisième porte; comme la seconde, elle n’opposa aucune résistance; elle donnait sur un autre escalier pareil à celui de la bibliothèque, mais qui n’avait que deux étages. De celui-là on sortait par un panneau de fer carré: en l’entr’ouvrant j’entendis des voix. J’éteignis ma bougie, je la posai sur la dernière marche; puis je me glissai par l’ouverture: elle était produite par le déplacement d’une plaque de cheminée. Je la repoussai doucement, et je me trouvai dans une espèce de laboratoire de chimiste, très faiblement éclairé, la lumière de la chambre voisine ne pénétrant dans ce cabinet qu’au moyen d’une ouverture ronde, placée au haut d’une porte et voilée par un petit rideau vert. Quant aux fenêtres, elles étaient si soigneusement fermées, que, même pendant le jour, toute clarté extérieure devait être interceptée.
Je ne m’étais pas trompée lorsque j’avais cru entendre parler. La conversation était bruyante dans la chambre attenante: je reconnus la voix du comte et de ses amis. J’approchai une chaise de la porte, et je montai sur la chaise; de cette manière j’atteignis jusqu’au carreau, et ma vue plongea dans l’appartement.
Le comte Horace, Max et Henri étaient à table; pourtant l’orgie tirait à sa fin. Le Malais les servait, debout derrière le comte. Chacun des convives était vêtu d’une blouse bleue, portait un couteau de chasse à la ceinture, et avait une paire de pistolets à portée de sa main. Horace se leva comme pour s’en aller.
—Déjà? lui dit Max.
—Que voulez-vous que je fasse ici? répondit le comte.
—Bois! dit Henri en levant son verre.
—Le beau plaisir de boire avec vous, reprit le comte; à la troisième bouteille vous voilà ivres comme des portefaix.
—Jouons!...
—Je ne suis pas un filou pour vous gagner votre argent quand vous n’êtes pas en état de le défendre, dit le comte en haussant les épaules et en se tournant à demi.
—Eh bien! alors, fais la cour à notre belle Anglaise; ton domestique a pris ses précautions pour qu’elle ne soit pas cruelle. Sur ma parole, voilà un gaillard qui s’y entend. Tiens, mon brave.
Max donna au Malais une poignée d’or.
—Généreux comme un voleur! dit le comte.
—Voyons, voyons, ce n’est pas répondre, repartit Max en se levant à son tour. Veux-tu de la femme ou n’en veux-tu pas?
—Je n’en veux pas.
—Alors je la prends.
—Un instant! s’écria Henri en étendant la main; il me semble que je suis bien quelqu’un ou quelque chose ici, et que j’ai des droits comme un autre. Qu’est-ce qui a tué le mari?
—Au fait, c’est un antécédent, dit en riant le comte.
Un gémissement se fit entendre à ce mot. Je tournai les yeux du côté où il venait: une femme était étendue sur un lit à colonnes, les bras et les jambes liés aux quatre supports du baldaquin. Mon attention avait été tellement absorbée sur un seul point, que je ne l’avais pas aperçue d’abord.
—Oui, continua Max; mais qui les a attendus au Havre? qui est accouru ici à franc étrier pour vous avertir?
—Diable! fit le comte, voilà qui devient embarrassant, et il faudrait être le roi Salomon en personne pour décider qui a le plus de droits, de l’espion ou de l’assassin.
—Il faut pourtant que cela se décide, dit Max. Tu m’y as fait penser, à cette femme, et voilà que j’en suis amoureux maintenant.
—Et moi de même, dit Henri. Ainsi, puisque tu ne t’en soucies pas, toi, donne-la à celui de nous deux que tu voudras.
—Pour que l’autre m’aille dénoncer à la suite de quelque orgie où, comme aujourd’hui, il ne saura plus ce qu’il fait, n’est-ce pas? Oh! que non, messieurs. Vous êtes beaux, vous êtes jeunes, vous êtes riches, vous avez dix minutes pour lui faire la cour. Allez, mes don Juan.
—A la cour près, ce que tu viens de dire est une idée, répondit Henri. Qu’elle choisisse elle-même celui qui lui conviendra le mieux.
—Allons, soit, répondit Max; mais qu’elle se dépêche. Explique-lui cela, toi qui parles toutes les langues.
—Volontiers, dit Horace. Puis, se tournant vers la malheureuse femme:—Milady, lui dit-il dans l’anglais le plus pur, voici deux brigands de mes amis, tous deux de bonne famille, au reste, ce dont on peut vous donner la preuve sur parchemin, si vous le désirez, qui, élevés dans les principes de la secte platonique, c’est-à-dire du partage des biens, ont commencé par manger les leurs; puis, trouvant alors que tout était mal arrangé dans la société, ont eu la vertueuse idée de s’embusquer sur les grandes routes où elle passe, pour corriger ses injustices, rectifier ses erreurs et équilibrer ses inégalités. Depuis cinq ans, à la plus grande gloire de la philosophie et de la police, ils s’occupent religieusement de cette mission, qui leur donne de quoi figurer de la manière la plus honorable dans les salons de Paris, et qui les conduira, comme cela est arrivé pour moi, à quelque bon mariage qui les dispensera de continuer de faire les Karl Moor et les Jean Sbogar. En attendant, comme il n’y a dans ce château que ma femme, et que je ne veux pas la leur donner, ils vous supplient bien humblement de choisir, entre eux deux, celui qui vous conviendra le plus; faute de quoi, ils vous prendront tous les deux. Ai-je parlé en bon anglais, madame, et m’avez-vous compris?...
—Oh! si vous avez quelque pitié dans le cœur, s’écria la pauvre femme, tuez-moi! tuez-moi!
—Que répond-elle? murmura Max.
—Elle répond que c’est infâme, voilà tout, dit Horace; et j’avoue que je suis un peu de son avis.
—Alors... dirent ensemble Max et Henri en se levant.
—Alors, faites comme vous voudrez, répondit Horace; et il se rassit, se versa un verre de vin de Champagne et but.
—Oh! tuez-moi donc! tuez-moi donc! s’écria de nouveau la femme en voyant les deux jeunes gens prêts à s’avancer vers elle.
En ce moment, ce qu’il était facile de prévoir arriva: Max et Henri, échauffés par le vin, se trouvèrent face à face, et, poussés par le même désir, se regardèrent avec colère.
—Tu ne veux donc pas me la céder? dit Max.
—Non! répondit Henri.
—Eh bien! alors, je la prendrai.
—C’est ce qu’il faudra voir.
—Henri! Henri! dit Max en grinçant des dents, je te jure sur mon honneur que cette femme m’appartiendra!
—Et moi, je te promets sur ma vie qu’elle sera à moi; et je tiens plus à ma vie, je crois, que tu ne tiens à ton honneur.
Alors ils firent chacun un pas en arrière, tirèrent leurs couteaux de chasse et revinrent l’un contre l’autre.
—Mais, par grâce, par pitié, au nom du ciel, tuez-moi donc! cria pour la troisième fois la femme couchée.
—Qu’est-ce que vous venez de dire? s’écria Horace toujours assis, s’adressant aux deux jeunes gens d’un ton de maître.
—J’ai dit, répondit Max en portant un coup à Henri, que ce serait moi qui aurais cette femme.
—Et moi, reprit Henri, pressant à son tour son adversaire, j’ai dit que ce serait non pas lui, mais moi; et je maintiens ce que j’ai dit.
—Eh bien! murmura Horace, vous en avez menti tous les deux; vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre.
A ces mots, il prit sur la table un pistolet, le leva lentement dans la direction du lit et fit feu: la balle passa entre les combattans et alla frapper la femme au cœur.
A cette vue, je jetai un cri affreux et je tombai évanouie, et aussi morte en apparence que celle qui venait d’être frappée.
Lorsque je revins à moi j’étais dans le caveau: le comte, guidé par le cri que j’avais poussé et par le bruit de ma chute, m’avait sans doute trouvée dans le laboratoire, et, profitant de mon évanouissement, qui avait duré plusieurs heures, m’avait transportée dans cette tombe: il y avait près de moi, sur une pierre, une lampe, un verre, une lettre: le verre contenait du poison; quant à la lettre, je vais vous la dire:
—Hésitez-vous à me la montrer, m’écriai-je, et n’êtes-vous confiante qu’à demi?
—Je l’ai brûlée, me répondit Pauline; mais, soyez tranquille: je n’en ai pas oublié une parole.
«Vous avez voulu que la carrière du crime fût complète pour moi, Pauline: vous avez tout vu, tout entendu: je n’ai donc plus rien à vous apprendre: vous savez qui je suis, ou plutôt ce que je suis.
»Si le secret que vous avez surpris était à moi seul, si nulle autre vie que la mienne n’était en jeu, je la risquerais plutôt que de faire tomber un seul cheveu de votre tête. Je vous le jure, Pauline.
»Mais une indiscrétion involontaire, un signe d’effroi arraché à votre souvenir, un mot échappé dans vos rêves, peut conduire à l’échafaud non-seulement moi, mais encore deux autres hommes. Votre mort assure trois existences: il faut donc que vous mouriez.
»J’ai eu un instant l’idée de vous tuer pendant que vous étiez évanouie, mais je n’en ai pas eu le courage, car vous êtes la seule femme que j’aie aimée, Pauline: si vous aviez suivi mon conseil, ou plutôt obéi à mes ordres, vous seriez à cette heure près de votre mère. Vous êtes venue près de moi: ne vous en prenez donc qu’à vous de votre destinée.
»Vous vous réveillerez dans un caveau où nul n’est descendu depuis vingt ans, et dans lequel, d’ici à vingt ans peut-être, nul ne descendra encore. N’ayez donc aucun espoir de secours, car il serait inutile. Vous trouverez du poison près de cette lettre: tout ce que je puis faire pour vous est de vous offrir une mort prompte et douce au lieu d’une agonie lente et douloureuse. Dans l’un ou l’autre cas, et quelque parti que vous preniez, à compter de cette heure, vous êtes morte.
»Personne ne vous a vue, personne ne vous connaît; cette femme que j’ai tuée pour mettre Max et Henri d’accord sera ensevelie à votre place, ramenée à Paris dans les caveaux de votre famille, et votre mère pleurera sur elle, croyant pleurer sur son enfant.
»Adieu, Pauline. Je ne vous demande ni oubli ni miséricorde: il y a longtemps que je suis maudit, et votre pardon ne me sauverait pas.»
—C’est atroce! m’écriai-je; ô mon Dieu, mon Dieu! que vous avez dû souffrir!
—Oui. Aussi tout ce qui me resterait à vous raconter ne serait que mon agonie: ainsi donc....
—N’importe, m’écriai-je en l’interrompant, n’importe, dites-la.
—Je lus cette lettre deux ou trois fois: je ne pouvais pas me convaincre moi-même de sa réalité. Il y a des choses contre lesquelles la raison se révolte: on les a devant soi, sous la main, sous les yeux; on les regarde, on les touche, et l’on n’y croit pas. J’allai en silence à la grille; elle était fermée; je fis deux ou trois fois en silence le tour de mon caveau, frappant ses murs humides de mon poing incrédule; puis je revins m’asseoir en silence dans un angle de mon tombeau. J’étais bien enfermée; à la lueur de la lampe je voyais bien la lettre et le poison; cependant je doutais encore; je disais, comme on se le dit quelquefois en songe: Je dors, je vais m’éveiller.
Je restai ainsi assise et immobile jusqu’au moment où ma lampe se mit à pétiller. Alors une idée affreuse, qui ne m’était pas venue jusque là, me vint tout-à-coup; c’est qu’elle allait s’éteindre. Je jetai un cri de terreur et m’élançai vers elle: l’huile était presque épuisée. J’allais faire dans l’obscurité mon apprentissage de la mort.
Oh! que n’aurais-je pas donné pour avoir de l’huile à verser dans cette lampe. Si j’avais pu l’alimenter de mon sang, je me serais ouvert les veines avec mes dents. Elle pétillait toujours; à chaque pétillement, sa lumière était moins vive, et le cercle de ténèbres, qu’elle avait éloigné lorsqu’elle brillait dans toute sa force, se rapprochait graduellement de moi. J’étais près d’elle, à genoux, les mains jointes; je ne pensais pas à prier Dieu, je la priais, elle....
Enfin elle commença de lutter contre l’obscurité, comme j’allais bientôt moi-même commencer de lutter contre la mort. Peut-être l’animais-je de mes propres sentimens; mais il me semblait qu’elle se cramponnait à la vie, et qu’elle tremblait de laisser éteindre ce feu qui était son âme. Bientôt l’agonie arriva pour elle avec toutes ses phases: elle eut des lueurs brillantes, comme un moribond a des retours de force; elle jeta des clartés plus lointaines qu’elle n’avait jamais fait, comme au milieu de son délire l’esprit fiévreux voit quelquefois au-delà des limites assignées à la vue humaine; puis la langueur de l’épuisement leur succéda; la flamme vacilla pareille à ce dernier souffle qui tremble aux lèvres d’un mourant; enfin elle s’éteignit, emportant avec elle la clarté, qui est la moitié de la vie.
Je retombai dans l’angle de mon cachot. A compter de ce moment, je ne doutai plus: car, chose étrange, c’était depuis que j’avais cessé de voir la lettre et le poison que j’étais bien certaine qu’ils étaient là.
Tant que j’avais vu clair, je n’avais point fait attention au silence: dès que la lumière fut éteinte, il pesa sur mon cœur de tout le poids de l’obscurité. Au reste, il y avait quelque chose de si funèbre et de si profond, qu’eussé-je eu la chance d’être entendue, j’eusse hésité peut-être à crier. Oh! c’était bien un de ces silences mortuaires qui viennent s’asseoir pendant l’éternité sur la pierre des tombes.
Une chose bizarre, c’est que l’approche de la mort m’avait presque fait oublier celui qui la causait: je pensais à ma situation, j’étais absorbée dans ma terreur; mais je puis le dire, et Dieu le sait, si je ne pensai pas à lui pardonner, je ne songeai pas non plus à le maudire. Bientôt je commençai à souffrir de la faim.
Un temps que je ne pus calculer s’écoula, pendant lequel probablement le jour s’était éteint et la nuit était venue: car, lorsque le soleil reparut, un rayon, qui pénétrait par quelque gerçure du sol, vint éclairer la base d’un pilier. Je jetai un cri de joie, comme si ce rayon m’apportait un espoir.
Mes yeux se fixèrent sur ce rayon avec tant de persévérance, que je finis par distinguer parfaitement tous les objets répandus sur la surface qu’il éclairait: il y avait quelques pierres, un éclat de bois et une touffe de mousse: en revenant toujours à la même place, il avait fini par tirer de terre cette pauvre et débile végétation. Oh! que n’aurais-je pas donné pour être à la place de cette pierre, de cet éclat de bois et de cette mousse, afin de revoir le ciel encore une fois à travers cette ride de la terre.
Je commençai à éprouver une soif ardente et à sentir mes idées se confondre: de temps en temps des nuages sanglans passaient devant mes yeux, et mes dents se serraient comme dans une crise nerveuse; cependant j’avais toujours les yeux fixés sur la lumière. Sans doute elle entrait par une ouverture bien étroite, car lorsque le soleil cessa de l’éclairer en face, le rayon se ternit et devint à peine visible. Cette disparition m’enleva ce qui me restait de courage: je me tordis de rage et je sanglotai convulsivement.
Ma faim s’était changée en une douleur aiguë à l’estomac. La bouche me brûlait; j’éprouvais le désir de mordre; je mis une tresse de mes cheveux entre mes dents, et je la broyai. Bientôt je me sentis prise d’une fièvre sourde, quoique mon pouls battît à peine. Je commençai à penser au poison: alors je me mis à genoux et je joignis les mains pour prier; mais j’avais oublié mes prières: impossible de me rappeler autre chose que quelques phrases entrecoupées et sans suite. Les idées les plus opposées se heurtaient à la fois dans mon cerveau; un motif de musique de la Gazza bourdonnait incessamment à mes oreilles; je sentais moi-même que j’étais en proie à un commencement de délire. Je me laissai tomber tout de mon long et la face contre terre.
Un engourdissement, produit par les émotions et la fatigue que j’avais éprouvées, s’empara de moi: je m’assoupis, sans que le sentiment de ma position cessât de veiller en moi. Alors commença une série de rêves plus incohérens les uns que les autres. Ce sommeil douloureux, loin de me rendre quelque repos, me brisa. Je me réveillai avec une faim et une soif dévorantes: alors je pensai une seconde fois au poison qui était là près de moi, et qui pouvait me donner une fin douce et rapide. Malgré ma faiblesse, malgré mes hallucinations, malgré cette fièvre sourde qui frémissait dans mes artères, je sentais que la mort était encore loin, qu’il me faudrait l’attendre bien des heures, et que de ces heures les plus cruelles n’étaient point passées: alors je pris la résolution de revoir une fois encore ce rayon de jour qui, la veille, était venu me visiter, comme un consolateur qui se glisse dans le cachot du prisonnier. Je restai les yeux fixés vers l’endroit où il devait paraître: cette attente et cette préoccupation calmèrent un peu les souffrances atroces que j’éprouvais.
Le rayon désiré parut enfin. Je le vis descendre pâle et blafard: ce jour-là le soleil était voilé sans doute. Alors tout ce qu’il éclairait sur la terre se représentait à moi: ces arbres ces prairies, cette eau si belle; Paris, que je ne reverrais plus; ma mère, que j’avais quittée pour toujours, ma mère, qui déjà peut-être avait reçu la nouvelle de ma mort et qui pleurait sa fille vivante. A tous ces aspects et à tous ces souvenirs, mon cœur se gonfla, j’éclatai en sanglots et je fondis en pleurs: c’était la première fois depuis que j’étais dans ce caveau. Peu à peu le paroxysme se calma, mes sanglots s’éteignirent, mes larmes coulèrent silencieuses. Ma résolution était toujours prise de m’empoisonner; cependant je souffrais moins.
Je restai, comme la veille, les yeux sur ce rayon tant qu’il brilla; puis, comme la veille, je le vis pâlir et disparaître. Je le saluai de la main... et je lui dis adieu de la voix, car j’étais décidée à ne pas le revoir.
Alors je me repliai sur moi-même et me concentrai en quelque sorte dans mes dernières et suprêmes pensées. Je n’avais pas fait dans toute ma vie, comme jeune fille ou comme femme, une action mauvaise: je mourais sans aucun sentiment de haine ni sans aucun désir de vengeance: Dieu devait donc m’accueillir comme sa fille, la terre ne pouvait me manquer que pour le ciel. C’était la seule idée consolante qui me restât; je m’y attachai.
Bientôt il me sembla que cette idée se répandait non-seulement en moi, mais autour de moi; je commençai d’éprouver cet enthousiasme saint qui fait le courage des martyrs. Je me levai tout debout et la tête vers le ciel, et il me sembla que mes yeux perçaient la voûte, perçaient la terre et arrivaient jusqu’au trône de Dieu. En ce moment, mes douleurs mêmes étaient comprimées par l’exaltation religieuse; je marchai vers la pierre où était posé le poison, comme si je voyais au milieu des ténèbres; je pris le verre, j’écoutai si je n’entendais aucun bruit, je regardai si je ne voyais aucune lumière; je relus en souvenir cette lettre qui me disait que depuis vingt ans personne n’était descendu dans ce souterrain, et qu’avant vingt ans peut-être personne n’y descendrait encore; je me convainquis bien dans mon âme de l’impossibilité où j’étais d’échapper aux souffrances qui me restaient à endurer, je pris le verre de poison, je le portai à mes lèvres et je le bus, en mêlant ensemble, dans un dernier murmure de regret et d’espérance, le nom de ma mère, que j’allais quitter, et celui de Dieu que j’allais voir.
Puis je retombai dans l’angle de mon caveau; ma vision céleste s’était éteinte, le voile de la mort s’étendait entre elle et moi. Les douleurs de la faim et de la soif avaient reparu; à ces douleurs allaient se joindre celles du poison. J’attendais avec anxiété cette sueur de glace qui devait m’annoncer ma dernière agonie.... Tout-à-coup j’entendis mon nom; je rouvris les yeux et je vis de la lumière: vous étiez là, debout à la grille de ma tombe!... vous, c’est-à-dire le jour, la vie, la liberté.... Je jetai un cri et je m’élançai vers vous. Vous savez le reste.
Et maintenant, continua Pauline, je vous rappelle sur votre honneur le serment que vous m’avez fait de ne rien révéler de ce terrible drame tant que vivra encore un des trois principaux acteurs qui y ont joué un rôle.
Je le lui renouvelai.
La confidence que m’avait faite Pauline me rendait sa position plus sacrée encore. Je sentis dès lors toute l’étendue que devait acquérir ce dévoûment dont mon amour pour elle me faisait un bonheur; mais en même temps je compris quelle indélicatesse il y aurait de ma part à lui parler de cet amour autrement que par des soins plus empressés et des attentions plus respectueuses. Le plan convenu entre nous fut adopté; elle passa pour ma sœur et m’appela son frère: cependant j’obtins d’elle, en lui faisant comprendre la possibilité d’être reconnue par quelque personne qui l’aurait rencontrée dans les salons de Paris, qu’elle renonçât à l’idée de donner des leçons de langue et de musique. Quant à moi, j’écrivis à ma mère et à ma sœur que je comptais rester pendant un an ou deux en Angleterre. Pauline éleva encore quelques difficultés lorsque je lui fis part de cette décision; mais elle vit qu’il y avait pour moi un tel bonheur à l’accomplir, qu’elle n’eut plus le courage de m’en parler, et que cette résolution prit entre nous force de chose convenue.
Pauline avait hésité longtemps pour décider si elle révélerait ou ne révélerait pas son secret à sa mère, et si, morte pour tout le monde, elle serait vivante pour celle à qui elle devait la vie: moi-même je l’avais pressée de prendre ce parti, faiblement il est vrai: car il m’enlevait, à moi, cette position de protecteur qui me rendait si heureux à défaut d’un autre titre; mais Pauline, après y avoir réfléchi, avait repoussé, à mon grand étonnement, cette consolation, et quelques instances que je lui eusse faites pour connaître le motif de son refus, elle avait refusé de me le révéler, prétendant qu’il m’affligerait.
Cependant nos journées passaient ainsi, pour elle dans une mélancolie qui semblait parfois n’être point sans charmes, pour moi dans l’espérance, sinon dans le bonheur; car je la voyais de jour en jour se rapprocher de moi par tous les petits contacts du cœur, et, sans s’en apercevoir elle-même, elle me donnait des preuves lentes mais visibles du changement qui s’opérait en elle: si nous travaillions l’un et l’autre, elle à quelque ouvrage de broderie, moi à un dessin ou à une aquarelle, il m’arrivait souvent, en levant les yeux vers elle, de trouver les siens fixés sur moi: si nous sortions ensemble, l’appui qu’elle me demandait d’abord était celui d’une étrangère à un étranger; puis, au bout de quelque temps, soit faiblesse, soit abandon, je la sentais peser mollement à mon bras; si je sortais seul, presque toujours, en tournant le coin de la rue Saint-James, je l’apercevais de loin à la fenêtre, regardant du côté où elle savait que je devais venir: tous ces signes, qui pouvaient simplement être ceux d’une familiarité plus grande, et d’une reconnaissance plus continuelle, m’apparaissaient à moi comme des révélations d’une félicité à venir; je lui savais gré de chacun d’eux, et je l’en remerciais intérieurement, car je craignais, si je le faisais tout haut, de lui faire apercevoir à elle-même que son cœur prenait peu à peu l’habitude d’une amitié plus que fraternelle.
J’avais fait usage de mes lettres de recommandation, et, tout isolés que nous vivions, nous recevions parfois quelque visite: car nous devions fuir à la fois et le tumulte du monde et l’affectation de la solitude. Parmi nos connaissances les plus habituelles était un jeune médecin qui avait acquis, depuis trois ou quatre ans, à Londres, une grande réputation pour ses études profondes de certaines maladies organiques: chaque fois qu’il venait nous voir, il regardait Pauline avec une attention sérieuse, qui, après son départ, me laissait toujours quelques inquiétudes; en effet, ces belles et fraîches couleurs de la jeunesse dont j’avais vu son teint autrefois si riche, et dont j’avais d’abord attribué l’absence à la douleur et à la fatigue, n’avaient point reparu depuis la nuit où je l’avais trouvée mourante dans ce caveau, ou, si quelque teinte revenait colorer momentanément ses joues, c’était pour leur donner, tant qu’elle y demeurait, un aspect fébrile plus inquiétant que la pâleur elle-même. Il arrivait aussi parfois que tout-à-coup, sans cause comme sans régularité, elle éprouvait des spasmes qui la conduisaient à des évanouissemens, et que, pendant les jours qui suivaient ces accidens, une mélancolie plus profonde s’emparait d’elle. Enfin ils se renouvelèrent avec une telle fréquence et une gravité si visiblement croissante, qu’un jour que le docteur Sercey était venu nous faire une de ses visites habituelles, je l’arrachai aux préoccupations qu’éveillait toujours en lui la vue de Pauline, et lui prenant le bras, je descendis avec lui dans le jardin.
Nous fîmes plusieurs fois sans parler le tour de la petite pelouse; puis enfin nous vînmes nous asseoir sur le banc où Pauline m’avait raconté cette terrible histoire. Là, nous restâmes un moment pensifs; enfin j’allais rompre le silence, lorsque le docteur me prévint:
—Vous êtes inquiet sur la santé de votre sœur? me dit-il.
—Je l’avoue, répondis-je, et vous-même m’avez laissé apercevoir des craintes qui augmentent les miennes.
—Et vous avez raison, continua le docteur, elle est menacée d’une maladie chronique de l’estomac. A-t-elle éprouvé quelque accident qui ait pu altérer cet organe?
—Elle a été empoisonnée....
Le docteur réfléchit un instant.
—Oui, c’est bien cela, me dit-il, je ne m’étais point trompé: je vous prescrirai un régime qu’elle suivra avec une grande exactitude. Quant au côté moral du traitement, il dépend de vous; procurez à votre sœur le plus de distraction possible. Peut-être est-elle prise de la maladie du pays, et un voyage en France lui ferait-il du bien.
—Elle ne veut pas y retourner.
—Eh bien! une course en Écosse, en Irlande, en Italie, partout où elle voudra; mais je crois la chose nécessaire.
Je serrai la main du docteur, et nous rentrâmes. Quant à l’ordonnance, il devait me l’envoyer à moi-même. Je comptais, pour ne pas inquiéter Pauline, substituer sans rien dire le régime qui lui serait prescrit à notre manière de vivre ordinaire; mais cette précaution fut inutile; à peine le docteur nous eût-il quittés, que Pauline me prit la main.
—Il vous a tout avoué, n’est-ce pas? me dit-elle. Je fis semblant de ne pas comprendre, elle sourit tristement.—Eh bien! continua-t-elle, voilà pourquoi je n’ai pas voulu écrire à ma mère: à quoi bon lui rendre son enfant pour qu’un an ou deux après, la mort vienne la lui reprendre? C’est bien assez de pleurer une fois ceux qu’on aime.
—Mais, lui dis-je, vous vous abusez étrangement sur votre état: c’est une indisposition, et voilà tout.
—Oh! c’est plus sérieux que cela, répondit Pauline avec son même sourire doux et triste, et je sens que le poison a laissé des traces de son passage et que je suis atteinte gravement; mais écoutez-moi, je ne me refuse pas à espérer. Je ne demande pas mieux que de vivre: sauvez-moi une seconde fois, Alfred. Que voulez-vous que je fasse?
—Que vous suiviez les prescriptions du docteur: elles sont faciles; un régime simple mais continu, de la distraction, des voyages.
—Où voulez-vous que nous allions? je suis prête à partir.
—Choisissez vous-même le pays qui vous est le plus sympathique.
—L’Écosse, si vous voulez, puisque la moitié de la route est faite.
—L’Écosse, soit.
Je fis aussitôt mes préparatifs de départ, et trois jours après nous quittâmes Londres. Nous nous arrêtâmes un instant sur les bords de la Twed pour la saluer de cette belle imprécation que Schiller met dans la bouche de Marie Stuart:
«La nature jeta les Anglais et les Ecossais sur une planche étendue au milieu de l’Océan: elle la sépara en deux parties inégales, et voua ses habitans au combat éternel de sa possession. Le lit étroit de la Twed sépare seul les esprits irrités, et bien souvent le sang des deux peuples se mêla à ses eaux: la main sur la garde de leur épée, depuis mille ans ils se regardent et se menacent debout sur chaque rive: jamais ennemi n’opprima l’Angleterre, que l’Ecossais n’ait marché avec lui; jamais guerre civile n’embrasa les villes de l’Écosse, sans qu’un Anglais n’ait approché une torche de ses murailles, et cela durera ainsi, et la haine sera implacable et éternelle jusqu’au jour où un même parlement unira les deux ennemies comme deux sœurs, et où un seul sceptre s’étendra sur l’île tout entière.»
Nous entrâmes en Écosse.
Nous visitâmes, Walter Scott à la main, toute cette terre poétique que, pareil à un magicien qui évoque des fantômes, il a repeuplée de ses antiques habitans, auxquels il a mêlé les originales et gracieuses créations de sa fantaisie: nous retrouvâmes les sentiers escarpés que suivait, sur son bon cheval Gustave, le prudent Dalgetty. Nous côtoyâmes le lac sur lequel glissait, la nuit, comme une vapeur, la Dame blanche d’Avenel. Nous allâmes nous asseoir sur les ruines du château de Lochleven, à l’heure même où la reine d’Écosse s’en était échappée, et nous cherchâmes sur les bords de la Tay le champ clos où Torquil du Chêne vit tomber ses sept fils sous l’épée de l’armurier Smith, sans proférer d’autre plainte que ces mots, qu’il répéta sept fois: Encore un pour Eachar!...
Cette excursion sera éternellement pour moi un rêve de bonheur dont jamais n’approcheront les réalités de l’avenir: Pauline avait une de ces organisations impressionnables comme il en faut aux artistes, et sans laquelle un voyage n’est qu’un simple changement de localités, une accélération dans le mouvement habituel de la vie, un moyen de distraire son esprit par la vue même des objets qui devraient l’occuper: pas un souvenir historique ne lui échappait; pas une poésie de la nature, soit qu’elle se manifestât à nous dans la vapeur du matin ou le crépuscule du soir, n’était perdue pour elle. Quant à moi, j’étais sous l’empire d’un charme; jamais un seul mot des événemens accomplis n’avait été prononcé entre nous depuis l’heure où elle me les avait racontés; pour moi, le passé disparaissait parfois comme s’il n’avait jamais existé. Le présent seul qui nous réunissait était tout à mes yeux: jeté sur une terre étrangère, où je n’avais que Pauline, où Pauline n’avait que moi, les liens qui nous unissaient se resserraient chaque jour davantage par l’isolement; chaque jour je sentais que je faisais un pas dans son cœur, chaque jour un serrement de main, chaque jour un sourire, son bras appuyé sur mon bras, sa tête posée sur mon épaule, était un nouveau droit qu’elle me donnait sans s’en douter pour le lendemain; et plus elle s’abandonnait ainsi, plus, tout en aspirant chaque émanation naïve de son âme, plus je me gardais de lui parler d’amour, de peur qu’elle ne s’aperçût que depuis longtemps nous avions dépassé les limites de l’amitié.
Quant à la santé de Pauline, les prévisions du docteur s’étaient réalisées en partie; cette activité que le changement des lieux et les souvenirs qu’ils rappelaient entretenaient dans son esprit, détournait sa pensée des souvenirs tristes qui l’oppressaient aussitôt qu’aucun objet important ne venait l’en distraire. Elle-même commençait presque à oublier, et à mesure que les abîmes du passé se perdaient dans l’ombre, les sommets de l’avenir se coloraient d’un jour nouveau. Sa vie, qu’elle avait crue bornée aux limites d’un tombeau, commençait à reculer ses horizons moins sombres, et un air de plus en plus respirable venait se mêler à l’atmosphère étouffante au milieu de laquelle elle s’était sentie précipitée.
Nous passâmes l’été tout entier en Écosse; puis nous revînmes à Londres: nous y retrouvâmes notre petite maison de Piccadilly, et ce charme que l’esprit le plus enclin aux voyages éprouve dans les premiers momens d’un retour. Je ne sais ce qui se passait dans le cœur de Pauline, mais je sais que, quant à moi, je n’avais jamais été si heureux.
Quant au sentiment qui nous unissait, il était pur comme la fraternité: je n’avais pas, depuis un an, redit à Pauline que je l’aimais, depuis un an Pauline ne m’avait point fait le moindre aveu, et cependant nous lisions dans le cœur l’un de l’autre comme dans un livre ouvert, et nous n’avions plus rien à nous apprendre. Désirais-je plus que je n’avais obtenu?... Je ne sais; il y avait tant de charme dans ma position, que j’aurais peut-être craint qu’un bonheur plus grand ne la précipitât vers quelque dénoûment fatal et inconnu. Si je n’étais pas amant, j’étais plus qu’un ami, plus qu’un frère; j’étais l’arbre auquel, pauvre lierre, elle s’abritait, j’étais le fleuve qui emportait sa barque à mon courant, j’étais le soleil d’où lui venait la lumière; tout ce qui existait d’elle existait par moi, et probablement le jour n’était pas loin où ce qui existait par moi existerait aussi pour moi.
Nous en étions là de notre vie nouvelle, lorsqu’un jour je reçus une lettre de ma mère. Elle m’annonçait qu’il se présentait pour ma sœur un parti non-seulement convenable, mais avantageux: le comte Horace de Beuzeval, qui joignait à sa propre fortune vingt-cinq mille livres de rente qu’il avait héritées de sa première femme, mademoiselle Pauline de Meulien, demandait Gabrielle en mariage!...
Heureusement j’étais seul lorsque j’ouvris cette lettre, car ma stupéfaction m’eût trahi: cette nouvelle que je recevais n’était-elle pas bien étrange en effet, et quelque nouveau mystère de la Providence ne se cachait-il pas dans cette bizarre prédestination qui conduisait le comte Horace en face du seul homme dont il fût connu? Quelque empire que je fusse parvenu à prendre sur moi-même, Pauline ne s’en aperçut pas moins, en rentrant, qu’il m’était arrivé, pendant son absence, quelque chose d’extraordinaire; au reste, je n’eus pas de peine à lui donner le change, et, dès que je lui eus dit que des affaires de famille me forçaient de faire un voyage en France, elle attribua tout naturellement au chagrin de nous séparer l’abattement dans lequel elle me retrouvait. Elle-même pâlit et fut forcée de s’asseoir: c’était la première fois que nous nous éloignions l’un de l’autre depuis près d’un an que je l’avais sauvée; puis il y a, entre cœurs qui s’aiment, au moment d’une séparation, quoique en apparence courte et sans danger, de ces pressentimens intimes qui nous la font inquiétante et douloureuse, quelque chose que la raison dise pour nous rassurer.
Je n’avais pas une minute à perdre; j’avais donc décidé que je partirais le lendemain. Je montai chez moi pour faire quelques préparatifs indispensables. Pauline descendit au jardin, où j’allai la rejoindre aussitôt que ces apprêts furent terminés.
Je la vis assise sur le banc où elle m’avait raconté sa vie. Depuis ce temps, je l’ai dit, comme si elle eût été réellement endormie dans les bras de la mort, ainsi qu’on le croyait, aucun écho de la France n’était venu la réveiller, mais peut être approchait-elle du terme de cette tranquillité, et l’avenir pour elle allait-il douloureusement se rattacher à ce passé que tous mes efforts avaient eu pour but de lui faire oublier. Je la trouvai triste et rêveuse; je vins m’asseoir à son côté; ses premiers mots m’apprirent la cause de sa préoccupation.
—Ainsi vous partez? me dit-elle.
—Il le faut, Pauline, répondis-je d’une voix que je cherchais à rendre calme, vous savez mieux que personne qu’il y a des événemens qui disposent de nous, et qui nous enlèvent aux lieux que nous voudrions ne pas quitter d’une heure, comme le vent fait d’une feuille. Le bonheur de ma mère, de ma sœur, le mien même, dont je ne vous parlerais pas s’il était le seul compromis, dépendent de ma promptitude à faire ce voyage.
—Allez donc, reprit Pauline tristement; allez, puisqu’il le faut; mais n’oubliez pas que vous avez en Angleterre aussi une sœur qui n’a pas de mère, dont le seul bonheur dépend désormais de vous, et qui voudrait pouvoir quelque chose pour le vôtre!...
—Oh! Pauline! m’écriai-je en la pressant dans mes bras, dites-moi, doutez-vous un instant de mon amour? croyez-vous que je ne m’éloigne pas le cœur brisé? croyez-vous que le moment le plus heureux de ma vie ne sera pas celui où je rentrerai dans cette petite maison qui nous dérobe au monde tout entier?... Vivre avec vous de cette vie de frère et de sœur, avec l’espoir seulement de jours plus heureux encore, croyez-vous que ce n’était pas pour moi un bonheur plus grand que je n’avais jamais osé l’espérer?... oh! dites-moi, le croyez-vous?...
—Oui, je le crois, me répondit Pauline; car il y aurait de l’ingratitude à en douter. Votre amour a été pour moi si délicat et si élevé, que je puis en parler sans rougir, comme je parlerais d’une de vos vertus.... Quant à ce bonheur plus grand que vous espérez, Alfred, je ne le comprends pas!... Notre bonheur, j’en suis certaine, tient à la pureté même de nos relations; et plus ma position est étrange et sans pareille peut-être, plus je suis déliée de mes devoirs envers la société, plus, pour moi-même, je dois être sévère à les accomplir....
—Oh! oui... oui, lui dis-je, je vous comprends, et Dieu me punisse si j’essayais jamais de détacher une fleur de votre couronne de martyre pour y mettre en place un remords! mais enfin il peut arriver tels événemens qui vous fassent libre.... La vie même adoptée par le comte, pardon si je reviens sur ce sujet, l’expose plus que tout autre....
—Oh! oui... oui, je le sais.... Aussi, croyez-le bien, je n’ouvre jamais un journal sans frémir.... L’idée que je puis voir le nom que j’ai porté figurer dans quelque procès sanglant, l’homme que j’ai appelé mon mari menacé d’une mort infâme.... Eh bien!... que parlez-vous de bonheur dans ce cas-là, en supposant que je lui survécusse?...
—Oh! d’abord... et avant tout, Pauline, vous n’en seriez pas moins la plus pure comme la plus adorée des femmes.... N’a-t-il pas pris soin de vous mettre à l’abri de lui-même, si bien qu’aucune tache de sa boue ni de son sang ne peut vous atteindre?... Mais je ne voulais point parler de cela, Pauline! Dans une attaque nocturne, dans un duel même, le comte peut trouver la mort.... Oh! c’est affreux, je le sais, de n’avoir d’autre espérance de bonheur que celle qui doit couler de la blessure ou sortir de la bouche d’un homme avec son sang et son dernier soupir!... Mais enfin, pour vous-même... une telle fin ne serait-elle pas un bienfait du hasard... un oubli de la Providence?
—Eh bien?... dit en m’interrogeant Pauline.
—Eh bien! alors, Pauline, l’homme, qui, sans conditions, s’est fait votre ami, votre protecteur, votre frère, n’aurait-il pas droit à un autre titre?
—Mais cet homme a-t-il bien réfléchi à l’engagement qu’il prendrait en le sollicitant?
—Sans doute, et il y voit bien des promesses de bonheur sans y découvrir une cause d’effroi....
—A-t-il pensé que je suis exilée de France, que la mort du comte ne viendra pas rompre mon ban, et que les devoirs que je me suis imposés envers sa vie, je me les imposerai envers sa mémoire?...
—Pauline, lui dis-je, j’ai songé à tout.... L’année que nous venons de passer ensemble a été l’année la plus heureuse de ma vie. Je vous l’ai dit, je n’ai aucun lien réel qui m’attache sur un point du monde plutôt que sur un autre.... Le pays où vous serez sera ma patrie!
—Eh bien! me dit Pauline avec un si doux accent que mieux qu’une promesse il renfermait toutes les espérances,—revenez avec ces sentimens, laissons faire à l’avenir, et confions-nous en Dieu.
Je tombai à ses pieds et je baisai ses genoux.
La même nuit je quittai Londres; vers midi, j’arrivai au Havre; je pris aussitôt une voiture de poste et je partis; à une heure du matin j’étais chez ma mère.
Elle était en soirée avec Gabrielle. Je m’informai dans quelle maison: c’était chez lord G., ambassadeur d’Angleterre. Je demandai si ces dames étaient seules, on me répondit que le comte Horace était venu les prendre; je fis une toilette rapide, je me jetai dans un cabriolet de place, et je me fis conduire à l’ambassade.
Lorsque j’arrivai, beaucoup de personnes s’étaient déjà retirées; les salons commençaient à s’éclaircir; mais cependant il y restait encore assez de monde pour que j’y pénétrasse sans être remarqué. Bientôt j’aperçus ma mère assise et ma sœur dansant, l’une avec toute sa sérénité d’âme habituelle, l’autre avec une joie d’enfant. Je restai à la porte, je n’étais pas venu pour faire une reconnaissance au milieu d’un bal; d’ailleurs je cherchais encore une troisième personne, je présumais qu’elle ne devait pas être éloignée. En effet, mon investigation ne fut pas longue: le comte Horace était appuyé au lambris de la porte en face de laquelle je me trouvais moi-même.
Je le reconnus au premier abord: c’était bien l’homme que m’avait dépeint Pauline, c’était bien l’inconnu que j’avais entrevu aux rayons de la lune dans l’abbaye de Grand-Pré; je retrouvai tout ce que je cherchais en lui, sa figure pâle et calme, ses cheveux blonds qui lui donnaient cet air de première jeunesse, ses yeux noirs qui imprimaient à sa physionomie un caractère si étrange, enfin ce pli du front que depuis un an, à défaut de remords, les soucis avaient dû faire plus large et plus profond.
La contredanse finie, Gabrielle alla se rasseoir près de sa mère. Aussitôt je priai un domestique de dire à madame de Nerval et à sa fille que quelqu’un les attendait dans la salle des pelisses et des manteaux. Ma mère et ma sœur jetèrent un cri de surprise et de joie en m’apercevant. Nous étions seuls, je pus les embrasser. Ma mère n’osait en croire ses yeux qui me voyaient et ses mains qui me serraient contre son cœur. J’avais fait une telle diligence, qu’à peine pensait-elle que sa lettre m’était arrivée. En effet, la veille, à pareille heure, j’étais encore à Londres.
Ni ma mère ni ma sœur ne pensaient à rentrer dans les salons de danse; elles demandèrent leurs manteaux, s’enveloppèrent dans leurs pelisses et donnèrent l’ordre au domestique de faire avancer la voiture. Gabrielle dit alors quelques mots à l’oreille de ma mère:
—C’est juste! s’écria celle ci;—et le comte Horace....
—Demain je lui ferai une visite et vous excuserai près de lui, répondis-je.
—Le voilà, dit Gabrielle.
En effet, le comte avait remarqué que ces dames quittaient le salon; au bout de quelques minutes, ne les voyant pas reparaître, il s’était mis à leur recherche, et il venait de les retrouver prêtes à partir.
J’avoue qu’il me passa un frissonnement par tout le corps en voyant cet homme s’avancer vers nous. Ma mère sentit mon bras se crisper sous le sien, elle vit mes regards se croiser avec ceux du comte, et, avec cet instinct maternel qui devine tous les dangers, avant que ni l’un ni l’autre de nous deux eût ouvert la bouche:
—Pardon, dit-elle au comte, c’est mon fils que nous n’avions pas vu depuis près d’un an, et qui arrive de Londres.
Le comte s’inclina.
—Serai-je le seul, dit-il d’une voix douce, à m’affliger de ce retour, madame, et me privera-t-il du bonheur de vous reconduire?
—C’est probable, monsieur, répondis-je me contenant à peine; car, là où je suis, ma mère et ma sœur n’ont pas besoin d’autre cavalier.
—Mais c’est le comte Horace! me dit ma mère en se retournant vivement vers moi.
—Je connais monsieur, répondis-je avec un accent dans lequel j’avais essayé de mettre toutes les insultes.
Je sentis ma mère et ma sœur trembler à leur tour: le comte Horace devint affreusement pâle; cependant aucun autre signe que cette pâleur ne trahit son émotion. Il vit les craintes de ma mère, et avec un goût et une convenance qui me donnaient la mesure de ce que j’aurais peut-être dû faire moi-même, il s’inclina et sortit. Ma mère le suivit des yeux avec anxiété; puis, lorsqu’il eut disparu:
—Partons! partons! dit-elle en m’entraînant vers le perron.
Nous descendîmes l’escalier, nous montâmes en voiture, et nous rentrâmes à la maison sans avoir échangé une parole.
Cependant, on peut le comprendre facilement, nos cœurs étaient pleins de pensées différentes: aussi ma mère, à peine rentrée, fit-elle signe à Gabrielle de se retirer dans sa chambre. La pauvre enfant vint me présenter son front, comme elle avait l’habitude de le faire autrefois: mais à peine eut-elle senti mes lèvres la toucher et mes bras la serrer sur ma poitrine, qu’elle fondit en larmes. Alors ma vue, en s’abaissant sur elle, pénétra jusqu’à son cœur, et j’en eus pitié.
—Chère petite sœur, lui dis-je, il ne faut pas m’en vouloir des choses qui sont plus fortes que moi. C’est Dieu qui fait les événemens, et les événemens commandent aux hommes. Depuis que mon père est mort, je réponds de toi à toi-même; c’est à moi de veiller sur ta vie et de la faire heureuse.
—Oh! oui, oui, tu es le maître, me dit Gabrielle; ce que tu ordonneras, je le ferai, sois tranquille. Mais je ne puis m’empêcher de craindre sans savoir ce que je crains, et de pleurer sans savoir pourquoi je pleure.
—Rassure-toi, lui dis-je, le plus grand de tes dangers est passé maintenant, grâce au ciel, qui veillait sur toi. Remonte dans ta chambre, prie comme une jeune âme doit prier: la prière dissipe les craintes et sèche les pleurs. Va.
Gabrielle m’embrassa et sortit. Ma mère la suivit des yeux avec anxiété; puis, lorsque la porte fut refermée:
—Que signifie tout cela? me dit-elle.
—Cela signifie, ma mère, lui répondis-je d’un ton respectueux mais ferme, que ce mariage dont vous m’avez parlé est impossible, et que Gabrielle ne peut épouser le comte Horace.
—C’est que je suis presque engagée, dit ma mère.
—Je vous dégagerai, je m’en charge.
—Mais enfin, me diras-tu pourquoi, sans raison aucune?...
—Me croyez-vous donc assez insensé, interrompis-je, pour briser des choses aussi sacrées que la parole, si je n’avais pas de motifs de le faire?
—Mais tu me les diras, je pense?
—Impossible, impossible, ma mère; je suis lié par un serment.
—Je sais qu’on dit bien des choses contre Horace; mais on n’a rien pu prouver encore. Croirais-tu à toutes ces calomnies?
—Je crois mes yeux, ma mère, j’ai vu!...
—Oh!...
—Écoutez. Vous savez si je vous aime et si j’aime ma sœur; vous savez si, lorsqu’il s’agit de votre bonheur à toutes deux, je suis capable de prendre légèrement une résolution immuable; vous savez enfin si, dans une circonstance aussi suprême, je suis homme à vous effrayer par un mensonge; eh bien! ma mère, je vous le dis, je vous le jure, si ce mariage s’était fait, si je n’étais pas venu à temps, si mon père, en mon absence, n’était pas sorti de la tombe pour se placer entre sa fille et cet homme, si Gabrielle s’appelait à cette heure madame Horace de Beuzeval, il ne me resterait qu’une chose à faire, et je la ferais, croyez-moi: ce serait de vous enlever, vous et votre fille, de fuir la France avec vous pour n’y rentrer jamais, et d’aller demander à quelque terre étrangère l’oubli et l’obscurité, au lieu de l’infamie qui nous attendrait dans notre patrie.
—Mais ne peux-tu pas me dire?...
—Je ne puis rien dire... j’ai fait serment.... Si je pouvais parler, je n’aurais qu’à prononcer une parole, et ma sœur serait sauvée.
—Quelque danger la menace-t-il donc?
—Non, pas tant que je serai vivant du moins.
—Mon Dieu! mon Dieu! dit ma mère, tu m’épouvantes!
Je vis que je m’étais laissé emporter malgré moi.
—Écoutez, continuai-je: peut-être tout cela est-il moins grave que je ne le crains. Rien n’était arrêté positivement entre vous et le comte, rien n’était encore connu dans le monde; quelque bruit vague, quelques suppositions, n’est-ce pas, et rien de plus?
—C’était ce soir seulement la seconde fois que le comte nous accompagnait.
—Eh bien! ma mère, prenez le premier prétexte venu pour ne pas recevoir; fermez votre porte à tout le monde, au comte comme aux autres. Je me charge de lui faire comprendre que ses visites seraient inutiles.
—Alfred, dit ma mère effrayée, de la prudence surtout, des ménagemens, des procédés. Le comte n’est pas un homme que l’on congédie ainsi sans lui donner une raison plausible.
—Soyez tranquille, ma mère, j’y mettrai toutes les convenances nécessaires. Quant à une raison plausible, je lui en donnerai une.
—Agis comme tu voudras: tu es le chef de la famille, Alfred, et je ne ferai rien contre ta volonté; mais, au nom du ciel, mesure chacune des paroles que tu diras au comte, et, si tu refuses, adoucis le refus autant que tu pourras. Ma mère me vit prendre une bougie pour me retirer.—Oui, tu as raison, continua-t-elle: je ne pense pas à ta fatigue. Rentre chez toi, il sera temps de penser demain à tout cela. J’allai à elle et l’embrassai: elle me retint la main.—Tu me promets, n’est-ce pas, de ménager la fierté du comte?
—Je vous le promets, ma mère; et je l’embrassai une seconde fois et me retirai.
Ma mère avait raison, je tombais de fatigue. Je me couchai et dormis tout d’une traite jusqu’au lendemain dix heures du matin.
Je trouvai en me réveillant une lettre du comte: je m’y attendais. Cependant je n’aurais pas cru qu’il eût gardé tant de calme et de mesure: c’était un modèle de courtoisie et de convenances. La voici:
«Monsieur,
»Quelque désir que j’eusse de vous faire promptement parvenir cette lettre, je n’ai voulu vous l’adresser ni par un domestique ni par un ami. Ce mode d’envoi, qui est cependant généralement adopté en pareille circonstance, eût pu éveiller des inquiétudes parmi les personnes qui vous sont chères, et que vous me permettez, je l’espère, de regarder encore, malgré ce qui s’est passé hier chez lord G., comme ne m’étant ni étrangères ni indifférentes.
»Cependant, monsieur, vous comprendrez facilement que les quelques mots échangés entre nous demandent une explication. Serez-vous assez bon pour m’indiquer l’heure et le lieu où vous pourrez me la donner? La nature de l’affaire exige, je crois, qu’elle soit secrète et qu’elle n’ait d’autres témoins que les personnes intéressées; cependant, si vous le désirez, je conduirai deux amis.
»Je crois vous avoir donné la preuve hier que je vous regardais déjà comme un frère, croyez qu’il m’en coûterait beaucoup pour renoncer à ce titre, et qu’il me faudrait faire violence à toutes mes espérances et à tous mes sentimens pour vous traiter jamais en adversaire et en ennemi.
»Comte Horace.»
Je répondis aussitôt:
«Monsieur le comte,
»Vous ne vous étiez pas trompé, j’attendais votre lettre, et je vous remercie bien sincèrement des précautions que vous avez prises pour me la faire parvenir. Cependant, comme ces précautions seraient inutiles vis-à-vis de vous, et qu’il est important que vous receviez promptement ma réponse, permettez que je vous l’envoie par mon domestique.
»Ainsi que vous l’avez pensé, une explication est nécessaire entre nous; elle aura lieu, si vous le voulez bien, aujourd’hui même. Je sortirai à cheval et me promènerai de midi à une heure au bois de Boulogne, allée de la Muette. Je n’ai pas besoin de vous dire, monsieur le comte, que je serai enchanté de vous y rencontrer. Quant aux témoins, mon avis, parfaitement d’accord avec le vôtre, est qu’ils sont inutiles à cette première entrevue.
»Il ne me reste plus, monsieur, pour avoir répondu en tout point à votre lettre, qu’à vous parler de mes sentimens pour vous. Je désirerais bien sincèrement que ceux que je vous ai voués pussent m’être inspirés par mon cœur; malheureusement, ils me sont dictés par ma conscience.
»Alfred de Nerval.»
Cette lettre écrite et envoyée, je descendis près de ma mère: elle s’était effectivement informée si personne n’était venu de la part du comte Horace, et sur la réponse que lui avaient faite les domestiques, je la trouvai plus tranquille. Quant à Gabrielle, elle avait demandé et obtenu la permission de rester dans sa chambre. A la fin du déjeuner on m’amena le cheval que j’avais demandé. Mes instructions avaient été suivies, la selle était garnie de fontes: j’y plaçai d’excellens pistolets de duel tout chargés; je n’avais pas oublié qu’on m’avait prévenu que le comte Horace ne sortait jamais sans armes.
J’étais au rendez-vous à onze heures un quart, tant mon impatience était grande. Je parcourus l’allée dans toute sa longueur; en me retournant, j’aperçus un cavalier à l’autre extrémité: c’était le comte Horace. A peine chacun de nous eut-il reconnu l’autre, qu’il mit son cheval au galop; nous nous rencontrâmes au milieu de l’allée. Je remarquai que, comme moi, il avait des fontes à la selle de son cheval.
—Vous voyez, me dit le comte Horace en me saluant avec courtoisie et le sourire sur les lèvres, que mon désir de vous rencontrer était égal au vôtre, car tous deux nous avons devancé l’heure.
—J’ai fait cent lieues en un jour et une nuit pour avoir cet honneur, monsieur le comte, lui répondis-je en m’inclinant à mon tour; vous voyez que je ne suis point en reste.
—Je présume que les motifs qui vous ont ramené avec tant d’empressement ne sont point des secrets que je ne puisse entendre; et, quoique mon désir de vous connaître et de vous serrer la main m’eût facilement déterminé à faire une pareille course en moins de temps encore, s’il eût été possible, je n’ai pas la fatuité de croire que ce soit une pareille raison qui vous ait fait quitter l’Angleterre.
—Et vous croyez juste, monsieur le comte. Des intérêts plus puissans, des intérêts de famille, dans lesquels notre honneur était sur le point d’être compromis, ont été la cause de mon départ de Londres et de mon arrivée à Paris.
—Les termes dont vous vous servez, reprit le comte en s’inclinant de nouveau, et avec un sourire dont l’expression devenait de plus en plus amère, me font espérer que ce retour n’a point eu pour cause la lettre que vous a adressée madame de Nerval, et dans laquelle elle vous faisait part d’un projet d’union entre mademoiselle Gabrielle et moi.
—Vous vous trompez, monsieur, répondis-je en m’inclinant à mon tour; car je suis venu uniquement pour m’opposer à ce mariage, qui ne peut se faire.
Le comte pâlit et ses lèvres se serrèrent; mais presque aussitôt il reprit son calme habituel.
—J’espère, me dit-il, que vous apprécierez le sentiment qui m’ordonne d’écouter avec sang-froid les réponses étranges que vous me faites. Ce sang-froid, monsieur, est une preuve du désir que j’attache à votre alliance; et ce désir est tel que j’aurai l’indiscrétion de pousser l’investigation jusqu’au bout. Me ferez-vous l’honneur de me dire, monsieur, quelles sont les causes qui peuvent me valoir de votre part cette aveugle antipathie, que vous exprimez si franchement? Marchons, si vous voulez, l’un à côté de l’autre, et nous continuerons de causer.
Je mis mon cheval au pas du sien, et nous suivîmes l’allée avec l’apparence de deux amis qui se promènent.
—Je vous écoute, monsieur, reprit le comte.
—D’abord, permettez-moi, répondis-je, monsieur le comte, de rectifier votre jugement sur l’opinion que j’ai de vous: ce n’est point une antipathie aveugle, c’est un mépris raisonné.
Le comte se dressa sur ses étriers comme un homme arrivé au bout de sa patience; puis il passa la main sur son front, et, d’une voix où il était difficile de distinguer la moindre altération:
—De pareils sentimens sont assez dangereux, monsieur, pour qu’on ne les adopte et surtout qu’on ne les manifeste qu’après une connaissance parfaite de l’homme qui les a inspirés.
—Et qui vous dit que je ne vous connais pas parfaitement, monsieur? répondis-je en le regardant en face.
—Cependant, si ma mémoire ne m’abuse, reprit le comte, je vous ai rencontré hier pour la première fois.
—Et cependant le hasard, ou plutôt la Providence, nous avait déjà rapprochés; il est vrai que c’était la nuit, et que vous ne m’avez pas vu.
—Aidez mes souvenirs, dit le comte; je suis fort gauche aux énigmes.
—J’étais dans les ruines de l’abbaye de Grand-Pré pendant la nuit du 27 au 28 septembre.
Le comte tressaillit et porta la main à ses fontes: je fis le même mouvement; il s’en aperçut.
—Eh bien? reprit-il en se remettant aussitôt.
—Eh bien! je vous ai vu sortir du souterrain, je vous ai vu enfouir une clef.
—Et quelle détermination avez-vous prise à la suite de toutes ces découvertes?
—Celle de ne pas vous laisser assassiner mademoiselle Gabrielle de Nerval comme vous avez tenté d’assassiner mademoiselle Pauline de Meulien.
—Pauline n’est point morte! s’écria le comte arrêtant son cheval et oubliant, pour cette fois seulement, ce sang-froid infernal qui ne l’avait pas quitté d’une minute.
—Non, monsieur, Pauline n’est point morte, répondis-je en m’arrêtant à mon tour; Pauline vit, malgré la lettre que vous lui avez écrite, malgré le poison que vous lui avez versé, malgré les trois portes que vous avez fermées sur elle, et que j’ai rouvertes, moi, avec cette clef que je vous avais vu enfouir. Comprenez-vous maintenant?
—Parfaitement, monsieur, reprit le comte la main cachée dans une de ses fontes; mais ce que je ne comprends pas, c’est que, possédant ces secrets et ces preuves, vous ne m’ayez pas tout bonnement dénoncé.
—C’est que j’ai fait un serment sacré, monsieur, et que je suis obligé de vous tuer en duel comme si vous étiez un honnête homme. Ainsi laissez là vos pistolets, car, en m’assassinant, vous pourriez gâter votre affaire.
—Vous avez raison, répondit le comte en boutonnant ses fontes et en remettant son cheval au pas. Quand nous battons-nous?
—Demain matin, si vous le voulez, repris-je en lâchant la bride du mien.
—Parfaitement. Où cela?
—A Versailles, si le lieu vous plaît.
—Très bien. A neuf heures je vous attendrai à la pièce d’eau des Suisses avec mes témoins.
—Messieurs Max et Henri, n’est-ce pas?...
—Avez-vous quelque chose contre eux?
—J’ai que je veux bien me battre avec un assassin, mais que je ne veux pas qu’il prenne pour seconds ses deux complices. Cela se passera autrement, si vous le permettez.
—Faites vos conditions, monsieur, dit le comte en se mordant les lèvres jusqu’au sang.
—Comme il faut que notre rencontre reste un secret pour tout le monde, quelque résultat qu’elle puisse avoir, nous choisirons chacun nos témoins parmi les officiers de la garnison de Versailles, pour qui nous resterons inconnus; ils ignoreront la cause du duel, et ils y assisteront seulement pour prévenir l’accusation de meurtre. Cela vous convient-il?
—A merveille, monsieur. Maintenant, vos armes?
—Maintenant, monsieur, comme nous pourrions nous faire avec l’épée quelque pauvre et mesquine égratignure, qui nous empêcherait peut-être de continuer le combat, le pistolet me paraît préférable. Apportez votre boîte, j’apporterai la mienne.
—Mais, répondit le comte, nous avons tous deux nos armes, toutes nos conditions sont arrêtées: pourquoi remettre à demain une affaire que nous pourrions terminer aujourd’hui même?
—Parce que j’ai quelques dispositions à prendre pour lesquelles ce délai m’est nécessaire. Il me semble que je me conduis à votre égard de manière à obtenir cette concession. Quant à la crainte qui vous préoccupe, soyez parfaitement tranquille, monsieur, je vous répète que j’ai fait un serment.
—Cela suffit, monsieur, répondit le comte en s’inclinant: à demain, neuf heures.
—A demain, neuf heures.
Nous nous saluâmes une dernière fois, et nous nous éloignâmes au galop, gagnant chacun une extrémité de la route.
En effet, le délai que j’avais demandé au comte n’était point plus long qu’il ne me le fallait pour mettre ordre à mes affaires; aussi, à peine rentré chez moi, je m’enfermai dans ma chambre.
Je ne me dissimulai pas que les chances du combat où j’étais engagé étaient hasardeuses; je connaissais le sang-froid et l’adresse du comte, je pouvais donc être tué; en ce cas-là j’avais à assurer la position de Pauline.
Quoique dans tout ce que je viens de te raconter je n’aie pas une fois prononcé son nom, continua Alfred, je n’ai pas besoin de te dire que son souvenir ne s’était pas éloigné un instant de ma pensée. Les sentimens qui s’étaient réveillés en moi lorsque j’avais revu ma sœur et ma mère s’étaient placés près du sien, mais sans lui porter atteinte; et je sentis combien je l’aimais, au sentiment douloureux qui me saisit lorsque, prenant la plume, je pensai que je lui écrivais pour la dernière fois peut-être. La lettre achevée, j’y joignis un contrat de rentes de 10,000 francs, et je mis le tout sous enveloppe, à l’adresse du docteur Sercey, Grosvenor-Square, à Londres.
Le reste de la journée et une partie de la nuit se passèrent en préparatifs de ce genre; je me couchai à deux heures du matin en recommandant à mon domestique de me réveiller à six.
Il fut exact à la consigne donnée: c’était un homme sur lequel je savais pouvoir compter, un de ces vieux serviteurs comme on en trouve dans les drames allemands, que les pères lèguent à leurs fils et que j’avais hérité de mon père. Je le chargeai de la lettre adressée au docteur, avec ordre de la porter lui-même à Londres, si j’étais tué. Deux cents louis que je lui laissai étaient destinés, en ce cas, à le défrayer de son voyage; dans le cas contraire, il les garderait à titre de gratification. Je lui montrai, en outre, le tiroir où étaient renfermés, pour lui être remis si la chance m’était fatale, les derniers adieux que j’adressais à ma mère; il devait, de plus, me tenir une voiture de poste prête jusqu’à cinq heures du soir, et si, à cinq heures je n’étais pas revenu, partir pour Versailles et s’informer de moi. Ces précautions prises, je montai à cheval; à neuf heures moins un quart j’étais au rendez-vous avec mes deux témoins: c’étaient, comme la chose avait été arrêtée, deux officiers de hussards qui m’étaient totalement inconnus, et qui cependant n’avaient point hésité à me rendre le service que je demandais d’eux. Il leur avait suffi de savoir que c’était une affaire dans laquelle l’honneur d’une famille recommandable était compromis, pour qu’ils acceptassent sans faire une seule question. Il n’y a que les Français pour être tout à la fois, et selon les circonstances, les plus bavards ou les plus discrets de tous les hommes.
Nous attendions depuis cinq minutes à peine, lorsque le comte arriva avec ses seconds; nous nous mîmes en quête d’un endroit convenable, et nous ne tardâmes pas à le trouver, grâce à nos témoins, habitués à découvrir ce genre de localité. Arrivés sur le terrain, nous fîmes part à ces messieurs de nos conditions, et nous les priâmes d’examiner les armes; c’était, de la part du comte, des pistolets de Lepage, et de ma part, à moi, des pistolets de Devismes, les uns et les autres à double détente et du même calibre, comme sont, au reste, presque tous les pistolets de duel.
Le comte alors ne démentit point sa réputation de bravoure et de courtoisie; il voulut me céder tous les avantages, mais je refusai. Il fut donc décidé que le sort réglerait les places et l’ordre dans lequel nous ferions feu; quant à la distance, elle fut fixée à vingt pas; les limites étaient marquées pour chacun de nous par un second pistolet tout chargé, afin que nous pussions continuer le combat dans les mêmes conditions, si ni l’une ni l’autre des deux premières balles n’était mortelle.
Le sort favorisa le comte deux fois de suite: il eut d’abord le choix des places, puis la priorité: il alla aussitôt se placer en face du soleil, adoptant de son plein gré la position la plus désavantageuse: je lui en fis la remarque, mais il s’inclina, en répondant que, puisque le hasard l’avait fait maître d’opter, il désirait garder le côté qu’il avait choisi: j’allai prendre la mienne à la distance convenue.
Les témoins chargeaient nos armes, j’eus donc le temps d’examiner le comte, et, je dois le dire, il garda constamment l’attitude froide et calme d’un homme parfaitement brave: pas un geste, pas un mot ne lui échappa qui ne fût dans les convenances. Bientôt les témoins se rapprochèrent de nous, nous présentèrent à chacun un pistolet, placèrent l’autre à nos pieds, et s’éloignèrent. Alors le comte me renouvela une seconde fois l’invitation de tirer le premier: une seconde fois je refusai. Nous nous inclinâmes chacun vers nos témoins pour les saluer; puis je m’apprêtai à essuyer le feu, m’effaçant autant que possible, et me couvrant le bas de la figure avec la crosse de mon pistolet, dont le canon retombait sur ma poitrine dans le vide formé entre l’avant-bras et l’épaule. J’avais à peine pris cette précaution, que les témoins nous saluèrent à leur tour, et que le plus vieux donna le signal en disant: «Allez, messieurs.» Au même instant je vis briller la flamme, j’entendis le coup du pistolet du comte, et je sentis une double commotion à la poitrine et au bras: la balle avait rencontré le canon du pistolet, et, en déviant, m’avait traversé les chairs de l’épaule. Le comte parut étonné de ne pas me voir tomber.
—Vous êtes blessé? me dit-il en faisant un pas en avant.
—Ce n’est rien, répondis-je en prenant mon pistolet de la main gauche. A mon tour, monsieur. Le comte jeta le pistolet déchargé, reprit l’autre et se remit en place.
Je visai lentement et froidement, puis je fis feu. Je crus d’abord que je ne l’avais pas touché, car il resta immobile, et je lui vis lever le second pistolet; mais, avant que le canon n’arrivât à ma hauteur, un tremblement convulsif s’empara de lui; il laissa échapper l’arme, voulut parler, rendit une gorgée de sang et tomba raide mort: la balle lui avait traversé la poitrine.
Les témoins s’approchèrent d’abord du comte, puis revinrent à moi. Il y avait parmi eux un chirurgien-major: je le priai de donner ses soins à mon adversaire, que je croyais plus blessé que moi.
—C’est inutile, me répondit-il en secouant la tête, il n’a plus besoin des soins de personne.
—Ai-je fait en homme d’honneur, messieurs? leur demandai-je.
Ils s’inclinèrent en signe d’adhésion.
—Alors, docteur, ayez la bonté, dis-je en défaisant mon habit, de me mettre la moindre chose sur cette égratignure, afin d’arrêter le sang, car il faut que je parte à l’instant même.
—A propos, me dit le plus vieux des officiers, comme le chirurgien achevait de me panser, où faudra-t-il faire porter le corps de votre ami?
—Rue de Bourbon, no 16, répondis-je en souriant malgré moi de la naïveté de ce brave homme, à l’hôtel de monsieur de Beuzeval.
A ces mots, je sautai sur mon cheval, qu’un hussard tenait en main avec celui du comte, et, remerciant une dernière fois ces messieurs de leur bonne et loyale assistance, je les saluai de la main et je repris au galop la route de Paris.
Il était temps que j’arrivasse; ma mère était au désespoir: ne me voyant pas descendre à l’heure du déjeuner, elle était montée dans ma chambre, et dans un des tiroirs de mon secrétaire elle avait trouvé la lettre qui lui était adressée.
Je la lui arrachai des mains et la jetai au feu avec celle qui était destinée à Pauline, puis je l’embrassai comme on embrasse une mère qu’on a manqué de ne plus revoir et que l’on va quitter sans savoir quand on la reverra.
Huit jours après la scène que je viens de te raconter, continua Alfred, nous étions dans notre petite maison de Piccadilly, assis et déjeunant de chaque côté d’une table à thé, lorsque Pauline, qui lisait une gazette anglaise, pâlit tout-à-coup affreusement, laissa tomber le journal, poussa un cri et s’évanouit. Je sonnai violemment, les femmes de chambre accoururent; nous la transportâmes chez elle; et, tandis qu’on la déshabillait, je descendis pour envoyer chercher le docteur et voir sur le journal la cause de son évanouissement. A peine l’eus-je ouvert, que mes yeux tombèrent sur ces lignes traduites du Courrier français.
«Nous recevons à l’instant les détails les plus singuliers et les plus mystérieux sur un duel qui vient d’avoir lieu à Versailles, et qui paraissait emprunter ses causes aux motifs inconnus d’une haine violente.
»Avant hier matin, 5 août 1833, deux jeunes gens qui paraissaient appartenir à l’aristocratie parisienne arrivèrent dans notre ville, chacun de son côté, à cheval et sans domestique. L’un se rendit à la caserne de la rue Royale, l’autre au café de la Régence; là, prière fut faite par eux à deux officiers de les accompagner sur le terrain. Chacun des combattans avait apporté ses armes; les conditions de la rencontre furent réglées, et les adversaires, placés à vingt pas de distance, firent feu l’un sur l’autre; l’un des deux est mort sur le coup, l’autre, dont on ignore le nom, est reparti à l’instant même pour Paris, malgré une blessure grave, la balle de son ennemi lui ayant traversé les chairs de l’épaule.
»Celui des deux qui a succombé se nomme le comte Horace de Beuzeval; on ignore le nom de son adversaire.»
Pauline avait lu cet article, et l’effet qu’il avait produit sur elle avait été d’autant plus grand, qu’aucune précaution ne l’y avait préparée. Depuis mon retour, je n’avais point prononcé le nom de son mari devant elle; et, il y a plus, quoique je sentisse la nécessité de lui faire connaître, un jour ou l’autre, l’accident qui la rendait libre, tout en lui laissant ignorer la cause de sa liberté, je ne m’étais encore arrêté à aucun mode de révélation, bien éloigné que j’étais de penser que les journaux prendraient les devans sur ma prudence et lui annonceraient brutalement et violemment ainsi une nouvelle qui demandait, pour être dite, à elle surtout dont la santé était toujours chancelante, plus de ménagemens encore qu’à toute autre femme.
En ce moment le docteur entra; je lui dis qu’une émotion violente venait d’amener chez Pauline une nouvelle crise. Nous remontâmes ensemble chez elle; la malade était toujours évanouie, malgré l’eau qu’on lui avait jetée au visage et les sels qu’on lui avait fait respirer. Le docteur parla de la saigner, et commença les préparatifs de cette opération; alors le courage me manqua, et, tremblant comme une femme, je me sauvai dans le jardin.
Là, je restai une demi-heure à-peu-près, la tête appuyée dans mes mains et le front brisé par mille pensées qui se heurtaient dans mon esprit. Dans tout ce qui venait de se passer j’avais suivi passivement le double intérêt de ma haine pour le comte et de mon amitié pour ma sœur; je détestais cet homme du jour où il m’avait enlevé tout mon bonheur en épousant Pauline, et le besoin d’une vengeance personnelle, le désir de rendre le mal physique en échange de la douleur morale m’avait emporté comme malgré moi; j’avais voulu tuer ou être tué, voilà tout. Maintenant que la chose était accomplie, j’en voyais se dérouler toutes les conséquences.
On me frappa sur l’épaule, c’était le docteur.
—Et Pauline! m’écriai-je en joignant les mains.
—Elle a repris connaissance.
Je me levai pour courir à elle, le docteur m’arrêta.
—Écoutez, continua-t-il: l’accident qui vient de lui arriver est grave; elle a besoin avant tout de repos.... N’entrez pas dans sa chambre en ce moment.
—Et pourquoi cela? lui dis-je.
—Parce qu’il est important qu’elle n’éprouve aucune émotion violente. Je ne vous ai jamais fait de question sur votre position vis-à-vis d’elle, je ne vous demande pas de confidence; vous l’appelez votre sœur: êtes-vous ou n’êtes-vous pas son frère, cela ne me regarde point comme homme, mais cela m’importe beaucoup comme médecin. Votre présence, votre voix même ont sur Pauline une influence visible.... Je l’ai toujours remarqué, et tout-à-l’heure encore, comme je tenais sa main, votre nom seul prononcé accéléra d’une manière sensible le mouvement de son pouls. J’ai défendu que personne entrât dans son appartement aujourd’hui, que moi et ses femmes de chambre; n’allez pas contre mon ordonnance.
—Est-ce donc dangereux? m’écriai-je.
—Tout est dangereux pour une organisation ébranlée comme l’est la sienne: il aurait fallu que je pusse donner à cette femme un breuvage qui lui fît oublier le passé; il y a en elle quelque souvenir, quelque chagrin, quelque regret qui la dévore.
—Oui, oui, répondis-je, rien ne vous est caché, et vous avez tout vu avec les yeux de la science.... Non, ce n’est pas ma sœur, non, ce n’est pas ma femme, non, ce n’est pas ma maîtresse; c’est un être angélique que j’aime au-dessus de tout, à qui cependant je ne puis rendre le bonheur, et qui mourra dans mes bras avec sa couronne de vierge et de martyre!... Je ferai ce que vous voudrez, docteur, je n’entrerai que lorsque vous me le permettrez, je vous obéirai comme un enfant; mais quand vous reverrai-je?
—Je reviendrai dans la journée....
—Et moi, que vais-je faire, mon Dieu?...
—Allons, du courage!... Soyez homme....
—Si vous saviez comme je l’aime!...
Le docteur me serra la main, je le reconduisis jusqu’à la porte, puis je restai immobile à l’endroit où il m’avait quitté. Enfin je sortis de cette apathie; je montai machinalement les escaliers; je m’approchai de sa porte, et, n’osant pas entrer, j’écoutai. Je crus d’abord que Pauline dormait; mais bientôt quelques sanglots étouffés parvinrent jusqu’à mon oreille je mis la main sur la clef. Alors je me rappelai ma promesse, et, pour ne pas y manquer, je m’élançai hors de la maison, je sautai dans la première voiture venue, et je me fis conduire à Regent’s-Park.
J’errai deux heures à peu-près, comme un fou, au milieu des promeneurs, des arbres et des statues; puis je revins. Je rencontrai sur la porte un domestique qui sortait en courant; il allait chercher le docteur; Pauline avait éprouvé une nouvelle crise nerveuse, à la suite de laquelle le délire s’était emparé d’elle. Cette fois je n’y pus pas tenir, je me précipitai dans sa chambre, je me jetai à genoux et je pris sa main qui pendait hors du lit; elle ne parut pas s’apercevoir de ma présence; sa respiration était entrecoupée et haletante, elle avait les yeux fermés, et quelques mots sans suite et sans raison s’échappaient fièvreusement de sa bouche. Le docteur arriva.
—Vous ne m’avez pas tenu parole, me dit-il.
—Hélas! elle ne m’a pas reconnu! lui répondis-je.
Néanmoins, au son de ma voix, je sentis sa main tressaillir. Je cédai ma place au docteur, il s’approcha du lit, tâta le pouls de la malade et déclara qu’une seconde saignée était nécessaire. Cependant, malgré le sang tiré, l’agitation alla toujours croissant; le soir une fièvre cérébrale s’était déclarée.
Pendant huit jours et huit nuits, Pauline resta en proie à ce délire affreux, ne reconnaissant personne, se croyant toujours menacée et appelant sans cesse à son aide; puis le mal commença à perdre de son intensité, une faiblesse extrême, une prostration complète de forces, succéda à cette exaltation insensée. Enfin, le matin du neuvième jour, en rouvrant les yeux après un sommeil un peu plus tranquille, elle me reconnut et prononça mon nom. Ce qui se passa en moi alors est impossible à décrire; je me jetai à genoux, la tête appuyée contre son lit, et je me mis à pleurer comme un enfant. En ce moment le docteur entra, et craignant pour elle les émotions, il exigea que je me retirasse; je voulus résister; mais Pauline me serra la main, en me disant d’une voix douce:
—Allez!...
J’obéis. Il y avait huit jours et huit nuits que je ne m’étais couché, je me mis au lit, et, un peu rassuré sur son état, je m’endormis d’un sommeil dont j’avais presque autant besoin qu’elle.
En effet, la maladie inflammatoire disparut peu à peu, et au bout de trois semaines il ne restait plus à Pauline qu’une grande faiblesse; mais pendant ce temps la maladie chronique dont elle avait déjà été menacée un an auparavant avait fait des progrès. Le docteur nous conseilla le remède qui l’avait déjà guérie, et je résolus de profiter des derniers beaux jours de l’année pour parcourir avec elle la Suisse et de là gagner Naples, où je comptais passer l’hiver. Je fis part de ce projet à Pauline: elle sourit tristement de l’espoir que je fondais sur cette distraction; puis, avec une soumission d’enfant, elle consentit à tout. En conséquence, vers les premiers jours de septembre, nous partîmes pour Ostende: nous traversâmes la Flandre, remontâmes le Rhin jusqu’à Bâle; nous visitâmes les lacs de Bienne et de Neuchâtel, nous nous arrêtâmes quelques jours à Genève; enfin nous parcourûmes l’Oberland, nous franchîmes le Brunig, et nous venions de visiter Altorf, lorsque tu nous rencontras, sans pouvoir nous joindre, à Fluélen, sur les bords du lac des Quatre-Cantons.
Tu comprends maintenant pourquoi nous ne pûmes t’attendre: Pauline, en voyant ton intention de profiter de notre barque, m’avait demandé ton nom, et s’était rappelé t’avoir rencontré plusieurs fois, soit chez madame la comtesse M..., soit chez la princesse Bel... A la seule idée de se retrouver en face de toi, son visage prit une telle expression d’effroi, que j’en fus effrayé, et que j’ordonnai à mes bateliers de s’éloigner à force de rames, quelque chose que tu dusses penser de mon impolitesse.
Pauline se coucha au fond de la barque, je m’assis près d’elle, et elle appuya sa tête sur mes genoux. Il y avait juste deux ans qu’elle avait quitté la France ainsi souffrante et appuyée sur moi. Depuis ce temps, j’avais tenu fidèlement l’engagement que j’avais pris: j’avais veillé sur elle comme un frère, je l’avais respectée comme une sœur, toutes les préoccupations de mon esprit avaient eu pour but de lui épargner une douleur ou de lui ménager un plaisir; tous les désirs de mon âme avaient tourné autour de l’espérance d’être aimé un jour par elle. Quand on a vécu longtemps près d’une personne, il y a de ces idées qui vous viennent à tous deux en même temps. Je vis ses yeux se mouiller de larmes, elle poussa un soupir, et, me serrant la main qu’elle tenait entre les siennes:
—Que vous êtes bon! me dit-elle.
Je tressaillis de la sentir répondre aussi complétement à ma pensée.
—Trouvez-vous que j’aie fait ce que je devais faire? lui dis-je.
—Oh! vous avez été pour moi l’ange gardien de mon enfance, qui s’était envolé un instant, et que Dieu m’a rendu sous le nom d’un frère!
—Eh bien! en échange de ce dévoùment, ne ferez-vous rien pour moi?
—Hélas! que puis-je maintenant pour votre bonheur? dit Pauline; vous aimer?... Alfred, en face de ce lac, de ces montagnes, de ce ciel, de toute cette nature sublime, en face de Dieu qui les a faits, oui, Alfred, je vous aime! Je ne vous apprends rien de nouveau en vous disant cela.
—Oh! oui, oui, je le sais, lui répondis-je; mais ce n’est point assez de m’aimer, il faut que votre vie soit attachée à la mienne par des liens indissolubles; il faut que cette protection, que j’ai obtenue comme une faveur, devienne pour moi un droit.
Elle sourit tristement.
—Pourquoi souriez-vous ainsi? lui dis-je.
—C’est que vous voyez toujours l’avenir de la terre, et moi l’avenir du ciel.
—Encore!... lui dis-je.
—Pas d’illusions, Alfred: ce sont les illusions qui rendent les douleurs amères et inguérissables. Si j’avais conservé quelque illusion, moi, croyez-vous que je n’eusse point fait connaître à ma mère que j’existais encore? Mais alors il m’aurait fallu quitter encore une seconde fois ma mère et vous, et c’eût été trop. Aussi ai-je eu d’avance pitié de moi-même et me suis-je privée d’une grande joie pour m’épargner une suprême douleur.
Je fis un mouvement de prière.
—Je vous aime! Alfred, me répéta-t-elle: je vous redirai ce mot tant que ma bouche pourra prononcer deux paroles; ne me demandez rien de plus, et veillez vous-même à ce que je ne meure pas avec un remords....
Que pouvais-je dire, que pouvais-je faire en face d’une telle conviction? prendre Pauline dans mes bras et pleurer avec elle sur la félicité que Dieu aurait pu nous accorder et sur le malheur que la fatalité nous avait fait.
Nous demeurâmes quelques jours à Lucerne, puis nous partîmes pour Zurich; nous descendîmes le lac et nous arrivâmes à Pfeffers. Là nous comptions nous arrêter une semaine ou deux; j’espérais que les eaux thermales feraient quelque bien à Pauline. Nous allâmes visiter la source féconde sur laquelle je basais cette espérance. En revenant, nous te rencontrâmes sur ce pont étroit, dans ce souterrain sombre: Pauline te toucha presque, et cette nouvelle rencontre lui donna une telle émotion, qu’elle voulut partir à l’instant même. Je n’osai insister, et nous prîmes sur-le-champ la route de Constance.
Il n’y avait plus à en douter pour moi-même, Pauline s’affaiblissait d’une manière visible. Tu n’as jamais éprouvé, tu n’éprouveras jamais, je l’espère, ce supplice atroce de sentir un cœur qu’on aime cesser lentement de vivre sous votre main, de compter chaque jour, le doigt sur l’artère, quelques battemens fiévreux de plus, et de se dire, chaque fois que, dans un sentiment réuni d’amour et de douleur, on presse sur sa poitrine ce corps adoré, qu’une semaine, quinze jours, un mois encore, peut-être, cette création de Dieu, qui vit, qui pense, qui aime, ne sera plus qu’un froid cadavre sans parole et sans amour!
Quant à Pauline, plus le temps de notre séparation semblait s’approcher, plus on eût dit qu’elle avait amassé pour ces derniers momens les trésors de son esprit et de son âme. Sans doute mon amour poétise ce crépuscule de sa vie; mais, vois-tu, ce dernier mois qui s’écoula entre le moment où nous te rencontrâmes à Pfeffers et celui où, du haut de la terrasse d’une auberge, tu laissas tomber au bord du lac Majeur ce bouquet d’oranger dans notre calèche, ce dernier mois sera toujours présent à ma pensée, comme a dû l’être à l’esprit des prophètes l’apparition des anges qui leur apportaient la parole du Seigneur.
Nous arrivâmes ainsi à Arona. Là, quoique fatiguée, Pauline semblait si bien renaître aux premières bouffées de ce vent d’Italie, que nous ne nous arrêtâmes qu’une nuit; car tout mon espoir était maintenant de gagner Naples. Cependant le lendemain elle était tellement souffrante, qu’elle ne put se lever que fort tard, et qu’au lieu de continuer notre route en voiture, je pris un bateau pour atteindre Sesto-Calende. Nous nous embarquâmes vers les cinq heures du soir. A mesure que nous nous approchions, nous voyions aux derniers rayons tièdes et dorés du soleil la petite ville, couchée aux pieds des collines, et sur ces collines ses délicieux jardins d’orangers, de myrtes et de lauriers-roses. Pauline les regardait avec un ravissement qui me rendit quelque espoir que ses idées étaient moins tristes.
—Vous pensez qu’il serait bien doux de vivre dans ce délicieux pays? lui demandai-je.
—Non, répondit-elle: je pense qu’il serait moins douloureux d’y mourir. J’ai toujours rêvé les tombes ainsi, continua Pauline, placées au milieu d’un beau jardin embaumé, entourées d’arbustes et de fleurs. On ne s’occupe pas assez, chez nous, de la dernière demeure de ceux qu’on aime: on pare leur lit d’un jour, et on oublie leur couche de l’éternité!... Si je mourais avant vous, Alfred, reprit-elle en souriant, après un moment de silence, et que vous fussiez assez généreux pour continuer à la mort les soins de la vie, je voudrais que vous vous souvinssiez de ce que je viens de vous dire.
—Oh! Pauline! Pauline! m’écriai-je en la prenant dans mes bras et en la serrant convulsivement contre mon cœur, ne me parlez pas ainsi, vous me tuez.
—Eh bien! non, me répondit-elle; mais je voulais vous dire cela, mon ami, une fois pour toutes; car je sais qu’une fois que je vous l’aurai dit, vous ne l’oublierez jamais. Non, vous avez raison, ne parlons plus de cela.... D’ailleurs, je me sens mieux; Naples me fera du bien. Il y a longtemps que j’ai envie de voir Naples....
—Oui, continuai-je en l’interrompant, oui, nous y serons bientôt. Nous prendrons pour cet hiver une petite maison à Sorrente ou à Résina; vous y passerez l’hiver, réchauffée au soleil, qui ne s’éteint pas; puis, au printemps, vous reviendrez à la vie avec toute la nature.... Qu’avez-vous? mon Dieu!...
—Oh! que je souffre! dit Pauline en se raidissant et en portant sa main à sa poitrine. Vous le voyez, Alfred, la mort est jalouse même de nos rêves, et elle m’envoie la douleur pour nous réveiller!...
Nous demeurâmes en silence jusqu’au moment où nous abordâmes. Pauline voulut marcher; mais elle était si faible, que ses genoux plièrent. Il commençait à faire nuit; je la pris dans mes bras et je la portai jusqu’à l’hôtel.
Je me fis donner une chambre près de la sienne. Depuis longtemps il y avait entre nous quelque chose de saint, de fraternel et de sacré qui faisait qu’elle s’endormait sous mes yeux comme sous ceux d’une mère. Puis, voyant qu’elle était plus souffrante que je ne l’avais vue encore, et désespérant de pouvoir continuer notre route le lendemain, j’envoyai un exprès en poste, dans ma voiture, pour aller chercher à Milan et ramener à Sesto le docteur Scarpa.
Je remontai près de Pauline: elle était couchée; je m’assis au chevet de son lit. On eût dit qu’elle avait quelque chose à me demander et qu’elle n’osait le faire. Pour la vingtième fois, je surpris son regard fixé sur moi avec une expression inouïe de doute.
—Que voulez-vous? lui dis-je; vous désirez m’interroger et vous n’osez pas le faire. Voilà déjà plusieurs fois que je vous vois me regarder ainsi: ne suis-je pas votre ami, votre frère?
—Oh! vous êtes bien plus que tout cela, me répondit-elle, et il n’y a pas de nom pour dire ce que vous êtes. Oui, oui, un doute me tourmente, un doute horrible! Je l’éclaircirai plus tard... dans un moment où vous n’oserez pas me mentir; mais l’heure n’est pas encore venue. Je vous regarde pour vous voir le plus possible... je vous regarde, parce que je vous aime!
Je pris sa tête et je la posai sur mon épaule. Nous restâmes ainsi une heure à peu près, pendant laquelle je sentis son souffle haletant mouiller ma joue, et son cœur bondir contre ma poitrine. Enfin elle m’assura qu’elle se sentait mieux et me pria de me retirer. Je me levai pour lui obéir, et, comme d’habitude, j’approchais ma bouche de son front, lorsqu’elle me jeta les bras autour du cou, et appuyant ses lèvres sur les miennes: Je t’aime! murmura-t-elle dans un baiser, et elle retomba la tête sur son lit. Je voulus la prendre dans mes bras; mais elle me repoussa doucement, et sans rouvrir les yeux: Laisse-moi, mon Alfred, me dit-elle: je t’aime!... je suis bien... je suis heureuse!...
Je sortis de la chambre; je n’aurais pas pu y rester dans l’état d’exaltation où ce baiser fiévreux m’avait mis. Je rentrai chez moi; je laissai la porte de communication entr’ouverte, afin de courir près de Pauline au moindre bruit; puis, au lieu de me coucher, je me contentai de mettre bas mon habit, et j’ouvris la fenêtre pour chercher un peu de fraîcheur.
Le balcon de ma chambre donnait sur ces jardins enchantés que nous avions vus du lac en nous approchant de Sesto. Au milieu des touffes de citronniers et des massifs de lauriers-roses, quelques statues debout sur leurs piédestaux se détachaient aux rayons de la lune, blanches comme des ombres. A force de fixer les yeux sur une d’elles, ma vue se troubla, il me sembla la voir s’animer et qu’elle me faisait signe de la main en me montrant la terre. Bientôt cette illusion fut si grande, que je crus m’entendre appeler; je portai mes deux mains à mon front, car il me semblait que je devenais fou. Mon nom, prononcé une seconde fois d’une voix plus plaintive, me fit tressaillir; je rentrai dans ma chambre et j’écoutai; une troisième fois mon nom arriva jusqu’à moi, mais plus faible. La voix venait de l’appartement à côté, c’était Pauline qui m’appelait, je m’élançai dans sa chambre.
C’était bien elle... elle, expirante, et qui n’avait pas voulu mourir seule, et qui, voyant que je ne lui répondais pas, était descendue de son lit pour me chercher dans son agonie; elle était à genoux sur le parquet... Je me précipitai vers elle, voulant la prendre dans mes bras, mais elle me fit signe qu’elle avait quelque chose à me demander. Puis, ne pouvant parler et sentant qu’elle allait mourir, elle saisit la manche de ma chemise, l’arracha avec ses mains, mit à découvert la blessure à peine refermée, que trois mois auparavant m’avait faite la balle du comte Horace, et me montrant du doigt la cicatrice, elle poussa un cri, se renversa en arrière et ferma les yeux.
Je la portai sur son lit, et je n’eus que le temps d’approcher mes lèvres des siennes pour recueillir son dernier souffle et ne pas perdre son dernier soupir.
La volonté de Pauline fut accomplie; elle dort dans un de ces jardins qui dominent le lac, au milieu du parfum des orangers et sous l’ombrage des myrtes et des lauriers-roses.
—Je le sais, répondis-je à Alfred, car je suis arrivé à Sesto quatre jours après que tu l’avais quitté; et, sans savoir qui elle renfermait, j’ai été prier sur sa tombe.

Vers cette même époque, c’est-à-dire dans le courant de l’année 1834, lord S. amena un soir le général italien W. T. chez Grisier.
Sa présentation fit événement. Le général T. était non-seulement un homme distingué comme instruction et comme courage, mais encore la part qu’il avait prise à deux événemens politiques importans en faisait un personnage historique. Ces deux événemens étaient le procès de Murat en 1815 et la révolution de Naples en 1820.
Nommé membre de la commission militaire qui devait juger l’ex-roi Joachim, le général T., alors simple capitaine, avait été envoyé au Pizzo, et, seul parmi tous ses collègues, il avait osé voter contre la peine de mort. Cette conduite avait été considérée comme une trahison, et le capitaine T., menacé à son tour d’un procès, en fut quitte à grand’peine, pour la perte de son grade et un exil de deux ans à Lipari.
Il était de retour à Naples depuis trois ans, lorsque la révolution de 1820 éclata. Il s’y jeta avec, toute l’ardeur de son courage et toute la conscience de ses opinions. Le vicaire général du royaume, le prince François, qui succéda depuis à son père Ferdinand, avait lui-même paru céder franchement au mouvement révolutionnaire; et un des motifs de la confiance que lui accordèrent alors grand nombre de patriotes fut le choix qu’il fit du capitaine T. pour commander une division de l’armée qui marcha contre les Autrichiens.
On sait comment finit cette campagne. Le général T., abandonné par ses soldats, rentra l’un des derniers à Naples; il y fut suivi de près par les Autrichiens. Le prince François, fort de leur présence, jugea qu’il était inutile de dissimuler plus longtemps, et il exila, comme rebelles et coupables de haute trahison, ceux dont il avait signé les brevets trois semaines auparavant.
Cependant la proscription n’avait pas été si prompte, que le général n’eût eu le temps, un soir qu’il prenait une glace au café de Tolède, de recevoir une impertinence et de rendre un soufflet. Le souffleté était un colonel autrichien, qui exigea une satisfaction que le général ne demandait pas mieux que de lui accorder. Le colonel fit toutes les conditions, le général n’en discuta aucune; il en résulta que les préliminaires de l’affaire furent promptement réglés; la rencontre fut fixée au lendemain. Elle devait avoir lieu à cheval et au sabre.
Le lendemain, à l’heure dite, les adversaires se trouvèrent au rendez-vous; mais, soit que les témoins se fussent mal expliqués, soit que le général eût oublié l’une des deux conditions du combat, il arriva en fiacre.
Les témoins proposèrent au colonel de se battre à pied; mais il n’y voulut pas consentir. Le général détela alors un des chevaux du fiacre; monta dessus sans selle et sans bride, et à la troisième passe, tua le colonel.
Ce duel fit grand honneur au courage et au sang-froid du général T.; mais il ne raccommoda point ses affaires. Huit jours après, il reçut l’ordre de quitter Naples: il n’y est pas rentré depuis.
On devine quelle bonne fortune ce fut pour nous qu’une pareille recrue; cependant nous y mîmes de la discrétion. Sa première visite se passa en conversation générale; à la seconde, nous hasardâmes quelques questions; à la troisième, son fleuret, grâce à notre importunité, ne lui servit plus qu’à nous tracer des plans de bataille sur le mur ou sur le plancher.
Parmi tous ces récits, il en était un que je désirais plus particulièrement connaître dans tous ses détails; c’était celui des circonstances qui avaient précédé les derniers instans et accompagné la mort de Murat. Ces détails étaient toujours restés pour nous, sous la restauration, couverts d’un voile que les susceptibilités royales, plus encore que la distance des lieux, rendaient difficile à soulever; puis la révolution de juillet était venue, et tant d’événemens nouveaux avaient surgi qu’ils avaient presque fait oublier les anciens. L’ère des souvenirs impériaux était passée depuis que ces souvenirs avaient cessé d’être de l’opposition. Il en résultait que si je perdais cette occasion d’interroger la tradition vivante, je courais grand risque d’être obligé de m’en rapporter à l’histoire officielle, et je savais trop comment celle-ci se fait, pour y avoir recours en pareille occasion. Je laissai donc chacun satisfaire sa curiosité aux dépens de la patience du général T., me promettant de retenir pour moi tout ce qui lui en resterait de disponible après la séance.
En effet, je guettai sa sortie, et comme nous avions même route à faire, je le reconduisis par le boulevard, et là, seul à seul, j’osai risquer des questions plus intimes sur le fait qui m’intéressait. Le général vit mon désir, et comprit dans quel but je me hasardais à le lui manifester. Alors, avec cette obligeance parfaite que lui savent tous ceux qui l’ont connu:
—Écoutez, me dit-il, de pareils détails ne peuvent se communiquer de vive voix et en un instant; d’ailleurs, ma mémoire me servît-elle au point que je n’en oubliasse aucun, la vôtre pourrait bien être moins fidèle; et, si je ne m’abuse, vous ne voulez rien oublier de ce que je vous dirai.
Je lui fis signe en riant que non.
—Eh bien! continua-t-il, je vous enverrai demain un manuscrit; vous le déchiffrerez comme vous pourrez, vous le traduirez, si bon vous semble; vous le publierez, s’il en mérite la peine; la seule condition que je vous demande, c’est que vous n’y mettiez pas mon nom en toutes lettres, attendu que je serais sûr de ne jamais rentrer à Naples. Quant à l’authenticité, je vous la garantis, car le récit qu’il contient a été rédigé ou sur mes propres souvenirs ou sur des pièces officielles.
C’était plus que je ne pouvais demander; aussi remerciai-je le général, et lui donnai-je une preuve de l’empressement que j’aurais à le lire en lui faisant promettre formellement de me l’envoyer le lendemain.
Le général promit et me tint parole.
C’est donc le manuscrit d’un témoin oculaire, traduit dans toute son énergique fidélité, que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs.
Le 18 juin 1815, à l’heure même où les destinées de l’Europe se décidaient à Waterloo, un homme habillé en mendiant suivait silencieusement la route de Toulon à Marseille. Arrivé à l’entrée des gorges d’Ollioulles, il s’arrêta sur une petite éminence qui lui permettait de découvrir tout le paysage qui l’entourait: alors, soit qu’il fût parvenu au terme de son voyage, soit qu’avant de s’engager dans cet âpre et sombre défilé, qu’on appelle les Thermopyles de la Provence, il voulût jouir encore quelque temps de la vue magnifique qui se déroulait à l’horizon méridional, il alla s’asseoir sur le talus du fossé qui bordait la grande route, tournant le dos aux montagnes qui s’élèvent en amphithéâtre au nord de la ville, et ayant par conséquent à ses pieds une riche plaine, dont la végétation asiatique rassemble, comme dans une serre, des arbres et des plantes inconnus au reste de la France. Au delà de cette plaine resplendissante des derniers rayons du soleil, s’étendait la mer, calme et unie comme une glace, et à la surface de l’eau glissait légèrement un seul brick de guerre, qui, profitant d’une fraîche brise de terre, lui ouvrait toutes ses voiles, et, poussé par elles, gagnait rapidement la mer d’Italie. Le mendiant le suivit avidement des yeux, jusqu’au moment où il disparut entre la pointe du cap de Gien et la première des îles d’Hyères, puis, dès que la blanche apparition se fut effacée, il poussa un profond soupir, laissa retomber son front entre ses mains, et resta immobile et absorbé dans ses réflexions, jusqu’au moment où le bruit d’une cavalcade le fit tressaillir; il releva aussitôt la tête, secoua ses longs cheveux noirs, comme s’il voulait faire tomber de son front les amères pensées qui l’accablaient, et fixant les yeux vers l’entrée des gorges, du côté d’où venait le bruit, il en vit bientôt sortir deux cavaliers qu’il reconnut sans doute; car aussitôt, se relevant de toute sa hauteur, il laissa tomber le bâton qu’il tenait à la main, croisa les bras et se tourna vers eux. De leur côté, les nouveaux arrivans l’eurent à peine aperçu qu’ils s’arrêtèrent, et que celui qui marchait le premier descendit de cheval, jeta la bride au bras de son compagnon, et mettant le chapeau à la main, quoiqu’il fût à plus de cinquante pas de l’homme aux haillons, s’avança respectueusement vers lui; le mendiant le laissa approcher d’un air de dignité sombre et sans faire un seul mouvement; puis, lorsqu’il ne fut plus qu’à une faible distance:
—Eh bien! monsieur le maréchal, lui dit-il, avez-vous reçu des nouvelles?
—Oui, sire, répondit tristement celui qui l’interrogeait.
—Et quelles sont-elles?...
—Telles que j’eusse préféré que tout autre que moi les annonçât à votre majesté....
—Ainsi l’empereur refuse mes services! il oublie les victoires d’Aboukir, d’Eylau, de la Moskowa?
—Non, sire; mais il se souvient du traité de Naples, de la prise de Reggio et de la déclaration de guerre au vice-roi d’Italie.
Le mendiant se frappa le front.
—Oui, oui, à ses yeux peut-être ai je mérité ces reproches; mais il me semble cependant qu’il devrait se rappeler qu’il y eut deux hommes en moi, le soldat dont il a fait son frère, et son frère dont il a fait un roi.... Oui, comme frère, j’eus des torts et de grands torts envers lui; mais comme roi, sur mon âme! je ne pouvais faire autrement.... Il me fallait choisir entre mon sabre et ma couronne, entre un régiment et un peuple!... Tenez, Brune, vous ne savez pas comment la chose s’est passée! Il y avait une flotte anglaise dont le canon grondait dans le port; il y avait une population napolitaine qui hurlait dans les rues. Si j’avais été seul, j’aurais passé avec un bateau au milieu de la flotte, avec mon sabre au milieu de la foule; mais j’avais une femme, des enfans. Cependant j’ai hésité, l’idée que l’épithète de traître et de transfuge s’attacherait à mon nom m’a fait verser plus de larmes que ne m’en coûtera jamais la perte de mon trône, et peut-être la mort des êtres que j’aime le plus.... Enfin, il ne veut pas de moi, n’est-ce pas?... Il me refuse comme général, comme capitaine, comme soldat?... Que me reste-t-il donc à faire?
—Sire, il faut que votre majesté sorte à l’instant de France[1].
—Et si je n’obéissais pas?
—Mes ordres sont alors de vous arrêter et de vous livrer à un conseil de guerre!
—Ce que tu ne ferais pas, n’est-ce pas, mon vieux camarade?
—Ce que je ferais, en priant Dieu de me frapper de mort au moment où j’étendrais la main sur vous!
—Je vous reconnais là, Brune; vous avez pu rester brave et loyal, vous! Il ne vous a pas donné un royaume, il ne vous a pas mis autour du front ce cercle de feu qu’on appelle une couronne et qui rend fou; il ne vous a pas placé entre votre conscience et votre famille. Ainsi il me faut quitter la France, recommencer la vie errante, dire adieu à Toulon qui me rappelait tant de souvenirs. Tenez, Brune, continua Murat en s’appuyant sur le bras du maréchal, ne voilà-t-il pas des pins aussi beaux que ceux de la villa Pamphile, des palmiers pareils à ceux du Caire, des montagnes qu’on croirait une chaîne du Tyrol? Voyez, à gauche, ce cap de Gien, n’est-ce pas, moins le Vésuve, quelque chose comme Castellamare et Sorrente? Et tenez, Saint-Mandrier, qui ferme là-bas le golfe, ne ressemble-t-il pas à mon rocher de Caprée, que Lamarque a si bien escamoté à cet imbécile d’Hudson Lowe? Ah! mon Dieu! et il me faut quitter tout cela! Il n’y a pas moyen de rester sur ce coin de terre française, dites, Brune?...
—Sire, vous me faites bien mal? répondit le maréchal.
—C’est vrai; ne parlons plus de cela. Quelles nouvelles?
—L’empereur est parti de Paris pour rejoindre l’armée; on doit se battre à cette heure....
—On doit se battre à cette heure, et je ne suis pas là! Oh! je sens que je lui aurais été cependant bien utile un jour de bataille! Avec quel plaisir j’aurais chargé sur ces misérables Prussiens et sur ces infâmes Anglais! Brune, donnez-moi un passeport, je partirai à franc étrier, j’arriverai où sera l’armée, je me ferai reconnaître à un colonel, je lui dirai: Donnez-moi votre régiment; je chargerai avec lui, et si le soir l’empereur ne me tend pas la main, je me brûlerai la cervelle, je vous en donne ma parole d’honneur!... Faites ce que je vous demande, Brune, et de quelque manière que cela finisse, je vous en aurai une reconnaissance éternelle!
—Je ne puis, sire....
—C’est bien, n’en parlons plus.
—Et votre majesté va quitter la France?
—Je ne sais; du reste, accomplissez vos ordres, maréchal, et si vous me retrouvez, faites-moi arrêter; c’est encore un moyen de faire quelque chose pour moi!... La vie m’est aujourd’hui un lourd fardeau, et celui qui m’en délivrera sera le bienvenu.... Adieu, Brune.
Et il tendit la main au maréchal; celui-ci voulut la lui baiser, mais Murat ouvrit ses bras, les deux vieux compagnons se tinrent un instant embrassés, la poitrine gonflée de soupirs, les yeux pleins de larmes; puis enfin ils se séparèrent. Brune remonta à cheval, Murat reprit son bâton, et ces deux hommes s’éloignèrent chacun de son côté, l’un pour aller se faire assassiner à Avignon, et l’autre pour aller se faire fusiller au Pizzo.
Pendant ce temps, comme Richard III, Napoléon échangeait à Waterloo sa couronne pour un cheval.
Après l’entrevue que nous venons de rapporter, l’ex-roi de Naples se retira chez son neveu, qui se nommait Bonafoux, et qui était capitaine de frégate; mais cette retraite ne pouvait être que provisoire, la parenté devait éveiller les soupçons de l’autorité. En conséquence, Bonafoux songea à procurer à son oncle un asile plus secret. Il jeta les yeux sur un avocat de ses amis, dont il connaissait l’inflexible probité, et le soir même il se présenta chez lui. Après avoir causé de choses indifférentes, il lui demanda s’il n’avait pas une campagne au bord de la mer, et, sur sa réponse affirmative, il s’invita pour le lendemain à déjeuner chez lui; la proposition, comme on le pense, fut acceptée avec plaisir.
Le lendemain, à l’heure convenue, Bonafoux arriva à Bonette, c’était le nom de la maison de campagne qu’habitaient la femme et la fille de monsieur Marouin. Quant à lui, attaché au barreau de Toulon, il était obligé de rester dans cette ville. Après les premiers complimens d’usage, Bonafoux s’avança vers la fenêtre, et faisant signe à Marouin de le rejoindre:
—Je croyais, lui dit-il avec inquiétude, que votre campagne était située plus près de la mer.
—Nous en sommes à dix minutes de chemin à peine.
—Mais on ne l’aperçoit pas.
—C’est cette colline qui nous empêche de la voir.
—En attendant le déjeuner, voulez-vous que nous allions faire un tour sur la côte?
—Volontiers. Votre cheval n’est pas encore dessellé, je vais faire mettre la selle au mien, et je viens vous reprendre.
Marouin sortit. Bonafoux resta devant la fenêtre, absorbé dans ses pensées. Au reste, les maîtresses de la maison, distraites par les préparatifs du déjeuner, ne remarquèrent point ou ne parurent point remarquer sa préoccupation. Au bout de cinq minutes, Marouin rentra; tout était prêt. L’avocat et son hôte montèrent à cheval et se dirigèrent rapidement vers la mer. Arrivé sur la grève, le capitaine ralentit le pas de sa monture, et, longeant la plage pendant une demi-heure à peu près, il parut apporter la plus grande attention au gisement des côtes. Marouin le suivait sans lui faire de question sur cet examen, que la qualité d’officier de marine rendait tout naturel. Enfin, après une heure de marche, les deux convives rentrèrent à la maison de campagne. Marouin voulut faire desseller les chevaux; mais Bonafoux s’y opposa, disant qu’aussitôt après le déjeuner il était obligé de retourner à Toulon. Effectivement, à peine le café était-il enlevé que le capitaine se leva et prit congé de ses hôtes. Marouin, rappelé à la ville par ses affaires, monta à cheval avec lui, et les deux amis reprirent ensemble le chemin de Toulon.
Au bout de dix minutes de marche, Bonafoux se rapprocha de son compagnon de route, et lui appuyant la main sur la cuisse:
—Marouin, lui dit-il, j’ai quelque chose de grave à vous dire, un secret important à vous confier.
—Dites, capitaine. Après les confesseurs, vous savez qu’il n’y a rien de plus discret que les notaires, et après les notaires que les avocats.
—Vous pensez bien que je ne suis pas venu à votre campagne pour le seul plaisir de faire une promenade. Un objet plus important, une responsabilité plus sérieuse me préoccupent, et je vous ai choisi entre tous mes amis, pensant que vous m’étiez assez dévoué pour me rendre un grand service.
—Vous avez bien fait, capitaine
—Venons au fait clairement et rapidement, comme il convient de le faire entre hommes qui s’estiment et qui comptent l’un sur l’autre. Mon oncle, le roi Joachim, est proscrit; il est caché chez moi, mais il ne peut y rester, car je suis la première personne chez laquelle on viendra faire visite. Votre campagne est isolée, et, par conséquent, on ne peut plus convenable pour lui servir de retraite. Il faut que vous la mettiez à notre disposition jusqu’au moment où les événemens permettront au roi de prendre une détermination quelconque.
—Vous pouvez en disposer, dit Marouin.
—C’est bien; mon oncle y viendra coucher cette nuit.
—Mais donnez-moi le temps au moins de la rendre digne de l’hôte royal que je vais avoir l’honneur de recevoir.
—Mon pauvre Marouin, vous vous donneriez une peine inutile, et vous nous imposeriez un retard fâcheux. Le roi Joachim a perdu l’habitude des palais et des courtisans; il est trop heureux aujourd’hui quand il trouve une chaumière et un ami; d’ailleurs je l’ai prévenu, tant d’avance j’étais sûr de votre réponse. Il compte coucher chez vous ce soir; si maintenant j’essayais de changer quelque chose à sa détermination, il verrait un refus dans ce qui ne serait qu’un délai, et vous perdriez tout le mérite de votre belle et bonne action. Ainsi, c’est chose dite: ce soir, à dix heures, au Champ-de-Mars.
A ces mots, le capitaine mit son cheval au galop et disparut. Marouin fit tourner bride au sien, et revint à sa campagne donner les ordres nécessaires à la réception d’un étranger dont il ne dit pas le nom.
A dix heures du soir, ainsi que la chose avait été convenue, Marouin était au Champ-de-Mars, encombré alors par l’artillerie de campagne du maréchal Brune. Personne n’était arrivé encore. Il se promenait entre les caissons, lorsque le factionnaire vint à lui et lui demanda ce qu’il faisait. La réponse était assez difficile: on ne se promène guère pour son plaisir à dix heures du soir au milieu d’un parc d’artillerie; aussi demanda-t-il à parler au chef du poste. L’officier s’avança: monsieur Marouin se fit reconnaître à lui pour avocat, adjoint au maire de la ville de Toulon, lui dit qu’il avait donné rendez-vous à quelqu’un au Champ-de-Mars, ignorant que ce fût chose défendue, et qu’il attendait cette personne. En conséquence de cette explication, l’officier l’autorisa à rester et rentra au poste. Quant à la sentinelle, fidèle observatrice de la subordination, elle continua sa promenade mesurée sans s’inquiéter davantage de la présence d’un étranger.
Quelques minutes après, un groupe de plusieurs personnes parut du côté des Lices. Le ciel était magnifique, la lune brillante. Marouin reconnut Bonafoux et s’avança vers lui. Le capitaine lui prit aussitôt la main, le conduisit au roi, et s’adressant successivement à chacun d’eux: «Sire, dit-il, voici l’ami dont je vous ai parlé.» Puis, se retournant vers Marouin: «Et vous, lui dit-il, voici le roi de Naples, proscrit et fugitif, que je vous confie. Je ne parle pas de la possibilité qu’il reprenne un jour sa couronne; ce serait vous ôter tout le mérite de votre belle action.... Maintenant servez-lui de guide, nous vous suivrons de loin, marchez.»
Le roi et l’avocat se mirent en route aussitôt. Murat était alors vêtu d’une redingote bleue, moitié militaire moitié civile, et boutonnée jusqu’en haut; il avait un pantalon blanc et des bottes à éperons. Il portait les cheveux longs, de larges moustaches et d’épais favoris qui lui faisaient le tour du cou. Tout le long de la route il interrogea son hôte sur la situation de la campagne qu’il allait habiter et sur la facilité qu’il aurait, en cas d’alerte, à gagner la mer. Vers minuit, le roi et Marouin arrivèrent à Bonette; la suite royale les rejoignit au bout de dix minutes: elle se composait d’une trentaine de personnes. Après avoir pris quelques rafraîchissemens cette petite troupe, dernière cour du roi déchu, se retira pour se disperser dans la ville et ses environs, et Murat resta seul avec les femmes, ne gardant auprès de lui qu’un seul valet de chambre nommé Leblanc.
Murat resta un mois à peu près dans cette solitude, occupant toutes ses journées à répondre aux journaux qui l’avaient accusé de trahison envers l’empereur. Cette accusation était sa préoccupation, son fantôme, son spectre: jour et nuit il essayait de l’écarter, en cherchant dans la position difficile où il s’était trouvé toutes les raisons qu’elle pouvait lui offrir d’agir comme il avait agi. Pendant ce temps, la désastreuse nouvelle de la défaite de Waterloo s’était répandue. L’empereur, qui venait de proscrire, était proscrit lui-même, et il attendait à Rochefort, comme Murat à Toulon, ce que les ennemis allaient décider de lui. On ignore encore à quelle voix intérieure a cédé Napoléon lorsque, repoussant les conseils du général Lallemand et le dévoûment du capitaine Bodin, il préféra l’Angleterre à l’Amérique, et s’en alla, moderne Prométhée, s’étendre sur le rocher de Sainte-Hélène. Nous allons dire, nous, quelle circonstance fortuite conduisit Murat dans les fossés de Pizzo; puis nous laisserons les fatalistes tirer de cette étrange histoire telle déduction philosophique qu’il leur plaira. Quant à nous, simple annaliste, nous ne pouvons que répondre de l’exactitude des faits que nous avons déjà racontés et de ceux qui vont suivre.
Le roi Louis XVIII était remonté sur le trône; tout espoir de rester en France était donc perdu pour Murat; il fallait partir. Son neveu Bonafoux fréta un brick pour les Etats-Unis, sous le nom du prince Rocca Romana. Toute la suite se rendit à bord, et l’on commença d’y faire transporter les objets précieux que le proscrit avait pu sauver dans le naufrage de sa royauté. D’abord ce fut un sac d’or pesant cent livres à peu près, une garde d’épée sur laquelle étaient les portraits du roi, de la reine et de ses enfans, et les actes de l’état civil de sa famille, reliés en velours et ornés de ses armes. Quant à Murat, il avait gardé sur lui une ceinture dans laquelle étaient, entre quelques papiers précieux, une vingtaine de diamans démontés qu’il estimait lui-même à une valeur de quatre millions.
Tous ces préparatifs de départ arrêtés, il fut convenu que le lendemain, 1er août, à cinq heures du matin, la barque du brick viendrait chercher le roi dans une petite baie distante de dix minutes de chemin de la maison de campagne qu’il habitait. Le roi passa la nuit à tracer à monsieur Marouin un itinéraire à l’aide duquel il devait arriver jusqu’à la reine, qui alors était, je crois, en Autriche. Au moment de partir il fut terminé, et en quittant le seuil de cette maison hospitalière, où il avait trouvé un refuge, il le remit à son hôte avec un volume de Voltaire que son édition stéréotype rendait portatif. Au bas du conte de Micromégas, le roi avait écrit:[2]
«Tranquillise-toi, ma chère Caroline; quoique bien malheureux, je suis libre. Je pars sans savoir où je vais; mais partout où j’irai mon cœur sera à toi et à mes enfans.
»J. M.»
Dix minutes après, Murat et son hôte attendaient sur la plage de Bonette l’arrivée du canot qui devait conduire le fugitif à son bâtiment.
Ils attendirent ainsi jusqu’à midi, et rien ne parut; et cependant ils voyaient à l’horizon le brick sauveur qui, ne pouvant tenir l’ancre à cause de la profondeur de la mer, courait des bordées, au risque, par cette manœuvre, de donner l’éveil aux sentinelles de la côte. A midi, le roi, écrasé de fatigue, brûlé par le soleil, était couché sur la plage, lorsqu’un domestique arriva portant quelques rafraîchissemens que madame Marouin, inquiète, envoyait à tout hasard à son mari. Le roi prit un verre d’eau rougie, mangea une orange, se releva un instant pour regarder si, dans l’immensité de cette mer, il ne verrait pas venir à lui la barque qu’il attendait. La mer était déserte, et le brick seul se courbait gracieusement à l’horizon, impatient de partir comme un cheval qui attend son maître.
Le roi poussa un soupir et se recoucha sur le sable. Le domestique retourna à Bonette avec l’ordre d’envoyer à la plage le frère de monsieur Marouin. Un quart d’heure après il arrivait, et presque aussitôt il repartait à grande course de cheval pour Toulon, afin de savoir de monsieur Bonafoux la cause qui avait empêché la barque de venir prendre le roi. En arrivant chez le capitaine, il trouva la maison envahie par la force armée; on faisait une visite domiciliaire dont Murat était l’objet. Le messager parvint enfin au milieu du tumulte jusqu’à celui auprès duquel il était envoyé, et là il apprit que le canot était parti à l’heure convenue, et qu’il fallait qu’il se fût égaré dans les calanges de Saint-Louis et de Sainte-Marguerite. C’est en effet ce qui était arrivé. A cinq heures, monsieur Marouin rapportait ces nouvelles à son frère et au roi. Elles étaient embarrassantes. Le roi n’avait plus le courage de défendre sa vie, même par la fuite; il était dans un de ces momens d’abattement qui saisissent parfois l’homme le plus fort, incapable d’émettre une opinion pour sa propre sûreté, et laissant monsieur Marouin maître d’y pourvoir comme bon lui semblerait. En ce moment un pêcheur rentrait en chantant dans le port. Marouin lui fit signe de venir, il obéit.
Marouin commença par acheter à cet homme tout le poisson qu’il avait pris; puis, après qu’il l’eut payé avec quelques pièces de monnaie, il fit briller de l’or à ses yeux, et lui offrit trois louis s’il voulait conduire un passager au brick que l’on apercevait en face de la Croix-des-Signaux. Le pêcheur accepta. Cette chance de salut rendit à l’instant même toutes ses forces à Murat; il se leva, embrassa monsieur Marouin, lui recommanda d’aller trouver sa femme et de lui remettre le volume de Voltaire, puis il s’élança dans la barque, qui s’éloigna aussitôt.
Elle était déjà à quelque distance de la côte, lorsque le roi arrêta le rameur et fit signe à Marouin qu’il avait oublié quelque chose. En effet, sur la plage était un sac de nuit dans lequel Murat avait renfermé une magnifique paire de pistolets montés en vermeil, qui lui avait été donnée par la reine, et à laquelle il tenait prodigieusement. A peine fut-il à la portée de la voix, qu’il indiqua à son hôte le motif de son retour. Celui-ci prit aussitôt la valise, et, sans attendre que Murat touchât terre, il la lui jeta de la plage dans le bateau; en tombant, le sac de nuit s’ouvrit, et un des pistolets en sortit. Le pêcheur ne jeta qu’un coup d’œil sur l’arme royale, mais ce fut assez pour qu’il remarquât sa richesse et qu’il conçût des soupçons. Il n’en continua pas moins de ramer vers le bâtiment. Monsieur Marouin, le voyant s’éloigner, laissa son frère sur la côte, et, saluant une dernière fois le roi, qui lui rendit son salut, retourna vers la maison pour calmer les inquiétudes de sa femme et prendre lui-même quelques heures de repos dont il avait grand besoin.
Deux heures après, il fut réveillé par une visite domiciliaire; sa maison, à son tour, était envahie par la gendarmerie. On chercha de tous les côtés sans trouver trace du roi. Au moment où les recherches étaient le plus acharnées, son frère rentra; Marouin le regarda en souriant, car il croyait le roi sauvé; mais à l’expression du visage de l’arrivant, il vit qu’il était advenu quelque nouveau malheur. Aussi, au premier moment de relâche que lui donnèrent les visiteurs, il s’approcha de son frère:
—Eh bien! dit-il, le roi est à bord, j’espère?
—Le roi est à cinquante pas d’ici, caché dans la masure.
—Pourquoi est-il revenu?
—Le pêcheur a prétexté un gros temps, et a refusé de le conduire jusqu’au brick.
—Le misérable!
Les gendarmes rentrèrent.
Toute la nuit se passa en visites infructueuses dans la maison et ses dépendances; plusieurs fois ceux qui cherchaient le roi passèrent à quelques pas de lui, et Murat put entendre leurs menaces et leurs imprécations. Enfin, une demi-heure avant le jour, ils se retirèrent. Marouin les laissa s’éloigner, et aussitôt qu’il les eut perdus de vue, il courut à l’endroit où devait être le roi. Il le trouva couché dans un enfoncement et tenant un pistolet de chaque main. Le malheureux n’avait pu résister à la fatigue et s’était endormi. Il hésita un instant à le rendre à cette vie errante et tourmentée; mais il n’y avait pas une minute à perdre. Il le réveilla.
Aussitôt ils s’acheminèrent vers la côte; le brouillard matinal s’étendait sur la mer. On ne pouvait distinguer à deux cents pas de distance: ils furent obligés d’attendre. Enfin les premiers rayons du soleil commencèrent à attirer à eux cette vapeur nocturne; elle se déchira, glissant sur la mer, pareille aux nuages qui glissent au ciel. L’œil avide du roi plongeait dans chacune des vallées humides qui se creusaient devant lui, sans y rien distinguer; cependant il espérait toujours que derrière ce rideau mobile il finirait par apercevoir le brick sauveur. Peu à peu l’horizon s’éclaircit; de légères vapeurs, semblables à des fumées, coururent encore quelque temps à la surface de la mer, et dans chacune d’elles le roi croyait reconnaître les voiles blanches de son vaisseau. Enfin la dernière s’effaça lentement, la mer se révéla dans toute son immensité; elle était déserte. Le brick, n’osant attendre plus longtemps, était parti pendant la nuit.
—Allons, dit le roi en se retournant vers son hôte, le sort en est jeté, j’irai en Corse.
Le même jour, le maréchal Brune était assassiné à Avignon.
[1] Madame la duchesse d’Abrantès a, dans ses Mémoires sur la Restauration, magnifiquement raconté cette scène, dont, comme le général T., elle connaissait les détails par un témoin oculaire.
Note de l’Éditeur.
[2] Ce volume est encore entre les mains de M. Marouin, à Toulon.
C’est encore sur cette, même plage de Bonette, dans cette même baie où nous l’avons vu attendre inutilement le canot de son brick, que toujours accompagné de son hôte fidèle, nous allons retrouver Murat le 22 août de la même année. Ce n’était plus alors par Napoléon qu’il était menacé, c’est par Louis XVIII qu’il était proscrit: ce n’était plus la loyauté militaire de Brune qui venait, les larmes aux yeux, lui signifier les ordres qu’il avait reçus, c’était l’ingratitude haineuse de monsieur de Rivière, qui mettait à prix[3] la tête de celui qui avait sauvé la sienne[4]. Monsieur de Rivière avait bien écrit à l’ex-roi de Naples de s’abandonner à la bonne foi et à l’humanité du roi de France, mais cette vague invitation n’avait point paru au proscrit une garantie suffisante, surtout de la part d’un homme qui venait de laisser égorger, presque sous ses yeux, un maréchal de France porteur d’un sauf-conduit signé de sa main. Murat savait le massacre des Mameluks à Marseille, l’assassinat de Brune à Avignon; il avait été prévenu la veille par le commissaire de police de Toulon[5] que l’ordre formel avait été donné de l’arrêter: il n’y avait donc pas moyen de rester plus longtemps en France. La Corse, avec ses villes hospitalières, ses montagnes amies et ses forêts impénétrables, était à cinquante lieues à peine; il fallait gagner la Corse, et attendre dans ses villes, dans ses montagnes ou dans ses forêts, ce que les rois décideraient relativement au sort de celui qu’ils avaient appelé sept ans leur frère.
A dix heures du soir, le roi descendit sur la plage. Le bateau qui devait l’emporter n’était pas encore au rendez-vous; mais, cette fois, il n’y avait aucune crainte qu’il y manquât; la baie avait été reconnue, pendant la journée, par trois amis dévoués à la fortune adverse: c’étaient messieurs Blancard, Langlade et Donadieu, tous trois officiers de marine, hommes de tête et de cœur, qui s’étaient engagés sur leur vie à conduire Murat en Corse, et qui en effet allaient exposer leur vie pour accomplir leur promesse. Murat vit donc sans inquiétude la plage déserte: ce retard, au contraire, lui donnait quelques instans de joie filiale. Sur ce bout de terrain, sur cette langue de sable, le malheureux proscrit se cramponnait encore à la France, sa mère, tandis qu’une fois le pied posé sur ce bâtiment qui allait l’emporter, la séparation devait être longue, sinon éternelle.
Au milieu de ces pensées, il tressaillit tout-à-coup et poussa un soupir: il venait d’apercevoir, dans l’obscurité transparente de la nuit méridionale, une voile glissant sur les vagues comme un fantôme. Bientôt un chant de marin se fit entendre; Murat reconnut le signal convenu, il y répondit en brûlant l’amorce d’un pistolet, et aussitôt la barque se dirigea vers la terre; mais, comme elle tirait trois pieds d’eau, elle fut forcée de s’arrêter à dix ou douze pas de la plage; deux hommes se jetèrent aussitôt à la mer, et gagnèrent le bord, le troisième resta enveloppé dans son manteau et couché près du gouvernail.
—Eh bien! mes braves amis, dit le roi en allant au-devant de Blancard et de Langlade jusqu’à ce qu’il sentît la vague mouiller ses pieds, le moment est arrivé, n’est-ce pas? Le vent est bon, la mer calme; il faut partir.
—Oui, répondit Langlade, oui, sire, il faut partir, et peut-être cependant serait-il plus sage de remettre la chose à demain.
—Pourquoi? reprit Murat.
Langlade ne répondit point; mais, se tournant vers le couchant, il leva la main, et, selon l’habitude des marins, il siffla pour appeler le vent.
—C’est inutile, dit Donadieu, qui était resté dans la barque, voici les premières bouffées qui arrivent, bientôt tu en auras à n’en savoir que faire.... Prends garde, Langlade, prends garde, parfois en appelant le vent on éveille la tempête.—Murat tressaillit, car il semblait que cet avis, qui s’élevait de la mer, lui était donné par l’esprit des eaux; mais l’impression fut courte, et il se remit à l’instant.
—Tant mieux, dit-il, plus nous aurons de vent, plus vite nous marcherons.
—Oui, répondit Langlade, seulement Dieu sait où il nous conduira, s’il continue à tourner ainsi.
—Ne partez pas cette nuit, sire, dit Blancard, joignant son avis à celui de ses deux compagnons.
—Mais enfin, pourquoi cela?
—Parce que, vous voyez cette ligne noire, n’est-ce pas? eh bien! au coucher du soleil elle était à peine visible, la voilà maintenant qui couvre une partie de l’horizon; dans une heure il n’y aura plus une étoile au ciel.
—Avez-vous peur? dit Murat.
—Peur! répondit Langlade, et de quoi? de l’orage? il haussa les épaules. C’est à-peu-près comme si je demandais à votre majesté si elle a peur d’un boulet de canon.... Ce que nous en disons, c’est pour vous, sire; mais que voulez-vous que fasse l’orage à des chiens de mer comme nous?
—Partons donc! s’écria Murat en poussant un soupir. Adieu, Marouin.... Dieu seul peut vous récompenser de ce que vous avez fait pour moi. Je suis à vos ordres, messieurs.
A ces mots, les deux marins saisirent le roi chacun par une cuisse, et l’élevant sur leurs épaules, ils entrèrent aussitôt dans la mer; en un instant il fut à bord, Langlade et Blancard montèrent derrière lui, Donadieu resta au gouvernail; les deux autres officiers se chargèrent de la manœuvre et commencèrent leur service en déployant les voiles. Aussitôt, comme un cheval qui sent l’éperon, la petite barque sembla s’animer; les marins jetèrent un coup d’œil insoucieux vers la terre, et Murat, sentant qu’il s’éloignait, se retourna du côté de son hôte et lui cria une dernière fois:
—Vous avez votre itinéraire jusqu’à Trieste. N’oubliez pas ma femme!... Adieu!... Adieu.
—Dieu vous garde, sire, murmura Marouin.—Et quelque temps encore, grâce à la voile blanche qui se dessinait dans l’ombre, il put suivre des yeux la barque qui s’éloignait rapidement; enfin elle disparut. Marouin resta encore quelque temps sur le rivage, quoiqu’il ne vît plus rien; alors un cri affaibli par la distance parvint encore jusqu’à lui: ce cri était le dernier adieu de Murat à la France.
Lorsque monsieur Marouin me raconta un soir, au lieu même où la chose s’était passée, les détails que je viens de décrire, ils lui étaient si présens, quoique vingt ans se fussent écoulés depuis lors, qu’il se rappelait jusqu’aux moindres accidens de cet embarquement nocturne. De ce moment, il m’assura qu’un pressentiment de malheur l’avait saisi, qu’il ne pouvait s’arracher de cette plage, et que plusieurs fois l’envie lui prit de rappeler le roi; mais, pareil à un homme qui rêve, sa bouche s’ouvrait sans laisser échapper aucun son. Il craignait de paraître insensé; et ce ne fut qu’à une heure du matin, c’est-à-dire deux heures et demie après le départ de la barque, qu’il rentra chez lui avec une tristesse mortelle dans le cœur.
Quant aux aventureux navigateurs, ils s’étaient engagés dans cette large ornière marine qui mène de Toulon à Bastia, et d’abord l’événement parut, aux yeux du roi, démentir la prédiction de nos marins: le vent, au lieu de s’augmenter, tomba peu à peu, et deux heures après le départ, la barque se balançait sans reculer ni avancer sur des vagues qui, de minute en minute, allaient s’aplanissant. Murat regardait tristement s’éteindre, sur cette mer où il se croyait enchaîné, le sillon phosphorescent que le petit bâtiment traînait après lui: il avait amassé du courage contre la tempête, mais non contre le calme; et, sans même interrompre ses compagnons de voyage, à l’inquiétude desquels il se méprenait, il se coucha au fond du bateau, s’enveloppa de son manteau, et fermant les yeux comme s’il dormait, il s’abandonna au flot de ses pensées, bien autrement tumultueux et agité que celui de la mer. Bientôt les deux marins, croyant à son sommeil, se réunirent au pilote, et, s’asseyant près du gouvernail, commencèrent à tenir conseil.
—Vous avez eu tort, Langlade, dit Donadieu, de prendre une barque ou si petite ou si grande: sans pont nous ne pouvons résister à la tempête, et sans rames nous ne pouvons avancer dans le calme.
—Sur Dieu! je n’avais pas le choix. J’ai été obligé de prendre ce que j’ai rencontré, et si ce n’était pas l’époque des madragues[6], je n’aurais pas même trouvé cette mauvaise péniche, ou bien il me l’aurait fallu aller chercher dans le port, et la surveillance est telle que j’y serais bien entré, mais que je n’aurais probablement pas pu en sortir.
—Est-elle solide au moins? dit Blancard.
—Pardieu! tu sais bien ce que c’est que des planches et des clous qui trempent depuis dix ans dans l’eau salée. Dans les occasions ordinaires on n’en voudrait pas pour aller de Marseille au château d’If; dans une circonstance comme la nôtre on ferait le tour du monde dans une coquille de noix.
—Chut! dit Donadieu. Les marins écoutèrent: un grondement lointain se fit entendre, mais si faible, qu’il fallait l’oreille exercée d’un enfant de la mer pour le distinguer.
—Oui, oui, dit Langlade; c’est un avertissement pour ceux qui ont des jambes ou des ailes de regagner le nid qu’ils n’auraient pas dû quitter.
—Sommes-nous loin des îles? dit vivement Donadieu.
—A une lieue environ.
—Mettez le cap sur elles.
—Et pour quoi faire? dit Murat en se soulevant.
—Pour y relâcher, sire, si nous le pouvons....
—Non, non! s’écria Murat, je ne veux plus remettre le pied à terre qu’en Corse; je ne veux pas quitter encore une fois la France. D’ailleurs, la mer est calme, et voilà le vent qui nous revient....
—Tout à bas! cria Donadieu.
Aussitôt Langlade et Blancard se précipitèrent pour exécuter la manœuvre. La voile glissa le long du mât, et s’abattit au fond du bâtiment.
—Que faites-vous? cria Murat; oubliez-vous que je suis roi et que j’ordonne?
—Sire, dit Donadieu, il y a un roi plus puissant que vous ici, c’est Dieu; il y a une voix qui couvre la vôtre, c’est celle de la tempête.... Laissez-nous sauver votre majesté, si la chose est possible, et n’exigez rien de plus....
En ce moment un éclair sillonna l’horizon, un coup de tonnerre, plus rapproché que le premier, se fit entendre, une légère écume monta à la surface de l’eau, la barque frissonna comme un être animé. Murat commença à comprendre que le danger venait; alors il se leva en souriant, jeta derrière lui son chapeau, secoua ses longs cheveux, aspira l’orage comme il aspirait la fumée; le soldat était prêt à combattre.
—Sire, dit Donadieu, vous avez bien vu des batailles; mais peut-être n’avez-vous point vu une tempête: si vous êtes curieux de ce spectacle, cramponnez-vous au mât et regardez, car en voilà une qui se présente bien.
—Que faut-il que je fasse? dit Murat; ne puis-je vous aider en rien?
—Non! pas pour le moment, sire; plus tard nous vous emploierons aux pompes....
Pendant ce dialogue, l’orage avait fait des progrès; il arrivait sur les voyageurs comme un cheval de course, soufflant le vent et le feu par ses naseaux, hennissant le tonnerre et faisant voler l’écume des vagues sous ses pieds. Donadieu pressa le gouvernail, la barque céda comme si elle comprenait la nécessité d’une prompte obéissance, et présenta sa poupe au choc du vent; alors la bourrasque passa laissant derrière elle la mer tremblante, et tout parut rentrer dans le repos. La tempête reprenait haleine.
—En sommes-nous donc quittes pour cette rafale? dit Murat.
—Non, votre majesté, dit Donadieu, ceci n’est qu’une affaire d’avant-garde; tout-à-l’heure le corps d’armée va donner.
—Et ne faisons-nous pas quelques préparatifs pour le recevoir? répondit gaîment le roi.
—Lesquels? dit Donadieu. Nous n’avons plus un pouce de toile où le vent puisse mordre, et tant que la barque ne fera pas eau nous flotterons comme un bouchon de liége. Tenez-vous bien, sire!...
En effet, une seconde bourrasque accourait, plus rapide que la première, accompagnée de pluie et d’éclairs. Donadieu essaya de répéter la même manœuvre, mais il ne put virer si rapidement que le vent n’enveloppât la barque; le mât se courba comme un roseau; le canot embarqua une vague.
—Aux pompes, cria Donadieu! Sire, voilà le moment de nous aider....
Blancard, Langlade et Murat saisirent leurs chapeaux et se mirent à vider la barque. La position de ces quatre hommes était affreuse, elle dura trois heures. Au point du jour le vent faiblit; cependant la mer resta grosse et tourmentée. Le besoin de manger commença à se faire sentir; toutes les provisions avaient été atteintes par l’eau de mer, le vin seul avait été préservé du contact. Le roi prit une bouteille, en avala le premier quelques gorgées; puis il la passa à ses compagnons, qui burent à leur tour: la nécessité avait chassé l’étiquette. Langlade avait par hasard sur lui quelques tablettes de chocolat, qu’il offrit au roi. Murat en fit quatre parts égales et força ses compagnons de manger; puis, le repas fini, on orienta vers la Corse; mais la barque avait tellement souffert qu’il n’y avait pas probabilité qu’elle pût gagner Bastia.
Le jour se passa tout entier sans que les voyageurs pussent faire plus de dix lieues; il naviguaient sous la petite voile; de foque, n’osant tendre la grande voile, et le vent était si variable, que le temps se perdait à combattre ses caprices. Le soir une voie d’eau se déclara; elle pénétrait à travers les planches disjointes; les mouchoirs réunis de l’équipage suffirent pour tamponner la barque, et la nuit, qui descendit triste et sombre, les enveloppa pour la seconde fois de son obscurité. Murat écrasé de fatigue, s’endormit; Blancard et Langlade reprirent place près de Donadieu; et ces trois hommes, qui semblaient insensibles au sommeil et à la fatigue, veillèrent à la tranquillité de son sommeil.
La nuit fut, en apparence, assez tranquille; cependant quelquefois des craquemens sourds se faisaient entendre. Alors les trois marins se regardaient avec une expression étrange; puis leurs yeux se reportaient vers le roi, qui dormait au fond de ce bâtiment, dans son manteau trempé d’eau de mer, aussi profondément qu’il avait dormi dans les sables de l’Egypte et dans les neiges de la Russie. Alors l’un d’eux se levait, s’en allait à l’autre bout du canot en sifflant entre ses dents l’air d’une chanson provençale... puis, après avoir consulté le ciel, les vagues et la barque, il revenait auprès de ses camarades, et se rasseyait en murmurant:—C’est impossible; à moins d’un miracle, nous n’arriverons jamais.—La nuit s’écoula dans ces alternatives. Au point du jour on se trouva en vue d’un bâtiment:—Une voile! s’écria Donadieu, une voile! A ce cri le roi se réveilla. En effet, un petit brick marchand apparaissait, venant de Corse et faisant route vers Toulon. Donadieu mit le cap sur lui, Blancard hissa les voiles au point de fatiguer la barque, et Langlade courut à la proue, élevant le manteau du roi au bout d’une espèce de harpon. Bientôt les voyageurs s’aperçurent qu’ils avaient été vus; le brick manœuvra de manière à se rapprocher d’eux; au bout de dix minutes ils se trouvèrent à cinquante pas l’un de l’autre. Le capitaine parut sur l’avant. Alors le roi le héla, lui offrant une forte récompense s’il voulait le recevoir à bord avec ses trois compagnons et les conduire en Corse. Le capitaine écouta la proposition; puis aussitôt, se tournant vers l’équipage, il donna à demi-voix un ordre que Donadieu ne put entendre, mais qu’il saisit probablement par le geste, car aussitôt il commanda à Langlade et à Blancard une manœuvre qui avait pour but de s’éloigner du bâtiment. Ceux-ci obéirent avec la promptitude passive des marins; mais le roi frappa du pied:
—Que faites-vous, Donadieu? que faites-vous? s’écria-t-il; ne voyez-vous pas qu’il vient à nous?
—Oui, sur mon âme! je le vois.... Obéissez, Langlade; alerte, Blancard. Oui, il vient sur nous, et peut-être m’en suis-je aperçu trop tard. C’est bien, c’est bien; à moi maintenant. Alors il se coucha sur le gouvernail, et lui imprima un mouvement si subit et si violent, que la barque, forcée de changer immédiatement de direction, sembla se raidir contre lui, comme ferait un cheval contre le frein; enfin elle obéit. Une vague énorme, soulevée par le géant qui venait sur elle, l’emporta avec elle comme une feuille; le brick passa à quelques pieds de sa poupe.
—Ah! traître! s’écria le roi, qui commença seulement à s’apercevoir de l’intention du capitaine; en même temps il tira un pistolet de sa ceinture, en criant: A l’abordage, à l’abordage! et essaya de faire feu sur le brick; mais la poudre était mouillée et ne s’enflamma point. Le roi était furieux, et ne cessait de crier: A l’abordage, à l’abordage!
—Oui, oui, le misérable, ou plutôt l’imbécile, dit Donadieu, il nous a pris pour des forbans, et il a voulu nous couler, comme si nous avions besoin de lui pour cela.
En effet, jetant les yeux sur le canot, il était facile de s’apercevoir qu’il commençait à faire eau. La tentative de salut que venait de risquer Donadieu avait effroyablement fatigué la barque, et la mer entrait par plusieurs écartemens de planches; il fallut se mettre à puiser l’eau avec les chapeaux; ce travail dura dix heures. Enfin Donadieu fit, pour la seconde fois, entendre le cri sauveur:—Une voile! une voile!...
Le roi et ses deux compagnons cessèrent aussitôt leur travail; on hissa de nouveau les voiles, on mit le cap sur le bâtiment qui s’avançait et l’on cessa de s’occuper de l’eau, qui, n’étant plus combattue, gagna rapidement.
Désormais c’était une question de temps, de minutes, de secondes, voilà tout; il s’agissait d’arriver au bâtiment avant de couler bas. Le bâtiment, de son côté, semblait comprendre la position désespérée de ceux qui imploraient son secours, il venait au pas de course; Langlade le reconnut le premier, c’était une balancelle du gouvernement, un bateau de poste qui faisait le service entre Toulon et Bastia. Langlade était l’ami du capitaine, il l’appela par son nom avec cette voix puissante de l’agonie, et il fut entendu. Il était temps, l’eau gagnait toujours; le roi et ses compagnons étaient déjà dans la mer jusqu’aux genoux; le canot gémissait comme un mourant qui râle; il n’avançait plus et commençait à tourner sur lui-même. En ce moment, deux ou trois câbles, jetés de la balancelle, tombèrent dans la barque; le roi en saisit un, s’élança et saisit l’échelle de corde: il était sauvé. Blancard et Langlade en firent autant presque aussitôt; Donadieu resta le dernier, comme c’était son devoir de le faire, et au moment où il mettait un pied sur l’échelle du bord, il sentit sous l’autre s’enfoncer la barque qu’il quittait; il se retourna avec la tranquillité d’un marin, vit le gouffre ouvrir sa vaste gueule au-dessous de lui, et aussitôt la barque dévorée tournoya et disparut. Cinq secondes encore, et ces quatre hommes, qui maintenant étaient sauvés, étaient à tout jamais perdus!...[7]
Murat était à peine sur le pont, qu’un homme vint se jeter à ses pieds; c’était un mameluk qu’il avait autrefois ramené d’Egypte, et qui s’était depuis marié à Castellamare; des affaires de commerce l’avaient attiré à Marseille, où, par miracle, il avait échappé au massacre de ses frères; et, malgré le déguisement qui le couvrait et les fatigues qu’il venait d’essuyer, il avait reconnu son ancien maître. Ses exclamations de joie ne permirent pas au roi de garder plus longtemps son incognito; alors le sénateur Casablanca, le capitaine Oletta, un neveu du prince Baciocchi, un ordonnateur nommé Boërco, qui fuyaient eux-mêmes les massacres du Midi, se trouvant sur le bâtiment, le saluèrent du nom de majesté et lui improvisèrent une petite cour: le passage était brusque, il opéra un changement rapide; ce n’était plus Murat le proscrit, c’était Joachim Ier, roi de Naples. La terre de l’exil disparut avec la barque engloutie; à sa place, Naples et son golfe magnifique apparurent à l’horizon comme un merveilleux mirage, et sans doute la première idée de la fatale expédition de Calabre prit naissance pendant ces jours d’enivrement qui suivirent les heures d’agonie. Cependant le roi, ignorant encore quel accueil l’attendait en Corse, prit le nom de comte de Campo Melle, et ce fut sous ce nom que le 25 août il prit terre à Bastia. Mais sa précaution fut inutile; trois jours après son arrivée, personne n’ignorait plus sa présence dans cette ville. Des rassemblemens se formèrent aussitôt, des cris de: Vive Joachim! se firent entendre, et le roi, craignant de troubler la tranquillité publique, sortit le même soir de Bastia avec ses trois compagnons et son mameluk. Deux heures après il entrait à Viscovato, et frappait à la porte du général Franceschetti, qui avait été à son service tout le temps de son règne, et qui, ayant quitté Naples en même temps que le roi, était revenu en Corse habiter avec sa femme la maison de monsieur Colona Cicaldi, son beau-père. Il était en train de souper lorsqu’on vint lui dire qu’un étranger demandait à lui parler: il sortit et trouva Murat enveloppé d’une capote militaire, la tête enfoncée dans un bonnet de marin, la barbe longue, et portant un pantalon, des guêtres et des souliers de soldat. Le général s’arrêta étonné; Murat fixa sur lui son grand œil noir; puis, croisant les bras:—Franceschetti, lui dit-il, avez-vous à votre table une place pour votre général qui a faim? avez-vous sous votre toit un asile pour votre roi qui est proscrit?... Franceschetti jeta un cri de surprise en reconnaissant Joachim, et ne put lui répondre qu’en tombant à ses pieds et en lui baisant la main. De ce moment, la maison du général fut à la disposition de Murat.
A peine le bruit de l’arrivée du roi fut-il répandu dans les environs que l’on vit accourir à Viscovato des officiers de tous grades, des vétérans qui avaient combattu sous lui, et des chasseurs corses que son caractère aventureux séduisait; en peu de jours la maison du général fut transformée en palais, le village en résidence royale, et l’île en royaume. D’étranges bruits se répandirent sur les intentions de Murat; une armée de neuf cents hommes contribuait à leur donner quelque consistance. C’est alors que Blancard, Langlade et Donadieu prirent congé de lui; Murat voulut les retenir; mais ils s’étaient voués au salut du proscrit, et non à la fortune du roi.
Nous avons dit que Murat avait rencontré à bord du bateau de poste de Bastia un de ses anciens mameluks nommé Othello, et que celui-ci l’avait suivi à Viscovato: l’ex-roi de Naples songea à se faire un agent de cet homme. Des relations de famille le rappelaient tout naturellement à Castellamare; il lui ordonna d’y retourner, et le chargea de lettres pour les personnes sur le dévoûment desquelles il comptait le plus. Othello partit, arriva heureusement chez son beau-père, et crut pouvoir lui tout dire; mais celui-ci, épouvanté, prévint la police: une descente nocturne fut faite chez Othello et sa correspondance saisie.
Le lendemain, toutes les personnes auxquelles étaient adressées des lettres furent arrêtées et reçurent l’ordre de répondre à Murat comme si elles étaient libres, et de lui indiquer Salerne comme le lieu le plus propre au débarquement: cinq sur sept eurent la lâcheté d’obéir, les deux autres, qui étaient deux frères espagnols, s’y refusèrent absolument: on les jeta dans un cachot.
Cependant, le 17 septembre, Murat quitta Viscovato, le général Franceschetti, ainsi que plusieurs officiers corses, lui servirent d’escorte; il s’achemina vers Ajaccio par Cotone, les montagnes de Serra et Bosco, Venaco, Vivaro, les gorges de la forêt de Vezzanovo et Bogognone; partout il fut reçu et fêté comme un roi, et à la porte des villes il reçut plusieurs députations qui le haranguèrent en le saluant du titre de majesté; enfin le 25 septembre il arriva à Ajaccio. La population tout entière l’attendait hors des murs; son entrée dans la ville fut un triomphe; il fut porté jusqu’à l’auberge qui avait été désignée d’avance par les maréchaux-de-logis: il y avait de quoi tourner la tête à un homme moins impressionnable que Murat: quant à lui, il était dans l’ivresse; en entrant dans l’auberge, il tendit la main à Franceschetti.—Voyez, lui dit-il, à la manière dont me reçoivent les Corses, ce que feront pour moi les Napolitains.—C’était le premier mot qui lui échappait sur ses projets à venir, et dès ce jour même il ordonna de tout préparer pour son départ.
On rassembla dix petites felouques: un Maltais, nommé Barbara, ancien capitaine de frégate de la marine napolitaine, fut nommé commandant en chef de l’expédition; deux cent cinquante hommes furent engagés et invités à se tenir prêts à partir au premier signal. Murat n’attendait plus que les réponses aux lettres d’Othello; elles arrivèrent dans la matinée du 28. Murat invita tous les officiers à un grand dîner, et fit donner double paye et double ration à ses hommes.
Le roi était au dessert lorsqu’on lui annonça l’arrivée de monsieur Maceroni: c’était un envoyé des puissances étrangères qui apportait à Murat la réponse qu’il avait attendue si longtemps à Toulon. Murat se leva de table et passa dans une chambre à côté. Monsieur Maceroni se fit reconnaître comme chargé d’une mission officielle, et remit au roi l’ultimatum de l’empereur d’Autriche. Il était conçu en ces termes:
«Monsieur Maceroni est autorisé par les présentes à prévenir le roi Joachim que sa majesté l’empereur d’Autriche lui accordera un asile dans ses États, sous les conditions suivantes:
«1° Le roi prendra un nom privé. La reine ayant adopté celui de Lipano, on propose au roi de prendre le même nom.
»2° Il sera permis au roi de choisir une ville de la Bohême, de la Moravie, ou de la Haute-Autriche, pour y fixer son séjour. Il pourra même, sans inconvénient, habiter une campagne dans ces mêmes provinces.
»3° Le roi engagera sa parole d’honneur envers S. M. I. et R. qu’il n’abandonnera jamais les Etats autrichiens sans le consentement exprès de l’empereur, et qu’il vivra comme un particulier de distinction, mais soumis aux lois qui sont en vigueur dans les Etats autrichiens.
»En foi de quoi, et afin qu’il en soit fait un usage convenable, le soussigné a reçu l’ordre de l’empereur de signer la présente déclaration.
Donné à Paris le 1er septembre 1815.
Signé le prince de Metternich.»
Murat sourit en achevant cette lecture, puis il fit signe à monsieur Maceroni de le suivre. Il le conduisit alors sur la terrasse de la maison, qui dominait toute la ville et qui était dominée elle-même par sa bannière qui flottait comme sur un château royal. De là on pouvait voir Ajaccio toute joyeuse et illuminée, le port où se balançait la petite flottille et les rues encombrées de monde, comme un jour de fête. A peine la foule eut-elle aperçu Murat, qu’un cri partit de toutes les bouches: Vive Joachim! vive le frère de Napoléon! vive le roi de Naples! Murat salua, et les cris redoublèrent, et la musique de la garnison fit entendre les airs nationaux. Monsieur Maceroni ne savait s’il devait en croire ses yeux et ses oreilles. Lorsque le roi eut joui de son étonnement, il l’invita à descendre au salon. Son état-major y était réuni en grand uniforme: on se serait cru à Caserte ou à Capodimonte. Enfin, après un instant d’hésitation, Maceroni se rapprocha de Murat.
—Sire, lui dit-il, quelle réponse dois-je faire à sa majesté l’empereur d’Autriche?
—Monsieur, lui répondit Murat avec cette dignité hautaine qui allait si bien à sa belle figure, vous raconterez à mon frère François ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu; et puis vous ajouterez que je pars cette nuit même pour reconquérir mon royaume de Naples.
[3] A 48,000 fr.
[4] Conspiration de Pichegru.
[5] M. Jolicleve.
[6] Pêche du thon.
[7] Ces détails sont populaires à Toulon, et m’ont été racontés vingt fois à moi-même pendant le double séjour que je fis en 1834 et 1835 dans cette ville; quelques-uns de ceux qui me les rapportaient les tenaient de la bouche même de Langlade et de Donadieu.
Les lettres qui avaient déterminé Murat à quitter la Corse lui avaient été apportées par un Calabrais nommé Luidgi. Il s’était présenté au roi comme un envoyé de l’Arabe Othello, qui avait été jeté, comme nous l’avons dit, dans les prisons de Naples, ainsi que les personnes auxquelles les dépêches dont il était porteur avaient été adressées. Ces lettres, écrites par le ministre de la police de Naples, indiquaient à Joachim le port de la ville de Salerne comme le lieu le plus propre au débarquement; car le roi Ferdinand avait rassemblé sur ce point trois mille hommes de troupes autrichiennes, n’osant se fier aux soldats napolitains, qui avaient conservé de Murat un riche et brillant souvenir. Ce fut donc vers le golfe de Salerne que la flottille se dirigea; mais, arrivée en vue de l’île de Caprée, elle fut assaillie par une violente tempête, qui la chassa jusqu’à Paola, petit port situé à dix lieues de Cosenza. Les bâtimens passèrent en conséquence la nuit du 5 au 6 octobre dans une espèce d’échancrure du rivage qui ne mérite pas le nom de rade. Le roi, pour ôter tout soupçon aux gardes des côtes et aux scorridori[8] siciliens, ordonna d’éteindre les feux et de louvoyer jusqu’au jour; mais, vers une heure du matin, il s’éleva de terre un vent si violent, que l’expédition fut repoussée en haute mer, de sorte que le 6, à la pointe du jour, le bâtiment que montait le roi se trouva seul. Dans la matinée il rallia la felouque du capitaine Cicconi, et les deux navires mouillèrent à quatre heures de l’après-midi en vue de Santo-Lucido. Le soir, le roi ordonna au chef de bataillon Ottoviani de se rendre à terre pour y prendre des renseignemens. Luidgi s’offrit pour l’accompagner, Murat accepta ses bons offices. Ottoviani et son guide se rendirent donc à terre, tandis qu’au contraire, Cicconi et sa felouque se remettaient en mer avec mission d’aller à la recherche du reste de la flotte.
Vers les onze heures de la nuit, le lieutenant de quart sur le navire royal distingua au milieu des vagues un homme qui s’avançait en nageant vers le bâtiment. Dès qu’il fut à la portée de la voix, il le héla. Aussitôt le nageur se fit reconnaître: c’était Luidgi. On lui envoya la chaloupe et il remonta à bord. Alors il raconta que le chef de bataillon Ottoviani avait été arrêté, et qu’il n’avait échappé lui-même à ceux qui le poursuivaient qu’en se jetant à la mer. Le premier mouvement de Murat fut d’aller au secours d’Ottoviani; mais Luidgi fit comprendre au roi le danger et l’inutilité de cette tentative; néanmoins Joachim resta jusqu’à deux heures du matin agité et irrésolu. Enfin, il donna l’ordre de reprendre le large. Pendant la manœuvre qui eut lieu à cet effet, un matelot tomba à la mer et disparut avant qu’on eût eu le temps de lui porter secours. Décidément les présages étaient sinistres.
Le 7 au matin, on eut connaissance de deux bâtimens. Le roi ordonna aussitôt de se mettre en mesure de défense; mais Barbara les reconnut pour être la felouque de Cicconi et la balancelle de Courrand, qui s’étaient réunies et faisaient voile de conserve. On hissa les signaux, et les deux capitaines se rallièrent à l’amiral.
Pendant qu’on délibérait sur la route à suivre, un canot aborda le bâtiment de Murat. Il était monté par le capitaine Pernice et un lieutenant sous ses ordres. Ils venaient demander au roi la permission de passer à son bord, ne voulant point rester à celui de Courrand, qui, à leur avis, trahissait. Murat l’envoya chercher; et, malgré ses protestations de dévoûment, il le fit descendre avec cinquante hommes dans une chaloupe, et ordonna d’amarrer la chaloupe à son bâtiment. L’ordre fut exécuté aussitôt, et la petite escadre continua sa route, longeant, sans les perdre de vue, les côtes de la Calabre; mais, à dix heures du soir, au moment où l’on se trouvait à la hauteur du golfe de Sainte-Euphémie, le capitaine Courrand coupa le câble qui le traînait à la remorque, et, faisant force de rames, il s’éloigna de la flottille. Murat s’était jeté sur son lit tout habillé: on le prévint de cet événement. Il s’élança aussitôt sur le pont, et arriva à temps encore pour voir la chaloupe, qui fuyait dans la direction de la Corse, s’enfoncer et disparaître dans l’ombre. Il demeura immobile, sans colère et sans cris; seulement il poussa un soupir et laissa tomber sa tête sur sa poitrine: c’était encore une feuille qui tombait de l’arbre enchanté de ses espérances.
Le général Franceschetti profita de cette heure de découragement pour lui donner le conseil de ne point débarquer dans les Calabres et de se rendre directement à Trieste, afin de réclamer de l’Autriche l’asile qu’elle lui avait offert. Le roi était dans un de ces instans de lassitude extrême et d’abattement mortel où le cœur s’affaisse sur lui-même: il se défendit d’abord, et puis finit par accepter. En ce moment, le général s’aperçut qu’un matelot, couché dans des enroulemens de câbles, se trouvait à portée d’entendre tout ce qu’il disait; il s’interrompit et le montra du doigt à Murat. Celui-ci se leva, alla voir l’homme et reconnut Luidgi; accablé de fatigue, il s’était endormi sur le pont. La franchise de son sommeil rassura le roi, qui d’ailleurs avait toute confiance en lui. La conversation interrompue un instant se renoua donc: il fut convenu que, sans rien dire des nouveaux projets arrêtés, on doublerait le cap Spartivento, et qu’on entrerait dans l’Adriatique; puis le roi et le général redescendirent dans l’entrepont.
Le lendemain 8 octobre, on se trouvait à la hauteur du Pizzo, lorsque Joachim, interrogé par Barbara sur ce qu’il fallait faire, donna ordre de mettre le cap sur Messine; Barbara répondit qu’il était prêt à obéir, mais qu’il avait besoin d’eau et de vivres; en conséquence, il offrit de passer sur la felouque de Cicconi, et d’aller avec elle à terre pour y renouveler ses provisions; le roi accepta; Barbara lui demanda alors les passeports qu’il avait reçus des puissances alliées, afin, disait-il, de ne pas être inquiété par les autorités locales. Ces pièces étaient trop importantes pour que Murat consentît à s’en dessaisir; peut-être le roi commençait-il à concevoir quelque soupçon: il refusa donc. Barbara insista; Murat lui ordonna d’aller à terre sans ces papiers; Barbara refusa positivement; le roi, habitué à être obéi, leva sa cravache sur le Maltais; mais en ce moment, changeant de résolution, il ordonna aux soldats de préparer leurs armes, aux officiers de revêtir leur grand uniforme; lui-même leur en donna l’exemple: le débarquement était décidé, et le Pizzo devait être le golfe Juan du nouveau Napoléon. En conséquence, les bâtimens se dirigèrent vers la terre. Le roi descendit dans une chaloupe avec vingt-huit soldats et trois domestiques, au nombre desquels était Luidgi. Arrivé près de la plage, le général Franceschetti fit un mouvement pour prendre terre, mais Murat l’arrêta: «C’est à moi de descendre le premier,» dit-il; et il s’élança sur le rivage. Il était vêtu d’un habit de général, avait un pantalon blanc avec des bottes à l’écuyère, une ceinture dans laquelle étaient passés deux pistolets, un chapeau brodé en or, dont la cocarde était retenue par une ganse formée de quatorze brillans; enfin il portait sous le bras la bannière autour de laquelle il comptait rallier ses partisans: dix heures sonnaient à l’horloge du Pizzo.
Murat se dirigea aussitôt vers la ville, dont il était éloigné de cent pas à peine, par le chemin pavé de larges dalles disposées en escalier qui y conduit. C’était un dimanche; on allait commencer la messe, et toute la population était réunie sur la place lorsqu’il y arriva. Personne ne le reconnut, et chacun regardait avec étonnement ce brillant état-major, lorsqu’il vit parmi les paysans un ancien sergent qui avait servi dans sa garde de Naples. Il marcha droit à lui, et lui mettant la main sur l’épaule: «Tavella, lui dit-il, ne me reconnais-tu pas?» Mais comme celui-ci ne faisait aucune réponse: «Je suis Joachim Murat; je suis ton roi, lui dit-il: à toi l’honneur de crier le premier vive Joachim!» La suite de Murat fit aussitôt retentir l’air de ses acclamations; mais le Calabrais resta silencieux, et pas un de ses camarades ne répéta le cri dont le roi lui-même avait donné le signal; au contraire, une rumeur sourde courait par la multitude. Murat comprit ce frémissement d’orage. «Eh bien! dit-il à Tavella, si tu ne veux pas crier vive Joachim, va au moins me chercher un cheval, et de sergent que tu étais, je te fais capitaine.» Tavella s’éloigna sans répondre; mais au lieu d’accomplir l’ordre qu’il avait reçu, il rentra chez lui et ne reparut plus. Pendant ce temps, la population s’amassait toujours sans qu’un signe amical annonçât à Murat la sympathie qu’il attendait. Il sentit qu’il était perdu s’il ne prenait une résolution rapide. «A Monteleone!» s’écria-t-il en s’élançant le premier vers la route qui conduisait à cette ville. «A Monteleone! répétèrent en le suivant ses officiers et ses soldats. Et la foule, toujours silencieuse, s’ouvrit pour les laisser passer.
Mais à peine avait-il quitté la place, qu’une vive agitation se manifesta. Un homme nommé Georges Pellegrino sortit de chez lui armé d’un fusil et traversa la place en courant et en criant: Aux armes! Il savait que le capitaine Trenta Capelli, qui commandait la gendarmerie de Cosenza, était en ce moment au Pizzo, et il allait le prévenir. Le cri aux armes eut plus d’écho dans cette foule que n’en avait eu celui de vive Joachim. Tout Calabrais a un fusil, chacun courut chercher le sien, et lorsque Trenta Capelli et Pellegrino revinrent sur la place, ils trouvèrent près de deux cents hommes armés. Ils se mirent à leur tête et s’élancèrent aussitôt à la poursuite du roi; ils le rejoignirent à dix minutes de chemin à peu près de la place, à l’endroit où est aujourd’hui le pont. Murat en les voyant venir s’arrêta et les attendit.
Trenta Capelli s’avança alors le sabre à la main vers le roi.—Monsieur, lui dit celui-ci, voulez-vous troquer vos épaulettes de capitaine contre des épaulettes de général? Criez vive Joachim! et suivez moi avec ces braves gens à Monteleone.
—Sire, répondit Trenta Capelli, nous sommes tous fidèles sujets du roi Ferdinand, et nous venons pour vous combattre et non pour vous accompagner: rendez-vous donc si vous voulez prévenir l’effusion du sang.
Murat regarda le capitaine de gendarmerie avec une expression impossible à rendre; puis, sans daigner lui répondre, il lui fit signe de la main de s’éloigner, tandis qu’il portait l’autre à la crosse de l’un de ses pistolets. Georges Pellegrino vit le mouvement.
—Ventre à terre, capitaine! ventre à terre! cria-t-il. Le capitaine obéit, aussitôt une balle passa en sifflant au-dessus de sa tête et alla effleurer les cheveux de Murat.
—Feu! ordonna Franceschetti.
—Armes à terre! cria Murat; et, secouant de sa main droite son mouchoir, il fit un pas pour s’avancer vers les paysans; mais au même instant une décharge générale partit: un officier et deux ou trois soldats tombèrent. En pareille circonstance, quand le sang a commencé de couler, il ne s’arrête pas; Murat savait cette fatale vérité, aussi son parti fut-il pris, rapide et décisif. Il avait devant lui cinq cents hommes armés, et derrière lui un précipice de trente pieds de hauteur: il s’élança du rocher à pic sur lequel il se trouvait tomba dans le sable, et se releva sans être blessé, le général Franceschetti et son aide-de-camp Campana firent avec le même bonheur le même saut que lui, et tous trois descendirent rapidement vers la mer, à travers un petit bois qui s’étend jusqu’à cent pas du rivage, et qui les déroba un instant à la vue de leurs ennemis. A la sortie de ce bois, une nouvelle décharge les accueillit; les balles sifflèrent autour d’eux, mais n’atteignirent personne, et les trois fugitifs continuèrent leur course vers la plage.
Ce fut alors seulement que le roi s’aperçut que le canot qui l’avait déposé à terre était reparti. Les trois navires qui composaient sa flottille, loin d’être restés pour protéger son débarquement, avaient repris la mer et s’éloignaient à pleines voiles. Le Maltais Barbara emportait non-seulement la fortune de Murat, mais encore son espoir, son salut, sa vie: c’était à n’y pas croire à force de trahison. Aussi le roi prit-il cet abandon pour une simple manœuvre, et, voyant une barque de pêcheur tirée au rivage sur des filets étendus, il cria à ses deux compagnons:—La barque à la mer.
Tous alors commencèrent à la pousser pour la mettre à flot, avec l’énergie du désespoir, avec les forces de l’agonie. Personne n’avait osé franchir le rocher pour se mettre à leur poursuite; leurs ennemis, forcés de prendre un détour, leur laissaient quelques instans de liberté. Mais bientôt des cris se firent entendre: Georges Pellegrino, Trenta Capelli, suivis de toute la population du Pizzo, débouchèrent à cent cinquante pas à peu près de l’endroit où Murat, Franceschetti et Campana s’épuisaient en efforts pour faire glisser la barque sur le sable. Ces cris furent immédiatement suivis d’une décharge générale. Campana tomba: une balle venait de lui traverser la poitrine. Cependant la barque était à flot: le général Franceschetti s’élança dedans; Murat voulut le suivre, mais il ne s’était point aperçu que les éperons de ses bottes à l’écuyère s’étaient embarrassés dans les mailles du filet. La barque, cédant à l’impulsion donnée par lui, se déroba sous ses mains, et le roi tomba les pieds sur la plage et le visage dans la mer. Avant qu’il eût eu le temps de se relever, la population s’était ruée sur lui: en un instant elle lui arracha ses épaulettes, sa bannière et son habit, et elle allait le mettre en morceaux lui-même, si Georges Pellegrino et Trenta Capelli, prenant sa vie sous leur protection, ne lui avaient donné le bras de chaque côté, en le défendant à leur tour contre la populace. Il traversa ainsi en prisonnier la place qu’une heure auparavant il abordait en roi. Ses conducteurs le menèrent au château; on le poussa dans la prison commune, on referma la porte sur lui, et le roi se trouva au milieu des voleurs et des assassins, qui, ne sachant pas qui il était, et le prenant pour un compagnon de crimes, l’accueillirent par des injures et des huées.
Un quart d’heure après, la porte du cachot se rouvrit, le commandant Mattei entra: il trouva Murat débout, les bras croisés, la tête haute et fière. Il y avait une expression de grandeur indéfinissable dans cet homme à demi nu, et dont la figure était souillée de boue et de sang. Il s’inclina devant lui.
—Commandant, lui dit Murat, reconnaissant son grade à ses épaulettes, regardez autour de vous, et dites si c’est là une prison à mettre un roi!
Alors une chose étrange arriva: ces hommes du crime, qui, croyant Murat un de leurs complices, l’avaient accueilli avec des vociférations et des rires, se courbèrent devant la majesté royale, que n’avaient point respectée Pellegrino et Trenta Capelli, et se retirèrent silencieux au plus profond de leur cachot. Le malheur venait de donner un nouveau sacre à Joachim.
Le commandant Mattei murmura quelques excuses, et invita Murat à le suivre dans une chambre qu’il venait de lui faire préparer; mais, avant de sortir, Murat fouilla dans sa poche, en tira une poignée d’or, et la laissant tomber comme une pluie au milieu du cachot:
—Tenez, dit-il en se retournant vers les prisonniers, il ne sera pas dit que vous avez reçu la visite d’un roi, tout captif et découronné qu’il est, sans qu’il vous ait fait largesse.
—Vive Joachim! crièrent les prisonniers.
Murat sourit amèrement. Ces mêmes paroles, répétées par un pareil nombre de voix, il y a une heure, sur la place publique, au lieu de retentir dans une prison, le faisaient roi de Naples! Les résultats les plus importans sont amenés parfois par des causes si minimes, qu’on croirait que Dieu et Satan jouent aux dés la vie ou la mort des hommes, l’élévation ou la chute des empires.
Murat suivit le commandant Mattei: il le conduisit dans une petite chambre qui appartenait au concierge, et que celui-ci céda au roi. Il allait se retirer lorsque Murat le rappela:
—Monsieur le commandant, lui dit-il, je désire un bain parfumé.
—Sire, la chose est difficile.
—Voilà cinquante ducats; qu’on achète toute l’eau de Cologne qu’on trouvera. Ah! que l’on m’envoie des tailleurs.
—Il sera impossible de trouver ici des hommes capables de faire autre chose que des costumes du pays.
—Qu’on aille à Monteleone, et qu’on me ramène ici tous ceux qu’on pourra réunir.
Le commandant s’inclina et sortit.
Murat était au bain lorsqu’on lui annonça la visite du chevalier Alcala, général du prince de l’Infantado et gouverneur de la ville. Il faisait apporter des couvertures de damas, des draps et des fauteuils. Murat fut sensible à cette attention, et il en reprit une nouvelle sérénité.
Le même jour, à deux heures, le général Nunziante arriva de Saint-Tropea avec trois mille hommes. Murat revit avec plaisir une vieille connaissance; mais au premier mot, le roi s’aperçut qu’il était devant un juge, et que sa présence avait pour but, non pas une simple visite, mais un interrogatoire en règle. Murat se contenta de répondre qu’il se rendait de Corse à Trieste en vertu d’un passeport de l’empereur d’Autriche, lorsque la tempête, et le défaut de vivres l’avaient forcé de relâcher au Pizzo. A toutes les autres questions, Murat opposa un silence obstiné; puis enfin, fatigué de ses instances:—Général, lui dit-il, pouvez-vous me prêter des habits, afin que je sorte du bain?
Le général comprit qu’il n’avait rien à attendre de plus, salua le roi et sortit. Dix minutes après, Murat reçut un uniforme complet; il le revêtit aussitôt, demanda une plume et de l’encre, écrivit au général en chef des troupes autrichiennes à Naples, à l’ambassadeur d’Angleterre et à sa femme, pour les informer de sa détention au Pizzo. Ces dépêches terminées, il se leva, marcha quelque temps avec agitation dans la chambre; puis enfin, éprouvant le besoin d’air, il ouvrit la fenêtre. La vue s’étendait sur la plage même où il avait été arrêté.
Deux hommes creusaient un trou dans la sable, au pied de la petite redoute ronde. Murat les regarda faire machinalement. Lorsque ces deux hommes eurent fini, ils entrèrent dans une maison voisine, et bientôt ils en sortirent portant entre leurs bras un cadavre. Le roi rappela ses souvenirs, et il lui sembla en effet qu’il avait, au milieu de cette scène terrible, vu tomber quelqu’un auprès de lui; mais il ne savait plus qui. Le cadavre était complètement nu; mais à ses longs cheveux noirs, à la jeunesse de ses formes, le roi reconnut Campana: c’était celui de ses aides-de-camp qu’il aimait le mieux. Cette scène, vue à l’heure du crépuscule, vue de la fenêtre d’une prison; cette inhumation dans la solitude, sur cette plage, dans le sable, émurent plus fortement Murat que n’avaient pu le faire ses propres infortunes. De grosses larmes vinrent au bord de ses yeux et coulèrent silencieusement sur sa face de lion. En ce moment le général Nunziante rentra et le surprit les bras tendus, le visage baigné de pleurs. Murat entendit du bruit, se retourna, et voyant l’étonnement du vieux soldat:—Oui, général, lui dit-il, oui, je pleure. Je pleure sur cet enfant de vingt-quatre ans, que sa famille m’avait confié, et dont j’ai causé la mort; je pleure sur cet avenir vaste, riche et brillant, qui vient de s’éteindre dans une fosse ignorée, sur une terre ennemie, sur un rivage hostile. O Campana! Campana! si jamais je remonte sur le trône, je te ferai élever un tombeau royal.
Le général avait fait préparer un dîner dans la chambre attenante à celle qui servait de prison au roi: Murat l’y suivit, se mit à table, mais ne put manger. Le spectacle auquel il venait d’assister lui avait brisé le cœur; et cependant cet homme avait parcouru sans froncer le sourcil les champs de bataille d’Aboukir, d’Eylau et de la Moskowa!
Après le dîner, Murat rentra dans sa chambre, remit au général Nunziante les diverses lettres qu’il avait écrites, et le pria de le laisser seul. Le général sortit.
Murat fit plusieurs fois le tour de sa chambre, se promenant à grands pas et s’arrêtant de temps en temps devant la fenêtre, mais sans l’ouvrir. Enfin il parut surmonter une répugnance profonde, porta la main sur l’espagnolette et tira la croisée à lui. La nuit était calme, on distinguait toute la plage. Il chercha des yeux la place où était enterré Campana: deux chiens qui grattaient la tombe la lui indiquèrent. Le roi repoussa la fenêtre avec violence, et se jeta tout habillé sur son lit. Enfin, craignant qu’on attribuât son agitation à une crainte personnelle, il se dévêtit, se coucha et dormit, ou parut dormir toute la nuit.
Le 9 au matin, les tailleurs que Murat avait demandés arrivèrent. Il leur commanda force habits, dont il prit la peine de leur expliquer les détails avec sa fastueuse fantaisie. Il était occupé de ce soin, lorsque le général Nunziante entra. Il écouta tristement les ordres que donnait le roi: il venait de recevoir des dépêches télégraphiques qui ordonnaient au général de faire juger le roi de Naples, comme ennemi public, par une commission militaire. Mais celui-ci trouva le roi si confiant, si tranquille, et presque si gai, qu’il n’eut pas le courage de lui annoncer la nouvelle de sa mise en jugement; il prit même sur lui de retarder l’ouverture de la commission militaire jusqu’à ce qu’il eût reçu une dépêche écrite. Elle arriva le 12 au soir. Elle était conçue en ces termes:
Naples, 9 octobre 1815
«Ferdinand, par la grâce de Dieu, etc., avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er, Le général Murat sera traduit devant une commission militaire, dont les membres seront nommés par notre ministre de la guerre.
Art. 2. Il ne sera accordé au condamné qu’une demi-heure pour recevoir les secours de la religion.
Signé Ferdinand.»
Un autre arrêté du ministre contenait les noms des membres de la commission; c’étaient:
Giuseppe Fasculo, adjudant, commandant et chef de l’état-major, président;
Laffaello Scalfaro, chef de la légion de la Calabre inférieure;
Latereo Natali, lieutenant-colonel de la marine royale;
Gennaro Lanzetta, lieutenant-colonel du corps du génie;
W. T., capitaine d’artillerie;
François de Vengé, idem;
Francesco Martellari, lieutenant d’artillerie;
Francesco Froio, lieutenant au 3e régiment;
Giovanni della Camera, procureur-général au tribunal criminel de la Calabre inférieure;
Et Francesco Papavassi, greffier.
La commission s’assembla dans la nuit. Le 13 octobre, à six heures du matin, le capitaine Stratti entra dans la prison du roi, il dormait profondément: Stratti allait sortir, lorsqu’en marchant vers la porte il heurta une chaise; ce bruit réveilla Murat.—Que me voulez-vous, capitaine? demanda le roi.
Stratti voulut parler, mais la voix lui manqua.
—Ah! ah! dit Murat, il paraît que vous avez reçu des nouvelles de Naples?...
—Oui, sire, murmura Stratti.
—Qu’annoncent-elles? dit Murat.
—Votre mise en jugement, sire.
—Et par qui l’arrêt sera-t-il prononcé, s’il vous plaît? Où trouvera-t-on des pairs pour me juger? Si l’on me considère comme un roi, il faut assembler un tribunal de rois; si l’on me considère comme un maréchal de France, il me faut une cour de maréchaux, et si l’on me considère comme général, et c’est le moins qu’on puisse faire, il me faut un jury de généraux.
—Sire, vous êtes déclaré ennemi public, et comme tel vous êtes passible d’une commission militaire; c’est la loi que vous avez rendue vous-même contre les rebelles.
—Cette loi fut faite pour des brigands, et non pour des têtes couronnées, monsieur, dit dédaigneusement Murat. Je suis prêt, que l’on m’assassine, c’est bien; je n’aurais pas cru le roi Ferdinand capable d’une pareille action.
—Sire, ne voulez-vous pas connaître la liste de vos juges?
—Si fait, monsieur, si fait; ce doit être une chose curieuse: lisez, je vous écoute.
Le capitaine Stratti lut les noms que nous avons cités. Murat les entendit avec un sourire dédaigneux.
—Ah! continua-t-il lorsque le capitaine eut achevé, il paraît que toutes les précautions sont prises.
—Comment cela, sire?
—Oui, ne savez-vous pas que tous ces hommes, à l’exception du rapporteur Francesco Froio, me doivent leurs grades; ils auront peur d’être accusés de reconnaissance, et, moins une voix peut-être, l’arrêt sera unanime.
—Sire, si vous paraissiez devant la commission, si vous plaidiez vous-même votre cause?
—Silence, monsieur, silence... dit Murat. Pour que je reconnaisse les juges que l’on m’a nommés, il faudrait déchirer trop de pages de l’histoire; un tel tribunal est incompétent, et j’aurais honte de me présenter devant lui; je sais que je ne puis sauver ma vie, laissez-moi sauver au moins la dignité royale.
En ce moment, le lieutenant Francesco Froio entra pour interroger le prisonnier, et lui demanda ses noms, son âge, sa patrie. A ces questions, Murat se leva avec une expression de dignité terrible:—Je suis Joachim Napoléon, roi des Deux-Siciles, lui répondit-il, et je vous ordonne de sortir.—Le rapporteur obéit.
Alors Murat passa un pantalon seulement, et demanda à Stratti s’il pouvait adresser des adieux à sa femme et à ses enfans. Celui-ci, ne pouvant plus parler, répondit par un geste affirmatif; aussitôt Joachim s’assit à une table, et écrivit cette lettre[9]:
«Chère Caroline de mon cœur,
»L’heure fatale est arrivée, je vais mourir du dernier des supplices; dans une heure tu n’auras plus d’époux, et nos enfans n’auront plus de père: souvenez-vous de moi et n’oubliez jamais ma mémoire.
»Je meurs innocent, et la vie m’est enlevée par un jugement injuste.
»Adieu, mon Achille; adieu, ma Lætitia; adieu, mon Lucien; adieu, ma Louise.
»Montrez-vous dignes de moi; je vous laisse sur une terre et dans un royaume pleins de mes ennemis: montrez-vous supérieurs à l’adversité, et souvenez-vous de ne pas vous croire plus que vous n’êtes, en songeant à ce que vous avez été.
»Adieu, je vous bénis. Ne maudissez jamais ma mémoire. Rappelez-vous que la plus grande douleur que j’éprouve dans mon supplice est celle de mourir loin de mes enfans, loin de ma femme, et de n’avoir aucun ami pour me fermer les yeux.
»Adieu, ma Caroline; adieu, mes enfans; recevez ma bénédiction paternelle, mes tendres larmes et mes derniers baisers.
»Adieu, adieu; n’oubliez pas votre malheureux père.
»Pizzo, ce 15 octobre 1815.
»Joachim MURAT.»
Alors il coupa une boucle de ses cheveux et la mit dans la lettre: en ce moment le général Nunziante entra; Murat alla à lui et lui tendit la main:—Général, lui dit-il, vous êtes père, vous êtes époux, vous saurez un jour ce que c’est que de quitter sa femme et ses fils. Jurez-moi que cette lettre sera remise.
—Sur mes épaulettes, dit le général[10] en s’essuyant les yeux.
—Allons, allons, du courage, général, dit Murat; nous sommes soldats, nous savons ce que c’est que la mort. Une seule grâce: vous me laisserez commander le feu, n’est-ce pas? Le général fit signe de la tête que cette dernière faveur lui serait accordée; en ce moment le rapporteur entra, la sentence du roi à la main. Murat devina ce dont il s’agisssait:—Lisez, monsieur, lui dit-il froidement, je vous écoute.—Le rapporteur obéit. Murat ne s’était pas trompé; il y avait eu, moins une voix, unanimité pour la peine de mort.
Lorsque la lecture fut finie, le roi se retourna vers Nunziante:—Général, lui dit-il, croyez que je sépare, dans mon esprit, l’instrument qui me frappe de la main qui le dirige. Je n’aurais pas cru que Ferdinand m’eût fait fusiller comme un chien; il ne recule pas devant cette infamie! c’est bien, n’en parlons plus. J’ai récusé mes juges, mais non pas mes bourreaux. Quelle est l’heure que vous désignez pour mon exécution?
—Fixez-la vous-même, sire, dit le général.
Murat tira de son gousset une montre sur laquelle était le portrait de sa femme; le hasard fit qu’elle était tournée de manière que ce fut le portrait et non le cadran qu’il amena devant ses yeux; il le regarda avec tendresse:
—Tenez, général, dit-il en le montrant à Nunziante, c’est le portrait de la reine, vous la connaissez; n’est-ce pas qu’elle est bien ressemblante?
Le général détourna la tête. Murat poussa un soupir et remit la montre dans son gousset.
—Eh bien! sire, dit le rapporteur, quelle heure fixez-vous?
—Ah! c’est juste, dit Murat en souriant, j’avais oublié pourquoi j’avais tiré ma montre en voyant le portrait de Caroline.—Alors il regarda sa montre de nouveau, mais cette fois du côté du cadran.—Eh bien! ce sera pour quatre heures, si vous voulez; il est trois heures passées, c’est cinquante minutes que je vous demande, est-ce trop, monsieur?
Le rapporteur s’inclina et sortit. Le général voulut le suivre.
—Ne vous reverrai-je plus, Nunziante? dit Murat.
—Mes ordres m’enjoignent d’assister à votre mort, sire; mais je n’en aurai pas la force.
—C’est bien, général, c’est bien; je vous dispense d’être là au dernier moment; mais je désire vous dire adieu encore une fois et vous embrasser.
—Je me trouverai sur votre route, sire.
—Merci. Maintenant laissez-moi seul.
—Sire, il y a là deux prêtres.—Murat fit un signe d’impatience.—Voulez-vous les recevoir? continua le général.
—Oui, faites-les entrer.
Le général sortit. Un instant après les deux prêtres parurent au seuil de la porte; l’un se nommait don Francesco Pellegrino: c’était l’oncle de celui qui avait causé la mort du roi; et l’autre don Antonio Masdea.
—Que venez-vous faire ici? leur dit Murat.
—Vous demander si vous voulez mourir en chrétien.
—Je mourrai en soldat. Laissez-moi.
Don Francesco Pellegrino se retira. Sans doute, il était mal à l’aise devant Joachim. Quant à Antonio Masdea, il resta sur la porte.
—Ne m’avez-vous pas entendu? dit le roi.
—Si fait, répondit le vieillard; mais permettez-moi, sire, de ne pas croire que c’est votre dernier mot. Ce n’est pas pour la première fois que je vous vois et que je vous implore; j’ai déjà eu l’occasion de vous demander une grâce.
—Laquelle?
—Lorsque votre majesté vint au Pizzo, en 1810, je lui demandai 25,000 francs pour faire achever notre église; votre majesté m’en envoya 40,000.
—C’est que je prévoyais que j’y serais enterré, répondit en souriant Murat.
—Eh bien! sire, j’aime à croire que vous ne refuserez pas plus ma seconde prière que vous ne m’avez refusé la première. Sire, je vous le demande à genoux.
Le vieillard tomba aux pieds de Murat.
—Mourez en chrétien!
—Cela vous fera donc bien plaisir? dit le roi.
—Sire, je donnerais le peu de jours qui me restent pour obtenir de Dieu que son esprit vous visitât à votre dernière heure.
—Eh bien! dit Murat, écoutez ma confession: Je m’accuse, étant enfant, d’avoir désobéi à mes parens; depuis que je suis devenu un homme, je n’ai jamais eu autre chose à me reprocher.
—Sire, me donnerez-vous une attestation que vous mourez dans la religion chrétienne?
—Sans doute, dit Murat; et il prit une plume et écrivit:
«Moi, Joachim Murat, je meurs en chrétien, croyant à la sainte Église catholique, apostolique et romaine.» Et il signa.
—Maintenant, mon père, continua le roi, si vous avez une troisième grâce à me demander, hâtez-vous, car dans une demi-heure il ne serait plus temps. En effet, l’horloge du château sonna en ce moment trois heures et demie.
Le prêtre fit signe que tout était fini.—Laissez-moi donc seul, dit Murat. Le vieillard sortit.
Murat se promena quelques minutes à grands pas dans la chambre; puis il s’assit sur son lit et laissa tomber sa tête dans ses deux mains. Sans doute, pendant le quart d’heure où il resta ainsi absorbé dans ses pensées, il vit repasser devant lui sa vie tout entière, depuis l’auberge d’où il était parti jusqu’au palais où il était entré; sans doute, son aventureuse carrière se déroula pareille à un rêve doré, à un mensonge brillant, à un conte des Mille et une Nuits. Comme un arc-en-ciel, il avait brillé pendant un orage, et comme un arc-en-ciel, ses deux extrémités se perdaient dans les nuages de sa naissance et de sa mort. Enfin il sortit de sa contemplation intérieure et releva son front pâle, mais tranquille. Alors il s’approcha d’une glace, arrangea ses cheveux: son caractère étrange ne le quittait pas. Fiancé de la mort, il se faisait beau pour elle.
Quatre heures sonnèrent.
Murat alla lui-même ouvrir la porte.
Le général Nunziante l’attendait.
—Merci, général, lui dit Murat: vous m’avez tenu parole; embrassez moi, et retirez-vous ensuite, si vous le voulez.
Le général se jeta dans les bras du roi en pleurant et sans pouvoir prononcer une parole:
—Allons, du courage, lui dit Murat; vous voyez bien que je suis tranquille.
C’était cette tranquillité qui brisait le courage du général! il s’élança hors du corridor et sortit du château en courant comme un insensé.
Alors le roi marcha vers la cour: tout était prêt pour l’exécution. Neuf hommes et un caporal étaient rangés en ligne devant la porte de la chambre du conseil. Devant eux était un mur de douze pieds de haut; trois pas avant ce mur était un seuil d’un seul degré: Murat alla se placer sur cet escalier, qui lui faisait dominer d’un pied à peu près les soldats chargés de son exécution. Arrivé là, il tira sa montre, baisa le portrait de sa femme, et les yeux fixés sur lui, il commanda la charge des armes. Au mot feu! cinq des neuf hommes tirèrent: Murat resta debout. Les soldats avaient eu honte de tirer sur leur roi; ils avaient visé au-dessus de sa tête.
Ce fut peut-être en ce moment qu’éclata le plus magnifiquement ce courage de lion qui était la vertu particulière de Murat. Pas un trait de son visage ne s’altéra, pas un muscle de son corps ne faiblit; seulement, regardant les soldats avec une expression de reconnaissance amère:
—Merci, mes amis, leur dit-il; mais, comme tôt ou tard vous serez obligés de viser juste, ne prolongez pas mon agonie. Tout ce que je vous demande, c’est de viser au cœur et d’épargner la figure. Recommençons.
Et avec la même voix, avec le même calme, avec le même visage, il répéta les paroles mortelles les unes après les autres, sans lenteur, sans précipitation, et comme il eût commandé une simple manœuvre; mais cette fois, plus heureux que la première, au mot feu! il tomba percé de huit balles, sans faire un mouvement, sans pousser un soupir, sans lâcher la montre qu’il tenait serrée dans sa main gauche[11].
Les soldats ramassèrent le cadavre, le couchèrent sur le lit, où dix minutes auparavant il était assis, et le capitaine mit une garde à la porte.
Le soir, un homme se présenta pour entrer dans la chambre mortuaire: la sentinelle lui en refusa l’entrée; mais cet homme demanda à parler au commandant du château. Conduit devant lui, il lui montra un ordre. Le commandant le lut avec une surprise mêlée de dégoût; puis, la lecture achevée, il le conduisit jusqu’à la porte qu’on lui avait refusée.
—Laisser passer le seigneur Luidgi, dit-il à la sentinelle. La sentinelle présenta les armes à son commandant. Luidgi entra.
Dix minutes s’étaient à peine écoulées, lorsqu’il sortit tenant à la main un mouchoir ensanglanté. Dans ce mouchoir était un objet que la sentinelle ne put reconnaître.
Une heure après, un menuisier apporta le cercueil qui devait renfermer les restes du roi. L’ouvrier entra dans la chambre; mais presque aussitôt il appela la sentinelle avec un accent indicible d’effroi. Le soldat entrebâilla la porte pour regarder ce qui avait pu causer la terreur de cet homme. Le menuisier lui montra du doigt un cadavre sans tête.
A la mort du roi Ferdinand, on retrouva dans une armoire secrète de sa chambre à coucher cette tête conservée dans de l’esprit-de-vin[12].
Huit jours après l’exécution du Pizzo, chacun avait déjà reçu sa récompense: Trenta Capelli était fait colonel, le général Nunziante était créé marquis, et Luidgi était empoisonné.
[8] Bâtimens légers armés en guerre.
[9] Nous pouvons en garantir l’authenticité, l’ayant transcrite nous-même au Pizzo, sur la copie qu’avait conservée de l’original le chevalier Alcala.
[10] Cette lettre n’est jamais parvenue à madame Murat.
[11] Madame Murat a racheté cette montre 200 louis.
[12] Comme je ne crois pas aux atrocités sans motifs, je demandai au général T. la raison de celle-ci; il me répondit que, comme Murat avait été jugé et fusillé dans un coin perdu de la Calabre, le roi de Naples craignait toujours que quelque aventurier ne se présentât sous le nom de Joachim: on lui eût répondu alors en lui montrant la tête de Murat.

Ces détails m’étaient d’autant plus précieux, que je comptais, dans quelques mois, partir pour l’Italie et visiter moi-même les lieux qui avaient servi de théâtre aux principales scènes que nous venons de raconter. Aussi, en reportant le manuscrit du général T., usai-je largement de la permission qu’il m’avait donnée de mettre à contribution ses souvenirs sur les lieux qu’il avait visités. On retrouvera donc, dans mon voyage d’Italie, une foule de détails recueillis par moi, il est vrai, mais dont je dois les indications à son obligeance. Cependant mon consciencieux cicérone m’abandonna à la pointe de la Calabre, et ne voulut jamais traverser le détroit. Quoique exilé deux ans à Lipari et en vue de ses côtes, il n’avait jamais mis le pied en Sicile, et craignait, en sa qualité de Napolitain, de ne pouvoir se soustraire, en m’en parlant, à l’influence de la haine que les deux peuples ont l’un pour l’autre.
Je m’étais donc mis en quête d’un réfugié sicilien, nommé Palmieri, que j’avais rencontré autrefois, mais dont j’avais perdu l’adresse, et qui venait de publier deux excellens volumes de souvenirs, afin de me procurer, sur son île si poétique et si inconnue, ces renseignemens généraux et ces désignations particulières qui posent d’avance les bornes milliaires d’un voyage, lorsqu’un soir nous vîmes arriver, faubourg Montmartre, no 4, le général T. avec Bellini, auquel je n’avais pas songé, et qu’il m’amenait pour compléter mon itinéraire. Il ne faut pas demander comment fut reçu dans notre réunion tout artistique, où souvent le fleuret n’était qu’un prétexte emprunté par la plume ou le pinceau, l’auteur de la Somnambule et de la Norma. Bellini était de Catane: la première chose qu’avaient vue ses yeux en s’ouvrant, étaient ces flots qui, après avoir baigné les murs d’Athènes, viennent mourir mélodieusement aux rivages d’une autre Grèce, et cet Etna fabuleux et antique, aux flancs duquel vivent encore, après dix-huit cents ans, la mythologie d’Ovide et les récits de Virgile. Aussi Bellini était-il une des natures les plus poétiques qu’il fût possible de rencontrer; son talent même, qu’il faut apprécier avec le sentiment, et non juger avec la science, n’est qu’un chant éternel, doux et mélancolique comme un souvenir; un écho pareil à celui qui dort dans les bois et les montagnes, et qui murmure à peine tant que ne le vient pas éveiller le cri des passions et de la douleur. Bellini était donc l’homme qu’il me fallait. Il avait quitté la Sicile jeune encore, de sorte qu’il lui était resté de son île natale cette mémoire grandissante que conserve religieusement, transporté loin des lieux où il a été élevé, le souvenir poétique de l’enfant. Syracuse, Agrigente, Palerme, se déroulèrent ainsi sous mes yeux: magnifique panorama, inconnu alors pour moi, et éclairé par les lueurs de son imagination; puis enfin, passant des détails topographiques aux mœurs du pays, sur lesquelles je ne me lassais pas de l’interroger:—Tenez, me dit-il, n’oubliez pas de faire une chose lorsque vous irez de Palerme à Messine soit par mer, soit par terre. Arrêtez-vous au petit village de Bauso, près de la pointe du cap Blanc; en face de l’auberge, vous trouverez une rue qui va en montant, et qui est terminée à droite par un petit château en forme de citadelle; aux murs de ce château il y a deux cages, l’une vide, l’autre dans laquelle blanchit depuis vingt ans une tête de mort. Demandez au premier passant venu l’histoire de l’homme à qui a appartenu cette tête, et vous aurez un de ces récits complets qui déroulent toute une société, depuis la montagne jusqu’à la ville, depuis le paysan jusqu’au grand seigneur.
—Mais, répondis-je à Bellini, ne pourriez-vous pas vous-même nous raconter cette histoire? A la manière dont vous en parlez, on voit que vous en avez gardé un profond souvenir.
—Je ne demanderais pas mieux, me dit-il, car Pascal Bruno, qui en est le héros, est mort l’année même de ma naissance, et j’ai été bercé tout enfant avec cette tradition populaire, encore vivante aujourd’hui, j’en suis sûr: mais comment ferai-je, avec mon mauvais français, pour me tirer d’un pareil récit?
—N’est-ce que cela? répondis-je, nous entendons tous l’italien; parlez-nous la langue de Dante, elle en vaut bien une autre.
—Eh bien! soit, reprit Bellini en me tendant, la main, mais à une condition.
—Laquelle?
—C’est qu’à votre retour, quand vous aurez vu les localités, quand vous vous serez retrempé au milieu de cette population sauvage et de cette nature pittoresque, vous me ferez un opéra de Pascal Bruno.
—Pardieu! c’est chose dite, m’écriai-je en lui tendant la main.
Et Bellini raconta l’histoire qu’on va lire.
Six mois après je partis pour l’Italie, je visitai la Calabre, j’abordai en Sicile, et ce que je voyais toujours comme le point désiré, comme le but de mon voyage, au milieu de tous les grands souvenirs, c’était cette tradition populaire que j’avais entendue de la bouche du musicien-poète, et que je venais chercher de huit cent lieues; enfin j’arrivai à Bauso, je vis l’auberge, je montai dans la rue, j’aperçus les deux cages de fer, dont l’une était vide et l’autre pleine.
Puis je revins à Paris après un an d’absence; alors, me souvenant de l’engagement pris et de la promesse à accomplir, je cherchai Bellini.
Je trouvai une tombe.
Il en est des villes comme des hommes; le hasard préside à leur fondation ou à leur naissance, et l’emplacement topographique où l’on bâtit les unes, la position sociale dans laquelle naissent les autres, influent en bien ou en mal sur toute leur existence: j’ai vu de nobles cités si fières, qu’elles avaient voulu dominer tout ce qui les entourait, si bien que quelques maisons à peine avaient osé s’établir au sommet de la montagne où elles avaient posé leur fondement: aussi restaient-elles toujours hautaines et pauvres, cachant dans les nuages leurs fronts crénelés et incessamment battus par les orages de l’été et par les tempêtes de l’hiver. On eût dit des reines exilées, suivies seulement de quelques courtisans de leur infortune, et trop dédaigneuses pour s’abaisser à venir demander à la plaine un peuple et un royaume. J’ai vu de petites villes si humbles qu’elles s’étaient réfugiées au fond d’une vallée, qu’elles y avaient bâti au bord d’un ruisseau leurs fermes, leurs moulins et leurs chaumières, qu’abritées par des collines, qui les garantissaient du chaud et du froid, elles y coulaient une vie ignorée et tranquille, pareille à celle de ces hommes sans ardeur et sans ambition, que tout bruit effraie, que toute lumière éblouit, et pour lesquels il n’est de bonheur que dans l’ombre et le silence. Il y en a d’autres qui ont commencé par être un chétif village au bord de la mer et qui, petit à petit, voyant les navires succéder aux barques et les vaisseaux aux navires, ont changé leurs chaumières en maisons et leurs maisons en palais; si bien qu’aujourd’hui l’or du Potose et les diamans de l’Inde affluent dans leurs ports, et qu’elles font sonner leurs ducats et étalent leurs parures, comme ces parvenus qui nous éclaboussent avec leurs équipages et nous font insulter par leurs valets. Enfin, il y en a encore qui s’étaient richement élevées d’abord au milieu des prairies riantes, qui marchaient sur des tapis bariolés de fleurs, auxquelles on arrivait par des sentiers capricieux et pittoresques, à qui l’on eût prédit de longues et prospères destinées, et qui tout-à-coup ont vu leur existence menacée par une ville rivale, qui, surgissant au bord d’une grande route, attirait à elle commerçans et voyageurs, et laissait la pauvre isolée dépérir lentement comme une jeune fille dont un amour solitaire tarit les sources de la vie. Voilà pourquoi on se prend de sympathie ou de répugnance, d’amour ou de haine, pour telle ou telle ville comme pour telle ou telle personne; voilà ce qui fait qu’on donne à des pierres froides et inanimées des épithètes qui n’appartiennent qu’à des êtres vivans et humains; que l’on dit Messine la noble, Syracuse la fidèle, Girgenti la magnifique, Tapani l’invincible, Palerme l’heureuse.
En effet, s’il fut une ville prédestinée, c’est Palerme: située sous un ciel sans nuages, sur un sol fertile, au milieu de campagnes pittoresques, ouvrant son port à une mer qui roule des flots d’azur, protégée au nord par la colline de Sainte-Rosalie, à l’orient par le cap Naferano, encadrée de tous côtés par une chaîne de montagnes qui ceint la vaste plaine où elle est assise, jamais odalisque bysantine ou sultane égyptienne ne se mira avec plus d’abandon, de paresse et de volupté, dans les flots de la Cyrénaïque ou du Bosphore, que ne le fait, le visage tourné du côté de sa mère, l’antique fille de Chaldée. Aussi vainement a-t-elle changé de maîtres, ses maîtres ont disparu, et elle est restée; et de ses dominateurs différens, séduits toujours par sa douceur et par sa beauté, l’esclave reine n’a gardé que des colliers pour toutes chaînes. C’est qu’aussi, les hommes et la nature se sont réunis pour la faire magnifique parmi les riches. Les Grecs lui ont laissé leurs temples, les Romains leurs aqueducs, les Sarrasins leurs châteaux, les Normands leurs basiliques, les Espagnols leurs églises; et comme la latitude où elle est située permet à toute plante d’y fleurir, à tout arbre de s’y développer, elle rassemble dans ses jardins splendides le laurier-rose de la Laconie, le palmier d’Egypte, la figue de l’Inde, l’aloës d’Afrique, le pin d’Italie, le cyprès d’Écosse et le chêne de France.
Aussi n’est-il rien de plus beau que les jours de Palerme, si ce n’est ses nuits; nuits d’Orient, nuits transparentes et embaumées, où le murmure de la mer, le frémissement de la brise, la rumeur de la ville, semblent un concert universel d’amour, où chaque chose de la création, depuis la vague jusqu’à la plante, depuis la plante jusqu’à l’homme, jette un mystérieux soupir. Montez sur la plate-forme de la Zisa, ou sur la terrasse du Palazzo Reale, lorsque Palerme dort, et il vous semblera être assis au chevet d’une jeune fille qui rêve de volupté.
C’est l’heure à laquelle les pirates d’Alger et les corsaires de Tunis sortent de leurs repaires, mettent au vent les voiles triangulaires de leurs felouques barbaresques, et rôdent autour de l’île, comme autour d’un bercail, les hyènes du Zahara et les lions de l’Atlas. Malheur alors aux villes imprudentes qui s’endorment sans fanaux et sans gardes au bord de la mer, car leurs habitans se réveillent aux lueurs de l’incendie et aux cris de leurs femmes et de leurs filles, et avant que les secours ne soient arrivés, les vautours d’Afrique se seront envolés avec leurs proies; puis, quand le jour viendra, on verra les ailes de leurs vaisseaux blanchir à l’horizon et disparaître derrière les îles de Porri, de Favignana ou de Lampadouze.
Parfois aussi il arrive que la mer prend tout-à-coup une teinte livide, que la brise tombe, que la ville se tait: c’est que quelques nuages sanglans qui courent rapidement du midi au septentrion ont passé dans le ciel; c’est que ces nuages annoncent le sirocco, ce khamsin tant redouté des Arabes, vapeur ardente qui prend naissance dans les sables de la Lybie, et que les vents du sud-est poussent sur l’Europe: aussitôt tout se courbe, tout souffre, tout se plaint: l’île entière gémit comme lorsque l’Etna menace; les animaux et les hommes cherchent avec inquiétude un abri; et lorsqu’ils l’ont trouvé, ils se couchent haletans, car ce vent abat tout courage, paralyse toute force, éteint toute faculté. Palerme alors râle pareille à une agonisante, et cela jusqu’au moment où un souffle pur, arrivant de la Calabre, rend la force à la moribonde qui tressaille à cet air vivifiant, se reprend à l’existence, respire avec le même bonheur que si elle sortait d’un évanouissement, et le lendemain recommence, insoucieuse, sa vie de plaisir et de joie.
C’était un soir du mois de septembre 1803; il avait fait sirocco toute la journée; mais au coucher du soleil le ciel s’était éclairci, la mer était redevenue azurée, et quelques bouffées d’une brise fraîche soufflaient de l’archipel lipariote. Ce changement atmosphérique exerçait, comme nous l’avons dit, son influence bienfaisante sur tous les êtres animés, qui sortaient peu à peu de leur torpeur: on eût cru assister à une seconde création, d’autant plus, comme nous l’avons dit, que Palerme est un véritable Eden.
Parmi toutes les filles d’Ève, qui, dans ce paradis qu’elles habitent, font de l’amour leur principale occupation, il en est une qui jouera un rôle trop important dans le cours de cette histoire pour que nous n’arrêtions pas sur elle et sur le lieu qu’elle habite l’attention et les regards de nos lecteurs: qu’ils sortent donc avec nous de Palerme par la porte de San-Georgio; qu’ils laissent à droite Castello-à-Mare, qu’ils gagnent directement le môle, qu’ils suivent quelque temps le rivage, et qu’ils fassent halte à cette délicieuse villa qui s’élève au bord de la mer, et dont les jardins enchantés s’étendent jusqu’au pied du mont Pellegrino; c’est la villa du prince de Carini, vice-roi de Sicile pour Ferdinand IV, qui est retourné prendre possession de sa belle ville de Naples.
Au premier étage de cette élégante villa, dans une chambre tendue de satin bleu de ciel, dont les draperies sont relevées par des cordons de perles, et dont le plafond est peint à fresque, une femme vêtue d’un simple peignoir est couchée sur un sofa, les bras pendans, la tête renversée et les cheveux épars; il n’y a qu’un instant encore qu’on aurait pu la prendre pour une statue de marbre: mais un léger frémissement a couru par tout son corps, ses joues commencent à se colorer, ses yeux viennent de se rouvrir; la statue merveilleuse s’anime, soupire, étend la main vers une petite sonnette d’argent posée sur une petite table de marbre de Sélinunte, l’agite paresseusement, et comme fatiguée de l’effort qu’elle a fait, se laisse retomber sur le sofa. Cependant le son argentin a été entendu, une porte s’ouvre, et une jeune et jolie camérière, dont la toilette en désordre annonce qu’elle a, comme sa maîtresse, subi l’influence du vent africain, paraît sur le seuil.
—Est-ce vous, Teresa? dit languissamment sa maîtresse en tournant la tête de son côté. O mon Dieu! c’est pour en mourir; est-ce que ce sirocco soufflera toujours?
—Non, signora, il est tout-à-fait tombé, et l’on commence à respirer.
—Apportez-moi des fruits et des glaces, et donnez-moi de l’air.
Teresa accomplit ces deux ordres avec autant de promptitude que le lui permettait un reste de langueur et de malaise. Elle déposa les rafraîchissemens sur la table, et alla ouvrir la fenêtre qui donnait sur la mer.
—Voyez, madame la comtesse, dit-elle, nous aurons demain une magnifique journée, et l’air est si pur que l’on voit parfaitement l’île d’Alicudi, quoique le jour commence à baisser.
—Oui, oui, cet air fait du bien. Donne-moi le bras, Teresa, je vais essayer de me traîner jusqu’à cette fenêtre.
La camérière s’approcha de sa maîtresse, qui reposa sur la table le sorbet que ses lèvres avaient effleuré à peine, et qui, s’appuyant sur son épaule, marcha languissamment jusqu’au balcon.
—Ah! dit-elle en aspirant l’air du soir, comme on renaît à cette douce brise! Approche moi ce fauteuil, et ouvre encore la fenêtre qui donne sur le jardin. Bien! le prince est-il revenu de Monsréal?
—Pas encore.
—Tant mieux: je ne voudrais pas qu’il me vît pâle et défaite ainsi. Je dois être affreuse.
—Madame la comtesse n’a jamais été plus belle; et je suis sûre que dans toute cette ville, que nous découvrons d’ici, il n’y a pas une femme qui ne soit jalouse de la signora.
—Même la marquise de Rudini? même la princesse de Butera?
—Je n’excepte personne.
—Le prince vous paie pour me flatter, Teresa.
—Je jure à madame que je ne lui dis que ce que je pense.
—Oh! qu’il fait doux à vivre à Palerme, dit la comtesse respirant à pleine poitrine.
—Surtout lorsqu’on a vingt-deux ans, qu’on est riche et qu’on est belle, continua en souriant Teresa.
—Tu achèves ma pensée: aussi je veux voir tout le monde heureux autour de moi. A quand ton mariage, hein?
Teresa ne répondit point.
—N’était-ce pas dimanche prochain le jour fixé? continua la comtesse.
—Oui, signora, répondit la camérière en soupirant.
—Qu’est-ce donc? n’es-tu plus décidée?
—Si fait, toujours.
—As-tu de la répugnance pour Gaëtano?
—Non; je crois que c’est un honnête garçon, et qui me rendra heureuse. D’ailleurs, ce mariage est un moyen de rester toujours près de madame la comtesse, et c’est ce que je désire.
—Pourquoi soupires-tu, alors?
—Que la signora me pardonne; c’est un souvenir de notre pays.
—De notre pays?
—Oui. Quand madame la comtesse se souvint à Palerme qu’elle avait laissé une sœur de lait au village dont son père était le seigneur, et qu’elle m’écrivit de la venir rejoindre, j’étais près d’épouser un jeune garçon de Bauso.
—Pourquoi ne m’as-tu point parlé de cela? le prince, à ma recommandation, l’aurait pris dans sa maison.
—Oh! il n’aurait pas voulu être domestique; il est trop fier pour cela.
—Vraiment?
—Oui. Il avait déjà refusé une place dans les campieri du prince de Goto.
—C’était donc un seigneur que ce jeune homme?
—Non, madame la comtesse, c’était un simple montagnard.
—Comment s’appelait-il?
—Oh! je ne crois pas que la signora le connaisse, dit vivement Teresa.
—Et le regrettes-tu?
—Je ne pourrais dire.—Ce que je sais seulement, c’est que si je devenais sa femme, au lieu d’être celle de Gaëtano, il me faudrait travailler pour vivre, et que cela me serait bien pénible, surtout en sortant du service de madame la comtesse, qui est si facile et si doux.
—On m’accuse cependant de violence et d’orgueil; est-ce vrai, Teresa?
—Madame est excellente pour moi; voilà tout ce que je puis dire.
—C’est cette noblesse palermitaine qui dit cela, parce que les comtes de Castelnuovo ont été anoblis par Charles V, tandis que les Ventimille et les Partanna descendent, à ce qu’ils prétendent, de Tancrède et de Roger. Mais ce n’est pas pour cela que les femmes m’en veulent; elles cachent leur haine sous le dédain, et elles me haïssent, parce que Rodolfo m’aime et qu’elles sont jalouses de l’amour du vice-roi. Aussi font-elles tout ce qu’elles peuvent pour me l’enlever; mais elles n’y parviendront pas: je suis plus belle qu’elles; Carini me le dit tous les jours, et toi aussi, menteuse.
—Il y a ici quelqu’un plus flatteur encore que son excellence et que moi.
—Et qui cela?
—Le miroir de madame la comtesse.
—Folle! Allume les bougies de la psyché.—La camérière obéit.—Maintenant, ferme cette fenêtre et laisse-moi: celle du jardin donnera assez d’air.
Teresa obéit et s’éloigna; à peine la comtesse l’eut-elle vue disparaître, qu’elle vint s’asseoir devant la psyché, se regarda dans la glace et se mit à sourire.
C’est qu’aussi c’était une merveilleuse créature que cette comtesse Emma, ou plutôt Gemma; car dès son enfance ses parens avaient ajouté un G à son nom de baptême; de sorte que, grâce à cette adjonction, elle s’appelait Diamant. Certes, c’était à tort qu’elle s’était bornée à faire remonter sa noblesse à une signature de Charles-Quint; car, à sa taille mince et flexible, on reconnaissait l’Ionienne, à ses yeux noirs et veloutés, la descendante des Arabes, à son teint blanc et vermeille, la fille des Gaules. Elle pouvait donc également se vanter de descendre d’un archonte d’Athènes, d’un émir sarrazin ou d’un capitaine normand; c’était une de ces beautés comme en trouve en Sicile d’abord, puis dans une seule ville du monde, à Arles, où le même mélange de sang, le même croisement de races réunit parfois dans une seule personne ces trois types si différens. Aussi, au lieu d’appeler à son secours, ainsi qu’elle en avait d’abord eu l’intention, l’artifice de la toilette, Gemma se trouva si charmante dans son demi-désordre, qu’elle se regarda quelque temps avec une admiration naïve, et comme doit se regarder une fleur qui se penche vers un ruisseau; et cette admiration, ce n’était point de l’orgueil, c’était une adoration pour le Seigneur, qui veut et qui peut créer de si belles choses. Elle resta donc ainsi qu’elle était. En effet, quelle coiffure pouvait mieux faire valoir ses cheveux que cet abandon qui leur permettait de flotter dans leur magnifique étendue? Quel pinceau aurait pu ajouter une ligne à l’arc régulier de ses sourcils de velours? et quel carmin aurait osé rivaliser avec le corail de ses lèvres humides, vif comme le fruit de la grenade? Elle commença, en échange et comme nous l’avons dit, à se regarder sans autre pensée que celle de se voir, et peu à peu elle tomba dans une rêverie profonde et pleine d’extase; car en même temps que son visage, et comme un fond à cette tête d’ange, la glace qui était placée devant la fenêtre restée ouverte réfléchissait le ciel; et Gemma, sans but, sans motif, se berçant dans un bonheur vague et infini, s’amusait à compter dans cette glace les étoiles qui apparaissaient chacune à son tour, et à leur donner des noms au fur et à mesure qu’elles pointaient dans l’éther. Tout-à-coup il lui sembla qu’une ombre surgissante se plaçait devant ces étoiles, et qu’une figure se dessinait derrière elle: elle se retourna vivement, un homme était debout sur sa fenêtre. Gemma se leva et ouvrit la bouche pour jeter un cri; mais l’inconnu, s’élançant dans la chambre, joignit les deux mains, et d’une voix suppliante:—Au nom du ciel, lui dit-il, n’appelez pas, madame, car, sur mon honneur, vous n’avez rien à craindre, et je ne veux pas vous faire de mal!...
Gemma retomba sur son fauteuil, et cette apparition et ces paroles furent suivies d’un moment de silence, pendant lequel elle eut le temps de jeter un coup-d’œil rapide et craintif sur l’étranger qui venait de s’introduire dans sa chambre d’une manière si bizarre et si inusitée.
C’était un jeune homme de vingt-cinq à vingt-six ans, qui paraissait appartenir à la classe populaire: il portait le chapeau calabrais, entouré d’un large ruban qui retombait flottant sur son épaule, une veste de velours à boutons d’argent, une culotte de même étoffe et à ornemens pareils; sa taille était serrée par une de ces ceintures en soie rouge avec des broderies et des franges vertes, comme on en fabrique à Messine, en imitation de celles du Levant. Enfin, des guêtres et des souliers de peau complétaient ce costume montagnard, qui ne manquait pas d’élégance, et qui semblait choisi pour faire ressortir les heureuses proportions de la taille de celui qui l’avait adopté. Quant à sa figure, elle était d’une beauté sauvage: c’étaient ces traits fortement accentués de l’homme du Midi, ses yeux hardis et fiers, ses cheveux et sa barbe noirs, son nez d’aigle et ses dents de chacal.
Sans doute que Gemma ne fut point rassurée par cet examen, car l’étranger lui vit étendre le bras du côté de la table, et devinant qu’elle y cherchait la sonnette d’argent qui y était placée:
—Ne m’avez-vous pas entendu, madame? lui dit-il en donnant à sa voix cette expression de douceur infinie à laquelle se prête si facilement la langue sicilienne: je ne vous veux aucun mal, et, bien loin de là, si vous m’accordez la demande que je viens vous faire, je vous adorerai comme une madone; vous êtes déjà belle comme la mère de Dieu, soyez bonne aussi comme elle.
—Mais enfin que me voulez-vous? dit Gemma d’une voix tremblante encore, et comment entrez-vous ainsi chez moi à cette heure?
—Si je vous avais demandé une entrevue à vous, noble, riche et aimée d’un homme qui est presque un roi, est-il probable que vous me l’eussiez accordé à moi, pauvre et inconnu? dites-le moi, madame: d’ailleurs, eussiez-vous eu cette bonté, vous pouviez tarder à me répondre, et je n’avais pas le temps d’attendre.
—Que puis-je donc pour vous? dit Gemma, se rassurant de plus en plus.
—Tout, madame; car vous avez entre vos mains mon désespoir ou mon bonheur, ma mort ou ma vie.
—Je ne vous comprends pas; expliquez-vous.
—Vous avez à votre service une jeune fille de Bauso.
—Teresa?
—Oui, Teresa, continua le jeune homme d’une voix tremblante: or, cette jeune fille va se marier à un valet de chambre du prince de Carini, et cette jeune fille est ma fiancée.
—Ah! c’est vous?...
—Oui, c’est moi qu’elle allait épouser au moment où elle reçut la lettre qui l’appelait auprès de vous. Elle promit de me rester fidèle, de vous parler pour moi, et, si vous refusiez sa demande, de venir me retrouver: je l’attendais donc; mais trois ans se sont écoulés sans que je la revisse, et comme elle ne revenait pas, c’est moi qui suis venu. En arrivant, j’ai tout appris, alors j’ai pensé à venir me jeter à vos genoux et à vous demander Teresa.
—Teresa est une fille que j’aime et dont je ne veux pas me séparer. Gaëtano est le valet de chambre du prince, et en l’épousant elle restera près de moi.
—Si c’est une condition, j’entrerai chez le prince, dit le jeune homme, se faisant une violence visible.
—Teresa m’avait dit que vous ne vouliez pas servir.
—C’est vrai! mais s’il le faut cependant, je ferai ce sacrifice pour elle; seulement, si cela était possible, j’aimerais mieux être engagé dans ses campieri que de faire partie de ses domestiques.
—C’est bien; j’en parlerai au prince, et s’il y consent....
—Le prince voudra tout ce que vous voudrez, madame; vous ne priez pas, vous ordonnez, je le sais.
—Mais qui me répondra de vous?
—Ma reconnaissance éternelle, madame.
—Encore faut-il que je sache qui vous êtes.
—Je suis un homme dont vous pouvez faire le malheur ou la félicité, voilà tout.
—Le prince me demandera votre nom.
—Que lui importe mon nom? le connaît-il? Le nom d’un pauvre paysan de Bauso est-il jamais arrivé jusqu’au prince?
—Mais moi, je suis du même pays que vous; mon père était comte de Castelnuovo, et habitait une petite forteresse à un quart de lieue du village.
—Je le sais, madame, répondit le jeune homme d’une voix sourde.
—Eh bien! je dois connaître votre nom, moi! Dites-le-moi, alors, et je verrai ce que j’ai à faire.
—Croyez-moi, madame la comtesse, il vaut mieux que vous l’ignoriez; qu’importe mon nom? Je suis honnête homme, je rendrai Teresa heureuse, et, s’il le faut je me ferai tuer pour le prince et pour vous.
—Votre entêtement est étrange; et je tiens d’autant plus à savoir votre nom, que je l’ai déjà demandé à Teresa, et, que, comme vous, elle a refusé de me le dire. Je vous préviens cependant que je ne ferai rien qu’à cette condition.
—Vous le voulez, madame?
—Je l’exige.
—Eh bien! une dernière fois, je vous en supplie.
—Ou nommez-vous, ou sortez! dit Gemma avec un geste impératif.
—Je m’appelle Pascal Bruno, répondit le jeune homme d’une voix si calme qu’on eût pu croire que toute émotion avait disparu, si en le voyant si pâle on n’eût facilement deviné ce qu’il souffrait intérieurement.
—Pascal Bruno! s’écria Gemma reculant son fauteuil, Pascal Bruno! seriez-vous le fils d’Antonio Bruno, dont la tête est dans une cage de fer au château de Bauso?
—Je suis son fils.
—Eh bien! savez-vous pourquoi la tête de votre père est là, dites? Pascal garda le silence.
—Eh bien! continua Gemma, c’est que votre père a voulu assassiner le mien.
—Je sais tout cela, madame, je sais encore que lorsqu’on vous promenait, enfant, dans le village, vos femmes de chambre et vos valets vous montraient cette tête en vous disant que c’était celle de mon père qui avait voulu assassiner le vôtre; mais ce qu’on ne vous disait pas, madame, c’est que votre père avait déshonoré le mien.
—Vous mentez.
—Que Dieu me punisse si je ne dis pas la vérité, madame: ma mère était belle et sage, le comte l’aima, et ma mère résista à toutes les propositions, à toutes les promesses, à toutes les menaces; mais un jour que mon père était allé à Taormine, il la fit enlever par quatre hommes, transporter dans une petite maison qui lui appartenait, entre Limero et Furnari, et qui est maintenant une auberge.... Et là!... là, madame, il la viola!
—Le comte était seigneur et maître du village de Bauso: ses habitans lui appartenaient, corps et biens, et c’était beaucoup d’honneur qu’il faisait à votre mère que de l’aimer!...
—Mon père ne pensa pas ainsi, à ce qu’il paraît, dit Pascal en fronçant le sourcil, et cela sans doute parce qu’il était né à Strilla, sur les terres du prince de Moncada-Paterno, ce qui fit qu’il frappa le comte; la blessure ne fut pas mortelle, tant mieux, je l’ai longtemps regretté; mais aujourd’hui, à ma honte, je m’en félicite.
—Si j’ai bonne mémoire, votre père, non-seulement a été mis à mort comme meurtrier, mais encore vos oncles sont au bagne?
—Ils avaient donné asile à l’assassin, ils l’avaient défendu lorsque les sbires étaient venus pour l’arrêter; ils furent considérés comme complices, et envoyés, mon oncle Placido à Favignana, mon oncle Pietro à Lipari, et mon oncle Pépé à Vulcano. Quant à moi, j’étais trop jeune, et quoique l’on m’eût arrêté avec eux, on me rendit à ma mère.
—Et qu’est-elle devenue votre mère?
—Elle est morte.
—Où cela?
—Dans la montagne, entre Pizzo de Goto et Nisi.
—Pourquoi avait-elle quitté Bauso?
—Pour que nous ne vissions pas, chaque fois que nous passions devant le château, elle, la tête de son mari, moi, la tête de mon père. Oui, elle est morte là, sans médecin, sans prêtre; elle a été enterrée hors de la terre sainte, et c’est moi qui ai été son seul fossoyeur.... Alors, madame, vous me pardonnerez, je l’espère, sur la terre fraîchement retournée, j’avais fait le serment de venger toute ma famille, à laquelle je survivais seul, car je ne compte plus mes oncles comme de ce monde, sur vous, qui restez seule de la famille du comte. Mais, que voulez-vous? je devins amoureux de Teresa; je quittai mes montagnes pour ne plus voir la tombe à laquelle je sentais que je devenais parjure; je descendis dans la plaine, je me rapprochai de Bauso, et je fis plus encore; lorsque je sus que Teresa quittait le village pour entrer à votre service, je songeai à entrer à celui du comte. Je reculai longtemps devant cette pensée, enfin je m’y habituai. Je pris sur moi de vous voir: je vous ai vue, et me voilà, sans armes et en suppliant, en face de vous, madame, devant qui je ne devais paraître qu’en ennemi.
—Vous comprenez, répondit Gemma, qu’il est impossible que le prince prenne à son service un homme dont le père a été pendu et dont les oncles sont aux galères.
—Pourquoi pas, madame, si cet homme consent à oublier que c’est injustement que ces choses ont été faites?
—Vous êtes fou!
—Madame la comtesse, vous savez ce que c’est qu’un serment pour un montagnard? Eh bien! je fausserai mon serment. Vous savez ce que c’est que la vengeance pour un Sicilien? eh bien! je renoncerai à ma vengeance.. Je ne demande pas mieux que de tout oublier, ne me forcez pas de me souvenir.
—Et dans ce cas que feriez-vous?
—Je ne veux pas y penser.
—C’est bien! nous prendrons nos mesures en conséquence.
—Je vous en supplie, madame la comtesse, soyez bonne pour moi; vous voyez que je fais ce que je peux pour rester honnête homme. Une fois engagé chez le prince, une fois le mari de Teresa, je réponds de moi.... D’ailleurs, je ne retournerai pas à Bauso.
—Cela est impossible.
—Madame la comtesse, vous avez aimé! (Gemma sourit dédaigneusement.) Vous devez alors savoir ce que c’est que la jalousie; vous devez savoir ce qu’on souffre et comment on se sent devenir fou. Eh bien! j’aime Teresa, je suis jaloux d’elle, je sens que je perdrai l’esprit si ce mariage ne se fait; et alors....
—Et alors?
—Alors!... gare que je ne me souvienne de la cage où est la tête de mon père, des bagnes où vivent mes oncles, et de la tombe où dort ma mère.
En ce moment un cri étrange, qui semblait être un signal, se fit entendre au bas de la fenêtre, presque aussitôt le bruit d’une sonnette retentit.
—Voilà le prince, s’écria Gemma.
—Oui, oui, je le sais, murmura Pascal d’une voix sourde; mais avant qu’il ne soit arrivé à cette porte, vous avez encore le temps de me dire oui. Je vous en supplie, madame, accordez-moi ce que je vous demande; donnez-moi Teresa, placez-moi au service du prince.
—Laissez-moi passer, dit impérieusement Gemma, s’avançant vers la porte; mais loin d’obéir à cet ordre, Bruno s’élança vers le verrou qu’il poussa.—Oseriez-vous m’arrêter? continua Gemma saisissant le cordon d’une sonnette.—A moi! au secours! au secours!
—N’appelez pas, madame, dit Bruno se contenant encore, car je vous ai dit que je ne voulais pas vous faire de mal. Un second cri pareil au premier se fit entendre au bas de la fenêtre.—C’est bien, c’est bien, Ali, tu veilles fidèlement, mon enfant, dit Bruno. Oui, je sais que le comte arrive, j’entends ses pas dans le corridor. Madame, madame, il vous reste encore un instant, une seconde, et tous les malheurs que je prévois n’auront pas lieu....
—Au secours! Rodolfo, au secours! cria Gemma.
—Vous n’avez donc ni cœur, ni âme, ni pitié, ni pour vous ni pour les autres! dit Bruno enfonçant ses mains dans ses cheveux et regardant la porte qu’on secouait avec force.
—Je suis enfermée, continua la comtesse se rassurant de l’aide qui lui arrivait,—enfermée avec un homme qui me menace. A moi! Rodolfo, à moi! au secours!
—Je ne menace pas, je prie... je prie encore... mais puisque vous le voulez!...
Bruno poussa un rugissement de tigre, et s’élança vers Gemma pour l’étouffer entre ses mains, sans doute, car, ainsi qu’il l’avait dit, il n’avait pas d’armes. Au même instant, une porte cachée au fond de l’alcôve s’ouvrit, un coup de pistolet se fit entendre, la chambre s’emplit de fumée, et Gemma s’évanouit.
Lorsqu’elle revint à elle, elle était entre les bras de son amant; ses yeux cherchèrent avec effroi autour de la chambre, et aussitôt qu’elle put articuler une parole:
—Qu’est devenu cet homme, dit-elle.
—Je ne sais. Il faut que je l’aie manqué, répondit le prince, car, tandis que j’enjambais par-dessus le lit, il a sauté par la fenêtre; et comme je vous voyais sans connaissance, je ne me suis pas inquiété de lui, mais de vous. Il faut que je l’aie manqué, répéta-t-il en jetant les yeux autour de la chambre; et cependant c’est bizarre, je ne vois pas la balle dans la tenture.
—Faites courir après lui, s’écria Gemma, et point de grâce, point de pitié pour cet homme, monseigneur, car cet homme c’est un bandit qui voulait m’assassiner.
On chercha toute la nuit dans la villa, par les jardins et sur le rivage, mais inutilement; Pascal Bruno avait disparu.
Le lendemain on découvrit une trace de sang, qui commençait au bas de la fenêtre et qui se perdait à la mer.
Au point du jour, les barques des pêcheurs sortirent du port comme d’habitude et se dispersèrent sur la mer; l’une d’elles, cependant, montée par un homme et par un enfant de douze à quatorze ans, s’arrétant en vue de Palerme, abattit sa voile pour rester en panne; et comme cette immobilité dans un endroit peu favorable à la pêche aurait pu attirer les soupçons sur elle, l’enfant s’occupa de raccommoder ses filets; quant à l’homme, il était couché au fond du bateau, la tête appuyée sur un des bords, et paraissait plongé dans une profonde rêverie; de temps en temps cependant il puisait, comme par un mouvement machinal, de l’eau de mer dans sa main droite, et versait de cette eau sur son épaule gauche serrée d’une bandelette ensanglantée. Alors sa bouche se contractait avec une expression si bizarre, qu’on aurait eu peine à distinguer si c’était un rire ou un grincement de dents qui lui donnait cette expression. Cet homme était Pascal Bruno, et cet enfant, c’était celui qui, placé au bas de la fenêtre, lui avait deux fois donné, par un cri, le signal de la fuite: au premier coup-d’œil on pouvait facilement le reconnaître pour le fils d’une terre plus ardente encore que celle sur laquelle se passent les événemens que nous racontons. En effet, cet enfant était né sur les côtes d’Afrique, et voici comment Bruno et lui s’étaient rencontrés.
Il y avait un an à peu près que des corsaires algériens, sachant que le prince de Moncada-Paterno, l’un des plus riches seigneurs de la Sicile, revenait dans une petite speronare de Pantellerie à Catane, accompagné seulement d’une douzaine d’hommes de sa suite, s’embarquèrent derrière l’île de Porri, distante de deux milles à peu près de la côte. Le bâtiment du prince, ainsi que l’avaient prévu les pirates, passa entre l’île et le rivage; mais au moment où ils le virent engagé dans le détroit, ils sortirent avec trois barques de la petite anse où ils étaient cachés, et firent force de rames pour couper le chemin au bâtiment du prince. Celui-ci ordonna aussitôt de gouverner vers la terre, et alla s’échouer sur la plage de Fugallo. Comme il y avait, à l’endroit où le bâtiment avait touché, trois pieds d’eau à peine, le prince et sa suite sautèrent à la mer, tenant leurs armes au-dessus de leurs têtes, et espérant arriver au village qu’ils voyaient s’élever à une demi-lieue à peu près dans les terres, sans avoir besoin d’en faire usage. Mais à peine furent-ils débarqués, qu’une autre troupe de corsaires qui, prévoyant cette manœuvre, avait remonté avec une barque le Bufaidone, sortit des roseaux au milieu desquels le fleuve coule, et coupa au prince la retraite sur laquelle il comptait. Le combat s’engagea aussitôt; mais tandis que les campieri du prince avaient affaire à cette première troupe, la seconde arriva, et toute résistance devenant visiblement inutile, le prince se rendit, demandant la vie sauve et promettant de payer rançon pour lui et pour toute sa suite. Au moment où les prisonniers venaient de déposer leurs armes, on aperçut une troupe de paysans qui accouraient armés de fusils et de faux. Les corsaires, maîtres de la personne du prince, et ayant par conséquent atteint le but qu’ils désiraient, n’attendirent pas les nouveaux arrivans, et s’embarquèrent avec une telle rapidité qu’ils laissèrent sur le champ de bataille trois hommes de leur équipage, qu’ils croyaient morts ou blessés mortellement.
Parmi ceux qui accouraient ainsi se trouvait Pascal Bruno, que sa vie nomade conduisait vaguement tantôt d’un côté, tantôt d’un autre, et que son esprit inquiet jetait dans toutes les entreprises aventureuses. Arrivés sur la plage où le combat avait eu lieu, les paysans trouvèrent un domestique du prince de Paterno mort, un autre blessé légèrement à la cuisse, et trois corsaires étendus dans leur sang, mais respirant encore. Deux coups de fusil eurent bientôt fait justice de chacun d’entre eux, et un coup de pistolet allait envoyer le troisième rejoindre ses camarades, lorsque Bruno, s’apercevant que c’était un enfant, détourna le bras qui allait le frapper, et déclara qu’il prenait le blessé sous sa protection. Quelques réclamations s’élevèrent sur cette pitié, qui semblait intempestive; mais quand Bruno avait dit une chose, il maintenait ce qu’il avait dit: il arma donc sa carabine, déclara qu’il ferait sauter la cervelle au premier qui s’approcherait de son protégé; et, comme on le savait homme à exécuter à l’instant sa menace, on lui laissa prendre l’enfant dans ses bras et s’éloigner avec lui. Bruno marcha aussitôt vers le rivage, descendit dans une barque avec laquelle il faisait habituellement ses excursions aventureuses, et dont il connaissait si bien la manœuvre qu’elle semblait lui obéir comme un cheval à son cavalier, déploya sa voile et cingla vers le cap d’Aliga-Grande.
A peine eut-il vu que la barque était dans sa route, et qu’elle n’avait plus besoin de son pilote, qu’il s’occupa de son blessé, toujours évanoui. Il écarta le burnous blanc dans lequel il était enveloppé, détacha la ceinture à laquelle était passé encore son yatagan, et vit, aux dernières lueurs du soleil couchant, que la balle avait frappé entre la hanche droite et les fausses côtes, et était ressortie près de la colonne vertébrale: la blessure était dangereuse, mais n’était pas mortelle.
La brise du soir, la sensation de fraîcheur produite par l’eau de mer avec laquelle Bruno lavait la plaie, rappelèrent l’enfant à lui; il prononça sans ouvrir les yeux quelque mots dans une langue inconnue; mais Bruno, sachant que l’effet habituel d’un coup de feu est de causer une soif violente, devina qu’il demandait à boire et approcha de ses lèvres une flasque pleine d’eau; l’enfant but avec avidité, poussa quelques plaintes inarticulées, et retomba dans son évanouissement. Pascal le coucha le plus doucement qu’il put au fond de sa barque, et, laissant la blessure à l’air, il continua de presser, de cinq minutes en cinq minutes, au-dessus d’elle, son mouchoir imbibé d’eau de mer, remède que les marins croient efficace à toutes leurs blessures.
Vers l’heure de l’Ave Maria, nos navigateurs se trouvèrent à l’embouchure de la Ragusa: le vent venait d’Afrique: Pascal n’eut donc qu’une légère manœuvre à faire pour s’engager dans le fleuve, et trois heures après, laissant Modica à droite, il passait sous le pont jeté sur la grande route qui va de Noto à Chiaramonti. Il fit encore une demi-lieue ainsi; mais alors le fleuve cessant d’être navigable, il tira sa barque dans les lauriers-roses et les papyrus qui bordent le rivage, et, reprenant l’enfant dans ses bras, il l’emporta à travers les terres. Bientôt il atteignit l’entrée d’une vallée dans laquelle il s’enfonça, et il ne tarda pas à trouver à sa droite et à sa gauche la montagne taillée à pic comme une muraille, et creusée de distance en distance, car dans cette vallée sont les restes d’une ancienne cité de Troglodytes, ces premiers habitans de l’île que civilisèrent les colonies grecques. Bruno entra dans l’une de ces cavernes, qui communiquait par un escalier à un étage supérieur, auquel un seul trou carré, en forme de fenêtre, donnait de l’air; un lit de roseaux était amassé dans un coin, il y étendit le burnous de l’enfant, le coucha sur le bournous; puis, redescendant pour allumer du feu, il remonta bientôt avec une branche de sapin enflammée, qu’il fixa dans le mur, et, s’asseyant sur une pierre, près de la couche du blessé, il attendit qu’il revînt à lui.
Ce n’était pas la première fois que Bruno visitait cette retraite: souvent, dans ces voyages sans but qu’il entreprenait à travers la Sicile pour distraire sa vie solitaire, calmer l’activité de son esprit et chasser ses mauvaises pensées, il était venu dans cette vallée, et il avait habité cette chambre creusée dans le roc depuis trois mille ans; c’est là qu’il se livrait à ces rêveries vagues et incohérentes qui sont habituelles aux hommes d’imagination auxquels la science manque. Il savait que c’était une race disparue de la terre qui, dans des temps reculés, avait creusé ces retraites, et, dévot aux superstitions populaires, il croyait, comme tous les habitans des environs, que ces hommes étaient des enchanteurs: au reste, cette croyance, loin de l’écarter de ces lieux redoutés, l’y attirait irrésistiblement: il avait dans sa jeunesse entendu raconter nombre d’histoires de fusils enchantés, d’hommes invulnérables, de voyageurs invisibles, et son âme, sans crainte et avide de merveilleux n’avait qu’un désir, c’était celui de rencontrer un être quelconque, sorcier, enchanteur ou démon, qui, moyennant un pacte infernal, lui accordât un pouvoir surnaturel qui lui donnerait la supériorité sur les autres hommes. Mais c’était toujours en vain qu’il avait évoqué les ombres des anciens habitans de la vallée de Modica; aucune apparition n’avait répondu à ses désirs, et Pascal Bruno était resté, à son grand désespoir, un homme comme les autres hommes; plus cependant, la force et l’adresse, que peu de montagnards possédaient à un degré qui pût lui être comparé.
Il y avait une heure à peu près que Bruno rêvait ainsi près de son jeune blessé, lorsque celui-ci sortit de l’espèce de léthargie dans laquelle il était plongé; il ouvrit les yeux, regarda autour de lui avec égarement, et arrêta son regard sur celui qui venait de le sauver, mais sans savoir encore s’il voyait en lui un ami ou un ennemi. Pendant cet examen, et par un instinct vague de défense, l’enfant porta la main à sa ceinture pour chercher son fidèle yatagan; mais ne l’y trouvant pas, il poussa un soupir.
—Souffres-tu? lui dit Bruno, employant pour se faire entendre de lui cette langue franque qui est l’idiome universel des côtes de la Méditerranée, depuis Marseille jusqu’à Alexandrie, depuis Constantinople jusqu’à Alger, et à l’aide duquel on peut faire le tour du vieux monde.
—Qui es-tu? répondit l’enfant.
—Un ami.
—Ne suis-je donc pas prisonnier?
—Non.
—Alors comment me trouvé-je ici?
Pascal lui raconta tout, l’enfant l’écouta attentivement; puis, lorsque le narrateur eut fini son récit, il fixa ses yeux sur ceux de Bruno, et avec un accent de reconnaissance profonde:
—Alors, lui dit-il, puisque tu m’as sauvé la vie, tu veux donc être mon père?
—Oui, dit Bruno, je le veux.
—Père, dit le blessé, ton fils s’appelle Ali; et toi, comment t’appelles-tu?
—Pascal Bruno.
—Allah te protége! dit l’enfant.
—Désires-tu quelque chose?
—Oui, de l’eau; j’ai soif.
Pascal prit une tasse de terre, cachée dans un enfoncement du rocher, et descendit puiser de l’eau à une source qui coulait près de la maison. En remontant, il jeta les yeux sur le yatagan de l’enfant, et il vit qu’il n’avait pas même songé à le rapprocher de lui. Ali prit avidement la tasse et la vida d’un trait.
—Allah te donne autant d’années heureuses qu’il y avait de gouttes d’eau dans cette tasse, dit l’enfant en la lui rendant.
—Tu es une bonne créature, murmura Bruno; dépêche-toi de guérir, et quand tu seras guéri, tu pourras retourner en Afrique.
L’enfant guérit et resta en Sicile, car il s’était pris pour Bruno d’une telle amitié, qu’il ne voulut jamais le quitter. Depuis lors, il était demeuré constamment avec lui, l’accompagnant dans ses chasses sur les montagnes, l’aidant à diriger sa barque en mer, et prêt à se faire tuer sur un signe de celui qu’il appelait son père.
La veille, il l’avait suivi à la villa du prince de Carini; il l’attendait sous les fenêtres pendant son entrevue avec Gemma, et c’était lui qui avait poussé le double cri d’alarme, la première fois, lorsque le prince avait sonné à la grille, et la seconde fois, lorsqu’il était entré dans le château. Il allait monter lui-même dans la chambre pour lui porter secours, si besoin était, lorsqu’il vit Bruno s’élancer par la fenêtre. Il le suivit dans sa fuite. Tous deux arrivèrent au rivage, se jetèrent dans leur canot qui les attendait, et comme la nuit ils ne pouvaient gagner la haute mer sans éveiller des soupçons, ils se contentèrent de venir se confondre parmi les barques de pêcheurs qui attendaient le point du jour pour sortir du port.
Pendant cette nuit, Ali rendit à son tour, à Pascal, tous les soins qu’il en avait reçus en pareille circonstance, car le prince de Carini avait visé juste, et la balle qu’il cherchait vainement dans sa tenture, avait presque traversé l’épaule de Bruno; de sorte qu’Ali n’eut qu’une légère incision à faire avec son yatagan, pour la retirer du côté opposé à celui par lequel elle était entrée. Tout cela s’était passé presque sans que Bruno s’en mêlât et parût même y penser, et la seule marque d’attention qu’il donnât à sa blessure, était, comme nous l’avons dit, de l’humecter de temps en temps avec de l’eau de mer, tandis que l’enfant faisait semblant de raccommoder ses filets.
—Père, dit tout-à-coup Ali s’interrompant dans cette feinte occupation, regarde donc du côté de la terre!
—Qu’y a-t-il?
—Une troupe de gens.
—Où cela?
—Là-bas, sur le chemin de l’église.
En effet, une société assez nombreuse suivait le chemin tortueux à l’aide duquel on gravit la montagne sainte. Bruno reconnut que c’était un cortège nuptial qui se rendait à la chapelle de Sainte-Rosalie.
—Mets le cap sur la terre et rame vivement, s’écria-t-il se levant tout debout.
L’enfant obéit, saisit de chaque main un aviron, et le petit canot sembla voler à la surface de la mer. Au fur et à mesure qu’ils approchaient du rivage, la figure de Bruno prenait une expression plus terrible; enfin, lorsqu’ils ne furent plus qu’à la distance d’un demi-mille à peu près....
—C’est Teresa! s’écria-t-il avec un accent de désespoir impossible à imaginer: ils ont avancé la cérémonie; ils n’ont pas voulu attendre à dimanche, ils ont eu peur que je ne l’enlevasse d’ici là!... Dieu m’est témoin que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour que cela finît bien.... Ce sont eux qui n’ont pas voulu; malheur à eux!
A ces mots, Bruno, aidé par Ali, hissa la voile de la petite barque, qui, tournant le mont Pellegrino, disparut au bout de deux heures derrière le cap de Gallo.
Pascal ne s’était pas trompé. La comtesse, craignant quelque entreprise de la part de Bruno, avait fait avancer le mariage de trois jours, sans rien dire à Teresa de l’entrevue qu’elle avait eue avec son amant; et, par une dévotion particulière, les époux avaient choisi, pour la célébration du mariage, la chapelle de Sainte-Rosalie, la patronne de Palerme.
C’est encore un des traits caractéristiques de Palerme, ville toute d’amour, que de s’être mise sous la protection d’une sainte jeune et jolie. Aussi sainte Rosalie est-elle à Palerme ce que saint Janvier est à Naples, la toute-puissante distributrice des bienfaits du ciel; mais, de plus que saint Janvier, elle est de race française et royale, et descend directement de Charlemagne[13], ainsi que le prouve son arbre généalogique, peint au-dessus de la porte extérieure de la chapelle; arbre dont le tronc sort de la poitrine du vainqueur de Witikind, et, après s’être divisé en plusieurs rameaux, réunit ses branches à la cime, pour donner naissance au prince de Sinebaldo, père de sainte Rosalie. Mais toute la noblesse de sa race, toute la richesse de sa maison, toute la beauté de sa personne, ne purent rien sur la jeune princesse. Elle quitta, à l’âge de dix-huit ans, la cour de Roger, et, entraînée vers la vie contemplative, elle disparut tout-à-coup sans qu’on sût ce qu’elle était devenue, et ce ne fut qu’après sa mort qu’on la trouva, belle et fraîche comme si elle vivait encore, dans la grotte qu’elle avait habitée, et dans l’attitude même où elle s’était endormie du sommeil chaste et innocent des élus.
Cette grotte était creusée au flanc de l’ancien mont Evita, si célèbre dans le cours des guerres puniques par les positions inexpugnables qu’il fournit aux Carthaginois; mais aujourd’hui la montagne profane a changé de nom. Sa tête stérile a reçu le baptême de la foi, et on l’appelle le mont Pellegrino, mot qui, dans sa double signification, veut dire également la colline Précieuse ou le mont du Pèlerin. En 1624, une peste désolait Palerme; sainte Rosalie fut invoquée. On tira le corps merveilleux de la grotte, on le transporta en grande pompe dans la cathédrale de Palerme; et à peine les ossemens sacrés eurent-ils touché le seuil du monument demi-chrétien, demi-arabe, bâti par l’archevêque Gauthier, qu’à la prière de la sainte, Jésus-Christ chassa de la ville non-seulement la peste, mais encore la guerre et la famine, comme en fait foi le bas-relief de Villa-Reale, élève de Canova. Ce fut alors que les Palermitains reconnaissans transformèrent en église la grotte de sainte Rosalie, établirent le magnifique chemin qui y conduit, et dont la construction semble remonter à ces époques où une colonie romaine jetait un pont ou un aqueduc d’une montagne à l’autre, comme la signature granitique de la métropole. Enfin, le corps de la sainte fut remplacé par une gracieuse statue de marbre, couronnée de roses et couchée dans l’attitude où la sainte s’était endormie, à l’endroit même où elle avait été retrouvée; et le chef-d’œuvre de l’artiste fut encore enrichi par un don royal. Charles III de Bourbon lui donna une robe d’étoffe d’or, estimée vingt-cinq mille francs, un collier de diamans et des bagues magnifiques; et, voulant joindre les honneurs chevaleresques aux richesses mondaines, obtint pour elle la grande croix de Malte, qui est suspendue par une chaîne d’or, et la décoration de Marie-Thérèse, qui est une étoile entourée de lauriers avec cette devise: Fortitudini.
Quant à la grotte elle-même, c’est une excavation creusée dans un noyau primitif recouvert de couches calcaires, à la voûte de laquelle pendent de brillantes stalactites; à gauche est un autel dans le bas duquel est couchée la statue de la sainte, que l’on voit à travers un treillage d’or, et derrière l’autel coule la fontaine où elle se désaltérait. Quant au portique de cette église naturelle, il est séparé d’elle par un intervalle de trois ou quatre pieds, par lequel pénètre le jour et descendent les festons de lierres; de sorte que les rayons du soleil séparent comme un rideau lumineux le desservant de ses auditeurs.
C’est dans cette église que Teresa et Gaëtano furent mariés.
La cérémonie terminée, la noce redescendit à Palerme, où des voitures attendaient les convives pour les conduire au village de Carini, fief princier dont Rodolfo tirait son nom et son titre. Là, par les soins de la comtesse, tous les apprêts d’un repas magnifique avaient été faits; les paysans des environs avaient été invités; il en était venu de deux ou trois lieues à la ronde, de Montreale, de Capaci et de Favarota; et parmi toutes ces jeunes paysannes qui avaient fait assaut de coquetterie villageoise, on reconnaissait celles de Piana de Greci à leur costume moraïte, qu’elles ont religieusement conservé, quoique la colonie qui le leur a légué et qui le tenait de ses pères ait quitté depuis douze cents ans la terre natale pour une nouvelle patrie.
Des tables étaient dressées sur une esplanade ombragée par des chênes verts et des pins parasols, embaumée par les orangers et les citronniers, et ceinte par des haies de grenadiers et de figuiers d’Inde, double bienfait de la Providence, qui, pensant à la faim et à la soif du pauvre, a semé ces arbres comme une manne sur toute l’étendue de la Sicile. On arrivait à cette esplanade par un chemin bordé d’aloës, dont les fleurs géantes, qui semblent de loin des lances de cavaliers arabes, renferment un fil plus brillant et plus solide que celui du chanvre et du lin; et tandis qu’au midi la vue était bornée par le palais, au-dessus de la terrasse duquel s’élevait la chaîne de montagnes qui sépare l’île en trois grandes régions, à l’occident, au nord et à l’est, à l’extrémité de trois vallées on revoyait trois fois cette magnifique mer de Sicile qu’à ses teintes variées on eût prise pour trois mers; car, grâce à un jeu de lumière produit par le soleil qui commençait à disparaître à l’horizon, du côté de Palerme elle était d’un bleu d’azur; autour de l’île des Femmes, elle roulait des vagues d’argent, tandis qu’elle brisait des flots d’or liquide contre les rochers de Saint-Vito.
Au moment du dessert, et lorsque le festin nuptial était dans toute sa joie, les portes du château s’ouvrirent, et Gemma, appuyée sur l’épaule du prince, précédée de deux domestiques portant des torches, et suivie d’un monde de valets, descendit l’escalier de marbre de la villa et s’avança sur l’esplanade. Les paysans voulurent se lever, mais le prince leur fit signe de ne pas se déranger. Gemma et lui commencèrent le tour des tables et finirent par s’arrêter derrière les fiancés. Alors un domestique tendit une coupe d’or, Gaëtano la remplit de vin de Syracuse, le domestique présenta la coupe à Gemma, Gemma fit un vœu en faveur des nouveaux époux, effleura de ses lèvres la coupe d’or et la passa au prince, qui, la vidant d’un trait, y versa une bourse pleine d’onces[14], et la fit porter à Teresa, dont c’était le présent de noce; au même instant les cris de vive le prince de Carini! vive la comtesse de Castel-Nuovo! se firent entendre; l’esplanade s’illumina comme par enchantement, et les nobles visiteurs se retirèrent, laissant après eux, comme une apparition céleste, de la lumière et de la joie.
A peine étaient-ils rentrés dans le château avec leur suite, qu’une musique se fit entendre; les jeunes gens quittèrent les tables et coururent à l’endroit préparé pour la danse. Comme d’habitude, Gaëtano allait ouvrir le bal avec sa fiancée, et déjà il s’avançait vers elle, lorsqu’un étranger arrivant par le chemin des Aloës, parut sur l’esplanade: c’était Pascal Bruno, vêtu du costume calabrais que nous avons déjà détaillé; seulement, une paire de pistolets et un poignard étaient passés à sa ceinture, et sa veste, jetée sur son épaule droite, comme une pelisse de hussard, laissait voir la manche ensanglantée de sa chemise. Teresa fut la première qui l’aperçut: elle jeta un cri, et, fixant sur lui ses yeux épouvantés, elle resta pâle et droite comme à l’aspect d’une apparition. Chacun se retourna vers le nouveau venu, et toute cette foule demeura dans l’attente, silencieuse et muette, devinant qu’il allait se passer quelque chose de terrible.—Pascal Bruno marcha droit à Teresa, et, s’arrêtant devant elle, il croisa les bras et la regarda fixement.
—C’est vous, Pascal? murmura Teresa.
—Oui, c’est moi, répondit Bruno d’une voix rauque: j’ai appris à Bauso, où je vous attendais, que vous alliez vous marier à Carini, et je suis venu à temps, je l’espère, pour danser la première tarentelle avec vous.
—C’est le droit du fiancé, interrompit Gaëtano s’approchant.
—C’est le droit de l’amant, répondit Bruno. Allons, Teresa, c’est le moins que vous puissiez faire pour moi, ce me semble.
—Teresa est ma femme, s’écria Gaëtano en étendant le bras vers elle.
—Teresa est ma maîtresse, dit Pascal en lui tendant la main.
—Au secours! cria Teresa.
Gaëtano saisit Pascal au collet; mais au même instant il poussa un cri et tomba, le poignard de Pascal enfoncé jusqu’au manche dans la poitrine. Les hommes firent un mouvement pour s’élancer vers le meurtrier, qui tira froidement un pistolet de sa ceinture et l’arma; puis, avec son pistolet, il fit signe aux musiciens de commencer l’air de la tarentelle. Ils obéirent machinalement: chacun demeura immobile.
—Allons, Teresa! dit Bruno.
Teresa n’était plus un être vivant, mais un automate dont le ressort était la peur. Elle obéit, et cette horrible danse près d’un cadavre dura jusqu’à la dernière mesure. Enfin les musiciens s’arrêtèrent, et comme si cette musique eût seule soutenu Teresa, elle tomba évanouie sur le corps de Gaëtano.
—Merci, Teresa, dit le danseur la regardant d’un œil sec; c’est tout ce que je voulais de toi. Et maintenant, s’il est quelqu’un ici qui désire savoir mon nom, afin de me retrouver autre part, je m’appelle Pascal Bruno.
—Fils d’Antonio Bruno, dont la tête est dans une cage de fer au château de Bauso, dit une voix.
—C’est cela même, répondit Pascal; mais si vous désirez l’y voir encore, hâtez-vous, car elle n’y restera pas longtemps, je vous le jure!
A ces mots, Pascal disparut sans qu’il prît envie à personne de le suivre; d’ailleurs, soit crainte, soit intérêt, tout le monde s’occupait de Gaëtano et de Teresa.
L’un était mort, l’autre était folle.
Le dimanche suivant était le jour de la fête de Bauso: tout le village était en joie, on buvait à tous les cabarets, on tirait des boîtes à tous les coins de rue. Les rues étaient pavoisées et bruyantes, et, entre toutes, celle qui montait au château était pleine de monde qui s’était amassé pour voir les jeunes gens tirer à la cible. C’était un amusement qui avait été fort encouragé par le roi Ferdinand IV, pendant son séjour forcé en Sicile; et plusieurs de ceux qui se livraient en ce moment à cet exercice avaient eu récemment, à la suite du cardinal Ruffo, occasion de déployer leur adresse sur les patriotes napolitains et les républicains français; mais pour le moment, le but était redevenu une simple carte, et le prix un gobelet d’argent. La cible était placée directement au-dessous de la cage de fer où était la tête d’Antonio Bruno, à laquelle on ne pouvait atteindre que par un escalier qui, de l’intérieur de la forteresse, conduisait à une fenêtre en dehors de laquelle était scellée cette cage. Les conditions du tirage étaient, au reste, des plus simples; on n’avait besoin, pour faire partie de la société, que de verser dans la caisse commune, qui devait servir à payer le prix du gobelet d’argent, la modique somme de deux carlins pour chaque coup que l’on désirait tirer, et l’on recevait en échange un numéro amené au hasard, qui fixait l’ordre dans lequel le tour devait arriver; les moins adroits prenaient jusqu’à dix, douze et quatorze balles; ceux qui comptaient sur leur habileté se bornaient à cinq ou six. Au milieu de tous ces bras tendus et de toutes ces voix confuses, un bras s’étendit qui jeta deux carlins, et une voix se fit entendre qui demanda une seule balle. Chacun se retourna étonné de cette pauvreté ou de cette confiance. Ce tireur qui demandait une seule balle, c’était Pascal Bruno.
Quoique depuis quatre ans il n’eût point paru dans le village, chacun le reconnut; mais nul ne lui adressa la parole. Seulement, comme on le savait le chasseur le plus habile de toute la contrée, on ne s’étonna point qu’il n’eût pris qu’une seule balle: elle portait le n° 41. Le tir commença.
Chaque coup était accueilli par des rires ou par des acclamations; et au fur et à mesure que les premières balles s’épuisaient les rires devenaient moins bruyans. Quant à Pascal, appuyé triste et pensif sur sa carabine anglaise, il ne paraissait prendre aucune part à l’enthousiasme ou à l’hilarité de ses compatriotes; enfin son tour vint; on appela son nom; il tressaillit et leva la tête comme s’il ne s’attendait pas à cet appel; mais, se rassurant aussitôt, il vint prendre place derrière la corde tendue qui servait de barrière. Chacun le suivit des yeux avec anxiété: aucun tireur n’avait excité un tel intérêt ni produit un pareil silence.
Pascal lui-même paraissait sentir toute l’importance du coup de fusil qu’il allait tirer, car il se posa d’aplomb, la jambe gauche en avant, et assurant son corps sur la jambe droite, il épaula avec soin, et prenant sa ligne d’en bas, il leva lentement le canon de sa carabine; tout le monde le suivait des yeux, et ce fut avec étonnement qu’on le vit dépasser la hauteur de la cible, et, se levant toujours ne s’arrêter que dans la direction de la cage de fer: arrivés là, le tireur et le fusil restèrent un instant immobiles comme s’ils étaient de pierre; enfin le coup partit, et la tête, enlevée de la cage de fer[15], tomba du haut du mur au pied de la cible!... Un frisson courut parmi les assistans, et aucun cri n’accueillit cette preuve d’adresse.
Au milieu de ce silence, Pascal Bruno alla ramasser la tête de son père, et prit, sans dire un mot et sans regarder une seule fois derrière lui, le sentier qui conduisait aux montagnes.
[13] Nous n’avons pas besoin de rappeler à nos lecteurs que nous ne faisons pas ici un cours d’histoire, mais que nous rapportons une tradition. Nous savons parfaitement que Charlemagne était de race teutonique, et non de lignée française.
[14] Monnaie dont chaque pièce vaut trois ducats.
[15] Les cages en fer dans lesquelles on expose les têtes en Italie n’ont pas de treillage.
Un an à peine s’était écoulé depuis les événemens que nous venons de raconter dans notre précédent chapitre, et déjà toute la Sicile, de Messine à Palerme, de Céfalu au cap Passaro, retentissait du bruit des exploits du bandit Pascal Bruno. Dans les pays comme l’Espagne et l’Italie, où la mauvaise organisation de la société tend toujours à repousser en bas ce qui est né en bas, et où l’âme n’a pas d’ailes pour soulever le corps, un esprit élevé devient un malheur pour une naissance obscure; comme il tend toujours à sortir du cercle politique et intellectuel où le hasard l’a enfermé, comme il marche incessamment vers un but dont mille obstacles le séparent, comme il voit sans cesse la lumière, et qu’il n’est point destiné à l’atteindre, il commence par espérer et finit par maudire. Alors il entre en révolte contre cette société pour laquelle Dieu a fait deux parts si aveugles, l’une de bonheur, l’autre de souffrances; il réagit contre cette partialité céleste et s’établit de sa propre autorité le défenseur du faible et l’ennemi du puissant. Voilà pourquoi le bandit espagnol et italien est à la fois si poétique et si populaire: c’est que, d’abord, c’est presque toujours quelque grande douleur qui l’a jeté hors de la voie; c’est qu’ensuite son poignard et sa carabine tendent à rétablir l’équilibre divin faussé par les institutions humaines.
On ne s’étonnera donc pas qu’avec ses antécédens de famille, son caractère aventureux, son adresse et sa force extraordinaire, Pascal Bruno soit devenu si rapidement le personnage bizarre qu’il voulait être. C’est que, si l’on peut parler ainsi, il s’était établi le justicier de la justice; c’est que, par toute la Sicile, et spécialement dans Bauso et ses environs, il ne se commettait pas un acte arbitraire qui pût échapper à son tribunal: et, comme presque toujours ses arrêts atteignaient les forts, il avait pour lui tous les faibles. Ainsi, lorsqu’un bail exorbitant avait été imposé par un riche seigneur à quelque pauvre fermier, lorsqu’un mariage était sur le point de manquer par la cupidité d’une famille, lorsqu’une sentence inique allait frapper un innocent, sur l’avis qu’il en recevait, Bruno prenait sa carabine, détachait quatre chiens corses, qui formaient sa seule bande, montait sur son cheval de Val-de-Noto, demi-arabe et demi-montagnard comme lui, sortait de la petite forteresse de Castel-Nuovo, dont il avait fait sa résidence, allait trouver le seigneur, le père ou le juge, et le bail était diminué, le mariage conclu, le prisonnier élargi. On comprendra donc facilement que tous ces hommes auxquels il était venu en aide lui payaient leur bonheur en dévoûment, et que toute entreprise dirigée contre lui échouait, grâce à la surveillance reconnaissante des paysans, qui le prévenaient aussitôt, par les signes convenus, des dangers qui le menaçaient.
Puis, des récits bizarres commençaient à circuler dans toutes les bouches; car plus les esprits sont simples, plus ils sont portés à croire au merveilleux. On disait que, dans une nuit d’orage, où toute l’île avait tremblé, Pascal Bruno avait passé un pacte avec une sorcière, et qu’il avait obtenu d’elle, en échange de son âme, d’être invisible, d’avoir la faculté de se transporter en un instant d’un bout de l’île à l’autre, et de ne pouvoir être atteint ni par le plomb, ni par le fer, ni par le feu. Le pacte, disait-on, devait durer pendant trois ans, Bruno ne l’ayant signé que pour accomplir une vengeance à laquelle ce terme, tout restreint qu’il paraissait, était suffisant. Quant à Pascal, loin de détruire ces soupçons, il comprenait qu’ils lui étaient favorables, et tachait, au contraire, de leur donner de la consistance. Ses relations multipliées lui avaient souvent fourni des moyens de faire croire à son invisibilité en le mettant au fait de circonstances qu’on devait penser lui être parfaitement inconnues. La rapidité de son cheval, à l’aide duquel, le matin, il se trouvait à des distances incroyables des lieux où on l’avait vu le soir, avait convaincu de sa faculté locomotive; enfin, une circonstance dont il avait tiré parti avec l’habileté d’un homme supérieur, n’avait laissé aucun doute sur son invulnérabilité. La voici:
Le meurtre de Gaëtano avait fait grand bruit, et le prince de Carini avait donné des ordres à tous les commandans de compagnie, afin qu’ils tâchassent de s’emparer de l’assassin, qui, du reste, offrait beau jeu à ceux qui le poursuivaient par l’audace de sa conduite. Ils avaient, en conséquence, transmis ces ordres à leurs agens, et le chef de la justice de Spadafora fut prévenu un matin que Pascal Bruno était passé dans le village pendant la nuit pour aller à Divieto. Il plaça, les deux nuits suivantes, des hommes en embuscade sur la route, pensant qu’il reviendrait par le même chemin qu’il avait suivi en allant, et que, pour son retour, il profiterait de l’obscurité.
Fatigués d’avoir veillé deux nuits, le matin du troisième jour, qui était un dimanche, les miliciens se réunirent à un cabaret situé à vingt pas de la route; ils étaient en train d’y déjeuner, lorsqu’on leur annonça que Pascal Bruno descendait tranquillement la montagne, du côté de Divieto. Comme ils n’avaient pas le temps d’aller reprendre leur embuscade, ils attendirent où ils étaient, et lorsqu’il ne fut plus qu’à cinquante pas de l’auberge, ils sortirent et se rangèrent en bataille devant la porte, sans cependant paraître faire attention à lui. Bruno vit tous ces préparatis d’attaque sans paraître s’en inquiéter, et au lieu de rebrousser chemin, ce qui lui aurait été facile, il mit son cheval au galop et continua sa route. Lorsque les miliciens virent quelle était son intention, ils préparèrent leurs armes, et, au moment où il passait devant eux, toute la compagnie le salua d’une décharge générale; mais ni le cheval, ni le cavalier n’en furent atteints, et l’homme et l’animal sortirent sains et saufs du tourbillon de fumée qui les avait un instant enveloppés. Les miliciens se regardèrent en secouant la tête, et allèrent raconter au chef de la justice de Spadafora ce qui venait de leur arriver.
Le bruit de cette aventure se répandit le même soir à Bauso, et quelques imaginations, plus actives que les autres, commencèrent à penser que Pascal Bruno était enchanté, et que le plomb et le fer s’aplatissaient et s’émoussaient en frappant contre lui. Le lendemain, cette assertion fut confirmée par une preuve irrécusable: on trouva accrochée à la porte du juge de Bauso, la veste de Pascal Bruno percée de treize coups de feu, et contenant dans ses poches les treize balles aplaties. Quelques esprits forts soutinrent bien, et parmi ceux-ci était César Alletto, notaire à Calvaruso, de la bouche duquel nous tenons ces détails, que c’était le bandit lui-même qui, échappé miraculeusement à la fusillade, et voulant mettre à profit cette circonstance, avait suspendu sa veste à un arbre, et avait tiré les treize coups de feu dont elle portait la marque; mais la majorité n’en demeura pas moins convaincue de l’enchantement, et la crainte qu’inspirait déjà Pascal s’en augmenta considérablement. Cette crainte était telle, et Bruno était si convaincu que des classes inférieures elle avait gagné les classes supérieures, que, quelques mois avant l’époque où nous sommes arrivés, ayant eu besoin, pour une de ses œuvres philantrophiques (il s’agissait de rebâtir une auberge brûlée), de deux cents onces d’or, il s’était adressé au prince de Butera pour faire l’emprunt de cette somme, lui indiquant un endroit de la montagne où il irait la prendre, en l’invitant à l’y enfouir exactement, afin que, pendant une nuit qu’il désignait au prince, il pût l’aller chercher; en cas de non exécution de cette invitation, qui pouvait passer pour un ordre, Bruno prévenait le prince que c’était une guerre ouverte entre le roi de la montagne et le seigneur de la plaine; mais que si, au contraire, le prince avait l’obligeance de lui faire le prêt, les deux cents onces d’or lui seraient fidèlement rendues sur la première somme qu’il enlèverait au trésor royal.
Le prince de Butera était un de ces types comme il n’en existe plus guère dans nos époques modernes: c’était un reste de la vieille seigneurie sicilienne, aventureuse et chevaleresque comme ces Normands qui ont fondé leur constitution et leur société. Il s’appelait Hercule, et semblait taillé sur le modèle de son antique patron. Il assommait un cheval rétif d’un coup de poing, brisait sur son genou une barre de fer d’un demi-pouce d’épaisseur, et tordait une piastre. Un événement où il avait fait preuve d’un grand sang-froid, l’avait rendu l’idole du peuple de Palerme. En 1770, le pain avait manqué dans la ville, une émeute s’en était suivie; le gouverneur en avait appelé à l’ultima ratio, le canon était braqué dans la rue de Tolède, le peuple marchait sur le canon, et l’artilleur, la mèche à la main, allait tirer sur le peuple, lorsque le prince de Butera alla s’asseoir sur la bouche de la pièce, comme il aurait fait sur un fauteuil, et de là commença un discours tellement éloquent et rationnel, que le peuple se retira à l’instant même, et que l’artilleur, la mèche et le canon rentrèrent vierges à l’arsenal. Mais ce n’était pas encore à ce seul motif qu’il devait sa popularité.
Tous les matins il allait se promener sur la terrasse qui dominait la place de la Marine, et comme, au point du jour, les portes de son palais étaient ouvertes pour tout le monde, il y trouvait toujours nombreuse compagnie de pauvres gens; il portait ordinairement pour cette tournée un grand gilet de peau de daim, dont les immenses poches devaient tous les matins être remplies, par son valet de chambre, de carlins et de demi-carlins qui disparaissaient jusqu’au dernier pendant cette promenade, et cela avec une manière de faire et de dire qui n’appartenait qu’à lui: de sorte qu’il semblait toujours prêt à assommer ceux auxquels il faisait l’aumône.
—Excellence, disait une pauvre femme entourée de sa famille, ayez pitié d’une pauvre mère qui a cinq enfans.
—Belle raison! répondait le prince en colère: est-ce moi qui te les ai faits?—Et, avec un geste menaçant, il laissait tomber dans son tablier une poignée de monnaie.
—Signor principe, disait un autre, je n’ai pas de quoi manger.
—Imbécile! répondait le prince en lui allongeant un coup de poing qui le nourrissait pour huit jours, est-ce que je fais du pain, moi? va-t’en chez le boulanger[16].
Aussi quand le prince passait par les rues, toutes les têtes se découvraient, comme lorsque monsieur de Beaufort passait par les halles; mais, plus puissant encore que le frondeur français, il n’aurait eu qu’un mot à dire pour se faire roi de Sicile; il n’en eut jamais l’idée, et il resta prince de Butera, ce qui valait bien autant.
Cette libéralité avait cependant trouvé un censeur, et cela dans la maison même du prince: ce censeur était son maître d’hôtel. On doit comprendre qu’un homme du caractère que nous avons essayé d’indiquer devait surtout appliquer à ses dîners ce luxe et cette magnificence qui lui étaient si naturels; aussi tenait-il littéralement table ouverte, et tous les jours avait-il à sa table vingt-cinq ou trente convives au moins, parmi lesquels sept ou huit lui étaient toujours inconnus, tandis que d’autres s’y asseyaient au contraire avec la régularité de pensionnaires de table d’hôte. Parmi ces derniers, il y avait un certain capitaine Altavilla, qui avait gagné ses épaulettes en suivant le cardinal Ruffo de Palerme à Naples, et qui était revenu de Naples à Palerme avec une pension de mille ducats. Malheureusement, le capitaine avait le défaut d’être tant soit peu joueur, ce qui eût rendu sa retraite insuffisante à ses besoins, s’il n’avait trouvé deux moyens à l’aide desquels son traitement trimestriel était devenu la part la moins importante de son revenu: le premier de ces moyens, et celui-là, comme je l’ai dit, était à la portée de tout le monde, le premier de ces moyens, dis-je, était de dîner tous les jours chez le prince, et le second, de mettre religieusement, chaque jour, en se levant de table, son couvert d’argent dans sa poche. Cette manœuvre dura quelque temps sans que cette soustraction quotidienne fût remarquée: mais si bien garnis que fussent les dressoirs du prince, on commença de s’apercevoir qu’il s’y formait des vides. Les soupçons du majordome tombèrent aussitôt sur le santa fede[17]; il l’épia avec attention, et il ne lui fallut qu’une surveillance de deux ou trois jours pour changer ses soupçons en certitude. Il en avertit aussitôt le prince, qui réfléchit un moment, puis qui répondit que, tant que le capitaine ne prendrait que son couvert, il n’y avait rien à dire; mais que, s’il mettait dans sa poche ceux de ses voisins, il verrait alors à prendre une résolution. En conséquence, le capitaine Altavilla était resté un des hôtes les plus assidus de son excellence le prince Hercule de Butera.
Ce dernier était à Castrogiovanni, où il avait une villa, lorsqu’on lui apporta la lettre de Bruno; il la lut et demanda si le messager attendait la réponse. On lui dit que non, et il mit la lettre dans sa poche avec le même sang-froid que si c’était une missive ordinaire.
La nuit fixée par Bruno arriva: l’endroit qu’il avait désigné était situé sur la croupe méridionale de l’Etna, près d’un de ces mille volcans éteints qui doivent leur flamme d’un jour à sa flamme éternelle, et dont l’existence éphémère a suffi pour détruire des villes. On appelait celui-là le Montebaldo; car chacune de ces collines terribles a reçu un nom en sortant de la terre. A dix minutes de chemin de sa base, s’élevait un arbre colossal et isolé appelé le Châtaignier des cent chevaux, parce qu’à l’entour de son tronc, qui a cent soixante-dix-huit pieds de circonférence, et sous son feuillage, qui forme à lui seul une forêt, on peut abriter cent cavaliers avec leurs montures. C’était dans la racine de cet arbre que Pascal venait chercher le dépôt qui devait lui être confié. En conséquence, il partit sur les onze heures de Centorbi, et vers minuit il commença, aux rayons de la lune, à apercevoir l’arbre gigantesque et la petite maison bâtie entre les tiges différentes de l’arbre, et qui sert à renfermer la récolte immense de ses fruits. Au fur et à mesure qu’il approchait, Pascal croyait distinguer une ombre debout contre un des cinq troncs qui puisent leur sève à la même racine. Bientôt cette ombre prit un corps; le bandit s’arrêta et arma sa carabine en criant:
—Qui vive?
—Un homme, parbleu! dit une voix forte; as-tu cru que l’argent viendrait tout seul?
—Non, sans doute, reprit Bruno; mais je n’aurais pas cru que celui qui l’apporterait serait assez hardi pour m’attendre.
—Alors c’est que tu ne connaissais pas le prince Hercule de Butera, voilà tout.
—Comment! c’est vous-même, monseigneur? dit Bruno, rejetant sa carabine sur son épaule et s’avançant le chapeau à la main vers le prince.
—Oui, c’est moi, drôle; c’est moi qui ai pensé qu’un bandit pouvait avoir besoin d’argent comme un autre homme, et qui n’ai pas voulu refuser ma bourse, même à un bandit. Seulement il m’a pris fantaisie de la lui apporter moi-même, afin que le bandit ne crût pas que je la lui donnais par peur.
—Votre excellence est digne de sa réputation, dit Bruno.
—Et toi, es-tu digne de la tienne? répondit le prince.
—C’est selon celle qu’on m’a faite devant vous, monseigneur; car je dois en avoir plus d’une.
—Allons, continua le prince, je vois que tu ne manques ni d’esprit ni de résolution; j’aime les hommes de cœur partout où je les rencontre, moi. Ecoute: veux-tu changer cet habit calabrais contre un uniforme de capitaine et aller faire la guerre aux Français? Je me charge de te lever une compagnie sur mes terres et de t’acheter des épaulettes.
—Merci, monseigneur, merci, dit Bruno; votre offre est celle d’un prince magnifique; mais j’ai certaine vengeance à accomplir et qui me retient encore pour quelque temps en Sicile; après nous verrons.
—C’est bien, dit le prince, tu es libre; mais, crois-moi, tu ferais mieux d’accepter.
—Je ne puis, excellence.
—Alors, voilà la bourse que tu m’as demandée; va-t’en au diable avec, et tâche de ne pas venir te faire pendre devant la porte de mon hôtel[18].
Bruno pesa la bourse dans sa main.
—Cette bourse est bien lourde, monseigneur, ce me semble.
—C’est que je n’ai pas voulu qu’un faquin comme toi se vantât d’avoir fixé une somme à la libéralité du prince de Butera, et qu’au lieu de deux cents onces que tu me demandais, j’en ai mis trois cents.
—Quelle que soit la somme qu’il vous a plu de m’apporter, monseigneur, elle vous sera fidèlement rendue.
—Je donne et je ne prête pas, dit le prince.
—Et moi j’emprunte ou je vole, mais je ne mendie pas, dit Bruno. Reprenez votre bourse, monseigneur; je m’adresserai au prince de Vintimille ou de la Cattolica.
—Eh bien! soit, dit le prince. Je n’ai jamais vu de bandit plus capricieux que toi: quatre drôles de ton espèce me feraient perdre la tête; aussi je m’en vais. Adieu!
—Adieu, monseigneur, et que sainte Rosalie vous garde!...
Le prince s’éloigna les mains dans les poches de son gilet de peau de daim, et en sifflant son air favori. Bruno resta immobile, le regardant s’en aller, et ce ne fut que lorsqu’il l’eut perdu de vue qu’il se retira de son côté en poussant un soupir.
Le lendemain l’aubergiste incendié reçut, par les mains d’Ali, les trois cents onces du prince de Butera.
[16] Voir pour plus amples détails sur cet homme singulier, dont j’ai trouvé la mémoire si vivante en Sicile qu’on le croirait mort d’hier, les souvenirs si spirituels et si amusans de Palmieri de Micciché.
[17] On appelait santa fede ceux qui avaient suivi le cardinal Ruffo dans la conquête de Naples.
[18] C’est sur la place de la marine, en face de la porte du prince de Butera, que se font les exécutions à Palerme.
Quelque temps après la scène que nous venons de raconter, Bruno apprit qu’un convoi d’argent, escorté par quatre gendarmes et un brigadier, allait partir de Messine pour Palerme. C’était la rançon du prince de Moncada-Paterno, laquelle, par suite d’une combinaison financière qui fait le plus grand honneur à l’imagination de Ferdinand IV, venait arrondir le budget napolitain, au lieu d’aller, comme c’était sa destination première, grossir le trésor de la Casauba.—Voici, au reste, l’histoire telle qu’elle m’a été racontée sur les lieux; comme elle est aussi curieuse qu’authentique, nous pensons qu’elle mérite la peine d’être rapportée; d’ailleurs, elle donnera une idée de la manière naïve dont se perçoivent les impôts en Sicile.
Nous avons dit, dans la première partie de cette histoire, comment le prince de Moncada-Paterno avait été pris par des corsaires barbaresques près du petit village de Fugello, en revenant de l’île de Pantellerie: il fut conduit avec toute sa suite à Alger, et là le prix de sa rançon et celle de sa suite fut fixé aimablement à la somme de cinq cent mille piastres (2,500,000 fr. de France), moitié payable avant son départ, moitié payable après son retour en Sicile.
Le prince écrivit à son intendant pour lui faire part de la position dans laquelle il se trouvait, et pour qu’il eût à lui envoyer au plus vite les deux cent cinquante mille piastres, en échange desquelles il devait recevoir sa liberté. Comme le prince de Moncada-Paterno était un des seigneurs les plus riches de la Sicile, la somme fut facile à compléter et promptement envoyée en Afrique; fidèle alors à sa promesse, en véritable sectateur du prophète, le dey relâcha le prince de Paterno, sur sa parole d’honneur d’envoyer avant un an les deux cent cinquante mille écus restans. Le prince revint en Sicile, où il s’occupait à recueillir l’argent nécessaire à son second paiement, lorsqu’un ordre de Ferdinand IV, basé sur ce motif, qu’étant en guerre avec la régence il ne voulait pas que ses sujets enrichissent ses ennemis, vint mettre opposition dans les mains du prince et lui enjoignit de verser les deux cent cinquante mille piastres en question dans le trésor de Messine. Le prince de Paterno, qui était un homme d’honneur en même temps qu’un sujet fidèle, obéit à l’ordre de son souverain et à la voix de sa conscience; de sorte que la rançon lui coûta sept cent cinquante mille piastres, dont les deux tiers furent envoyés au corsaire infidèle, et l’autre tiers versé à Messine, entre les mains du prince de Carini, mandataire du pirate chrétien. C’était cette somme que le vice-roi envoyait à Palerme, siége du gouvernement, sous l’escorte de quatre gendarmes et d’un brigadier; ce dernier était chargé, en outre, de remettre de la part du prince une lettre à sa bien-aimée Gemma, qu’il invitait à venir le rejoindre à Messine, où les affaires du gouvernement devaient le retenir encore quelques mois.
Le soir où le convoi devait passer près de Bauso, Bruno lâcha ses quatre chiens corses, traversa avec eux le village dont il était devenu le seigneur, et alla se mettre en embuscade sur la route entre Divieto et Spadafora; il y était depuis une heure à peu près lorsqu’il entendit le roulement d’un caisson et le pas d’une troupe de cavaliers. Il regarda si sa carabine était bien amorcée, s’assura que son stylet ne tenait pas au fourreau, siffla ses chiens, qui vinrent se coucher à ses pieds, et attendit debout au milieu de la route. Quelques minutes après, le convoi parut au tournant d’un chemin, et s’avança jusqu’à la distance de cinquante pas environ de celui qui l’attendait: c’est alors que les gendarmes aperçurent un homme, et crièrent: Qui vive?—Pascal Bruno, répondit le bandit, et, à un sifflement particulier, les chiens, dressés à cette manœuvre, s’élancèrent sur la petite troupe.
Au nom de Pascal Bruno, les quatre gendarmes avaient pris la fuite; les chiens, par un mouvement naturel, poursuivirent ceux qui fuyaient. Le brigadier, resté seul, tira son sabre et chargea le bandit.
Pascal porta sa carabine à son épaule avec le même sang-froid et la même lenteur que s’il s’apprêtait à tirer sur une cible, décidé à lâcher le coup seulement lorsque le cavalier ne serait plus qu’à dix pas de lui, lorsqu’au moment où il appuyait le doigt sur la gâchette, le cheval et l’homme s’abattirent dans la poussière: c’est que Ali avait suivi Bruno sans en rien dire, et, le voyant chargé par le brigadier, avait, comme un serpent, rampé sur la route, et avec son yatagan coupé le jarret du cheval; quant au brigadier, n’ayant pu se retenir, tant sa chute avait été rapide et inattendue, sa tête avait porté sur le pavé, et il était évanoui.
Bruno s’approcha de lui, après s’être assuré qu’il n’avait plus rien à craindre; il le transporta, avec l’aide d’Ali, dans la voiture qu’un instant auparavant il escortait, et mettant la bride des chevaux dans les mains du jeune Arabe, il lui ordonna de conduire la voiture et le brigadier à la forteresse. Quant à lui, il alla au cheval blessé, détacha la carabine de la selle où elle était fixée, fouilla dans les fontes, y prit un rouleau de papier qui s’y trouvait, siffla ses chiens, qui revinrent, la gueule ensanglantée, et suivit la capture qu’il venait de faire.
Arrivé dans la cour de la petite forteresse, il ferma la porte derrière lui, prit sur ses épaules le brigadier toujours évanoui, le porta dans une chambre et le coucha sur le matelas où il avait l’habitude de se jeter lui-même tout habillé; puis, soit oubli, soit imprudence, il posa dans un coin la carabine qu’il avait détachée de la selle, et il sortit de la chambre.
Cinq minutes après le brigadier rouvrit les yeux, regarda autour de lui, se trouva dans un lieu qui lui était parfaitement inconnu, et se croyant sous l’empire d’un rêve, il se tâta lui-même pour savoir s’il était bien éveillé. Ce fut alors que, sentant une douleur au front, il y porta la main, et, la retirant pleine de sang, s’aperçut qu’il était blessé. Cette blessure fut un point de souvenir pour sa mémoire; alors il se rappela qu’il avait été arrêté par un seul homme, lâchement abandonné par ses gendarmes, et qu’au moment où il s’élançait sur cet homme, son cheval s’était abattu. Passé cela, il ne se souvenait plus de rien.
C’était un brave que ce brigadier; il sentait quelle responsabilité pesait sur lui, et son cœur se serra de colère et de honte: il regarda autour de la chambre, essayant de s’orienter; mais tout lui était absolument inconnu. Il se leva, alla à la fenêtre, vit qu’elle donnait sur la campagne. Alors un espoir lui vint, c’était de sauter par cette fenêtre, d’aller chercher main forte et de revenir prendre sa revanche; il avait déjà ouvert la fenêtre pour exécuter ce projet, lorsque, jetant un dernier regard dans la chambre, il aperçut sa carabine placée presque à la tête de son lit; à cette vue, le cœur lui battit violemment, car une autre pensée que celle de la fuite s’empara aussitôt de son esprit; il regarda s’il était bien seul, et lorsqu’il se fut assuré qu’il n’avait été et ne pouvait être vu de personne, il saisit vivement l’arme dans laquelle il voyait un moyen de salut plus hasardé, mais de vengeance plus prompte, s’assura vivement qu’elle était amorcée en levant la batterie, qu’elle était chargée en passant la baguette dans le canon; puis, la remettant à la même place, il alla se recoucher comme s’il n’avait pas encore repris ses sens. A peine était-il étendu sur le lit, que Bruno rentra.
Il portait à la main une branche de sapin allumée qu’il jeta dans l’âtre, et qui communiqua sa flamme au bois préparé pour la recevoir, puis il alla à une armoire pratiquée dans le mur, en tira deux assiettes, deux verres, deux fiasques de vin, une épaule de mouton rôtie, posa le tout sur la table, et parut attendre que le brigadier fût revenu de son évanouissement pour lui faire les honneurs de ce repas improvisé.
Nous avons vu l’appartement où la scène que nous racontons s’est passée; c’était une chambre plus longue que large, ayant une seule fenêtre à un angle, une seule porte à l’autre, et la cheminée entre elles deux. Le brigadier, qui est maintenant capitaine de gendarmerie à Messine, et qui nous a raconté lui-même ces détails, était couché, comme nous l’avons dit, parallèlement à la croisée; Bruno était debout devant la cheminée, les yeux fixés vaguement du côté de la porte, et paraissait de plus en plus s’enfoncer dans une rêverie profonde.
C’était le moment qu’avait attendu le brigadier, moment décisif où il s’agissait de jouer le tout pour le tout, vie pour vie, tête pour tête. Il se souleva en s’appuyant sur sa main gauche, étendit lentement et sans perdre de vue Bruno, la main vers la carabine, la prit entre la sous-garde et la crosse, puis resta un moment ainsi sans oser faire un mouvement de plus, effrayé des battemens de son cœur que le bandit aurait pu entendre s’il n’avait été si profondément distrait; enfin, voyant qu’il se livrait pour ainsi dire lui-même, il reprit confiance, se souleva sur un genou, jeta un dernier regard sur la fenêtre, son seul moyen de retraite, appuya l’arme sur son épaule, ajusta Bruno en homme qui sait que sa vie dépend de son sang-froid, et lâcha le coup.
Bruno se baissa tranquillement, ramassa quelque chose à ses pieds, regarda l’objet à la lumière, et se retournant vers le brigadier muet et stupide d’étonnement:
—Camarade, lui dit-il, quand vous voudrez tirer sur moi, prenez des balles d’argent, ou sans cela, voyez, elles s’aplatiront comme celle-ci. Au reste, je suis bien aise que vous soyez revenu à vous, je commençais à avoir faim, et nous allons souper.
Le brigadier était resté dans la même posture, les cheveux hérissés et la sueur sur le front. Au même instant, la porte s’ouvrit, et Ali, son yatagan à la main, s’élança dans la chambre.
—Ce n’est rien, mon enfant, ce n’est rien, lui dit Bruno en langue franque; le brigadier a déchargé sa carabine, voilà tout. Va donc te coucher tranquillement, et ne crains rien pour moi. Ali sortit sans répondre et alla s’étendre en travers de la première porte, sur la peau de panthère qui lui servait de lit.
—Eh bien! continua Bruno se retournant vers le brigadier et versant du vin dans les deux verres, ne m’avez-vous pas entendu?
—Si fait, répondit le brigadier en se levant, et puisque je n’ai pas pu vous tuer, fussiez-vous le diable, je boirai avec vous.
A ces mots, il marcha d’un pas ferme vers la table, prit le verre, trinqua avec Bruno et vida le vin d’un seul trait.
—Comment vous appelez-vous? dit Bruno.
—Paolo Tommasi, brigadier de gendarmerie, pour vous servir.
—Eh bien! Paolo Tommasi, continua Bruno en lui mettant la main sur l’épaule, vous êtes un brave, et j’ai envie de vous faire une promesse.
—Laquelle?
—C’est de ne laisser gagner qu’à vous seul les trois mille ducats qu’on a promis pour ma tête.
—Vous avez là une bonne idée, répondit le brigadier.
—Oui; mais elle demande à être mûrie, dit Bruno; en attendant, comme je ne suis pas encore las de vivre, asseyons-nous et soupons; plus tard nous reparlerons de la chose.
—Puis-je faire le signe de la croix avant de manger? dit Tommasi.
—Parfaitement, répondit Bruno.
—C’est que j’avais peur que cela ne vous gênât. On ne sait pas quelquefois.
—En aucune manière.
Le brigadier fit le signe de la croix, se mit à table, et commença à attaquer l’épaule de mouton en homme qui a la conscience parfaitement tranquille et qui sait qu’il a fait, dans une circonstance difficile, tout ce qu’un brave soldat peut faire. Bruno lui tint noblement tête, et certes, avoir ces deux hommes mangeant à la même table, buvant à la même bouteille, tirant au même plat, on n’aurait pas dit que, chacun à son tour, et dans l’espace d’une heure, ils venaient réciproquement de faire tout ce qu’ils avaient pu pour se tuer.
Il y eut un instant de silence, produit moitié par l’occupation importante à laquelle se livraient les convives, moitié par la préoccupation de leur esprit. Paolo Tommasi le rompit le premier pour exprimer la double pensée qui le préoccupait:
—Camarade, dit il, on mange bien chez vous, il faut en convenir; vous avez du bon vin, c’est vrai; vous faites les honneurs de votre table en bon convive, à merveille; mais je vous avoue que je trouverais tout cela meilleur si je savais quand je sortirai d’ici.
—Mais demain matin, je présume.
—Vous ne me garderez donc pas prisonnier?
—Prisonnier! que diable voulez-vous que je fasse de vous?
—Heim! dit le brigadier, voilà qui est déjà pas mal. Mais, continua-t-il avec un embarras visible, ça n’est pas tout.
—Qu’y a-t-il encore? dit Bruno lui versant à boire.
—Il y a, il y a, continua le brigadier regardant la lampe à travers son verre; il y a... c’est une question assez délicate, voyez-vous.
—Parlez: j’écoute.
—Vous ne vous fâcherez pas?
—Il me semble que vous devriez connaître mon caractère.
—C’est vrai, vous n’êtes pas susceptible, je sais bien. Je disais donc qu’il y a, ou qu’il y avait... que je n’étais pas seul sur la route.
—Oui, oui, il y avait quatre gendarmes.
—Oh! je ne parle pas d’eux; je parle d’un... d’un certain fourgon. Voilà le mot lâché.
—Il est dans la cour, dit Bruno regardant à son tour la lampe à travers son verre.
—Je m’en doute bien, répondit le brigadier; mais vous comprenez, je ne peux pas m’en aller sans mon fourgon.
—Aussi vous vous en irez avec.
—Et intact?
—Heim! fit Bruno, il y manquera peu de chose relativement à la somme; je n’y prendrai que ce dont j’ai strictement besoin.
—Et êtes-vous bien gêné?
—Il me faut trois mille onces.
—Allons, c’est raisonnable, dit le brigadier, et bien des gens ne seraient pas aussi délicats que vous.
—D’ailleurs, soyez tranquille, je vous donnerai un récépissé, dit Bruno.
—A propos de récépissé, s’écria le brigadier en se levant, j’avais des papiers dans mes fontes!
—N’en soyez pas inquiet, dit Bruno, les voilà.
—Ah! vous me rendez bien service de me les rendre.
—Oui, dit Bruno, je le comprends, car je me suis assuré de leur importance: le premier est votre brevet de brigadier, et j’y ai mis une apostille constatant que vous vous êtes assez bien conduit pour passer maréchal-des-logis; le second est mon signalement; je me suis permis d’y faire quelques petites rectifications, par exemple aux signes particuliers j’ai ajouté incantato; enfin le troisième est une lettre de son excellence le vice-roi à la comtesse Gemma de Castelnuovo, et j’ai trop de reconnaissance à cette dame de ce qu’elle me prête son château, pour mettre des entraves à sa correspondance amoureuse. Voici donc vos papiers, mon brave; un dernier coup à votre santé, et dormez tranquille. Demain, à cinq heures, vous vous mettrez en route; il est plus prudent, croyez-moi, de voyager le jour que la nuit; car peut-être n’auriez-vous pas toujours le bonheur de tomber en aussi bonnes mains.
—Je crois que vous avez raison, dit Tommasi serrant ses papiers; et vous me faites l’effet d’être encore plus honnête homme que beaucoup d’honnêtes gens que je connais.
—Je suis bien aise de vous laisser dans de pareilles idées, vous en dormirez plus tranquille. A propos, je dois vous prévenir d’une chose, c’est de ne pas descendre dans la cour, car mes chiens pourraient bien vous dévorer.
—Merci de l’avis, répondit le brigadier.
—Bonne nuit, dit Bruno; et il sortit laissant le brigadier libre de prolonger indéfiniment son souper ou de s’endormir.
Le lendemain, à cinq heures, comme la chose était convenue, Bruno rentra dans la chambre de son hôte; il était debout et prêt à partir, il descendit avec lui et le conduisit à la porte. Il y trouva le fourgon tout attelé et un cheval de selle magnifique sur lequel on avait eu le soin de transporter tout le fourniment de celui que le yatagan d’Ali avait mis hors de service. Bruno pria son ami Tommasi d’accepter ce cadeau comme un souvenir de lui. Le brigadier ne se fit aucunement prier; il enfourcha sa monture, fouetta l’attelage du fourgon, et partit paraissant enchanté de sa nouvelle connaissance.
Bruno le regarda s’éloigner; puis, lorsqu’il fut à vingt pas:
—Surtout, lui cria-t-il, n’oubliez pas de remettre à la belle comtesse Gemma la lettre du prince de Carini.—Tommasi fit un signe de tête et disparut à l’angle de la route.
Maintenant, si nos lecteurs nous demandent comment Pascal Bruno n’a pas été tué par le coup de carabine de Paolo Tommasi, nous leur répondrons ce que nous a répondu il signor César Alletto, notaire à Calvaruso:—C’est qu’il est probable que dans le trajet de la grande route à la forteresse, le bandit avait pris la précaution d’enlever la balle de la carabine. Quant à Paolo Tommasi, il a toujours trouvé plus simple de croire qu’il y avait magie.
Nous livrons à nos lecteurs les deux opinions, et nous les laissons parfaitement libres d’adopter celle qui leur conviendra.
On comprend facilement que le bruit de pareils exploits ne restait pas circonscrit dans la juridiction du village de Bauso. Aussi n’était-il question par toute la Sicile que du hardi brigand qui s’était emparé de la forteresse de Castelnuovo, et qui de là, comme un aigle de son aire, s’abattait sur la plaine, tantôt pour attaquer les grands, tantôt pour défendre les petits. Nos lecteurs ne s’étonneront donc pas d’entendre prononcer le nom de notre héros dans les salons du prince de Butera, qui donnait une fête dans son hôtel de la place de la Marine.
Avec le caractère que nous connaissons au prince, on comprend ce que devait être une fête donnée par lui. Celle-là surtout allait vraiment au-delà de tout ce que l’imagination peut rêver de plus splendide. C’était quelque chose comme un conte arabe; aussi le souvenir s’en est-il perpétué à Palerme, quoique Palerme soit la ville des féeries.
Qu’on se figure des salons splendides, entièrement couverts de glaces depuis le plafond jusqu’au parquet, et conduisant, les uns à des allées de treillages parquetées, du sommet desquelles pendaient les plus beaux raisins de Syracuse et de Lipari; les autres à des carrés formés par des orangers et des grenadiers en fleurs et en fruits; les premiers servant à danser les gigues anglaises, les autres des contredanses de France. Quant aux valses, elles s’entrelaçaient autour de deux vastes bassins de marbre, de chacun desquels jaillissait une magnifique gerbe d’eau. De ces différentes salles de danse partaient des chemins sablés de poudre d’or. Ces chemins conduisaient à une petite colline entourée de fontaines d’argent, contenant tous les rafraîchissemens qu’on pouvait désirer, et ombragée par des arbres qui, au lieu de fruits naturels, portaient des fruits glacés. Enfin, au sommet de cette colline, faisant face aux chemins qui y conduisaient, était un buffet à quatre pans, constamment renouvelé au moyen d’un mécanisme intérieur. Quant aux musiciens, ils étaient invisibles, et le bruit seul des instrumens arrivait jusqu’aux convives; on eût dit une fête donnée par les génies de l’air.
Maintenant que, pour animer cette décoration magique, on se représente les plus belles femmes et les plus riches cavaliers de Palerme, vêtus de costumes de caractères plus brillans ou plus bizarres les uns que les autres, le masque au visage ou à la main, respirant cet air embaumé, s’enivrant de cette mélodie invisible, rêvant ou parlant d’amour, et l’on sera encore loin de se faire de cette soirée un tableau pareil au souvenir qu’en avaient conservé, à mon passage à Palerme, c’est-à-dire trente-deux ans après l’événement, les personnes qui y avaient assisté.
Parmi les groupes qui circulaient dans ces allées et dans ces salons, il y en avait un surtout qui attirait plus particulièrement les regards de la foule; c’était celui qui s’était formé à la suite de la belle comtesse Gemma, et qu’elle entraînait après elle comme un astre fait de ses satellites: elle venait d’arriver à l’instant même avec une société de cinq personnes, qui avait adopté, ainsi qu’elle, le costume des jeunes femmes et des jeunes seigneurs qui, dans la magnifique page écrite par le pinceau d’Orgagna sur les murs du Campo-Santo de Pise, chantent et se réjouissent pendant que la mort vient frapper à leur porte. Cet habit du treizième siècle, si naïf et si élégant à la fois, semblait choisi exprès pour faire ressortir l’exquise proportion de ses formes, et elle s’avançait au milieu d’un murmure d’admiration, conduite par le prince de Butera lui-même, qui, déguisé en mandarin, l’avait reçue à la porte d’entrée et la précédait pour la présenter, disait-il, à la fille de l’empereur de la Chine. Comme on présumait que c’était quelque surprise nouvelle ménagée par l’amphitryon, on suivait avec empressement le prince, et le cortége se grossissait à chaque pas. Il s’arrêta à l’entrée d’une pagode gardée par deux soldats chinois, qui, sur un signe, ouvrirent la porte d’un appartement entièrement décoré d’objets exotiques, et au milieu duquel, sur une estrade, était assise, dans un costume magnifique de Chinoise, qui avait à lui seul coûté trente mille francs, la princesse de Butera, qui, dès qu’elle aperçut la comtesse, vint au-devant d’elle suivie de toute une cour d’officiers, de mandarins et de magots, plus brillans, plus rébarbatifs, ou plus bouffons les uns que les autres. Cette apparition avait quelque chose de si oriental et de si fantastique, que toute cette société, si habituée cependant au luxe et à la magnificence, se récria d’étonnement. On entourait la princesse, on touchait sa robe brodée de pierreries, on faisait sonner les clochettes d’or de son chapeau pointu, et un instant l’attention abandonna la belle Gemma pour se concentrer entièrement sur la maîtresse de la maison. Chacun la complimentait et l’admirait, et parmi les complimenteurs et les admirateurs les plus exagérés était le capitaine Altavilla, que le prince avait continué de recevoir à ses dîners, à la grande désolation de son maître-d’hotel, et qui, comme déguisement sans doute, avait revêtu son grand uniforme.
—Eh bien! dit le prince de Butera à la comtesse de Castelnuovo, que dites-vous de la fille de l’empereur de la Chine?
—Je dis, répondit Gemma, qu’il est fort heureux pour sa majesté Ferdinand IV que le prince de Carini soit à Messine en ce moment, attendu qu’avec le cœur que je lui connais, il pourrait bien, pour un regard de la fille, livrer la Sicile au père, ce qui nous forcerait de faire de nouvelles vêpres contre les Chinois.
En ce moment, le prince de Moncada-Paterno, vêtu en brigand calabrais, s’approcha de la princesse.
—Sa Hautesse me permettra-t-elle, en ma qualité de connaisseur, d’examiner son magnifique costume?
—Sublime fille du Soleil, dit le capitaine Altavilla, désignant le prince, prenez garde à vos clochettes d’or, car je vous préviens que vous avez affaire à Pascal Bruno.
—La princesse serait peut-être plus en sûreté près de Pascal Bruno, dit une voix, que près de certain santa fede de ma connaissance. Pascal Bruno est un meurtrier et non un filou, un bandit et non un coupeur de bourses.
—Bien répondu, dit le prince de Butera. Le capitaine se mordit les lèvres.
—A propos, continua le prince de la Cattolica, savez-vous sa dernière prouesse?
—A qui?
—A Pascal Bruno.
—Non; qu’a-t-il fait?
—Il a arrêté le convoi d’argent que le prince de Carini envoyait à Palerme.
—Ma rançon! dit le prince de Paterno.
—Oh! mon Dieu, oui, excellence, vous êtes voué aux infidèles.
—Diable! pourvu que le roi n’exige pas que je lui en tienne compte une seconde fois! reprit Moncada.
—Que votre excellence se rassure, dit la même voix qui avait déjà répondu à Altavilla: Pascal Bruno n’a pris que trois mille onces.
—Et comment savez-vous cela, seigneur Albanais? dit le prince de la Cattolica, qui se trouvait près de celui qui avait parlé, lequel était un beau jeune homme de vingt-six à vingt-huit ans portant le costume de Vina[19].
—Je l’ai entendu dire, répondit négligemment le Grec en jouant avec son yatagan; d’ailleurs, si votre excellence désire des renseignemens plus positifs, voici un homme qui peut lui en donner.
Celui qu’on désignait ainsi à la curiosité publique n’était autre que notre ancienne connaissance Paolo Tommasi, qui, esclave de sa consigne, s’était fait conduire, aussitôt son arrivée, chez la comtesse de Castelnuovo, et qui, ne la trouvant pas chez elle, et la sachant à la fête, s’était servi de sa qualité d’envoyé du vice-roi pour pénétrer dans les jardins du prince de Butera; en un instant, il se trouva le centre d’un immense cercle et l’objet de mille questions. Mais Paolo Tommasi était, comme nous l’avons vu, un brave qui ne s’effarouchait pas facilement; il commença donc par remettre la lettre du prince à la comtesse.
—Prince, dit Gemma, après avoir lu la missive qu’elle venait de recevoir, vous ne vous doutiez pas que vous me donniez une fête d’adieu; le vice-roi m’ordonne de me rendre à Messine, et, en fidèle sujette que je suis, je me mettrai en route dès demain. Merci, mon ami, continua-t-elle en donnant sa bourse à Paolo Tommasi; maintenant vous pouvez vous retirer.
Tommasi essaya de profiter de la permission de la comtesse, mais il était trop bien entouré pour battre facilement en retraite. Il lui fallut se rendre à discrétion, et la condition de sa liberté fut le récit exact de sa rencontre avec Pascal Bruno.
Il la raconta, il faut lui rendre justice, avec toute la simple naïveté du vrai courage; il dit, sans rien ajouter, à ses auditeurs, comment il avait été fait prisonnier, comment il avait été conduit à la forteresse de Castelnuovo, comment il avait tiré, sans résultat, sur le bandit, et comment enfin celui-ci l’avait renvoyé en lui faisant cadeau d’un magnifique cheval en remplacement de celui qu’il avait perdu: tout le monde écouta ce récit, empreint de vérité, avec le silence de l’attention et de la foi, à l’exception du capitaine Altavilla, qui éleva quelques doutes sur la véracité de l’honnête brigadier; mais heureusement pour Paolo Tommasi, le prince de Butera lui-même vint à son secours.
—Je parierais, dit-il, que rien n’est plus vrai que ce que vient de dire cet homme, car tous ces détails me paraissent être parfaitement dans le caractère de Pascal Bruno.
—Vous le connaissez donc? dit le prince de Moncada-Paterno.
—J’ai passé une nuit avec lui, répondit le prince de Butera.
—Et où cela?
—Sur vos terres.
Alors ce fut le tour du prince; il raconta comment Pascal et lui s’étaient rencontrés au châtaignier des cent chevaux; comment lui, le prince de Butera, lui avait offert du service qu’il avait refusé, et comment il lui avait prêté trois cents onces. A ce dernier trait, Altavilla ne put retenir son hilarité.
—Et vous croyez qu’il vous les rendra, monseigneur? lui dit-il.
—J’en suis sûr, répondit le prince.
—Pendant que nous y sommes, interrompit la princesse de Butera, y a-t-il quelqu’un encore dans la société qui ait vu Pascal Bruno, et qui lui ait parlé? j’adore les histoires de brigands, elle me font mourir de peur.
—Il y a encore la comtesse Gemma de Castelnuovo, dit l’Albanais.
Gemma tressaillit; tous les regards se tournèrent vers elle comme pour l’interroger.
—Serait-ce vrai? s’écria le prince.
—Oui, répondit en tressaillant Gemma, mais je l’avais oublié.
—Il s’en souvient, lui, murmura le jeune homme.
On se pressa autour de la comtesse, qui voulut en vain s’en défendre; il lui fallut, à son tour, raconter la scène par laquelle nous avons ouvert ce récit, dire comment Bruno avait pénétré dans sa chambre, comment le prince avait tiré sur lui, et comment celui-ci, pour se venger, avait pénétré dans la villa, le jour de la noce, et tué le mari de Teresa; cette histoire était la plus terrible de toutes, aussi laissa-t-elle dans l’esprit des auditeurs une profonde émotion. Quelque chose comme un frisson courait par toute cette assemblée, et n’étaient ces toilettes et ces parures, on n’aurait pas cru assister à une fête.
—Sur mon honneur, dit le capitaine Altavilla, rompant le premier silence, le bandit vient de commettre son plus grand crime en attristant ainsi la fête de notre hôte: j’aurais pu lui pardonner ses autres méfaits, mais celui-ci, je jure par mes épaulettes que j’en tirerai vengeance; et, à compter de ce moment, je me voue à sa poursuite.
—Parlez-vous sérieusement, capitaine Altavilla? dit l’Albanais.
—Oui, sur mon honneur; et j’affirme ici que je ne désire rien tant que de me trouver face à face avec lui.
—C’est chose possible, dit froidement l’Albanais.
—A celui qui me rendrait ce service, continua Altavilla, je donnerais....
—C’est inutile de fixer une récompense, capitaine, je connais un homme qui vous rendra ce service pour rien.
—Et cet homme, où pourrai-je le rencontrer? reprit Altavilla en affectant un sourire de doute.
—Si vous voulez me suivre, je m’engage à vous le dire.
Et à ces mots l’Albanais s’éloigna comme pour inviter le capitaine à marcher derrière lui.
Le capitaine hésita un instant, mais il s’était trop avancé pour reculer; tous les yeux étaient tournés vers lui, il comprit que la moindre faiblesse le perdrait de réputation; d’ailleurs, il prenait la proposition pour une plaisanterie.
—Allons, s’écria-t-il, tout pour l’honneur des dames! Et il suivit l’Albanais.
—Savez-vous quel est ce jeune seigneur déguisé en Grec? dit d’une voix tremblante la comtesse au prince de Butera.
—Non, sur mon âme, répondit le prince; quelqu’un le sait-il?
Chacun se regarda, mais personne ne répondit.
—Avec votre permission, dit Paolo Tommasi en portant la main à son chapeau, je le sais, moi.
—Et quel est-il, mon brave brigadier?
—Pascal Bruno, monseigneur!
La comtesse jeta un cri et s’évanouit. Cet incident mit fin à la fête.
Une heure après, le prince de Butera était retiré dans sa chambre, et mettait, assis devant son bureau, ordre à quelques papiers, lorsque le maître-d’hotel entra d’un air triomphant.
—Qu’y a-t-il, Giacomo? dit le prince.
—Je vous l’avais bien dit, monseigneur....
—Voyons, que m’avais-tu dit?
—Que votre bonté l’encourageait.
—Qui donc?
—Le capitaine Altavilla.
—Qu’a-t-il donc fait?
—Ce qu’il a fait, monseigneur?... D’abord, votre excellence se rappelle que je l’ai prévenue qu’il mettait régulièrement son couvert d’argent dans sa poche.
—Oui, après?
—Pardon, et votre excellence a répondu que tant qu’il n’y mettrait que le sien il n’y avait rien à dire.
—Je me le rappelle.
—Eh bien! aujourd’hui, monseigneur, il paraît qu’il y a mis non-seulement le sien, mais encore celui de ses voisins; car il en manque huit.
—Alors, c’est autre chose, dit le prince.
Il prit une feuille de papier et écrivit:
«Le prince Hercule de Butera a l’honneur de prévenir le capitaine Altavilla que, ne dînant plus chez lui, et se voyant privé, par cette circonstance fortuite, du plaisir de le recevoir désormais, il le prie d’accepter la bagatelle qu’il lui envoie comme une faible indemnité du dérangement que cette détermination causera dans ses habitudes.»
—Tenez, continua le prince, en remettant cinquante onces au majordome[20], vous porterez demain cette lettre et cet argent au capitaine Altavilla.
Giacomo, qui savait qu’il n’y avait rien à dire quand le prince avait parlé, s’inclina et sortit; le prince continua de ranger tranquillement ses papiers; puis, au bout de dix minutes, entendant quelque bruit à la porte de son cabinet, il leva la tête et aperçut une espèce de paysan calabrais debout sur le seuil de son appartement, et tenant son chapeau d’une main et un paquet de l’autre.
—Qui va là? dit le prince.
—Moi, monseigneur, dit une voix.
—Qui, toi? —Pascal Bruno.
—Et que viens-tu faire?
—D’abord, monseigneur, dit Pascal Bruno s’avançant et renversant son chapeau plein d’or sur le bureau, d’abord je viens vous apporter les trois cents onces que vous m’avez si obligeamment prêtées; elles ont eu la destination que je vous avais indiquée: l’auberge brûlée est rebâtie.
—Ah! ah! tu es homme de parole; eh bien! j’en suis aise.
Pascal s’inclina.
—Puis, ajouta-t-il après une courte pause, je viens vous rendre huit couverts d’argent à vos armes et à votre chiffre, et que j’ai trouvés dans la poche du capitaine, qui vous les avait probablement volés.
—Pardieu! dit le prince, il est curieux que ce soit par toi qu’ils me reviennent. Et maintenant, qu’y a-t-il dans ce paquet?
—Il y a dans ce paquet, dit Bruno, la tête d’un misérable qui a abusé de votre hospitalité, et que je vous apporte comme une preuve du dévoûment que je vous ai juré.
A ces mots, Pascal Bruno dénoua le mouchoir, et prenant la tête du capitaine Altavilla par les cheveux, il la posa toute sanglante sur le bureau du prince.
—Que diable veux-tu que je fasse d’un pareil cadeau? dit le prince.
—Ce qu’il vous plaira, monseigneur, répondit Pascal Bruno. Puis il s’inclina et sortit.
Le prince de Butera, resté seul, demeura un instant les yeux fixés sur cette tête, se balançant sur son fauteuil et sifflant son air favori; puis il sonna: le majordome reparut.
—Giacomo, dit le prince, il est inutile que vous alliez demain matin chez le capitaine Altavilla; déchirez la lettre gardez les cinquante onces, et jetez cette charogne sur le fumier.
[19] Colonie albanaise qui a émigré lors de la prise de Constantinople par Mahomet II, et qui a religieusement conservé le costume de ses ancêtres.
[20] 630 francs.
A l’époque où se passent les événemens que nous racontons, c’est-à-dire vers le commencement de l’année 1804, la Sicile était dans cet état presque sauvage dont l’ont tirée à moitié le séjour du roi Ferdinand et l’occupation des Anglais; la route qui va aujourd’hui de Palerme à Messine, en passant par Taormine et Catane, n’était point encore faite, et la seule qui fût, nous ne disons pas bonne, mais praticable, pour se rendre d’une capitale à l’autre, était celle qui longeait la mer, passait par Termini et Céfalu, et qui, abandonnée pour sa nouvelle rivale, n’est plus guère fréquentée aujourd’hui que par les artistes qui vont y chercher les magnifiques points de vue qu’elle déroule à chaque instant. Les seules manières de voyager sur cette route, où aucun service de poste n’était établi, étaient donc, autrefois comme maintenant, le mulet, la litière à deux chevaux, ou sa propre voiture avec des relais envoyés à l’avance, et disposés de quinze lieues en quinze lieues, de sorte qu’au moment de partir pour Messine, où le prince de Carini lui avait écrit de le venir joindre, la comtesse Gemma de Castelnuovo fut forcée de choisir entre ces trois moyens. Le voyage à mulet était trop fatigant pour elle; le voyage en litière, outre les inconvéniens de ce mode de transport, dont le principal est la lenteur, offre encore le désagrément de donner le mal de mer: la comtesse se décida donc sans hésitation aucune pour la voiture, et envoya d’avance des chevaux de relais qui devaient l’attendre aux quatre différentes stations qu’elle comptait faire en route, c’est-à-dire à Termini, à Céfalu, à Sainte-Agathe et à Melazzo.
Outre cette première précaution, qui regardait purement et simplement le transport, le courrier était chargé d’en prendre une seconde, qui était celle d’agglomérer sur les points précités la plus grande quantité de vivres possible, précaution importante et que nous ne saurions trop recommander à ceux qui voyagent en Sicile, où l’on ne trouve littéralement rien à manger dans les hôtelleries, et où, généralement ce ne sont point les aubergistes qui nourrissent les voyageurs, mais au contraire les voyageurs qui nourrissent les aubergistes. Aussi la première recommandation qu’on vous fait en arrivant à Messine, et la dernière qu’on reçoit en quittant cette ville, point ordinaire du départ, est celle de se munir de provisions, d’acheter une batterie de cuisine, et de louer un cuisinier; tout ceci augmente habituellement votre suite de deux mulets et d’un homme qui, estimés modestement au même prix, vous font un surcroît de dépense de trois ducats par jour. Quelques Anglais expérimentés ajoutent à ce bagage un troisième mulet qu’ils chargent d’une tente, et il faut bien que nous avouions ici, malgré notre prédilection pour ce magnifique pays, que cette dernière précaution, pour être moins indispensable que les autres, n’en est pas moins bonne à prendre, vu l’état déplorable des auberges qu’on trouve sur les routes, et qui, tout en manquant des animaux les plus nécessaires aux premiers besoins de la vie, sont fabuleusement peuplées de tous ceux qui ne sont bons qu’à la tourmenter. La multiplicité des derniers est si grande que j’ai vu des voyageurs qui étaient tombés malades par défaut de sommeil, et la pénurie des premiers est si grande, que j’ai rencontré des Anglais qui, après avoir épuisé leurs provisions, délibéraient gravement s’ils ne mangeraient pas leur cuisinier, qui leur était devenu complétement inutile. Voilà où était réduite, en l’an de grâce 1804, la fertile et blonde Sicile, qui, du temps d’Auguste, nourrissait Rome avec le superflu de ses douze millions d’habitans.
Je ne sais si c’était un savant connaissant à fond la Sicile antique, mais à coup sûr c’était un observateur sachant bien sa Sicile moderne que celui dont on préparait le souper à l’auberge della Croce, auberge qui venait d’être rebâtie à neuf avec les trois cents onces du prince de Butera, et qui était située sur la route de Palerme à Messine, entre Ficarra et Patti; l’activité de l’aubergiste et de sa femme, qui, dirigée par un étranger, s’exerçait à la fois sur du poisson, du gibier et de la volaille, prouvait que celui pour lequel la friture, les fourneaux et la broche étaient mis en réquisition, tenait non-seulement à ne pas manquer du nécessaire, mais encore n’était pas ennemi du superflu. Il venait de Messine, voyageait avec une voiture et des chevaux à lui, s’était arrêté là, parce que le site lui plaisait, et avait tiré de son caisson tout ce qui était nécessaire à un véritable sybarite et à un touriste consommé, depuis les draps jusqu’à l’argenterie, depuis le pain jusqu’au vin. A peine arrivé, il s’était fait conduire à la meilleure chambre, avait allumé des parfums dans une cassolette d’argent, et attendait que son dîner fût prêt, couché sur un riche tapis turc, et fumant dans une chibouque d’ambre le meilleur tabac du mont Sinaï.
Il était occupé à suivre avec la plus grande attention les nuages de fumée odorante qui s’échappaient de sa bouche et allaient se condenser au plafond, lorsque la porte de la chambre s’ouvrit, et que l’aubergiste, suivi d’un domestique à la livrée de la comtesse, s’arrêta sur le seuil.
—Excellence! dit le digne homme s’inclinant jusqu’à terre.
—Qu’y a-t-il? répondit sans se retourner le voyageur avec un accent maltais fortement prononcé.
—Excellence, c’est la princesse Gemma de Castelnuovo....
—Eh bien?
—Dont la voiture est forcée de s’arrêter dans ma pauvre auberge, parce que l’un de ses chevaux boîte si bas qu’elle ne peut continuer sa route.
—Après?
—Et qui comptait, ne prévoyant pas cet accident en partant ce matin de Sainte-Agathe, aller coucher ce soir à Melazzo, où l’attendent ses relais, de sorte qu’elle n’a avec elle aucune provision.
—Dites à la comtesse que mon cuisinier et ma cuisine sont à ses ordres.
—Mille grâces, au nom de ma maîtresse, excellence, dit le domestique; mais comme la comtesse sera sans doute forcée de passer la nuit dans cette auberge, attendu qu’il faudra aller chercher le relais à Melazzo et le ramener ici, et qu’elle n’a pas plus de provisions de nuit que de provisions de jour, elle fait demander à votre excellence si elle aurait la galanterie de....
—Que la comtesse fasse mieux, interrompit le voyageur; qu’elle accepte mon appartement, tout préparé qu’il est. Quant à moi, qui suis un homme habitué à la fatigue et aux privations, je me contenterai de la première chambre venue. Descendez donc prévenir la comtesse qu’elle peut monter, et que l’appartement est libre, tandis que notre digne hôte va me placer du mieux qu’il lui sera possible. A ces mots, le voyageur se leva et suivit l’aubergiste: quant au domestique, il redescendit immédiatement pour accomplir sa commission.
Gemma accepta l’offre du voyageur comme une reine à qui son sujet fait hommage, et non comme une femme à qui un étranger rend service; elle était tellement habituée à voir tout plier à sa volonté, tout céder à sa voix, tout obéir à son geste, qu’elle trouva parfaitement simple et naturelle l’extrême galanterie du voyageur. Il est vrai qu’elle était si ravissante, lorsqu’elle s’achemina vers la chambre, appuyée sur le bras de sa camérière, que tout devait s’incliner devant elle; elle portait un costume de voyage de la plus grande élégance, en forme d’amazone, court, collant sur les bras et sur la poitrine, et rattaché devant par des brandebourgs de soie; autour de son cou était roulé, de peur du froid des montagnes, un ornement encore inconnu chez nous, où depuis il a été si répandu: c’était un boa de martre que le prince de Carini avait acheté d’un marchand maltais qui l’avait rapporté de Constantinople; sur sa tête était un petit bonnet de velours noir de fantaisie, pareil à une coiffe du moyen-âge, et de cette coiffe tombaient de longs et magnifiques cheveux bouclés à l’anglaise. Cependant, si préparée qu’elle fût à trouver une chambre prête à la recevoir, elle ne put s’empêcher de s’étonner en entrant du luxe avec lequel le voyageur inconnu avait combattu la pauvreté de l’appartement; tous les ustensiles de toilette étaient d’argent; le linge qui couvrait la table était d’une finesse extrême, et les parfums orientaux qui brûlaient sur la cheminée semblaient faits pour embaumer un sérail.
—Mais vois donc, Gidsa, si je ne suis pas prédestinée, dit la comtesse; un domestique maladroit ferre mal mes chevaux, je suis forcée de m’arrêter, et un bon génie, qui me voit dans l’embarras, bâtit sur ma route un palais de fée.
—Madame la comtesse n’a-t-elle point quelque soupçon sur ce génie inconnu?
—Non, vraiment.
—Pour moi, il me semble que madame la comtesse devrait deviner.
—Je vous jure, Gidsa, dit la comtesse se laissant tomber sur une chaise, que je suis dans l’ignorance la plus parfaite. Voyons, que pensez-vous donc?...
—Mais je pense.... Que madame me pardonne, quoique ma pensée soit bien naturelle....
—Parlez!
—Je pense que son altesse le vice-roi, sachant madame la comtesse en route, n’aura pas eu la patience d’attendre son arrivée, et que....
—Oh! mais vous avez là une idée merveilleusement juste, et c’est probable.... Au fait, qui donc, si ce n’était lui, aurait préparé, pour me la céder, une chambre avec tant de recherches? Cependant écoutez, il faut vous taire. Si c’est une surprise que Rodolfo me ménage, je veux m’y abandonner entièrement, je ne veux pas perdre une des émotions que me causera sa présence inattendue. Ainsi il est convenu que ce n’est pas lui, que cet étranger est un voyageur inconnu. Ainsi donc, gardez vos probabilités et laissez-moi avec mon doute. D’ailleurs, si c’était lui, c’est moi qui aurais deviné sa présence, et non pas vous.... Qu’il est bon pour moi, mon Rodolfo!... comme il pense à tout!... comme il m’aime!...
—Et ce dîner préparé avec tant de soin, croyez-vous...?
—Chut! je ne crois rien; je profite des biens que Dieu m’envoie, et je n’en remercie que Dieu. Voyez donc, c’est une merveille que cette argenterie. Si je n’avais pas trouvé ce noble voyageur, comment donc aurais-je fait pour manger dans autre chose? Voyez cette tasse de vermeil, n’a-t-elle pas l’air d’avoir été ciselée par Benvenuto?... Donnez-moi à boire, Gidsa.
La camérière remplit la tasse d’eau et y versa ensuite quelques gouttes de malvoisie de Lipari. La comtesse en avala deux ou trois gorgées, mais plutôt évidemment pour porter la coupe à sa bouche que par soif. On eût dit qu’elle cherchait, par le contact sympathique de ses lèvres, à deviner si c’était bien son amant lui-même qui avait été ainsi au-devant de tous ces besoins de luxe et de magnificence qui deviennent un superflu si nécessaire lorsque, depuis l’enfance, on en a pris l’habitude.
On servit à souper. La comtesse mangea comme mange une femme élégante, effleurant tout à la manière des colibris, des abeilles et des papillons, distraite et préoccupée tout en mangeant, et les yeux constamment fixés sur la porte, tressaillant chaque fois que cette porte s’ouvrait, le sein oppressé et les yeux humides; puis peu à peu elle tomba dans une langueur délicieuse dont elle ne pouvait pas elle-même se rendre compte. Gidsa s’en aperçut et s’en inquiéta:
—Madame la comtesse souffrirait-elle?
—Non, répondit Gemma d’une voix faible; mais ne trouvez-vous pas que ces parfums sont enivrans?
—Madame la comtesse veut-elle que j’ouvre la fenêtre?
—Gardez-vous-en; il me semble que je vais mourir, c’est vrai; mais il me semble aussi que la mort est bien douce. Otez-moi ma coiffe, elle me pèse, et je n’ai plus la force de la porter.
Gidsa obéit, et les longs cheveux de la comtesse tombèrent ondoyans jusqu’à terre.
—N’éprouvez-vous donc rien de pareil à ce que j’éprouve, Gidsa? C’est un bien-être inconnu, quelque chose de céleste qui me passe dans les veines; j’aurai bu quelque philtre enchanté. Aidez-moi donc à me soulever, et conduisez-moi devant cette glace.
Gidsa soutint la comtesse et l’aida à marcher vers la cheminée. Arrivée devant elle, elle appuya ses deux coudes sur le haut chambranle, abaissa sa tête sur ses mains et se regarda.
—Maintenant, dit-elle, faites enlever tout cela, déshabillez-moi et me laissez seule.
La camérière obéit, les valets de la comtesse desservirent, et lorsqu’ils furent sortis, Gidsa accomplit la seconde partie de l’ordre de sa maîtresse sans qu’elle se dérangeât de devant cette glace; seulement elle leva languissamment les bras, l’un après l’autre, pour donner à sa femme de chambre la possibilité de remplir son office, qu’elle remplit entièrement sans que la comtesse sortît de l’espèce d’extase dans laquelle elle était tombée; puis enfin, ainsi que sa maîtresse le lui avait ordonné, elle sortit et la laissa seule.
La comtesse acheva machinalement et dans un état pareil au somnambulisme le reste de sa toilette nocturne, se coucha, resta un instant accoudée et les regards fixés sur la porte; puis enfin, peu à peu et malgré ses efforts pour rester éveillée, ses paupières s’allourdirent, ses yeux se fermèrent, et elle se laissa aller sur son oreiller en poussant un long soupir et en murmurant le nom de Rodolfo.
Le lendemain, en s’éveillant, Gemma étendit la main comme si elle croyait trouver quelqu’un à ses côtés, mais elle était seule. Ses yeux errèrent alors autour de la chambre, puis revinrent se fixer sur une table placée près de son lit: sur cette table était une lettre tout ouverte, elle la prit et lut:
«Madame la comtesse,
»Je pouvais tirer de vous une vengeance de brigand, j’ai préféré me donner un plaisir de prince, mais, pour qu’en vous réveillant vous ne croyiez pas avoir fait un rêve, je vous ai laissé une preuve de la réalité: regardez-vous dans votre miroir.
»PASCAL BRUNO.»
Gemma se sentit frissonner par tout le corps, une sueur glacée lui couvrit le front; elle étendit la main vers la sonnette pour appeler; mais, s’arrêtant par un instinct de femme, elle rassembla toutes ses forces, sauta en bas de son lit, courut à la glace et poussa un cri: elle avait les cheveux et les sourcils rasés.
Aussitôt elle s’enveloppa d’un voile, se jeta dans sa voiture et ordonna de retourner à Palerme.
A peine y fut-elle arrivée, qu’elle écrivit au prince de Carini que son confesseur, en expiation de ses péchés, lui avait ordonné de se raser les sourcils et les cheveux, et d’entrer pendant un an dans un monastère.
Le 1er mai 1805, il y avait fête au château de Castelnuovo; Pascal Bruno était de bonne humeur, et donnait à souper à un de ses bons amis, nommé Placido Meli, honnête contrebandier du village de Gesso, et à deux filles que ce dernier avait ramenées avec lui de Messine dans l’intention de passer une joyeuse nuit. Cette attention amicale avait sensiblement touché Bruno, et, pour ne pas demeurer en reste de politesse avec un si prévoyant camarade, il s’était chargé de faire les honneurs de chez lui à la société; en conséquence, les meilleurs vins de Sicile et de Calabre avaient été tirés des caves de la petite forteresse, les premiers cuisiniers de Bauso mis en réquisition, et tout ce luxe singulier, auquel se plaisait parfois le héros de notre histoire, déployé pour cette circonstance.
L’orgie allait un train du diable, et cependant les convives n’étaient encore qu’au commencement du dîner, lorsque Ali apporta à Placido un billet d’un paysan de Gesso. Placido le lut, et froissant avec colère le papier entre ses mains:
—Par le sang du Christ! s’écria-t-il, il a bien choisi son moment!
—Qui cela, compère? dit Bruno.
—Pardieu! le capitaine Luigi Cama de Villa-San-Giovani.
—Ah! dit Bruno, notre fournisseur de rhum?
—Oui, répondit Placido: il me fait prévenir qu’il est sur la plage, et qu’il a tout un chargement dont il désire se débarrasser avant que les douaniers n’apprennent son arrivée.
—Les affaires avant tout, compère, dit Bruno. Je t’attendrai; je suis en bonne compagnie; et sois tranquille, pourvu que tu ne sois pas trop longtemps, tu retrouveras de tout ce que tu laisses, et plus que tu n’en pourras prendre.
—C’est l’affaire d’une heure, reprit Placido paraissant se rendre au raisonnement de son hôte; la mer est à cinq cents pas d’ici.
—Et nous avons toute la nuit, dit Pascal.
—Bon appétit, compère.
—Bon voyage, maître.
Placido sortit, Bruno resta avec les deux filles, et, comme il l’avait promis à son convive, l’entrain du souper ne souffrit aucunement de cette absence; Bruno était aimable pour deux, et la conversation et la pantomime commençaient à prendre une tournure des plus animées, lorsque la porte s’ouvrit et qu’un nouveau personnage entra: Pascal se retourna et reconnut le marchand maltais dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, et dont il était une des meilleures pratiques.
—Ah! pardieu! dit-il, soyez le bienvenu, surtout si vous apportez des pastilles du sérail, du tabac de Latakié, et des écharpes de Tunis: voilà deux odalisques qui attendent que je leur jette le mouchoir, et elles aimeront autant qu’il soit brodé d’or que s’il était de simple mousseline. A propos, votre opium a fait merveille.
—J’en suis aise, répondit le Maltais; mais en ce moment je viens pour autre chose que pour mon commerce.
—Tu viens pour souper, n’est-ce pas? Assieds-toi là, alors, et une seconde fois sois le bienvenu: voilà une place de roi; en face d’une bouteille et entre deux filles.
—Votre vin est excellent, j’en suis sûr, et ces dames me paraissent charmantes, répondit le Maltais, mais j’ai quelque chose d’important à vous dire.
—A moi?
—A vous.
—Dis.
—A vous seul.
—Alors à demain la confidence, mon digne commandeur.
—Il faut que je vous parle tout de suite.
—Alors parle devant tout le monde; il n’y a personne ici de trop, et j’ai pour principe, quand je suis bien, de ne pas me déranger, fùt-il question de ma vie.
—C’est justement de cela qu’il s’agit.
—Bah! dit Bruno remplissant les verres, il y a un Dieu pour les honnêtes gens. A ta santé, commandeur.—Le Maltais vida son verre.—C’est bien; maintenant assieds-toi et prêche, nous écoutons.
Le marchand vit bien qu’il fallait faire selon le caprice de son hôte; en conséquence, il lui obéit.
—A la bonne heure, dit Bruno; et maintenant qu’y a-t-il?
—Il y a, continua le Maltais, que vous savez que les juges de Calvaruso, de Spadafora, de Bauso, de Saponara, de Divieto et de Romita ont été arrêtés.
—J’ai entendu dire quelque chose comme cela, dit insoucieusement Pascal Bruno en vidant un plein verre de vin de Marsalla, qui est le madère de la Sicile.
—Et vous savez la cause de cette arrestation?
—Je m’en doute; n’est-ce pas parce que le prince de Carini, de mauvaise humeur de ce que sa maîtresse s’est retirée dans un couvent, trouve qu’ils mettent trop de lenteur et de maladresse à arrêter un certain Pascal Bruno dont la tête vaut trois mille ducats?
—C’est cela même.
—Vous voyez que je suis au courant de ce qui se passe.
—Cependant il se peut qu’il y ait certaines choses que vous ignoriez.
—Dieu seul est grand, comme dit Ali; mais continuez, et j’avouerai mon ignorance; je ne demande pas mieux que de m’instruire.
—Eh bien! les six juges se sont rassemblés, et ils ont mis en commun vingt-cinq onces, ce qui fait cent cinquante.
—Autrement dit, répondit Bruno toujours avec la même insouciance, dix-huit cent quatre-vingt-dix livres. Vous voyez que, si je ne tiens pas exactement mes registres, ce n’est pas faute de savoir compter.... Après?
—Après, ils ont fait offrir cette somme à deux ou trois hommes qu’ils savent de votre société habituelle, s’ils voulaient aider à vous faire prendre.
—Qu’ils offrent, je suis bien sûr qu’ils ne trouveront pas un traître à dix lieues à la ronde.
—Vous vous trompez, dit le Maltais, le traître est trouvé.
—Ah! fit Bruno fronçant le sourcil et portant la main à son stylet: et comment sais-tu cela?
—Oh! mon Dieu, de la manière la plus simple et la plus naturelle: j’étais hier à Messine, chez le prince de Carini, qui m’avait fait venir pour acheter des étoffes turques, lorsqu’un valet vint lui dire deux mots à l’oreille.—C’est bien, répondit tout haut le prince; qu’il entre.—Il me fit signe alors de passer dans un cabinet; j’obéis; et, comme il ne se doutait aucunement que je vous connusse, j’entendis la conversation qui vous concernait.
—Oui, eh bien?
—Eh bien! l’homme qu’on annonçait, c’était le traître; il s’engageait à ouvrir les portes de votre forteresse, à vous livrer sans défense pendant que vous souperiez, et à conduire lui-même les gendarmes jusqu’à votre salle à manger.
—Et sais-tu quel est le nom de cet homme? dit Bruno.
—C’est Placido Meli, répondit le Maltais.
—Sang-Dieu! s’écria Pascal en grinçant des dents, il était là tout-à-l’heure.
—Et il est sorti?
—Un instant avant que vous n’arrivassiez.
—Alors il est allé chercher les gendarmes et les compagnies; car, autant que j’en puis juger, vous étiez en train de souper.
—Tu le vois.
—C’est cela même. Si vous voulez fuir, il n’y a pas un instant à perdre.
—Moi fuir! dit Bruno en riant. Ali!... Ali!...—Ali entra.—Ferme la porte du château, mon enfant; lâche trois de mes chiens dans la cour, fais monter le quatrième, Lionna... et prépare les munitions.—Les femmes poussèrent des cris.—Oh! taisez-vous, mes déesses, continua Bruno avec un geste impératif; il ne s’agit pas de chanter ici; du silence, et vivement, s’il vous plaît.—Les femmes se turent.—Tenez compagnie à ces dames, commandeur, ajouta Bruno; quant à moi, il faut que je fasse ma tournée.
Pascal prit sa carabine, ceignit sa giberne, s’avança vers la porte; mais, au moment de sortir, il s’arrêta écoutant.
—Qu’y a-t-il? dit le Maltais.
—N’entendez-vous pas mes chiens qui hurlent? l’ennemi s’avance: voyez, ils n’ont été que de cinq minutes en retard sur vous.—Silence, mes tigres, continua Bruno ouvrant une fenêtre et faisant entendre un sifflement particulier. C’est bien, c’est bien, je suis prévenu. Les chiens gémirent doucement et se turent; les femmes et le Maltais frissonnèrent de terreur, devinant qu’il allait se passer quelque chose de terrible. En ce moment Ali entra avec la chienne favorite de Pascal: la noble bête alla droit à son maître, se dressa sur ses pattes de derrière, lui mit les deux pattes de devant sur les épaules, le regarda avec intelligence, et se mit à hurler doucement.
—Oui, oui, Lionna, dit Bruno, oui, vous êtes une charmante bête.—Puis il la caressa de la main, et l’embrassa au front comme il aurait fait à une maîtresse. La chienne poussa un second hurlement bas et plaintif.—Allons, Lionna, continua Pascal, il paraît que cela presse. Allons, ma belle, allons.—Et il sortit, laissant le Maltais et les deux femmes dans la chambre du souper.
Pascal descendit dans la cour et trouva les trois chiens qui s’agitaient avec inquiétude, mais sans indiquer encore que le danger fût très pressant. Alors il ouvrit la porte du jardin et commença d’en faire le tour. Tout-à-coup Lionna s’arrêta, prit le vent, et marcha droit vers un point de l’enclos. Arrivée au pied du mur, elle se dressa comme pour l’escalade, faisant claquer ses mâchoires l’une contre l’autre, et rugissant sourdement en regardant si son maître l’avait suivie. Pascal Bruno était derrière elle.
Il comprit qu’il y avait dans cette direction et à quelques pas de distance seulement, un ennemi caché, et se rappelant que la fenêtre de la chambre où Paolo Tommasi avait été prisonnier donnait justement sur ce point, il remonta vivement, suivi de Lionna, qui, la gueule béante et les yeux pleins de sang, traversa la salle où les deux filles et le Maltais attendaient, pleins d’anxiété, la fin de cette aventure, et entra dans la chambre voisine, qui se trouvait sans lumière et dont la fenêtre était ouverte. A peine entrée, Lionna se coucha à plat ventre, rampa comme un serpent vers la croisée, puis, lorsqu’elle n’en fut plus éloignée que de quelques pieds, et avant que Pascal ne pensât à la retenir, elle s’élança comme une panthère par l’issue qui lui était offerte, s’inquiétant peu de retomber de l’autre côté de la hauteur de vingt pieds.
Pascal était à la fenêtre en même temps que la chienne; il lui vit faire trois bonds vers un olivier isolé, puis il entendit un cri. Lionna venait de saisir à la gorge un homme caché derrière cet olivier.
—Au secours! cria une voix que Pascal reconnut pour être celle de Placido; à moi, Pascal! à moi!... rappelle ton chien, ou je l’éventre.
—Pille!... Lionna, pille! A mort, à mort, Lionna! à mort le traître!...
Placido vit que Bruno savait tout: alors, à son tour, il poussa un rugissement de douleur et de colère, et un combat mortel commença entre l’homme et le chien. Bruno regardait ce duel étrange appuyé sur sa carabine. Pendant dix minutes, à la clarté incertaine de la lune, il vit lutter, tomber, se relever, deux corps dont il ne pouvait distinguer ni la nature ni la forme, tant ils semblaient n’en faire qu’un. Pendant dix minutes il entendit des cris confus, sans pouvoir reconnaître les hurlemens de l’homme de ceux du chien; enfin, au bout de dix minutes, l’un des deux tomba pour ne plus se relever: c’était l’homme.
Bruno siffla Lionna, traversa de nouveau la chambre du souper sans dire une parole, descendit vivement et alla ouvrir la porte à sa chienne favorite; mais, au moment où elle rentrait toute sanglante de coups de couteau et de morsures, il vit, dans la rue qui montait du village au château, luire sous un rayon de la lune des canons de carabines. Aussitôt il barricada la porte et remonta dans la chambre où étaient les convives tremblans. Le Maltais buvait, les deux filles disaient leurs prières.
—Eh bien? dit le Maltais.
—Eh bien! commandeur? dit Bruno.
—Placido?
—Son affaire est faite, dit Bruno, mais voilà une autre légion de diables qui nous tombe sur le corps.
—Lesquels?
—Les gendarmes et les compagnies de Messine, si je ne me trompe.
—Et qu’allez-vous faire?
—En tuer le plus que je pourrai d’abord.
—Et ensuite?
—Ensuite... je me ferai sauter avec le reste.
Les filles jetèrent de grands cris.
—Ali, continua Pascal, conduis ces demoiselles à la cave, et donne-leur tout ce qu’elles te demanderont, excepté de la chandelle, de peur qu’elles ne mettent le feu aux poudres avant qu’il ne soit temps.
Les pauvres créatures tombèrent à genoux.
—Allons, allons, dit Bruno frappant du pied, obéissons. Et il dit cela avec un geste et un accent tels, que les deux filles se levèrent et suivirent Ali sans oser proférer une seule plainte.
—Et maintenant, commandeur, dit Bruno lorsqu’elles furent sorties, éteignez les lumières et mettez-vous dans un coin oû les balles ne puissent pas vous atteindre, car voilà les musiciens qui arrivent, et la tarentelle va commencer.
Quelques instans après, Ali rentra portant sur son épaule quatre fusils du même calibre et un panier plein de cartouches. Pascal Bruno ouvrit toutes les fenêtres, pour faire face à la fois des différens côtés. Ali prit un fusil et s’apprêta à se placer à l’une d’elles.
—Non, mon enfant, lui dit Pascal avec un accent d’affection toute paternelle, non, cela me regarde seul. Je ne veux pas unir ainsi ta destinée à la mienne; je ne veux pas t’entraîner où je vais. Tu es jeune, rien n’a poussé encore ta vie hors de la voie ordinaire; crois-moi, reste dans le chemin battu par les hommes.
—Père, dit le jeune homme avec sa voix douce, pourquoi ne veux-tu pas que je te défende comme Lionna t’a défendu? Tu sais bien que je n’ai que toi, et que, si tu meurs, je mourrai avec toi.
—Non point, Ali, si je meurs, je laisserai peut-être derrière moi à accomplir sur la terre quelque mission mystérieuse et terrible que je ne pourrais confier qu’à mon enfant, il faut donc que mon enfant vive pour faire ce que lui ordonnera son père.
—C’est bien, dit Ali. Le père est le maître, l’enfant obéira. Pascal laissa tomber sa main, Ali la prit et la baisa.
—Ne te servirai-je donc à rien, père? dit l’enfant.
—Charge les fusils, répondit Bruno. Ali se mit à la besogne.
—Et moi? dit le Maltais du coin où il était assis.
—Vous, commandeur, je vous garde pour vous envoyer en parlementaire.
En ce moment Pascal Bruno vit briller les fusils d’une seconde troupe qui descendait de la montagne, et qui s’avançait si directement vers l’olivier isolé au pied duquel gisait le corps de Placido, qu’il était évident que cette troupe venait à un rendez-vous indiqué. Ceux qui marchaient les premiers heurtèrent le cadavre; alors un cercle se forma autour de lui, mais nul ne pouvait le reconnaître, tant les dents de fer de Lionna l’avaient défiguré. Cependant, comme c’était à cet olivier que Placido leur avait donné rendez-vous, que le cadavre était au pied de cet olivier, et que nul être vivant ne se montrait aux environs, il était évident que le mort était Placido lui-même. Les miliciens en augurèrent que la trahison était découverte, et que par conséquent Bruno devait être sur ses gardes. Alors ils s’arrêtèrent pour délibérer. Pascal suivait tous leurs mouvemens debout à la fenêtre. En ce moment la lune sortit de derrière un nuage, son rayon tomba sur lui; un des miliciens l’aperçut, le désigna de la main à ses camarades; le cri: Le bandit!... le bandit!... se fit entendre dans les rangs et fut immédiatement suivi d’un feu de peloton. Quelques balles vinrent s’aplatir contre le mur; d’autres passèrent en sifflant aux oreilles et au-dessus de la tête de celui à qui elles étaient adressées, et allèrent se loger dans les solives du plafond. Pascal répondit en déchargeant successivement les quatre fusils que venait de charger Ali: quatre hommes tombèrent.
Les compagnies, qui n’étaient pas composées de troupes de ligne, mais d’une espèce de garde nationale organisée pour la sûreté des routes, hésitèrent un instant en voyant la mort si prompte à venir au-devant d’elles. Tous ces hommes, comptant sur la trahison de Placido, avaient espéré une prise facile: mais, au lieu de cela, c’était un véritable siége qu’il fallait faire. Or, tous les ustensiles nécessaires à un siége leur manquaient; les murailles de la petite forteresse étaient élevées et ses portes solides, et ils n’avaient ni échelles ni haches; restait la possibilité de tuer Pascal au moment où il était forcé de se découvrir pour ajuster par la fenêtre; mais c’était une assez mauvaise chance pour des gens convaincus de l’invulnérabilité de leur adversaire. La manœuvre qu’ils jugèrent la plus urgente fut donc de se retirer hors de portée pour délibérer sur ce qu’il y avait à faire; mais leur retraite ne s’opéra point si vite que Pascal Bruno n’eût le temps de leur envoyer deux nouveaux messagers de mort.
Pascal, se voyant momentanément débloqué de ce côté, se porta vers la fenêtre opposée, qui plongeait sur le village, les coups de fusil avaient donné l’éveil à cette première troupe; aussi à peine eut il paru à la fenêtre qu’il fut accueilli par une grêle de balles; mais le même bonheur miraculeux le préserva de leur atteinte; c’était à croire à un enchantement; tandis qu’au contraire chacun de ses coups, à lui, porta sur cette masse, et Pascal put juger, aux blasphèmes qu’il entendit, qu’ils n’avaient point été perdus.
Alors même chose arriva pour cette troupe que pour l’autre: le désordre se mit dans ses rangs; cependant, au lieu de prendre la fuite, elle se rangea contre les murs mêmes de la forteresse, manœuvre qui mettait Bruno dans l’impossibilité de tirer sur ses ennemis sans sortir à moitié le corps par la fenêtre. Or, comme le bandit jugea inutile de s’exposer à ce danger, il résulta de ce double acte de prudence que le feu cessa momentanément.
—En sommes-nous quittes, dit le Maltais, et pouvons-nous crier victoire?
—Pas encore, dit Bruno; ce n’est qu’une suspension d’armes; ils sont sans doute allés chercher dans le village des échelles et des haches, et nous ne tarderons pas à avoir de leurs nouvelles. Mais soyez tranquille, continua le bandit remplissant deux verres, nous ne demeurerons pas en reste avec eux, et nous leur donnerons des nôtres.... Ali, va chercher un tonneau de poudre. A votre santé, commandeur.
—Que voulez-vous faire de ce tonneau? dit le Maltais avec une certaine inquiétude.
—Oh! presque rien... vous allez voir.
Ali rentra avec l’objet demandé.
—C’est bien, continua Bruno; maintenant prends une vrille et perce un trou dans ce baril.
Ali obéit avec cette promptitude passive qui était la marque distinctive de son dévoûment. Pendant ce temps, Pascal déchira une serviette, l’effila, réunit les fils, les roula dans la poudre d’une cartouche, passa cette mèche dans le trou du baril, et boucha ce trou avec de la poudre mouillée qui fixa la mèche en même temps; il avait à peine fini ces préparatifs, que des coups de hache retentirent dans la porte.
—Suis-je bon prophète? dit Bruno en roulant le baril vers l’entrée de la chambre, laquelle donnait sur un escalier descendant à la cour, et en revenant prendre au feu un morceau de sapin allumé.
—Ah! fit le Maltais, je commence à comprendre....
—Père, dit Ali, ils reviennent du côté de la montagne avec une échelle.
Bruno s’élança vers la fenêtre de laquelle il avait fait feu la première fois, et vit qu’effectivement ses adversaires s’étaient procuré l’instrument d’escalade qui leur manquait, et que, honteux de leur première retraite, ils revenaient à la charge avec une certaine contenance.
—Les fusils sont-ils chargés? dit Bruno.
—Oui, père, répondit Ali lui présentant sa carabine.
Bruno prit, sans regarder, l’arme que lui tendait l’enfant, l’appuya lentement contre son épaule, et visa avec plus d’attention qui ne l’avait encore fait; le coup partit, un des deux hommes qui portaient l’échelle tomba.
Un second le remplaça; Bruno prit un second fusil, et le milicien tomba près de son camarade.
Deux autres hommes succédèrent aux hommes tués, et furent tués à leur tour; l’échelle semblait avoir la fatale propriété de l’arche, à peine y avait-on porté la main, que l’on tombait mort. Les escaladeurs, laissant leur échelle, se retirèrent une seconde fois, envoyant une décharge aussi inutile que les autres.
Cependant ceux qui attaquaient la porte frappaient à coups redoublés; de leur côté, les chiens hurlaient affreusement de momens en momens, les coups devenaient plus sourds et les aboiemens plus acharnés. Enfin un battant de la porte fut enfoncé, deux ou trois hommes pénétrèrent par cette ouverture; mais à leurs cris de détresse leurs camarades jugèrent qu’ils étaient aux prises avec des ennemis plus terribles qu’ils ne les avaient jugés d’abord; il n’y avait pas moyen de tirer sur les chiens sans tuer les hommes. Une partie des assiégeans pénétra donc successivement par l’ouverture, la cour s’emplit bientôt, et alors commença une espèce de combat du cirque, entre les soldats de milice et les quatre molosses qui défendaient avec acharnement l’escalier étroit qui conduisait au premier étage de la forteresse. Tout-à-coup la porte placée au haut de cet escalier, s’ouvrit, et le baril de poudre préparé par Bruno, bondissant de marche en marche, vint éclater comme un obus au milieu de cette tuerie.
L’explosion fut terrible, un mur s’écroula, tout ce qui était dans la cour fut pulvérisé.
Il y eut un moment de stupeur parmi les assiégeans; cependant les deux troupes s’étaient réunies et elles présentaient encore un effectif de plus de trois cents combattans. Un sentiment profond de honte prit cette multitude, de se voir ainsi tenue en échec par un seul homme; les chefs en profitèrent pour l’encourager. A leur voix, les assiégeans se formèrent en colonne; une brèche était pratiquée par la chute du mur, ils marchèrent vers elle en bon ordre, et, se déployant dans toute sa largeur, la franchirent sans obstacle, pénétrèrent dans la cour et se trouvèrent en face de l’escalier. Là, il y eut encore un moment d’hésitation. Enfin quelques-uns commencèrent à le gravir aux encouragemens de leurs camarades; les autres les suivirent, l’escalier fut envahi, et bientôt les premiers eussent voulu reculer que la chose ne leur eût plus été possible; ils furent donc forcés d’attaquer la porte; mais, contre leur attente, la porte céda sans résister. Les assiégeans se répandirent alors avec de grands cris de victoire dans la première chambre. En ce moment, la porte de la seconde s’ouvrit et les miliciens aperçurent Bruno assis sur un baril de poudre et tenant un pistolet de chaque main; en même temps le Maltais, épouvanté, s’élança par la porte ouverte, en s’écriant avec un accent de vérité qui ne laissait aucun doute:
—Arrière! tous, arrière! la forteresse est minée; si vous faites un pas de plus, nous sautons!...
La porte se referma comme par enchantement; les cris de victoire se changèrent en cris de terreur; on entendit toute cette multitude se précipiter par l’escalier étroit qui conduisait à la cour; quelques-uns sautèrent par les fenêtres; il semblait à tous ces hommes qu’ils sentaient trembler la terre sous leurs pieds. Au bout de cinq minutes, Bruno se retrouva maître de nouveau de la forteresse; quant au Maltais, il avait profité de l’occasion pour se retirer.
Pascal, n’entendant plus aucun bruit, se leva et alla vers une fenêtre; le siége était converti en blocus; des postes étaient établis en face de toutes les issues, et ceux qui les composaient s’étaient mis à l’abri du feu de la place derrière des charrues et des tonneaux; il était évident qu’un nouveau plan de campagne venait d’être adopté.
—Il paraît qu’ils comptent nous prendre par famine, dit Bruno.
—Les chiens! répondit Ali.
—N’insulte pas les pauvres bêtes qui sont mortes en me défendant, dit en souriant Bruno, et appelle les hommes des hommes.
—Père! s’ecria Ali.
—Eh bien?
—Vois-tu?
—Quoi?
—Cette lueur?...
—En effet, que signifie-t-elle?... Ce n’est point encore le jour qui s’élève; d’ailleurs, elle vient du nord et non de l’orient.
—C’est le feu qui est au village, dit Ali.
—Sang du Christ! est-ce vrai?...
En ce moment, on commença à entendre de grands cris de détresse... Bruno s’élança vers la porte et se trouva face à face avec le Maltais.
—C’est vous, commandeur? s’écria Pascal.
—Oui, c’est moi... moi-même.... Ne vous trompez pas et ne me prenez pas pour un autre. Je suis un ami.
—Soyez le bien venu: que se passe-t-il?
—Il se passe que, désespérant de vous prendre, ils ont mis le feu au village, et qu’ils ne l’éteindront que lorsque les paysans consentiront à marcher contre vous: quant à eux, ils en ont assez.
—El les paysans?
—Refusent.
—Oui... oui... je le savais d’avance: ils laisseraient plutôt brûler toutes leurs maisons que de toucher un cheveu de ma tête.... C’est bien, commandeur; retournez vers ceux qui vous envoient, et dites-leur d’éteindre l’incendie.
—Comment cela?
—Je me rends.
—Tu te rends, père? s’écria Ali.
—Oui... mais j’ai donné ma parole de ne me rendre qu’à un seul homme, et je ne me rendrai qu’à lui: qu’on éteigne donc l’incendie comme j’ai dit, et qu’on aille me chercher cet homme à Messine.
—Et cet homme, quel est-il?
—C’est Paolo Tommasi, le brigadier de la gendarmerie.
—Avez-vous autre chose à demander?
—Une seule, répondit Bruno; et il parla bas au Maltais.
—J’espère que ce n’est pas ma vie que tu demandes? dit Ali.
—Ne t’ai-je pas prévenu que j’aurais peut-être besoin de toi après ma mort?
—Pardon, père, je l’avais oublié.
—Allez, commandeur, et faites ce que je vous ai dit; si je vois le feu s’éteindre, c’est que mes conditions seront acceptées.
—Vous ne m’en voulez pas de ce que je me suis chargé de la commission?
—Ne vous ai-je pas dit que je vous gardais pour parlementaire?
—C’est juste.
—A propos, dit Pascal, combien de maisons brûlées?
—Il y en avait déjà deux quand je suis venu vers vous.
—Il y a trois cent quinze onces dans cette bourse; vous les distribuerez entre les propriétaires. Au revoir.
—Adieu.
Le Maltais sortit.
Bruno jeta loin de lui ses pistolets, revint s’asseoir sur son baril de poudre, et tomba dans une rêverie profonde; quant au jeune Arabe, il alla s’étendre sur sa peau de tigre et resta immobile en fermant les yeux comme s’il dormait. Peu à peu la lueur de l’incendie s’éteignit: les conditions étaient acceptées.
Au bout d’une heure à peu près, la porte de la chambre s’ouvrit; un homme parut sur le seuil, et, voyant que ni Bruno ni Ali ne s’apercevaient de son arrivée, il se mit à tousser avec affectation: c’était un moyen d’annoncer sa présence qu’il avait vu employer avec succès au théâtre de Messine.
Bruno se retourna.
—Ah! c’est vous, brigadier? dit-il en souriant; c’est un plaisir de vous envoyer chercher, vous ne vous faites pas attendre.
—Oui... ils m’ont rencontré à un quart de lieue d’ici sur la route, comme je venais avec ma compagnie... et ils m’ont dit que vous me demandiez.
—C’est vrai: j’ai voulu vous prouver que j’étais homme de mémoire.
—Pardieu! je le savais bien.
—Et comme je vous ai promis de vous faire gagner les trois mille ducats en question, j’ai voulu vous tenir parole.
—Sacredieu!... sacredieu!!... sacredieu!!!... dit le brigadier avec une énergie croissante.
—Qu’est-ce que cela veut dire, camarade?
—Ça veut dire... ça veut dire... que j’aimerais mieux gagner ces trois mille ducats d’une autre manière... à autre chose... à la loterie, par exemple.
—Et pourquoi cela?
—Parce que vous êtes un brave, et que les braves sont rares.
—Bah! que vous importe?... c’est de l’avancement pour vous, brigadier.
—Je le sais bien, répondit Paolo d’un air profondément désespéré: ainsi, vous vous rendez?
—Je me rends.
—A moi?
—A vous.
—Parole?
—Parole. Vous pouvez donc éloigner toute cette canaille, à laquelle je ne veux pas avoir affaire?
Paolo Tommasi alla à la fenêtre.
—Vous pouvez vous retirer tous, cria-t-il; je réponds du prisonnier: allez annoncer sa prise à Messine.
Les miliciens poussèrent de grands cris de joie.
—Maintenant, dit Bruno au brigadier, si vous voulez vous mettre à table, nous achèverons le souper qui a été interrompu par ces imbéciles.
—Volontiers, répondit Paolo, car je viens de faire huit lieues en trois heures, et je meurs de faim et de soif.
—Eh bien! dit Bruno, puisque vous êtes en si bonnes dispositions et que nous n’avons plus qu’une nuit à passer ensemble, il faut la passer joyeuse.—Ali, va chercher ces dames.—En attendant, brigadier, continua Bruno en remplissant deux verres, à vos galons de maréchal-des-logis!
Cinq jours après les événemens que nous venons de raconter, le prince de Carini apprit, en présence de la belle Gemma, qui venait d’achever sa pénitence au couvent de la Visitation, et qui, depuis huit jours seulement, était rentrée dans le monde, que ses ordres étaient enfin exécutés, et que Pascal Bruno avait été pris et conduit dans les prisons de Messine.
—C’est bien, dit-il; que le prince de Goto paie les trois mille ducats promis, qu’il lui fasse faire son procès et qu’on l’exécute.
—Oh! dit Gemma avec cette voix douce et caressante à laquelle le prince ne savait rien refuser, j’aurais été bien curieuse de voir cet homme que je ne connais pas, et dont on raconte des choses si bizarres!
—Qu’à cela ne tienne, mon bel ange, répondit le prince; nous le ferons pendre à Palerme!
Selon la promesse qu’il avait faite à sa maîtresse, le prince de Carini avait ordonné de transférer le condamné de Messine à Palerme, et Pascal Bruno avait été amené à grand renfort de gendarmerie dans la prison de la ville, qui était située derrière le Palazzo Reale et qui attenait à l’hôpital des Fous.
Vers le soir du deuxième jour, un prêtre descendit dans son cachot; Pascal se leva en voyant entrer l’homme de Dieu; cependant, contre son attente, il refusa de se confesser; le prêtre insista, mais rien ne put déterminer Pascal à accomplir cet acte de religion. Le prêtre, voyant qu’il ne pouvait vaincre cette obstination, lui en demanda la cause.
—La cause, lui dit Bruno, est que je ne veux pas faire un sacrilége....
—Comment cela, mon fils?
—La première condition d’une bonne confession n’est-elle pas, non-seulement l’aveu de ses crimes à soi, mais encore l’oubli des crimes des autres?
—Sans doute, et il n’y a point de confession parfaite sans cela.
—Eh bien! dit Bruno, je n’ai pas pardonné; ma confession serait donc mauvaise, et je ne veux pas faire une mauvaise confession....
—Ne serait-ce pas plutôt, dit le prêtre, que vous avez des crimes si énormes à avouer, que vous craignez qu’ils ne dépassent le pouvoir de la rémission humaine? Rassurez-vous, Dieu est miséricordieux, et il y a toujours espérance là où il y a repentir.
—Cependant, mon père, si, entre votre absolution et la mort, une mauvaise pensée me venait que je n’aie pas la force de vaincre....
—Le fruit de votre confession serait perdu, dit le prêtre.
—Il est donc inutile que je me confesse, dit Pascal, car cette mauvaise pensée me viendra.
—Ne pouvez-vous la chasser de votre esprit?
Pascal sourit.
—C’est elle qui me fait vivre, mon père; sans cette pensée infernale, sans ce dernier espoir de vengeance, croyez-vous que je me serais laissé traîner en spectacle à cette multitude? Non point, je me serais déjà étranglé avec la chaîne qui m’attache. J’y étais décidé à Messine, j’allais le faire, lorsque l’ordre de me transporter à Palerme est arrivé. Je me suis douté qu’Elle avait voulu me voir mourir.
—Qui?
—Elle.
—Mais si vous mourez ainsi, sans repentir, Dieu sera sans miséricorde.
—Mon père, Elle aussi mourra sans repentir, car Elle mourra au moment où elle s’y attendra le moins; Elle aussi mourra sans prêtre et sans confession; Elle aussi trouvera comme moi Dieu sans miséricorde, et nous serons damnés ensemble.
En ce moment un geôlier entra.
—Mon père, dit-il, la chapelle ardente est préparée.
—Persistez-vous dans votre refus, mon fils? dit le prêtre.
—J’y persiste, répondit tranquillement Bruno.
—Alors, je ne retarderai pas la messe des morts, que je vais dire pour vous, par de plus longues instances; d’ailleurs j’espère que, pendant que vous l’écouterez, l’esprit de Dieu vous visitera et vous inspirera de meilleures pensées.
—C’est possible, mon père, mais je ne le crois pas.
Les gendarmes entrèrent, détachèrent Bruno, le conduisirent à l’église de Saint-François-de-Sales, qui est en face de la prison, et qui était ardemment éclairée; c’est là qu’il devait, selon l’usage, entendre la messe des morts et passer la nuit en prières, car l’exécution était fixée pour le lendemain à huit heures du matin. Un anneau de fer était scellé à un pilier du chœur; Pascal fut attaché à cet anneau par une chaîne qui lui ceignait le corps, mais qui était assez longue cependant pour qu’il pût atteindre le seuil de la balustrade où les fidèles venaient s’agenouiller pour recevoir la communion.
Au moment où la messe commençait, des gardiens de l’hôpital des Fous apportèrent une bière qu’ils placèrent au milieu de l’église; elle renfermait le corps d’une aliénée décédée dans la journée, et le directeur avait pensé à faire profiter la morte du bénéfice de la messe dite pour celui qui allait mourir. D’ailleurs, c’était pour le prêtre une économie de temps et de peine, et comme cette disposition arrangeait tout le monde, elle ne souffrit pas la plus petite difficulté. Le sacristain alluma deux cierges, l’un à la tête, l’autre au pied du cercueil, et le sacrifice divin commença; Pascal l’écouta tout entier avec recueillement.
Lorsqu’il fut fini, le prêtre descendit vers lui et lui demanda s’il était dans des dispositions meilleures; mais le condamné lui répondit que, malgré la messe qu’il avait entendue, malgré les prières dont il l’avait accompagnée, ses sentimens de haine étaient toujours les mêmes. Le prêtre lui annonça que le lendemain, à sept heures du matin, il reviendrait lui demander si une nuit de solitude et de recueillement dans une église et en face de la croix n’avait point amené quelque changement dans ses projets de vengeance.
Bruno resta seul. Alors il tomba dans une rêverie profonde. Toute sa vie repassa devant ses yeux, depuis cet âge de la première enfance où l’on commence à se rappeler; il chercha en vain dans cet âge ce qu’il avait pu faire pour mériter la destinée qui attendait sa jeunesse. Il n’y trouva rien qu’une obéissance filiale et sainte aux parens que le Seigneur lui avait donnés. Il se rappela cette maison paternelle si tranquille et si heureuse d’abord, et qui tout-à-coup était devenue, sans qu’il en sût encore la cause, si pleine de larmes et de douleurs; il se rappela le jour où son père était sorti avec un stylet, et était rentré plein de sang; il se rappela la nuit pendant laquelle celui à qui il devait la vie avait été arrêté comme il venait de l’être, où on l’avait conduit, lui enfant, dans une chapelle ardente pareille à celle où il était maintenant renfermé, et le moment où il trouva dans cette chapelle un homme enchaîné comme lui. Il lui sembla que c’était une fatale influence, un hasard capricieux, une victorieuse supériorité du mal sur le bien, qui avaient ainsi mené au pire toutes les choses de sa famille. Alors il ne comprit plus rien aux promesses de félicité que le ciel fait aux hommes; il chercha vainement dans sa vie une apparition de cette Providence tant vantée; et, pensant qu’en ce moment suprême quelque chose de cet éternel secret lui serait révélé peut-être, il se précipita le front contre terre, adjurant Dieu, avec toutes les voix de son âme, de lui dire le mot de cette énigme terrible, de soulever un pan de ce voile mystérieux, et de se montrer à lui comme un père ou comme un tyran. Cette espérance fut vaine, tout resta muet, si ce n’est la voix de son cœur, qui répétait sourdement: Vengeance! vengeance! vengeance!...
Alors il pensa que la mort était peut-être chargée de lui répondre, et que c’était dans ce but de révélation qu’un cadavre avait été apporté près de lui, tant il est vrai que l’homme le plus infime fait de sa propre existence le centre de la création, croit que tout se rattache à son être, et que sa misérable personne est le pivot autour duquel tourne l’univers. Il se releva donc lentement, plus sombre et plus pâle de sa lutte avec sa pensée que de sa lutte avec l’échafaud, et tourna les yeux vers ce cadavre; c’était celui d’une femme.
Pascal frissonna sans savoir pourquoi; il chercha les traits du visage[21] de cette femme, mais un coin du linceul était retombé sur sa figure et la voilait. Tout-à-coup un souvenir instinctif lui rappela Teresa, Teresa qu’il n’avait pas vue depuis le jour où il avait rompu avec les hommes et avec Dieu; Teresa qui était devenue folle, et qui, depuis trois ans, habitait la maison des aliénés, d’où sortait cette bière et ce cadavre; Teresa, sa fiancée, avec laquelle il se retrouvait peut-être au pied de l’autel, où il avait espéré si longtemps la conduire, et où ils venaient enfin, par une amère dérision de la destinée, se rejoindre, elle morte et lui près de mourir. Un plus long doute lui fut insupportable, il s’avança vers le cercueil pour s’assurer de la réalité; mais tout-à-coup il se sentit arrêter par le milieu du corps: c’était sa chaîne qui n’était point assez longue pour qu’il pût atteindre le cadavre, et qui le retenait scellé à son pilier; il étendit les bras vers lui, mais il s’en fallait de quelques pieds qu’il ne pût l’atteindre. Il chercha s’il ne trouverait pas à la portée de sa main une chose quelconque, à l’aide de laquelle il pût écarter ce coin de voile, mais il ne vit rien; il épuisa tout le souffle de sa poitrine pour soulever ce suaire, mais ce suaire demeura immobile comme un pli de marbre. Alors il se retourna avec un mouvement de rage intime, impossible à décrire, saisit sa chaîne à deux mains, et, dans une secousse où il rassembla toutes les forces de son corps, il essaya de la briser: les anneaux étaient solidement rivés les uns aux autres, la chaîne résista. Alors la sueur d’une rage impuissante glaça son front; il revint s’asseoir au pied de son pilier, laissa tomber sa tête dans ses mains et resta immobile, muet comme la statue de l’abattement, et lorsque le prêtre revint le lendemain matin, il le retrouva dans la même posture.
L’homme de Dieu s’avança vers lui, serein et calme comme il convenait à sa mission de paix et à son ministère de réconciliation; il crut que Pascal dormait, et lui posa la main sur l’épaule. Pascal tressaillit et leva la tête.
—Eh bien! mon fils, dit le prêtre, êtes-vous prêt à vous confesser? je suis prêt à vous absoudre....
—Tout à l’heure je vous répondrai, mon père; mais d’abord, rendez-moi un dernier service, dit Bruno.
—Lequel? parlez.
Bruno se leva, prit le prêtre par la main, le conduisit près du cercueil, dont il s’approcha lui-même autant que sa chaîne le lui permit; puis lui montrant le cadavre:
—Mon père, lui dit-il, voulez-vous lever le coin du linceul qui me cache la figure de cette femme?
Le prêtre leva le coin du linceul; Pascal ne s’était pas trompé; cette femme, c’était Teresa. Il la regarda un instant avec une tristesse profonde, puis il fit signe au prêtre de laisser retomber le suaire. Le prêtre obéit.
—En bien! mon fils, lui dit-il, la vue de cette femme vous a-t-elle inspiré de pieuses pensées?
—Cette femme et moi, mon père, répondit Bruno, nous étions nés pour être heureux et innocens; Elle l’a faite parjure, et moi meurtrier; Elle nous a conduits, cette femme par le chemin de la folie, et moi par celui du désespoir, à la tombe où nous descendrons tous deux aujourd’hui.... Que Dieu lui pardonne, s’il l’ose; mais moi, je ne lui pardonne pas!
En ce moment les gardes entrèrent, qui venaient chercher Pascal pour le conduire à l’échafaud.
[21] En Italie on expose les morts à visage découvert; ce n’est qu’au moment de descendre le cadavre en terre qu’on cloue le couvercle du cercueil.
Le ciel était magnifique, l’air limpide et transparent; Palerme se réveillait comme pour une fête: on avait donné congé aux colléges et aux séminaires, et la population tout entière semblait réunie dans la rue de Tolède, que le condamné devait parcourir dans toute sa longueur pour se rendre de l’église de Saint-François-de-Sales, où il avait passé la nuit, à la place de la Marine, où devait avoir lieu l’exécution. Les fenêtres des premiers étages étaient garnies de femmes que la curiosité avait tirées de leur lit à l’heure où ordinairement elles y sommeillaient encore; l’on voyait comme des ombres s’agiter dans leurs galeries grillées[22] les religieuses des différens couvens de Palerme et de ses environs, et sur les toits plats de la ville une dernière population aérienne ondoyait comme un champ de blé. A la porte de l’église, le condamné trouva la charrette conduite par des mules; elle était précédée par la confrérie des pénitens blancs, dont le premier portait la croix et les quatre derniers la bière, et suivie par le bourreau à cheval et tenant un drapeau rouge; derrière le bourreau, ses deux aides venaient à pied; puis enfin, derrière les aides, une autre confrérie de pénitens noirs fermait le cortége, qui s’avançait entre une double haie de miliciens et de soldats, tandis que sur les flancs, au milieu de la foule, couraient des hommes revêtus d’une longue robe grise, la tête couverte d’un capuchon troué aux yeux et à la bouche, tenant d’une main une clochette, de l’autre une escarcelle, et faisant la quête pour délivrer du purgatoire l’âme du criminel encore vivant. Le bruit, au reste, s’était répandu parmi toute cette foule que le condamné n’avait pas voulu se confesser; et cette réaction contre toutes les idées religieuses adoptées donnait plus de poids encore à ces rumeurs d’un pacte infernal conclu entre Bruno et l’ennemi du genre humain, qui s’étaient répandues dès le commencement de son entrée dans la carrière qu’il avait si promptement et si largement parcourue; un sentiment de terreur planait donc sur toute cette population curieuse, mais muette, et aucune vocifération, aucun cri, aucun murmure ne troublaient les chants de mort que faisaient entendre les pénitens blancs qui formaient la tête du cortége, et les pénitens noirs qui en étaient la queue: derrière ces derniers, et à mesure que le condamné s’avançait dans la rue de Tolède, les curieux se joignaient au cortége et l’accompagnaient vers la place de la marine: quant à Pascal, il était le seul qui parût parfaitement calme au milieu de cette population agitée, et il regardait la foule qui l’entourait, sans humilité comme sans ostentation, et en homme qui, connaissant les devoirs des individus envers la société, et les droits de la société contre les individus, ne se repent pas d’avoir oublié les uns, et ne se plaint pas qu’elle venge les autres.
Le cortége s’arrêta un instant à la place des Quatre-Cantons, qui forme le centre de la ville, car une telle foule s’était pressée des deux côtés de la rue de Cassero, qu’elle avait rompu la ligne de troupes, et que le milieu du chemin se trouvant encombré, les pénitens ne purent se faire jour. Pascal profita de ce moment de repos pour se lever debout dans sa charrette, et regarda autour de lui comme s’il cherchait quelqu’un à qui il eût un dernier ordre à donner, un dernier signe à faire; mais, après un long examen, n’apercevant pas celui qu’il cherchait, il retomba sur la botte de paille qui lui servait de siége, et sa figure prit une expression sombre qui alla croissant jusqu’au moment où le cortége arriva place de la Marine. Là, un nouvel encombrement avait lieu, qui nécessita une nouvelle halte. Pascal se leva une seconde fois, jeta d’abord un coup d’œil indifférent sur l’extrémité opposée de la place où était la potence, puis, parcourant tout le cercle immense de cette place, qui semblait pavée et bâtie de têtes, à l’exception de la terrasse du prince de Butera, qui était complètement déserte, il arrêta ses yeux sur un riche balcon tendu de damas à fleurs d’or et abrité par une tente de pourpre. Là, sur une espèce d’estrade, entourée des plus jolies femmes et des plus nobles seigneurs de Palerme, était la belle Gemma de Castelnuovo, qui, n’ayant pas voulu perdre une minute de l’agonie de son ennemi, avait fait dresser son trône en face de son échafaud. Le regard de Pascal Bruno et le sien se rencontrèrent, et leurs rayons se croisèrent comme deux éclairs de vengeance et de haine. Ils ne s’étaient point encore détachés l’un de l’autre, lorsqu’un cri étrange partit de la foule qui entourait la charrette: Pascal tressaillit, se retourna vivement vers le point d’où venait ce cri, et sa figure reprit aussitôt, non-seulement son ancienne expression de calme, mais encore une nouvelle apparence de joie. En ce moment le cortége fit un pas pour se remettre en route; mais d’une voix forte Bruno cria: Arrêtez.
Cette parole eut un effet magique: toute cette foule sembla clouée à l’instant même à la terre; toutes les têtes se retournèrent vers le condamné, et des milliers de regards ardens se fixèrent sur lui.
—Que veux-tu? répondit le bourreau.
—Me confesser, dit Pascal.
—Le prêtre n’est plus là, tu l’as renvoyé.
—Mon confesseur habituel est ce moine qui est ici à ma gauche dans la foule; je n’en ai pas voulu d’autre, mais je veux celui-là.
Le bourreau fit un geste d’impatience et de refus; mais à l’instant même le peuple, qui avait entendu la demande du condamné, cria: Le confesseur! le confesseur! Le bourreau fut obligé d’obéir; on s’écarta devant le moine: c’était un grand jeune homme, au teint brun, qui semblait maigri par les austérités du cloître: il s’avança vers la charrette et monta dedans. Au même instant, Bruno tomba à genoux. Ce fut un signal général: sur le pavé de la rue, aux balcons des fenêtres, sur le toit des maisons, tout le monde s’agenouilla; il n’y eut que le bourreau qui resta à cheval, et ses aides qui demeurèrent debout, comme si ces hommes maudits étaient exceptés de la rémission générale. En même temps, les pénitens se mirent à chanter les prières des agonisans pour couvrir de leurs voix le bruit de la confession.
—Je t’ai cherché longtemps, dit Bruno.
—Je t’attendais ici, répondit Ali.
—J’avais peur qu’ils ne tinssent pas la parole qu’ils m’avaient donnée.
—Ils l’ont tenue: je suis libre.
—Ecoute bien.
—J’écoute.
—Ici à ma droite...—Bruno se tourna de côté, car ses mains étant liées il ne pouvait indiquer autrement.—Sur ce balcon tendu d’étoffes d’or....
—Oui.
—Est une femme jeune, belle, ayant des fleurs dans les cheveux.
—Je la vois. Elle est à genoux et prie comme les autres.
—Cette femme, c’est la comtesse Gemma de Castelnuovo.
—Au bas de la fenêtre de laquelle je t’attendais lorsque tu fus blessé à l’épaule.
—Cette femme, c’est elle qui est cause de tous mes malheurs; c’est elle qui m’a fait commettre mon premier crime; c’est elle qui me conduit ici.
—Bien.
—Je ne mourrais pas tranquille si je croyais qu’elle dût me survivre heureuse et honorée, continua Bruno.
—Meurs tranquille, répondit l’enfant.
—Merci, Ali.
—Laisse-moi t’embrasser, père.
—Adieu.
—Adieu.
Le jeune moine embrassa le condamné, comme le prêtre a l’habitude de faire lorsqu’il donne l’absolution au coupable, puis il descendit de la charrette et se perdit dans la foule.
—Marchons, dit Bruno, et le cortége obéit de nouveau, comme si celui qui parlait avait le droit de commander.
Tout le monde se releva: Gemma se rassit, souriante. Le cortége continua sa marche vers l’échafaud.
Arrivé au pied de la potence, le bourreau descendit de cheval, monta sur l’échafaud, grimpa contre l’échelle, planta sur la poutre transversale[23] l’étendard couleur de sang, s’assura que la corde était bien attachée, et jeta son habit pour avoir plus de liberté dans les mouvemens. Aussitôt Pascal sauta en bas de la charrette, écarta d’un double mouvement d’épaules les valets qui voulaient l’aider, monta rapidement sur l’échafaud, et alla s’appuyer de lui-même à l’échelle, qu’il devait gravir à reculons. Au même moment, le pénitent qui portait la croix la planta en face de Pascal, de manière à ce qu’il pût la voir pendant toute son agonie. Les pénitens qui portaient la bière s’assirent dessus, et un cercle de troupes se forma tout autour de l’échafaud, ne laissant dans son centre que les deux confréries de pénitens, le bourreau, ses valets et le patient.
Pascal monta l’échelle sans souffrir qu’on le soutînt, avec autant de calme qu’il en avait montré jusque-là: et comme le qu’il jeta les yeux de ce côté avec un sourire. Au même moment, le bourreau lui passa la corde autour du cou, le prit par le milieu du corps et le jeta au bas de l’échelle. Aussitôt il glissa le long de la corde et se laissa peser de tout son poids sur les épaules du patient, tandis que les valets, s’accrochant à ses jambes, pesaient à la partie inférieure du corps; mais tout-à-coup la corde, qui n’était pas assez forte pour porter ce quadruple poids, se rompit, et tout ce groupe infâme, composé du bourreau, des valets et de la victime, roula sur l’échafaud. Cependant un homme se releva le premier: c’était Pascal Bruno, dont les mains s’étaient déliées pendant l’exécution, et qui se redressait au milieu du silence, ayant dans le côté droit de la poitrine le couteau que le bourreau venait d’y plonger de toute la longueur de sa lame.
—Misérable! dit le bandit s’adressant à l’exécuteur; misérable! tu n’es digne ni d’être bourreau ni d’être bandit; tu ne sais ni pendre ni assassiner!
A ces mots, il arracha le couteau du côté droit, le plongea dans le côté gauche et tomba mort.
Alors il y eut un grand cri et un grand tumulte dans cette foule: les uns se sauvèrent loin de la place, les autres se ruèrent sur l’échafaud. Le condamné fut emporté par les pénitens, et le bourreau mis en pièces par le peuple.
Le soir qui suivit cette exécution, le prince de Carini dîna chez l’archevêque de Montreal, pendant que Gemma, qui ne pouvait être reçue dans la sainte société du prélat, restait à la villa Carini. La soirée était magnifique comme l’avait été la matinée. De l’une des fenêtres de la chambre tendue en satin bleu, dans laquelle nous avons ouvert la première scène de notre histoire, on distinguait parfaitement Alicudi, et derrière elle, comme une vapeur flottante sur la mer, les îles de Filicudi et de Salina. De l’autre croisée on dominait le parc, tout planté d’orangers, de grenadiers et de pins; on distinguait à droite, depuis sa base jusqu’à son sommet, le mont Pellegrino, et la vue pouvait s’étendre a gauche jusqu’à Montreal. C’est à cette fenêtre que resta longtemps la belle comtesse Gemma de Castelnuovo, les yeux fixés sur l’ancienne résidence des rois normands, et cherchant à reconnaître dans chaque voiture qu’elle voyait descendre vers Palerme l’équipage du vice-roi. Mais enfin la nuit s’était répandue plus épaisse, et les objets éloignés s’étant effacés peu à peu, elle rentra dans la chambre, sonna sa camérière, et, fatiguée qu’elle était des émotions de la journée, elle se mit au lit, puis elle fit fermer les fenêtres qui donnaient sur les îles, de peur que la brise de la mer ne l’atteignît pendant son sommeil, et ordonna de laisser entrebâillée celle qui s’ouvrait sur le parc, et par laquelle pénétrait dans sa chambre un air tout chargé du parfum des jasmins et des orangers.
Quant au prince, ce ne fut que bien tard qu’il put se dérober à la vigilance gracieuse de son hôte; et onze heures sonnaient à la cathédrale bâtie par Guillaume-le-Bon, lorsque la voiture du vice-roi l’emporta au galop de ses quatre meilleurs chevaux. Une demi-heure lui suffit pour arriver à Palerme, et en cinq minutes il franchit l’espace qui s’étend entre la ville et la villa. Il demanda à la camérière où était Gemma, et celle-ci lui répondit que la comtesse, s’étant trouvée fatiguée, s’était couchée vers les dix heures.
Le prince monta vivement à la chambre de sa maîtresse et voulut ouvrir la porte d’entrée, mais elle était fermée en dedans: alors il alla à la porte dérobée, qui donnait de l’autre côté du lit, dans l’alcôve de Gemma, ouvrit doucement cette porte, afin de ne pas réveiller la charmante dormeuse, et s’arrêta un instant pour la regarder dans ce désordre du sommeil, si doux et si gracieux à voir. Une lampe d’albâtre, suspendue au plafond par trois cordons de perles, éclairait seule l’appartement, et sa lueur était ménagée de manière à ne pas blesser les yeux pendant le sommeil. Le prince se pencha donc sur le lit pour mieux voir. Gemma était couchée la poitrine presque entière hors de la couverture, et autour de son cou était roulé le boa qui, par sa couleur foncée, contrastait admirablement avec la blancheur de sa peau. Le prince regarda un instant cette ravissante statue, mais bientôt son immobilité l’étonna: il se pencha davantage, et vit que le visage était d’une pâleur étrange; il approcha son oreille et n’entendit aucune respiration; il saisit la main et la sentit froide; alors il passa son bras sous ce corps bien-aimé pour le rapprocher de lui et le réchauffer contre sa poitrine, mais aussitôt il le laissa retomber en poussant un cri de terreur affreux: la tête de Gemma venait de se détacher de ses épaules et de rouler sur le parquet.
Le lendemain on retrouva au bas de la fenêtre le yatagan d’Ali.
[22] A Palerme, les religieuses, qui ne peuvent pas se mêler aux fêtes mondaines, y prennent part cependant par la vue. Tout couvent un peu riche possède en location un étage donnant ordinairement sur la rue de Tolède: c’est de ces fenêtres grillées, où elles se rendent par des routes souterraines qui ont quelquefois un quart de lieue de longueur, et qui communiquent du couvent à la maison louée, que les saintes recluses regardent les fêtes sacrées et profanes.
[23] La potence italienne offre avec la nôtre une différence notable: la nôtre a la forme d’une F; l’autre, celle d’un H dont on aurait haussé la traverse jusqu’au bout des deux portans.
FIN.
TABLE.
| PAULINE | 1 |
| MURAT | 159 |
| PASCAL BRUNO | 211 |
Imprimerie Lange Lévy et Comp., 16, rue du Croissant.
Note de Transcription
Ce livre a été publié en 1848. Vous pouvez constater que l'orthographe française a évolué.
1. Mots qui se terminent en ent ou ant : Ils perdent le t au pluriel:
un événement ==> des événemens un enfant ==> des enfans un habitant ==> des habitans un instant ==> des instans un moment ==> des momens etc.
2. Accents différents:
forme moderne ==> forme ancienne complètement ==> complétement
Ponctuation a été maintenue sauf si évidente erreurs d’impression se produisent.
Une couverture a été créée pour ce livre électronique et est placée dans le domaine public.
[Fin de Pauline et Pascal Bruno par Alexandre Dumas]