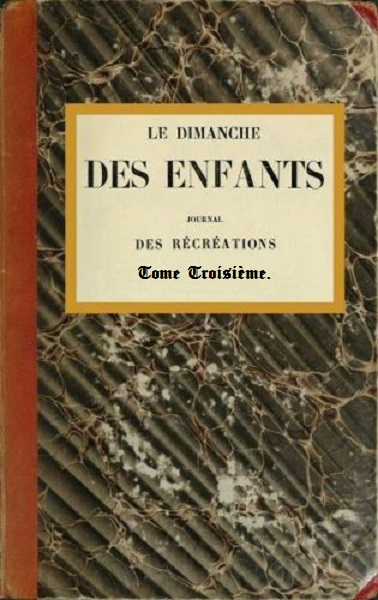
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This ebook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the ebook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the ebook. If either of these conditions applies, please contact a FP administrator before proceeding.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: Le Dimanche des Enfants, tome 3
Date of first publication: 1840
Author: Various
Date first posted: Apr. 29, 2018
Date last updated: Jan. 17, 2019
Faded Page eBook #20180447
This ebook was produced by: Marcia Brooks, Cindy Beyer & the online Distributed Proofreaders Canada team at http://www.pgdpcanada.net
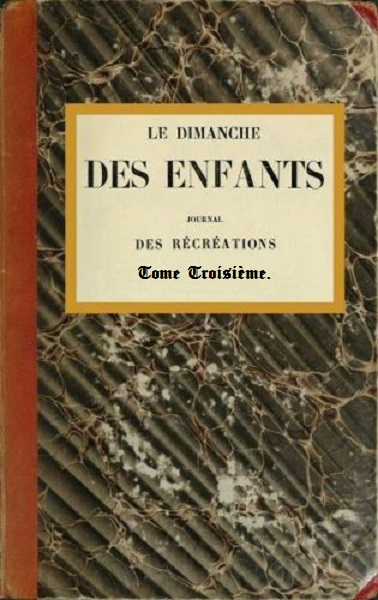
LE DIMANCHE
DES ENFANTS
Imprimerie de Ducessois, 55, quai des Grands-Augustins.
(Près le Pont-Neuf.)
LE DIMANCHE
DES ENFANTS
JOURNAL
DES RÉCRÉATIONS
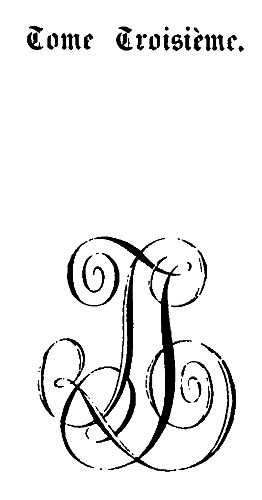
PARIS
LOUIS JANET, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE SAINT-JACQUES, 59,
AU FOND DE LA COUR.
TABLE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME

| Pages | |||
| Marie. | 1 | Dubreil de Marzan. | |
| L’Ange gardien. | 14 | Edouard Vaneeckout. | |
| Les boas de Timor. | 16 | Miss Lucy Saunders. | |
| Henriette d’Angleterre. | 21 | Mme Eugénie Foa. | |
| Trois fois, trois frères rois. | 32 | Edouard Patry. | |
| Le Génie et la fourmilière. | 36 | Mme Fanny Richomme. | |
| Tomy. | 41 | Etienne Enault. | |
| Découverte et missions du Paraguay. | 58 | Mme de Sainte-Marguerite. | |
| Moïse, ou l’enfant sauvé dese aux. | 71 | Symphor Vaudoré. | |
| L’Avent. | 73 | Mme de Sainte-Marguerite. | |
| Au coin d’une borne. | 75 | Gustave des Essards. | |
| Le gagne-petit. | 82 | J. N. Bouilly. | |
| Le bon roi Réné. | 93 | Alphonse Fourtier. | |
| Les orphelins. | 99 | De Joannès. | |
| Noël. | 100 | Symphor Vaudoré. | |
| Christophe Colomb. | 105 | Mlle Léonide de Mirbel. | |
| Versailles. | 130 | M. P. H***. | |
| Les dangers de l’ignorance. | 137 | Théodore Barrière. | |
| Une nuit d’hiver. | 145 | Gustave des Essards. | |
| Juliette. | 151 | Mme Fanny Denoix. | |
| Le petit roi de Rome. | 154 | Léon Guérin. | |
| La pêche des perles. | 174 | Anonyme. | |
| Le Carême. | 177 | Symphor Vaudoré. | |
| Mongolfier, ou les aérostats. | 179 | M. H. D***. | |
| La jeune Espagnole. | 184 | Léon Guérin. | |
| La tourterelle et le lézard. | 195 | Mlle Élise Moreau. | |
| Le lac de Grand-Lieu. | 198 | Gustave des Essards. | |
| Une nuit près du pôle boréal. | 202 | M. H. D***. | |
| L’Orphelin. | 207 | Charles Collet. | |
FIN DE LA TABLE.
LISTE
DES VIGNETTES DE CE VOLUME.
DESSINS DE M. LOUIS LASSALLE.

| Pages | ||
| 1. | L’Ange gardien. | 14 |
| 2. | Henriette d’Angleterre. | 21 |
| 3. | Tomy. | 41 |
| 4. | Découverte et missions du Paraguay. | 58 |
| 5. | Au coin d’une borne. | 75 |
| 6. | Le gagne-petit. | 82 |
| 7. | Christophe Colomb. | 105 |
| 8. | Les dangers de l’ignorance. | 137 |
| 9. | Une nuit d’hiver. | 145 |
| 10. | Le petit roi de Rome. | 154 |
| 11. | Schœnbrun en 1830. | 172 |
| 12. | La jeune Espagnole. | 184 |
| 13. | Une nuit près du pôle boréal. | 202 |

LE
DIMANCHE DES ENFANTS
JOURNAL DES RÉCRÉATIONS


Rien de plus doux, de plus poétique, de plus délicieusement naïf, que la vie humble et cachée de la vierge Marie dans son pèlerinage sur la terre. C’est une histoire qui intéresse tous les siècles, tous les âges, et qui convient à toutes les positions de la vie. Patronne des vierges et des mères, de l’innocence et du repentir, des rois sur le trône et des martyrs sur l’échafaud; modèle de ce qui est grand et de ce qui est doux, elle fut couronnée deux fois: ici-bas, de sept douleurs, en sa qualité de mère des hommes; là-haut, de douze étoiles, en sa qualité de mère de Dieu et de reine des anges. Celui qui connaît le fils, peut-il ignorer la mère? Celui qui goûta le fruit ne doit-il pas aimer la fleur, et le miracle de la femme restée vierge n’est-il pas digne de l’homme resté Dieu? Ce poëme, que le ciel et la terre chantent depuis dix-huit siècles, renferme les plus tendres mystères de vertu, de compatissance et d’humilité. Il s’adresse au vieillard qui a porté sa croix, comme à l’enfant venu sur la terre pour la prendre; telle est cette merveilleuse création, qu’à toutes les époques, à toutes les heures orageuses de l’existence, il nous suffit de regarder dans notre cœur pour voir rayonner sur nous la figure de Marie, comme une seconde et maternelle providence. Avec les traits de la vie de la Vierge, consignés dans l’Évangile ou recueillis par la tradition, on composerait des volumes aussi attachants pour l’enfant qui apprend à parler que pour l’homme qui apprend à penser; et je ne sais ce qu’on pourrait dire à celui qui serait insensible au spectacle de cette glorieuse et douloureuse maternité, qui commence dans une étable et qui finit au pied de la croix.
On se figure aisément que l’inaltérable union des deux chastes époux issus de David fut pour eux une source de jouissance, de paix et de bénédiction. Joseph et Marie, dans leur maison de Nazareth, partageaient les journées entre le travail, qui annonce l’expiation, et la prière, qui annonce l’espérance. Le fils de David, le pasteur, se levait tous les matins avant le soleil, et pauvre lui-même, il s’en allait bâtir pour les pauvres de la vallée les cabanes de térébinthe et de bois d’olivier. Modeste charpentier, il façonnait tour à tour des toits rustiques pour l’indigent, des joujoux pour l’enfance, des barques pour le pêcheur, des charrues pour l’homme des champs. Il ne rougissait pas d’employer des mains royales à ces simples ouvrages qui allaient bientôt occuper une main divine. Marie, toute resplendissante de sa parure inviolable, voilée sous sa pauvreté, comme Dieu le fut sous notre chair, tissait elle-même des nattes de roseaux et des habits de lin, lavait les tuniques de Joseph, pétrissait les gâteaux de farine, et, le soir, descendait, comme les filles des patriarches, à la fontaine où elle puisait l’eau vive. Au coucher du soleil, quand le dernier chant de l’oiseau annonçait le lever de la première étoile, elle servait, sur une table d’ébène, les pains d’orge ou de doura, les laitages, les légumes secs, les figues savoureuses, que le couple évangélique partageait quelquefois avec des anges, déguisés sous l’habit de voyageurs. Car la mère ne devait-elle pas être en quelque façon le modèle du fils? et cette fille de roi descendue du trône de David dans les humbles occupations d’un ménage obscur, n’était-elle pas digne du fils de Dieu tombé du ciel dans une étable? L’odeur de cette maison bénie montait jusqu’aux cieux, et les charmait, et le plus beau des serviteurs du Très-Haut, Gabriel, se trouve heureux de quitter la face du Seigneur pour venir contempler cette créature incomparable, et la saluer le premier de son royal titre: mère de Dieu.
L’Évangile fait mention de trois voyages où la figure de la Vierge apparaît avec une auréole particulière de poésie et de sérénité. Du premier voyage où elle mérita d’être appelée bienheureuse et bénie entre toutes les femmes, il nous est resté le cantique du dimanche: Magnificat. Du second voyage, il nous est resté quelque chose de plus étonnant: l’événement qui a changé le monde en nous donnant le Christ, et le cantique des anges, qui rappelle éternellement les gloires de Dieu et la délivrance des hommes. Les livres saints se contentent de mentionner le troisième voyage de la Vierge entrepris pour dérober Jésus-Christ aux persécutions d’Hérode, et fuir, comme Jacob, vers la terre d’Égypte. Mais la tradition a mêlé à ce souvenir un épisode bien connu de nos pères, et à peu près oublié de nos jours, qui répand un intérêt tout dramatique sur l’excursion de la sainte famille.
Ce pèlerinage lointain offrait une longue suite de dangers et de fatigues. Ce n’étaient de toutes parts que collines escarpées, sentiers caillouteux, terrains de grès et de tuf, où filtrait à peine une maigre verdure, et d’où s’élevaient tristement quelques nopals épineux. Il fallait suivre le lit pierreux des torrents, s’enfoncer dans des routes perdues, et se détourner du chemin pour rencontrer un caroubier qui prêtât un peu d’ombrage au céleste enfant qui ne devait pas mourir seulement de lassitude et de chaleur. Or la Vierge Marie ne possédait ni serviteurs ni suivantes, ni chameaux ni tentes, ni tapis pour traverser les océans de sables brûlants. Une feuille de sycomore ou de figuier suffira pour défendre du soleil celui qu’une pauvre étable a défendu contre les bises piquantes de l’hiver, et le Verbe fait chair doit se trouver heureux de partager la goutte de rosée qu’il créa pour la fleur et le rayon de miel oublié dans les fentes de la roche pour la colombe du désert.
Les chacals, les serpents, les reptiles hideux étaient un grand sujet d’effroi pour les timides voyageurs; cependant ils redoutaient plus encore les hommes et avec raison. Jésus devait payer par ses souffrances tout le bien qu’il venait nous faire. Le bienfaiteur est souvent victime du bienfait. Tout César a son Brutus, toute mère son Benjamin. Jésus nous apportait sa vie, que pouvions-nous lui rendre que la mort? Depuis la prédiction de Siméon au temple, cette pensée pénétrait l’âme de la Vierge, comme un glaive mystérieux et tranchant: son martyre avait commencé le même jour que sa maternité. Partie de l’étable de Béthléem, où pouvait-elle se rendre sinon au Calvaire?
Sortis de Galilée suivant les ordres de l’ange, les pèlerins avaient déjà passé sans accident les environs de Jérusalem: ils avaient trompé les regards, les espions, évité tous les dangers qui les menaçaient du côté d’Hérode. Échappée à tant d’inquiétudes, la sainte famille commençait à respirer un peu, car les riches et verdoyantes plaines de la Syrie allaient bientôt s’ouvrir devant elle. Encore une journée de marche, et ils pourront voyager en sécurité avec l’espérance d’Israël. Mais ce jour était le plus pénible et le plus alarmant pour eux. On sait, par les relations des voyageurs, et de M. de Lamartine notamment, dont les descriptions sont presque toujours des tableaux d’après nature, que la plupart des plaines de Galilée et de Judée sont défendues par des gorges profondes, espèces de défilés fuyant entre deux montagnes hérissées d’énormes mamelons de terre et de granit, qu’on prendrait pour des villes crénelées, avec leurs murailles, leurs bastions et leurs tours. Il est facile de reconnaître une intention providentielle dans ces fortifications de la nature, que Dieu avait ainsi placées autour de son peuple comme une ceinture protectrice destinée à le défendre des invasions des païens et de l’idolâtrie. Depuis la conquête romaine, ces solitudes étaient peuplées de voleurs et de bandes indépendantes qui tombaient du haut de ces collines comme des pirates ou des oiseaux de proie sur les riches pays d’alentour, les tribus voyageuses, les corps d’armée isolés, et faisaient une sorte de guerre de partisans à la manière actuelle des Kabyles et des guérillas espagnols. Ils avaient pris racine dans ces montagnes, car la police de Rome était trop éloignée pour protéger le voyageur contre le brigandage armé du désert. Plusieurs fois on avait essayé, mais en vain, de détruire ces nids de vautours. L’avarice du juif avait triomphé des vainqueurs du monde, et pas une caravane ne passait en ces lieux sans payer tribut à la barbarie.
Un jour donc séparait la sainte famille des plaines tant désirées qui lui promettaient enfin de la fraîcheur, de la verdure, et plus d’ennemis. Mais il fallait auparavant traverser un horrible et profond ravin où le voyageur était comme étouffé par des remparts de rochers s’étayant les uns sur les autres jusqu’à une hauteur prodigieuse, et laissant voir, de distance en distance, de larges bouches de cavernes qui s’ouvraient et menaçaient comme des gueules de monstres. Des fleurs rouges, imitant le corail, croissaient dans les fentes de ces roches gris-cendre, et les faisaient ressembler, sous les ondulations de la lumière, à d’énormes cadavres marquetés de sang. Joseph nourricier de Jésus, comme l’autre Joseph avait été nourricier d’Israël, ne possédait aucun moyen de défense; seulement, il emportait dans une ceinture de cuir quelques restes précieux de la visite des Mages; et c’était à la fois pour lui, dans ce désert, un sujet d’inquiétude et d’espérance. Mais l’objet de ses plus tendres alarmes, c’était le trésor vivant dont il répondait au ciel et au genre humain. Chaque regard qu’il jetait sur sa chère Marie, si jeune, si délicate, si belle, sur l’enfant Jésus dont le sourire rose était déjà mêlé d’un nuage de tristesse douce, revenait sur lui comme un trait perçant, et le dévorait d’une angoisse sourde et poignante. Parfois il considérait sa faiblesse, et il lui semblait que toute cette gorge de grès et d’âpres pics s’ébranlait, vivait, marchait à lui. Dans l’horreur ténébreuse qui l’environnait, il s’imaginait que ces trous étaient les yeux de l’enfer qui le regardait, de l’enfer, qui allait déclarer la guerre au Messie; il croyait en voir sortir des tigres prêts à déchirer les membres si gracieux du Sauveur, qui étaient destinés aux verges des hommes et aux caresses des bourreaux. Et il frissonnait. «Seigneur, disait-il, se peut-il que vous m’ayez donné votre fils à garder, moi qui ne suis qu’un pauvre faible vieillard sans armes; vous qui êtes si grand, moi qui suis si petit; lui qui est si précieux pour Israël, que tous vos anges suffiraient à peine à lui faire une garde digne de sa grandeur! Donnez-moi la force de David devant le géant, de Samson devant le Philistin; protégez le fils et la mère, comme Daniel dans la fosse aux lions; prenez tout mon sang, toute ma vie, plutôt qu’un cheveu de sa tête, et défendez vous-même votre chaste épouse et le salut des hommes!» Après avoir fait le sacrifice de lui-même, son cœur devint moins lourd, et il lui sembla qu’il respirait.
C’était le soir: les mates blancheurs de la lune donnaient aux roches du ravin des airs de spectres et d’ossements: les végétations fauves de la vallée projetaient des ombres pâles qui retombaient à larges pans sur la modeste caravane, et se promenaient sur les hauteurs comme de silencieux ennemis; le vent des nuits tirait, des fissures de la pierre, des murmures confus et sinistres qui enveloppaient la sainte tribu d’un nuage de terreur; les ténèbres s’épaississaient, des formes étrangement livides se balançaient dans les détours du vallon, et les oiseaux funèbres, cherchant leur proie dans la nuit, rasaient la tête du Sauveur, et semblaient lui porter un défi de la part des enfers. La pauvre mère, en proie à des accès de frayeur inexprimable, noyait toutes ses pensées de trouble dans une larme de Jésus; elle ne voyait que les lèvres rosées de son Emmanuel, que ses petits bras entrelacés en croix. Le souffle du divin enfant était la seule harmonie qu’elle pût entendre; car c’était le seul bien que connût son cœur, le lien unique qui l’attachât à la terre, la seule partie d’elle-même où il y eût encore des palpitations et de la vie. Elle adorait silencieusement le Verbe-Dieu, qui était sa gloire; elle baisait, pressait, étreignait le Verbe fait homme qui était sa souffrance. Sa force, sa beauté, sa tendresse, son âme, c’était lui. Spectres, visions, images funèbres, tout cela passait à ses yeux comme les ombres de l’ombre. Elle était vierge, et elle était épouse du Saint-Esprit. Mère d’un homme, elle défierait un tigre; mère de Dieu, craindrait-elle l’armée des hommes ou des démons? D’ailleurs, elle devait croire aux miracles, cette femme qui en était un.
Les trois voyageurs firent encore quelques pas sous les silencieux rayons de la lune. Mais voilà que la paisible monture du Messie dresse ses crins à l’aspect d’une forme étrange qui s’agite à quelque distance: Joseph fait halte devant la vision. Les objets qui flottaient, indéterminés et douteux au premier abord, se rapprochent et grandissent; les ombres se changent en véritables hommes, les pointes en poignards, les craintes en réalité; il n’est plus possible de méconnaître une troupe de brigands armés qui marchent vers le groupe innocent et lui barrent le passage. Joseph se dispose déjà à dénouer sa ceinture pour acheter le passage du ravin; mais le chef des brigands, sans faire attention à lui, court droit à Marie, qui sent son cœur se resserrer en elle, et est traversée d’une de ces étreintes indicibles dont les mères seules peuvent rendre compte. Mais, comme si elle obéissait à une impulsion divine, voilà qu’elle prend son fils qui dort, le place sur son cœur comme un bouclier, écarte son voile, et regarde sans pâlir le brigand qui est devant elle. En ce moment, il se passe quelque chose d’inouï dans ces trois âmes, dont l’une était le salut, l’autre la beauté, l’autre la souillure du monde. Un éclair formé d’un triple rayon de divinité, de maternité et de miséricorde, frappe soudain l’homme du crime comme une éblouissante apparition. Sans savoir ce qu’il fait, voici qu’il tombe à genoux devant cette faiblesse que des rois ont adorée, et son cœur, transformé dans un instant comme celui d’Alexandre quand il aperçut le grand prêtre des Hébreux, tressaille d’un sentiment céleste. Revenu de cet éblouissement, il étend la main vers l’ânesse de la Vierge, et, par un sentier connu de lui seul et des chamois, il conduit les saints personnages dans sa forteresse, bâtie comme un nid de vautour, au sommet d’un roc escarpé. Là, mille soins tendres sont prodigués à cette enfance, à cette virginité, à cette vieillesse qui l’ont charmé. Il offre tour à tour au voyageur et à sa belle compagne de l’eau tiède pour laver leurs pieds meurtris, et de l’eau fraîche pour essuyer la poussière de leurs fronts. Le Christ est couché dans un berceau de jonc; des peaux de tigre et d’ours sont étendues pour reposer les pèlerins, et l’ânesse elle-même est soignée comme un hôte respectable. La sainte famille trouve un repas composé, comme ceux des patriarches, d’agneau, de gibier sauvage, de fruits secs et de pains cuits sous la cendre. La lune de juin rayonnait sur cette scène de douceur et d’hospitalité; ses mélancoliques rayons, mêlés à la joie des saints convives et du maître hospitalier, s’étonnaient d’éclairer pour la première fois le Créateur devenu petit, et l’homme devenu grand; l’innocence et la beauté servies par le pécheur, et le roi de toute justice ne trouvant d’asile ici-bas que dans celui des animaux et dans la demeure des criminels. Qui aurait contemplé cette miraculeuse réunion d’un saint vieillard, d’une Vierge mère, d’un Dieu enfant et d’un voleur assis à la même table, buvant dans la même coupe du vin qui peut-être avait coûté des larmes, eût été ravi comme poëte, comme peintre, comme croyant, et n’aurait jamais oublié le spectacle de cette compagnie dont chaque personnage était un prodige. Si cette tradition semblait invraisemblable à quelqu’un, nous demanderions ce que Dieu venait faire dans le monde? Il ne venait pas racheter les anges, mais les hommes; il avait pris un corps et une mère pour cela. Celui qui n’eut pas honte de paraître semblable à nous, avait-il à rougir de nos misères? Médecin, il devait commencer par le malade; prêtre, par le pécheur. Je ne vois pas au reste ce qu’il y a de plus incroyable d’un Dieu qui naît homme et pauvre sous une masure, ou d’un Dieu enfant qui reçoit l’hospitalité d’un misérable criminel à qui il apporte l’espérance.
Cependant, le bandit se tenait en présence de ses convives, dans l’attitude du respect, et s’occupait à les servir, lorsque tout à coup des éclats de trompettes, des voix d’hommes et des pas d’archers, troublent le silence de la nuit et la joie de cette scène qui commençait à essuyer tous ces fronts: à ceux-là la sueur, à celui-ci le vice. Une anxiété nouvelle serre aux entrailles Joseph et Marie. Le dépôt qu’ils possédaient, c’était le salut d’Israël et du genre humain. Or, cet Enfant-Dieu, si calme et si doux, avait lui-même besoin d’un sauveur, et ce sauveur était une mère sans autre défense que sa virginité; son gardien était un vieillard sans autre force que ses cheveux blancs, et tout cela reposait sous le toit et sous la bonne foi d’un brigand inconnu. Cette idée traversait, comme un frisson, les veines de Marie; mais Jésus, réveillé par le bruit des trompettes, jeta sur sa mère un de ces sourires plus pénétrants que le rayon de soleil qui relève la fleur, et il y eut alors sur ces deux figures un rayonnement que nul pinceau ne pourrait rendre.
Le bandit, monté sur un escarpement de roches, pour reconnaître d’où venait le mouvement, avait distingué un détachement des milices d’Hérode, qui, depuis quelque temps, rôdaient dans ces déserts pour en surveiller les maîtres. Il vient avertir ses hôtes, qu’il s’efforce de rassurer, puis remonte au sommet de la tour pour observer la marche du corps d’armée et disposer toutes choses en cas d’attaque. Cet incident répandit une double émotion dans l’âme des saints personnages. D’une part, ils admiraient la Providence, qui les avait si visiblement préservés; car, s’ils n’avaient rencontré le brigand, ils tombaient entre les mains d’Hérode, et le Messie eût été traité comme les autres innocents. De l’autre, ils se virent menacés de nouveaux dangers, s’ils étaient exposés aux horreurs d’un siége nocturne. Joseph tombe à genoux devant le Rédempteur, et lève les bras au ciel, comme autrefois Moïse durant le combat qui se livra dans le désert. Marie découvre son sein à l’enfant de Dieu, qui seul était digne de le voir et d’y appliquer ses lèvres; et l’abeille divine, aspirant le miel de la rose mystique, offrit un spectacle qui dut faire tressaillir les anges.
Pendant que cette scène de pureté et de tendresse bénie se passait au dedans, l’ange exterminateur armait au dehors le bras du terrible brigand. Il prenait ses mesures pour une vigoureuse résistance. Aidé de quelques-uns des siens, il accumulait les pierres, les graviers, tendait les arcs, aiguisait les piques, armait les frondes de cailloux perçants; il plaçait ses postes, fortifiait les points faibles, tandis que là-bas, tout au fond, la multitude remuait, grossissait, bourdonnait comme les vagues d’un fleuve. Déjà même, il distinguait confusément des bruits sourds et caverneux, comme les coups du bélier contre une muraille, et pressentait bien qu’il touchait à quelque situation violente. Mais la crainte n’entra pas un instant dans son esprit: je ne sais quelle force surnaturelle développait en son âme une énergie inconnue; il sentait que, pour la première fois, il allait servir une cause juste.
Les soldats du roi des Juifs, qui avaient rempli de deuil toutes les maisons d’Israël où se trouvaient des nouveau-nés, fouillaient maintenant ces cavernes pour y trouver de l’or et des fugitifs. D’ailleurs, ces montagnes leur étaient signalées comme un repaire de voleurs et d’ennemis de l’État, qui étaient parvenus, à l’aide de ces retranchements naturels, à se soustraire à la domination des Romains. Donc, ils se décidèrent à emporter d’assaut la forteresse du bandit, qui cette nuit se trouvait presque seul, avec deux ou trois des siens, ses gens étant occupés à une expédition dont les Galiléens avaient eu connaissance. L’entreprise était audacieuse. Peut-être la place sera-t-elle défendue sérieusement; et puis que fera le bélier contre des remparts que Dieu lui-même a construits? Cependant deux brigades, munies de leviers, de piques, de pioches, de javelots et de balistes, s’engagèrent dans le défilé, et montaient en silence par un sentier de la colline, ombragé de palmiers, lorsqu’un fracas effroyable interrompit leur marche. Une douzaine des leurs, emportés par un quartier de rocher, roulaient pêle-mêle à une profondeur énorme, et se tordaient dans le gouffre avec le pavé qui rebondissait et mugissait comme un tonnerre souterrain. Étourdis de ce brusque avertissement, les assiégeants n’eurent pas le temps de se reconnaître, qu’ils virent une nouvelle foule de mourants et de blessés tournoyer au-dessous d’eux, sans qu’ils devinassent à quels ennemis ils avaient affaire. Ils décochaient en vain des flèches et des traits qui allaient blesser au hasard quelques troncs d’olivier ou s’accrocher aux herbes, et le plus souvent retombaient émoussés sur leurs têtes. Mais les chefs, parmi lesquels se trouvaient des officiers romains, n’étaient pas habitués à reculer: ils se forment en carrés, se serrent, s’abritent sous les voûtes de granit, et marchent en bon ordre vers la terrible muraille. A ce nouveau plan d’attaque on oppose un plan de défense habile; les gros blocs cessent de rouler, mais les pierres se mettent à tomber une à une sur les soldats, et éclaircissent leurs rangs. Ceux-ci n’avançaient pas moins, malgré les cailloux qui pleuvaient, malgré l’abîme qui mugissait; déjà même, ils découvraient la forteresse du bandit. La grêle de gravois, de moellons, de sables, de projectiles, n’était plus aussi épaisse; la défense se ralentissait évidemment, l’arsenal du brigand semblait épuisé, et l’horrible clameur des soldats arrivait jusqu’à l’intérieur de la citadelle où la pauvre Marie, en prières, palpitait entre la vie et la mort. Une charge encore, et ils sont maîtres du dernier mamelon. C’est là que le montagnard les attendait. Ils venaient de laisser derrière eux un effroyable escalier de roches pointues, hérissées de dents comme une mâchoire de requin. Alors le bandit juge qu’ils sont assez prêts et le ravin assez profond. A l’instant où ils crient victoire, voilà qu’une affreuse masse de granit vert s’ébranle, se détache d’elle-même, et entraîne les deux bataillons à deux cents pieds dans le précipice. Soldats, officiers, bras mutilés, têtes sanglantes, débris minéraux et débris humains ruissellent et s’éparpillent sur les flancs déchirés de la montagne. L’énorme bloc, brisé par la rapidité de la chute, se divise en serpents de pierre qui vont chercher les hommes comme des machines intelligentes; ils écorchent les saillies du vallon, mordent, balaient, broient tous les obstacles, que ce soient des troncs d’arbres ou des troncs d’hommes, des créneaux ou des têtes, des os de morts ou des os de vivants. Tout cela tourne, poudroie, saigne, se déchire, se mêle, et les morceaux de pierres et les morceaux de cadavres arrivent à grand bruit dans le gouffre, qui ressemble à une horrible mer de métal bouillant, à un enfer d’où il ne sort plus qu’une plainte étouffée et sinistre comme la mort. Quelques hommes échappés par miracle à cette éruption volcanique, s’imaginent que le mont lui-même s’est rué sur eux, et va les engloutir. Ils se hâtent de fuir dans les ténèbres, et croient entendre le génie de la montagne chanter derrière eux des airs de triomphe.
Et le calme se fit. La lune s’épanouissait dans le ciel comme pour sourire à la victoire de Dieu; les tièdes brises des nuits d’Orient, parfumées aux orangers de la plaine, glissaient dans les fissures de la montagne, et répandaient dans l’air je ne sais quelle odeur d’intarissable vie; le dôme à demi voilé des cieux laissait tomber de pittoresques rayonnements sur les cimes échancrées des collines, où pyramidaient des têtes de sapins aux formes coniques. Toutes les structures bizarrement dentelées du ravin se diamantaient sous une pluie ondulante de lumière, et les étoiles, flottant dans leur lit d’azur, semblaient autant de berceaux suspendus sur le Christ enfant.
Le bandit, en retournant à ses hôtes, trouva sa maison remplie d’une lueur mystérieuse et douce. Il prit ce vieillard, cette femme et cet enfant pour une famille des anciens jours qui allait ramener sur la terre la vie patriarcale. A l’aspect du montagnard victorieux, la tête de la Vierge se pencha comme une fleur pleine de rosée; ses lèvres, qui n’avaient jamais reçu le baiser d’aucun homme, se posèrent sur celles de l’enfant-Dieu, et le chef-d’œuvre de la beauté embrassa le prodige de la miséricorde. Cette figure de femme, qui devait être un jour le refuge du pécheur, attachait particulièrement les regards de l’inconnu; car un double mystère frappait quiconque approchait de Marie; c’était un caractère de grandeur qui, plus tard, en a fait la reine des anges, allié à ce rayonnement d’une miséricordieuse tendresse qui déjà trahissait la mère des hommes.
Jusqu’alors, le brigand n’avait vécu que de pillages, de victimes, de malédictions et d’horreurs; il ne connaissait d’autres harmonies, d’autres fêtes, d’autre fièvre, que les larmes du voyageur et les ricanements de l’enfer. Et voilà qu’il logeait chez lui la paix, les bénédictions, l’idéal le plus pur de la grâce, de la charité, de la douceur, qui jamais soit apparu sur la terre. Il prit l’enfant avec une sorte de saisissement délicieux: en présence de ce mystère que Jacob avait désiré, il tressaillit sans savoir pourquoi, comme l’aveugle devant la lumière, et il sentit bien qu’en égorgeant les voyageurs et qu’en saisissant ses proies, jamais son cœur n’avait battu comme cela. Tel autrefois Balaam, appelé pour maudire le peuple de Dieu, reçut une impulsion mystérieuse qui le força de se répandre en bénédiction et de chanter les louanges du Seigneur. La nature elle-même semblait changée et conquise par la vertu du Très-Haut. Il y avait quelque chose d’imposant et d’auguste dans le calme solennel qui avait remplacé le bruit des armes; on eût dit que l’armée de Pharaon qui poursuivait Israël venait d’être engloutie sous les flots de la mer Rouge, et que Moïse entonnait, dans le lointain des cieux, le cantique d’actions de grâces que les fils de Jacob chantaient depuis dix siècles.
Après cette nuit de joie et d’inquiétudes, de terreurs et d’espérances, de perplexités et de triomphe, les pèlerins reprirent en paix la route de l’exil. L’hôte protecteur voulut les accompagner jusqu’au sortir de ces défilés affreux, et les guider lui-même par des chemins sûrs, inconnus des autres montagnards. Les couleurs chaudes et veloutées du ciel d’Orient répandaient sur leurs pas des rayons étincelants comme des diamants mobiles qui enveloppaient les saints voyageurs de faisceaux lumineux; les cimes des montagnes argentées comme des cônes de neige, fuyaient et se perdaient dans les profondeurs de l’horizon; le chant des oiseaux sous les arbres, le bourdonnement des insectes dans les herbes, la voix des torrents sous les roches, formaient une harmonie vaste et grandiose qui se mêlait aux magnifiques horreurs de cette nature sauvage. Joseph et Marie éprouvaient une étrange émotion en quittant ces déserts où ils avaient été maudits par les hommes, protégés et bénis par un brigand. Celui-ci voulut leur servir de guide jusqu’à l’entrée des plaines de Syrie, où ils trouvèrent une caravane qui faisait route pour l’Égypte; de plus, il chargea les voyageurs de ce qui pourrait leur être agréable parmi les dépouilles des ennemis vaincus.
Comme il retournait dans ses montagnes, il crut entendre une bouche invisible qui chantait: «Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez les routes du Seigneur, rendez droits ses sentiers.» Et il ne comprit pas le sens de ces paroles. Mais ce qu’il avait vu et ce qu’il avait fait lui sembla comme une vision bénie, et toujours depuis cette époque il épargna les voyageurs qui emmenaient avec eux des enfants. L’enfant de la montagne accomplissait alors sa trente-troisième année.
Trente-trois ans après ce jour, un autre grand combat se livrait entre l’enfer, qui perdait l’empire du monde, et le fils de Dieu, qui allait sauver les hommes. Le drame adorable et sanglant de notre salut se dénouait sur le Calvaire: Jésus montait de sa crèche de Béthléem à sa croix du Golgotha, et trois gibets étaient dressés sur la montagne des douleurs. Le Christ, couronné d’épines, avait à sa gauche un assassin qui blasphémait; à sa droite, un criminel crucifié comme lui, qui penchait humblement la tête, et disait: Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume! et l’homme-Dieu lui répondait: «Je vous le dis, en vérité, aujourd’hui même vous serez avec moi dans le paradis.» Il y a dix-huit cents ans que cela se passait, et depuis dix-huit siècles l’Église honore la mémoire du bon larron, qui un jour avait partagé sa demeure avec le Christ enfant, et qui mérita plus tard de partager sa croix.
Les ruines de la forteresse du bandit existent encore aujourd’hui. Au temps des Croisades, les Francs la visitaient avec un religieux respect; et plus d’une fois au moyen âge, la scène traditionnelle que nous venons de rapporter fut le sujet d’un de ces drames allégoriques et pieux qu’on représenta si longtemps dans l’enfance de l’art.

L’Ange Gardien.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| »Je te protégerai, je serai ton bon Ange. | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Près du lit de sa mère, au fond de son berceau,
Un jeune enfant dormait, comme on dort à son âge,
Lorsque soudain un ange, en l’azur d’un nuage,
A ses yeux apparut, resplendissant et beau.
Sur son front blanc et pur rayonnait une étoile,
Et ses beaux cheveux blonds descendant, comme un voile,
Sur ses pieds enfantins à flots d’or ruisselaient;
D’un bruit harmonieux ses ailes frémissaient;
Sur ses lèvres errait un céleste sourire,
Et ses doux yeux d’azur sur l’enfant qu’il admire,
Planant avec amour, semblaient le protéger.
Puis, auprès du berceau posant son pied léger
Et penchant, gracieux, son céleste visage:
«Enfant, lui disait-il, oh! regarde-moi bien!
De ta vie, ici-bas, je suis l’Ange Gardien;
Tous tes jours, avec moi, couleront sans nuage,
Et tes ans se suivront sans amener de pleurs,
Ne laissant recueillir à ta main que des fleurs,
Ôtant devant tes pieds de ce monde la fange,
Je te protégerai, je serai ton bon ange.
Lorsque parfois, enfant, tu sens dans tes cheveux
Passer légèrement la brise qui soupire,
C’est mon souffle, pareil au souffle du zéphyre,
Qui, pour te caresser, descend du haut des cieux;
Puis, lorsque t’effleurant, légère, de son aile,
Tu sens, auprès de toi, la rapide hirondelle
Qui passe et dans les airs s’envole loin de toi,
Dans l’odorant parfum des iris de la plaine,
Dans les échos mourants des ailes du phalène,
Enfant, c’est encor moi, c’est moi, c’est toujours moi!
Quand, avec les saisons qui glissent sur ta tête,
Ton oublieuse enfance aura fui sans retour,
Inondant ton front pur des flots de mon amour,
C’est moi qui, de tes jours ferai des jours de fête;
Je te suivrai toujours, toujours planant sur toi,
Tu sentiras frémir mon aile tutélaire...
Car Dieu qui t’aime, enfant, propice à ma prière,
De ta vie en ce monde, a fait deux parts: à moi
Il donna la douleur et te laissa la joie.
Garde-la, mon enfant, sois heureuse, parcours,
En la semant de fleurs la belle et douce voie
Que le ciel t’a tracée. Entraînée au long cours
Du fleuve de la vie, en saluant ses rives
De tes cris de bonheur, des plus beaux de tes jours,
Laisse couler en paix les heures fugitives...
Va, l’on pleure assez tôt; assez tôt de tes yeux
Se ternira l’azur sous un voile de larmes;
Assez tôt, mon enfant, se flétriront tes charmes.
Je retourne, sur toi, veiller du haut des cieux.
Ce soir, quand de la nuit s’abaisseront les voiles,
Lève les yeux au ciel, regarde les étoiles
En des palais d’azur tout resplendissans d’or,
D’où vers toi, chaque jour, je guide mon essor,
Sous des arbres fleuris aux couleurs éclatantes,
Auprès des séraphins aux ailes chatoyantes,
C’est là qu’est ma demeure, enfant, et souviens-toi
Que toujours de là-haut ton bon ange te voit.
Adieu!!»—Puis, déployant soudain ses blanches ailes
L’ange prit son essor aux voûtes éternelles,
En saluant de loin celui qu’il protégeait.
—Et l’enfant, à l’aurore entr’ouvrant sa paupière,
Aperçut, se penchant sur son berceau, sa mère
Qui, pendant son sommeil, encor sur lui veillait.


Timor est une île des Indes-Orientales, habitée par les Malais, méchante race d’hommes que vous ne connaissez peut-être pas encore, mes enfants; je vais vous en dire deux mots. Ces tribus se trouvent éparses sur une grande partie de l’Archipel d’Asie; cruelles, ignorantes, elles poussent la barbarie quelquefois même jusqu’à mêler du sang humain aux sacrifices qu’elles offrent à leurs idoles. C’est affreux cela! Aussi de saints missionnaires ont-ils maintes fois affronté les plus grands périls pour chercher à répandre sur ces contrées les lumières de l’Évangile; hélas! les douces paroles de ces ministres de Dieu ne parvinrent jamais à toucher le cœur de ces idolâtres, et le plus souvent leur admirable dévouement n’eut pour prix que les persécutions et la mort; mais, hommes du Seigneur, ils regardaient leurs souffrances comme un bienfait pour l’humanité; ce martyre leur ouvrait les portes du ciel.
Voilà donc ce que c’est que les Malais; maintenant parlons de Timor. Cette île montueuse, hérissée de volcans mal éteints, est fréquemment ébranlée par les tremblements de terre, ravagée par des ouragans qui éclatent à l’improviste sur ces côtes marécageuses; elle est d’ailleurs entourée de récifs, de bancs de corail, qui en rendent l’accès très-dangereux aux navigateurs. Eh bien! sans doute, allez-vous me dire, il n’y a pas grand mal à cela; que peut-on avoir à démêler avec des barbares comme vos Malais, avec une île aussi affreuse que Timor?
A cela je répondrai, moi, qu’il ne faut pas se hâter de prendre si légèrement certaines choses en aversion; souvent le bien est à côté du mal; rien de ce qui nous entoure, mes enfants, en objets d’art, d’industrie, en nécessités de la vie et dont nous jouissons tous, n’a certes été improvisé: il a fallu bien du mal, de la persévérance, des sueurs, des sacrifices et l’expérience surtout de bien des siècles pour en venir au point de produire, créer, façonner de cent mille manières toutes les choses que vous voyez. Ce qui vous charme et vous séduit, brille le plus à vos yeux, l’or même et le diamant, tout n’était, à son état primitif, qu’objet brut et grossier. Où en serions-nous donc, si nos pères s’étaient dit, à propos de toutes choses. «A quoi bon faire ceci, travailler cela?»—Et vous-mêmes, pauvres petits êtres en naissant, que deviendriez-vous, si des soins maternels, de jour et de nuit, ne veillaient à votre existence, à votre santé, à tous vos moindres besoins; si nous ne mettions avec tant de sollicitude votre corps à l’abri des difformités; si nous ne façonnions si péniblement votre esprit et votre intelligence; si nous ne mettions sans cesse votre cœur en garde contre les impressions du vice? Tout cela est-il donc l’œuvre d’un jour? Pardon, mes amis, de cette longue digression; mais j’ai voulu vous faire comprendre que, pour arriver à faire le bien, il ne faut se laisser rebuter ni par les obstacles, ni par les dangers, ni par la peine; ainsi, par exemple, vous voilà convaincus d’avance que Timor est un pays abominable, où la terre tremble, où des volcans brûlent, où les hommes sont méchants, où l’on risque (ce que je ne vous avais pas dit encore) d’être dévoré à toute heure par d’énormes serpents. Oui, et nonobstant cela, Timor a encore un puissant attrait pour les Européens; son sol est fécond et riche; il se pare de tous les brillants végétaux de l’Inde; c’est de là que les Hollandais tirent leur camphre, leur vanille, leur benjoin. Ses forêts renferment en outre des bois précieux d’aloès et d’ébène; or, tous ces produits deviennent la source de grandes richesses; voilà pourquoi Timor, malgré tous ses inconvénients, est une île aussi fréquentée qu’aucune autre.
Mais revenons à ses habitants; les Malais passent une grande partie de leur vie à la chasse. Dès l’enfance, ils se sont habitués à des luttes, souvent corps à corps, avec les bêtes fauves qu’ils ont à détruire. C’est à ces exercices journaliers qu’ils doivent leur férocité; on ne livre pas impunément une guerre acharnée à des animaux féroces, sans qu’il reste toujours quelque chose de la bête fauve au fond du cœur. Au reste, de toutes ces chasses, la plus dangereuse encore est la chasse au boa. Rien de plus curieux, mais en même temps de plus terrible! Vous allez en juger; et, si par hasard mon récit vous effrayait quelque peu, rappelez-vous bien vite que ces affreux serpents-là ne sont pas à vos côtés, mais à quelques mille lieues de vous: ce qui devra vous rassurer.
Alors donc que le soleil lance sur Timor ses rayons de feu, et qu’une chaleur étouffante absorbe la nature, le Malais dévoré, brûlé, cherche un refuge sous les grands arbres de ses forêts; et là, par le calme solennel qui l’environne, il écoute si, du milieu de ces amas de feuilles desséchées qui jonchent le sol, il ne surgira pas tout à coup certain frémissement comme celui d’un corps qui se glisserait en rampant. Il regarde s’il ne verra pas au loin d’immenses ondulations serpenter dans les allées sombres. Oh! s’il apercevait cela, le Malais sentirait aussitôt battre son cœur tout à la fois de crainte et d’espérance, car il aurait deviné son plus cruel ennemi: le boa.
Parmi les forêts nombreuses qui avoisinent Timor, il en est surtout de célèbres pour les chasses qu’y font les insulaires. Ces hommes ont eu l’audace de planter leurs cabanes jusque dans ces repaires de reptiles. Ils vivent près d’eux, au milieu d’eux; quand, d’un bond, le boa peut les atteindre, d’un repli les broyer. Un boa a-t-il saisi sa proie (soit homme, soit buffle), il l’étreint dans ses immenses anneaux, l’enveloppe, l’étouffe, brise et pétrit ses os; cela fait, il ouvre son énorme mâchoire et y engloutit sa victime tout entière. Ah! c’est alors, seulement alors, que l’habitant de la forêt peut l’approcher sans crainte et lui plonger dans le corps son poignard empoisonné; car, après un tel repas, l’affreux reptile tombe toujours en un état de léthargie complète; et cependant, qui le croirait? ce n’est pas cet instant de sommeil si propice dont profitera le vrai chasseur de boa pour attaquer le monstre; ce n’est pas un adversaire repu, engourdi qu’il lui faut: il veut avoir affaire à un ennemi furieux et altéré de sang.
Toutefois, bien que les Malais n’attachent aucune espèce d’honneur à tuer le boa, une fois plongé en cet état, ils ne manquent cependant pas alors de le percer toujours de leurs flèches aiguës, trempées dans certain poison fort subtil qui découle d’un arbrisseau: le Bohon-oupas; sa mort est ainsi assurée; et, à son tour, il servira de pâture aux animaux de la forêt.
La chasse au boa offre d’autant plus de dangers, que les armes à feu sont impuissantes contre un pareil adversaire. Quelle balle pourrait jamais atteindre ce corps immense qui sans cesse se plie, se dresse, se courbe, tournoie en mille évolutions aussi rapides qu’imprévues? A peine, en effet, le chasseur aura-t-il entendu l’herbe sèche bruïre au loin sous les ondulations du reptile, que tout à coup, d’un seul bond, il lui apparaîtra, se balançant à la branche la plus élevée d’un arbre voisin, et prêt à fondre sur sa tête. Assurément, il faut être Malais, avoir vu souvent de près un ennemi si terrible pour n’être point, en pareil cas, glacé d’épouvante.
Souvent aussi le boa déserte ses forêts pour venir attaquer l’habitant de Timor jusque dans ses huttes grossières; alors il cherche, avec mille efforts, à se glisser à travers les joints de la cabane; il rampe, se rapetisse, s’allonge; s’il y pénètre enfin, oh! malheur à qui l’habite, malheur! point d’espoir de salut, il faut périr!
Ces sortes d’attaques devinrent insensiblement fréquentes au point de répandre partout la terreur. Le conseil de l’île organisa donc des chasses régulières pour accélérer la destruction des boas: on fit choix, pour de semblables expéditions, des hommes les plus intrépides, car il ne s’agissait de rien moins que de faire, jour et nuit, dans les forêts, une battue générale.
Un Anglais, poussé par une curiosité invincible, eut un jour la témérité de se mêler, en amateur, à une bande de ces chasseurs Malais; ceux-ci étaient, selon leur habitude, armés de criks à la lame fine, aiguisée, et de flèches disposées en éventail sur leur poitrine. On marchait depuis quelques heures à travers la forêt; le lugubre silence de cette solitude n’avait encore été jusque-là interrompu que par le vol sinistre de plusieurs oiseaux de proie. On marchait donc toujours, quand nos chasseurs entendent soudain bruire près d’eux un amas de feuilles sèches; et du sein de ces feuilles agitées, presque aussitôt ils voient serpenter un corps énorme: c’était un boa. A cet aspect, ils ont tressailli de joie, et l’Anglais a senti tout à coup un léger frisson parcourir tous ses membres. Mais déjà les Malais ont préparé leurs flèches; ils s’avancent à pas de loup pour surprendre l’ennemi. A un signal donné, mille dards pleuvent sur lui. Ainsi assailli de toutes parts, le monstre fait un soubresaut horrible; sa masse immense se déroule avec la rapidité de l’éclair; ses anneaux tour à tour s’allongent, se recourbent, s’enlacent; puis tout à coup son corps entier se soulève, et, de sa queue formidable, étreignant le sommet d’un arbre qu’il ébranle, il s’élance et l’enveloppe de ses anneaux de fer; alors la gueule du monstre est béante, ses yeux lancent de terribles éclairs; il se balance, tournoie incessamment, toujours prêt à fondre sur les malheureux chasseurs. Oh! alors notre pauvre Anglais n’a plus une goutte de sang dans les veines; cependant, chacun des Malais avait, du plus grand sang-froid, déjà pris position pour l’attaque. Les uns, placés derrière l’arbre, s’élancent armés de leurs criks et frappent à coups redoublés le reptile pour en venir à briser un de ses anneaux; efforts impuissants! Le boa fait alors retentir l’air d’un sifflement horrible; et, par un mouvement soudain, cramponnant sa mâchoire à l’arbre, il déroule ses anneaux, détache sa queue et la lance au loin avec fureur. Un homme a été frappé, balayé par elle, et cet homme, c’est le voyageur anglais; l’infortuné roule sans vie aux pieds des Malais, qui se précipitent à son aide. Mais le boa n’a que trop senti la résistance d’un corps, il se retourne, et, prompt comme la foudre, il s’abat sur sa victime, l’étouffe et broie ses os avec rage.
Les Malais restent d’abord glacés d’horreur à la vue de cette scène affreuse; mais, bientôt ne respirant plus que vengeance, ils assaillent en désespérés le boa de leurs flèches; ils le frappent à l’envi de leurs criks; celui-ci, blessé d’innombrables coups, cherche en vain à saisir de nouvelles victimes; ses yeux étincèlent de mille feux; il s’agite, se tord en bonds convulsifs... c’en est fait, il est vaincu; une fois encore il s’est dressé, furieux dans l’air, puis il retombe enfin épuisé sur le sol, en poussant un dernier et sourd frémissement.
D’abord les chasseurs ont entouré leur terrible ennemi, contemplé avec ivresse sa dernière agonie; mais, au milieu de leur joie, bientôt ils reculent devant le cadavre horriblement mutilé du malheureux Anglais. Leur victoire lui avait coûté la vie; ils revinrent donc fort tristes à la ville, après avoir rendu à l’étranger les honneurs de la sépulture.
Plus tard, le gouvernement de Timor, pour mettre un terme aux ravages toujours croissants des boas, qui finissaient par dépeupler la colonie, prit le parti désespéré de livrer l’île à un incendie général. Forêts et reptiles, tout brûla donc à la fois; et, au milieu de cette immense fournaise, à la lueur des flammes, on eût pu voir mille tourbillons animés, étranges, qui sifflaient, rugissaient, se tordaient en convulsions horribles: c’étaient les boas de Timor dont on faisait un vaste auto-da-fé.
Depuis ce jour aussi l’île est-elle bien moins infestée de reptiles: ce qui n’est pas toutefois une raison, mes enfants, pour que je vous engage à l’aller visiter vous-mêmes un jour, sans nécessité; il n’y a d’agréable que les choses utiles.

Henriette d’Angleterre.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| Ils descendirent ainsi l’Escalier de la Tourelle. | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Le 16 juillet 1646, à la tombée de la nuit, le château fort du comte d’Essex, à Exeter, retentissait des éclats d’une joie immodérée; le comte, suivi de ses principaux officiers, s’était absenté pour toute la journée; les soldats, abandonnés à eux-mêmes, mettaient à profit ce moment de liberté; il est vrai de dire aussi que, depuis le matin, on n’avait cessé de leur faire des distributions de viande et de vin, en leur disant que ces dons leur venaient des parlementaires, pour récompenser les troupes de leur dévouement à la cause de Cromwell, et célébrer la récente victoire de ce chef sur les partisans de la royauté.
Au nombre des domestiques chargés de la distribution des vivres, il en était un surtout dont le zèle à faire manger et boire les soldats paraissait infatigable; c’était un homme jeune encore, d’une figure sévère et douce à la fois; on le nommait Péterson; du reste, personne ne le connaissait parfaitement: il n’était que depuis peu admis parmi les gens du comte. Allant d’une table à l’autre, excitant les soldats, leur versant lui-même à boire, cet homme, d’après le plaisir qu’il éprouvait à voir l’ivresse gagner chaque convive, semblait possédé d’une autre idée que celle d’enivrer simplement des soldats.
Effectivement, quand il les vit enfin rouler tous ou à peu près sous la table, les uns plongés dans un état à ne plus rien voir et rien entendre, les autres, dans un sommeil lourd et profond, il les contempla, un moment, avec l’air d’un homme qui a réussi dans ses projets; puis, leur jetant à tous un regard de mépris, il s’achemina lentement et avec précaution vers une autre partie du château.
Lorsque ce personnage eut traversé bien des galeries et des appartements, monté, descendu plusieurs escaliers, il parvint à une tourelle entièrement isolée, à laquelle des portes massives, des croisées bardées de fer, donnaient toute l’apparence d’une prison.
C’en était une. Péterson en ouvrit la porte, saisit derrière cette porte un petit paquet de hardes, que probablement il avait caché là depuis quelques instants; puis, grimpant avec agilité un escalier roide et obscur, il arriva devant une porte qu’il ouvrit à l’aide de plusieurs clefs et en tirant plusieurs verroux, enfin il se trouva devant une femme pâle et tremblante, qui lui cria d’une voix émue: «Eh bien!
—Tout a réussi, madame, répondit respectueusement Péterson, grâce à la vente de vos bijoux; cet argent m’a servi à enivrer les soldats; je leur ai fait une distribution de vin et de viande, au nom de Cromwell, de sa récente victoire et des parlementaires; la ruse a eu un plein succès. J’ai fait répandre ces mêmes bruits dans la ville... toute la garnison est désarmée, jusqu’aux sentinelles qui dorment dans leur guérite; voici des vêtements de paysan pour la princesse; vite, vite, madame, il n’y a pas un instant à perdre, revêtons madame Henriette de ce costume et partons.»
A ce nom de madame Henriette, une petite fille de trois ans et demi, blonde et rose, s’avança vivement en s’écriant:
«Nous allons donc sortir de cette vilaine tour grillée; oh! oui, petite maman, partons.
—Chère enfant, reprit la comtesse Morton en déployant le paquet que venait de lui remettre Péterson, il faut d’abord endosser ces vêtements.
—Ces vêtements! dit la jolie enfant avec un sourire dédaigneux; mais ce sont des habits de paysan, et moi, je suis une princesse!
—Pauvre petite! répliqua madame Morton, tout en habillant Henriette; hélas! le fils d’un paysan est, en ce moment, plus heureux que toi.
—Oh! vous avez bien raison! petite maman, soupira l’enfant devenue soudain triste et soucieuse; les princesses sont bien malheureuses; d’abord, pas de papa ni de vraie maman... une bonne petite maman, c’est vrai, ajouta-t-elle en passant ses jolies mains autour du cou de madame Morton; mais, enfin, une petite maman n’est pas une maman pour tout de bon; puis, une chambre dont on ne sort jamais... tout plein de joujoux, c’est vrai, mais personne avec qui jouer... et puis, pas d’air!
—Comment, pas d’air, répéta madame Morton surprise.
—Est-ce que vous croyez, petite maman, dit Henriette, que je ne me suis pas aperçue que, lorsque vous vouliez de l’air, vous ouvriez la croisée; donc, l’air est dans le jardin, et non pas ici... ah! mon Dieu! que les petites princesses sont malheureuses!...»
Madame Morton soupira sans répondre; Henriette avait alors revêtu son petit costume de paysan; et certes, rien ne ressemblait moins à un enfant des champs que cette jolie petite fille, si blonde, si blanche, si délicate, et dont le front, le cou, les bras et les mains avaient le poli de l’albâtre.
Péterson, qui était sorti pendant la toilette de la princesse, revint sur ces entrefaites:
«Partons, partons, s’écria-t-il en entrant; le comte d’Essex ne sera de retour que demain; mais, s’il lui prenait fantaisie de revenir ce soir, nous serions perdus... La princesse est-elle prête?
—Oui, la princesse est prête, dit Henriette d’un ton boudeur, la princesse est prête, et bien mal costumée pour une princesse, on peut le dire.»
Péterson prit la princesse sur ses bras, et, lui recommandant le plus grand silence, il sortit avec elle de la chambre; madame Morton le suivit, inquiète et troublée, après avoir abaissé sur ses yeux le capuchon de son mantelet noir; ils descendirent ainsi l’escalier de la tourelle, tournèrent le grand bâtiment en se dirigeant vers une petite poterne qui donnait sur un chemin de traverse; la porte en était ouverte; deux chevaux se trouvaient là, tout sellés, tout bridés; Péterson monta l’un d’eux et assit Henriette devant lui; la comtesse s’élança sur l’autre avec toute la grâce et la prestesse d’une excellente écuyère, et les chevaux partirent au galop.
«Comme on est secoué, disait Henriette à Péterson... et puis, mal assise, ajouta-t-elle voyant que celui-ci ne répondait pas... et puis, il pleut, reprit-elle.
—Hélas! dit madame Morton qui avait entendu ses plaintes, les princesses ne sont pas toujours heureuses!
—On peut bien dire jamais, répliqua Henriette en soupirant à son tour et bâillant.
—Dieu est grand! ma fille, repartit la comtesse; il faut le prier pour votre mère et pour vous.
—Je ne demande pas mieux, petite maman, dit l’enfant;» elle joignit aussitôt les mains, et marmotta une petite prière que lui avait apprise madame Morton, sa gouvernante; mais le sommeil l’ayant surprise au milieu de sa prière, Péterson la couvrit de son manteau, et lui et la comtesse continuèrent leur route en silence.
Nos trois fugitifs voyagèrent ainsi plusieurs jours, en se dirigeant vers les côtes d’Angleterre et suivant toujours des chemins de traverse dans la crainte d’être poursuivis; et la pauvre petite Henriette qui, le premier jour, avait été enchantée de ce changement de position, commençait à regretter sa chambre bien close, quoique grillée, et cette solitude qui l’ennuyait tant.
Vers la fin du huitième jour, à l’entrée de la nuit, ils se trouvèrent devant une cabane isolée, non loin des bords de la mer. Madame Morton, épuisée de fatigue, ne se sentait plus la force de se tenir sur son cheval; Péterson frappa à la porte de cette cabane pour y demander l’hospitalité.
«Qui va là? répondit une voix enrouée et d’un ton de mauvaise humeur.
—De pauvres voyageurs surpris par la nuit, qui demandent un gîte pour une ou deux heures, reprit Péterson; il y a un enfant; au nom du ciel, ne nous refusez pas.»
A ce mot d’enfant, la porte s’ouvrit aussitôt; car l’enfance porte toujours avec elle une magie qui soumet les cœurs même les plus durs; et une vieille femme parut sur le seuil: «Entrez,» dit-elle simplement.
Péterson, qui était descendu de cheval, remit aux mains de la vieille la petite Henriette endormie; puis, ayant aidé la comtesse à quitter sa monture, il conduisit les deux chevaux dans une grange que lui indiqua cette femme, tandis que la comtesse pénétrait dans l’intérieur de la cabane.
C’était une misérable hutte de pêcheur, toute tapissée de filets; des poissons pendaient à des crocs. Quelques bottes de paille, étalées çà et là, prouvaient que ses habitants n’avaient pas d’autres lits pour se reposer.
Péterson était de retour à peine de la grange que la porte de la cabane s’ouvrit de nouveau, mais brusquement; et trois hommes parurent soudain: tous trois de stature colossale, à l’air farouche, vêtus de la même manière, armés de pistolets et de carabines; ce devait être le père et les deux fils.
«A souper, la mère!» crièrent-ils en entrant; mais, à la vue des étrangers qui s’étaient levés à leur approche, leur front se rembrunit.
Henriette, qui venait de se réveiller, les regarda avec effroi.
«Ce sont des voyageurs égarés, dit la vieille femme répondant ainsi aux regards inquiets de ces trois hommes; ils ont avec eux cette enfant: mais voici le souper,» ajouta-t-elle en posant sur la table une marmite pleine de soupe et un plat énorme de pommes de terre bouillies; puis une petite fille parut, tenant une cruche pleine de bière.
Quelques mots ayant été échangés entre la vieille femme et la petite fille à propos de sa lenteur à faire son service, Nelly (c’était le nom de la petite) s’en alla bouder et pleurer dans un coin.
Pendant qu’on prenait place à table et qu’on invitait le plus poliment du monde madame Morton à vouloir bien partager ce repas, Henriette s’approcha tout doucement de Nelly.
«Est-ce que tu es une princesse? lui demanda-t-elle de prime abord.
—Pourquoi? repartit la boudeuse.
—C’est que tu pleures et que je n’ai jamais vu pleurer que des princesses, reprit-elle naïvement; les autres enfants ne s’ennuient jamais.»
Ces paroles ayant attiré l’attention du plus âgé d’entre les trois hommes, il se tourna vers Henriette, et, remarquant avec surprise son ravissant et blanc visage entouré de sa couronne naturelle de beaux cheveux blonds, il s’écria:
«Quel bel enfant pour un enfant de paysan!
—Monsieur, riposta aussitôt Henriette d’un air de dignité offensée, je ne suis pas un paysan, mais bien une princesse, s’il vous plaît.
Madame Morton, qui n’avait pu prévoir cette repartie funeste, devint pâle; elle allait chercher à en détruire l’effet, lorsque le père l’interrompant brusquement: «Pensez-vous nous donner le change, madame, et ne voyons-nous pas à votre air, à celui de cette enfant, que vous êtes de grands personnages déguisés... Mille cartouches!... ne craignez rien: nous sommes des contrebandiers, mais non des espions, des délateurs.
—Messieurs, répondit la comtesse d’une voix émue: dans le fait, j’aime mieux me fier à votre bonne foi; sachez donc tout, et que notre confiance nous serve du moins de sauve-garde auprès de vous...» Puis, ayant un moment recueilli ses esprits troublés par la terrible indiscrétion de Henriette, elle ajouta: «Vous voyez en cette enfant madame Henriette-Anne d’Angleterre, la fille de notre infortuné roi, Charles I, et de Henriette-Marie de France, fille de Henri IV; malheureuse reine, comme elle s’est appelée si souvent elle-même! On la maria en 1625 (elle avait quatorze ans alors), au prince de Galles, Charles Stuart; véritable fille de Henri le Grand, elle était douée de toutes les vertus: douce et bonne, autant que noble et courageuse, on ne pouvait pas plus douter de sa parole que désespérer de sa clémence! Mon Dieu! qui ne l’a vue, lors de la peste qui affligea Londres! qui ne se la rappelle prodiguant indistinctement ses charités à tous les sujets de son époux? Et quand le feu des discordes civiles et religieuses se ralluma; quand on se révolta en Écosse, en Angleterre; quand le roi eut à combattre ses propres sujets, n’accusa-t-on pas la reine de tant de maux?... et comment cette noble fille de Henri le Grand répondit-elle à tant d’outrages?... par des bienfaits, par des preuves constantes de bonté, de sagesse et de fermeté. Enfin, lorsque les rebelles croissant chaque jour en audace, en puissance, Charles I fut obligé de fuir Londres et de se séparer de sa femme, quelle conduite admirable ne développa-t-elle pas encore, cette jeune et infortunée reine d’Angleterre! Oh! laissez-moi vous raconter cela, poursuivit madame Morton lisant sur les visages basanés de ses convives l’émotion que son récit faisait naître; laissez-moi vous parler de cette noble femme, que j’ai si souvent entendu calomnier. Sous prétexte de conduire, en Hollande, la princesse royale, sa fille aînée, mariée depuis peu à Guillaume, prince d’Orange, il fut convenu que la reine irait y chercher des secours d’armes et d’argent. Une furieuse tempête l’assaillit à son retour; mais, au milieu des éclairs et de l’ouragan, rien ne put lui faire quitter le pont du navire; ranimant de la voix et du geste le courage abattu de l’équipage, elle disait avec un air de conviction qu’elle communiquait aux autres: «Les reines ne se noient jamais.» Bientôt, après avoir perdu deux vaisseaux et une grande partie des munitions qu’elle apportait, Henriette fut rejetée sur les côtes de la Hollande; et, au bout de quinze jours, elle se confiait encore aux hasards de la mer, aux rigueurs de l’hiver; enfin elle débarqua en Angleterre, où l’attendaient de nouveaux périls. Les ennemis, instruits de son arrivée, assaillirent avec le canon la maison qui lui servait d’asile; et elle n’échappa à cette mort inévitable que par un miracle inouï. A peine en sûreté, elle défendit de poursuivre les auteurs de ce coupable attentat. Ainsi, en cette occasion comme dans toutes celles qui se succédèrent pendant une année entière, cette femme admirable montra constamment un courage supérieur à son sexe et à sa fortune, un zèle ardent pour la cause du roi son époux, une clémence qui, plusieurs fois, lui gagna des partisans, même parmi les rebelles... Mais, hélas! elle touchait encore au moment d’être mère; les fatigues de son état l’obligèrent à quitter le roi, qu’elle avait jusqu’alors accompagné en tout lieu. Après de longs et touchants adieux, Henriette alla chercher un refuge à Exeter: c’est là que je vis cette souveraine des Trois Royaumes manquer des premières nécessités de la vie, et avoir recours à Anne d’Autriche pour lui envoyer jusqu’aux moindres choses dont elle avait besoin, et, de plus, vingt mille pistoles, qu’elle fit aussitôt passer au roi son époux... Cette chère petite princesse,» reprit madame Morton en posant sa blanche main sur la belle tête blonde d’Henriette, qui écoutait sa gouvernante avec une attention si soutenue, qu’elle ne touchait même pas, quoique mourant de faim, aux aliments qu’on avait placés devant elle; «cette chère petite princesse vint au monde le 16 juin 1644, il y a aujourd’hui trois ans et un mois; et dix-sept jours après, sa mère, à peine rétablie, menacée qu’elle était par l’approche de l’armée révoltée, sous le commandement du comte d’Essex, fut obligée de fuir, et de passer secrètement en France, après avoir confié la jeune princesse à mes soins. Accueillie en France avec tous les honneurs qui lui étaient dus, cette noble et malheureuse reine n’est préoccupée que du déplorable état du roi, de ses enfants et de l’Angleterre... Je suis la comtesse Morton, gouvernante de madame Henriette; grâce à ce serviteur fidèle et dévoué, ajouta-t-elle en désignant Péterson, j’ai réussi jusqu’à ce jour à soustraire cette chère enfant aux factieux; je voudrais la conduire en France, auprès de sa mère; le vaisseau qui doit nous y transporter est près de ces côtes, mais comment aller le rejoindre?
—Et dans ma barque, donc! répliqua le chef de la cabane.
—Oh! monsieur, s’écria la comtesse partagée entre la crainte et l’espoir; monsieur, si nous nous fions à vous, qui nous dit que vous ne nous trahirez pas?»
Un nuage passa sur le front du contrebandier et de ses fils; le plus jeune répliqua brusquement:
«Si vous ne vous fiez pas à nous, pourquoi vous reposer dans notre cabane?... savez-vous si nous n’avons pas déjà envoyé quelques voisins auprès des émissaires de Cromwell pour prévenir que la fille de Charles I est en notre pouvoir?...
—Tom... Tom...» cria le père en frappant du poing sur la table et montrant à son fils la pâleur soudaine répandue sur les joues de madame Morton; «c’est mal ce que tu dis là... mais tu es jeune, toi, tu ne sais pas que le malheur rend méfiant... Madame, ajouta-t-il en se tournant vers la comtesse, mes enfants et moi n’entendons rien aux affaires du royaume, et il nous importe fort peu de crier: vive le Prétendant ou vive Charles Stuart; notre royaume c’est nos filets; notre roi, c’est la mer; notre politique, c’est la manière de prendre plus ou moins de poissons; nous joignons à cela un peu de contrebande, seulement parce qu’il faut vivre, et que nous ne comprenons pas trop quel tort nous faisons au chef de l’État en introduisant dans son royaume, d’une manière ou d’une autre, quelques litres d’eau-de-vie de plus... Mais, foi de Tom Muller, fils d’André Muller, et père de Jacques et de Tommy Muller, vous pouvez vous fier à nos bras, madame.
—Et je le crois, dit la comtesse en se levant; partons.
—Partons,» répétèrent les trois pêcheurs en se levant; et, pendant que l’un des fils saisissait les rames et la voile, l’autre les filets, comme pour aller à la pêche, Péterson se chargeait d’Henriette, qu’il enveloppait dans son manteau; le vieux Muller offrit son bras à la comtesse.
«Appuyez-vous sur moi, madame, lui dit-il, le terrain est glissant, et nous avons une petite côte à descendre pour gagner le rivage.»
En arrivant au bord de la mer, ils purent distinguer un navire qui se tenait en panne, n’attendant que le moment de lever l’ancre; la barque des pêcheurs y amena les fugitifs; et, le lendemain, la vue des côtes de la Normandie rassura madame Morton, en lui prouvant qu’elle n’avait plus rien à craindre pour la jeune princesse.
Henriette trouva sa mère installée au Louvre, avec son frère, qui fut depuis Charles II. En voyant cette reine infortunée constamment pleurer, la pauvre enfant fut confirmée davantage dans l’idée que les princesses n’étaient pas heureuses. Effectivement, bien que la reine d’Angleterre eût d’abord été accueillie au Louvre avec tous les honneurs dus à la fille de Henri IV, à force d’envoyer des secours d’hommes, d’argent et de vaisseaux à son mari, elle se trouva bientôt réduite à manquer elle-même des choses les plus nécessaires à la vie. Ce fut alors, en 1649, qu’elle reçut la nouvelle de l’assassinat de Charles I, de ce roi, dit Bossuet, clément jusqu’à être obligé de s’en repentir. Pour dérober à tous les yeux ses douleurs et son infortune, elle se retira dans une maison de Chaillot, où, en vertu de lettres patentes, un couvent de la Visitation fut fondé sous son nom; elle y donna l’exemple de toutes les vertus; mais les troubles civils de la Fronde la forcèrent à revenir au Louvre. La postérité aura peine à croire qu’un jour, au mois de janvier, une petite-fille de Henri IV ne put se lever, faute d’un fagot pour allumer du feu; et c’est pourtant ce qui arriva à la jeune Henriette. A l’époque dont nous parlons, le cardinal de Retz étant allé faire visite à la reine, la trouva dans la chambre de sa fille: «Vous voyez, dit-elle au cardinal, je viens tenir compagnie à Henriette: cette pauvre enfant n’a pu se lever aujourd’hui faute de feu.»
Ce fut sans doute à cette éducation donnée par le malheur que cette jeune princesse puisa cette douceur et cette aménité qui l’ont rendue l’une des princesses les plus aimables dont la cour de France conserve encore le souvenir.
Pendant quelque temps, Anne d’Autriche, mère de Louis XIV, et la reine d’Angleterre parurent désirer que ce monarque choisît Henriette pour épouse; mais il la trouva trop jeune. Ce fut peu de mois après le traité des Pyrénées que le mariage de Henriette se conclut avec Philippe de France, duc d’Orléans, frère de Louis XIV; les époux furent unis le 31 mars 1661, dans la chapelle du palais royal, sans aucune pompe, à cause du carême.
Hélas! heureuse alors, elle ne jouit pas longtemps du bonheur que causent l’affection qu’on éprouve et celle qu’on fait éprouver.
Un dimanche, le 29 juin 1670, deux cris retentissaient tout à coup dans Saint-Cloud: Madame se meurt! madame est morte!—Ces deux cris se succédèrent rapidement.
Le matin, la princesse se plaignit d’une douleur au côté et d’une douleur dans l’estomac; à sept heures du soir, elle demanda un verre d’eau de chicorée qu’elle prenait depuis quelques jours. A peine l’eut-elle bu que les douleurs redoublèrent et allèrent toujours en croissant. Madame demanda son confesseur, et le curé de Saint-Cloud vint; elle se confessa sans permettre à la femme de chambre, qui soutenait ses oreillers, de se retirer; le roi arriva de Versailles à onze heures du soir, et passa tout de suite chez sa belle-sœur, à laquelle il dit adieu en pleurant. Madame vit bien qu’elle se mourait; elle accepta ses souffrances avec résignation; elle rendit le dernier soupir, en véritable chrétienne, à trois heures du matin, à peine âgée de vingt-six ans.


Dans l’histoire de France, que vous étudierez plus sérieusement un jour, il se présente, mes enfants, une circonstance singulière qu’il est bon de vous faire connaître. Déjà, vous savez indubitablement que la nomenclature de nos rois se divise en trois races: les Mérovingiens, les Carlovingiens et les Capétiens. Vous n’ignorez pas non plus que cette dernière race, qui dure encore, tient, dans notre histoire, la place la plus importante, tant par la nature des hauts faits qu’elle a accomplis, que par le grand nombre de rois qu’elle a donnés à la France: lequel ne s’élève pas à moins de trente-huit jusqu’à nos jours. Or, c’est dans cette race que se rencontre l’étonnante particularité que je vais vous signaler.
Cette grande famille des Capétiens, dont le chef régnait il y a mille ans, a formé trois branches distinctes: celle des Capétiens directs, celle des Valois et celle des Bourbons, qui s’est tout récemment subdivisée, en 1830, en Bourbons d’Orléans. Eh bien! chacun de ces trois grands rameaux a fini par trois frères rois, et chacun de ces trois frères rois, dans les trois branches, a été plus ou moins malheureux, soit dans sa vie privée, soit dans l’administration du royaume: c’est ce que vous allez voir.
Philippe IV le Bel, troisième roi de la branche des Capétiens, mourut en 1314, laissant trois fils: Louis Hutin, comte de Champagne, Philippe le Long, comte de Poitou, Charles le Bel, comte de la Marche, et une fille, Isabelle, dont le mariage avec Édouard II, roi d’Angleterre, devint pour la France la source de grands et longs malheurs.
Louis Hutin, l’aîné des trois frères, succéda à son père sous le titre de Louis X; il mourut après un règne de deux ans, en 1316, ne laissant de sa première femme, Marguerite de Bourgogne, qu’une seule fille, nommée Jeanne, à qui appartenait de droit la couronne. Mais, habitués à se voir gouvernés par des rois, et craignant sans doute de se déshonorer s’ils obéissaient à une femme, les Français, par une décision injuste, déclarèrent les femmes inhabiles à régner. Ils s’étaient fondés sur un article d’une vieille loi des Francs, la loi salique, laquelle exclut les femmes du partage de la terre salique, c’est-à-dire d’une certaine portion des terres conquises; cette loi salique a, depuis, été appliquée sept fois.
Jeanne fut donc exclue du trône; et, comme sa belle-mère, Clémence de Hongrie, seconde femme de Louis X, était près de donner un héritier à la couronne quand Louis Hutin mourut, Philippe le Long, comte de Poitou, fut nommé régent du royaume, jusqu’au jour où la naissance de cet enfant détruirait par son sexe toutes les incertitudes, en affermissant ou non la couronne sur la tête du régent. Au bout de six mois, la veuve de Louis X mit au jour un fils, qui fut proclamé roi de France, sous le nom de Jean I posthume (c’est-à-dire né après la mort de son père); mais Jean ne vécut que sept jours; en conséquence, la couronne passa légitimement au second fils de Philippe IV le Bel, Philippe le Long, comte de Poitou, qui prit dès lors le titre de Philippe V.
Après six ans d’un règne malheureux, celui-ci mourut, laissant deux filles naturellement exclues du trône par la loi salique. La couronne échut donc au troisième fils de Philippe le Bel, Charles, comte de la Marche, qui s’appela Charles IV le Bel.
Comme son dernier frère, Charles IV ne régna que six ans; comme lui aussi n’eut-il que des filles, de sorte qu’il fut le dernier des Capétiens directs.
Ainsi finit, par trois frères rois, cette première branche des Capétiens.
Mais ce qu’il y a ici de plus remarquable encore, c’est, indépendamment de l’extinction de leur race et par les mêmes causes, l’étonnante similitude de destinée pour ces trois frères. Tous trois moururent jeunes: Louis à vingt-six ans, Philippe à trente, Charles à trente-quatre. Tous trois eurent à punir un même genre de crime chez leurs femmes: Louis fit étrangler Marguerite de Bourgogne, au Château-Gaillard, où elle avait déjà subi une captivité de deux années; Philippe pardonna à la sienne, Jeanne de Bourgogne, et la reprit avec lui, tandis que Charles, après s’être séparé de Blanche de Bourgogne, sœur de Jeanne, la relégua dans un monastère, où elle finit ses jours dans la plus austère pénitence. Les trois frères avaient également été détestés de leurs sujets à cause des lourds impôts dont ils les accablaient et de l’altération fréquente qu’ils firent subir aux monnaies. Enfin, aucun des trois n’eut, comme nous l’avons vu, de fils pour successeurs; la naissance de Jean n’ayant eu, en réalité, aucun résultat. Une ancienne chronique dit à ce sujet: «La Providence divine ne voulut pas accorder de descendants à ceux qui avaient saccagé le royaume par tant d’exactions et de violences.»
La branche des Valois succéda à celle des Capétiens. Philippe VI monta sur le trône à la mort de son cousin Charles IV le Bel. Il fut le premier de cette famille royale sous laquelle tant d’événements heureux ou malheureux pour la France devaient s’accomplir.
Henri II fut le dixième roi de cette branche; il mourut en 1559, des suites d’une blessure que lui fit Montgommery dans un tournoi, laissant, de Catherine de Médicis, quatre fils, dont aucun n’eut de postérité, et dont trois seulement régnèrent, le duc d’Alençon, le plus jeune d’entre eux, étant mort avant Henri, son troisième frère. François II, l’aîné, ne régna que dix-sept mois, n’eut pas d’enfants de sa femme Marie Stuart, de sorte que la couronne passa à son frère Charles IX, âgé seulement de dix ans et demi. Marié à Élisabeth d’Autriche, celui-ci n’eut qu’une fille; et, lorsqu’il mourut en 1574, Henri, troisième fils d’Henri II, accourut de Pologne dont il avait été nommé roi, pour ceindre la couronne de France, sous le nom de Henri III. Comme François II, il n’eut pas d’enfants, et en lui s’éteignit la branche des Valois.
De même que les trois derniers Capétiens, ils furent tous trois malheureux, et rendirent la France plus malheureuse encore. Sous la funeste influence de leur mère, Catherine de Médicis, méchante femme, qui avait su s’emparer de leur esprit et les dominer, ils accablèrent leurs sujets des maux les plus cruels: la Saint-Barthélemi, ou massacre des protestants ordonné par Charles IX, sera une tache aussi ineffaçable de ce règne que la guerre civile de la ligue, qui désola sans interruption celui de Henri III. Et maintenant, comment s’éteignit la race des Valois? François II mourut à dix-huit ans, d’un abcès à l’oreille; Charles IX, à peine âgé de vingt-quatre ans, périt de phthisie ou d’empoisonnement, déchiré de remords, misérable et chargé de l’exécration publique; enfin, à trente-neuf ans, Henri III fut assassiné à Saint-Cloud par le fanatique Jacques Clément.
La branche des Bourbons eut beaucoup de peine à s’asseoir sur le trône de France. Henri IV, élevé dans la religion protestante, n’y monta, longtemps après la mort d’Henri III, qu’après avoir abjuré sa croyance. Ses successeurs furent Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, dont l’histoire vous est sans doute connue.
Indépendamment de plusieurs filles, Louis XV eut un fils Louis dauphin, qui mourut, regretté de toute la France, avant son père, et laissant trois fils: Louis, duc de Berri; Louis, comte de Provence, et Charles, comte d’Artois.
A la mort de Louis XV, en 1774, la couronne échut de droit, toujours d’après la loi salique, au préjudice de ses filles, à l’aîné de ses petits-fils, le duc de Berri, qui fut Louis XVI. Celui-ci, avec une fille, la duchesse d’Angoulême, qui vit encore, n’eut que deux fils, morts, le premier à onze ans, et le second à dix, en sorte qu’après les divers événements accomplis pendant la Révolution, sous la République et sous l’Empire, la couronne échut au frère de Louis XVI, Louis, comte de Provence, qui se fit appeler Louis XVIII, et non Louis XVII, parce que le second fils de son frère, quoique mort à dix ans, avait cependant survécu de deux années à son père.
Louis XVIII étant mort sans enfant, en 1824, Charles, comte d’Artois, troisième frère, monta sur le trône sous le nom de Charles X.
Comme chez les Capétiens et les Valois, le sort de ces trois frères a été malheureux. Louis XVI est mort, comme un martyr, sur l’échafaud, en 1793; Louis XVIII eut, jusqu’à sa mort, à lutter sans cesse contre la fureur des partis; enfin, Charles X est mort tout récemment sur la terre d’exil.
Voilà un rapprochement historique assurément fort triste, mais en même temps bien extraordinaire.


Dans un beau pays des Indes vivait un puissant génie, l’effroi des méchants par ses formes gigantesques. Mais, s’ils tremblaient de lui déplaire, craignant l’effet de sa vengeance, en revanche le Génie était adoré des bons, qui se reposaient sous sa protection juste et paternelle.
Dans ce même pays vivait un savant nommé Phanor, que ses vastes connaissances auraient rendu l’admiration de tous, si son orgueil insupportable ne l’avait fait détester lui, et même la science qu’il professait. Il faisait un tel abus de cette science, qu’il en était venu jusqu’à nier l’existence de Brama[1]! Le génie souffrait d’entendre ainsi raisonner le docteur, car ces faux raisonnements pouvaient entraîner la jeunesse simple et ignorante qu’il enseignait.
Un jour donc, il se présente devant lui, pendant qu’il faisait un cours à ses disciples: il l’écoute parler, propose avec douceur quelques objections, auxquelles Phanor répond par de si grands mots, que tout son petit auditoire, étourdi et ravi, à proportion qu’il comprenait moins, l’applaudit à tout rompre.
Le génie sentit que tous ces esprits avaient besoin d’une leçon; mais, désespérant de les ramener par des discours, il pensa que l’expérience serait un meilleur maître; d’un coup de sa baguette il touche Phanor, et trace un cercle dans lequel il l’enferme lui et tous ses disciples. Allez, dit-il, puisque vous faites un si mauvais usage de l’intelligence que Brama vous a donnée pour le comprendre, l’admirer et l’aimer, devenez un des plus petits insectes qui végètent sur la terre: soyez fourmis, et remerciez-moi, car j’aurais pu vous choisir une condition plus abjecte, et vous classer parmi des êtres plus chétifs encore.
Il n’avait pas achevé, que tout avait disparu, et à la place de la tribune du docteur, sur un léger monticule de sable, s’agitait une fourmilière. Le génie se coucha à terre pour l’observer; comme il avait non-seulement de bons yeux, mais encore les yeux d’un génie, il distingua Phanor, qui, ayant pris avec la forme, l’instinct de ces industrieux animaux, dirigeait les travaux de sa nouvelle république.
Savez-vous, mes enfants, que c’est intéressant à observer une fourmilière? l’intelligence de ces petits êtres, leur industrie, leur persévérance, l’ordre, l’économie, qui règnent parmi eux, forment une histoire charmante et qui vous amusera beaucoup quand vous vous occuperez d’histoire naturelle; mais revenons à Phanor.
Vous jugez bien qu’en devenant si petit, il avait beau être admirablement organisé pour une fourmi, ce n’était plus l’organisation d’un homme; et toutes ces grandes idées de science qui l’occupaient autrefois, s’étaient réduites à proportion de sa petite tête. Cependant parmi les fourmis, c’était encore une fourmi raisonneuse, et surtout orgueilleuse.
En visitant le petit espace de terre qu’il pouvait parcourir, il se disait: Que ce monde est grand! En montant sur une petite hauteur, il se croyait au moins sur la cime d’une des plus hautes montagnes; de là il regardait aussi loin que ses petits yeux pouvaient le lui permettre, et il disait: Que la nature est belle! Jusque-là c’était bien; si sa vue ne s’étendait pas davantage, l’on ne pouvait raisonnablement lui en faire un reproche, c’était la faute de son organisation.
Mais à force de réfléchir, il voulut, comme auparavant, approfondir le grand secret de la nature, et connaître celui qui l’avait créée. Ceci était encore une louable pensée et un noble désir, s’il eût su comprendre que tout ne peut être dévoilé à de simples créatures; mais Phanor, trop orgueilleux pour soumettre son esprit, niait toujours ce qui n’était pas à sa portée.
Le voilà donc parcourant la terre qui l’entoure, dans un assez grand espace pour ses petites pattes; il monte jusqu’au haut d’un magnifique tulipier; il en suit les branches qui lui paraissaient autant de vastes et immenses routes. Arrivé au sommet, il aperçoit les brillantes fleurs qui couronnent ce bel arbre. Où suis-je! s’écrie-t-il; sans doute dans les régions célestes... Que c’est admirable!—Toutes ces tentes légères faites d’étoffes transparentes et embaumées, panachées de couleurs brillantes, se balançant doucement dans les airs, doivent être au moins la demeure des génies, si ce n’est celle de Brama lui-même. Que j’ai bien fait d’avoir la persévérance de supporter les fatigues d’un long voyage! mais oserai-je pénétrer dans ces réduis mystérieux et aériens? Pourquoi pas: c’est ma conquête; je suis venu là par la force de mes hautes facultés; j’en veux recueillir le fruit.
Il descend donc hardiment dans le sein de la plus belle des tulipes; il peut faire un savoureux repas sur les étamines de la fleur; au fond de son calice, quelques gouttes de rosée le rafraîchissent délicieusement, et là il attend en vain l’hôte de ces palais enchantés; mais il n’aperçut que quelques mouches légères et bourdonnantes, et notre fourmi comprenait bien qu’une mouche était une créature dans son genre.
Après avoir parcouru toutes les fleurs, il pensa: Mais je suis fou; tout cela est seulement fait pour moi, pour moi qui ai su le découvrir!... J’irai dire ces belles choses à mes disciples; ils seront bien surpris.
Et voilà Phanor, tout fier, reprenant la route par laquelle il était venu.
Arrivé près de son domaine, après bien des dangers; il aperçoit une masse dont il ne peut apprécier les véritables proportions; il la parcourt, avec de grandes difficultés, dans tous les sens, et se dit: Voilà sans doute une nouvelle montagne formée par quelque grande catastrophe durant mon voyage; je veux analyser ce nouveau phénomène: un terrain mouvant sous ses pas, des bruits sourds, un sol brulant, offraient matière à ses observations.
Il découvre bientôt, entre autres merveilles, plusieurs gouffres de formes différentes, des cavernes profondes, des bois touffus, et enfin deux lacs couverts d’un cristal transparent.
Voilà, dit-il, des choses moins riantes, mais plus extraordinaires que tout ce que j’ai vu. Mais Dieu! quel vent violent, quel bruit affreux, sortent de ces cavernes! Où suis-je? la terre tremble sous moi, la montagne s’ébranle, m’enlève dans les airs. Tenons-nous bien; mettons-nous à l’abri dans cette forêt.
Phanor entre dans le taillis, se cramponne à la terre, lorsqu’une puissance dont il ne peut se rendre compte, l’en arrache et le jette dans l’espace.
Grâce à sa petitesse, le vent le porta doucement jusqu’à sa fourmilière. Il resta longtemps sur le sable, à se débattre et à reprendre ses esprits. Quand il fut revenu à lui, il se pressa de rentrer dans ses Etats, et Dieu sait comme ses aventures parurent surprenantes aux fourmis qui l’écoutaient.
Il en était à conter les dernières choses qui l’avaient frappé; il parlait des cavernes bruyantes, des lacs de cristal, de la forêt où il s’était réfugié, et de la force extraordinaire qui l’en avait arraché, quand le Génie, qui l’écoutait, se prit à rire de toutes ses forces, et, touchant la fourmilière de sa baguette, Phanor et ses disciples reparurent sous la forme d’hommes.
Le Génie leur apprit que cet objet si étonnant, cette montagne, n’était autre chose que lui-même, qui s’était couché près de la fourmilière pour l’observer.
«Les cavernes profondes d’où soufflait un vent violent, c’étaient ma bouche et mes narines; les lacs de cristal, mes deux yeux; et la forêt où tu t’étais réfugié, pas autre chose que ma barbe, où tu m’as causé une démangeaison si vive, que je t’ai lancé sur la terre. Les superbes tentes aériennes qui causaient ton admiration, ne sont que les fleurs du tulipier. Ce qui te semble à toi, homme, un fort bel arbre seulement, pour toi, fourmi, avec tes petits yeux, tes petites idées, devait être un étrange phénomène.
«Et toi, avec tes yeux d’homme, tu prétends comprendre Brama le créateur de toutes les merveilles qui embellissent notre terre, des astres qui brillent aux cieux, des créatures qui peuplent et la terre, et l’air, et les ondes; le créateur enfin de tout ce que tu vois et de tout ce que tu ne peux voir! Pauvre Phanor!...
»Moi, Génie, je vois un peu plus que toi, comme toi, homme, tu vois un peu plus que la fourmi... Brama seul peut embrasser d’un coup d’œil les mondes qu’il a créés; lui seul est grand!!!» Phanor courba sa tête altière devant le raisonnement du Génie; il fit mieux, il comprit le néant de sa vanité.
Depuis ce jour, au lieu de chercher à vouloir définir Brama, il l’admira dans ses œuvres; pénétré de reconnaissance, il le bénissait pour sa bonté et l’adorait dans sa grandeur. Il n’avait plus qu’un désir, plus qu’un orgueil; c’était de faire connaître à tous cette vérité qui avait subjugué son esprit et attendri son cœur.
Cet heureux changement lui attira l’amitié et la protection toute particulière du Génie, qui lui fit part des hautes connaissances et des secrets auxquels son organisation plus parfaite lui permettait d’atteindre. Phanor, cette fois, n’en fit usage que pour rendre hommage à Brama; et lorsqu’après de longs jours qu’il avait su rendre utiles, Brama, content de Phanor et de la tâche qu’il avait remplie, le rappela à lui pour le récompenser, Phanor, admis dans les célestes régions du bonheur, de la science et de la lumière, put voir alors combien autrefois il était peu de chose, combien Brama était grand, et comme il avait dû rire de son orgueil.

|
Nom sous lequel les Indiens adorent Dieu. |
Tomy.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| Il effeuilla les fleurs autour de son ami, et, s’accompagnant sur sa harpe, il chanta. | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Par une soirée du rigoureux hiver de 1788, le vent gémissait autour de Saint-Sulpice, à Paris; une pluie glaciale fouettait les vitraux; l’intérieur de l’église était désert, le silence profond; une seule lampe perçait l’obscurité, et, comme une lueur d’espoir, se projetait dans la chapelle de la Vierge. La mère du Christ semblait veiller seule, le corps légèrement incliné en avant, avec l’expression de la plus ineffable bonté; mais pas une prière ne s’élevait vers elle, pas une douleur ne venait se prosterner sur la dalle humide.
Neuf heures sonnaient à la tour.
En ce moment, une porte latérale s’entr’ouvrit, une forme humaine s’avança dans l’ombre, et vint tomber épuisée devant la chapelle. La clarté de la lampe permit alors de distinguer un enfant pâle, chétif, déguenillé, offrant tous les symptômes de la misère et de la souffrance; ses doigts s’entrelaçaient convulsivement, ses membres se contractaient, ses dents claquaient de froid, et de douloureux soupirs s’échappaient de sa poitrine. «Sainte Vierge! sainte Vierge! murmurait-il, ayez pitié de moi!»
Puis, sa force s’étant brisée dans cette dernière parole, il s’évanouit. Quand il reprit ses sens, il était dans la sacristie. Un respectable ecclésiastique (M. l’abbé Capdeville) qui traversait le sanctuaire, l’avait secouru: à la vue du misérable état de cet enfant, il s’était considéré comme l’instrument de la bonté divine.
«Hélas! pauvre petit, dit-il, quelle pâleur!... il est à peine couvert par un froid si grand.»
Et il se dépouilla de sa soutane pour en envelopper l’enfant. Quelques étincelles brillaient encore dans la cendre d’un poêle; il s’empressa d’y jeter du bois menu et de raviver le feu. L’enfant ouvrit ses grands yeux bleus, dont l’humide regard exprima une angélique reconnaissance.
«Merci, monsieur, merci, dit-il d’une voix presque éteinte.
—Te sens-tu mieux? lui demanda le bon prêtre.
—Oh! oui,» fit celui-ci avec un signe de tête; mais, au même instant, il lui prit une nouvelle faiblesse. Sa pâleur devint effrayante, ses deux mains s’appuyèrent fortement sur son estomac, et il ajouta d’une voix creuse: «J’ai faim!»
Il est de ces mots qui ont une puissance horrible: l’abbé Capdeville resta immobile et le cœur glacé.
«J’ai faim, répéta l’enfant avec un accent morne et poignant.
—Je suis à toi,» s’écria l’ecclésiastique. Et il s’élança tout à coup hors de la sacristie; puis il traversa l’église, en renversant, dans sa marche précipitée, quelques chaises dans l’ombre, et sans se soucier le moins du monde de n’être qu’à moitié vêtu.
Il fut bientôt de retour avec les aliments nécessaires. L’enfant reprit sensiblement des forces en mangeant; ses yeux s’animèrent, ses lèvres se colorèrent. A chaque bouchée qu’il mangeait, il regardait M. Capdeville avec une indicible expression de joie reconnaissante; il lui baisait les mains, il priait Dieu, il remerciait la sainte Vierge, il riait, il pleurait, et, par-dessus toute chose, il dévorait, le pauvre enfant, que c’était plaisir à voir.
Le bon prêtre le regardait en souriant. Ah! c’était un si digne homme!
«Courage, dit-il, mon enfant, courage; tout à l’heure tu vas être tout à fait mieux... Cependant mange moins vite; il serait fâcheux que tu te fisses mal avec un aussi bon appétit; rien ne nous presse.»
Et l’enfant ralentit le mouvement de sa mâchoire. Mais au bout d’une seconde, il recommençait de plus belle.
«Allons, dit le bon prêtre, je vois que tu es pressé de retourner chez ta mère.»
L’enfant s’arrêta court; il regarda son bienfaiteur avec une tristesse profonde.
«Eh quoi! je t’ai causé de la peine, mon petit ami, tu pleures?
—Hélas! monsieur, vous avez éveillé bien des regrets dans mon cœur! Je n’ai plus de mère!...» Et le pauvre enfant était suffoqué par les larmes.
—Mais tu as une famille?
—Non, monsieur.
—Ta mère, en mourant, ne t’a donc laissé à la garde de personne?
—Si bien, monsieur; elle est morte, ma mère, il y a deux ans; et comme elle était bien pauvre, ma mère, elle m’avait donné à ma nourrice; ma nourrice m’aimait, et elle prit soin de moi; ses paroles consolèrent l’orphelin, mais son mari ne m’aimait pas, lui; j’ignore pourquoi, je ne lui avais jamais fait de mal; dans la maison, on ne m’entendait pas plus que si je n’y avais pas été. Hélas! elle aussi mourut, ma nourrice, et subitement encore; elle n’eut que le temps de me dire, car elle paraissait bien inquiète pour mon avenir: «Va, mon fils, Dieu est grand et bon, et il protégera l’orphelin.»
«A peine avait-on recouvert de terre le cercueil de ma pauvre nourrice, que son mari me dit brusquement de m’en aller. «Va à Paris, va gagner ton pain.» Et il me poussa sans pitié à la porte, qu’il referma aussitôt... «Où aller? que faire? que devenir?... O ma mère! ô ma nourrice! mes providences en ce monde, vous n’étiez plus! Qui donc m’aimera, maintenant? qui me protégera, m’abritera? Du haut des cieux, m’écriai-je tout en pleurs, et en tombant à genoux au milieu du chemin, veillez sur moi, ô ma mère! ô ma nourrice! secourez votre enfant!... Alors je me sentis un peu plus de courage au cœur, et je m’acheminai vers Paris, avec l’espoir d’être bientôt secouru, à cause de ma jeunesse. Ah! monsieur, je suis allé frapper à bien des portes; souvent j’ai été repoussé, et j’ai entendu des mots qui m’ont fait bien du mal. On a refusé de m’employer, j’étais trop jeune, disait-on; comme si mes douze ans m’empêchaient d’être bon à quelque chose. Oh! j’aurais travaillé avec courage, avec ardeur, et au lieu de cela, forcé par la nécessité, j’ai été tendre la main, j’ai mendié; mais le passant a l’oreille sourde et le cœur dur... Allez, monsieur, j’ai senti bien de la honte, car je n’étais pas fait pour mendier, moi... Ah! je suis bien malheureux!...»
A ces mots, la tête du pauvre enfant se pencha douloureusement, et des sanglots débordèrent de sa poitrine.
L’abbé, lui aussi, était profondément ému. «Console-toi, mon ami, lui dit-il, et souviens-toi des paroles de ta nourrice: «Dieu est grand et bon!»
—Et la sainte vierge aussi, reprit l’enfant avec une ingénuité pleine de confiance; car c’est elle que j’intercédais, et qui vous a fait venir vers moi.
—Pour que tes malheurs aient un terme.
—Hélas! fit-il, ils recommenceront demain.
—Comment te nomme-t-on?
—Tomy, monsieur.
—Eh bien! Tomy, veux-tu que je te serve de père?
—Que dites-vous là, monsieur? s’écria l’enfant.
—Je dis que, puisque tu n’as plus de famille en ce monde, je serai désormais ta famille, je remplacerai ta mère, si toutefois une mère se peut remplacer. Je ne suis pas riche, il s’en faut; mais enfin, nous ferons pour le mieux, et puisse ce nouvel appui ne pas se briser entre tes mains, mon fils!»
A mesure que le vénérable ecclésiastique parlait, Tomy relevait la tête, et portait ses bras en avant; lorsqu’il s’entendit appeler mon fils, ses jambes fléchirent; il ne douta plus, il ne put résister à l’émotion qui le gagnait, et se jeta au cou du prêtre, qui le pressa sur son cœur.
«Mon bienfaiteur! mon père!» s’écria Tomy.
—Mon fils!» répondit M. Capdeville. Et tous deux sortirent de la sacristie. Ils traversèrent ainsi l’église; mais arrivés devant la statue de la Vierge, Tomy se jeta à genoux, et s’écria avec effusion: «Sainte Vierge! sainte Vierge! vous avez eu pitié de moi!»
L’abbé Capdeville habitait sur la place Saint-Sulpice, au troisième étage, dans une maison de modeste apparence; un ameublement sévère, une propreté minutieuse, offraient une idée exacte du caractère de l’homme pieux, dont une partie de l’existence s’était écoulée dans cette habitation. Quelques fleurs soigneusement cultivées en ornaient les trois fenêtres.
Tomy fut bientôt installé dans ce tranquille intérieur. La vie de l’un et de l’autre subit une heureuse influence. Le misérable état de l’enfant disparut, et la solitude de l’abbé s’anima. Tomy était une de ces organisations délicates qui ont besoin d’aimer, d’aimer beaucoup, et chez lesquelles la reconnaissance est un bonheur, non un fardeau. Le bon prêtre ne tarda pas à s’apercevoir qu’il avait trouvé là un être doué de tous les bons instincts. La beauté du front proéminent de cet enfant était le siège d’une haute intelligence, et la profondeur de ses yeux, déjà mélancoliques, décelait une exquise sensibilité; aussi s’appliquait-il à satisfaire cette intelligence, à diriger cette sensibilité. Il initia son élève aux secrets de la science, et l’éleva dans une bonne éducation chrétienne.
Resserré dans le cercle étroit de son ministère, les idées nouvelles qui envahissaient le siècle ne l’avaient que légèrement ému, à cause de la sincérité de son cœur et de la droiture de ses opinions; il arriva donc jusqu’en 89, sans soupçonner même que l’avenir était gros d’orages. Tout occupé de l’éducation de son enfant adoptif, sa vie intérieure remplissait seule son existence. Ce fut aussi dans l’intimité de ce vieillard au cœur pur, que Tomy grandit, et qu’il fut surtout initié à cette vie intellectuelle et morale qui centuple les facultés; mais, comme entre autres dons de la nature, le bon ecclésiastique avait remarqué que son jeune élève était doué de grandes dispositions pour la musique, il lui avait mis un solfége entre les mains, et lui donnait des leçons de chant. Tomy montra, pour cette étude, une disposition si persévérante, qu’en peu de temps sa voix douce put s’unir à plusieurs instruments. Rien n’était plus expressif que son chant; et quoique bien jeune encore, on sentait qu’il y avait une âme puissante dans le frêle corps de Tomy, que cette âme s’était développée rapidement à l’école du malheur.
L’abbé Capdeville était assez bon musicien. Souvent, le soir, quand le bruit de la ville semblait s’assoupir, il fallait voir Tomy, assis sur un tapis, la tête cachée dans ses deux mains, prêter l’oreille, avec une émotion croissante, et suspendre toute son âme aux chants graves et harmonieux que modulait son bienfaiteur: le pauvre enfant avait un sentiment si profond de la musique! Quand le bon prêtre avait fini de chanter, Tomy restait encore absorbé dans son émotion, puis relevait sa pâle et jolie figure toute humide de larmes. Quelquefois Tomy, emporté par un mouvement involontaire, allait presser la main de son bienfaiteur.
«Mon enfant, lui dit un soir l’abbé Capdeville en souriant: tu joueras mieux que moi, beaucoup mieux. Tu deviendras peut-être un grand artiste. Tomy tressaillit.
—Vous croyez? dit-il.
—De l’aptitude, de l’âme, de la persévérance; que faut-il de plus?
—Moi, artiste! murmura Tomy avec une exaltation mal comprimée. Oh! quel avenir! mon Dieu! ô mon père, que dites-vous là? moi, devenir artiste!...»
A cette prédiction, Tomy vit s’ouvrir un nouvel horizon devant lui. Avec quelle joie il travaillait! Avec quelle puissance de désir il aspirait alors après un avenir illustre! Mais hélas! cet avenir qu’il ne voyait qu’à travers le prisme d’une brillante illusion, était enveloppé d’un nuage de deuil.
Deux années s’écoulèrent ainsi sans qu’aucun événement influât sur leur destinée. Cependant la tourmente révolutionnaire commençait à se déchaîner; toutefois, au milieu des ébranlements de la France, les occupations du bon ecclésiastique et de Tomy étaient réglées et calmes: la prière, l’étude, la musique, de petites promenades au Luxembourg, la culture de leurs fleurs bien-aimées, toutes bonnes choses qui ne les empêchaient pas de trouver encore les moyens d’accomplir des œuvres charitables. Tout en gémissant sur les calamités de son pays, M. Capdeville demandait, avec ferveur, au ciel de lui épargner les terribles catastrophes qui semblaient se préparer.
Cependant, depuis quelque temps, des bruits sinistres circulaient dans Paris. Les esprits étaient livrés à la plus grande anxiété. On approchait du 2 septembre 1792.
Il est, au milieu de l’Océan, de vertes oasis, des bocages de palmiers posés sur des écueils; longtemps la tempête se déchaîne autour d’eux sans troubler le calme de leur retraite profonde; les fleurs y croissent, les oiseaux y chantent. Il semble que leur repos doive être éternel; quand, hélas! il arrive un moment où les vents et les flots, dans un redoublement de fureur, renversent les digues de granit, et portent la désolation dans ces retraites inconnues. Ainsi furent troublés tout à coup le bonheur caché, la vie douce et obscure du respectable M. Capdeville et de son fils adoptif.
Un soir, Tomy se promenait dans le jardin du Luxembourg; le ciel était beau, l’air parfumé. Les feuilles gazouillaient sur les arbres, les oiseaux parmi les feuilles. Toute la nature semblait convier à la joie. Mais Tomy était triste; il marchait lentement, un livre à la main, sans lire; l’inquiétude se peignait sur son visage; il détournait souvent la tête et regardait çà et là, au travers des arbres. Une larme furtive coulait de ses yeux.
«Pas encore! murmura-t-il en s’asseyant sur un banc de pierre. Il m’avait pourtant promis de revenir bientôt.»
L’heure avançait, et l’inquiétude de Tomy croissait avec l’heure; il ne pouvait rester en place; il se levait, marchait, se rasseyait, se relevait et proférait des paroles pleines d’une douloureuse angoisse.
Enfin, neuf heures sonnèrent; chaque vibration de la cloche faisait bondir son cœur; tout à coup son visage s’altéra, l’oppression le saisit, il put à peine prononcer ce mot: neuf! «Il lui sera arrivé malheur! ô mon père, qu’est-il devenu?» Et il se prit à courir de toute sa force. En un clin d’œil il fut sur la place Saint-Sulpice. «M. l’abbé? demanda-t-il au portier.—Je ne l’ai pas vu, répondit celui-ci; mais il est parti avec vous?—C’est vrai, reprit Tomy; comme nous allions au jardin du Luxembourg, un de ses confrères l’a abordé avec mystère et lui a dit des choses que j’ignore. M. l’abbé a paru attristé, il a baissé la tête, m’a dit d’aller l’attendre au but de notre promenade et qu’il reviendrait bientôt; puis, en s’adressant au digne prêtre qui lui parlait, il a ajouté: «Allons chez M. l’archevêque d’Arles.»
«Chez l’archevêque d’Arles! s’écria le portier; ah bien! alors, je comprends que M. l’abbé ne soit pas ici.
—Que voulez-vous dire, reprit Tomy en frémissant.
—Hélas! M. Tomy, l’archevêque d’Arles vient d’être arrêté; sans doute ceux qui étaient chez lui, ont partagé son sort.
—Êtes-vous bien sûr?—Que trop, M. Tomy.»
Tomy fit un mouvement de désespoir, et monta dans sa chambre, où il passa la nuit dans les prières et les larmes.
Le lendemain, il reçut un billet ainsi conçu:
«Tomy, mon cher enfant,
»Le prêtre que tu as vu m’entretenir venait d’être informé qu’on allait arrêter Mgr. l’archevêque d’Arles. Nous avons voulu prévenir le prélat, mais nous sommes arrivés trop tard. Comme diocésain du vénérable archevêque, on m’a aussi conduit aux Carmes, où ma réclusion, je l’espère, ne sera pas de longue durée. Ne sois plus inquiet; Dieu fera que je revienne bientôt t’embrasser, mon bon Tomy. Adieu, au revoir.
»L’abbé Capdeville.»
Tomy relut plusieurs fois ce billet, le baisa avec transport, puis retomba dans une profonde tristesse; tout à coup une sinistre pensée lui traversa la tête. Il tressaillit, devint pâle et murmura: «Mon Dieu! si on en voulait à sa vie!»
Quelques jours après la réception de cette lettre (c’était le samedi 1er septembre 1792), d’étranges mesures avaient plongé Paris dans les plus vives alarmes. On avait fermé les barrières, fait des perquisitions dans tous les domiciles; un calme effrayant régnait dans la cité; Tomy, sorti de grand matin, parcourait les rues de Paris. Chaque fois qu’il apercevait un groupe, il s’y glissait pour apprendre si les craintes dont il avait le cœur rongé étaient réellement fondées; et tout ce qu’il entendait, n’était guère de nature à le rassurer. On parlait vaguement de complots et d’exécutions; il fallait, disait-on, effrayer les conspirateurs qui, du fond de leurs prisons, s’entendaient avec l’étranger.
Tomy tremblait de tous ses membres à ces révélations terribles: «Quels conspirateurs! se demandait-il avec effroi; non, non, M. l’abbé n’est pas du nombre de ces hommes!»
Pendant tout le chemin, il n’entendit que des paroles menaçantes; mais, reposant sa pensée sur l’innocence de son bienfaiteur, il se rassurait bientôt; il repassait dans son esprit les actions de ce digne prêtre; toutes, elles étaient empreintes de cette bonté ineffable qui ne laisse aucune prise au soupçon. Toutefois, malgré ses efforts pour tranquilliser son âme, Tomy se sentit un grand malaise. Plusieurs heures s’étaient écoulées depuis qu’il avait quitté sa demeure; il était encore à jeun; la fatigue, l’émotion, lui causèrent un peu de faiblesse; il éprouva des tiraillements d’estomac. Fort éloigné de la place Saint-Sulpice, il s’assit sur un banc des Champs-Élysées, et se prit à pleurer amèrement; quand tout à coup des clameurs retentirent sur la place de la Révolution; Tomy ressentit une commotion violente. Il leva la tête et vit au loin un attroupement d’hommes qui s’agitaient avec fureur. Il y courut aussitôt, se glissa dans la foule. Et quelle foule! Ce rassemblement était affreux à voir, à entendre. Un homme était au milieu et semblait le dominer de toute l’énergie de la scélératesse: «Citoyens! criait-il, l’ennemi est à trente lieues de la capitale. Il marche sur Paris. Nous allons voler à sa rencontre. Mais attaquerons-nous les ennemis du dehors avant d’avoir frappé ceux de l’intérieur?
—Non, non, à mort! hurla la foule.
—Les laisserons-nous opprimer nos familles, tandis que nous nous battrons aux frontières?
—A mort! où sont-ils?
—Dans les prisons, à l’Abbaye, aux Carmes, partout!
—Lâche! lâche! s’écria soudain une voix dans la foule.
—Qui parle? fit l’orateur forcené avec un geste de fureur.
—Moi, repartit Tomy avec fermeté et croisant fièrement ses bras sur sa poitrine: je vous dis que vous n’êtes qu’un lâche et que la patrie n’a pas de plus redoutable ennemi que vous.»
Le monstre auquel il s’adressait, sourit ironiquement en voyant un enfant dont la frêle constitution contrastait, d’une manière si étrange, avec l’assurance de son maintien et l’énergie de ses paroles.
«Prends garde à toi, petit aristocrate[2], se contenta de répliquer ce misérable.
—Que Dieu vous pardonne vos paroles impies,» reprit solennellement Tomy. Il fit mine de vouloir s’éloigner, et tandis que la foule, ébahie de tant d’audace à cet âge, s’écartait pour le laisser passer, l’enfant ajouta comme inspiré: «Peuple, sois humain, et tu seras grand sous tes haillons.»
La foule le suivit longtemps des yeux et toute stupéfaite...
Cette scène, qui présageait de si grands malheurs, mit la mort dans l’âme du pauvre Tomy. De plus en plus tourmenté pour le sort de celui qu’il aimait plus que sa vie, il résolut de chercher à le voir à tout prix; il se dirigea donc vers les Carmes; il lui fallait pénétrer dans l’église. Mais comment faire? Le hasard lui fut un puissant auxiliaire. Comme il arrivait à ce couvent transformé en prison, la porte s’entr’ouvrit pour recevoir deux prêtres; sans hésiter, il entra avec eux; on ne fit aucune difficulté de l’enfermer avec deux cents ecclésiastiques déjà confinés dans l’église. Il était plus aisé d’y entrer que d’en sortir.
Cependant une espèce de guichetier lui avait dit: «Où vas-tu, fou que tu es? cette prison n’est pas sûre.
—C’est pour cela que j’entre,» avait répondu Tomy.
Et il courut se jeter dans les bras de l’abbé Capdeville.
Ah! combien l’émotion fut vive! combien ils furent heureux de se revoir! Ce fut un bonheur si grand, qu’ils ne purent d’abord proférer une seule parole: mais comme ils s’embrassèrent, comme ils pleurèrent, comme ils confondirent leurs larmes! Dès qu’ils purent parler, épancher leur cœur, gros de souvenirs, avec quelles délices ils se rappelèrent les douces et laborieuses journées qu’ils avaient passées ensemble, les charmantes heures de causeries et de méditation sous les ombrages du Luxembourg; car c’est surtout quand le malheur nous frappe que nous aimons à nous souvenir des moments de félicité; il semble que cela aide à supporter les maux présents. Et quel doux passé, quels doux souvenirs ils avaient, eux!...
Cependant, assiégé tour à tour par de sombres et riantes pensées, le bon prêtre accabla Tomy de questions. «Mon enfant, disait-il, je suis charmé de te voir; mais dis-moi, quelles nouvelles du dehors? As-tu bien pris soin de nos fleurs?... On dit qu’il se passe d’étranges choses dans Paris?... A propos, tu n’as pas négligé ton chant, au moins?»
A toutes ces questions, Tomy répondit, avec calme et pour ne pas alarmer son bienfaiteur, toutes les choses rassurantes qu’il put imaginer; et ils s’entretinrent, cette journée entière, de nouveaux projets de travail et d’avenir. Mais enfin, la nuit arriva, et il fallut faire trêve à ces doux entretiens.
«Enfant, dit l’abbé Capdeville, il est temps de retourner à notre demeure.
—Mon père, reprit l’enfant, qu’ai-je besoin de vous quitter, puisque je puis rester ici? laissez-moi près de vous.
—Non, Tomy, il faut être raisonnable; et d’ailleurs, dans ces temps de troubles, on ne sait ce qui peut se passer ici.»
Tomy sourit tristement. «Raison de plus, dit-il, pour que je ne vous quitte pas.
—Mais, mon enfant, si je te l’ordonnais?
—Oh! alors, je vous fermerais la bouche avec un baiser.»
A ces mots, il jeta ses bras autour du cou du digne ecclésiastique, et l’embrassa avec force; mais, en même temps, il dévora une larme en silence, car revenu tout à coup au sentiment de leur position réelle, il se rappela l’horrible scène des Champs-Élysées.
L’abbé Capdeville eut beau insister pour qu’il partît, Tomy demeura inébranlable; et c’était la première fois qu’il se montrait sourd aux prières de son bienfaiteur.
Les détenus passèrent la nuit à prier.
Le lendemain matin, la première nouvelle qu’ils apprirent, fut que trente prêtres venaient d’être égorgés à l’Abbaye. Cette nouvelle jeta la consternation aux Carmes; tous les visages pâlirent, les yeux se mouillèrent; il se fit un silence glacial pendant quelques secondes. La terreur, ce premier sentiment de l’homme sans défense, venait de s’emparer de tous ces vénérables ecclésiastiques. L’archevêque d’Arles lui-même, assis dans un fauteuil devant l’autel, à cause de son grand âge et de sa dignité, avait la tête tristement penchée sur sa poitrine; près de lui, l’abbé Capdeville fixait ses yeux humides sur Tomy, qui pleurait à chaudes larmes, accroupi sur les marches de l’autel: c’était une scène de silencieuse terreur et de désolation.
Soudain une rumeur lointaine s’élève; tous les ecclésiastiques tressaillent et prêtent l’oreille avec un redoublement d’effroi. Cette rumeur devint bientôt plus distincte; il n’y a plus à douter qu’elle ne soit causée par un rassemblement de peuple qui se dirige sur les Carmes; alors l’archevêque se lève avec effroi, et, d’une voix émue, il adresse une courte exhortation à ses compagnons d’infortune, puis il récite les prières des agonisants; la voix des prisonniers agenouillés lui répond au milieu des soupirs, des larmes, et surtout de la terrible rumeur qui croissait de minute en minute.
Tomy surtout, Tomy, en ce moment suprême, était affreusement agité, non de crainte pour lui, mais pour son père adoptif. Il parcourait l’église comme un fou, cherchant à trouver une issue; puis, épuisé, haletant, il revenait près du digne abbé, et lui disait avec un désespoir insensé: «Nous sommes perdus! ô mon père! sauvez-vous! cachez-vous! fuyez, voici une croisée, votre bras est fort, vous pourriez en arracher les barreaux. Au nom du ciel, que je ne vous voie pas massacrer... Horreur! horreur!... Cette pensée me glace, cette pensée me tue!»
Et ses yeux étaient hagards; et il couvrait l’abbé de caresses frénétiques; et celui-ci cherchait en vain à calmer son désespoir. «Enfant, lui dit-il enfin, il est des jours d’épreuve qu’il faut savoir subir avec courage. Si ma dernière heure est venue, laisse-moi la passer avec résignation. Ta douleur me fait mal. Le ciel t’avait envoyé vers moi pour dernière faveur; je l’en remercie encore: s’il trouve que j’ai assez vécu, je me résigne. Mais toi, pauvre Tomy, écoute ma dernière prière. Va frapper à la porte de cette prison; les geôliers t’ouvriront, te laisseront sortir, car on n’a pas donné l’ordre de te renfermer. Va, j’ai fait un testament qui t’assure le peu que je possède; vis donc dans l’amour du Seigneur et dans le souvenir de celui qui t’aimera jusques dans les cieux. Mais hâte-toi, pars, laisse-moi...
—Jamais! s’écria Tomy.
—Et moi je le veux! reprit le vénérable prêtre, en l’entraînant vers la porte de l’église.»
Au même instant, la porte s’ouvrit, et un geôlier parut.
«J’ai pensé à toi, petit fou, dit-il en s’adressant à Tomy, et je viens te dire de sortir, car il pourrait bien t’arriver malheur ici.
—Quel est ce bruit? demanda Tomy.
—C’est le peuple qui accourt furieux.
—Est-ce qu’il va pénétrer dans cette enceinte?
—Sans doute. Allons, sors vite, car ils ne sont point à dix pas d’ici.
—Faites sortir mon père à ma place, reprit Tomy en se jetant aux pieds du geôlier.
—Impossible.
—Je vous en supplie! s’écria l’enfant en lui prenant les mains et les mouillant de larmes.
—Impossible, te dis-je! allons, suis-moi, si tu veux.
—Fuis, Tomy, va-t’en, ajouta M. Capdeville en le poussant violemment sur les pas du geôlier.»
Mais l’enfant, se dégageant aussitôt de l’étreinte du prêtre et courant au fond de l’église: «Je resterai,» dit-il d’une voix résolue.
Le geôlier sortit. Peu de minutes après, un bruit épouvantable retentit comme des éclats de tonnerre; les portes s’ouvrirent avec fracas, et des hommes furieux se précipitèrent dans l’église à flots pressés; la dalle fut, en un clin d’œil, jonchée de cadavres...
Tomy était tombé évanoui pendant cet horrible massacre.
Quand le pauvre enfant reprit ses sens, l’autel était brisé, l’église silencieuse. Un seul homme en troublait la solitude: c’était le geôlier qui fouillait les victimes d’un air impassible.
«Bon, se dit-il, il paraît qu’il en est réchappé, lui; il peut se vanter d’être le seul;» puis il continua son exploration.
Tomy se leva sur son séant; il resta quelque temps immobile, l’œil stupide; il paraissait n’avoir conservé aucun sentiment, aucun souvenir de ce qu’il avait vu. Si la vie lui était revenue au cœur, le réveil de l’intelligence se faisait lentement. Il ne tarda pas à porter la main à son front, à promener un regard vague autour de lui; mais les objets qui se présentaient à sa vue, ne semblaient lui apporter aucune idée, au moins distincte: ni le geôlier qui le regardait, ni l’église où il se trouvait, ni les cadavres qui l’entouraient. Ses oreilles ne furent pas plus intelligentes; en vain les bruits de l’extérieur venaient mourir dans cette enceinte, comme des flots sur la grève: bruits de peuple, bruits de cloches, bruits de tambours, bruits de toute une ville profondément agitée, bruits d’un volcan qui fait éruption,... il ne parut rien saisir, rien comprendre, et les premières paroles que sa bouche prononça, furent celles-ci: «Où est mon ami?...» et encore les prononça-t-il en souriant. Il était fou!
«Est-ce que tu es blessé?» dit le geôlier, en voyant qu’il ne se levait pas.
Tomy le regarda sans le comprendre. Puis, loin de répondre à sa question, il se releva, et lui dit d’un air inquiet:
«N’auriez-vous pas vu mon ami, monsieur?
—Qu’est-ce que tu dis?
—Je demande si vous ne pouvez pas m’indiquer où est mon ami?
—Mais, mon pauvre enfant, si tu veux parler de l’homme qui te pressait tant de partir ce matin, je ne puis que te répondre: Il est là, parmi les morts, cherche!
—Ah! quel bonheur! s’écria Tomy d’un air enjoué; il est là, je vais le revoir; je craignais tant de ne plus le retrouver; car, lorsqu’il m’a quitté, il était un peu fâché contre moi.»
Et il se prit à regarder autour de lui; puis son regard s’arrêta avec une vive expression de joie sur le cadavre du malheureux Capdeville, qui avait la tête appuyée sur une marche supérieure de l’autel, le corps sur celles du dessous; le coup qui lui avait donné une mort rapide, n’avait pas effacé l’expression habituelle de bienveillance répandue sur sa physionomie; il semblait sommeiller.
«Je crois qu’il dort, dit Tomy, ne l’éveillons pas.» Puis il s’approcha de lui sur la pointe des pieds, retenant sa respiration, réprimant parfois un pas trop brusque, imposant silence de la main, lorsqu’il croyait entendre quelque bruit, et s’agenouilla à côté de son protecteur:
«Pauvre fou! se dit le geôlier qui le suivait des yeux.
—Taisez-vous, murmura Tomy, en lui lançant un regard de colère; allez vous-en, vous êtes un méchant homme, vous qui cherchez à troubler le sommeil de mon ami. Vous feriez mieux de fermer cette fenêtre, car le vent agite ses cheveux.»
En même temps, il dirigea sur cette fenêtre ses grands yeux bleus. Un arbre lui formait un rideau à l’extérieur; cet arbre bruissait: une fauvette chantait dans son feuillage.
«Vent qui souffle, murmura Tomy, arbre qui frissonne, fauvette qui chante! vous avez de bien douces mélodies, et nous vous avons souvent et religieusement écoutés, mon ami et moi, sous les ombrages du Luxembourg; mais celui qui vous aimait tant a besoin de sommeil aujourd’hui, je crains que vous ne troubliez son repos. Suspendez vos doux accents; taisez-vous tous, maintenant, jusqu’à ce que vous puissiez reprendre votre symphonie pour saluer le réveil de celui qui est notre maître à tous.»
A ces mots il se tut, et parut attendre que le vent, l’arbre et la fauvette en fissent autant; mais voyant que sa prière n’était pas entendue:
«Au fait, dit-il en soupirant, cela berce peut-être son sommeil, et sert ainsi à prolonger les doux songes que le ciel lui envoie. S’il en est ainsi, merci à vous, chantres de la nature; si j’osais, j’unirais ma voix à la vôtre; mais il me semble, reprit-il tout à coup, que tu dois avoir froid, mon père, ton visage est pâle, ta main glacée..... Ah! vite, dépouillons-nous. Mon petit habit n’est pas si chaud que ta soutane dont tu m’as couvert, il y a longtemps, dans une église; mais je n’ai pas mieux que mon petit habit, il te réchauffera du moins les pieds.»
Et aussitôt il ôta ce vêtement et en emmaillota les pieds du pauvre prêtre.
«Et tes cheveux blancs, les voilà qui voltigent sur ton front, au gré du vent,» reprit-il.
Et il dénoua sa cravate et la lui mit avec précipitation sur la tête; puis il l’embrassa et dit à voix basse: «A présent, dors bien, mon ami, et moi je vais veiller!»
Le pauvre fou s’assit et resta silencieux, près du cadavre, jusqu’au soir. Déjà l’ombre se projetait dans l’église; le geôlier revint voir si Tomy voulait sortir.
«Il ne se réveille pas, lui répondit-il avec tristesse. L’heure se passe d’arroser mes fleurs, d’aller me promener au Luxembourg et de faire un peu de musique.»
Puis, prêtant l’oreille à ce bruit d’airain, qui depuis longtemps frappait l’air; «Ah! dit-il, voilà au moins neuf heures qui sonnent.»
Hélas! Tomy se trompait; ce n’était pas l’heure qui sonnait, mais le tocsin funèbre.
«Je vais encore attendre, dit Tomy au geôlier, ou plutôt, pour le réveiller doucement, je vais lui chanter une romance dont lui-même a composé les paroles et la musique; vous allez voir comme elle est touchante!»
Mais au même instant, frappé d’une soudaine réflexion, il reprit: «Veillez un peu à ma place, je vais aller chercher ma harpe; vous comprendrez mieux la beauté de ce chant avec accompagnement.[3]»
A ces mots il sortit, en courant, de l’église, et revint bientôt, portant sa harpe et quelques fleurs. Il effeuilla les fleurs autour de son ami, et, s’accompagnant sur sa harpe, il chanta.
Plusieurs hommes du peuple venaient d’entrer dans l’église pour enlever les cadavres. Saisis de la beauté de ce chant, ils suspendirent leurs travaux pour l’écouter.
Jamais, peut-être, voix aussi douce, aussi pure, jamais musique aussi simple, aussi mélodieuse, ne s’étaient élevées sous la nef de cette église. Le pauvre fou fit passer toute son âme dans son chant, et les larmes qui, par instants, lui roulaient dans la voix, se communiquèrent aux yeux des hommes du peuple qui l’écoutaient.
«Pauvre enfant! disait l’un.
—C’est que c’est beau ça, au moins, ajoutait un autre.
—J’en pleure comme une bête! répliquait un troisième.
—Quel malheur qu’il soit fou, dit le geôlier, il ferait un fameux chanteur!»
Tomy, en effet, était sublime; il mit tant d’expression dans la dernière strophe de son chant, que la pâleur de son visage, inondé de pleurs, devint effrayante, et qu’il tomba de faiblesse sur les degrés de l’autel.
Les hommes du peuple l’emportèrent chez le geôlier, où on lui prodigua les soins plus touchants. Il prit un peu de nourriture, et dormit quarante-huit heures d’un sommeil léthargique dont il sortit avec toutes les apparences de la santé et de la raison; mais, si la première lui fut conservée quelque temps encore, l’autre ne lui fut jamais rendue.
Par commisération pour sa pieuse démence, on lui accorda une résidence dans la maison des Carmes. Il y restait en silence jusqu’à ce que chaque journée ramenât la troisième heure du soir. Aussitôt qu’elle sonnait, Tomy, qui se promenait d’ordinaire avec lenteur, courait chercher sa harpe; puis il allait s’appuyer contre les débris de l’autel, et jouait les airs qui plaisaient à son ami...
A six heures, il terminait brusquement, s’agenouillait et paraissait examiner quelque chose avec une douloureuse anxiété; puis il se levait en soupirant, se retirait avec précaution, et disait à la première personne qu’il rencontrait sur son passage:
«Il dort encore aujourd’hui, mon ami; je crois qu’il ne se réveillera que demain.»
Et c’est ainsi qu’il attendit, de jour en jour, que son bienfaiteur sortît de son sommeil et lui fût rendu.
Mais une année s’était à peine écoulée; à l’heure désignée, on ne vit plus revenir le petit élève de l’abbé Capdeville. La nef de l’église des Carmes ne répéta plus le son de sa voix si douce, de sa harpe si expressive, les marches de l’autel ne furent plus semées de fleurs effeuillées, Tomy s’était lassé d’attendre un réveil qui n’arrivait pas.
Il s’était endormi du sommeil de son ami.

|
A cette époque de lugubre mémoire de la révolution française, la populace donnait, par forme de mépris, le nom d’aristocrate à quiconque était soupçonné d’être noble ou d’aimer le roi et la monarchie. |
|
Historique. |
Découverte et Mission du Paraguay.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| Qu’on juge de la surprise de ces hommes en trouvant Maldonata pleine de vie..... | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Sébastien Cabot, fameux navigateur du quinzième siècle, venait de découvrir la grande île de Terre-Neuve et une partie du continent voisin, pour le compte de Henri VII, roi d’Angleterre. Ce prince avait beaucoup trop à faire dans son royaume avec les intrigues suscitées par l’apparition d’un faux duc de Warwik et par celle de l’imposteur Perkins, se disant fils d’Édouard IV, pour pouvoir songer à créer des établissements dans le Nouveau-Monde; il négligea donc de répondre aux demandes de Sébastien: celui-ci, lassé des délais continuels qu’on lui opposait, courut en Espagne où Charles-Quint mit à sa disposition une flotte, avec le titre de grand pilote de Castille.
Sébastien Cabot mit à la voile le 1er avril 1526; il arriva à l’embouchure d’un grand fleuve nommé alors Rio de Solis, le remonta jusqu’à la hauteur de trente lieues, et bâtit en cet endroit une forteresse où il laissa garnison; puis, continuant de remonter toujours le fleuve, il parvint au confluent du Paraguay et du Parana. Une fois entré dans le fleuve Paraguay, il rencontra plusieurs peuplades d’Indiens, se battit avec les unes, fit alliance avec les autres qui lui fournirent des vivres, et lui livrèrent une grande quantité de lingots d’argent en échange d’objets de peu de valeur. Ne doutant pas que ce pays n’eût d’abondantes mines d’argent, il donna au fleuve le nom de Rio de la Plata (rivière de l’argent), et retourna en Europe chargé de richesses, après avoir laissé là quelques Espagnols sous la conduite d’un officier, nommé Meschera. Ses récits, et plus encore la vue du brillant métal qu’il avait rapporté, disposèrent la cour d’Espagne à poursuivre la découverte du Paraguay. Mais ici, comme pour Christophe Colomb, les envieux firent naître des obstacles; et, sept ou huit ans après son retour, Sébastien mourut du chagrin de voir ses projets tombés dans l’oubli.
Cependant Charles-Quint était trop habile pour laisser ainsi perdre l’occasion d’accroître sa puissance; il donna ordre d’armer à Cadix une flotte de quatorze vaisseaux, commandée par don Pèdre de Mendoze, son premier échanson, qu’il créa gouverneur général de tous les pays qui seraient découverts jusqu’à la mer du Sud. Une foule de grands seigneurs l’accompagnèrent; aucune colonie espagnole ne compta autant d’illustres noms parmi ses fondateurs que celle du Paraguay. La flotte, pourvue de provisions de toute espèce pour un an, mit à la voile au mois d’août 1535, saison la plus favorable au voyage, et arriva heureusement à l’embouchure de Rio de la Plata. La salubrité du climat détermina don Pèdre à former un établissement en ce lieu; il fit aussitôt tracer le plan d’une ville, qui fut nommée Buenos-Ayres. Tout le monde s’empressa d’aider au travail, et bientôt les édifices furent assez nombreux pour servir de camp. Mais les naturels du pays ne purent voir de bon œil un établissement étranger si près d’eux; ils refusèrent des vivres; il fallut avoir recours aux armes pour en obtenir; il y eut plusieurs combats dans lesquels les Espagnols furent très-maltraités, et la disette devint extrême à Buenos-Ayres. Don Pèdre avait perdu une partie de ses meilleurs officiers; il craignait d’accoutumer les Indiens à verser le sang espagnol; en conséquence il défendit, sous peine de mort, de passer l’enceinte de la nouvelle ville; et, craignant que la faim ne fît enfreindre ses ordres, il mit des gardes de toutes parts, en leur enjoignant de tirer sur ceux qui chercheraient à sortir. Cette précaution contint tout le monde, excepté une seule femme, qui parvint à tromper la vigilance des sentinelles. Cette femme, nommée Maldonata, n’avait pu se procurer le moindre aliment; depuis deux jours, elle était en proie à une faim cruelle, elle allait mourir... que lui importaient les coups des soldats!... en fuyant la ville, elle fuyait une mort certaine... elle avait l’espoir d’échapper à la surveillance, elle se décida à braver les ordres du gouverneur. Maldonata parvint à passer les lignes. Après avoir erré, tout le jour, dans des champs déserts et avoir apaisé sa faim au moyen de quelques racines et de fruits sauvages, elle découvrit une caverne profonde qui lui parut une retraite sûre contre toutes les recherches; mais, ô terreur! à peine a-t-elle mis le pied sur le seuil qu’elle se trouve en face d’une énorme lionne dont la vue glace son sang d’une frayeur mortelle... Elle n’ose avancer... elle n’ose fuir dans la crainte d’être poursuivie par l’animal furieux... l’infortunée demeure immobile en proie à une affreuse angoisse... tandis que l’animal, qui semble avoir deviné ce qui se passe dans son âme, s’avance en rampant à ses pieds, poussant des gémissements douloureux, et vient lécher les mains de Maldonata stupéfaite. En examinant la lionne, elle reconnut bientôt qu’elle était pleine et ne pouvait mettre bas; elle semblait, par ses caresses, demander un service que Maldonata ne craignit point de lui rendre: elle la délivra heureusement.
Le lendemain, la lionne sortit pour chercher sa nourriture; et, jamais depuis ce jour, elle ne manqua d’apporter aux pieds de sa libératrice le produit de sa chasse, qu’elle partageait avec elle. Ce soin dura aussi longtemps que ses petits la retinrent dans la caverne; mais ils devinrent forts, la famille courut dans les forêts voisines; et Maldonata, réduite à chercher sa subsistance elle-même, ne put sortir, à plusieurs reprises, sans rencontrer enfin des Indiens, qui la firent esclave. Ceux-ci, à leur tour, ayant été attaqués à l’improviste par les Espagnols, Maldonata, reprise, fut conduite à Buenos-Ayres. Malheureusement pour elle, don Pèdre en était sorti; celui qui commandait à sa place, homme dur jusqu’à la cruauté, savait que cette infortunée avait violé une loi capitale, et ne la crut pas assez punie par les périls qu’elle avait courus; il donna ordre qu’elle fut liée à un arbre en pleine campagne, pour mourir du mal dont elle avait voulu se garantir par sa fuite, ou pour y être dévorée par les bêtes féroces. En vain essaya-t-on de supplier pour elle; l’inflexible gouverneur ne voulut rien entendre, Maldonata fut conduite sur le lieu de son supplice et liée au tronc d’un arbre. Deux jours après, le commandant, voulant savoir ce qu’elle était devenue, envoya quelques soldats auprès d’elle. Qu’on juge de la surprise de ces hommes en trouvant Maldonata pleine de vie, quoique environnée de tigres, de jaguars et de panthères qui n’osaient s’approcher d’elle, parce qu’une belle lionne et ses lionceaux étaient à ses pieds, et semblaient la défendre de leurs attaques. A la vue des soldats, la lionne se retira un peu, comme pour leur laisser la liberté de délier sa bienfaitrice. Maldonata, questionnée par eux, leur dit qu’à peine l’avaient-ils quittée, elle avait vu accourir à elle cette lionne, suivie de ses lionceaux; elle s’était crue perdue, lorsqu’à sa grande surprise, la lionne, après l’avoir flairée, l’avait couverte des plus tendres caresses et s’était couchée à ses pieds comme un chien fidèle; elle avait alors reconnu sa lionne de la caverne, dont elle leur raconta l’aventure. Les soldats, émerveillés de ce récit, détachèrent les liens de Maldonata, et se disposèrent à la conduire à Buenos-Ayres, quand la lionne, après l’avoir beaucoup caressée, se retira lentement, non sans retourner souvent la tête, comme pour lui témoigner ses regrets de la perdre. Lorsque Maldonata fut arrivée à la ville, et que le commandant eut entendu ce rapport, il comprit qu’il ne pouvait être plus cruel que des lions; il accorda la grâce à cette femme, dont le ciel avait si visiblement protégé la vie, et lui fit donner quelques secours.
Don Pèdre de Mendoze, pour aviser aux moyens de faire cesser cette terrible famine, avait remonté le Rio de la Plata jusqu’au fort bâti par Cabot; là, il fit alliance avec deux nations indiennes, les Timbuers et les Caracoas; il donna ordre à l’un de ses lieutenants de continuer les découvertes le long du fleuve, et lui laissa à cet effet des barques et cinquante hommes, au nombre desquels don Louis Perez, frère de l’ordre de Sainte-Thérèse; puis il retourna à Buenos-Ayres, où il eut bientôt le bonheur de voir arriver des secours d’Europe, qui ne laissèrent plus que le souvenir des horreurs de la famine passée. Les lieutenants de don Pèdre, Gonzalès et Saluzar, s’étant avancés le long du Paraguay, trouvèrent une espèce de port, formé par un cap avancé au sud; la situation leur en parut si commode, qu’ils se décidèrent à y bâtir un fort et une ville à laquelle ils donnèrent le nom d’Assomption, qu’elle porte encore. Gonzalès y demeura seul, et Saluzar partit pour aller rendre compte de son voyage à don Pèdre; mais il ne le retrouva plus à Buenos-Ayres, et la ville était retombée dans une disette extrême, par suite d’une guerre malheureuse que les Espagnols avaient eue à soutenir contre les Indiens, et qui les avait cruellement affaiblis. Toutefois, ranimés bientôt par l’arrivée de deux navires de leur nation, ils remportèrent une éclatante victoire, due à ce que leurs ennemis crurent voir, pendant le combat, un homme vêtu de blanc, l’épée nue à la main, jetant une lumière qui les avait éblouis. Les Espagnols ne doutèrent pas que ce ne fût saint Blaise, dont on célébrait la fête le même jour; aussi choisirent-ils ce saint pour protecteur de la province. Malgré ces avantages, la difficulté de subsister au milieu de peuplades ennemies, fit longtemps languir la colonie de Buenos-Ayres; cette ville demeura quarante ans déserte, et ce ne fut qu’en 1580 que don Juan d’Ortez, alors gouverneur du Paraguay, fit rebâtir la ville qui tombait en ruines.
Saint Ignace de Loyola venait de mourir, après avoir fondé cette Société de Jésus dont le nom devait être si célèbre dans la suite des temps. A peine à son aurore, elle avait donné des hommes recommandables par leurs talents supérieurs, dans tous les genres, et par leur zèle pour la propagation de notre sainte religion. Les jésuites étaient établis, depuis trente ans, au Brésil, et depuis peu au Pérou. Déjà ils avaient fait de nombreuses conversions, et partout on disait hautement que ce nouvel Ordre avait reçu du ciel une mission spéciale et une grâce particulière pour établir, dans le Nouveau-Monde, le royaume de Jésus-Christ.
Trois missionnaires jésuites arrivent du Brésil à Buenos-Ayres, et bientôt la ville change de face; ils apprennent aux habitants à faire des briques, des carreaux, de la chaux, et la ville sort du sol comme par enchantement; des édifices majestueux, de larges rues tirées au cordeau viennent l’embellir et ajouter à sa commodité. Mais tous les avantages de ces établissements se bornaient à la pacification des petits pays environnant la ville; le reste de cette vaste et belle contrée, situé entre le Chili, le Pérou et le Brésil, était couvert de nations indigènes qui, à la vue des soldats espagnols, avaient abandonné le pays, et s’étaient retirés dans des montagnes inaccessibles, dont les chemins étaient inconnus; plusieurs détachements avaient tenté d’y pénétrer, et tous avaient été détruits par la famine ou la flèche des sauvages; les Guaranis surtout, peuple nombreux et puissant, avaient rompu toute communication avec les Espagnols; les terres étaient incultes, et la colonie, réduite à tirer ses ressources d’Europe, ne pouvait prospérer. Elle était dans ce triste état au commencement du dix-septième siècle, lorsque l’Espagne envoya pour gouverneur don Fernand de Pedreras, homme dur, avare, dont le caractère n’était guère propre à ramener les Guaranis. Fier et despote, l’avarice et l’orgueil remplissaient son cœur; il devint bientôt odieux aux colons, et redouté du peu d’Indiens qui venaient apporter des vivres; ceux-ci, fatigués de ses vexations, ne tardèrent même pas à aller rejoindre les Guaranis.
Au nombre des derniers missionnaires arrivés à Buenos-Ayres, se trouvait un jésuite nommé Maceta, dont les vertus étaient dignes de la haute mission qui lui était confiée. Jamais la parole d’un dieu de paix et de bonté ne fut prêchée par une bouche plus digne; jamais prêtre ne fut plus pénétré de ses pieux devoirs. Sa vie entière s’était écoulée à soulager l’humanité. Riche d’un patrimoine considérable, il l’avait dissipé peu à peu en le partageant aux infortunés; il vieillit en donnant, et lorsqu’il s’aperçut enfin à soixante ans qu’il ne lui restait rien, il demanda à être envoyé en Amérique: «Je ne puis plus rien donner, disait-il, je veux quitter un pays où je vois des pauvres. Au Pérou, tout le monde a de l’or, mais l’Évangile leur manque, je vais le leur porter, et c’est encore un beau présent que je vais leur faire.»
En arrivant à l’Assomption, où on l’envoya, le bon jésuite fut surpris de trouver des chrétiens à consoler, au lieu des Indiens qu’il venait convertir; son zèle s’en accrut; il s’empressa de les visiter, écouta leurs plaintes, soulagea leurs peines, et devint leur avocat auprès du terrible gouverneur. Maceta était béni de tous, respecté même de Pedreras, qui paraissait plus doux depuis son arrivée.
Un jour, il se promenait seul assez loin de la ville, en suivant le bord du fleuve; soudain, il entend des cris, des sanglots, et distingue sur le rivage un enfant nu, qui s’agitait auprès d’un homme couché sur le sable; Maceta court à cet enfant; il est âgé d’environ treize ans, son visage est baigné de larmes; il embrasse en gémissant, il soulève de ses faibles mains, il cherche à réchauffer par ses baisers le corps immobile d’un homme de trente à quarante ans, nu comme lui, souillé de limon, les cheveux en désordre et portant sur son visage pâle les marques d’une longue fatigue et d’une mort pénible. Dès que l’enfant aperçut le jésuite, il courut à lui, se mit à genoux, et, serrant avec force les mains de Maceta, il lui dit quelques paroles entrecoupées, qui attendrirent vivement le bon père; celui-ci relève aussitôt l’enfant, va vers le corps, qu’il examine et qu’il craint de ne pouvoir rappeler à la vie. Le malheureux enfant contemplait le jésuite; jugeant à son air triste que toute espérance était perdue, il se jette sur le corps, le baise mille fois, et, se relevant tout à coup, prend sa course pour se précipiter dans le fleuve. Malgré son âge, Maceta, plus fort que l’enfant, l’arrête et le retient dans ses bras; il ne songe pas que le jeune sauvage ne peut l’entendre, il cherche à le calmer par de consolantes paroles. Comme il versait des larmes, l’enfant le comprenait; la pitié est une langue entendue de tous les peuples! Il lui rendait ses caresses, il lui montrait toujours le corps, et mettait la main sur son cœur en prononçant le nom d’Alcaïpa, Maceta comprit bien que le sauvage était son père, et se disposait à courir chercher des secours à la ville, quand heureusement il vit passer un soldat; il le charge d’aller à l’Assomption demander le chirurgien de l’hôpital. Celui-ci arrive bientôt, examine le corps, et, trouvant un reste de chaleur, il propose de faire transporter le sauvage à l’hôpital. Maceta s’y oppose; il craint la dureté du gouverneur, et ne veut confier à personne qu’à lui le soin des infortunés que la Providence a remis à sa garde. Le soldat et le chirurgien forment, avec des branches, une espèce de brancard, y posent le sauvage, et, suivis de Maceta et de l’enfant, arrivent à l’Assomption.
Bientôt le sauvage est rendu à la vie; témoin, chaque jour, de la bonté du jésuite, il écouta avec fruit ses instructions religieuses, et demanda à être baptisé, ainsi que son fils. Maceta, au comble de la joie, disposa tout pour l’auguste cérémonie qui devait donner deux âmes à Dieu, et pria Alcaïpa de lui apprendre comment il avait été réduit à l’état dans lequel il l’avait trouvé: «Mon père, je vois que tous tes frères te donnent ce nom, lui dit-il; tu le mérites, car tu es le meilleur des hommes, et tu es pour moi un père, puisque sans toi je ne verrais pas ce jour qui nous éclaire. Je suis un des chefs de la puissante nation des Guaranis que tes frères, les Espagnols, ont forcé de quitter ces fertiles plaines. Une nation de Brasiliens, qu’ils ont sans doute chassée, est venue nous attaquer dans nos forêts; nous nous sommes battus; les Brasiliens ont été vainqueurs. J’ai été obligé de fuir: nous avons construit à la hâte un canot d’écorce, et nous nous sommes embarqués sur le grand fleuve sans savoir où nous arrêter, car les Brasiliens étaient derrière nous, et nous tremblions d’avancer vers les Espagnols. Le fleuve était débordé et roulait de grands arbres; notre canot se renversa; je soutins mon fils d’une main et nageai de l’autre; mais la rapidité du courant m’emportait, je me sentais affaibli, et j’arrivais à l’endroit où le fleuve élargi forme une mer; je redoublai d’efforts, je traversai le fleuve et tombai sur le sable en y déposant mon enfant: tu arrivas bientôt après, mon père, et tu sais le reste.»
Maceta, ému en entendant ce récit, se livrait à ce charme si doux qui accompagne la bienfaisance; il comblait de bontés Alcaïpa et son jeune fils, dont l’âme pure et naïve s’attachait vivement au souvenir de son père, lorsqu’au bout de quelque temps l’avide Pedreras, ayant appris que le jésuite avait sauvé et recueilli un chef des Guaranis dans sa maison, envoya l’ordre à Maceta de se rendre sur-le-champ près de lui: ce que fit Maceta, non sans crainte. Pedreras ne tarda pas à lui enjoindre de chercher à obtenir d’Alcaïpa le secret des chemins conduisant aux montagnes habitées par les siens. «Quand vous le saurez, lui dit-il, vous vous y rendrez suivi de troupes qui soumettront alors cette nation, la plus belliqueuse du Paraguay, et dont le sol possède les plus riches mines d’or et d’argent: ainsi vous aurez bien mérité du roi d’Espagne. Allez, vous connaissez ma volonté, vous me répondez, sur votre tête, d’Alcaïpa.»
Le bon jésuite, atterré par cette déclaration, reprit tristement le chemin de sa maison où, à peine arrivé, ses hôtes ne tardèrent pas à s’apercevoir de sa tristesse. Maceta, questionné par Alcaïpa, lui raconta l’action infâme qu’exigeait Pedreras, en ajoutant qu’aucune menace ne lui ferait trahir les devoirs de l’hospitalité et de l’humanité; il sentait trop quels malheurs fondraient sur les Guaranis, s’il les livrait à la cruauté et à l’avarice des Espagnols: «Mes enfants, leur dit-il, le péril est grand! je ne puis ni ne dois obéir; si je refuse, je deviens suspect, et le gouverneur est capable de tout: nous n’avons qu’un parti à prendre, c’est de fuir tous ensemble chez les Guaranis. Je vous suivrai, mes enfants; oui, je vous suivrai, j’irai, la croix à la main, prêcher les frères d’Alcaïpa; je les convertirai comme je l’ai converti; je remplirai mon devoir et servirai mon Dieu en lui donnant des hommes.» Alcaïpa et son fils se jettent dans les bras de Maceta: ils concertent leur fuite.
Et dès que les ténèbres voilent la terre, Alcaïpa, muni d’un canot dans lequel ils s’embarquent tous trois, remonte le fleuve jusqu’à l’entrée des montagnes; là, descendant au milieu des bois, il submerge son canot, suit des sentiers déserts et arrive au milieu des Guaranis: il y fut reçu avec joie, et se hâta de dire aux siens ce qu’il devait à Maceta. Les sauvages accablèrent le jésuite de caresses et de présents; tous voulurent travailler à la cabane du bon père et à celle de leur chef: ces cabanes furent construites sur de grands arbres où l’on parvenait, par une poutre taillée, que l’on retirait dès qu’on était monté. (Précaution bien nécessaire contre les tigres et les inondations.) Maceta, chéri d’un peuple doux, prêcha avec succès la religion chrétienne, et convertit aisément ces âmes simples qui admiraient ses vertus: tous les Guaranis se firent baptiser.
Au bout de peu de temps, ils demandèrent eux-mêmes au bon père de faire venir d’autres jésuites, et se soumirent volontairement au roi d’Espagne, à condition qu’il n’enverrait chez eux que les collègues de Maceta; ils s’engagèrent en outre à payer un écu d’or, par tête, d’imposition annuelle. La cour de Madrid accepta cette proposition. Les missionnaires, se distribuant la tâche, donnèrent l’exemple des plus hautes vertus; ils rencontrèrent souvent des obstacles; mais le roi d’Espagne les soutint par sa protection, et leur constance triompha de tout. Sur la foi du traité, les Guaranis se rapprochèrent de l’Assomption et se partagèrent en plusieurs peuplades, dont chacune bâtit son bourg où un jésuite, devenu curé, les instruisit dans l’agriculture et les gouverna paternellement.
Pendant le cours de leurs prédications, les jésuites avaient observé qu’une des choses qui éloignaient le plus les Indiens de la religion, était la manière relâchée dont vivaient les anciens chrétiens: ils prirent en conséquence la résolution d’empêcher qu’aucun étranger ne s’immisçât dans leurs missions du Paraguay; ils formèrent une espèce de république chrétienne dont les vertus et l’union rappelaient les beaux jours du christianisme naissant. Chaque peuplade avait son arsenal particulier où étaient renfermées les armes qui servaient dans les cas où la guerre était indispensable, soit contre les Portugais dont les établissements du Brésil étaient très-rapprochés, soit contre les nations du voisinage: c’étaient des fusils, des épées et des baïonnettes. Tous les soirs des jours de fête, on apprenait la manière de s’en servir par des exercices publics, et la milice s’assemblait, tous les lundis, pour manœuvrer et passer en revue devant un cacique ou chef de guerre. On avait établi des prix pour ceux qui se distinguaient dans les diverses armes: aussi ces jeunes soldats devinrent d’excellentes troupes qui battirent les Portugais en plusieurs occasions. Dans toutes les bourgades, il y avait des écoles gratuites où l’on apprenait à lire, écrire, chanter, danser, peindre et jouer des instruments: on y faisait d’excellents élèves, parce que le curé, qui surveillait les travaux, prenait soin de consulter le goût et les dispositions des jeunes gens avant de les admettre. Enfin rien ne manquait aux Guaranis de ce qu’on trouve dans nos villes, si ce n’est le vice et la pauvreté. Le curé veillait à l’exécution des lois qui n’étaient ni nombreuses ni sévères, les plus grands châtiments se réduisant au jeûne et à la prison; encore ces châtiments étaient-ils rares chez un peuple innocent, paisible, n’ayant aucune idée du vol et du meurtre, conservant cette heureuse ignorance, grâce aux soins que prenaient les jésuites de ne laisser pénétrer aucun étranger dans le pays.
Les bourgades des Guaranis occupaient un grand territoire généralement situé au bord d’un fleuve et sur un beau site; les maisons étaient bien bâties, commodes, et si bien meublées que celles des Espagnols ne pouvaient leur être comparées; les églises étaient grandes, ornées de beaux tableaux et de somptueuses tentures; elles avaient, chacune, leur chapelle de musique composée de chanteurs et d’instruments, et le service divin s’y célébrait avec la même pompe que dans les cathédrales d’Espagne. Des avenues de grands arbres, formant des arcades de verdure, partaient de l’extrémité des rues, allant aboutir à d’autres chapelles bâties dans la campagne: ces monuments religieux servaient de point de repos aux processions les jours de grandes solennités, et surtout à celle de la Fête-Dieu qui se faisait avec une pompe dont nous ne pouvons nous faire une idée en France, et dont les cérémonies, usitées en Espagne et en Italie, ne donnent qu’une image imparfaite.
Dès la veille, on allumait des feux de joie, les rues étaient illuminées, sablées et jonchées de fleurs et de verdure; les enfants dansaient, car les jésuites avaient l’habitude de faire accompagner ces fêtes par des danses: ils avaient, à cet effet, des habits particuliers couverts d’or et de pierreries. Le lendemain, aussitôt que l’aurore avait annoncé la fête du roi de l’univers, les maisons se couvraient de riches tapis; les cloches et le bruit du canon appelaient à l’église la troupe des fidèles, et le cortège commençait à défiler. On voyait, en avant, la milice précédée par le cacique de guerre, monté sur un superbe cheval, couvert d’un dais que des cavaliers soulevaient à ses côtés; les magistrats portant sur leurs épaules les châsses richement ornées contenant les reliques des saints patrons de leurs tribus; les religieux précédés de l’étendard de Jésus-Christ, de cette croix qu’il fit briller autrefois dans les airs pour annoncer au premier empereur chrétien qu’il vaincrait son ennemi; enfin le prêtre, dont les mains soutenaient le radieux saint-sacrement, se montrait sous un dais à l’extrémité de la procession, comme on voit quelquefois briller le soleil à son couchant sur un nuage d’or. Cependant des groupes d’adolescents marchent entre les rangs de la procession; les uns présentaient des corbeilles de fleurs, les autres des vases de parfum: à un signal répété, les choristes se retournaient vers l’image du soleil éternel et faisaient voler des fleurs effeuillées sur son passage. Sur les branches d’arbres qui formaient les arcs de triomphe, sous lesquels passait le saint-sacrement, on voyait voltiger des oiseaux de toutes couleurs qui, attachés par les pattes à de longs fils, paraissaient avoir toute leur liberté; ils mêlaient leur gazouillement au chant des musiciens et du peuple; ils semblaient bénir, à leur manière, celui dont la providence ne leur manqua jamais. D’espace en espace, on voyait des tigres et des lions bien enchaînés, afin qu’ils ne troublassent point la fête, et de très-beaux poissons qui jouaient dans de grands bassins remplis d’eau. En un mot, toutes les espèces de créatures vivantes assistaient à cette fête, comme par députation, pour y rendre hommage à leur Créateur dans son auguste sacrement! On portait les prémices de toutes les récoltes pour les offrir au Seigneur, et le grain qu’on devait semer, afin qu’il le bénît. Des lévites en tunique blanche balançaient l’encensoir devant le Très-Haut; alors des chants s’élevaient sur toute la ligne; celui des oiseaux, le rugissement des lions, le frémissement des tigres, tout formait un concert unique. Mais bientôt le bruit des cloches et le roulement des canons annonçaient que le Tout-Puissant avait franchi le seuil du temple; par intervalles, les voix et les instruments se taisaient, et un silence, aussi majestueux que celui des grandes mers dans un jour de calme, régnait parmi cette multitude recueillie; on n’entendait plus que des pas mesurés sur le sol retentissant.
Dès que le saint-sacrement était rentré dans l’église, on présentait aux missionnaires tous les comestibles qui avaient été exposés sur leur passage; ils faisaient porter aux malades ce qu’il y avait de meilleur; le reste était partagé entre tous les habitants de la bourgade. Rien n’était comparable au bonheur dont jouissaient les fortunés habitants du Paraguay; on ne voyait parmi eux ni procès ni querelles; le tien et le mien y étaient inconnus: car c’est ne rien avoir à soi que d’être toujours disposé à partager le peu qu’on possède avec ceux qui sont dans le besoin. Cet esprit de cruauté et de vengeance, ces vices grossiers qui caractérisent les hordes indiennes, s’étaient transformés en un esprit de douceur, de patience et de chasteté. On jugera de la vertu de ces simples chrétiens par ce qu’écrivait à Philippe V l’évêque de Buenos-Ayres: «Sire, dans ces peuplades nombreuses; il règne une si grande innocence, que je ne crois pas qu’il s’y commette un seul péché mortel. Dans l’espace de cent quarante ans qu’a duré cette république, on trouve à peine l’exemple d’un Indien qui ait mérité la peine du fouet.»
Tel était l’état des célèbres missions du Paraguay au milieu du dix-huitième siècle. Hélas! comme toutes les choses de ce monde, il ne pouvait durer bien longtemps. La politique se chargea de détruire cette félicité si pure. Les Portugais, qui ne voyaient qu’avec jalousie un établissement si prospère, après des agressions continuelles sur les terres du Paraguay, obtinrent de l’Espagne la cession du territoire des missions, en 1757, en échange de la colonie du Saint-Sacrement, située sur le Rio de la Plata, hors des limites du Brésil.
Dix ans après, les jésuites furent chassés de l’Amérique: dès lors le sort des infortunés habitants changea totalement. On les accabla de travail et de mauvais traitements; et maintenant ces sauvages, rassemblés avec tant de fatigue, sont errants dans les bois, ou plongés vivants dans les entrailles de la terre.
Tous le voyez, mes enfants, par ce récit. Quand les hommes sont guidés par la religion... voilà ce qu’ils créent. Lorsque l’esprit de religion les abandonne... voilà ce qu’ils détruisent.


Vous vous rappelez sans doute, mes chers enfants, comment les frères de Joseph s’établirent en Egypte avec toute leur famille. Ils y furent d’abord très-heureux, car le roi les protégeait; et le nombre s’augmenta tellement, qu’ils devinrent un peuple puissant qu’on appela le peuple hébreu. Mais, après la mort de Joseph, il monta sur le trône un autre roi qui leur fit souffrir toutes sortes de persécutions, parce qu’il les craignait beaucoup. Cependant, il avait beau les tourmenter et leur imposer des travaux très-pénibles, ils n’en étaient que plus nombreux. C’est pourquoi, voulant absolument s’en débarrasser, il ordonna aux femmes de jeter tous leurs enfants mâles dans le fleuve du Nil, à mesure qu’ils naîtraient.
Une pauvre mère qui venait d’avoir un fils, ne voulut point obéir à cet ordre barbare; et, l’ayant caché soigneusement, elle le nourrit quelque temps en secret. Hélas! sa tendresse lui devint inutile; l’enfant ne pouvait échapper aux recherches des soldats, et il fallut bien se résoudre à l’abandonner. Elle prit donc une corbeille de jonc, l’enduisit de résine pour que l’eau n’y pût entrer, et y plaça son cher fils; puis elle s’en fut, un matin, au bord du fleuve, et, après avoir écarté de la main les roseaux du rivage, elle y déposa la corbeille en tremblant. «Reste ici, dit-elle ensuite à sa fille; cache-toi derrière ces buissons et veille de loin sur ton frère. Tu viendras m’apprendre ce que tu auras vu.»
La pauvre mère parlait encore, quand la fille du roi sortit du palais de son père, et se dirigea vers le Nil pour s’y baigner avec ses compagnes. Dieu voulut qu’elle s’arrêtât à l’endroit où se trouvait la corbeille. Quelle fut sa surprise, en apercevant un enfant nouveau-né qui pleurait bien fort et lui tendait les bras, comme s’il l’appelait à son secours. Emue de pitié, elle le fit retirer promptement. «C’est sans doute, s’écria-t-elle, un enfant des Hébreux. O mes sœurs, qu’il est beau! Pauvre petit, tu ne mourras point; c’est moi qui serai ta mère, et tu seras mon fils. Dès ce jour, je te mets sous ma protection, et je t’appellerai Moïse (c’est-à-dire sauvé des eaux), car je t’ai sauvé des eaux du Nil.»
La sœur de l’enfant ayant entendu ces paroles, sortit du lieu où elle était cachée, et fit semblant de s’être trouvée là par hasard. «Princesse, dit-elle, si vous avez besoin d’une nourrice, je connais une femme très-fidèle qui ne demeure pas loin d’ici, et je pourrais aller la chercher.—Va donc, répondit la fille de Pharaon, et amène-la moi.» Aussitôt elle courut chez sa mère, et lui raconta tout; celle-ci se hâta de venir, et la princesse consentit à lui confier Moïse, non pas, toutefois, sans lui recommander d’en prendre le plus grand soin, et sans lui promettre une forte récompense.
La joie de la pauvre femme était si grande, qu’elle n’osait embrasser son fils devant ce monde, dans la crainte qu’on ne découvrît la ruse de son amour maternel; mais quand elle fut seule, je vous laisse à juger de ses transports et de ses caresses.
Comme il n’est si bonne nourrice qu’une mère, Moïse grandit promptement, et devint un très-beau jeune homme. La fille du roi remplit fidèlement ses promesses; elle le fit élever sous ses yeux, dans son palais, et lui donna la meilleure éducation.
Dieu, qui l’avait préservé de la mort par un miracle, devait se servir de lui pour délivrer les Hébreux de l’esclavage des Egyptiens; et c’est encore là, mes chers enfants, une grande et belle histoire, que je vous raconterai quelque jour.


Vous avez souvent entendu parler de l’Avent, mes chers enfants, de cet espace de temps qui précède la grande solennité de la naissance de notre divin Rédempteur, et que l’Église a consacré à la prière et à l’abstinence, pour se préparer dignement à célébrer le mystère d’amour et de miséricorde d’un Dieu fait homme pour racheter les crimes du genre humain. La piété des premiers fidèles avait consacré un Carême de quarante jours avant Noël, appelé, dans quelques anciens auteurs, le Carême de Saint-Martin; et cette abstinence, instituée d’abord pour les lundis, mercredis et vendredis, dans le concile de Mâcon en 581, fut depuis étendue à tous les autres jours. Le rite établi par saint Ambroise, archevêque de Milan, dans le quatrième siècle, marque six semaines pour l’Avent; mais l’usage présent de l’Église est d’en placer l’ouverture au dimanche qui tombe entre le 29 novembre et le 3 décembre inclusivement; il n’a donc plus que quatre semaines de durée, et pendant ce temps, l’Église met à la portée de ses enfants tous ses trésors, comme sermons, instructions pastorales et prières. Vous, enfants, dont l’âge encore trop tendre ne permet pas une abstinence sévère, vous pouvez facilement vous unir à la sanctification de cette époque, en redoublant d’obéissance pour vos parents et vos maîtres, de douceur envers vos égaux, et de charité vis-à-vis les malheureux. Vous recevez tous de l’argent pour vos menus-plaisirs, eh bien! ne vous permettez pas la moindre fantaisie, consacrez le produit de vos économies au soulagement de pauvres familles, qui, à ce moment de l’année, ont de si grands besoins! Voilà les jeûnes et les abstinences que votre âge peut offrir à celui qui fut doux et humble de cœur, et qui a dit à ses disciples: «En vérité, je vous le dis, un verre d’eau donné au nom de mon père, à celui qui a soif, ne restera pas sans récompense en ce monde et dans l’autre.»
L’ouverture de l’Avent, à Rome, est une des solennités dans lesquelles le pape officie pontificalement. La cérémonie a lieu au Vatican, dans la fameuse chapelle Sixtine: un autel paré simplement est placé au fond, en face de là porte d’entrée; le trône du pape est élevé sur le côté gauche du spectateur; immédiatement après, le sénateur romain, chef de la magistrature, est assis dans un fauteuil, ensuite les cardinaux et les prêtres sur des banquettes exhaussées: les cardinaux-diacres, les généraux d’ordres religieux, les ecclésiastiques, sont placés vis-à-vis d’eux. Une grille sépare en deux la chapelle, et derrière cette grille se trouvent des gradins, dans lesquels les dames sont admises, ainsi que des tribunes destinées aux ambassadeurs des puissances catholiques.
A onze heures, le commandant fait fermer la grande porte de la chapelle, et peu après, le souverain pontife, précédé des prélats et des officiers de sa maison, entre par une petite porte placée à côté de l’autel et va s’asseoir sur son trône. Aussitôt chaque cardinal, vêtu d’une soutane rouge recouverte d’un rochet de dentelle, se rend aux pieds de notre Saint-Père, baise son anneau, et retourne à sa place.
La messe commence; pendant sa durée, le pape ne quitte son trône que deux fois, à l’Évangile et à l’Élévation, et vient se mettre à genoux sur un prie-Dieu en face de l’autel. La messe finie, notre Saint-Père prend sur l’autel le Saint-Sacrement, donne la bénédiction, pendant laquelle on chante le Pange Lingua, et se rend en procession, précédé des cardinaux, à la chapelle Pauline, splendidement illuminée pour cette cérémonie. Le représentant de Jésus-Christ sur la terre est revêtu d’une magnifique chasuble blanche brodée d’or; sa tête est découverte et ombragée par un dais éclatant d’or, porté par des cardinaux. Devant le dais marchent des diacres tenant à la main de grands éventails de plumes de paons blancs, et derrière le dais, d’autres ecclésiastiques portent la queue du manteau du pape.
Après avoir placé le Saint-Sacrement sur l’autel de la chapelle Pauline, où il doit rester exposé pendant l’Octave, le pape fait un acte d’adoration, et se retire dans l’intérieur du palais du Vatican. Tous les spectateurs se rendent en foule à l’adoration, et reçoivent leur part des indulgences accordées, par le père des fidèles, à ceux qui peuvent assister à cette pieuse commémoration.

Au coin d’une Borne.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Milles Bombes!» s’écrie-t-il après avoir regardé ce que ce pouvait être. | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.
Par une de ces nuits d’hiver, si longues et si cruelles pour le pauvre, un chiffonnier, le dos courbé sous le poids de sa large hotte, son crochet d’une main, sa lanterne de l’autre, suivait la rue Saint-Honoré, allant tantôt à droite, tantôt à gauche, selon qu’il pensait pouvoir plus sûrement remplir son mannequin.
C’est un état bien pénible, mes enfants, que celui de chiffonnier. Dès que la nuit est venue, on les voit, ces pauvres diables, se répandre dans Paris, visitant chaque rue, chaque place, et remuant les tas d’ordures qu’on y dépose, dans l’espoir d’y trouver des os, de la ferraille, de vieux morceaux de papier ou de linge; car tout ici-bas (même les choses qu’on méprise le plus), tout a son utilité: les os servent à fabriquer des manches de couteaux, des boutons, ou bien on les prépare de manière à servir d’engrais pour les terres, en les faisant brûler et les réduisant en poudre noire qu’on appelle noir animal. Le vieux fer est refondu ou travaillé pour acquérir une qualité supérieure ou des formes nouvelles; avec les chiffons, on fait du papier; avec les morceaux de papier, du carton.
Il était tard, onze heures venaient de sonner, et cependant le père Michaud (c’est le nom de notre chiffonnier) retardait toujours le moment de rentrer dans la petite chambre qu’il habitait, rue aux Ours, avec sa femme.
Michaud, mes enfants, était un de ces vieux soldats que Napoléon conduisait à la victoire, et qui, après avoir parcouru l’Europe entière, glorieux et triomphants, mouraient sur le champ de bataille ou revenaient écloppés, sans bras ni jambes. Quant à Michaud, il n’avait rien laissé aux ennemis: il était revenu tout entier.
Sa taille était élevée; ses cheveux gris commençaient à devenir rares; à peine en voyait-on quelques mèches retomber sur son front que creusait profondément une large blessure. Comment n’avait-il pas succombé en la recevant! Dieu seul le sait! C’était à la bataille de Waterloo, ce combat de géants, où vingt nations se ruant sur nous, s’écriaient: «Rendez-vous,» et recevaient, au milieu de la mitraille, cette réponse sublime: «La garde meurt, mais elle ne se rend pas!» Les soldats français tombaient en héros sur le champ de bataille; Michaud pleurait de désespoir et de rage à la vue de ses camarades expirants. Il était, au milieu des ennemis, tout couvert de sang, tout noir de poudre; soudain il aperçoit le porte-drapeau de son régiment, entouré par vingt Prussiens et près de succomber. Il s’élance, renverse tout sur son passage, attaque les Prussiens, leur arrache le drapeau dont ils s’étaient déjà emparés; puis, le serrant sur sa poitrine, il combat encore malgré les blessures dont il est couvert. Ses camarades l’ont vu, ils accourent, et le reçoivent dans leurs bras au moment où il tombait frappé d’un coup de sabre.
En revenant de l’armée, Michaud épousa une vieille cantinière, connue par maints traits de courage, et qui avait soigné ses blessures. La pauvre femme allait faire le ménage de quelques personnes trop peu fortunées pour avoir des domestiques.
Vous me pardonnerez tous ces détails, mes enfants; mais ils étaient indispensables pour vous faire connaître un peu la famille Michaud, avec laquelle vous allez passer quelques instants.
Donc, comme je vous l’ai dit en commençant, le vieux soldat retournait chez lui, et il projetait, de tous côtés, la lueur inégale et vacillante de sa lanterne.
Bientôt il se hâte, presse le pas et s’approche de la porte d’un bel hôtel, près duquel il aperçoit un gros paquet. La neige, qui tombe en flocons pressés, ne l’a pas encore tout à fait couvert.
«Mille bombes!» s’écrie-t-il après avoir regardé ce que ce pouvait être; et aussitôt il pose à terre, hotte, crochet, lanterne, et soulève ce qu’il vient de trouver.
Vous croyez peut-être que c’est quelque paquet de linge ou de papiers jetés là par hasard? Eh bien! non, mes amis, détrompez-vous. Ce que Michaud avait pris d’abord pour un monceau d’ordures, est un joli petit garçon endormi, presque gelé et respirant à peine. Ses cheveux blonds tombent en boucles couvertes de neige autour de sa tête; ses joues sont pâles, ses lèvres bleues se serrent l’une contre l’autre. Oh! je vous l’assure, cela faisait mal à voir.
Une blouse en velours vert retenue autour de sa taille par une ceinture, une petite toque écossaise, annoncent un enfant qui appartient à une famille riche. Michaud déblaie la neige qui le couvre, et cherche à le ranimer en prenant dans ses mains celles du pauvre petit. Efforts inutiles!
«Que faire? se dit Michaud. Allons, c’est ça!»
Et aussitôt il renverse sa hotte dans la rue, rassemble les morceaux de papier qui s’y trouvaient; puis il y met le feu. L’enfant, réchauffé par la flamme bienfaisante, commence à remuer les lèvres.
Une larme coule des yeux du vieux soldat, dont les longues moustaches grises touchent presque la figure de l’enfant. Ses beaux yeux bleus s’ouvrent lentement. Effrayé du rêve qu’il avait fait, il jette un cri, se lève et regarde avec étonnement autour de lui.
«Ma mère! ma mère! s’écrie-t-il d’une voix déchirante.
—Que faire! se dit encore Michaud; irai-je, à cette heure, frapper à toutes les portes et demander à qui appartient cet enfant. On ne voudra pas m’ouvrir, et, pendant ce temps, il gèlera, le pauvre innocent! Allons, retournons chez nous; demain, je reviendrai, et je chercherai partout.»
Michaud prit l’enfant dans ses bras et se dirigea vers la rue aux Ours.
«Tiens, Marion, dit-il à sa femme en entrant dans sa petite chambre, voilà ce que j’ai trouvé ce soir.
—Un enfant! oh! comme il est gentil!... merci, mon bon Michaud, merci!
—Merci! dis-tu, folle que tu es; tu ne comprends donc pas que cet enfant est perdu?
—Ah! pauvre petit! mon Dieu! comme il a froid!»
Et Marion, l’enveloppant dans une couverture, le plaça bien doucement sur le seul matelas qui fût dans la chambre.
Des domestiques à l’air affairé entraient, à chaque instant, dans un hôtel de la rue de Provence, puis en sortaient en courant et se dirigeaient de tous les côtés. Leur physionomie exprimait la plus vive douleur.
«Eh bien, Jean, demanda une femme de chambre en essuyant ses yeux pleins de larmes, avez-vous su quelque chose?
—Rien.
—Oh! c’est désolant!... Retournez, Jean, cherchez partout; notre bonne maîtresse est si malheureuse!»
Jean partit aussitôt pour chercher le petit Edgard, qui n’était pas rentré avec sa bonne. Il était alors huit heures du soir, et depuis trois heures on ne savait ce qu’il était devenu. Sa mère, madame la baronne d’Antrac, pleurait amèrement, comme pleureraient vos mères, si vous étiez perdus, mes enfants.
«Oh! mon Dieu! rends-le-moi!» disait-elle avec désespoir; et des sanglots s’échappaient de son sein.
A chaque instant sa main se portait convulsivement sur le cordon de sonnette placé près de sa cheminée: elle l’agitait violemment.
«Edgard est-il ici?
—Non, madame, pas encore, répondait-on.»
Alors la pauvre mère se jetait sur son lit et pleurait. Au moindre bruit elle se relevait, une lueur d’espérance venait ranimer ses forces... Si vous l’eussiez vue, pâle, les yeux égarés, les bras tendus, se précipiter vers la porte; oh! vous auriez eu bien pitié de sa douleur. Une fièvre ardente la dévorait. Dans son délire, elle appelait son fils.
«Edgard!... Edgard! disait-elle; viens, mon fils, viens sur mes genoux!» Elle prenait son oreiller, et le berçait comme elle eût bercé son fils.
La nuit se passa ainsi, triste et douloureuse pour les habitants de l’hôtel; car Edgard était si bon, si gentil, que tout le monde le regrettait amèrement.
Minuit venait de sonner; on voyait, à la démarche des domestiques, le triste résultat de leurs courses.
Madame d’Antrac berçait toujours son oreiller. Agenouillée près du lit de sa maîtresse, Rose, la bonne d’Edgard, pleurait et priait Dieu de lui rendre son enfant. «C’est moi qui l’ai perdu, disait-elle... Oh! rendez-le-moi, mon Dieu!»
Elle disait vrai, la vieille Rose; il y avait bien de sa faute dans le malheur qu’on déplorait. Le matin, elle était allée avec Edgard aux Champs-Élysées; après quelques instants, elle s’assit sur un banc, prit son ouvrage et travailla, tandis que le petit garçon jouait auprès d’elle.
La pauvre femme était vieille; la promenade qu’elle venait de faire l’avait fatiguée, elle s’endormit; bientôt Edgard s’éloigna pour aller voir des saltimbanques qui amusaient la foule par des tours surprenants.
C’était merveille de les voir avaler des épées, des barres de fer; manger la tête en bas; dévorer de l’étoupe et respirer des flammes. Il y avait là aussi, un âne savant qui disait l’heure juste des Tuileries, en frappant la terre avec son pied, faisait une addition, jouait au domino, chantait une romance nouvelle et s’accompagnait en râclant du violon.
Edgard était ravi; aussi quand les saltimbanques et l’âne s’en allèrent plus loin recommencer leurs curieux exercices, il les suivit, et lorsque Rose se réveilla, elle chercha Edgard de tous côtés, mais en vain; elle l’appela, personne ne répondit; pensant que peut-être il était retourné chez sa mère, elle y courut; Edgard n’avait pas paru.
La nuit était venue que le petit imprudent regardait encore les saltimbanques. Comme il avait faim, il songea enfin à retrouver sa bonne; il jeta les yeux autour de lui; mais les Champs-Élysées avaient disparu, et il se trouvait seul au milieu d’une grande place qu’il ne connaissait pas... c’était celle du Carrousel. Le pauvre petit cria, pleura; mais, hélas! peine inutile. Il s’était mis à courir; puis enfin, épuisé de fatigue, il était venu tomber près de la borne où le père Michaud le ramassa.
Le lendemain, un domestique vint dire à l’hôtel de madame d’Antrac qu’un jeune enfant était tombé dans la Seine et qu’on n’avait pu le sauver. On crut que ce devait être Edgard. Lorsqu’on annonça cette horrible nouvelle à sa mère, celle-ci se mit à rire aux éclats. Elle était folle!
Le lendemain, le père Michaud se réveilla de bonne heure, prit son mannequin et sortit sans faire de bruit. «Adieu, Marion, dit-il à sa femme, je vais me promener pour le petit; quand il sera réveillé, fais-le jaser.»
Marion alluma bientôt du feu dans un réchaud et alla chercher du lait pour déjeuner. En moins d’une demi-heure, tout le quartier connut la trouvaille de Michaud. Aussi, quand Marion revint chez elle, une foule de voisines la suivirent pour voir le bel enfant; mais elles firent tant de bruit qu’il se réveilla. Effrayé de se trouver au milieu de toutes ces commères en négligé du matin, c’est-à-dire sales et à moitié vêtues, le pauvre petit se prit à pleurer. Marion renvoya enfin toutes les curieuses; puis, s’approchant d’Edgard: «Comment vous nommez-vous, mon enfant? lui demanda-t-elle.
—Je me nomme Edgard; je veux voir maman.
—Où demeure-t-elle?
—A Paris.
—Quel est son nom?
—Maman.»
Vous comprenez, mes enfants, qu’avec de pareils renseignements on ne pouvait guère espérer parvenir à retrouver les parents d’Edgard.
Michaud revint; toutes ses recherches avaient été inutiles.
«Allons, dit-il, nous garderons l’enfant; n’est-ce pas, Marion?
—Oui, et nous le traiterons de notre mieux.
—Notre mieux est bien mauvais.
—Enfin, le ciel nous aidera peut-être; mais il ne faut pas nous décourager.»
Tous les jours, Marion emmenait l’enfant dans les maisons où elle allait faire le ménage, et partout elle racontait son histoire.
Cinq années se passèrent ainsi, pendant lesquelles on ne put rien découvrir touchant les parents d’Edgard. La famille Michaud s’imposait mille privations pour élever son fils adoptif. Une bonne dame dont Marion faisait les commissions fut touchée de la gentillesse du pauvre petit; elle lui apprit elle-même à lire et à écrire, et, reconnaissant ses bonnes dispositions et son amour du travail, elle le mit en pension chez un instituteur qu’elle connaissait, et dont il devint bientôt le meilleur élève.
Le père Michaud avait failli mourir; ses blessures s’étaient rouvertes, et, sans les soins qu’on lui prodigua, c’en était fait de lui.
Le jour de la distribution des prix de l’institution d’Edgard, il voulut y assister, et, malgré son excessive faiblesse, il revêtit ses plus beaux habits, et s’y rendit appuyé sur Marion, qui marchait toute fière du triomphe qu’elle espérait pour Edgard.
Une estrade avait été élevée au fond de la classe pour les professeurs et les personnes de distinction invitées à la cérémonie. Au nombre de ces dernières, il y avait une dame habillée de noir, des pieds à la tête. Ses traits pâles et sa figure amaigrie annonçaient de longues souffrances. En voyant tous ces enfants gais et joyeux venir se placer sur leurs bancs, des larmes coulèrent de ses yeux. Le maître de pension prononça quelques paroles touchantes, et la distribution commença: «Prix d’honneur: Edgard Michaud.»
A ce nom d’Edgard, la dame noire se leva comme réveillée en sursaut, regarda fixement le jeune lauréat, et se précipita vers lui.
«Mon fils!... mon fils!...» s’écria-t-elle d’une voix entrecoupée de sanglots; et elle tomba sans connaissance.
Michaud et sa femme s’étaient approchés; lorsque la dame noire revint à elle, ils lui racontèrent l’histoire d’Edgard.
Cette dame noire, mes enfants, c’était madame d’Antrac; jugez de son bonheur; après cinq années de souffrances, elle retrouvait son fils qu elle croyait mort.
Aujourd’hui, la famille Michaud habite l’hôtel de madame d’Antrac, qui n’a pas voulu les séparer d’Edgard.
Que de réflexions cette histoire, qui n’est pas un conte inventé à plaisir, doit faire naître en vous, mes enfants! Voyez d’abord quelle terrible punition Edgard reçut de son imprudence; puis ensuite les sacrifices et la vertu des époux Michaud récompensés par la reconnaissance de madame d’Antrac.
Et remarquez bien surtout qu’Edgard ne dut le bonheur de retrouver sa mère qu’à son travail et à sa bonne conduite; car, s’il eût été paresseux et mauvais sujet, son nom n’aurait jamais été prononcé à la distribution des prix.
Puissiez-vous profiter de l’exemple qu’il vous donne, et vous souvenir toujours que l’obéissance et la charité, le travail et la bonne conduite, sont les gages d’un bonheur certain!

Le Gagne Petit.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| On n’chasse pas de la sorte un ancien sergent du 55eme, réplique Michel d’un ton martial et prononcé. | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Ce récit, mes chers enfants, a pour but de vous prouver que la profession la plus abjecte, en apparence, est souvent digne d’estime, de considération, et que la bienfaisance même se cache quelquefois sous des vêtements grossiers. Gardez-vous donc bien de ne juger les personnes que sur leur extérieur; et dites-vous, en regardant le plus humble artisan gagnant son pain à la sueur de son front: «Sous cette veste de bure et rapiécée, bat peut-être le cœur le plus noble et le plus généreux.»
Michel Bertrand, ancien sergent d’infanterie, devenu rémouleur ambulant, vulgairement surnommé gagne-petit, était un de ces hommes francs et courageux qui se plaisent à cacher le bien qu’ils font sous le voile du mystère. Habile dans son état, grand travailleur et d’une gaîté intarissable, il était toujours bien accueilli dans les villages qu’il parcourait, dans les divers châteaux à la porte desquels il se présentait. Dès qu’il venait avec sa femme, établir ses meules à aiguiser les ciseaux, les couteaux et les instruments de toute espèce, il ne tardait pas à se voir entouré de nombreux chalands qui souvent l’obligeaient de séjourner plusieurs jours parmi eux; car il songeait, avant tout, à ménager les forces de son excellente femme, qui tournait la roue derrière lui, tout en chantant une vieille chanson du pays, dont la naïveté faisait sourire le gagne-petit et lui donnait cœur à l’ouvrage.
C’était dans les environs de Lyon et sur les belles rives du Rhône et de la Saône, que Michel Bertrand et Madelaine, sa digne compagne, exerçaient leur modeste profession, qui ne laissait pas que de leur devenir souvent très-profitable. Aussi jamais n’acceptaient-ils l’hospitalité qu’on leur offrait, si ce n’est dans quelques châteaux isolés, dans quelques grosses fermes éloignées, où le travail leur faisait oublier que le jour touchait à son déclin, et que la nuit approchait. Mais partout où ils apercevaient une auberge, ils allaient y prendre, en payant, leur souper et leur coucher. «Lorsqu’on gagne honnêtement sa vie, disait Michel, on n’doit point r’cevoir la charité.—T’as raison, not’homme, ajoutait la bonne Madelaine; le pain qu’on paie a ben meilleur goût que l’pain qu’on nous donne. Aussi, j’ons toujours soin d’porter dans ma panetière d’quoi nous réconforter tous les deux pendant le jour; j’en sommes quittes pour manger assis sur l’herbe, à l’ombre d’un vert feuillage: c’ qui n’fait qu’doubler not’ appétit.»
Depuis plusieurs années, Michel et sa femme parcouraient seuls les environs de Lyon, toujours bien achalandés dans tous les lieux où ils s’arrêtaient; mais bientôt ils parurent accompagnés d’un jeune enfant d’environ douze ans, d’une force remarquable et d’une figure intéressante. Il soulageait sa mère à porter tantôt la panetière contenant la nourriture de la journée, tantôt la roue qui faisait tourner les meules du gagne-petit. Il se nommait Prosper, et paraissait répondre au tendre attachement que lui témoignaient ses parents. C’était lui qui remettait ordinairement aux diverses personnes les outils qu’avait repassés son père, et lui rapportait le prix de son travail. Il s’était approprié l’obligation de tourner la roue à la place de sa mère, qui toutefois le relevait quelquefois encore dans cette corvée pénible et monotone, surtout pendant les longues et chaudes journées de la belle saison.
Prosper avait la noble fierté de ses parents: il n’acceptait jamais rien des pratiques, même de celles qu’il intéressait le plus; si ce n’est un verre d’eau, lorsque la soif le tourmentait trop fort; ou bien un fruit qui lui faisait attendre plus patiemment le repas du soir. Il se faisait surtout remarquer par une voix vibrante, expressive, dans les chansons que sa mère lui avait apprises, et qu’il répétait, en tournant la roue, avec une verve qui souvent rassemblait les passants autour de lui. Il excellait surtout dans une vieille romance, intitulée: l’Enfant sauvé, récit historique et touchant du dévouement admirable d’un pauvre rémouleur, qui, dans un débordement horrible du Rhône et de la Saône, s’était exposé, malgré les cris de sa femme, à une mort presque certaine, pour sauver un enfant entraîné dans son berceau sur les flots en fureur. C’était la mère Michel qui avait appris à son cher Prosper cette ancienne chanson répandue dans tout le pays; et jamais celui-ci ne la répétait sans voir de douces larmes s’échapper des yeux de ses parents, et sans éprouver lui-même une vive émotion dont il ne pouvait se défendre.
Par une belle matinée du mois de juin, Michel Bertrand, avec sa femme et Prosper, vinrent établir leur atelier de gagne-petit devant la grille d’un vaste château situé près du village de Quincy, sur les belles rives de la Saône, et ne tardèrent pas à recevoir du chef de cuisine divers objets à repasser. Ils se livraient au travail avec leur zèle accoutumé, lorsqu’une pluie d’orage, qui survint tout à coup, les força de se réfugier sous une des remises pratiquées au-dessous d’une aile des bâtiments dont les fenêtres donnaient sur la cour de service; se trouvant à l’abri de l’ondée qui continuait à tomber, nos rémouleurs redoublaient de zèle à l’ouvrage, et se préparaient une bonne journée, lorsque Prosper, selon son usage, se met à chanter, tout en tournant la roue, une de ses chansons favorites, et cela d’une voix expressive, retentissante. Michel, tout en repassant les outils qu’on lui avait confiés, et la bonne Madelaine, assise sur un mauvais escabeau et raccommodant une vieille jupe déchirée, répétaient gaîment avec leur cher Prosper ce refrain de la romance:
«Sur les flots vogue en assurance,
Vogue sans crainte, bel enfant!
Sur toi veille la Providence:
Tu braveras la fureur du torrent.
Vogue sans crainte, bel enfant!»
Le rémouleur et sa femme, en chantant ce refrain, portaient sur Prosper des regards attendris, et paraissaient réprimer avec effort la vive émotion qu’ils éprouvaient. Celui-ci, loin de s’en apercevoir, se livrait à toute sa verve, à toute la gaîté de son âge, lorsqu’un domestique en livrée, descendant brusquement par un escalier dérobé, vint leur signifier qu’ils eussent à cesser leurs criailleries qui étourdissaient M. le comte de Rosental, son maître, en ce moment occupé à faire une lecture intéressante. «Pardon, excuse, mon cher monsieur,» lui répond Prosper, «mais je n’ saurais tourner ma roue sans chanter; ça me donne du cœur à l’ouvrage et ça me fait oublier la fatigue de mon état.—En ce cas, répond le laquais, allez travailler plus loin; car M. le comte vous ferait chasser hors du château.—On n’ chasse pas de la sorte un ancien sergent du 35e,» réplique Michel d’un ton martial et prononcé. «Les honorables cicatrices que je porte, ne me permettent pas de m’ laisser insulter impunément. Il est donc bien terrible vot’ comte de Rosental? Est-il dans l’ service?—Il est trop jeune encore.—Et quel âge a-t-il donc?—Pas tout à fait douze ans.—Mon père n’en f’rait qu’une bouchée,» dit Prosper en éclatant de rire.—Allons, p’tit garçon, taisez-vous!» dit à son tour la mère Michel, toujours prête à prévenir la moindre dispute, «c’ brave homme n’ fait qu’exécuter les ordres qu’on lui a donnés; et l’on n’ vient pas chez les gens pour les m’nacer. L’ondée est passée; r’tirons-nous sous ces gros arbres qui sont auprès d’ la grille, sur la grande route, et nous y achèv’rons not’ ouvrage, sans crainte d’étourdir M. le comte.—Et vous ferez bien,» reprend le domestique, «car il n’est pas endurant.—N’y aurait pas d’ mal, en c’ cas, à lui donner une leçon,» dit Michel en souriant.—Comme il est à peu près d’ mon âge, voulez-vous que j’ m’en charge?» ajouta le petit tourneur de roue avec des yeux étincelants.—Silence, encore une fois!» reprend la mère Michel, lui mettant une main sur la bouche. «Excusez, monsieur, la vivacité d’un enfant qui n’ sent pas toute la portée d’ ses paroles.... et nous, allons, allons achever not’ besogne en dehors de la grille.—Là du moins,» reprend Prosper, en toisant l’homme à livrée de la tête aux pieds, «là du moins, nous pourrons chanter tout à not’ aise, sans crainte d’importuner M. l’comte, qui n’a pas encore douze ans.» Le laquais se retira d’un air mécontent; et nos rémouleurs allèrent s’établir sous les arbres près l’entrée du château.
Leurs chants recommencèrent en toute liberté, et le travail n’en allait que mieux. Comme ils achevaient d’émoudre divers objets, parut tout à coup à la grille le jeune comte de Rosental, escorté de plusieurs de ses gens, et portant sur sa figure l’expression de la colère: «Voilà donc comme vous obéissez aux ordres qu’on vous donne?» dit-il en abordant les rémouleurs; «et vous ne cesserez pas de me déchirer les oreilles avec vos criailleries.»—«Pardon, excuse,» lui répond Michel; «nous nous sommes privés d’chanter tant qu’nous sommes restés dans les cours du château; mais sur une grande route on est libre, c’est la propriété de tout l’monde, et vous n’avez pas l’droit d’venir nous interrompre.»—«Mais je crois que ce vieux gagne-petit voudrait faire avec moi le raisonneur,» reprend le jeune comte rouge de dépit.—«Si vous étiez aussi bon raisonneur que moi, mon p’tit mosieu, vous prendriez un autre ton.»—«Qu’appelles-tu petit mosieu?»—«Vous voyez bien qu’vous n’êtes pas plus grand qu’moi,» répliqua vivement Prosper en mesurant son épaule à la sienne.—«Excusez, monsieu l’comte!» dit la mère Michel, s’élançant entre eux deux et faisant reculer Prosper. «C’est jeune, c’est vif, et ça n’sait pas c’que ça dit.»—«Ah! tu te crois autant que moi, petit manant!... Je saurai bien te faire mesurer la distance qui règne entre nous deux... Emparez-vous de cet insolent!» dit-il à ses gens qui l’entourent.—«Le premier qui s’avance, est mort!» s’écria Michel Bertrand, désignant un hachoir qu’il porte à la main et qu’il venait d’aiguiser. «S’emparer d’un enfant à ma barbe! à moi, vieux militaire couvert de cicatrices!... J’vous l’répète, l’premier d’vous qui s’avance est mort!»
En ce moment paraît à la grille du château la comtesse de Rosental, d’une figure noble, expressive, qui commande le respect, annonce la bonté; elle se fait rendre compte du sujet de la querelle; et s’adressant à son fils d’un ton touchant, mais plein de dignité, elle lui dit: «Cher Arthur, vous ne vous corrigerez donc jamais de ce ridicule orgueil, de cet insultant dédain pour tous ceux que le hasard a placés dans la classe du peuple? Vous oublierez donc toujours qu’on y rencontre souvent les qualités et les vertus qui nous rendent plus estimables, plus chers à la société que ne le font souvent les prérogatives du rang et de la fortune? Depuis la mort de votre excellent père, le titre de comte dont vous avez hérité, et qu’il avait conquis au champ d’honneur, vous enivre et vous fait tourner la tête: il semble que tout doive s’humilier, fléchir devant vous. Non content d’avoir chassé ces bonnes gens de l’intérieur du château, vous les poursuivez jusqu’ici; vous les insultez, vous les menacez!»—«Mais, ma mère...»—«Retirez-vous dans votre appartement, et n’en sortez que quand je vous en ferai donner l’ordre.»
«Eh quoi!» dit Michel Bertrand, lorsqu’Arthur se fut retiré, «madame s’rait-elle donc la veuve du brave général Rosental qui commanda longtemps les lanciers d’ la garde impériale?»—«C’était mon mari.»—«Eh bien! j’ai reçu, tout près de lui, à la bataille d’Austerlitz, une dragée dans cette cuisse qui, par bonheur, ne fit qu’ traverser les chairs.»—«Ainsi,» s’écria la comtesse en lui serrant la main «c’était un frère d’armes de son père que mon fils insultait!... Oh! comme je veux l’en faire repentir!»—«J’ lui disais donc la vérité,» reprend à son tour Prosper «en soutenant qu’il n’était pas plus grand qu’ moi.»—«Tu lui as p’t être dit en riant la vérité,» ajoute Madelaine en le pressant dans ses bras. «Cher enfant, tu es plus grand qu’ tu ne l’ penses.»—«Qu’ voulez-vous dire, ma bonne mère?»—«Rien, rien,» reprit la brave femme en regardant son mari qui lui fait signe de se taire.—«Est-ce que cet enfant ne serait pas à vous?» reprend la comtesse de Rosental avec le plus vif intérêt.—«Si fait, si fait,» s’écrie Michel en pressant Prosper sur sa poitrine; «il est à nous... oh! bien à nous... Mais c’est une histoire qui s’rait trop longue à vous raconter.»—«Si elle intéresse votre cher enfant, j’ose vous sommer de m’en instruire. La veuve de votre frère d’armes n’a-t-elle pas quelques droits à votre confiance?»—«J’ nons pas l’ courage d’ vous r’fuser, ma bonne dame,» lui répond la mère Michel; «et tandis qu’ l’enfant va r’porter à vot’ chef de cuisine c’ qu’i’ nous a donné à r’passer, et qu’ensuite i’ r’viendra mettre en ordre tout c’ qui concerne not’ état, j’allons vous suivre dans vot’ appartement, si vous daignez nous l’ permettre, et là j’ vous confierons not’ secret... Tu nous attendras ici, Prosper, et p’t-être qu’à force de r’cherches...»—«Mais quoiqu’il puisse arriver, cher enfant,» ajouta Michel en l’embrassant encore «dis-toi bien: Je n’ s’rai jamais sans parents.»
Michel et sa femme suivirent la comtesse dans son boudoir, et là, forcés de s’asseoir à ses côtés, ils commencèrent le récit suivant: «Y a d’ ça onze ans,» dit le rémouleur.—«Onze ans et d’mi, not’ homme; c’était au mois d’ novembre, le 17, et nous somme’ au 18 mai.»—«T’as raison, bonne mère; y a donc onze ans et d’mi, nous parcourions, ma femme et moi, les villages qui bordent la Saône d’puis Lyon jusqu’à Trévoux; les pluies d’automne avaient inondé tout l’ pays; Vimy, Roche-Taille et Quincy même étaient sous les eaux; c’était à douze lieues à la ronde comme une mer rugissante, et la principale ferme de c’ château fut engloutie par l’inondation qui dura quatorze grands mortels jours.»—«Oh! si vous aviez vu, madame,» ajoute la mère Michel, «des habitations tout entières, des meules de blé, de fourrage, des meubles d’ toute espèce, emportés par le torrent... c’était à faire frémir!»—«Mais c’ qu’était l’ plus pénible à voir,» reprend le rémouleur avec expression, «c’était d’apercevoir sus l’ cours de la Saône des vêtements d’ femmes et des berceaux d’enfants; c’était à tirer les larmes du cœur le plus insensible.»—«Aussi not’ homme n’ put y résister,» reprit la mère Michel; «et quoiqu’ je m’ fusse j’tée à ses pieds pour l’empêcher d’exposer sa vie...»—«Est-c’ qu’on peut résister à un pareil spectacle?» repart vivement Michel Bertrand: «j’en fais juge madame la comtesse... Nous nous étions retirés, ma femme et moi, sur les hauteurs de Roche-Taille avec un grand nombre d’habitants des environs qui, par bonheur, s’étaient munis d’vivres qu’ils partageaient avec nous. Vieux militaire et nageur intrépide, j’avais contribué plusieurs fois à sauver des malheureux entraînés par le torrent; v’là qu’ nous apercevons au milieu d’la Saône, dont le cours était si rapide, un berceau en forme d’gondole et en bois d’acajou, au-dessus duquel s’élevaient deux p’tites mains blanches et potelées qui semblaient invoquer du s’cours: ça me r’mua, moi, jusqu’au fond des entrailles... Mais c’ qui m’ach’va, c’ fut d’voir paraître au-dessus du berceau une jolie p’tite tête blonde qui m’it l’effet d’un ange tombé du ciel dans les eaux... J’quitte aussitôt ma veste, j’embrasse ma bonne Mad’laine qui n’ voulait pas m’lâcher, en lui disant: Allons, du courage! et j’ m’élance à travers les flots qui d’abord me r’poussent, m’engloutissent, et j’entends crier au rivage: «Il est perdu!... il est mort...» Mais, habile plongeur, et fort du d’sir de faire une bonne action, je r’parais sur la surface de l’onde, j’atteins l’berceau et je l’ramène à bord sus les hauteurs de Satonay, à plus d’une lieue d’ Roche-Taille, tant j’avais été entraîné par la rapidité du torrent.»—«Jugez, madame,» reprend la mère Michel, «jugez d’mes angoisses, d’ mon désespoir! j’croyais mon mari perdu à jamais pour moi; et je m’livrais à toute ma douleur lorsque l’soir même un jeune pâtre vint m’apprendre qu’ Michel avait abordé, comme par miracle, sus les hauteurs de Satonay, et qu’il avait sauvé l’enfant... Je m’ fais conduire auprès d’ lui dans une barque, et je l’trouve sous d’bons vêtements qu’on lui avait prêtés; il était entouré d’ plusieurs femmes du village, s’disputant à qui aurait l’bonheur d’allaiter l’pauvre petit naufragé qui déjà leur souriait et semblait les r’mercier d’avance. J’réclamai, comme de juste, l’droit de lui choisir sa nourrice; et ça vous a poussé comme une fleur des champs aux beaux jours du mois d’ mai.»—«Dieu n’t’a pas permis de d’venir mère, dis-je alors à Madeleine en déposant l’enfant dans ses bras; mais Dieu t’ordonne d’en remplir les devoirs, et semble t’en promettre les jouissances.»—«Dignes et braves gens!» s’écrie la comtesse encaissant leurs mains dans les siennes, «oui, sans doute, le ciel vous récompensera de votre dévouement, de vos généreux sacrifices; car c’est avec le produit de votre travail, avec la sueur de vos fronts, que vous avez élevé cet enfant.»—«Après avoir fait vainement mille recherches,» reprend Michel, «pour découvrir son origine, qu’tout nous dit être élevée, opulente, j’ sommes conv’nus, ma femme et moi, d’ lui laisser croire qu’il est not’ enfant véritable; et j’ nous sommes ben gardés d’ li mettre en tête des idées d’ grandeur qui n’auriont fait que l’ tourmenter.»—«Et pour ça,» ajoute Madeleine, «j’ li avons fait accroire que c’ berceau d’acajou et l’ voile d’ belle mousseline brodée qui l’ couvrait, étaient une prise qu’a faite mon mari à l’époque des inondations: l’ cher enfant vous gobe ça doux comme fraise, et s’ croit ben franchement l’ fils d’un pauv’ gagne-petit.»—«Mais c’ que nous avons eu soin surtout de n’ jamais lui faire voir,» reprend le rémouleur, «c’est un riche médaillon qu’on avait attaché à son col où s’ trouve un portrait d’homme avec un p’tit papier cont’nant une écriture au crayon...»—«Un portrait!» dit la comtesse avec une vive curiosité.—«Je l’ porte toujours là,» dit Madelaine en désignant sa poitrine; «i’ n’ m’a jamais quittée.»—«Ne pourriez-vous pas me le faire voir?»—«L’ moyen d’vous r’fuser, madame la comtesse? mais surtout n’en parlez pas à Prosper.» Madelaine tire aussitôt de son sein un médaillon en or, l’ouvre et le présente au regard de madame de Rosental, qui s’écrie avec le saisissement de la surprise et de la joie: «Que vois-je!... Mon frère!...»—«Vot’ frère, madame!» s’écrie à son tour Michel Bertrand.—«Oui, c’est mon frère, le comte Alfred de Thyl, colonel de cavalerie, l’ami de mon enfance, que j’ai tant pleuré... Eh! comment ne reconnaîtrais-je pas ce portrait? c’est mon ouvrage; c’est moi qui l’avais peint pour sa femme Amélie Descarville, aussi belle que bonne, dont je reconnais l’écriture tracée sur ce billet, d’une main défaillante.»—«Plus de doute,» dit Michel, «Prosper est leur enfant.»—«C’est à la fois mon neveu et mon filleul,» reprend la comtesse. «Dites-moi, avez-vous conservé le berceau qui s’offrit à votre vue?» —«Oui, madame,» répond Madelaine, «ainsi que l’ rideau d’riche mousseline brodée.»—«Et n’avez-vous pas remarqué, au pied du berceau, une plaque de cuivre doré?»—«Oui, madame, portant un double chiffre composé d’une H et d’un T.»—«Qui signifient,» reprend la comtesse, «Hector de Thyl, noms sous lesquels il fut baptisé. Le pauvre enfant perdit son père et sa mère qui s’étaient retirés de ce château pour se réfugier dans une de leurs fermes, où l’inondation de 1827 les poursuivit; ils y furent engloutis sous les flots, ainsi qu’un grand nombre d’habitants; et la malheureuse mère, en se séparant de son cher Hector, l’aura sans doute confié à la Providence, en attachant à son cou ce portrait et ce billet qui pourraient un jour le faire reconnaître... Courez vite le chercher, excellente femme; il me tarde de le presser sur mon cœur, de revoir, de retrouver en lui mon frère.» Madelaine prend aussitôt la course et va trouver le gagne-petit qui achevait de serrer ses outils de rémoulage, tout en fredonnant encore la vieille chanson de l’enfant sauvé.
Pendant ce temps-là, madame de Rosental se disposa, de concert avec Michel Bertrand, à donner au jeune Arthur, son fils, la leçon qu’il méritait. Le jeune rémouleur arrive conduit par sa mère adoptive, et n’ose encore s’avancer vers la comtesse qui lui tend les bras, en lui disant les yeux noyés de larmes: «Viens, mon sang, viens, fils de mon frère sur le sein de ta marraine!» Le gagne-petit hésite, il n’ose croire encore à cet étrange changement, et, s’accrochant au cou de Michel et de Madelaine, il leur dit: «Jamais, jamais je ne cesserai d’être vot’ enfant.»—«Oui,» lui répond le rémouleur, «not’ enfant adoptif; oh çà! à la vie, à la mort; mais tu dois te j’ter aux pieds d’ la digne sœur de ton véritable père.» A ces mots, il le conduit vers la comtesse, en lui disant: «Dieu m’avait choisi pour le sauver et soigner son enfance, je vous l’restitue.» Madame de Rosental le presse sur son sein palpitant, le couvre des baisers les plus tendres, et tend la main à Michel et à sa femme, qu’elle remercie des soins qu’ils ont donnés à son cher filleul... Entre en ce moment le jeune comte de Rosental, auquel elle avait fait donner l’ordre de se rendre auprès d’elle. A la vue de ce groupe enlacé, à la vue surtout du petit rémouleur assis sur ses genoux et pressé dans les bras de sa mère, Arthur reste stupéfait, rougit et baisse les yeux. «Vous voyez, mon fils, lui dit alors la comtesse, un de ces coups de la Providence qui se plaît à venger les opprimés; vous traitiez avec mépris, avec dureté cet orphelin; c’est mon filleul, l’unique rejeton d’une famille illustre, c’est le fils légitime du colonel de Thyl, mon frère chéri dont je vous ai parlé tant de fois. Vous vouliez le faire chasser par vos gens de ce château, et vous étiez chez lui, car ce domaine lui appartient, ainsi que plusieurs autres que je saurai bien faire restituer par un acte authentique. Enfin, vous ne regardiez ce jeune gagne-petit que comme un simple manœuvre réduit à gagner son pain à la sueur de son front, eh bien, c’est le comte de Thyl possédant, à lui seul, plus du double de notre fortune. Vous le voyez, Arthur, l’orgueil nous expose tôt ou tard à d’étranges méprises, à de justes humiliations.»—«Je remercie le ciel, ma mère, de la forte leçon que je reçois, et surtout par une bouche aussi tendre, aussi expressive que la vôtre. Vous pouvez juger à mon émotion du changement qui s’opère en moi: vous me voyez corrigé pour la vie, et j’ose croire que le fils de mon oncle, que le filleul de ma mère, ne me refusera pas de le presser dans mes bras.»—«Oh! d’tout mon cœur!» s’écria l’enfant sauvé: «j’suis trop flatté d’la grâce, d’l’honneur que veut bien m’faire monsieur l’comte.»—«Appelle-moi Arthur tout bonnement, et tutoyons-nous; tu vois que je t’en donne l’exemple»—«C’est dit: tu m’aid’ras ainsi qu’marraine, à prendre l’ton, le langage et les manières d’un comte, mais c’est à condition que j’verrai toujours mon père et ma mère dans mes chers libérateurs, qui ne m’quitt’ront qu’à la mort, que j’répét’rai tout à mon aise la chanson d’l’enfant sauvé, et qu’je n’ cesserai d’honorer le métier d’gagne-petit.»


Il y a quatre siècles de cela, la Provence, ce riant jardin de la France, était gouvernée par un prince aussi célèbre par ses vertus que par ses malheurs; il se nommait Réné, et il réunissait sur sa tête les couronnes de roi de Sicile, de comte d’Anjou et de Provence. Les bienfaits qu’il se plaisait à répandre sur les habitants de cette dernière contrée, au milieu de laquelle s’écoula la plus grande partie de sa vie, lui avaient mérité le nom de bon roi Réné. Maintenant encore, c’est sous ce nom que les Provençaux le désignent lorsque, le soir, devant le feu qui flambe dans la haute cheminée, ils racontent au voyageur les histoires du vieux monarque.
Vous allez juger vous-mêmes, mes enfants, si ce glorieux surnom convenait à Réné. Plein de douceur et d’indulgence, il était d’un accès facile, écoutait toutes les plaintes, et, comme le grand roi saint Louis, rendait souvent, à l’ombre d’un vieux chêne, la justice à ses sujets. Il aimait à visiter, à l’aide d’un déguisement, les habitations de sa chère Provence, à s’informer longuement des affaires et des besoins de ceux qui y vivaient, et rarement il prenait congé d’eux sans leur laisser des souvenirs de sa présence: aux uns il donnait de sages conseils, aux autres de l’argent. Ses mœurs étaient si simples, que, pendant l’hiver, on le voyait souvent se promener dans les lieux exposés au soleil et défendus des vents: aussi, dans chaque village de la Provence, ces sortes d’abris s’appellent toujours cheminées du bon roi Réné.
Voilà, n’est-il pas vrai, pour un roi, de grands titres à l’amour et à la vénération de ses sujets: et faut-il s’étonner qu’au nom de Réné le cœur des Provençaux s’attendrisse encore? Vous-mêmes, vous l’aimerez aussi ce prince, lorsque je vous aurai dit qu’il fut à la fois infortuné père et malheureux roi. Deux fois il fut appelé au trône, et deux fois contraint d’en descendre. La Providence lui avait accordé neuf enfants, et il les perdit presque tous dans un âge peu avancé.
Vers la fin de l’été de l’année 1476, le roi Réné était venu passer quelques jours dans sa bastide[4] de l’Arc, située non loin de la ville d’Aix. Un soir, enveloppé dans une grande cape brune, la tête couverte d’une toque de velours qui ombrageait ses traits, il sortit par une petite porte qui donnait sur la campagne, afin de se mettre en quête de quelque aventure; la lune, qui venait de se lever, éclairait le paysage de sa lumière argentée; des bouffées de vent, venant de la mer, rafraîchissaient l’atmosphère et apportaient aux oreilles du roi les notes d’un air mélancolique qu’exécutait au loin, sur son galoubet, un jeune pâtre attardé. Le magnifique spectacle que présentait à cette heure la campagne, avait rempli d’émotion le cœur de Réné et fait naître en lui de mélancoliques pensées; il songeait à son fils Jehan d Anjou, mort au milieu de ses triomphes à Barcelonne, à sa fille Yolande, à ses autres enfants ravis sitôt à son amour.
Le bon roi cheminait ainsi depuis une heure environ, lorsqu’il s’aperçut qu’il était à l’entrée d’un petit village vers lequel il n’avait jamais porté ses pas; une lumière brillait dans la première maison; il s’en approcha, et, à travers les planches mal jointes qui fermaient la fenêtre, il aperçut, assise sur un escabeau, une femme occupée à filer du lin; à ses pieds, jouaient deux enfants sur lesquels elle jetait, de temps en temps, un regard d’amour plein de tristesse. Pendant quelques instants, Réné se plut à considérer cette scène simple et naïve à la fois. Voulant pousser plus loin son investigation, il heurta à la porte qui s’ouvrit tout aussitôt, et Réné se trouva dans une pièce dont les meubles, peu nombreux, étaient délabrés, mais exempts de ces souillures qui rendent la misère si hideuse.
«Je suis, dit Réné à la femme qui s’était empressée de lui offrir un escabeau, un voyageur égaré; la fatigue m’accable, veuillez me permettre de me reposer quelques instants chez vous.
—Bien volontiers, monseigneur, dit la femme qui avait deviné à la voix et aux gestes de son interlocuteur qu’il était un personnage distingué. Si vous voulez passer la nuit ici, je pourrai vous faire un bon lit de paille fraîche, sur lequel vous reposerez à merveille. Quant à souper, je ne puis vous offrir qu’un peu de pain de sarrasin et quelques figues.»
Ces offres, faites avec bonté et simplicité, touchèrent le vieux roi; il vit bien qu’il n’était pas reconnu; il se hâta donc de continuer la conversation.
«Bonne mère, vous ne paraissez pas heureuse? Vos vêtements de deuil annoncent que vous avez perdu récemment une personne qui vous était chère: serait-ce votre mari?
—Hélas! oui, monseigneur; depuis tantôt six mois, je suis veuve. Après une longue et douloureuse maladie qui a épuisé toutes nos ressources, mon mari a succombé, me laissant sans fortune avec ces deux jeunes enfants.
—Pauvre femme!... N’avez-vous pas de parents, d’amis?
—J’avais des parents. Dieu les a rappelés à lui; j’avais des amis, ils se sont éloignés de moi en me voyant malheureuse. J’attends donc tout de la divine Providence. On dit que noire bon roi Réné va venir habiter sa bastide de l’Arc; aussitôt qu’il sera venu, j’irai le trouver et lui demander, au nom de sa fille’, la reine Marguerite, au service de laquelle j’ai été longtemps, du pain et un abri pour moi et mes enfants, car on va bientôt nous chasser de cette chaumière.
—Quoi! vous avez appartenu à la reine Marguerite? dit Réné avec une vivacité qui faillit le trahir; où? en quelles circonstances? contez-moi tout. Je suis un seigneur de la suite du roi; il vient d’arriver à sa bastide; je lui parlerai de vous, et, n’en doutez pas, il vous arrachera à votre fâcheuse position.
—Oh! mon seigneur, soyez béni, puisque vous vous intéressez à la pauvre veuve! Ce que j’ai à vous dire ne sera pas long:
«En 1445, comme bien vous savez, la princesse Marguerite, fille de notre bon roi Réné, fut mariée au roi Henri VI d’Angleterre. Il y eut alors de grandes fêtes; mais lorsqu’elle quitta la France, on répandit beaucoup de larmes, comme si on eût deviné qu’elle n’allait recueillir sur son trône que peines et tourments. A cette époque, et quoique je fusse bien jeune, j’obtins d’être placée dans le service particulier de la nouvelle reine d’Angleterre, et je partis.
Mieux que moi, sans doute, vous savez que les seigneurs ne tardèrent pas à s’armer contre la couronne, et que la reine, à défaut du roi presque fou, se mit à la tête des troupes, et déploya un courage et une persévérance héroïques. Malheureusement, en 1463, à la bataille de Northumberland, ses armées furent battues, dispersées; elle-même fut condamnée à errer déguisée avec son fils dans ses propres États. Presque toute sa suite l’abandonna lâchement, et bientôt je restai seule, moi pauvre servante, avec elle, une reine!... Mais, voyez vous, c’était la fille de notre bon roi; elle avait été élevée sous le soleil de la Provence; je ne pouvais la quitter sans commettre une mauvaise action: quelquefois elle daignait me parler de notre beau pays, alors nous pleurions toutes deux. Oh! monseigneur, c’est surtout quand elle regardait son gentil fils, le prince de Galles, que sa douleur était grande. Il avait alors dix ans: il était si beau, si aimant!»
A ces mots, la pauvre veuve laissa éclater ses sanglots qu’elle avait contenus jusque-là; et, comme, pendant son récit, ses enfants s’étaient approchés d’elle, elle les embrassa convulsivement. Quant au royal visiteur, depuis longtemps, la tête plongée dans ses mains, il pleurait comme un père qui entend le récit des malheurs de ses enfants. La pauvre femme s’en aperçut.
«Quoi! monseigneur, vous pleurez aussi? Oh! vous êtes père, n’est-il pas vrai? et vous comprenez alors la douleur d’une mère qui voit souffrir ce qu’elle aime.
—Continuez, de grâce, dit Réné maîtrisant son émotion.
—Oh! mon Dieu, où en étais-je donc? Quand je pense à ce temps-là, voyez-vous, et j’y pense souvent, je ne puis retenir mes larmes; mes idées se brouillent. Ah! m’y voilà. Je vous disais que nous errions misérables, toujours déguisées, à travers les comtés d’Angleterre. Un jour, afin d’éviter les soldats qu’on avait mis à notre poursuite, nous nous jetâmes dans une forêt, mais ce fut pour tomber au milieu d’une bande de brigands qui se saisirent de nous. Sans pitié pour les larmes de la reine, ils la dépouillèrent des bijoux quelle portait cachés sur elle; mais, à la faveur d’une querelle qui s’éleva entre eux, nous pûmes nous échapper. Quelques instants après, nous fîmes la rencontre d’un autre brigand; la figure de celui-là était moins sinistre; la reine s’approcha vivement de lui: «Mon ami, sauve le fils de ton roi,» lui dit-elle. A ces mots, prononcés avec fermeté, l’homme s’inclina, chargea sur ses épaules le jeune prince malade, et, par des chemins détournés, il nous conduisit jusque sur les bords de la mer; il nous aida même à nous embarquer. J’accompagnai encore la reine avec son fils jusqu’à Bruges; là, avec sa permission, je la quittai, car j’avais grand besoin de revoir ma Provence, mes parents, mes amis. J’épousai bientôt après Pierre, le métayer; mais, au commencement de cette année, les blessures qu’il avait reçues autrefois en faisant la guerre en Italie, à la suite du roi Réné, se rouvrirent, et il succomba.»
Après quelques instants d’un silence qui n’était troublé que par les pleurs de la pauvre veuve, Réné lui dit:
«Dites-moi votre nom, s’il vous plaît, madame?
—Thiéphaine, monseigneur.
—Eh bien! Thiéphaine, dit le roi, venez demain avec vos enfants à la bastide de l’Arc. Vous vous ferez présenter au grand sénéchal Jean de Cossa; vous saurez ensuite le reste.»
A ces mots, Thiéphaine devina toute la vérité; elle se leva tremblante pour se prosterner devant le roi; mais déjà celui-ci avait disparu.
Le lendemain, couverte de ses plus beaux atours, et conduisant par la main ses deux enfants, Thiéphaine était introduite par le seigneur Jean de Cossa, l’ami et le confident du roi, dans une salle meublée d’une façon fort modeste. Réné, assis sur un coffre couvert d’un tapis grossier, se livrait à un de ses délassements habituels; il peignait une miniature pour un livre d’heures. Aussitôt qu’elle l’aperçut, elle se jeta avec ses enfants à ses genoux, en lui demandant grâce et pardon pour la manière dont elle l’avait accueilli, la veille, dans sa chaumière; mais le roi s’empressa de lui dire avec bonté:
«Relevez-vous, madame; ce n’est pas ainsi que doit se présenter à moi celle qui a donné à ma fille des preuves d’un si beau dévouement. La reine Marguerite ne vous a pas oubliée; elle s’intéressait si fort à vous, qu’elle a fait faire de grandes recherches pour vous trouver; mais elles ont été vaines, car vous aviez changé de nom. Je remercie le Seigneur d’avoir dirigé mes pas hier vers votre demeure, et de m’avoir donné l’occasion de récompenser vos bons et loyaux services. Écoutez-moi bien: Je vous abandonne, à vous et à vos enfants, cette bastide avec toutes les terres qui en dépendent. J’y mets cependant une condition; aussitôt que la saison sera favorable, vous ferez faire dans les champs de grandes plantations d’un arbre appelé mûrier, et, dans cette maison, vous vous livrerez à l’éducation des vers à soie. Cette éducation, si intéressante, est à peu près inconnue dans le pays[5]; mais je placerai près de vous un homme de confiance qui la dirigera, et bientôt vous serez à la tète d’une grande fortune.
Ces paroles furent accueillies par Thiéphaine comme elles devaient l’être, et la bonne femme s’empressa de remercier le roi avec toute l’effusion d’un cœur pur et dévoué.
Ainsi Réné dut considérer ce jour comme un des plus beaux de sa vie, puisqu’il trouva l’occasion de rendre au bonheur une famille malheureuse, et de répandre une industrie qui devait faire un jour l’une des principales sources de prospérité du pays.
Quatre ans après le fait que nous venons de raconter, le 10 juillet 1480, le bon roi René, âgé de soixante-douze ans, rendit son âme à Dieu, laissant la Provence entière éplorée.

|
On appelle ainsi les maisons de plaisance en Provence. |
|
Ce sont deux moines persans qui ayant observé, en Chine, les travaux du ver à soie, et s’étant instruit de tous les procédés de leur éducation, vinrent les premiers, à Constantinople, expliquera l’empereur Justinien l’origine de la soie et les différentes manières de la manufacturer et de la préparer. Encouragés par ses libéralités, ces moines apportèrent des vers à soie en Occident. Bientôt on en éleva un grand nombre dans les différentes parties de la Grèce, surtout dans le Péloponnèse. Dès 1130, la Sicile essaya d’élever des vers à soie; elle fut imitée, à son tour, par les différentes villes d’Italie. L’art de fabriquer la soie se répandit insensiblement d’Italie en Espagne, et de là dans les provinces méridionales de la France, telles que le Languedoc, la Provence, le comtat d’Avignon. En 1471, Louis XI avait déjà établi, à Tours, des manufactures de soieries, mais dont les ouvriers étaient tirés de Gènes, de Venise et de Florence. |

Le vent inclinait la bruyère,
La neige tombait à flocons,
La nuit obscurcissait la terre,
Au loin grondaient les aquilons.
—«Perdus, dans la forêt lointaine,
Couverts de givre et de frimats,
Qui vous guidera vers la plaine?
Pauvres enfants, bâtez le pas!»
Pleurant, ils cheminaient ensemble,
Murmurant d’un accent confus:
—«Frère, dit l’un, comme je tremble!
J’ai faim, j’ai froid, je n’y vois plus.
Les chemins sont couverts de neige;
Frère, dis-moi, peux-tu les voir?
—Frère, que le ciel nous protège!
—Le ciel?... hélas! il est bien noir!
—N’entends-tu pas un bruit de cloche,
Qui se balance triste et lent?
Écoute!... je crois qu’on s’approche...
—Non, pauvre frère, c’est le vent!
Asseyons-nous au pied du chêne,
Le jour viendra... Mais tu gémis?
Tu pleures?... Viens, que mon haleine
Réchauffe tes doigts engourdis?
Ne pleure plus, allons, courage!
Comme toi, suis-je pas transi?
Le grésil frappe mon visage,
Et la bise me glace aussi!
Endormons-nous dans la prière,
Le bon Dieu nous protégera...»
Le lendemain, près de leur mère,
Un ange, au ciel, les éveilla.

L’an 4004 du monde, César Auguste, empereur de Rome, voulant connaître la population de la Judée, ordonna un dénombrement général. Il chargea Cyrinus de l’exécution de son édit, et chaque chef de famille fut obligé d’aller, à un certain jour désigné, se faire inscrire dans la ville principale de sa tribu.
C’était une sombre journée d’hiver. Les habitants des bourgades et des campagnes se hâtaient de toutes parts, et l’on eût dit qu’ils couraient à quelque solennité, tant ils se pressaient d’obéir aux ordres de César. Joseph de Nazareth quitta comme les autres le lieu de sa demeure, emmenant avec lui son épouse Marie, celle-la qui fut bénie entre toutes les femmes, et que l’Esprit saint choisit pour être la mère d’un Dieu. Ils se rendirent à Bethléem, principale cité de la tribu de David; mais quand ils arrivèrent, il n’y avait plus de place dans les hôtelleries. Épuisés de fatigue, ils frappèrent inutilement à toutes les portes; nulle porte ne s’ouvrit devant eux, et ils ne trouvèrent d’autre asile qu’une étable à demi ruinée, trop heureux encore de partager avec quelques animaux ce triste réduit.
Cependant les jours marqués par la Providence étaient accomplis. Le Messie que les nations attendaient, allait enfin descendre des cieux: et ce fut là, au milieu d’une nuit froide et humide, que vint au monde le divin Enfant qui devait mourir sur une croix. Ainsi le créateur de l’univers ne put, dès sa naissance, trouver chez ses créatures une pierre où reposer la tête.
Toutefois, il y avait, aux environs de Bethléem, des bergers qui gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit; c’étaient de pauvres gens qui ne possédaient d’autres richesses que la vertu, d’autre science que l’espérance en Dieu. Mais les grands de la terre ne sont pas ceux que Jésus recherche: il voulut nous donner tout de suite une leçon d’humilité, en choisissant des bergers pour ses premiers courtisans. Ils étaient donc à garder leurs troupeaux, lorsque tout à coup ils aperçurent au ciel une clarté si vive qu’ils en furent éblouis. Saisis de terreur, ils tombèrent à genoux, et entendirent l’ange du Seigneur qui leur dit:
«Ne craignez point, car je vous annonce une grande joie. Un Sauveur vous est né à Bethléem, cité de David. C’est le Christ que les nations attendent, que les prophètes ont prédit. Allez, vous le trouverez enveloppé de langes et couché dans une crèche.»
A ces mots, l’ange parut entouré d’une multitude d’esprits célestes. Il se lit dans le ciel un admirable concert, et l’on entendit les séraphins chanter en chœur:
Gloire à Dieu! gloire au plus haut des cieux!
Quand la vision eut disparu, les bergers se relevèrent pleins d’espérance et de joie. «Mes frères, se dirent-ils entre eux, le Seigneur a fait pour nous un prodige! Allons, courons à Bethléem chercher le Christ qui nous est né.»
Et abandonnant leurs troupeaux à la garde du ciel, ils se mirent aussitôt en chemin: conduits par l’Esprit saint, ils s’arrêtèrent il la porte de l’étable, et, se prosternant avant d’entrer, ils adorèrent.—Quel spectacle, ô mes chers amis! un enfant chétif, demi-nu, couché sur un peu de paille! une pauvre mère cherchant à le garantir du froid de la nuit! un homme faible lui-même, unique protecteur de tant de faiblesse! sainte et mystérieuse famille qui n’était abandonnée des hommes que pour mieux faire briller la sagesse impénétrable de Dieu, et qui ne devait tant souffrir sur la terre que pour nous ouvrir le ciel!
A cette vue, les bergers adorèrent de nouveau. Pénétrés d’un sentiment ineffable d’amour, ils regardaient avec attendrissement l’enfant qui semblait leur sourire. «Voilà bien, s’écriaient-ils en rappelant les paroles de l’ange, voilà bien celui que vous nous aviez promis, Seigneur! Voilà, couché dans sa crèche, l’enfant que les prophètes ont annoncé. Soyez béni, Seigneur, en toutes vos œuvres.»
Gloire à Dieu! gloire au plus haut des cieux!
Marie écoutait ces paroles et les méditait en son cœur. Oh! qu’elle était fière alors l’humble Vierge de Nazareth! comme elle pouvait, maintenant surtout, chanter son admirable cantique:
«Le Seigneur a fait en moi de grandes choses, et son nom est saint.»
Elle qui venait de mettre au monde un Dieu!
Mais, hélas! à côté de la joie, je ne sais quelle vague tristesse se peignait sur son visage. Un douloureux pressentiment agitait le cœur de Marie et troublait les pieux transports de sa divine allégresse. Sans doute l’Esprit saint lui révélait déjà les dures épreuves qui lui étaient réservées; et la mère, auprès de la crèche, interrogeait la croix.
Vous comprenez bien à présent, mes chers enfants, pourquoi c’est aujourd’hui un jour de fête; c’est qu’il y a aujourd’hui mille huit cent quarante ans, Notre Seigneur Jésus-Christ apparaissait au monde. Aussi cette fête que nous appelons Noël, du mot Emmanuel (Dieu est avec nous), qui fut le nom de Jésus, les Grecs l’appelaient Théophanis, c’est-à-dire apparition de Dieu.
L’Église a voulu nous y préparer par les prières de l’Avent, où elle demande au Seigneur la venue du Messie désiré, qui doit être doux à notre âme comme la rosée des nuits l’est aux fleurs.
«O cieux! s’écriait-elle, envoyez votre rosée sur la terre, et que le juste descende des nues comme une pluie désirée!»
Mais, à cette heure, le Juste est descendu; nos vœux sont exaucés, et nous pouvons librement faire éclater notre joie.
«Un petit enfant nous est né, et un fils nous a été donné. Il portera sur son épaule la marque de son empire... Chantez au Seigneur un nouveau cantique, parce qu’il a opéré des merveilles!»
Vous savez que l’on célèbre, ce jour-là, trois messes solennelles? La première à minuit, et à la clarté des bougies, pour honorer particulièrement l’heure où naquit Jésus: on la nomme la messe de minuit, et elle se dit encore par toute la France, excepté dans les grandes villes. La seconde, appelée messe de l’aurore, se dit au point du jour, et consacre le souvenir de l’adoration des bergers. La troisième enfin, à l’heure habituelle des offices de la paroisse[6].
Le pape célébrait lui-même les trois messes, revêtu de ses habits pontificaux; l’une à Sainte-Marie-Majeure, l’autre à Saint-Anastase, et la dernière à Saint-Pierre.
Autrefois la veille de Noël était une grande fête dans le midi de la France; quatre chantres annonçaient à haute voix la naissance de Jésus-Christ, et l’archidiacre, en chape de velours, s’avançait au milieu du chœur, au son joyeux des cloches, et lisait l’Évangile.
A Constantinople, on portait l’Évangile à baiser aux empereurs dans leurs oratoires, et, pendant la cérémonie, le peuple témoignait son allégresse en criant: Vivat! vivat! qu’il vive! qu’il vive!
La fête ne se terminait point avec la journée; mais elle se prolongeait jusqu’à l’Épiphanie, ou l’adoration des rois, dont j’aurai peut-être à vous entretenir.
Quand la foi réunissait tous les chrétiens au pied des autels, la solennité de Noël était un si grand sujet de bonheur, que ce mot de Noël devint un cri de joie. Le roi faisait il sou entrée dans une des bonnes villes de son royaume, annonçait-on la naissance d’un prince, la foule se mettait à crier: Noël! Noël! ne trouvant pas de plus digne manière d’honorer un souverain.
Les temps sont bien changés, mes enfants, et les coutumes aussi. De Noël à l’Épiphanie, par exemple, on célébrait en l’honneur des saints Innocents une fête où les enfants avaient beaucoup de plaisir. On les habillait en prêtres, en moines, en évêques; ils portaient des aubes, des chapes, des surplis, des crosses et des mitres; ils faisaient de longues processions, dansant et chantant jusque dans le chœur au son des violes, des guiternes, des busines et des tympans, instruments de musique aussi oubliés de nos jours qu’ils étaient alors estimés. L’Église toléra d’abord ces sortes de cérémonies; mais il s’y introduisit de tels abus, elles donnèrent lieu à tant de scandales, que plusieurs conciles les défendirent.
Maintenant encore, dans la Basse-Normandie, pendant les jours de Noël, les petits enfants parcourent les rues, le soir, avec des lanternes de papier et des torches enflammées. Ils chantent, par intervalles, ce vieux refrain:
Noël, Noël!
Adieu Noël,
Noël s’en va;
Quand reviendra-t-il?
Dans un an d’ici.
Qu’apportera-t-il?
Chapon rôti,
Galette aussi.
A la messe de l’aurore, on répandait de la paille dans quelques églises pour figurer la crèche où Jésus fut couché après sa naissance. Tous les bergers du canton y assistaient, et ils chantaient des cantiques en s’accompagnant avec le hautbois.
Il arrivait quelquefois que l’on dressait sur la place publique un théâtre où des acteurs représentaient le miracle dont la fête rappelait le souvenir; ainsi le jour de Noël, c’était l’enfant Jésus, la sainte Vierge et saint Joseph qui parlaient entre eux, puis les bergers qui venaient adorer le Messie et raconter comment l’ange du Seigneur leur était apparu, etc.
Ces spectacles, que l’on appelait mystères, réjouissaient fort le peuple; et, dans le principe, ils n’étaient point mauvais. Pourtant ils dégénérèrent comme le reste, et les conciles, qui ne les avaient jamais approuvés, les condamnèrent sévèrement.
La fête de Noël donna lieu à l’établissement de beaucoup d’autres coutumes. L’Église a mis autant de sagesse à les abolir qu’elle en avait mis à les tolérer. Je vous en ai dit quelques-unes, parce qu’il est bon de n’être pas tout à fait ignorant là-dessus; mais n’attachez pas vos jeunes cœurs aux superstitions qui s’effacent, et que le mot de Noël réveille en vous un doux sentiment d’amour pour l’enfant qui vint au monde, dans l’étable de Bethléem.

|
Cet usage s’établit d’abord à Rome. |
Christophe-Colomb.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| Je porte ces fers par l’ordre du Roi et de la Reine d’Espagne, j’obéirai à ce commandement comme à tous ceux que j’ai reçus deux. | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Les Portugais, secondés par l’illustre prince Henri, duc de Viseo, fils du roi Jean Ier de Portugal, tentaient déjà, depuis plusieurs années, avec succès, de grands voyages sur mer, dans le but que se proposaient du reste à l’envi les divers navigateurs de cette époque: celui de se frayer une route maritime d’Europe aux Indes orientales, quand naquit un enfant de parents si peu connus qu’on ne sait au juste où ils vivaient. On a seulement appris plus tard qu’ils habitaient, lors de la naissance de leur enfant, sur le territoire de l’ancienne république de Gênes, en Italie; qu’ils avaient été obligés d’embrasser, pour vivre, la profession de marins, et qu’ils se nommaient Colomb. Quant à leur fils, il avait reçu, lors de son baptême, le prénom peu ambitieux de Christophe.
Christophe Colomb témoigna, dès sa plus tendre jeunesse, un goût décidé pour la profession de ses parents. Ces braves gens, loin de combattre de pareilles inclinations, les développèrent par un genre d’éducation pour laquelle ils firent toutes sortes de sacrifices. Après lui avoir fait acquérir quelque connaissance de la langue latine, lu seule qui fût alors enseignée, on lui fit apprendre la géométrie, la cosmographie, l’astronomie et le dessin; il y fit des progrès rapides. Avec de si heureuses dispositions, il fit, à quatorze ans, son premier pas dans la carrière qui devait le conduire à tant de gloire.
Ses premiers voyages eurent lieu dans les ports de la Méditerranée que fréquentaient ses compatriotes, les Génois; mais c’était là des bornes trop étroites pour une âme aussi active que la sienne; il fit une excursion dans les mers du Nord, visita les côtes de l’île d’Islande où la pêche commençait à attirer quelques nations. Après avoir satisfait sa curiosité et ajouté à ses connaissances maritimes par ce premier voyage, il s’attacha à un homme de son nom et de sa famille, alors capitaine de vaisseau, qui jouissait d’une certaine réputation. Ce marin commandait une petite escadre armée à ses frais; et en faisant la course, tantôt contre les Turcs, tantôt contre les Vénitiens (alors puissants rivaux des Génois dans le commerce), il avait acquis des richesses et une sorte de célébrité. Le jeune Christophe le suivit dans ses expéditions pendant plusieurs années, et se distingua autant par son courage, comme homme de guerre, que par son habileté comme homme de mer. A la fin, dans un combat opiniâtre sur la côte de Portugal contre des navires vénitiens qui revenaient richement chargés des Pays-Bas, le bâtiment sur lequel se trouvait Christophe Colomb prit feu en même temps que le vaisseau ennemi auquel le sien était fortement attaché par les grappins. Dans une si terrible extrémité, sa présence d’esprit et son intrépidité ne l’abandonnèrent pas. Il se jeta à la mer, se saisit d’une rame flottante, et, aidé de ce triste secours et de son adresse à nager, il gagna le rivage éloigné d’environ deux lieues, sauvant ainsi une vie réservée à de merveilleuses choses.
Dès qu’il eut recouvré ses forces, il se rendit à Lisbonne où plusieurs de ses compatriotes étaient établis. Ceux-ci conçurent bientôt une opinion si avantageuse de son mérite, qu’ils le pressèrent vivement de se fixer en Portugal, où ses talents ne pouvaient manquer d’être dignement appréciés. Le service portugais était alors plus attrayant qu’aucun autre, pour quiconque se sentait animé du désir ou de voir des pays nouveaux ou de signaler son savoir-faire comme marin. Colomb se laissa facilement entraîner par ses amis; il se maria à une Portugaise, et fixa son séjour à Lisbonne. Son mariage, au lieu de le détacher, comme on aurait pu le croire, du genre de vie qu’il avait mené jusque-là, contribua au contraire à étendre ses connaissances en navigation, et lui donna le désir de les accroître encore. Sa femme était fille de Barthélemi de Perestrello, un des capitaines qu’avait employés le savant prince Henri dans ses premières navigations. Perestrello avait découvert la fameuse île africaine de Madère. Colomb devint possesseur des journaux de voyages et des cartes de ce navigateur expérimenté. Il y apprit les routes qu’avaient tenues les Portugais dans leurs récentes découvertes sur les côtes occidentales d’Afrique, et les diverses circonstances qui les avaient encouragés et guidés; cette étude enflamma sa noble passion des voyages. Il n’y put résister plus longtemps; il fit voile pour Madère, établit pendant plusieurs années un commerce avec cette île, avec les Canaries, les îles Açores et les divers autres établissements qu’avaient fondés les Portugais en Guinée et sur le continent d’Afrique.
L’expérience que Christophe Colomb ne tarda pas acquérir par suite d’un si grand nombre de voyages dans presque toutes les parties du globe alors connues, le rendit bientôt lui-même un des meilleurs navigateurs de l’Europe, mais cette gloire ne lui suffisait pas; il en ambitionnait une plus grande. D’après certains calculs qui, dans l’état des connaissances géographiques de son temps, avaient des apparences de réalité, lui aussi, il entreprit de chercher une route maritime aux Indes orientales, mais sans se traîner, cette fois, sur les traces des Portugais. Au lieu de suivre la côte occidentale d’Afrique donc on désespérait presque de trouver le terme, Colomb pensa qu’en naviguant directement à l’ouest à travers la mer Atlantique, il trouverait infailliblement des pays nouveaux qui devaient, selon lui, tenir au vaste continent de l’Inde et de l’Asie. Plein de ce pressentiment, il ne rêva plus qu’aux moyens de parvenir à en faire connaître les résultats. L’amour de la patrie ne s’était pas éteint dans son cœur malgré une bien longue absence: il faisait des vœux pour que Gênes recueillît le fruit de ses travaux et de ses découvertes. Il proposa donc son projet au sénat de la république; mais Gênes méconnut son enfant, elle se rit du projet de Colomb et refusa dédaigneusement le monde qu’il offrait de lui donner. Après avoir ainsi accompli ses devoirs envers son pays, Colomb proposa son projet à Jean II, roi de Portugal, dans les États duquel il avait été longtemps établi, et qu’il considérait, par cette raison, comme sa seconde patrie. Mais le prince Henri ne vivait plus; Jean II, quoiqu’il favorisât les tentatives de navigation de ses sujets, n’était cependant pas homme à accueillir, de prime abord et de lui-même, le projet de Colomb; il en renvoya l’examen à son conseil. Ce conseil trouva fort audacieux qu’un étranger se permît de ne pas suivre la trace des navigateurs portugais. Jean II et son conseil refusèrent donc ce monde que leur offrait Colomb. Mais, tout en lui refusant les moyens de mettre à exécution son entreprise, ils eurent en même temps la bassesse d’envoyer, en secret, un de leurs compatriotes pour tenter la route qu’indiquait celui qu’ils avaient l’air de dédaigner. Mais Dieu veillait pour le génie de Colomb. Le Portugais ainsi envoyé à la découverte, ayant essuyé des vents contraires et n’apercevant aucun vestige de terre, se laissa effrayer, et revint à Lisbonne, où il décria le plan de Colomb comme aussi extravagant que dangereux. La trahison avait échoué.
Colomb n’en continua pas moins à offrir son monde; il passa, à cet effet, en Espagne, en même temps qu’il envoyait son frère, dans le même but, à la cour d’Angleterre. Alors régnaient, en Espagne, deux souverains célèbres, Ferdinand et Isabelle; ils avaient, par leur mariage, réuni les couronnes de Castille et d’Aragon. Ferdinand, prince peu ouvert, assez méfiant, ne se montra pas d’abord très-disposé à seconder Colomb; il en fut tout autrement d’Isabelle: cette princesse était prompte à saisir une idée grande et neuve. Quoi qu’il en soit, en Espagne aussi, le projet de Colomb fut renvoyé à l’examen d’un conseil, composé de gens ennemis déclarés de tout ce qui peut sortir des chemins vulgaires, des sentiers battus.
On ne saurait imaginer tout ce qu’eut à souffrir Colomb d’incertitudes, de lenteurs, d’espérances incessamment suivies de déceptions, pendant les huit années que l’Espagne hésita à entrer dans ses vues,—le retenant, d’une main, de peur qu’il n’eût par hasard raison et qu’il ne fît jouir une autre nation du résultat de son projet,—le repoussant, de l’autre, comme un aventurier. Enfin, au bout de ces huit années, qui mirent à toutes les épreuves l’énergique persévérance de Colomb, la reine Isabelle se décida enfin à courir personnellement la chance de conquérir tout un monde nouveau, en avançant les frais nécessaires à l’expédition projetée. Quant à Ferdinand, il déclara formellement qu’il ne tremperait pas, même pour la plus légère somme, dans une pareille extravagance. Ce qui fit alors répondre à Isabelle, en plaisantant, que si l’on trouvait de nouveaux pays, ils seraient tout entiers pour elle qui faisait seule les frais de la découverte. Toute la cour d’Espagne rit beaucoup de cette fantaisie de reine; la chose fut traitée tout aussi gaîment que si, de nos jours, il prenait à quelqu’un la folle idée d’aller, en ballon, essayer des découvertes dans la lune, et que, par caprice, une princesse se prêtât à faire les frais du ballon. Il faut le dire cependant: Isabelle n’était pas une princesse ordinaire, et sa fantaisie de céder enfin aux inspirations de Colomb (si fantaisie il y eut, comme on le croyait à sa cour), fut celle d’une grande âme. Réduite à ses ressources personnelles pour subvenir aux dépenses de l’entreprise, elle offrit de mettre ses diamants en gage. Mais un Espagnol, dont le nom mérite d’être conservé, Santangel, qui lui-même avait contribué, non-seulement de tous ses efforts, à retenir Colomb au moment où celui-ci voulait quitter l’Espagne, mais encore à décider la reine à seconder un projet si vaste, Santangel dispensa Isabelle de recourir à ce moyen extrême; il s’engagea à avancer sur-le-champ, et de ses deniers, la somme dont aurait besoin.
Un traité fut signé entre les souverains d’Espagne et Colomb. Le roi Ferdinand y prit part, mais seulement pour la forme; et, comme il s’agissait pour lui de mondes tout à fait imaginaires, il ne vit pas d’inconvénient à promettre, pour Colomb et sa postérité, le titre et les prérogatives de vice-roi des pays que celui-ci se proposait de découvrir.
Malgré les efforts réunis d’Isabelle, de Santangel et de Colomb, trois méchants navires (dont deux même n’étaient que de grandes chaloupes), furent tout ce qu’on put offrir à celui qui allait entreprendre un voyage si lointain dans des mers inconnues, et qui prétendait conquérir un monde tout entier à l’Espagne.
Colomb commandait, comme amiral, le plus fort de ces navires; il lui donna le nom de Sainte-Marie, en l’honneur de la Vierge, pour laquelle il avait une dévotion particulière. Martin Pinson commandait le second, appelé la Pinta, et avait son frère François pour pilote. Le troisième, appelé la Nigna, avait pour capitaine Yanes Pinson. Colomb était plein de sentiments de religion; il ne voulut pas s’embarquer pour une expédition si dangereuse, et dont un des principaux buts était d’étendre la foi chrétienne, sans avoir imploré, par un grand acte religieux, la protection du ciel. Pour accomplir ce devoir, lui-même et tous ceux qui le devaient accompagner, se rendirent en procession solennelle à l’église d’un monastère voisin, s’y confessèrent, et communièrent des mains du bon prieur Jean Pérès, l’un de ceux qui avaient le plus ardemment secondé Colomb. Le digne ecclésiastique joignit ses prières à celles des équipages, et les bénit.
Le lendemain au matin, mardi 3 août 1492, un peu avant le lever du soleil, Colomb mit à la voile, dans le port de Palos, petite ville maritime de la province d’Andalousie, en présence d’une foule de spectateurs qui levaient leurs mains au ciel pour en obtenir une réussite heureuse; ils la souhaitaient plus qu’ils ne l’espéraient.
Colomb cingla droit sur les îles Canaries. Le gouvernail de la Pinta se rompit dès le deuxième jour: cet accident alarma les équipages, et fut regardé, par eux, comme un augure du mauvais succès de l’expédition. Colomb fit rétablir ce gouvernail et réparer les autres navires qui déjà menaçaient, par leur frêle état de construction, de ne pouvoir soutenir un long voyage; et il partit de Gomera, l’une des plus occidentales des îles Canaries, le sixième jour de septembre 1492.
Colomb avait jusque-là vogué sur des mers connues; mais, à partir de ce moment, il s’aventura sur des océans auxquels, avant le sien, aucun navire ne s’était confié. Il fit voile directement vers l’ouest, abandonnant toutes les routes suivies précédemment. Le second jour, on avait perdu de vue les Canaries. Aussitôt plusieurs de ses matelots, consternés en réfléchissant à l’audace de leur entreprise, commencèrent à déplorer leur sort, à verser des larmes, comme s’ils ne devaient plus revoir la terre dont ils s’éloignaient. Heureusement Colomb possédait l’art de manier l’esprit des hommes et de maîtriser leurs passions; il réussit à réprimer ce premier mouvement de terreur dans ses équipages.
Rien ne se fit en mer que par ses ordres; il veillait lui-même à l’exécution de toutes les manœuvres; il ne prenait que quelques heures de sommeil et ne quittait jamais le pont. La sonde et tous les autres instruments de marine étaient sans cesse dans ses mains. Il était attentif au mouvement des marées, à la direction des courants, au vol des oiseaux; il observait les poissons, les plantes et tous les corps flottants sur la mer.
Le 14 septembre, la petite flotte se trouvait à plus de deux cents lieues à l’ouest des îles Canaries, plus loin de terre qu’aucun vaisseau espagnol n’avait été jusqu’alors. Colomb continua de porter droit à l’ouest. En suivant cette route, il trouva les vents alisés qui soufflent constamment de l’est à l’ouest entre les Tropiques. Ces vents, toujours fixes, le poussèrent avec une rapidité si constante, qu’il fut rarement nécessaire d’employer la voile. A environ quatre cents lieues des Canaries, il trouva la mer si couverte de plantes, qu’elle ressemblait à une prairie d’une vaste étendue, et ces plantes étaient, en quelques endroits, si épaisses que la marche du vaisseau en était retardée. Des inquiétudes se firent sentir de nouveau; les matelots s’imaginèrent être arrivés aux dernières bornes de l’Océan navigable; ils croyaient que les herbes, devant les empêcher de pénétrer plus avant, cachaient des écueils dangereux, ou bien une grande étendue de terres submergées. Colomb s’efforça de leur persuader que l’objet qui les effrayait était plutôt de nature à les encourager, comme étant le signe du voisinage de quelque continent: en même temps un vent frais les dégagea de ces herbes. On vit plusieurs oiseaux voltiger au-dessus du navire, et diriger leur vol vers l’ouest. L’équipage abattu reprit donc courage.
Le 1er octobre, Colomb se trouva, selon son estime, à sept cent soixante-dix lieues à l’ouest des Canaries. Les équipages étaient depuis trois semaines en mer, toujours avançant dans la même direction sans avoir jamais aperçu la moindre apparence de terre, et cependant ils avaient beaucoup plus fait qu’aucun des navigateurs n’avaient tenté avant eux. L’espoir d’aborder à une terre quelconque semblait donc s’évanouir plus que jamais. Des sourds murmures, on en vint alors à des plaintes ouvertes; on s’éleva contre la crédulité de souverains assez confiants dans les vaines promesses d’un misérable étranger pour compromettre l’existence d’un grand nombre de leurs sujets à la poursuite d’un plan chimérique; on protestait même avoir pleinement satisfait à ses devoirs en s’aventurant si loin dans une route dont le terme était inconnu, et en refusant de suivre plus longtemps un aventurier qui courait, tête baissée, à une mort certaine; bref, on convint de chercher à contraindre Colomb à prendre un parti auquel était attaché le salut commun. De plus audacieux allèrent jusqu’à proposer de jeter cet homme à la mer, persuadés qu’ils étaient qu’à leur retour en Espagne, la mort d’un pareil aventurier n’exciterait ni intérêt ni pitié.
Colomb sentit parfaitement tout le danger de sa situation; il avait reconnu avec douleur les funestes effets de l’ignorance et de la crainte dans le mécontentement de ses équipages: il voyait une révolte près d’éclater. Toutefois, malgré toutes ses inquiétudes, il conserva sa présence d’esprit, montra constamment le visage gai d’un homme content des succès qu’il a déjà obtenus, et qui en attend de plus grands encore: il feignit d’ignorer les complots qui se tramaient autour de lui, et, par sa bonne contenance et ses discours, il réussit encore à calmer les esprits.
A mesure qu’on avançait, toutes les apparences du voisinage d’un continent semblaient se confirmer; des oiseaux apparaissaient par troupes, volant au sud-ouest. Colomb, à l’instar des navigateurs portugais, que le vol des oiseaux avait guidés dans leurs découvertes, changea donc de direction et porta au sud-ouest; mais après avoir tenu, plusieurs jours, cette nouvelle route sans succès, et ne voyant toujours que le ciel et l’eau, les matelots perdirent de nouveau l’espérance; la crainte se réveilla plus terrible, la rage et le désespoir éclatèrent sur tous les visages. Seul, au milieu du danger et des menaces, Colomb gardait une physionomie impassible. Les officiers, qui avaient jusque-là partagé sa confiance dans le succès de l’entreprise et soutenu son autorité, commencèrent à se ranger du côté des mécontents.
Alors toute subordination est détruite; on s’assemble tumultueusement sur le pont; on exige que Colomb reprenne sur-le-champ la route d’Europe. Ainsi Colomb, abandonné de tous, réduit à lui seul, allait être contraint de céder au nombre, à la terreur et aux menaces de ses équipages. Jugez de son désespoir! perdre un monde au moment où son génie lui disait qu’il y touchait. «Trois jours! trois jours seulement encore! s’écria-t-il. Si, dans trois jours, je ne vous donne un monde, j’y consens, j’abandonne l’entreprise, et je vous ramène en Espagne.» Et le grand homme, en suppliant qu’on lui accordât ce délai, sentait des larmes d’indignation rouler dans ses yeux: il les réprima. Les matelots hésitaient. «Eh bien! m’accorde-t-on les trois jours?» demanda Colomb.—On lui en a déjà donné trente, répondit un des plus insolents parmi les matelots.—Trois jours, reprenait Colomb, trois jours! ne me les refusez pas!... Tenez, la terre est là; je la sens, je la vois, elle m’appelle.—Allons, soit, encore trois jours, disent les moins lâches; risquons encore trois jours; mais le quatrième, l’Espagne! rien que l’Espagne!
—Et s’il me fallait seulement quelques heures du quatrième jour pour toucher à ce monde que devine mon génie, pensa Colomb, les misérables ne me les accorderaient même pas, et la moitié de la terre courrait risque de demeurer encore au néant pour l’autre, pendant des siècles! Colomb leva les yeux au ciel pour le remercier des trois jours qu’on lui accordait, et pour le supplier de lui faire toucher la terre qu’il cherchait, avant que le soleil du troisième se fût caché.
Colomb continua à voguer dans l’anxiété la plus grande à laquelle jamais cœur humain ait été en proie. O quelle fut sa joie, lorsque l’équipage de la Pinta fit savoir à Colomb que l’on avait aperçu, sur les flots, un roseau fraîchement coupé: ce roseau fit tressaillir d’aise le grand homme; il s’y rattacha comme au but de ses espérances. Bientôt ce fut une pièce de bois travaillée de main d’homme que l’on distingua, puis une branche d’arbre flottante avec des baies rouges aussi très-fraîches: c’était à ces modestes signes que l’approche d’une moitié de la terre se révélait: enfin l’air était plus doux, plus chaud, et, durant la nuit, le vent devenait inégal et variable. Le cœur de Colomb palpitait. Il tomba à genoux sur le pont de la Sainte-Marie, et, tous ses matelots l’imitant, il pria Dieu avec ferveur de ne pas lui faire perdre un bien si longtemps cherché au moment d’y toucher; puis il fit carguer toutes les voiles, tenir les trois vaisseaux en panne et veiller toute la nuit, de peur d’être jetés sur quelque côte. En ce moment de crise et d’attente, personne ne ferma les yeux. Tous les regards étaient fixés du même côté, vers le point que Colomb indiquait du doigt, sans le voir toutefois encore autrement que dans son génie.
Vers les dix heures du soir, Colomb, étant sur le gaillard d’avant, observa une lumière à quelque distance, et tirant à part Pierre Guttières, page de la reine Isabelle, il la lui montra. Guttières la distingua fort bien, et appelant Solado, commissaire de l’escadre, tous trois reconnurent qu’elle était en mouvement, comme si on la portait d’un lieu à un autre. Un peu après minuit, on entendit crier: «Terre! Terre!» du bord de la Pinta, laquelle était toujours en tête; mais on avait été si souvent abusé par les apparences, qu’on croyait à peine à tant de bonheur, et l’on attendit le jour avec l’anxiété la plus vive. Le jour parut enfin, et avec lui tous les doutes s’évanouirent. On vit distinctement, à deux lieues au nord, une île verdoyante, ombragée de bois, arrosée de ruisseaux, présentant l’aspect d’un pays délicieux. Oh! alors les équipages des trois navires, à la vue de cette île, entonnèrent un sublime Te Deum, entre la mer et le ciel, pour remercier le Très-Haut. On versait des larmes de joie; on se félicitait mutuellement. Les actions de grâces qu’on rendit au ciel, furent suivies de la réparation qu’on devait au grand homme: les matelots se jetèrent aux pieds de Colomb avec toutes les marques d’un sincère repentir et du respect qu’il leur inspirait; ils lui demandèrent pardon de leur ignorance, de leur incrédulité, de leur insolence, qui lui avaient causé tant de peine et mis tant d’obstacles à l’exécution d’un plan aussi bien concerté que le sien. Passant enfin d’une extrémité à l’autre, l’homme que naguère encore ils insultaient et menaçaient, ils le regardèrent, dans leur admiration, comme inspiré par le ciel et doué d’un génie au-dessus de l’humanité. Colomb reçut ces hommages sans vanité, avec le seul sourire d’une conscience satisfaite.
Au lever du soleil, toutes les chaloupes, remplies d’hommes armés, s’avancèrent vers l’île, enseignes déployées, au son d’une musique guerrière. A mesure qu’on approchait de la côte, on la voyait se couvrir d’habitants, dont l’attitude et les gestes exprimaient l’étonnement étrange que leur causait le spectacle extraordinaire qui s’offrait à leurs yeux. Colomb fut le premier Européen qui mît le pied dans ce Nouveau-Monde qu’il venait de découvrir; il débarqua revêtu d’un riche costume, l’épée à la main, et ses compagnons à sa suite; tous baisèrent d’abord la terre, après laquelle ils soupiraient depuis si longtemps; après quoi, ils élevèrent un crucifix, et, se prosternant, remercièrent Dieu de leurs succès.
Colomb donna à l’île qu’il venait de découvrir le nom de San-Salvador (Saint-Sauveur); les naturels du pays l’appelaient Guanahani. C’était l’une des îles Lucayes, aujourd’hui possédées par les Anglais, dans les Antilles.
Les Espagnols se trouvèrent bientôt environnés d’un grand nombre d’insulaires, qui les contemplaient en silence et avec admiration. Les vêtements des Européens, la blancheur de leur peau, leur barbe, leurs armes, tout étonna ces hommes. Mais ce fut surtout les grandes machines sur lesquelles Colomb et ses équipages venaient de traverser les mers, qui semblaient se mouvoir sur les eaux avec des ailes et portaient au loin un bruit terrible, accompagné d’éclairs et de fumée, qui les frappèrent d’une terreur telle qu’ils commencèrent à regarder leurs nouveaux hôtes comme des enfants du soleil, descendus sur la terre pour la visiter. De leur côté, les Européens n’étaient guère moins surpris de tout ce qu’ils voyaient. Les arbres, les arbustes, l’herbe même, tout était différent de ce qui croissait en Europe. Les habitants étaient entièrement nus; leurs cheveux noirs et longs flottaient sur leurs épaules, ou relevés en tresses autour de leur tête. Ils n’avaient pas trace de barbe; leur teint était de couleur cuivre foncé; leurs traits singuliers, sans être désagréables; leur physionomie, douce et timide; leur visage et une partie de leur corps, bizarrement peints de couleurs éclatantes. D’abord la crainte les tint un peu sur la réserve; puis bientôt ils se familiarisèrent avec les Espagnols et reçurent d’eux, avec des transports de joie, des grelots, des grains de verre et autres bagatelles, pour lesquelles ils donnèrent en échange quelques provisions et du fil de coton, seule marchandise de quelque valeur qu’ils pussent fournir.
Vers le soir, Colomb retourna à ses vaisseaux; un grand nombre d’insulaires l’accompagnèrent dans des espèces de bateaux, appelés par eux canots, faits d’un seul tronc d’arbre, et qu’ils maniaient avec une adresse surprenante. Colomb employa le jour suivant à faire le tour de l’île. La pauvreté des habitants lui fit préjuger que ce n’était pas là le riche pays qu’il cherchait. Toutefois, ayant observé que la plupart de ces gens portaient de petites plaques d’or, comme ornement à leurs narines, il ne manqua pas de leur demander d’où ils tiraient ce précieux métal; alors ils lui montrèrent le sud, en lui faisant comprendre, par signes, que l’or abondait dans les pays situés vers cette direction. Déterminé à diriger sa route de ce côté, Colomb emmena avec lui sept des naturels de San-Salvador pour lui servir de guides, dès qu’ils auraient appris un peu d’espagnol. Il découvrit alors plusieurs îles, et prit terre à trois des plus considérables; mais comme le sol, les productions, les habitants, étaient là partout les mêmes qu’à San-Salvador, il ne s’arrêta dans aucune d’elles. Il s’informait d’où venait l’or, et partout on lui faisait cette même réponse: qu’il était apporté du sud. En suivant donc toujours cette direction, il finit par découvrir une contrée d’une grande étendue, non plate comme les îles qu’il avait déjà visitées, mais semée de collines, de montagnes, de rivières, de baies et de plaines, de sorte qu’il douta si c’était une île ou un continent.
Les habitants de San-Salvador qu’il avait pris à son bord donnaient, à cette terre, le nom de Cuba qu’elle conserve encore aujourd’hui. C’est la plus grande île des Antilles. Colomb pénétra dans l’embouchure d’une belle rivière avec sa petite escadre; mais tous les habitants s’enfuirent, à son approche, dans les montagnes. Ses gens s’étant avancés à vingt lieues environ dans le pays, lui annoncèrent qu’outre un grand nombre de huttes éparses, ils avaient trouvé un village contenant plus de mille habitants; ceux-ci, nus et cuivrés comme ceux de San-Salvador, leur avaient baisé les pieds et les avaient honorés comme des êtres descendus du ciel. Les avides Espagnols avaient surtout remarqué que les habitants de Cuba portaient aussi des ornements d’or. Les naturels, étonnés de l’empressement extrême que mettaient les Européens à rechercher ce métal, leur avaient indiqué, à l’est, une île qu’ils appelaient Haïti, en faisant entendre que l’or y était plus abondant que chez eux. Colomb se disposa à faire voile vers cette île avec son escadre; il y arriva le 6 décembre 1492.
Il donna à l’île le nom d’Hispaniola; mais celui de Saint-Domingue, dû au principal des établissements qu’on y fonda, et le nom d’Haïti, donné par les anciens insulaires, ont prévalu. Colomb apprit que cinq caciques, ou princes du pays, se partageaient le gouvernement de l’île; il reçut la visite de l’un d’eux; ce cacique était porté dans un palanquin, sur les épaules de quatre hommes, et suivi d’un grand nombre de ses sujets qui lui témoignaient le plus grand respect. Son maintien était grave et digne. Il offrit à Colomb quelques plaques d’or et une ceinture d’un travail curieux. Les naturels d’Haïti étaient nus et avaient la peau bariolée de couleurs, comme ceux des îles précédemment découvertes. Bientôt Colomb reçut, d’un des autres caciques, la proposition d’une entrevue; il fit voile pour une autre partie de la côte. La multiplicité de ses travaux ne lui avait pas permis de fermer les yeux depuis deux jours; il se retira vers minuit pour prendre quelque repos, après avoir remis le gouvernail aux mains du pilote, avec défense expresse de le quitter. Celui-ci, se croyant à l’abri de tout danger, l’abandonna à un mousse sans expérience; il advint que le vaisseau, emporté par un courant, toucha contre un rocher. La violence du choc éveilla Colomb; il courut sur le pont; tout était dans la confusion et le désespoir; lui seul conserva sa présence d’esprit. Néanmoins tout ce qu’il put faire, ce fut de sauver l’équipage. Le premier de ses vaisseaux était donc perdu; d’autre part, le capitaine de la Pinta, l’un des frères Pinson, méditant une trahison odieuse, s’était séparé de Colomb, avec son navire, dans la coupable intention d’aller porter le premier, en Espagne, la nouvelle de la grande découverte. Le cacique rendit visite à Colomb, à bord de la Nigna, et s’efforça de le consoler en lui offrant de faire tout ce qui dépendrait de lui pour l’aider à réparer son malheur. Les insulaires, préposés par son ordre à la garde des objets échappés au naufrage de la Sainte-Marie, s’acquittèrent de leur mission avec beaucoup de zèle et de loyauté.
Ces témoignages d’amitié qu’il recevait à Haïti, décidèrent Colomb à laisser quelques-uns de ses gens dans l’île et à faire voile pour l’Espagne, dans le but de prévenir Pinson, ce traître, qui voulait lui ravir sa gloire. Mais, avant de se séparer, pour un temps déterminé, de ceux qui lui restaient fidèles, Colomb voulut assurer leur sécurité. Il fallait obtenir, d’un des caciques de l’île, le droit de bâtir un fort sur la côte. Le prince qu’il venait de voir, lui épargna précisément la peine de faire pareille demande, car il sollicita de lui-même la protection des Espagnols contre certains peuples, appelés caraïbes ou guerriers, qui sortaient fréquemment d’autres îles, situées au sud-ouest, pour lui faire la guerre. Ces sauvages se plaisaient dans le carnage et dévoraient la chair des prisonniers tombés entre leurs mains. Colomb n’eut pas de peine à persuader au cacique de se fortifier contre les attaques des Caraïbes, à l’aide des Espagnols; et, sur-le-champ, il traça un petit fort auquel il donna le nom de la Nativité, parce qu’il était débarqué, sur cette côte, le jour de Noël. Il fit creuser un fossé profond, élever des remparts; placer enfin de gros canons sauvés du naufrage de la Sainte-Marie par les soins des confiants insulaires qui contribuèrent eux-mêmes aussi à l’élévation du fort. En dix jours, l’œuvre fut achevée, et les Espagnols s’installèrent dans leur petite citadelle au bruit du canon et de la mousqueterie. Les Haïtiens d’alors, qui ne connaissaient d’autres armes que les flèches de roseau armées d’os de poisson, des sabres et des javelines de bois durci au feu, furent saisis d’une terreur sainte et mystérieuse, semblable à celle qu’inspire le bruit des tonnerres célestes. C’était bien là ce qu’espérait Colomb, qui, ne laissant dans l’île que trente-huit des siens, avait besoin de les faire passer pour des êtres au-dessus de l’humanité, contre lesquels toutes les forces réunies de l’île demeureraient impuissantes.
Ceci fait, il s’embarqua pour l’Espagne. Il n’y avait pas deux jours qu’il faisait voile avec le seul et misérable bâtiment qui lui restait, que la justice du ciel lui fit rencontrer le navire que montait le traître Pinson. Il le rejoignit après une séparation de plus de six semaines, et, sans y croire, il accepta en apparence toutes les raisons du capitaine pour justifier cette séparation de la Pinta. Le voyage fut heureux pendant près de cinq cents lieues; mais, des vents violents s’élevèrent insensiblement, et finirent par dégénérer en un ouragan terrible; le désespoir était partout; mais, dans l’âme de Colomb, il était seulement accompagné de réflexions qui le lui rendaient plus déchirant encore: l’admirable découverte qu’il venait de faire, allait donc périr avec lui. Après tant d’efforts inouïs, son nom allait donc passer à la postérité comme celui d’un imprudent aventurier, au lieu de vivre, dans la mémoire des hommes, comme celui de l’auteur de la plus belle découverte qu’on eût jamais faite! Moins touché de la perte de sa vie que préoccupé du soin de sauver de l’oubli les grandes choses qu’il avait exécutées, il se retira dans sa chambre, écrivit sur parchemin un récit abrégé de son voyage: ayant ensuite enveloppé cet écrit dans une toile cirée, enduite à son tour d’une forte couche de cire, il mit ce paquet dans un tonneau bouché avec le plus grand soin et le jeta à la mer, dans l’espérance que les flots porteraient ce dépôt précieux à quelque rive européenne.
Enfin la Providence vint au secours du grand homme, et sauva une vie réservée à d’autres grands événements. Le vent tomba, la mer se calma; et, après avoir touché aux îles Açores, puis aux côtes du Portugal, Colomb arriva, le 15 mars 1493, à ce même petit port de Palos d’où il était parti, moins de sept mois auparavant, pour aller à la découverte de la plus vaste portion du globe. Dès qu’on signala son vaisseau, tous les habitants de la ville coururent au rivage pour embrasser leurs parents, leurs compatriotes, et savoir des nouvelles de l’expédition. Mais lorsqu’on en eut appris l’heureux succès, quand on eut vu ces hommes extraordinaires que Colomb ramenait avec lui, ces animaux inconnus, ces productions inouïes des pays qu’il avait découverts, alors l’effusion de la joie et de l’enthousiasme fut immense, on ne la put contenir; toutes les cloches furent mises en branle; on tira le canon. En débarquant, Colomb fut reçu avec des honneurs égaux à ceux que l’on rendait au roi d’Espagne. Tout le peuple, en procession solennelle, l’accompagna lui et sa troupe à l’église, où ils allèrent remercier Dieu d’avoir couronné d’un si éclatant succès le voyage le plus long et le plus important qui eût jamais été entrepris jusque-là. Le bon prieur Jean Pérès, qui avait béni le départ, officia pour le retour.
Le roi et la reine d’Espagne se trouvaient alors à Barcelonne; ils firent appeler sur-le-champ Colomb auprès d’eux: le peuple accourut en foule de toutes parts sur son passage pour l’admirer et lui prodiguer des applaudissements. Le voyage se faisait avec une pompe ordonnée par Isabelle; les insulaires qu’avait amenés Colomb marchaient en tête; leur teint, leur physionomie et la singularité de toute leur personne les faisait regarder comme des hommes d’une nouvelle espèce; après eux, on portait les ornements d’or façonnés par l’art grossier de ces peuples, les grains d’or trouvés dans les montagnes, la poudre de même métal recueillie dans les rivières; enfin les différentes productions de ces pays nouveaux. Colomb fermait la marche et attirait tous les yeux; on le contemplait avec admiration.
Ferdinand et Isabelle reçurent l’illustre navigateur assis sur leur trône, revêtus de tous les ornements royaux et placés sous un dais magnifique. A son approche, ils se levèrent, et, ne permettant pas qu’il se mît à genoux pour leur baiser la main, ils lui ordonnèrent de s’asseoir sur un siége préparé pour lui et de leur faire le récit de son voyage: ce qu’il fit avec noblesse et simplicité. Lorsqu’il eut fini sa narration, le roi et la reine se mirent à genoux pour rendre grâce à Dieu du plus grand événement qui eût eu lieu sur la terre, depuis la naissance du Christ... la découverte d’un monde!
Dans le premier mouvement d’enthousiasme, l’ombrageux Ferdinand lui-même avait confirmé Christophe Colomb dans son titre de vice-roi des pays qu’il avait découverts, pour lui et ses descendants; bref, on ne lui avait rien refusé de ce qu’on s’était engagé à lui donner: ce qui coûtait d’autant moins, que c’est à lui qu’on devait tout. Mais dès qu’on fut un peu revenu de ce premier élan généreux, l’intrigue, la jalousie, toutes les basses et viles passions des cours commencèrent à se liguer contre le grand homme. Toutefois put-il encore partir heureux et fier pour son second voyage, à la tête d’une flotte plus convenable que la première. Colomb était impatient de revoir la colonie qu’il avait laissée à Haïti et de suivre la carrière de gloire qu’il s’était ouverte. Cinq semaines environ après ce nouveau départ, il prit terre à l’une de ces îles des Antilles dont le groupe, en raison de sa position, a reçu le nom d’îles du Vent. Il nomma celle à laquelle il aborda Désirade, à cause du désir que ses équipages manifestaient de toucher à quelque partie du Nouveau-Monde. Il découvrit ensuite la Guadeloupe, Marie-Galande ces trois îles appartiennent aujourd’hui à la France, puis la Dominique, Antigoa, Saint-Jean de Porto-Rico, et plusieurs autres îles qu’il trouva en s’avançant, du sud au nord, vers Haïti: toutes étaient habitées par ces cruels Caraïbes dont le cacique d’Haïti avait tant parlé à Colomb. Les Espagnols les trouvèrent absolument tels qu’on les leur avait dépeints; et toutes les fois qu’ils débarquèrent sur leur côte, ils furent reçus par eux de manière à bien juger de l’esprit guerrier et de l’audace de ces insulaires, que les bizarres peintures de leur peau rendaient d’ailleurs plus effrayants encore: ils découvrirent même, dans leurs habitations, jusqu’aux horribles restes des repas qu’ils faisaient avec les corps de leurs ennemis, une fois prisonniers: enfin ils avaient une affreuse chanson que quelques peuplades du continent de l’Amérique méridionale chantent encore.
Ces affreux Caraïbes habitaient, à l’époque de la découverte de Colomb, les jolies îles, aujourd’hui françaises, de la Guadeloupe, de Marie-Galande, de la Martinique, ainsi que plusieurs autres situées dans les mêmes parages.
Colomb faisait joyeusement voile vers Haïti, où, selon toute probabilité, l’attendaient avec impatience les trente-huit Espagnols qu’il y avait laissés. Il arrive, personne d’entre eux ne se montre, personne n’accourt au-devant de lui. Quant aux naturels, qui s’étaient montrés si confiants à son départ, ils prirent la fuite dès qu’ils eurent distingué ses voiles. Colomb débarque; il trouve son fort démoli. Alors plus de doute, une affreuse catastrophe a eu lieu; les trente-huit Espagnols ont été massacrés par les habitants. Mais bientôt il a le regret d’apprendre que leur tyrannie, leurs cruautés, joints à leur imprudence, leur ont attiré ce sort.
Colomb rejeta l’avis de plusieurs de ses officiers, qui voulaient venger la mort trop méritée de leurs compatriotes par un massacre des insulaires et de leurs caciques. Au lieu de perdre le temps à venger des maux accomplis, Colomb s’occupa des précautions à prendre pour prévenir de nouveaux malheurs. Il fit choix d’une situation saine et commode, et jeta les fondements de la première ville que les Européens aient construite en Amérique. Il contraignit tous les Espagnols à y travailler, et lui-même, le vice-roi des nouvelles colonies, donna l’exemple en mettant la main à l’œuvre. Comme il ne permettait pas aux Espagnols de tyranniser à leur gré les insulaires, et qu’on ne trouvait pas d’ailleurs sous les pieds autant de lingots d’or que de caillous, ainsi que beaucoup avaient eu la niaiserie de l’espérer, des ennemis commencèrent à se déclarer contre lui dans le sein même de sa troupe, et, sur ces entrefaites, les intrigues allaient toujours leur train à la cour d’Espagne. Le grand Colomb fut donc obligé d’interrompre son plan de colonisation d’Haïti et le cours de ses découvertes pour aller demander justice aux souverains dont il faisait la gloire, contre les attaques dont on le menaçait de toutes parts. Il emportait avec lui, dans ce second retour en Espagne, la soumission à la couronne de Ferdinand et d’Isabelle de tous les insulaires d’Haïti et de leurs caciques; et comme, au nombre des honteux griefs qu’on lui imputait, on parlait de la prétendue pauvreté des pays qu il avait découverts, il apportait la preuve irrécusable de leur richesse. Déjà le peuple inconstant ne faisait plus cortège à Colomb sur son passage; déjà on ne le portait plus en triomphe. Il parut à la cour avec la confiance tranquille, mais modeste, d’un homme qui se regarde non-seulement comme irréprochable, mais comme ayant rendu d’importants services. Ferdinand et Isabelle, honteux d’avoir prêté l’oreille à des accusations injustes, reçurent Colomb avec une considération si marquée, que ses ennemis demeurèrent, pour un temps, couverts de confusion. Mais ils ne devaient pas tarder à reprendre courage.
Bientôt Colomb, pressé de mettre à fin l’œuvre de sa découverte, partit pour son troisième voyage; à dessein il s’écarta plusieurs jours de ses premières routes, dans l’espérance de faire de nouvelles découvertes. Le 1er août 1498, le matelot de garde sur la hune du vaisseau amiral, excita dans l’équipage une agréable surprise, en criant: Terre! On gouverna de ce côté, et l’on découvrit une île considérable que Colomb appela île de la Trinité, nom quelle conserve encore aujourd’hui. Elle est située sur la côte de la Guyane, près de l’embouchure de l’Orénoque. Cette rivière, quoique de troisième ordre pour la grandeur parmi celles du Nouveau-Monde, surpasse de beaucoup toutes celles de notre hémisphère; elle porte à l’Océan une masse d’eau si énorme, et coule avec tant d’impétuosité, que lorsqu’on rencontre la marée qui, sur cette côte, monte à une très-grande hauteur, il se fait un terrible choc qui agite et élève les flots d’une manière surprenante; et cependant la rapidité du fleuve lui fait maîtriser encore la marée, et on le voit porter ses eaux à plusieurs lieues dans l’Océan, sans les y mêler.
Avant d’avoir pu connaître le danger, Colomb se trouva engagé entre ce courant formidable et les vagues amoncelées; il n’échappa que par miracle à une mort inévitable, et encore même par un détroit qui lui parut si dangereux, qu’il l’appela la Bouche du Dragon. Ce péril une fois passé, il trouva dans l’objet même de son juste effroi des motifs d’espérance; il conjectura fort judicieusement qu’une si grande rivière ne pouvait être fournie par une île, mais qu’elle devait couler au travers d’un très-grand continent, et il ne douta pas que ce ne fût celui qu’il cherchait depuis si longtemps. Plein de cette idée, il navigua à l’ouest le long de la côte des provinces aujourd’hui connues sous les noms de Para et de Cumana; il prit terre en différents endroits, y établit quelques relations avec les habitants, dont les traits et les mœurs lui parurent ressembler à ceux des Indiens d’Haïti; ils portaient des ornements d’or en petites plaques et des perles fort belles, qu’ils échangèrent volontiers pour de petites merceries d’Europe: ils semblaient doués de plus d’intelligence et de courage que les habitants des îles. On voyait là des quadrupèdes de diverses espèces et une grande variété d’oiseaux et de fruits. Colomb fut si transporté de la beauté du pays, que, plein de cet enthousiasme qui accompagne ordinairement la passion des découvertes, il imagina que c’était là le paradis terrestre que Dieu avait donné à l’homme pour y habiter, tant que son innocence le rendrait digne d’un si beau séjour.
Peu de temps après, quelques armateurs s’étant réunis sous le patronage de la cour d’Espagne, quoiqu’à leurs frais, pour aller à la découverte sur les traces de Colomb, Améric Vespuce, gentilhomme florentin, fut de ce nombre; il était bon marin à ce qu’il paraît, et de plus fort adroit: il acquit tant d’empire sur ses compagnons, qu’ils lui abandonnèrent la direction du voyage. Il ne prit aucune route que Colomb n’eût déjà parcourue avant lui; mais il écrivit la relation de ses aventures, et, pressé de la vanité si commune aux voyageurs de se donner de la célébrité, il parla en homme qui avait, le premier, découvert le continent de l’Amérique, sous prétexté que Colomb n’en avait vu que les îles. Celte relation d’Àméric Vespuce était écrite avec charme; nulle autre n’avait paru, avant la sienne, sur le Nouveau-Monde; car Colomb préoccupé de plus grandes choses, avait négligé ces petits moyens de célébrité. Peu à peu donc on s’accoutuma à appeler le nouveau continent du nom de celui qui l’avait peint sous des couleurs si séduisantes. Le caprice des hommes, souvent aussi inexplicable qu’injuste, a toujours perpétué l’erreur; et cette vaste partie du monde, que le cri de la reconnaissance publique aurait dû nommer Colombie, s’appelle aujourd’hui encore Amérique: l’imposteur l’emporta en apparence sur le grand homme. Il est vrai que c’est à peine si l’on sait de nos jours quel était celui qui donna à l’Amérique son nom insignifiant. Comme Christophe Colomb et les navigateurs qui suivirent ses traces, crurent que l’Amérique tenait aux Indes orientales, on appela ces contrées les Indes occidentales; ce nom leur est concurremment resté, et les naturels de l’Amérique sont appelés encore des Indiens.
Si Colomb n’avait eu à souffrir que de ce genre d’ingratitude qui le frappa dans sa renommée, cela ne l’eût pas du moins atteint de son vivant; mais une sorte de martyre l’attendait, car les hommes jaloux vous font cruellement expier la gloire. Après avoir parcouru le continent, objet de ses désirs, Colomb fit voile pour la colonie qu’il avait fondée à Haïti. Sa santé avait déjà beaucoup souffert des travaux de son imagination, de la fatigue des voyages, et plus encore des indignes tracasseries qu’on lui avait suscitées. Colomb, en abordant pour la seconde fois à Haïti, y trouva une révolte ouverte contre l’autorité de celui qu’il avait nommé pour le remplacer en son absence, et une désunion affreuse parmi les Espagnols. Malgré la fièvre qui le consumait, il lui fallut travailler jour et nuit à rétablir l’ordre; il y parvint: mais le nombre de ses ennemis secrets ne fit que s’en accroître. On fit passer tant de calomnies contre lui à la cour d’Espagne, que Ferdinand et Isabelle eurent l’insigne faiblesse d’y croire, et de nommer un intrigant, du nom de François de Bovadilla, pour examiner la conduite de Colomb, et le remplacer, s’il trouvait les accusations fondées. Bovadilla avait un si grand intérêt à se ranger du côté des accusateurs de Colomb, qu’il ne prit pas même la peine de rechercher la vérité. En débarquant à Haïti, il prit possession de la maison du vice-roi alors absent, saisit tous ses effets, se rendit maître du fort, se fit reconnaître en qualité de gouverneur général, appela à son aide les bandits et les assassins qu’il fit sortir des prisons où les avait jetés la justice de Colomb... Il osa plus encore... Sans daigner même voir le grand homme, il le fit arrêter, et, pour comble d’ignominie, lui fit mettre les fers aux pieds. Ainsi donc, celui qui avait découvert un monde fut traîné, chargé de chaînes, comme un malfaiteur, à bord d’un vaisseau. Jusque dans cet humiliant revers de fortune, le beau caractère de Colomb ne l’abandonna pas. Rassuré par le témoignage de sa conscience, et se consolant lui-même par le souvenir des grandes choses qu’il avait exécutées, il souffrit le plus horrible des outrages non-seulement avec calme, mais avec dignité. L’infâme Bovadilla fit également charger de fers les deux frères de Colomb qui, attirés par sa gloire, l’étaient venus rejoindre en Amérique; et, ajoutant la cruauté à l’insulte, il les fit placer sur des vaisseaux différents pour les priver du bonheur de se voir.
Pour l’honneur du nom espagnol, Alonzo de Vallejo, capitaine du vaisseau sur lequel se trouvait Colomb, ne fut pas plutôt hors de vue d’Haïti qu’il s’approcha de son prisonnier avec respect, et lui offrit de lui enlever les fers dont il était si injustement chargé. «Non, répliqua le grand homme avec une généreuse indignation; je porte ces fers par l’ordre du roi et de la reine d’Espagne; j’obéirai à ce commandement comme à tous ceux que j’ai reçus d’eux: leur volonté m’a dépouillé de ma liberté, leur volonté seule peut me la rendre.» Heureusement le voyage fut court.
Aussitôt que Ferdinand et Isabelle apprirent que Colomb leur était amené prisonnier, le remords les saisit au cœur. Qu’allait dire l’Europe de ces deux souverains qui donnaient des fers à celui de qui ils avaient reçu un monde? Le besoin de sauver leur réputation d’une ineffaçable honte leur fit affronter, un moment, les intrigues des ennemis de Colomb; ils firent enlever ses chaînes, l’invitèrent à venir à la cour, lui envoyèrent même de l’argent, afin qu’il y parut d’une manière convenable à son rang. Colomb demeura quelque temps silencieux; les paroles lui manquaient pour exprimer l’étonnement que lui causait la crédulité de ses souverains; enfin la voix lui revenant, sa justification fut entière. Le froid Ferdinand ne put s’empêcher de lui témoigner des égards. Plus expansive, Isabelle le traita avec une sorte de respect et d’admiration. Tous deux, chagrins de l’opprobre qu’on lui avait fait subir, destituèrent Bovadilla; mais Ferdinand, dans son inquiète jalousie, ne rendit cependant pas à Colomb sa position de vice-roi: il déchira le traité qu’il avait passé avec lui avant la découverte. Sous divers prétextes, on retint enfin Colomb à la cour, et l’on envoya à Haïti un nouveau gouverneur à sa place.
Colomb fut vivement frappé de ce coup que lui portaient les mains même qui semblaient s’employer à guérir ses anciennes blessures: son âme était à bon droit ulcérée de la bassesse et de la trahison des Espagnols. Partout où il allait, il portait avec lui, comme un monument de leur ingratitude, les fers dont ils l’avaient meurtri: il les avait toujours suspendus dans sa chambre, et il voulut qu’à sa mort on les ensevelît dans son cercueil.
L’âme de Colomb était néanmoins toujours infatigable; nonobstant tous les dégoûts dont on l’abreuvait, il entreprit un quatrième voyage sur des vaisseaux délabrés, les seuls que Ferdinand daignât lui accorder. Un ouragan violent dont son expérience lui faisait pronostiquer les approches l’engagea, contre sa première intention, à s’approcher des côtes d’Haïti, et il demanda au nouveau gouverneur la permission de venir s’y mettre à l’abri dans le hâvre; il n’éprouva qu’un refus molestant; mais le ciel se chargea cette fois de le venger. Méprisant l’avis qu’il avait donné d’une tempête prochaine, une flotte de dix-huit vaisseaux qui se trouvait dans le port mit à la voile pour l’Espagne: la nuit suivante, l’ouragan éclata avec une terrible furie. Colomb avait pris toutes ses précautions; il se sauva avec sa petite escadre délabrée. Des dix-huit vaisseaux sortis d’Haïti, trois seulement échappèrent au naufrage: l’infâme Bovadilla et un assez grand nombre des persécuteurs de Colomb périrent dans les flots avec toutes les richesses que leur avaient acquises leur injuste oppression et leur cruauté.
Colomb poursuivit quelque temps encore ses découvertes tout le long des côtes de l’Amérique, mais avec des chances diverses. D’affreuses tempêtes mirent souvent ses navires à deux doigts de leur perte: il en perdit un, fut obligé d’en abandonner un autre, et, avec les deux qui lui restaient, il quitta une partie du continent qu’il avait nommée, dans sa détresse, la Côte des Contradictions. En vue de l’île de Cuba un nouveau malheur l’attendait; ses vaisseaux se heurtèrent, et furent si endommagés de ce choc qu’il eut beaucoup de peine à gagner la Jamaïque, île aujourd’hui anglaise, et fut même obligé de s’y échouer pour ne pas couler à fond. Dans cette extrémité, Colomb envoya à Haïti, dans deux canots faits d’un seul tronc d’arbre creusé à la mode de ceux des insulaires, deux Génois qui lui étaient dévoués, pour informer le gouverneur de sa position et de celle de ses compagnons: longtemps il ignora le sort de ses envoyés et de leurs frêles embarcations. Les matelots qui étaient restés avec Colomb se révoltèrent, et allèrent jusqu’à délibérer s’ils l’assassineraient ou non; en même temps les insulaires commençaient à murmurer du long séjour des Espagnols parmi eux: c’est alors que le génie de Colomb lui suggéra un heureux artifice qui rétablit et accrut même la haute opinion des naturels pour les Espagnols. Il connaissait les insulaires de la Jamaïque très-superstitieux, comme ceux des autres îles de l’Amérique; car ils admettaient, en général, des êtres qu’ils regardaient comme les auteurs de tous les maux qui affligent l’espèce humaine; ils représentaient ces terribles divinités sous les formes les plus effrayantes, et ils leur rendaient un hommage religieux: leurs médecins se faisaient passer pour devins et enchanteurs. Colomb, tout en mettant à profit la superstition de ces insulaires, résolut de les frapper par quelque chose de plus vrai et de plus naturel que tout ce dont on les avait épouvantés jusqu’alors. Ses connaissances en astronomie lui faisant prévoir qu’il y aurait sous peu de temps une éclipse de lune, le jour qui précéda l’éclipse, il assembla autour de lui les principaux Indiens, et, après leur avoir adressé des reproches, il leur dit que les Espagnols étaient les serviteurs du grand Esprit qui habite les cieux, qui a fait et qui gouverne le monde; que ce grand Esprit était offensé du refus que les Indiens faisaient de secourir des hommes qui étaient l’objet de sa faveur particulière; qu’il se préparait à punir le crime avec sévérité; que cette même nuit donc la lune leur retirerait sa lumière et leur paraîtrait couleur de sang, signe de la colère divine et emblème de la vengeance prête à éclater sur eux. Cette prédiction fut accueillie d’abord avec indifférence. Mais lorsque la lune commença à s’obscurcir par degrés et parut enfin couleur de sang, tous les insulaires furent frappés de terreur; ils tombèrent aux pieds de Colomb, le prièrent d’intercéder pour eux auprès du grand Esprit et de conjurer le malheur qui les menaçait: ils apportaient en même temps aux Espagnols la nourriture et tous les secours dont ils les avaient laissé manquer depuis plusieurs jours. Colomb se montra touché de leurs prières; l’éclipse se dissipa, la lune reprit son éclat, et dès ce moment les Espagnols n’eurent plus à se plaindre une seule fois des naturels de la Jamaïque.
Cependant un petit navire espagnol fut signalé au loin; il fit comprendre à Colomb que les deux Génois envoyés par lui à Haïti avaient touché cette île. Alors celui-ci et ses compagnons d’infortune se livrèrent à tous les transports de la joie; ils se croyaient sauvés. Mais le navire épia, le long de la côte, l’état et les mouvements des naufragés; il détacha même une barque pour faire parvenir à Colomb une lettre pleine de compliments et de promesses équivoques; puis tout disparut: le navire n’était qu’une infâme déception, une insultante ironie adressée à Colomb de la part du nouveau gouverneur d’Haïti. Le désespoir des compagnons de Colomb fut au comble; ils se livrèrent à de nouvelles menaces contre leur chef; des menaces, ils en vinrent aux voies de fait. Colomb, alors malade, confia à l’un de ses frères le soin de mettre à la raison les mutins; après un léger combat, ceux-ci s’enfuirent honteusement et se soumirent: enfin on apperçut des vaisseaux qui, cette fois, venaient réellement délivrer Colomb et ses compagnons d’infortune. Il n’avait pas fallu moins d’une année pour que l’on se décidât à cet acte d’humanité qu’on ne refuserait pas à des inconnus.
Après avoir subi de nouveaux affronts à Haïti, Colomb fit voile enfin pour l’Espagne. En arrivant, il y apprit la mort d’Isabelle: il ne lui restait donc plus personne qui put réparer les injustices dont il avait été victime et le payer de toutes ses souffrances. Ferdinand détestait les étrangers; il était d’ailleurs prévenu contre lui. Colomb n’en put rien obtenir que de froides et stériles politesses. Le roi d’Espagne se flattait que la santé chancelante de son plus illustre serviteur le délivrerait bientôt du fardeau de la reconnaissance: il ne fut pas trompé dans sa coupable attente. Le cœur navré de l’ingratitude d’un monarque et d’un peuple pour lesquels il avait tout sacrifié, usé par les chagrins, les fatigues et les infirmités, suite inévitable de ses travaux, Colomb finit sa carrière à Valladolid, le 20 mai 1506, dans sa cinquante-neuvième année. Il mourut avec la fermeté qui avait toujours distingué son grand caractère, avec les sentiments de religion qu’il avait montrés dans toutes les circonstances de sa vie.


Par une belle matinée du mois de septembre 1630, une brillante cavalcade s’avançait au pas sur la route qui traversait le Val de Galie, situé à quelques lieues à l’ouest de Paris; elle avait dépassé le pont de Porchefontaine. Leurs habits brillants de soie, de velours et de broderies, leurs grands chapeaux de feutre, ornés de plumes, à soixante livres le brin, leurs manteaux courts, élégamment rejetés sur l’épaule, et surtout la beauté de leurs montures, indiquaient des seigneurs de haut parage.
Sur la colline qui s’élevait devant eux, on apercevait un château construit en briques, selon la mode du temps, et entouré de fossés sur lesquels s’abaissait un pont-levis; des échelles, des tas de gravois et quelques outils oubliés par les ouvriers, indiquaient que cet édifice venait d’être tout récemment bâti, et que les derniers travaux n’étaient pas entièrement terminés. A gauche du château, sur le versant méridional de la colline, se dressait la flèche de l’église de Saint-Julien, autour de laquelle se groupaient quelques pauvres toits de chaume.
«Maréchal, dit un des seigneurs en entrant dans la cour, vous souvient-il que, dans nos chasses, nous voyions sur cette colline un moulin à vent?»
Le personnage à qui s’adressaient ces paroles et qui suivait le front baissé et enseveli dans une méditation profonde, releva brusquement la tête. Au même instant, un coup de vent fit voler son large feutre à vingt pas derrière lui. Tandis qu’un page accourait pour le lui rapporter, il répondit avec un mouvement de mauvaise humeur assez marqué:
«Oui, sire, le moulin n’y est plus, mais le vent y est toujours, et il murmura entre ses dents: J’aimerais, ma foi mieux, le moulin que ce chétif château de la construction duquel un simple gentilhomme ne voudrait tirer vanité.»
Le personnage bourru qui critiquait ainsi, à part lui, l’œuvre de son maître, n’était autre que le fameux maréchal de Bassompierre; son interlocuteur était le roi Louis XIII. Le château était le premier château de Versailles, dont la plus grande partie est encore debout tel qu’il était alors, moins les fossés et le pont-levis; et le village, au pied de la colline, était le hameau de Versailles, qui a donné son nom au château, et à une rue de la majestueuse cité de Louis le Grand, la rue du Vieux-Versailles.
Si vous me demandez, mes enfants, d’où venait ce nom bizarre de Versailles, je vous répondrai que je n’en sais rien. Il y a bien, il est vrai, de braves gens qui ont prétendu qu’il vient du mot verser, parce que le grand vent qu’il y faisait, et qu’il y fait encore, versait les blés de ses environs; mais, à ce compte, il y aurait en France plus de cent localités qui auraient mérité ce nom à plus juste titre encore, tandis qu’après la ville de Louis XIV, il n’y a que deux endroits appelés Versailles: l’un est un hameau du département de l’Orne, dépendant de Laferté-Macé, seigneurie qui a appartenu au duc de Beauvilliers lequel par un sentiment de gratitude pour les princes qui l’avaient comblé de faveur, aurait donné le nom de son habitation au hameau dont nous parlons; le second est une ville du Kentucki, aux États-Unis, fondée probablement par quelques émigrés français. Ces deux Versailles ne sont donc que la reproduction d’un seul et même nom.
J’avais donc raison de vous dire que je ne sais pas du tout d’où vient le nom de Versailles; au reste cela n’est guère plus important que de savoir qu’en décomposant ce mot, on trouve ceux-ci: ville seras, prophétie que Louis XIV a réalisée, mais qui n’a été trouvée que longtemps après l’événement.
Le hameau de Versailles était déjà une seigneurie au onzième siècle.
Au treizième, en 1270, Pierre de Versailles habitait à Paris un hôtel qu’il avait fait bâtir dans le quartier Saint-Victor, et qui a donné son nom à la rue de Versailles, qui existe encore; à la même époque, l’église du hameau, placée sous l’invocation de Saint-Julien, relevait des abbayes de Saint-Magloire et de Marmoutiers. En 1350, il y avait à Versailles une léproserie ou hôpital pour les lépreux; le fief de Porchefontaine payait à cette léproserie une redevance de quatre miniers de seigle par an.
Le fief de Porchefontaine, où il existe encore une belle ferme, dont les terrains sont traversés par le chemin de fer de la rive gauche, appartenait à Pierre de Craon, conseiller du roi Charles VI, dont il obtint qu’à l’avenir on donnât des confesseurs à tous les criminels. Cet acte d’humanité et de justice ne l’empêcha pas d’être un des assassins du connétable Olivier de Clisson, frappé en sortant de l’hôtel Saint-Paul, le 14 juin 1392. Le roi lui confisqua ses biens, et donna Porchefontaine à Louis d’Orléans, son frère, qui en fit don aux Célestins de la rue Saint-Victor, à Paris. Chose singulière! Porchefontaine appartint successivement à Pierre de Craon, à Louis d’Orléans; l’un fut assassin, l’autre assassiné par le duc de Bourgogne.
Le célèbre Martial de Loménie, victime de la Saint-Barthélemy, était seigneur de Versailles en 1561; son frère, Antoine de Loménie, lui succéda, et allait souvent avec le roi Henri IV et le marquis d’Elbœuf, courre le cerf dans le bois de Versailles.
Albert de Gondy, frère de Pierre de Gondy, qui devint plus tard cardinal de Retz, était seigneur de Versailles en 1574.
Enfin, au dix-septième siècle, époque où Louis XIII en fit l’acquisition pour élever le château rouge que l’on voit au fond de la cour de marbre, Versailles appartenait en partie à Jean-François de Gondy, fils du duc de Retz, et en partie à Jean de Loisy. C’est en 1627 que l’on commença à bâtir ce qui nous reste du château de Louis XIII.
Si j’ai autant insisté sur l’histoire de Versailles avant 1630, c’est parce que bien des gens pensent que c’est seulement depuis cette époque que l’on entendit prononcer ce nom. J’ai voulu, mes enfants, vous mettre en garde contre une erreur qui pourrait vous donner des idées fausses; et maintenant, avant de revenir au roi Louis XIII et au maréchal de Bassompierre, que nous avons un peu oubliés, je vais vous raconter une histoire qui s’est passée, il y a bien longtemps, au Val de Galie, ce vallon dont la colline de Versailles forme un des côtés.
Il y avait une fois, dans cette vallée, de bons paysans, le mari et la femme, qui s’aimaient de tout leur cœur, et possédaient quelques biens. Le bon Dieu leur avait donné un fils, un beau petit garçon, tout frais, tout rose, tout éveillé, grand joueur, et qui maintes fois avait failli se tuer en cueillant des cerises dans le gros cerisier derrière le clos; d’autres fois, il s’en allait dans les champs avec les petits paysans, et il donnait et recevait assez souvent de bons coups. Sa bonne mère commençait par le gronder, et finissait toujours par l’embrasser et lui donner quelque beau fruit, tant il avait de gentillesse pour demander pardon et promettre de ne plus mal faire, sauf à recommencer le lendemain. Cela dura ainsi tant qu’il fut petit; mais dès qu’il eut quatorze ou quinze ans, il lui prit un amour de l’étude si grand, que le curé était tout étonné de ses progrès; il était continuellement occupé à lire, et ne jouait plus avec ses petits camarades; mais la science l’avait rendu fier, et il les regardait par-dessus l’épaule: ce qui était fort mal, parce que l’on perd tout le mérite que l’on a à s’instruire, si l’on en tire vanité et si l’on veut paraître supérieur aux autres. L’orgueil est un grand vice, et le bon Dieu le punit tôt ou tard.
A dix-sept ans, il partit pour Paris; ses parents vendirent une petite pièce de terre, afin de l’habiller convenablement, et de lui donner quelque argent pour vivre dans cette grande ville, où la vie est si chère. Les adieux furent tristes; l’enfant pleura et partit le cœur bien gros, avec son bâton, quelques livres que le curé lui avait donnés, et un pain de belle farine que sa mère avait fait cuire exprès pour lui. Mais, quand il eut perdu de vue le clocher de Saint-Julien, la nouveauté du pays, l’espoir de parvenir par son talent, tout cela lui donna du courage, et, le soir, quand il se coucha dans une petite auberge du faubourg Saint-Victor, il se voyait déjà riche et puissant seigneur. En effet, il prospéra; mais son orgueil augmenta avec sa fortune, et depuis longtemps il n’écrivait plus à sa bonne mère de ces lettres que la pauvre femme allait porter, en pleurant de joie, au bon curé qui lui en faisait la lecture.
L’enfant du Val de Galie était parvenu, par son mérite, à une place de la magistrature; il faisait grand étalage, non-seulement de sa science et de sa charge, mais encore de sa terre de Galie, qui n’étaient pas à lui, puisque ses parents vivaient encore; si bien qu’il rencontra une belle demoiselle, fille d’un conseiller au parlement, dont il devint très-amoureux, et qu’il demanda en mariage à son père. Le père y consentit, mais, avant de régler les bases du contrat, on résolut d’aller tous ensemble au Val de Galie, pour voir les terres du futur. Ce mauvais fils avait fait croire, au père de sa fiancée, que ses parents étaient morts. Il eût donc mieux aimé ne pas conduire sa nouvelle famille dans son village. Mais le conseiller insista; il fallut partir. Chemin faisant, l’orgueilleux disait à ses compagnons de route: «Nous allons trouver là-bas de braves paysans qui m’ont élevé et qui cultivent mes terres; ils me regardent comme leur enfant et m’appellent de ce nom, mais c’est une mauvaise habitude que je leur ferai perdre.»
On arrive; la mère reconnaît son fils, et lui saute au cou en versant des larmes de joie, et en appelant son mari qui battait du blé dans la grange.
«Allons, allons, bonne femme, dit son fils, en voilà assez; saluez cette belle demoiselle, qui sera bientôt ma femme.
—Ta femme, mon garçon! je serais la maman de cette belle fille! quel bonheur, mon Dieu! quel bonheur! Je vas chercher M. le curé pour lui conter ça.»
Et avant que son fils eût pu la retenir, elle courait à travers le village criant à toutes les portes que son fils était revenu en carrosse avec une belle demoiselle qu’il allait épouser.
Le fils était sur les épines; le conseiller commençait à deviner le mystère; mais il n’y eut plus de doute quand le curé arriva, et lui dit, en le voyant le chapeau sur la tête et prenant des airs de protection «Chapeau bas, monsieur, car le Seigneur a dit: «Tes père et mère honoreras.» A ces mots, le conseiller dit à celui qui croyait devenir son gendre: «Monsieur, vous avez du talent, mais vous n’avez pas de cœur; j’aurais donné ma fille au fils d’un paysan honnête; je ne la donne pas à un fils ingrat.
—Et moi, disait la pauvre mère, moi qui ne comprenais pas qu’il m’appelait bonne femme pour ne pas me dire maman! moi qui l’ai tant aimé! oh! mon Dieu! mon Dieu! que je suis malheureuse!
—Femme, dit le père, qui n’avait pas encore prononcé un mot, mais qui avait tout compris dès le premier instant; femme, laissez cet enfant, qu’il s’en aille et qu’il soit maudit. Nous donnerons nos terres aux bons pères de Sainte-Geneviève, et lui, il vivra avec son talent, dont il est si fier.»
Cette petite histoire se formula en une ballade, dont il ne nous reste que ces deux vers:
L’enfant ingrat, par sa folie,
A perdu le Val de Galie.
Mais il est temps d’en venir enfin à Louis XIII et à Bassompierre.—Deux mois après la visite du roi à son nouveau château, l’édifice était entièrement terminé, et le 8 novembre 1630, Louis XIII, arrivant de Lyon, où il était malade, alla coucher à Versailles. Vous avez sans doute, mes enfants, entendu parler déjà du cardinal de Richelieu, grand ministre, mais méchant homme, qui avait su mettre en désaccord le roi et sa mère. Malgré ses intrigues, Louis, touché des soins vraiment maternels qu’elle lui avait prodigués pendant la maladie qu’il venait de faire, éprouvait un retour d’amour filial bien naturel; la reine-mère en profita pour lui demander de destituer le ministre. C’était une grande décision à prendre, et Louis, avec son caractère irrésolu, venait à Versailles pour réfléchir à loisir sur ce coup d’Etat.
Le 10 novembre, qui était un dimanche, Louis, de retour à Paris, promit de nouveau à sa mère de renvoyer son ministre; mais il demanda un sursis de six semaines, parce que l’État avait besoin des services du cardinal. La reine y consentit; l’entretien qu’ils avaient à ce sujet n’était pas terminé, que le cardinal frappe à la porte. «C’est lui!» s’écrie Marie. Le ministre devine tout, et dit froidement: «Vous parliez de moi!» La reine sort de chez son fils; le cardinal va la retrouver au Luxembourg qu’elle habitait, et, en sortant, il rencontre Bassompierre, et lui dit: «Monsieur le maréchal, vous ne ferez plus de cas d’un défavorisé comme moi.» Bassompierre, ennemi du cardinal, va répéter le mot aux courtisans; et, pendant trois jours, la cour en émoi ne parla que de la disgrâce du ministre.
Le mardi 12, le roi, retourné à Versailles, appelle Richelieu; une longue conférence s’établit entre eux, et le faible Louis retombe plus jamais sous l’influence de cet homme rouge. Antoine de Loménie est envoyé à Gratigny, pour redemander à Michel Marillac, un des adversaires du cardinal, les sceaux de l’État. Michel les remet sans répliquer, espérant que là se bornerait sa disgrâce, mais il est arrêté et conduit comme prisonnier au château de Caen, et de là à celui de Châteaudun, où il mourut en 1632. Le maréchal de Bassompierre se présente à Versailles le vendredi 15, et remarque que le prince lui fait fort mauvaise chère; il sort, et, trois mois après, il est enfermé à la Bastille. Ainsi c’est à Versailles que se passèrent les événements du 12 novembre 1630, journée mémorable, à laquelle les historiens ont donné le nom de journée des dupes, parce que ceux-là qui se réjouissaient de la disgrâce du ministre, furent les premiers à se repentir de son immense influence sur le roi.
Huit ans après, le 16 septembre 1638, le château de Saint-Germain, dont nous vous parlerons plus tard, était en grand émoi; après vingt-trois ans de mariage, la reine Anne d’Autriche donnait le jour à un fils qui fut surnommé Dieudonné; cet enfant devait être le grand roi Louis XIV; par lui, le chétif château de Louis XIII devait se transformer en une merveille de grandeur et de magnificence; par lui, le hameau qui se groupait autour de la petite église de Saint-Julien devait s’élever au rang de ville royale, aux rues vastes et alignées, aux hôtels somptueux; et, plus tard, ces lieux, où la monarchie avait, pour la première fois, rompu les obstacles qui s’opposaient à l’exercice de sa puissance, devaient voir les premiers symptômes de sa chute, non plus dans le château qui domine l’éminence, mais dans une grande baraque de planches, appelée le Jeu de Paume.

Les dangers de l’ignorance.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Écris! écris bien vite lui dit-elle, c’est pour sauver mon père.» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Travaillez, mes enfants; l’étude est une bonne mère qui console dans le malheur et aide toujours à en sortir. La richesse est chose fragile, le plaisir est passager et laisse parfois des regrets; l’étude seule ne nous abandonne pas; c’est la compagne du prisonnier, celle du pauvre affligé; elle est la source de toutes les vertus, comme l’oisiveté celle de tous les vices.
Voilà ce que répétait bien souvent M. de Coulanges à sa fille unique, Aline, âgée de treize ans à peine; mais, hélas! la pauvre enfant n’avait point du tout mis à profit les conseils de son père. La fortune ayant toujours comblé jusqu’à ses moindres désirs, elle ne comprenait pas ce que c’était que le malheur; elle ne voulait rien faire pour s’en préserver.
Un matin, M. de Coulanges était dans son appartement avec sa fille; celle-ci se disposait à faire sa promenade de chaque jour; déjà même Antoine, le vieux domestique de la maison, se tenait à quelque distance, prêt à accompagner sa jeune maîtresse.
«Eh bien! méchante enfant, tu es donc incorrigible? dit M. de Coulanges à Aline qui venait de l’embrasser pour obtenir le signal du départ; tu ne changeras donc jamais? tu ne veux pas travailler? Crois-moi, tu te repentiras un jour de tout ce temps perdu.
—Mon père, encore aujourd’hui seulement, et demain...
—Demain, fit M. de Coulanges avec un ton de reproche, tu recommenceras. Tu crois donc, parce que je suis riche, parce que tu as de belles robes, des bijoux, qu’il est inutile de savoir autre chose que se parer et prendre du plaisir? mais, Aline, tout cela peut changer: si Dieu ne veut pas qu’on doute de sa bonté, il ne veut pas non plus qu’on néglige de s’en rendre digne.»
Aline s’était dirigée tout doucement vers la porte, en écoutant son père; puis, quand celui-ci eut fini de parler, elle partit comme une étourdie; Antoine sortit derrière elle.
Après avoir couru près d’une heure au hasard, Aline monte enfin un petit sentier qui conduisait à la demeure de la vieille Marcel. Sa petite-fille filait à côté d’elle sur le seuil de la cabane.
En apercevant Aline, la bonne Marcel et Mariette se levèrent pour aller à sa rencontre; mais elle était déjà venue se poser sur l’herbe qui tapissait le devant de l’habitation.
«Vous paraissez bien fatiguée, mamzelle? vous avez bien chaud? Voulez-vous prendre queuqu’ chose? dit la vieille Marcel.
—Merci, je n’ai besoin de rien; mais Antoine, c’est différent, il va vous suivre; moi je reste avec Mariette.» Et elle fit signe à celle-ci de venir reprendre sa place.
C’était un singulier contraste que celui de ces deux jeunes filles groupées ainsi l’une à côté de l’autre; l’élégant costume d’Aline se mêlait à la robe de bure de Mariette, et son pantalon blanc, bordé de dentelles, touchait les sabots de la petite paysanne.
«Continue donc, Mariette, dit bientôt Aline en désignant le rouet avec le bout de la jolie ombrelle qu’elle tenait à la main.
—Comment, mamzelle, vous voulez que devant vous...
—Sans doute; cela m’amusera.»
Mariette se remit donc à filer. Il y avait quelques instants à peine que celle-ci avait repris son travail, lorsque Aline, qui n’avait probablement pas trouvé, dans le jeu du rouet, la distraction qu’elle en attendait, rompit tout à coup le silence:
«Que je te plains! dit-elle avec un soupir, d’être obligée de travailler ainsi toute la journée. Tu dois bien t’ennuyer, ma pauvre Mariette?
—Moi, oh! non, mamzelle; j’ vous assure que j’n’en avons pas le temps.
—Mais n’as-tu aucun plaisir? Que fais-tu toute la journée?
—Dam, le matin j’ dis mes prières, puis je travaille avec ma grand’mère, qui ne pourrait pas me nourrir à elle toute seule, et le soir je lui lis des histoires. C’est si amusant de lire!»
Aline rougit; elle ne connaissait pas ce plaisir-là; car, il le faut bien avouer à sa honte, la malheureuse petite fille, en dépit des maîtres qu’on lui avait donnés et des supplications de son père, ne savait encore en vérité ni lire ni écrire.
«Ah! dam, reprit Mariette, nous n’ sommes pas si heureuses que vous, mamzelle; nous n’ sommes pas riches; malgré ça, quand la journée est finie, je suis contente, je l’ai ben employée.»
Aline était devenue rêveuse; l’exemple de la petite paysanne lui donnait des regrets... «Mais, au fait, pensa-t-elle, mon père est riche, ai-je besoin de travailler?» C’est ainsi qu’elle faisait taire les reproches que lui adressait quelquefois sa conscience. Elle appela Antoine, et repartit.
Deux heures après, Aline se retrouvait dans l’appartement de son père. M. de Coulanges paraissait absorbé dans une profonde méditation; sa tête était baissée sur sa poitrine, et il tenait encore à la main le papier qui semblait avoir causé sa tristesse. Nous étions alors vers la fin de l’année 1792; c’était une gazette qui annonçait au marquis les troubles qui agitaient Paris; tous les nobles abandonnaient leurs biens et se réfugiaient à Coblentz.
Au bruit que fit Aline en rentrant, M. de Coulanges leva la tête, et, en l’apercevant, des larmes s’échappèrent de ses yeux.
«Qu’avez-vous donc, mon père?» dit la jeune fille en se jetant à son cou. M. de Coulanges détourna la tête. «Oh! mon bon père, si vous ne confiez pas vos peines à votre enfant, qui donc vous consolera?» Mais comme le marquis gardait toujours le silence, Aline baissa les yeux; c’est alors qu’elle vit le journal qui avait glissé sur le tapis; elle devina que c’était là la cause du chagrin de son père, et soudain elle s’en saisit pour y découvrir le secret qu’on lui cachait; mais, presque aussitôt, elle le rejeta avec dépit.
Sur ces entrefaites, M. de Coulanges s’était levé, et après avoir marché quelque temps avec agitation, il s’arrêta; puis, ayant paru faire un effort sur lui-même: «Aline! dit-il d’une voix solennelle, s’il fallait partir bientôt, aujourd’hui peut-être; s’il te fallait renoncer, pour quelque temps du moins, à tous tes plaisirs pour la vie de nos paysans; s’il nous fallait remplacer enfin ce château par une chaumière... t’y résignerais-tu avec courage?
—Oh! mais pourquoi supposer cela, mon père? répondit celle-ci avec inquiétude.
—C’est que mes craintes seront bientôt peut-être de funestes réalités; c’est qu’alors... il faudra fuir, car il y ira de l’honneur... de la vie de ton père.
—Ah! mon Dieu! s’écria Aline en sanglottant; oh! mais, alors, partons, partons vite; les vêtements les plus grossiers, je serai fière de les porter, s’ils doivent mettre en sûreté vos jours.»
Quelques mois après, Aline et son père vivaient ignorés au fond d’un petit village de la Bourgogne, éloigné de quelques lieues du château de M. de Coulanges. Aimé comme il l’était de tous ses paysans, ce digne seigneur avait aisément trouvé un refuge assuré parmi eux. Mais aussi plus de belles parures, de domestiques à livrée, plus de promenades comme autrefois; il ne fallait plus commander, mais obéir, de peur d’éveiller les soupçons.
Aline avait pris un costume de paysanne, et elle était forcée de partager les travaux des enfants du fermier qui se dévouait ainsi pour sauver son maître.
Un soir, alors que tout le monde se trouvait réuni autour de la table du vieux fermier, et se disposait à partager son frugal repas, on frappa violemment à la porte de la ferme. Aline, comme par un pressentiment involontaire, devint pâle, et se rapprocha avec terreur de son père.
Tout le monde se regarda, indécis; mais comme on continuait à frapper avec plus de force, Michel (c’était le nom du fermier) se leva et alla ouvrir. Un homme, enveloppé dans un large manteau, se précipita dans la cour et referma vivement la porte sur lui.
«Que demandez-vous, monsieur? s’écria Michel d’un ton de mauvaise humeur; il ne fait pas un temps à courir la campagne.
—Pardonnez-moi, monsieur! Mais vous êtes un homme humain, généreux; ma vie est entre vos mains; je suis proscrit, poursuivi; des hommes à figures sinistres rôdent dans ce village; ils ont perdu ma trace. Sauvez-moi!» Et tout en disant ces mots, il s’acheminait insensiblement avec Michel vers la maison.
M. de Coulanges et Aline ne purent réprimer un léger mouvement d’effroi qui n’échappa pas à l’étranger. Un léger sourire de satisfaction contracta un instant ses lèvres. «Cet homme, murmura-t-il entre ses dents, c’est lui sans doute; je ne m’étais pas trompé; mais il me faut des preuves.» Et presque aussitôt son visage reprit l’expression de terreur suppliante qu’il avait auparavant. «Monsieur, reprit-il en joignant les mains, cachez-moi... ne fût-ce qu’un jour ou deux, et je partirai ensuite, je vous le jure; je ne voudrais pas vous compromettre.»
Le bon fermier parut vaincu par cette prière. Aussi, après avoir un moment réfléchi, s’écria-t-il: «Eh bien soit; prenez donc place au foyer du pauvre laboureur; Michel n’a jamais repoussé le malheur; mais fasse le ciel que je n’aie pas à me repentir de l’hospitalité que je vous accorde!» Il fit mettre alors un nouveau couvert pour son hôte, et, le souper fini, il lui fit disposer un lit, comme aussi des vêtements pour le lendemain.
Il y avait déjà quelques jours que la maison de Marcel comptait un commensal de plus, et l’étranger avait fini par gagner la confiance de tous les habitants de la ferme, mais surtout l’amitié d’Aline, à qui il prenait à tâche de rappeler ses beaux jours en flattant tous ses caprices, lorsqu’un matin un des petits garçons du fermier accourut tout essoufflé vers la jeune fille et lui présenta un paquet soigneusement cacheté, en disant qu’un inconnu venait de le lui remettre en secret. Comme il ne savait pas lire, il le lui apportait pour qu’elle pût voir à qui s’adressait ce message.
Aline prit la lettre, la tourna entre ses doigts; déjà même elle se disposait à la porter à son père, quand l’étranger, alors présent, devinant son embarras, l’arrêta soudain en apercevant l’adresse. «Cette lettre est pour moi, dit-il; elle est d’un de mes amis qui connaît ma retraite. Donnez, donnez vite, je suis impatient de savoir...» Et tout en disant ces mots, il prit la lettre des mains d’Aline qui hésitait à s’en séparer, en détacha l’enveloppe et lut rapidement ce qui suit:
«Mon cher de Coulanges, vous n’êtes pas en sûreté chez le fermier Michel; des émissaires sont à votre poursuite; vos jours sont en danger, si vous ne fuyez au plus vite.»
La lecture de cette lettre à peine achevée, la figure de l’étranger s’anima d’une joie qui effraya la pauvre Aline. Un horrible pressentiment vint tout à coup la saisir; elle s’élança vers l’inconnu, comme s’il eût été temps encore de lui reprendre ce fatal billet; mais il avait déjà disparu.
Elle vint donc se rasseoir, toute consternée, les yeux attachés sur l’enveloppe qu’elle avait ramassée, et qu’involontairement elle baignait de ses larmes. En ce moment, M. de Coulanges entra: «Que vois-je! des pleurs. Qu’as-tu donc, mon enfant? et que signifie ce papier? La lettre qu’il contenait m’était adressée; je reconnais l’écriture du comte de Mesnil.»
Alors Aline poussa un cri déchirant et se laissa tomber aux genoux de son père: «Grâce! grâce! votre fille est bien coupable, s’écria-t-elle avec toute l’expression du plus violent désespoir.
—Mon Dieu! tu me fais frémir... Aurais-tu perdu cette lettre?
—Non! il l’a emportée.—Qui?—Cet étranger que je croyais notre ami, et qui m’a dit que cette lettre lui appartenait.
—Ah! malheureuse! tu m’as perdu,» s’écria M. de Coulanges en se laissant tomber sur un siège.
Aline embrassait encore les genoux de son père, en sanglottant, quand la porte s’ouvrit. Plusieurs hommes parurent dans la chambre, l’étranger à leur tête.
«Au nom de la loi, dit-il, je vous ordonne d’arrêter M. le marquis de Coulanges.»
Celui-ci se leva, embrassa la pauvre Aline, à laquelle il avait déjà pardonné, et sortit en lançant un regard de mépris à l’infâme qui avait ainsi abusé de l’humanité d’un vieillard et de l’ignorance d’une jeune fille.
Aline s’élança de nouveau au cou de son père: «Oh! je vous sauverai, murmura-t-elle tout bas à son oreille; je vous sauverai, mon père!...» Et elle s’évanouit dans les bras de Michel.
M. de Coulanges avait été conduit à Paris dans les prisons de la Conciergerie. Dès le lendemain, à la pointe du jour, Aline était partie de Rouvray avec Antoine, qui ne les avait pas abandonnés. La jeune fille n’avait pas eu besoin d’exciter le courage du vieil Antoine, et pourtant ils devaient faire la route à pied, et par un temps affreux. Arrivés à Paris, Antoine prit des informations, et deux jours après, Aline était à la porte de la maison d’un des hommes les plus redoutés de cette triste époque.
La pauvre enfant tremblait comme la feuille; mais le souvenir du serment qu’elle avait fait à son père, et que son cœur brûlait d’accomplir, vint enfin la soutenir. D’abord elle fut repoussée; mais elle ne se découragea pas; elle attendit; et, profilant d’une occasion favorable, elle se glissa inaperçue jusqu’à l’appartement du farouche représentant du peuple. Cet homme était assis devant un bureau chargé de papiers qu’il était occupé à relire. Il n’avait pas entendu entrer Aline; aussi quand elle fut tout près de lui, leva-t-il la tête avec un mouvement de surprise.
«Que demandes-tu? dit-il brusquement.—La grâce de mon père, monsieur, répondit naïvement la jeune fille, en se jetant à ses pieds.—La grâce de ton père? rien qu’ ça, reprit celui-ci d’un ton goguenard; et quel est son nom?—Le marquis de Coulanges.» D... fronça le sourcil, et ne répondit pas. Aline, qui ne perdait pas un seul de ses mouvements, trembla sous ce regard sévère. «Je ne puis rien pour lui, balbutia-t-il enfin; je ne suis pas le maître; d’autres doivent décider de son sort.
—Mais, monsieur, j’ai promis à mon père de le sauver, reprit Aline en mouillant de ses larmes les mains de cet homme; il compte sur moi, entendez-vous? Oh! non, je ne vous quittera pas sans emporter au moins une parole d’espérance.—D’ailleurs il est peut-être trop tard.—Mais alors, hâtez-vous donc, monsieur, s’écria Aline éperdue en redoublant ses sanglots; hâtez-vous! chaque minute qui s’écoule me prépare des regrets éternels, car c’est moi qui l’ai perdu. Ah! par pitié, tuez-moi si vous voulez, mais sauvez mon père.»
D... n’était pas de ces misérables dont le cœur est fermé à tout sentiment d’humanité; et puis il y a tant de puissance dans les larmes d’une enfant qui prie pour son père, qu’il fut ému, et la relevant avec plus de douceur: «Eh bien! petite, j’y consens, dit-il; je verrai à parler pour ton père; ou plutôt il est un moyen de réparer le mal que tu as fait. Tu veux sauver ton père? eh bien! demande sa grâce, écris, je remettrai ta lettre.»
Et D... sortit aussitôt en lui désignant froidement le bureau. La joie et l’espérance avaient fait encore une fois oublier à Aline sa fatale ignorance. Elle courut donc s’asseoir devant la table; c’est là qu’elle fut tout à coup ramenée à l’horreur de sa position. Le sort de son père était entre ses mains; quelques lignes seulement, et il était sauvé, et elle ne pouvait le sauver, et toutes les expressions d’amour filial demeuraient étouffées dans son cœur, elle ne pouvait les écrire. Être contrainte à rester muette, pour ainsi dire, quand d’un mot, d’un seul mot dépend la vie d’un père; cela est bien affreux, n’est-ce pas, mes amis? Aussi c’était trop de tant d’émotions à la fois pour une enfant qui n’avait pas été habituée à souffrir. Aline se frappait le front, elle arrachait ses beaux cheveux blonds de désespoir.
En ce moment, une petite fille, plus jeune qu’Aline, entra en jouant dans le salon; mais dès qu’elle vit le chagrin de celle-ci, elle s’approcha d’elle pour la consoler. Aline se retournant tout à coup et la regardant fixement: «Sais-tu écrire, toi? lui dit-elle.—Sans doute, fit la petite fille tout étonnée.» Alors Aline lui saute au cou et l’embrasse avec frénésie; elle l’eût battue sans doute si elle avait été aussi ignorante qu’elle. Puis, sans ajouter un mot, elle la pousse dans le fauteuil qu’elle venait de quitter, et lui montrant une feuille de papier: «Écris! écris bien vite, lui dit-elle, c’est pour sauver mon père.—Qu’est-ce qu’il a donc fait ton père?—Rien; il est noble. Mais écris donc.—C’est un noble; oh! mais alors mon oncle me grondera, car il ne les aime pas, lui.—Qui est ton oncle?—Le citoyen D..., reprit la petite fille.—Eh bien! n’aie pas peur, il lui a pardonné.» La jeune enfant hésitait encore; mais en voyant les larmes d’Aline, elle se mit à pleurer à son tour, et écrivit ce que celle-ci lui dictait.
D... tint sa promesse; le marquis fut rendu à la liberté. Aline avait été assez punie de son ignorance; Dieu, pour la récompenser de ce qu’elle avait souffert, avait voulu lui rendre son père.
M. de Coulanges, après avoir réalisé les débris de sa fortune, se rendit à Coblentz, où il vécut dans une douce obscurité entouré des soins du vieil Antoine et des caresses de sa fille, qui apprit bientôt, je vous jure, mes enfants, à lire les tristes détails des périls auxquels son père avait si heureusement échappé.

Une nuit d’hiver.
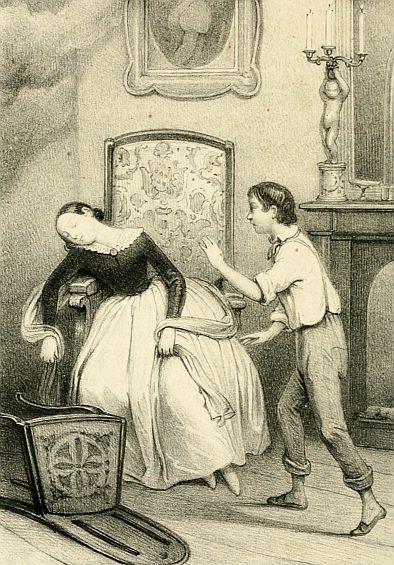
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «C’est elle!..... c’est elle! oh! mon Dieu, pourvu qu’il ne soit pas trop tard!» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.
C’était au commencement de décembre 1829. La nuit était sombre, le vent soufflait avec force, et la pluie tombait par torrents dans les rues de Versailles.
Un pauvre enfant de douze ans environ se tenait grelottant auprès de la porte cochère d’un des plus beaux hôtels de la rue Royale. De nombreux équipages y entraient à chaque instant; les fenêtres étaient brillamment éclairées, et l’on entendait parfois les accords d’un orchestre harmonieux qui jouait des contredanses. Il y avait bal chez le comte de H***; on y dansait, on s’y amusait, et le pauvre petit mendiant tendait la main à tous ceux qui entraient.
«La charité, s’il vous plaît, mon bon monsieur,» disait-il. Mais sa voix affaiblie était couverte par le bruit des voitures.
La pluie tombait toujours, l’air était froid, et Julien sentait ses vêtements trempés se coller contre ses membres engourdis.
«O mon Dieu! répétait le mendiant, ayez pitié de moi... secourez-moi, car, sans votre assistance, mon père va mourir.»
Dix heures venaient de sonner au château, et Julien n’avait encore rien obtenu de la charité publique.
Le pauvre garçon, pâle, épuisé, mourant de froid et de fatigue, se soutenait à peine; ses genoux tremblaient sous lui.
Au moment où, découragé, il pensait à s’éloigner, il vit s’approcher une calèche derrière laquelle deux grands laquais richement galonnés se tenaient debout.
Il s’avança vers la portière; et comme la voiture s’était arrêtée pour laisser un autre équipage sortir de l’hôtel, il tendit la main, et répéta tristement sa prière:
«La charité, s’il vous plaît, mon bon monsieur.»
Sa voix était si déchirante, qu’une jeune fille, assise dans la voiture, mit la tête à la portière. En voyant Julien, son cœur se serra.
«Pauvre enfant!» dit-elle avec un accent de pitié. Et se tournant vers son père, elle lui demanda une pièce de monnaie pour la donner au mendiant.
Julien tendait toujours sa main vers la portière.
«Va-t’en, petit voleur,» lui cria un des domestiques.
Cette injure grossière fit rougir Julien; il baissa tristement la tête, et pleura.
«Entends-tu, vaurien?» continua le domestique.
Et, voyant que Julien ne s’éloignait pas, il descendit de la voiture, et le prit violemment par le bras.
En ce moment, la jeune fille se montra à la portière.
«Jean, cria-t-elle à cet homme, que faites-vous?
—Je chasse ce petit mauvais sujet qui ennuie mademoiselle.
—Et qui vous a donné cet ordre?... Pourquoi le maltraitez-vous?
—Mais, mademoiselle...
—Taisez-vous! approchez, mon enfant, dit-elle à Julien, ne pleurez pas; prenez cet argent, et demain venez nous voir; voici l’adresse de mon père.»
Le pauvre Julien n’avait pas la force de répondre, tant il était ému; il leva ses beaux yeux vers la jeune demoiselle, et elle put y lire combien son cœur était reconnaissant.
La voiture s’éloigna pour entrer dans la cour de l’hôtel.
«O mon père, mon père, vous êtes sauvé!» s’écria Julien; et il se mit à courir, à toutes jambes, vers la boutique d’un pharmacien.
Il tira de sa poche une ordonnance de médecin, et paya les médicaments avec la pièce de cinq francs que lui avait donnée mademoiselle Louise de Révanne; puis il se dirigea vers une maison de chétive apparence, située à quelques pas de là.
Julien monta légèrement l’escalier noir et tortueux auquel une corde attachée, de distance en distance, par des anneaux de fer scellés dans le mur servait de rampe.
Lorsqu’il eut atteint le dernier étage, il poussa une porte à demi fermée, et pénétra dans une petite chambre qu’éclairait à peine une veilleuse près de s’éteindre. Le vent ébranlait la toiture, et la pluie tombait à travers les carreaux brisés jusque sur le plancher.
Dans un coin, il y avait un matelas posé par terre, sur lequel était étendu un homme si pâle, qu’on eût dit qu’il venait de mourir, si de temps en temps une plainte douloureuse ne fût sortie de sa bouche. Une pauvre femme, assise près de lui, soutenait sa tête.
Oh! mes enfants! c’était un spectacle horrible que celui-là... Et voyez combien vous devez remercier le ciel de ce qu’il vous a donné des parents dont la fortune vous permet d’avoir une chambre bien chaude et bien fermée, un bon lit, des vêtements bien propres, toutes les jouissances de la vie!... Mais aussi, songez que c’est au travail de vos parents que vous êtes redevables de ce bien-être... Travaillez comme eux, imitez leur exemple, conduisez-vous bien, afin de les récompenser de la peine qu’ils se sont donnée pour vous.
«Ma mère, dit Julien à voix basse, voilà les médicaments ordonnés par le médecin.»
Aussitôt la pauvre femme se leva, et prépara tout ce qu’il fallait pour panser son mari.
Julien alla dans un coin de la chambre, se mit à genoux, et pria Dieu pour mademoiselle de Révanne.
Le père de Julien, mes enfants, était ouvrier charpentier. Depuis longtemps il travaillait avec courage, et ses maîtres le citaient comme un modèle à ses camarades. Actif, laborieux, honnête et probe, il s’était fait aimer de tout le monde. Toujours prêt à obliger un camarade, il ne regardait pas à la peine, quand il pouvait être utile.
A force de travail, il parvint à économiser une petite somme; alors il se maria, et bientôt après le petit Julien vint au monde.
Dès l’âge de huit ans, son père l’emmenait avec lui au chantier où il travaillait, et lui apprenait son état. Tout allait bien dans le petit ménage, et la famille Julien était heureuse, lorsqu’un jour on rapporta le pauvre charpentier sur un brancard. En établissant un échafaudage, une planche avait glissé sous ses pieds; il était tombé, et, quand on le releva, il avait la jambe cassée.
En peu de temps, les économies amassées avec tant de peine disparurent, employées en pansements de tout genre. L’hiver vint, et, au lieu de se mieux porter, le malade sentit ses forces diminuer.
Enfin, le soir même où nous vous avons montré Julien demandant l’aumône, le médecin avait ordonné des médicaments dont il espérait un grand bien pour le malade; mais il n’y avait plus un sou à la maison; les meubles, les vêtements, étaient vendus; il ne restait plus rien.
Ce fut alors que Julien descendit dans la rue.
Le pauvre blessé venait d’être pansé, et déjà l’on pouvait voir le bien-être qu’il ressentait; sa figure était moins pâle; sa respiration moins pénible; il commençait à reposer. Sa femme s’assit sur un petit escabeau, et, appuyée contre le mur, chercha à réparer par le sommeil ses forces épuisées.
Julien veilla près de son père.
Vers une heure du matin, un bruit extraordinaire se fit entendre dans la rue. Julien crut d’abord que c’étaient les voitures qui sortaient du bal, et il pensa à cette jeune demoiselle, si belle et si bonne, qui avait sauvé la vie de son père.
Bientôt des cris d’effroi parvinrent jusqu’à lui; une lueur rougeâtre remplit la chambre et l’éclaira tout à coup.
Julien eut peur; il réveilla sa mère.
«Regarde, maman, regarde, lui dit-il avec frayeur.
—Oh! mon Dieu! qu’est-ce que c’est? qu’est-ce qu’il y a? le feu est quelque part!
—Oui, maman, écoute, on crie au feu! au feu!... Si c’était à l’hôtel où il y avait un bal cette nuit?
—Cours, Julien! va voir, et surtout prends bien garde de ne pas t’exposer...» Julien sortit en courant.
La rue tout entière était éclairée par l’incendie. Les flammes sortaient, en gros tourbillons, des fenêtres de l’hôtel du comte de H***.
On voyait des femmes en costume de bal, avec des diamants, des fleurs, des robes de soie, courir partout, appelant à grands cris leur mari, leur père, leur fils... C’était un désordre, une cohue épouvantable.
Les pompes venaient à peine d’arriver; mais le froid était devenu plus piquant, la pluie avait cessé, le vent soufflait avec violence, et l’eau gelait dans les tuyaux.
Julien faisait la chaîne pour conduire de l’eau aux pompes, lorsque tout à coup il entendit un monsieur âgé crier avec désespoir:
«Louise!... ma fille!... Louise! où es-tu?»
Mais personne ne lui répondait, et le pauvre monsieur courait partout comme un fou.
«C’est monsieur de Révanne, dit un homme qui faisait la chaîne auprès de Julien.
—Monsieur de Révanne! s’écria le fils du charpentier... Mais sa fille est peut-être encore dans l’hôtel... elle a sauvé mon père... ô mon Dieu, faites que je puisse m’acquitter envers elle!»
Aussitôt il entre dans l’hôtel malgré les soldats et les pompiers qui en gardent la porte; il traverse la cour et s’élance dans l’escalier, à travers les tourbillons de fumée qui en sortent.
Arrivé au premier étage, il veut entrer, mais le feu le brûle et ses vêtements s’enflamment. Alors il s’approche d’une fenêtre, brise les carreaux, et les pompiers qui l’aperçoivent, dirigent vers lui le jet de leurs pompes.
Puis il continue à marcher: les poutres embrasées tombent autour de lui, le plancher tremble sous ses pas... il marche toujours, appelant de toutes ses forces Louise de Révanne.
Il arrive enfin à un petit salon où le feu commence à peine à pénétrer. Sur un fauteuil, il voit une jeune fille étendue sans connaissance!... il s’approche:
«C’est elle!... c’est elle! Oh! mon Dieu, pourvu qu’il ne soit pas trop tard!»
Il prend la main de la jeune fille, cherche à la ranimer, mais en vain; elle est froide et insensible.
La flamme avance... avance jusque dans le petit salon. Sa chaleur réveille enfin Louise... Elle se lève, regarde autour d’elle...
«Où suis-je?... mon père!... mon père!...» crie-t-elle avec désespoir...
Tout à coup, elle aperçoit Julien.
«Oh! sauvez-moi!» lui dit-elle en se précipitant vers lui.
Julien monte sur la cheminée, s’accroche aux rideaux de la fenêtre, et les renverse; en les attachant à la suite l’un de l’autre, il double leur longueur; de distance en distance il fait des nœuds, puis il les accroche solidement par un bout, et les laisse pendre par la fenêtre.
«Allons, mademoiselle, dit-il à Louise, donnez-moi la main, serrez-moi bien et mettez vos pieds sur les nœuds.»
Au moment où ils vont descendre, la flamme sort avec fureur de la fenêtre placée au-dessous de celle du petit salon, et les rideaux sont bientôt en feu.
Julien se met à cheval sur le balcon...
«Une échelle!... une échelle!...»
Les pompiers le voient, la foule accourt; la violence du feu est telle que les murs se fendent et s’écroulent de tous côtés.
On apporte l’échelle.
Julien attache Louise par la taille avec son écharpe, et la tient sur son dos pour descendre.
Arrivé au milieu de l’échelle, une poutre se détache du toit et lui fait, en tombant, une large blessure à la tête.
Il va lâcher l’écharpe de Louise, ses forces l’abandonnent.
«Courage!... courage!» s’écrie la foule.
Et personne n’ose monter à leur secours, car on craint que l’échelle ne se brise sous le poids...
Julien entend les cris qu’on lui adresse, et, malgré sa douleur, malgré le sang dont il est couvert, il descend...
«Bravo!... bravo!» s’écrie la foule...
Ils touchent terre... Louise est sauvée... Elle est dans les bras de son père.
Julien tombe épuisé et sanglant! on s’empresse auprès de lui, on le relève. M. de Révanne le fait porter à son hôtel; son médecin arrive et cherche à le rappeler à la vie.
Lorsqu’il rouvre les yeux, il voit Louise penchée sur lui et essuyant le sang qui coule de sa blessure.
«Oh! merci, mon Dieu! dit-il doucement: j’ai pu m’acquitter envers elle.»
Le feu avait pris au milieu du bal, et lorsqu’on s’en aperçut, il était déjà trop tard pour qu’on pût en arrêter les progrès.
Tout d’abord ce fut une confusion extrême; chacun s’enfuit, ne pensant qu’à se sauver. M. de Révanne, éloigné de sa fille, avait cru l’apercevoir, s’enfuyant, dans la cour, et il était sorti pour la rejoindre; mais il s’était trompé, et, sans le dévouement sublime de Julien, elle eût péri.
Quelques semaines suffirent pour rendre le brave garçon à la santé. Son père, soigné par le médecin de M. de Révanne, put, au bout de deux mois, reprendre son travail.
Louise de Révanne fit entrer son sauveur dans une pension, où il travailla avec zèle et persévérance.
Plus tard, aidé par elle, il monta un petit commerce, et maintenant aimé, honoré de tous ceux qui le connaissent, Julien est devenu l’un des premiers négociants de Paris.
Vous le voyez, mes enfants, un bienfait n’est jamais perdu! Soyez généreux et charitables envers les pauvres, ils souffrent tant! Montrez-vous reconnaissants envers ceux qui vous obligent: c’est un devoir sacré que vous devez remplir et dont vous recevrez tôt ou tard la récompense.


A peine le sommeil a fui de ma paupière,
A peine j’entrevois un rayon de lumière,
Que prompte, à tes côtés, j’accours me reposer,
Et sur ton front vermeil imprimer un baiser.
Sans cesse ton image agite ma pensée;
Je t’adore le jour, en songe je te vois;
Si par un doux accent, la nuit, je suis bercée,
Il me semble entendre ta voix!
Déjà, ma chère fille, a disparu l’aurore;
Mais l’heure ne vient pas de t’éveiller encore
Attends que le soleil, planant à l’horizon,
De sa flamme dorée ait séché le gazon
Où tu jouais hier étourdie et folâtre,
Où tes pieds délicats essayaient leur essor,
Où d’un lien de fleurs ton petit bras d’albâtre
Enchaînait notre chien Médor!
Oui, demeure en repos, ô mon heureuse fille!
Ainsi tu me parais si fraîche, si gentille!
Laisse-moi contempler ton aimable souris,
La blancheur de ton teint, son léger coloris.
Tiens, ma Julietta, lorsque je considère
Ton visage serein, ton calme gracieux,
Je te croirais un ange oublié sur la terre,
Tout prêt à s’envoler aux cieux!
Mais tu sens ma présence, et ta bouche bégaie
Des sons mélodieux: ta voix flexible et gaie
Rappelle les chansons du ravissant oiseau
Célébrant un beau jour à travers le rameau.
Impatiente aussi de quitter cette place,
Comme lui tu voudrais, en ton vol triomphant,
Errer en liberté, voltiger dans l’espace
Orné de tes rêves d’enfant!
Avant, Julietta, jouis de ma tendresse,
Et viens contre mon sein partager mon ivresse.
Entre tes bras longtemps, longtemps enlace-moi:
Sens mon être frémir d’un indicible émoi!
Redis les mots d’amour que je t’appris naguère:
Oh! repète souvent ce langage enchanteur,
Dont le céleste écho, dans l’âme d’une mère,
Épanche des flots de bonheur!
Adresse ton hommage à notre unique maître;
C’est lui qui te nourrit, c’est lui qui t’a fait naître.
Que de ta faible voix les précoces accents
S’élèvent vers son trône ainsi qu’un pur encens.
Redis aussi ton hymne à la vierge Marie,
Pour trouver un abri sous son regard divin:
Celui, Julietta, qui, bien fervent la prie,
Ne l’invoque jamais en vain!
Et nous irons revoir la riante vallée,
Où la rouge anémone au gazon est mêlée,
Où l’on entend chanter les oiseaux dans les bois,
Et résonner en chœur les airs des villageois;
Où le triste ramier pleure sa tourterelle;
Où le rustique pâtre, au son des chalumeaux,
Appelle à ses côtés la tendre pastourelle,
Conduisant de jolis agneaux!
Là nous écouterons des ondes le murmure:
Si déjà le soleil a coloré la mure,
J’en promets, sans épine, une branche à ta main:
Et si la marguerite est éclose au chemin,
J’en ferai pour ton front une blanche couronne,
Afin, Julietta, que ton père au retour
Te voie entre mes bras plus belle, et qu’il te donne
Encor plus de baisers d’amour!
Julietta! souris à ton père qui t’aime
Presqu’aussi tendrement que ta mère elle-même;
Va, comme le chevreau, bondir sur ses genoux
Et qu’il tressaille d’aise à ton aspect si doux!
Si la sombre tristesse assiégé son visage;
Si d’un cuisant chagrin ses yeux sont obscurcis,
Sois-lui plus caressante et dissipe l’image
Importune de ses soucis!
Et toi, mon Créateur, que sans cesse je prie
Pour la félicité de ma fille chérie;
Prolonge ses beaux jours, garde ses yeux de pleurs;
Sur chacun de ses pas fais éclore des fleurs!
Nos sons reconnaissants rediront ta louange,
Et dans ton temple saint nous irons te bénir.
O Dieu! conserve-moi toujours mon petit ange
Ou fais-moi mille fois mourir!

Le petit Roi de Rome.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| Le petit Roi avait toujours de gentils saluts, de gentilles phrases pour ces vieux serviteurs qui avaient blanchi sur tant de champs de batailles et de climats. | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Un cercueil en rappelle un autre. Celui qui naguère encore revint si triomphant de Sainte-Hélène rappelle celui qui reste en Autriche; l’histoire et le cercueil du père font ressouvenir de l’histoire et du cercueii du fils; s’il y a plus de grandeur et d’éclat dans la tombe de Napoléon Ier, il n’y a pas moins de tristesse et de douleur dans la tombe du jeune homme qui parut un jour destiné à devenir Napoléon II.
C’était en 1811: Napoléon le Grand venait, en moins d’un an, d’ajouter seize départements nouveaux à son empire qui embrassait avec la France, l’Italie, la Hollande, la Belgique et les plus belles provinces d’Allemagne. Il bouleversait à son gré l’Europe soumise, y créait des royaumes ou des duchés nouveaux pour ses parents et ses amis. Naples et l’Espagne avaient reçu aussi sur leurs trônes des membres de sa famille. Jusqu’en Suède, un de ses généraux allait régner par son consentement. Si les maisons impériales et royales d’Autriche et de Prusse étaient conservées dans leurs États, c’était par le seul effet de sa munificence et de sa générosité. Il avait déjà entamé la Russie dans la plus belle partie de la Pologne, dont il lui avait plu de gratifier le roi de Saxe, son protégé. L’Angleterre luttait encore, il est vrai: elle entretenait et soulevait, à force d’argent, les haines contre ce colosse qui menacait de plus en plus de l’isoler et de la faire périr d’inanition; mais Napoléon venait d’annoncer qu’en six années il aurait cent cinquante vaisseaux de haut bord, et que, par ce moyen, il irait chercher et soumettre jusque dans leur île les Anglais que la mer seule avait défendus contre lui. La veille même, il avait reçu des députations venues des rivages de la mer du Nord, jusqu’à laquelle il avait reculé son empire; les envoyés de Hambourg et de Lubeck s’étaient glorifiés en sa présence de l’origine française de leurs villes maritimes fondées par Charlemagne, et qui, disaient-ils, ne feraient que revenir à leur berceau en se réunissant à la France. L’honneur, en ce temps, n’était pas de résister à ce grand homme du siècle, mais de lui appartenir et d’être lié à lui de plus près. Il avait pris pour épouse, depuis environ un an, une fille des empereurs d’Autriche, l’archiduchesse Marie-Louise, et, pour cimenter sa puissance et mettre le comble à la grandeur sans égale de cet homme qui avait commencé par être un pauvre écolier, un pauvre sous-lieutenant, il ne semblait plus lui manquer qu’un héritier direct. Dieu, qui mesurait d’avance la chute de ce géant à qui il avait tout donné et qui jamais ne se satisfaisait, ne lui refusa pas cette dernière marque de faveur.
Après un moment de transes cruelles qui faillit, dit-on, coûter la vie à l’impératrice Marie-Louise, à huit heures du matin, le 20 mars de cette année 1811, des salves de coups de canon, dont Napoléon donna lui-même le signal, annoncèrent à la capitale de l’empire qu’un enfant venait de naître au conquérant du monde. Soudain et de toutes parts, les habitants de Paris se mirent aux fenêtres, descendirent à leurs portes, remplirent les rues, et comptèrent les coups de canon avec une vive sollicitude: car la pensée et l’espérance de Napoléon étaient la pensée et l’espérance de toute la France; jamais peuple ne s’était si parfaitement identifié avec son souverain. Quand les coups de canon dépassèrent d’un seul le nombre de ceux que l’on tire pour la naissance des filles du sang royal, un immense cri de joie éclata dans la population, et alla retentir jusques sous les fenêtres du palais où se tenait l’empereur.
Napoléon avait dit que son fils naîtrait roi de Rome; et ce fut par ce titre, superbe et renouvelé des temps antiques, que l’on répondit au premier vagissement de l’enfant qui venait de naître. La France entière, dans son amour, ne l’appela plus que le petit roi de Rome. Sur son berceau de vermeil, présent de la Ville de Paris, on déposa les grands cordons des ordres de la Légion d’honneur et de la Couronne de fer. Il fut ondoyé, le soir de sa naissance, dans la chapelle des Tuileries. Précédé de ses nombreux officiers, le petit roi de Rome était porté par la comtesse de Montesquiou, sa gouvernante; et le glorieux maréchal Moncey, duc de Conégliano, portait la queue de son manteau.
Bientôt aux cent un coups de canon de l’esplanade des Invalides à Paris, répondirent ceux du fort Saint-Ange à Rome, ceux de Naples, de Turin, de Milan, de Gênes, de Venise, de Florence, de Madrid, d’Amsterdam, de Bruxelles et de toutes les villes d’Allemagne. Non pas seulement tout Paris, non pas seulement toute la France, mais presque toute l’Europe s’illumina pour célébrer cette naissance qui fut annoncée, dans certaines villes, la nuit et à la clarté des flambeaux. On écrivait de Gand qu’il n’y aurait pas de nuit dans cette ville, tant elle serait inondée de lumières. Un Te Deum immense fut chanté depuis Paris jusqu’à Madrid, jusqu’à Vienne en Autriche, jusqu’à Rome, pour remercier et louer le ciel d’avoir fait naître l’enfant-roi. L’enthousiasme se répandait jusqu’à l’étranger; on y regardait cette naissance comme le gage de la paix prochaine du monde. Les poètes saluaient à l’envi, sur tous les tons, la venue du roi de Rome. Toutes les formes des oracles et des prophéties furent épuisées par eux pour lui présager des destins presque célestes; il y en eut un qui avoua ne ressentir qu’ une crainte pour le jeune héritier du grand Napoléon: c’était que l’univers, soumis par le père, ne condamnât les jours du fils à l’inaction.
Le 1er juin 1811, Rome, fière de sa résurrection militaire, voulut célébrer par des pompes merveilleuses la naissance de son roi. Le Capitole, le Forum, les temples de la Concorde, d’Antonin, de la Paix, les arcs de Septime-Sévère, de Titus, de Constantin, la colonne de Jupiter-Stator, le Colysée, tous ces vieux monuments, tous ces lieux consacrés par les grands souvenirs de la Rome antique furent illuminés. La place de Monte-Cavallo où se trouvait le palais destiné au nouveau roi, et les rues adjacentes, étaient remplies d’un peuple immense, dansant au son d’un orchestre rangé aux pieds des chevaux de marbre des immortels sculpteurs de l’antiquité, Praxitèle et Phidias. Mais rien n’égala, en magnificence et en féerie, l’illumination du dôme et de la colonnade de l’église de Saint-Pierre de Rome, rien, si ce n’est le spectacle que présentaient en même temps, et pour le même objet, la ville de Naples et ses environs. Sur la côte du Pausilippe, à droite de Naples, qui se présentait en amphithéâtre, toute illuminée aux bords de la mer, on avait élevé un édifice qui offrait à distance l’image d’un temple de feu, et se réfléchissait dans les eaux du beau golfe voisin, tandis qu’en face même des passagères et fantastiques illuminations du mont Pausilippe, brûlait l’éternelle et volcanique illumination du Mont-Vésuve.
Tout cela n’était que le prélude des fêtes du baptême de l’héritier présomptif de Napoléon le Grand. Le 9 juin, il fut présenté, par l’empereur et l’impératrice en personnes, à l’église Notre-Dame de Paris. Il était revêtu d’un manteau d’argent, doublé d’hermine, et porté par une gouvernante, ayant à droite et à gauche les deux sous-gouvernantes et sa nourrice. Ce jour, la queue de son manteau royal était portée par le maréchal duc de Valmy, insigne honneur que s’étaient disputé les grands de l’empire. L’empereur et l’impératrice étaient chacun sous un dais séparé, et porté par des chanoines de la cathédrale. Suivait un cortège de rois, de princes souverains et de tous les dignitaires de l’État. Le grand duc, archiduc de Wurtzbourg, représentait l’empereur d’Autriche, parrain; madame Lætitia Bonaparte, mère de Napoléon, qu’on appelait madame-mère, était marraine, et présente en personne; une seconde marraine, la reine de Naples, était représentée par la reine Hortense, belle-sœur de Napoléon. Le cardinal-archevêque de Paris, entouré d’un grand nombre d’évêques, ayant achevé la cérémonie du baptême, le chef des hérauts d’armes de l’empereur s’avança au milieu du chœur de l’église, et cria trois fois: «Vive le Roi de Rome!» Ces cris répétés se prolongèrent longtemps sous les voûtes de la cathédrale. L’impératrice, debout, tenait en ce moment son enfant sur les bras; l’empereur le prit bientôt dans les siens, l’éleva et le montra au peuple avec une émotion que trahissaient des larmes de joie. L’enthousiasme public fut au comble.
A la même heure, les cloches harmonieuses de Saint-Pierre de Rome, dans l’attente depuis plusieurs semaines, faisaient un écho lointain aux volées des cloches de Notre-Dame de Paris.
Les fêtes de cette journée tinrent du prodige dans la capitale de l’empire français. Des fontaines de vin, des buffets de comestibles gratuits, des voltiges, des exercices d’équitation, des jeux de bague, de courses à l’épée, au pistolet, au sabre, à la lance, vingt spectacles différents de batailles appelèrent la multitude en délire aux Champs-Élysées. Un grand tournoi eut lieu, composé de six escadrilles de cinq chevaux chacun, de quatre hérauts d’armes, de quatre hérauts de bancs, de douze trompettes et de six porte-bannières. On avait tiré la vieille chevalerie de son oubli en l’honneur du roi de Rome. Le vainqueur du tournoi fut promené en triomphe aux acclamations de la multitude. Des feux d’artifices partirent, le soir, de la place de la Concorde à Paris, pendant qu’à la même heure, à Rome, il en partait un autre du château St-Ange.
A l’Hôtel de Ville de Paris, où l’empereur et l’impératrice avaient dîné, un jardin factice avait été formé au-dessus de la cour, au niveau de la salle du trône; il surpassait, par sa splendeur, les fameux jardins suspendus de Babylone qu’il rappelait. Le fleuve romain du Tibre y était figuré par d’abondantes eaux qui répandaient une douce fraîcheur; il serpentait parmi les fleurs et les orangers odorants. Tout à coup le jardin factice et suspendu s’illumina en un million de verres de couleurs; et des danses qui s’échappaient de toutes les ouvertures des appartements voisins prolongèrent leurs anneaux et leurs groupes capricieux jusque dans les allées fleuries, jusqu’au bord des eaux du fleuve merveilleux, au bruit cadencé de six cents instruments mariant ensemble leur harmonie.
Quinze jours après à peine, l’empereur Napoléon rendait, dans sa demeure d’été de Saint-Cloud, aux habitants de Paris, la fête qu’il en avait reçu pour son fils à l’Hôtel de Ville. On y vit plus de trois cent mille spectateurs couronner les hauteurs du parc. La garde impériale avait formé dans la plaine qui se déroule aux pieds, jusque et par delà le bois de Boulogne, un vaste banquet où elle traita la garnison de Paris. Le peuple circulait dans les jardins publics du château, au milieu des fontaines de vin et de mille jeux, à travers lesquels il n’avait que l’embarras du choix. L’empereur et l’impératrice, ayant à côté d’eux le petit roi de Rome, se promenèrent en calèche découverte dans les allées remplies d’une multitude dont la joie se traduisait à chaque pas en vivat. Le simulacre d’un combat naval fut offert sur la Seine. Dans ce temps, les spectacles de guerre étaient les seuls qui convînssent à la France. Quand vint la nuit, le bois de Saint-Cloud présenta un indescriptible tableau. La verdure de ses grands arbres était traversée par des guirlandes enflammées; l’onde de ses bassins, de ses cascades, semblait ruisseler en nappes flamboyantes, et jusqu’à ses jets d’eaux s’élançant jusqu’au ciel, et retombant en perles et en diamants: tout était en feu. Le fleuve de la Seine lui-même ne parut plus qu’une longue et large traînée de feu ondoyant sous les pièces d’artifice, dont le couvrirent, en un instant, les artilleurs de la garde impériale qui le parcouraient en tous sens dans des barques. Le principal feu d’artifice fut tiré dans la vaste plaine où s’était donné le banquet de la garnison de Paris. On put le voir de plus de six lieues à la ronde. A une majestueuse colonnade de flammes succéda un jardin aérien, dont les cascades, les arbres, les portiques, présentaient des feux de diverses couleurs; une girande magnifique éclaira, pendant quelque temps, l’immense horizon qui se développait, jusque dans la nuit, autour de la plaine de Saint-Cloud et de Boulogne. Une célèbre aéronaute, madame Blanchard, s’élança dans un ballon lumineux, plana au-dessus de la fête, et mit le feu à des pièces d’artifices disposées autour de sa nacelle, et qui présentaient une couronne d’étoiles suspendue à une prodigieuse hauteur. Des paysans exécutaient des danses champêtres. Cent bals variés avaient lieu. Des opéras-comiques se jouèrent toute la nuit dans les bosquets du parc de Saint-Cloud, à la clarté mobile des feux de Bengale, qui éclairèrent en outre un souper somptueux servi aux dames de la cour, toutes ruisselantes de diamants et de pierreries, dans deux longues tentes rehaussées de soie, de velours et d’or. Ce n’est là qu’un rapide aperçu des fêtes par lesquelles on célébra la naissance et le baptême de l’enfant à qui chacun prédisait qu’il recueillerait tout entier l’héritage de Napoléon au plus haut point de sa puissance.
A peine la moitié d’une année s’était écoulée depuis que le petit roi de Rome avait reçu le jour, que déjà son père rêvait d’autres victoires, courait à de nouvelles conquêtes. Il entreprit la funeste campagne de Russie, dans laquelle chacun de ses succès et de ses pas en avant ne faisaient qu’accélérer davantage sa ruine prochaine. Pendant que les armées vaincues du czar de Russie reculaient devant lui, le terrible hiver de l’an 1812 accourait. Napoléon était entré dans l’ancienne capitale de l’empire moscovite; il avait occupé Moscou quand l’incendie vint se joindre à un froid mortel pour exterminer, par les éléments déchaînés, celui que les hommes ne pouvaient vaincre. Une conspiration pour le renverser du trône se découvrait dans le même temps à Paris. Pour celui dont le passé n’avait été qu’une série d’incroyables triomphes, l’avenir commençait à se montrer menaçant. Napoléon qui, la veille encore, était occupé à supputer combien de marches il faudrait à son armée pour aller achever son ennemi jusque dans ses dernières retraites, jusqu’aux bords de la Mer Baltique, dut songer tout à coup à revenir se défendre jusqu’au sein de ses États, dans sa propre capitale.
Cependant le petit roi de Rome avait quitté les langes du premier âge, et, sous les yeux attentifs de sa gouvernante, madame de Montesquiou, que, dans son langage enfantin, il appelait maman Quiou, il allait croissant en santé, en force, en beauté. A son retour à Paris, l’empereur le revit avec une émotion extraordinaire chez un homme dont la tête était remplie de si grands projets. Des pleurs d’attendrissement roulaient dans ses yeux; il semblait se dire en regardant son enfant: «Que sera-t-il?» Souvent aussi se consolait-il, près de son fils, des revers de la fortune prêts à fondre sur sa maison impériale; à l’aspect de cet héritier à qui tant de puissance avait été promise, il se refusait à croire aux revirements du sort; sa dynastie lui semblait éternelle. Peu à peu son front s’éclaircissait, sa bouche souriait de ce sourire indéfinissable dont parlent tous ceux qui l’ont vu dans ses moments de bonheur; et le monarque des monarques, sans croire déroger à son rang suprême, se livrait aux jeux les plus enfantins avec le petit roi de Rome; il se roulait avec lui sur les tapis, comme Henri IV jadis faisait du jeune dauphin son fils, il le portait sur son dos. Il y a quelque chose qui saisit l’âme dans ce spectacle des héros se laissant aller, dans le sein de leur famille, aux naïfs mouvements, aux aimables impressions de l’enfance. Le grand poëte Homère en comprit toute la poésie, lorsqu’il représenta, dans son immortelle Iliade, Hector souriant au petit Astyanax qui jouait avec le panache de son casque victorieux.
Le petit roi de Rome se trouvait bien de ces moments d’absence de toute pompe et de toute étiquette dont son père lui-même donnait quelquefois l’exemple; il se serait voulu plus libre encore et moins gêné dans ses allures enfantines; témoin ce jour où, les yeux attachés sur ce qu’il distinguait à travers les fenêtres du château de Saint-Cloud, et ses jolies petites lèvres roses collées sans souffle à la vitre, sa gouvernante lui demande ce qu’il voulait pour sa récompense d’avoir été bien sage.
«Aller barboter dans le ruisseau avec ces petits garçons,» répondit vivement l’enfant en se retournant et en montrant du doigt des enfants qui jouaient avec la boue et les cailloux.
L’homme est ainsi fait depuis sa plus tendre enfance; ce qu’il n’a pas est toujours ce qui le tente. Pendant que le petit roi de Rome enviait aux enfants des rues leurs jeux dans le ruisseau, les enfants des rues, et bien d’autres encore, enviaient au petit roi de Rome son beau petit carrosse d’argent et d’or ciselés, dans lequel il était traîné chaque jour par de blancs agneaux, guidés par des rubans roses flottants et enrichis de perles fines. L’enfant, ayant un col de dentelle rabattu qui relevait encore la grâce naïve de sa charmante tête, portant le grand cordon de la Légion d’honneur par-dessus une petite robe de satin ou de velours lamés d’argent et d’or, se promenait ordinairement ainsi dans son petit carrosse, soit à Saint-Cloud, soit sur les terrasses des Tuileries. De vieux grognards de la garde impériale, qui lui souriaient à travers leurs épaisses moustaches grisonnantes, formaient quelquefois l’escorte de ce gracieux équipage, et présentaient le tableau de la force veillant sur la faiblesse de l’enfant en qui reposait alors l’avenir de la France. Le petit roi avait toujours de gentils saluts et de gentilles phrases pour ces vieux serviteurs qui avaient blanchi sur tant de champs de batailles et de climats.
On savait bien que le roi de Rome ne pouvait rien par lui-même, et qu’à peine encore se rendait-il compte de ce qu’on lui adressait; mais on savait aussi que Napoléon était extrêmement flatté qu’on lui demandât quelque faveur par l’innocent intermédiaire de son fils, et que jamais un placet n’était oublié dès qu’il avait passé par ses petites mains chéries. C’était donc à qui s’approcherait du beau carrosse aux moutons blancs pour y déposer une supplique: le carrosse était souvent surchargé de pétitions. Au milieu des papiers dont on l’encombrait, on n’apercevait plus du petit roi que sa tête rose et fraîche, et d’autant plus joyeuse, que les pétitions pleuvaient davantage autour d’elle.
«Il paraît que nous avons bonne charge aujourd’hui,» disait Napoléon toutes les fois qu’il voyait ainsi revenir son fils dans le petit carrosse. Et l’enfant répondait en jetant à pleines mains aux pieds de l’empereur, hors du carrosse, les pétitions de la journée: «N’est-ce pas, papa-empereur, que vous leur donnerez à tous?—Oui, certainement, à tous,» répondait l’empereur.
Et l’empereur envoyait aussitôt la plupart de ces suppliques à son vénérable et illustre ami le grand chancelier de la Légion d’honneur, le savant naturaliste Lacépède, dont le cœur excellent, que ne démentait jamais celui du souverain, ruinait le trésor public à force de répandre des bienfaits; avec cela que les pétitionnaires étaient presque toujours des mères, des veuves, des sœurs de braves soldats morts ou blessés pour la patrie. Comment ne pas avoir égard à de tels titres présentés à l’empereur des Français de la main du roi de Rome? C’eût été impossible. Quand il n’y avait plus d’argent dans la caisse de la Légion d’honneur, le grand chancelier faisait des emprunts à la liste civile et au trésor privé de l’empereur; et quand liste civile et trésor privé devenaient par suite à sec; quand l’empereur, ce qui arriva souvent, avait donné jusqu’à son dernier napoléon, alors (cela est historique) le bon chancelier Lacépède prenait sur ses propres appointements, sur sa propre bourse; tous ses revenus particuliers y passaient; et, pour donner aux mères, aux veuves, aux sœurs des soldats, il empruntait même à ses employés. «Messieurs, disait-il, vous savez bien que l’empereur vous le rendra; c’est lui qui nous a faits ce que nous sommes; nous devons donc secours et protection aux infortunés parents de ses braves serviteurs.»
Il en résultait, coûte que coûte, que les pétitionnaires du roi de Rome avaient leur affaire. Chacun de ses sourires était une perle précieuse qui portait la consolation et la prospérité chez ceux qui avaient été assez heureux pour pouvoir s’adresser à lui.
Le bon cœur de l’enfant perçait en toute occasion. On raconte qu’un jour, comme il prenait plaisir à voir circuler la foule sous les fenêtres de l’appartement qu’il occupait, il distingua un enfant vêtu de noir, porté par une dame en deuil, et qui agitait dans ses petites mains un papier en tournant ses regards vers les fenêtres du palais. «Maman Quiou, pourquoi donc ce petit garçon est-il habillé de noir? demanda le roi de Rome à sa gouvernante.
—C’est que son papa est mort, répondit madame de Montesquiou, et qu’il ne le verra plus.
—Son papa est mort! Pauvre petit! Comment! il ne verra plus son papa? s’écria l’enfant avec attendrissement.
—Non, reprit la gouvernante, il ne le verra plus... que dans le ciel. Il est bien malheureux, le pauvre petit, de n’avoir plus son père; et sa mère, cette dame en noir, elle est bien malheureuse aussi! C’est pour cela que le pauvre petit tourne ses yeux vers vous pour que vous consoliez sa mère.
—Que faut-il donc faire? demanda le petit roi. Ah! s’il ne fallait que donner tous mes joujous, mes moutons blancs et mon carrosse pour consoler ce petit garçon, je les donnerais bien vite.
—Ce n’est pas cela qu’il lui faut, reprit encore la gouvernante attentive à cultiver les bonnes et généreuses dispositions de l’enfant; ce qu’il désire, c’est que vous preniez ce papier qu’il vous montre pour que vous le présentiez à votre père.»
Madame de Montesquiou n’eut pas plutôt dit, que le roi de Rome demanda instamment à voir de plus près le petit garçon. Bientôt la dame en deuil et son fils furent présentés à l’enfant impérial. La dame était la veuve d’un officier tué dans une campagne récente; elle était mère de famille, et sa position approchait de l’indigence. Le roi de Rome prit la pétition des mains du petit garçon, dit qu’il la remettrait à l’empereur, promit de bien prier pour qu’on y eût égard, et échangea quelques caresses enfantines avec le petit solliciteur, qui sortit à demi consolé, ainsi que sa mère. Le lendemain, l’empereur faisait inscrire le nom de l’infortunée veuve sur le livre des pensionnaires de l’État.
Une autre fois, le petit roi, assis sur les genoux d’une grande dame, s’amusait d’un joyau précieux dont elle faisait sa parure.
«Comme il brille, comme il est beau! disait-il. N’est-ce pas que le pauvre à qui on en donnerait un pareil deviendrait riche?
—Oui, riche, s’il savait se contenter, répondit la dame.
—J’en connais un qui se contenterait bien, reprit l’enfant naïvement; il est là tout près dans le bois. Voulez-vous qu’on le fasse venir? Comme je passais, il m’a demandé de quoi s’acheter un habit; mais, moi, je n’avais plus d’argent.
—Comment, reprit la comtesse de Montesquiou qui était présente, vous n’avez plus d’argent? et ce matin, avant de sortir, l’empereur vous a donné sa bourse pleine! Qu’en avez-vous fait?
—Il y avait de pauvres ouvriers dans la cour du château, et je leur ai donné tout ce que j’avais, répondit le petit roi de Rome.
—C’est bien sans doute; mais vous vous êtes trop hâté de tout donner aux premiers que vous avez rencontrés. Vous voyez bien qu’il ne vous est plus rien resté pour le pauvre enfant qui vous demandait des habits.
—Ah! oui, reprit le roi de Rome qui ne perdait pas de vue son objet; mais si la dame donne sa belle pierre au petit pauvre, ça reviendra au même, et il aura des habits toujours, toujours.»
La dame était aussi bonne que puissante et riche; elle envoya savoir quel était l’enfant qu’avait aperçu le roi de Rome dans le bois, et, sans se dépouiller de sa parure, elle trouva non-seulement moyen de le vêtir, mais encore de lui procurer un petit sort.
L’avenir du pauvre secouru à la considération du petit roi de Rome était mieux assuré, par quelques deniers intelligemment mis à profit, que l’avenir du fils à qui Napoléon semblait devoir léguer le monde. Une adversité plus rapide encore que n’avait été la prospérité le prouva bientôt. L’année 1812 avait commencé pour Napoléon une série de revers que de savantes manœuvres, de glorieuses victoires où l’on était toujours vingt contre cent, n’interrompirent, par instant, que pour rendre la chute du grand capitaine du siècle plus retentissante. Trahi par la fortune, trahi surtout en ce moment par les nombreuses troupes étrangères qu’il avait, avec trop de confiance, engagées comme amies et alliées dans son armée, épuisé de soldats français, les seuls, avec quelques braves Polonais, qui lui restassent fidèles, mais dont le nombre diminuait par la mort d’une manière effrayante, aussi bien à chaque nouvelle victoire qu’à chaque revers, aussi bien par l’intempérie des saisons que par les batailles, Napoléon revint à Paris. Il conjura le pays d’avoir encore foi en lui; il demanda à la nation ses dernières épargnes, aux parents en pleurs les derniers de leurs fils, leur promettant de les ramener vivants et vainqueurs. Hélas! à travers le voile des larmes de la douleur publique on n’apercevait plus déjà que du sang et des cadavres mutilés par la guerre, par la guerre interminable; père, mère, frère, sœur, tout le monde avait à pleurer quelque membre de sa famille: à mesure que ces tristes fantômes augmentaient et se rapprochaient, le prestige de la gloire et des grandeurs passées disparaissait. Cependant, à celui dont le génie trop téméraire avait naguère entrepris la campagne de Russie, si féconde en épouvantables catastrophes, la France donna encore une fois ses trésors et ses enfants: c’était le reste.
L’empereur, avant de repartir pour l’armée avec des soldats de seize à vingt ans, improvisés en un seul jour, reçut aux Tuileries les officiers de la garde nationale de Paris, et leur présenta son fils, qui avait alors trois ans; l’impératrice le tenait par la main.
«En quittant la capitale, leur dit-il, je laisse avec confiance sous votre garde l’impératrice et le roi de Rome, ma femme et mon fils, sur lesquels sont placées toutes nos espérances; je vous laisse tout ce que j’ai de plus cher au monde après la France, et le remets avec confiance en vos mains.»
Les officiers de la garde nationale jurèrent de veiller sur ce dépôt qui leur était confié. L’empereur embrassa ensuite sa femme et son fils, puis il les quitta. Jamais plus il ne devait les revoir. Le mois de mars de l’année 1811 avait été témoin de la naissance du roi de Rome; le mois de mars de l’année 1814 fut témoin de sa sortie de Paris avec sa mère, pendant que déjà les armées de l’Europe soulevée en masse et coalisée, frappaient aux portes de cette capitale. A l’innocent petit roi qui demandait où on le voulait conduire, et qui, dans l’instinct de ce qui se passait, s’attachait, se ressaisissait à tous les meubles des Tuileries, en s’écriant: «Je veux rester avec papa-empereur! je veux rester dans mon château des Tuileries!» on répondait seulement que ce n’était là qu’un voyage comme ceux qu’il faisait ordinairement à Fontainebleau ou à Saint-Cloud. Mais c’était sur Blois, de l’autre côté de la Loire, qu’on allait le diriger en fugitif; et l’on eut toutes les peines du monde, malgré les assurances qu’on lui donnait, à le porter dans le carrosse de sa mère; il fallut presque employer la force. Le carrosse, qui n’était plus celui dans lequel le traînaient naguère paisiblement de blancs moutons, fut emporté d’une course rapide; il ne s’arrêta qu’à vingt lieues de Paris, à Orléans, où l’on donna, pour quelques heures, au petit roi de Rome, la compagnie de quelques enfants des familles les plus hautes en considération de la ville: le petit roi leur offrit des bonbons, mais en moins grande quantité qu’il n’aurait voulu.
«Je voudrais bien vous en donner davantage, leur dit-il avec une expression pleine de tristesse; mais je n’en ai plus: ce vilain roi de Prusse m’a tout pris.»
Quelques jours à peine après, il fallut non pas seulement se réfugier à Blois, mais quitter la France. L’enfant, prisonnier des princes et des peuples coalisés, fut conduit en Autriche, près de la capitale des États de son aïeul maternel, tandis que l’île d’Elbe était assignée à son père pour empire dérisoire. C’était en vain que Napoléon Ier avait abdiqué le trône impérial de France pour son fils, et que le corps législatif, qui représentait alors la chambre des députés, avait proclamé Napoléon II empereur des Français. Dans cette guerre inégale où la France, épuisée par vingt ans de triomphes, avait toute l’Europe devant elle, et où la misère publique, sans la justifier, servait de voile et de prétexte à la trahison, les projets, les serments de la veille étaient oubliés pour les projets et les serments du lendemain. Pendant tout cela, ne sachant pas même dans son exil que l’on songeait encore, par instants et selon les circonstances, à le donner pour successeur à son père, l’enfant disait avec amertume à sa gouvernante:
«Ah! je vois bien que je ne suis plus le petit roi, car je n’ai plus de pages.»
On éloigna de lui les quelques Français loyaux qui s’étaient fait un devoir de le suivre. Madame de Montesquiou resta seule encore de sa première maison; mais ce ne fut pas pour longtemps. Sa mère, l’impératrice Marie-Louise, étant partie pour l’Italie avec la triste souveraineté des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, la digne comtesse de Montesquiou fut renvoyée en France. Cette séparation fut des plus douloureuses.
«Maman Quiou, dit le petit roi désormais déshérité, maman Quiou, je serais bien heureux de retourner en France avec toi; mais bon papa (il parlait de l’empereur d’Autriche) assure que cela n’est pas possible: attends que je sois grand, et tu verras, je saurai bien aller tout seul te rejoindre en France.»
Les soins et les égards dont l’empereur d Autriche, son aïeul, et l’archiduc Charles, son oncle, entouraient l’enfant, ne lui faisaient oublier ni son pays natal, ni son père. Dans ce temps que l’impératrice, qui se montra plus oublieuse, elle, et de sa patrie adoptive et du grand homme qu’elle avait eu l’insigne honneur d’avoir pour époux, dans le temps que l’impératrice, sa mère, était encore avec lui au château de Schœnbrun près Vienne, on annonça un jour la visite d’un prince feld-maréchal autrichien qui avait servi comme général dans l’armée de Napoléon, et qui était passé à l’ennemi comme tant d’autres.
«Ne le reçois pas, maman, s’écria le roi de Rome: c’est un de ces vilains généraux qui ont trahi papa.»
Bientôt de sa grandeur prématurée le fils de Napoléon ne garda pas même le titre de roi de Rome; ceux qui naguère encore l’appelaient sire et majesté, ne lui donnèrent plus, par les ordres de la cour de Vienne, que le titre de duc et celui d’altesse. Celui qui était né souverain de l’ancienne capitale du monde, qui avait dû être empereur des Français, reçut en dédommagement de tant de splendeurs éclipsées, le nom jusqu’alors inconnu de duc de Reischtadt. Reischtadt pour lui remplaça Rome. Qui aurait pu prévoir une si rapide et si profonde chute? Quand Napoléon s’échappa de l’île d’Elbe, et entreprit à lui seul la dernière et la plus merveilleuse de ses campagnes, qui tint pendant cent jours l’Europe entière en échec, le jeune exilé en Autriche ne put pas revenir, lui, même pour ces jours glorieux et passagers. Sans doute on lui cacha la cause qui remettait ainsi subitement le monde en émoi; mais on se montra certainement plus disposé à lui apprendre que son père, écrasé définitivement par le nombre, venait d’être relégué non plus à l’île d’Elbe, mais sur le rocher de Sainte-Hélène, à trois mille lieues dans les mers.
Toutefois, il faut le dire, puisque telle est la vérité, on chercha autant que possible à la cour d’Autriche, à alléger pour le jeune prince exilé et déshérité, le fardeau d’un malheur inévitable; on ne lui laissa pas apercevoir les chaînes dans lesquelles on le retenait loin de sa patrie. L’empereur d’Autriche prenait à tâche de consoler lui-même une position qui l’attendrissait, qui le touchait profondément, mais à laquelle les intérêts de son empire et de sa famille lui interdisaient de rien changer. Son éducation fut confiée, dit-on, à des hommes capables de développer les heureuses facultés de son intelligence: comme il montrait des dispositions pour l’art militaire, on lui donna de bonne heure un régiment à commander. La gloire de son père ne lui fut point cachée tout entière; il avait à peine atteint sa douzième année, qu’il fut conduit sur la place où Napoléon avait remporté, contre deux empereurs coalisés, l’immortelle victoire d’Austerlitz. Mais, si bons, si aimables qu’ils fussent, ces hommes qui prenaient soin de son éducation, ces soldats qu’il commandait, ces généraux blanchis, il est vrai, sur les mêmes champs de bataille et sous les mêmes climats que les vieilles légions françaises, ces généraux qui lui faisaient visiter les lieux où son père avait été victorieux, tout ce monde était étranger, n’était pas Français, et le jeune prince le sentait, et les chagrins de l’exil, et le désespoir de n’avoir plus de père, rongeaient et minaient son cœur. On avait beau faire, c’était toujours l’Autriche avec ses habits blancs, qui se présentait devant ses yeux; et, ce qui vivait en lui, c’était la France et le glorieux renom et les malheurs de son père. Il est faux que le fils de Napoléon soit devenu Autrichien comme on l’a prétendu. L’imprudente visite que lui fit un Français, dans le cours de l’année 1826, prouve bien le contraire. Ce Français, prenant bien plus conseil de ses propres sentiments et de ses désirs que de la position du jeune prince, commença par étaler devant lui le tableau de la France humiliée par ce qu’il appelait un gouvernement imposé par l’étranger; et tout à coup, tirant de son sein une cocarde tricolore, il la lit briller aux yeux de l’exilé, en s’écriant que la France l’attendait comme un sauveur, et qu’il n’aurait qu’à montrer cette cocarde pour que tous les chemins lui fussent ouverts. Le jeune prince sentit bouillir son sang dans ses veines; il pâlit et rougit tour à tour; ses lèvres frémissaient d’une ardeur inconnue; on avait réveillé en lui, dans leur plus active énergie, tous les regrets du passé, tous les rêves de l’avenir; la fièvre lente qui le consumait dès longtemps dans le silence et l’isolement, était soudain transformée en un délire inexprimable à l’aspect de la cocarde des armées françaises.
«Dites, dites aux Français, s’écria-t-il avec enthousiasme, quelle émotion, quelle joie m’a saisi à la vue de cette cocarde dont vous me faites présent; dites-leur que j’ai soif de me montrer digne d’être le fils de l’empereur Napoléon.»
Mais ce n’était qu’un mouvement de fièvre, qu’une surexcitation, et cela ne pouvait être autre chose dans la position du jeune prince; son corps, usé avant l’âge par la pensée et par les douleurs intimes, ne pouvait pas se prêter longtemps à la dévorante activité d’une telle entrevue. Le Français qui l’avait mis aux prises avec une si formidable secousse ne fut pas plutôt parti, que l’infortuné jeune homme s’affaissa sur lui-même, et de ses lèvres mourantes s’échappaient ces paroles où la souffrance et l’inquiétude se mêlaient à l’amertume:
«Eh! mon Dieu, que veulent-ils faire de moi? croient-ils donc que j’aie la tête de mon père?»
A compter de ce jour, on interdit aux Français qui étaient dans Vienne tout accès auprès du prince. Ce dut être une bien douloureuse privation pour lui; mais on lui dit que la politique et le repos de l’Europe l’exigeaient, et encore une fois il parut se résigner, le pauvre jeune homme. Ceux qui l’appelaient en France sans avoir de moyens de l’y ramener, ne faisaient que resserrer son exil et en aggraver les intimes souffrances.
La Révolution de 1830, qui jeta un autre jeune prince également innocent loin de sa patrie, ranima les espérances du fils de Napoléon, mais ne fit que hâter sa fin. Il ressemblait à une lampe près de s’éteindre, et qui ne jetait quelques flammes à ses derniers moments que pour mieux marquer l’heure de son complet anéantissement. Une tentative fut faite pour l’enlever, l’amener en France, et lui donner le trône; elle échoua. L’infortuné jeune homme, il n’agissait pas, mais il se laissait faire; il n’allait pas de lui-même, mais il était prêt à se laisser conduire où son cœur l’appelait. Il devait succomber sous tant de luttes intérieures. Le supplice moral que les événements lui imposaient, était au-dessus de ses forces. Il était de plus en plus sévèrement tenu à l’écart des Français qui voyageaient en Autriche. Depuis plus de cinq ans déjà, il ne parlait plus à un seul; mais du moins il en pouvait distinguer, de temps à autre, quelques-uns se promenant accompagnés de gardiens sous les ombrages du parc de Schœnbrun, où était sa demeure habituelle. L’entrée du parc impérial fut interdite aux Français, et, si par hasard quelqu’un d’entre eux aperçut encore sa grave et pâle figure dans les allées qui avoisinaient le château, ce ne fut qu’à la dérobée et en jetant un coup d’œil furtif à travers les lointaines percées extérieures du parc. Il n’y eut que le maréchal Marmont, duc de Raguse, qui dut à son haut rang et peut-être à sa position d’homme malheureux et presque fugitif de France après la révolution de 1830, de pouvoir arriver jusqu’au fils de Napoléon. Le jeune prince se montra d’abord peu disposé à le recevoir, malgré l’exception que le gouvernement d’Autriche accordait au maréchal, et peut-être même à cause de cette exception: car le fils de Napoléon n’ignorait pas que le duc de Raguse avait été hautement accusé d’avoir trahi son père et livré Paris aux étrangers. Toutefois le maréchal fut assez heureux pour parvenir à vaincre les répugnances du prince, et pour justifier pleinement ensuite sa conduite devant lui. Le fils de Napoléon le reconduisit jusqu’à la porte de ses appartements, et, s’adressant aux officiers de sa maison, il leur dit: «Messieurs, je vous présente M. le maréchal Marmont, l’un des plus braves compagnons d’armes de mon père; je le connais maintenant, et je puis dire de lui comme du chevalier Bayard: Il est sans peur et sans reproche.»
On peut, sans atténuer pour cela l’expression si favorable au maréchal, interpréter ces bienveillantes paroles comme une preuve de l’excellence du cœur et de la générosité d’âme du prince; l’entrevue entre lui et le duc de Raguse dut être douloureuse et pénible, surtout pour celui-ci qui avait à se justifier devant le fils de son bienfaiteur, et l’on voit, dans le mot du jeune exilé, l’intention de laver un militaire, plus malheureux que coupable, des reproches de l’histoire.
Cependant le mal intérieur qui dévorait le prince infortuné empirait dans l’ombre. Sa pâle figure maigrissait à vue d’œil, et le triste voile de ses longues paupières, la mélancolie de ses yeux bleus rendus plus grands par la maigreur, donnaient déjà à sa physionomie quelque chose qui tenait autant de la mort que de la vie. A cette même époque il fut pris, dit-on, d’une croissance soudaine qui contribua à hâter sa fin. Ce n’était plus qu’un spectre qui semblait, à chaque pas, s’avancer vers la tombe. L’habit blanc qui composait son uniforme autrichien seyait d’une étrange manière à sa pâleur mortelle. Ceux qui, vers l’automne de 1831, le voyaient errer lentement et péniblement ainsi, la tête inclinée et les bras croisés sous les grands arbres de Schœnbrun qui perdaient leur feuillage jaunissant, se sentaient saisis d’une stupeur mêlée de larmes. Tout le monde aimait le jeune prince en Autriche: car il était aimable et bon, et l’on ne pouvait s’empêcher de donner des pleurs à celui qui avait commencé par tant de grandeur, à qui un si brillant avenir avait été promis en naissant, et qui s’éteignait prématurément loin du sol natal, sacrifié, innocente victime, à la paix du monde.
Au mois d’avril 1832, les souffrances et la maladie du fils de Napoléon furent rendues publiques, et l’on annonça son départ pour l’Italie. Mais ce ciel bienfaisant de l’Italie que les médecins lui avaient prescrit, il ne le vit pas. Peut-être se rappela-t-on, pour l’en priver, qu’il était né roi de Rome, et pensa-t-on que sa seule présence sur le sol italien suffirait pour soulever les populations en sa faveur, et pour qu’on proclamât son fantôme impérial, monarque d’un nouvel empire romain. Quoi qu’il en soit, il resta en Autriche, dans le château de Schœnbrun, qui avait reçu vingt ans auparavant l’empereur Napoléon en vainqueur, en conquérant, au faîte de sa puissance.
Que de souvenirs à la fois glorieux et tristes ce château ne devait-il pas, à chaque instant, offrir à l’imagination du jeune malade, étendu sur un lit de souffrances dans la chambre même où Napoléon avait autrefois rendu les décrets qui amenèrent son mariage avec l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche!
Marie-Louise, la veuve trop tôt consolée du grand homme, la mère de l’infortuné prince, vint enfin, de son duché de Parme, voir son fils à ses derniers moments, et verser des larmes sur le lit d’où le malade ne devait plus se relever. Elle le trouva couché auprès de ce même berceau de vermeil dont lui avait fait présent, à sa naissance, la Ville de Paris, et qu’il avait voulu revoir avant de mourir. Elle le serra dans ses bras et fut saisie d’une grande et profonde douleur à l’aspect de ce fils, trop oublié d’elle pendant quinze ans, qu’elle avait vu si plein de santé au temps de leur prospérité commune, et qu’elle retrouvait si pâle, si défait, n’offrant plus, dans sa vingt-unième année, que l’image funèbre de lui-même. La mère et le fils échangèrent quelques pensées; les paroles expiraient sur les lèvres du jeune prince, mais ses longs regards et son doigt indiquaient le ciel, et en même temps il colla sur sa bouche un médaillon où était représentée l’image de son père. Puis, comme s’il craignait que ce portrait ne fût, pour sa mère, un reproche, il le cacha dans son sein.
On était au mois de juillet 1832; la capitale de l’Autriche présentait un aspect morne et triste, quoique toute la population fût hors des maisons. Le recueillement et la mélancolie se peignaient sur tous les visages. Bientôt on vit paraître une division de hussards, puis une voiture de cour à six chevaux. Quand le carrosse fut arrivé en face de l’église des Capucins de Vienne, un personnage en grand deuil en descendit, et frappa à la porte de l’église.
«Pour qui se présente-t-on?» demanda une voix du dehors.
—Pour très-iliustre et très-auguste prince S. A. I. Napoléon Bonaparte, duc de Reischtadt, colonel d’un régiment de Sa Majesté, mort le 22 juillet 1832, à cinq heures du matin, au château de Schœnbrun, dans le sein de l’Église catholique et romaine.
—Que Dieu ait son âme!» reprit la voix du dedans, en répondant au personnage qui avait décliné les litres du défunt.
Et en même temps les portes de l’église s’ouvrirent, et l’on aperçut à genoux dans le chœur, illuminé et tendu de noir, les princes et princesses de la maison impériale d’Autriche, en grand deuil et escortés des principaux personnages de la cour. Alors on vit s’avancer à pas comptés vers l’église le catafalque du défunt, traîné par huit chevaux caparaçonnés de housses noires semées de larmes d’argent; des porteurs de torches marchaient aux côtés du corbillard; des détachements de hussards et de grenadiers formaient le cortége.
On distinguait aisément, à sa contenance pleine de douleur et aux pleurs qui baignaient les visages, le régiment de Gustave Wasa, dont le prince avait été le colonel affectueux et chéri. Par ordre de l’empereur d’Autriche, ce régiment portait déjà, et il porte encore le nom de Napoléon sur ses drapeaux. Les soldats de ce régiment descendirent le cercueil du corbillard et le portèrent dans le chœur de l’église des Capucins. Après la cérémonie, que sa simplicité rendait encore plus touchante, le cercueil fut descendu dans le caveau de la famille impériale d’Autriche. Selon l’usage de cette famille, on ne grava aucune épitaphe sur la pierre qui recouvre les restes du prince; mais on assure que, quelques jours avant sa mort, il avait lui-même composé celle-ci:
Ci gît le fils du grand Napoléon!
Il naquit roi de Rome
Et mourut colonel autrichien!
Assurément si cette épitaphe était de lui, elle disait assez la cause de sa mort prématurée. Ce qui ne l’exprimerait pas d’une manière moins éloquente et moins triste, ce sont ces dernières paroles entrecoupées, qui s’exhalaient, dit-on, de son cœur et de ses lèvres au moment où il rendait l’âme:
«Oui... sans gloire... pour la France... Ah! mon père!»
L’église des Capucins de Vienne eut donc son corps; l’église Saint-Étienne de la même ville eut ses entrailles; et son cœur, son cœur qui appartenait d’origine et de prédilection à la France, fut aussi l’héritage d’un temple religieux de l’Autriche; il fut donné à l’église des Augustins, et déposé dans la chapelle de Lorette.

Schœnbrun 1830!
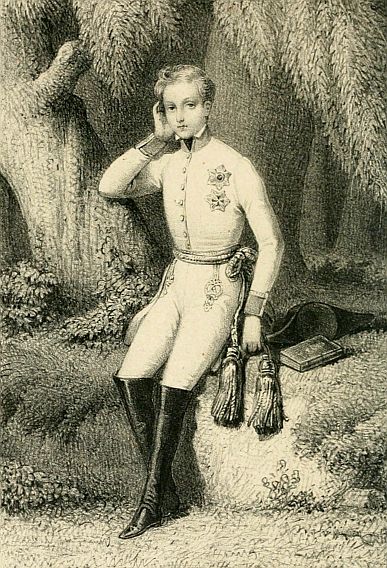
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| Le petit Roi de Rome. | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Cette pêche se fait d’une manière assez curieuse pour mériter, mes enfants, qu’on vous en dise deux mots. Avant tout, vous saurez que la perle se trouve dans l’écaille d’une espèce de coquillage (comme l’huître et la moule), qu’on nomme mère-perle. Bien différente des autres pierres précieuses, qui toutes sont brutes quand on les trouve, celle-ci naît parfaite, et la nature y a mis la dernière main, avant qu’on l’arrache de sa nacre.
La pêche des côtes de Ceylan est faite par les Anglais. Elle commence dans les premiers jours de mars; plus de deux cent cinquante bateaux y sont employés; et ils viennent avec leurs équipages, leurs plongeurs et tout leur appareil, des divers points de la côte de Coromandel.
Après s’être livrés préliminairement à une foule de cérémonies superstitieuses, communes chez les matelots, les pécheurs gagnent le large à minuit, guidés par des pilotes. Arrivés au banc de perles, ils jettent l’ancre, attendent le jour; et, dès que le soleil paraît, ils se mettent a l’œuvre.
On commence par disposer, de chaque côté du bateau, un faisceau composé de rames et de pièces de bois, qui devra porter la corde du plongeur; puis on fixe cette corde par son extrémité, à travers une pierre, du poids de vingt-cinq kilogrammes, en forme de pain de sucre. Un nœud ouvert, en guise d’étrier, permet de fixer un pied sur la pierre.
Ceci fait, le plongeur se jette à la nage, attrape du pied la pierre et l’étrier, et, se soutenant à la corde, reste un instant droit et fixe dans cette position. Son bras lui sert de balancier pour conserver l’équilibre. Une corbeille, attachée à une seconde corde, lui est alors jetée; il s’en saisit, y place son autre pied. Quand il se croit suffisamment préparé à plonger, d’une main il bouche ses narines pour empêcher l’eau d’y entrer; de l’autre, il donne une secousse à la corde qui le soutient, il se trouve ainsi couler au fond rapidement, grâce au poids de la pierre et au jeu d’une poulie; en même temps on a lâché la corde qui tient à la corbeille.
Dès qu’il a touché le banc, le plongeur dégage son pied du nœud qui le retenait sur la pierre. Une fois libre au fond de l’eau, il se précipite, la tête en avant, sur tout ce qu’il trouve; il en remplit sa corbeille. Veut-il enfin remonter? il lui suffit de secouer sa corde qu’on retire alors aussi vivement que possible vers le bateau; en la suivant de la main, il revient à la surface. Le temps qu’un plongeur passe sous l’eau, excède à peine une minute et demie; et, dans ce court intervalle, s’il est habile, il a pu jeter dans sa corbeille environ cent cinquante coquillages.
Il y a toujours deux plongeurs pour chaque pierre, de sorte que l’un d’eux se repose quand l’autre est sous l’eau. Après être revenus à l’air, la plupart de ces hommes rendent du sang par les narines et par les oreilles; pourtant on ne les entend jamais murmurer ni se plaindre, si ce n’est quand la pêche est mauvaise.
La journée finie, sur un signal du pilote, la petite flottille regagne le rivage aux acclamations de la foule qui s’y trouve assemblée. Chaque bateau prend sa station; les coquillages se déposent dans des enclos pavés; on les y place en tas, sous une garde sûre, pendant une dizaine de jours: temps nécessaire pour les amener à un état de putréfaction. Une fois décomposés, on les jette dans un grand vase rempli d’eau salée, où on les laisse environ douze heures, pour les amollir. Alors on les prend un à un; on en sépare les écailles, on les lave. Celles des écailles qui contiennent des perles, sont mises à part, et passent entre les mains de gens appelés trieurs, qui les détachent avec des pinces.
Après qu’on a extrait du haquet toutes les écailles, il reste naturellement au fond une espèce de bourbe composée de fragments d’écailles, de sable, etc. Alors on passe l’eau salée dont on veut se débarrasser, dans un sac, en guise d’égouttoir, afin qu’il n’y ait rien de perdu, et on lui substitue de l’eau pure; après quoi, l’on agite sans cesse tout ce qui reste de matières grossières, et l’on continue de les dégager, jusqu’à ce qu’enfin le sable et les perles demeurent seuls au fond. Il est facile d’y saisir les grosses perles; on les aperçoit au premier coup d’œil; mais la recherche des petites est un travail fort minutieux.
Une fois qu’on a bien lavé, séché, essuyé toutes les perles petites et grosses, on les dispose par classes selon leur volume; enfin, on les perce d’un trou pour les passer dans un cordonnet. C’est ainsi, mes enfants, que ces perles, de si peu de valeur d’abord, et plus tard si précieuses, sont livrées au commerce.
Les perles étaient connues des Hébreux. Job en parle dans les livres saints. Les Grecs y prirent goût, au temps d’Alexandre. Les Romains les préféraient à toute autre parure; ils les tiraient d’Orient. On cite des perles auxquelles on attachait des prix qui passent toute croyance. Celle dont Jules-César fit présent à Servilie, avait coûté près de onze cent mille livres tournois. Les perles qui ornaient les oreilles de la célèbre Cléopâtre avaient une valeur énorme de trois millions huit cent mille livres. C’est à peu près ce qu’il en eût coûté pour nourrir, pendant toute une année, deux mille huit cents pauvres familles.


Si toutes les paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ sont des préceptes, toutes ses actions sont des exemples. Nous devons donc imiter sa vie, comme le modèle accompli d’une vie chrétienne; et plus nous serons semblables à lui, plus nous serons parfaits devant Dieu. Or, vous savez mes chers enfants, que le Sauveur, après son baptême, se retira dans une affreuse solitude, afin de se préparer, par un jeûne de quarante jours, aux grandes choses qu’il allait opérer. L’Église n’a point oublié cet enseignement divin, et outre les mortifications ordinaires de l’année, elle a établi, avant la fête de Pâques, le jeûne du Carême. Son but est de nous rappeler la retraite de Jésus au désert, de suivre son exemple, et de nous disposer, par une longue pénitence, à célébrer dignement le mystère de la Résurrection.
Les austérités du Carême étaient autrefois d’une extrême rigueur. Elles consistaient principalement à ne faire qu’un seul repas vers le soir, et à s’abstenir non-seulement de viande, mais encore d’œufs, de laitage et de vin. Quelques chrétiens s’abstenaient aussi d’aliments crus et secs, tels que les amandes, la noix, etc.; d’autres ne mangeaient que des racines; d’autres enfin ne vivaient que de pain et d’eau. On gardait partout un profond silence. Les villes devenaient paisibles comme des solitudes, et les journées se passaient dans la prière et le recueillement. Nul n’était exempt du jeûne, pas même les rois et les empereurs; et les enfants y étaient obligés dès l’âge de dix ans. Cependant la règle se relâcha peu à peu. Le repas du soir se fit d’abord à trois heures, puis à midi; puis on permit une légère collation, et voici comment ce dernier usage s’introduisit. Les moines, outre les jeûnes de l’Église, en observaient d’autres ordonnés par les constitutions de leurs monastères; et comme, après le repas de trois heures, ils allaient travailler aux champs, ils obtinrent la permission de boire un peu d’eau (car il n’était point permis de se désaltérer); et il fut décidé qu’aux jeûnes des constitutions seulement, les moines se rafraîchiraient au réfectoire, avant la conférence ou collation de la Vie des saints Pères. On étendit plus tard la permission aux jeûnes établis par l’Église, et en faveur de tous les chrétiens. Bientôt on joignit à l’eau quelques gouttes de vin, puis du pain, et le nom de collation resta néanmoins à ce léger repas du soir que l’on tolère aujourd’hui.
Le premier jour du Carême est un mercredi, appelé mercredi des Cendres, à cause d’une cérémonie dont l’origine remonte aux premiers siècles du christianisme. Autrefois, quand un chrétien avait commis une faute grave, il était obligé d’en faire publiquement pénitence, sous peine d’excommunication. L’excommunication le privait de l’entrée de l’église, de l’usage des sacrements, de toute communication avec les fidèles, et de la sépulture ecclésiastique. Voici en quoi consistait la pénitence publique. Un prêtre délégué par l’évêque, et quelquefois l’évêque lui-même, examinait la conduite du coupable, la gravité du crime commis, fixait la durée de la peine, et décidait s’il y avait lieu à confession publique. Dans ce cas, le pénitent s’accusait de son crime devant le peuple. De plus, le premier jour du Carême, il se présentait à l’église avec des vêtements déchirés en signe de deuil, et allait recevoir des mains de l’évêque des cendres et un cilice. C’était une chemise de crin, d’un tissu extrêmement rude, que l’on portait sous ses habits. Il assistait encore aux prières qu’on faisait afin d’obtenir la grâce de sa conversion et les écoutait à genoux; puis l’évêque le mettait hors de l’église, dont les portes se refermaient sur lui, et où il ne pouvait rentrer qu’après l’expiration de sa peine. La durée de la pénitence publique était de deux ans, sept ans, onze ans, vingt ans, quelquefois de toute la vie, selon l’énormité du crime.
Les pénitents passaient les jours et les nuits à pleurer leurs fautes, gardant un silence presque absolu et un jeûne rigoureux. Dans les grandes fêtes, ils s’agenouillaient sur le parvis de l’église, demandant aux chrétiens le secours de leurs prières; et ceux qui n’étaient pas condamnés à perpétuité, recevaient solennellement l’absolution le jeudi-saint, après avoir été soumis à des épreuves longues et variées.
Aucun chrétien ne pouvait se soustraire à cette terrible punition. En effet, on a vu l’empereur Théodose subir, comme les autres, la pénitence que saint Ambroise lui imposa, pour avoir fait massacrer injustement et sans distinction les habitants d’une ville révoltée.
Bien peu de chrétiens auraient maintenant un pareil courage, mes chers enfants; aussi l’Église, plus tendre que sévère, n’a conservé de cette coutume que la cérémonie du Mercredi des Cendres. Vous y avez probablement assisté, mais je ne sais si vous l’avez comprise. Cela n’est pourtant pas très-difficile, quand on fait attention aux paroles du prêtre: «Homme, dit-il, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière.» Cela nous apprend que nous ne devons nous glorifier de la beauté de notre visage, ni de la richesse de nos vêtements, ni de tout ce que nous possédons, puisque ces choses se dissiperont d’elles-mêmes, et que notre âme une fois devant Dieu, il ne restera de nous qu’un peu de poudre. Cela nous apprend encore qu’il faut renoncer aux plaisirs pendant ces jours de Carême, remplis des souvenirs de la Passion du Sauveur. Si la faiblesse de votre âge vous dispense du jeûne et des austérités, entrez du moins dans la pensée de l’Église, qui veut par là nous inspirer un repentir sincère de nos fautes. Profitez de la grande leçon que le prêtre vous a donnée, et qu’elle laisse plus de traces dans vos cœurs que la cendre légère n’en a laissé sur vos fronts.

C’était le 5 juin 1783. Tous les habitants d’Annonay et les personnes les plus distinguées de la province se trouvaient rassemblés dans cette ville pour assister à un spectacle bien extraordinaire. Une énorme machine en toile, recouverte de papier, ayant la forme d’un sac, était disposée sur la place publique. Deux hommes, dont la science et la réputation inspiraient d’ailleurs toute confiance, avaient annoncé que, dès que cette machine serait une fois remplie par des vapeurs qu’ils avaient l’art de produire, elle s’élèverait d’elle-même jusqu’aux nues. Tout le monde était dans l’attente.
Cependant un feu de paille est allumé sous le ballon; des vapeurs s’en dégagent et pénètrent par une ouverture pratiquée à sa partie inférieure; la machine enfle et s’arrondit; et bientôt, à un signal donné, dégagé des liens qui le retenaient au sol, le ballon s’élance dans les airs en présence d’une multitude qu’un tel spectacle frappe de surprise et d’admiration. En moins de dix minutes, il est parvenu à 2,000 mètres d’élévation; puis, après avoir parcouru une longue ligne horizontale, il descend lentement et vient retomber à terre.
Les auteurs de cette étonnante découverte étaient deux frères: Joseph et Étienne Mongolfier; ils appartenaient à une famille honorable du Vivarais. La similitude de leurs goûts les avait dirigés tous deux vers l’étude des sciences; une étroite amitié leur faisait mettre en commun le fruit de leurs pensées. Ces jeunes savants avaient observé que l’air chaud, plus léger que l’air froid, tend toujours à s’élever avec une certaine force; et une observation attentive des nuages, qui, malgré leur poids, se soutiennent à de grandes hauteurs, leur fit entrevoir la possibilité d’imiter à leur tour la nature; c’est alors qu’ils conçurent l’idée d’emprisonner de l’air chaud dans des tissus imperméables; ce fut là tout leur secret.
La nouvelle de leur expérience parvint bientôt à Paris; les physiciens voulurent la répéter. Cette deuxième ascension eut lieu au Champ-de-Mars, le 27 août suivant, à l’aide d’une machine de taffetas enduit de gomme élastique; mais, comme le procédé de MM. Mongolfier était encore ignoré, on se servit d’un gaz connu alors sous le nom de gaz inflammable (aujourd’hui gaz hydrogène), environ treize fois plus léger que l’air atmosphérique. Une immense affluence de curieux couvrit la vaste enceinte du Champ-de-Mars et tous les alentours: à cinq heures du soir, un coup de canon est tiré; à ce signal, les liens sont coupés et le ballon, abandonné à lui-même, s’élève avec une grande vitesse et va se perdre dans un nuage: un second coup de canon annonce sa disparition; puis il reparaît bientôt, et, au bout de trois quarts d’heure, il redescend avec majesté, et va tomber près d’Écouen, à environ cinq lieues de son point de départ. Cette ascension merveilleuse excita un enthousiasme difficile à décrire.
Ce devait être, en effet, un spectacle bien étrange que celui d’une toile plate d’abord, qui, par une cause alors inconnue, se gonflait, déployait insensiblement ses plis et replis; puis, une fois bien arrondie, développée, s’élançait de terre pour aller voyager seule dans l’espace.
Étienne, le plus jeune des deux Mongolfier, s’étant rendu à Paris, fut invité à répéter sa propre expérience à Versailles, et le roi Louis XVI voulut y assister. Il fit construire un énorme globe en canevas doublé de papier en dedans et au dehors, et plaça cet appareil au milieu de la grande cour du château. Dès le matin du 19 septembre, jour fixé pour l’ascension, les avenues de Versailles étaient couvertes de voitures: de toutes parts, on arrivait pour être témoin de cette expérience. A une heure après midi, le ballon, après lequel on avait suspendu une cage contenant un mouton et quelques volatiles, s’éleva en présence de la Famille Royale et de plus de cent cinquante mille spectateurs; il parvint rapidement à une grande hauteur; puis, chassé par le vent, flotta pendant quelques minutes et alla s’abattre dans le bois de Vaucresson. Vous êtes sans doute inquiets, mes enfants, sur le sort du pauvre mouton qu’on avait soumis à ce périlleux voyage; rassurez-vous: il fut trouvé sain et sauf, et broutant paisiblement le foin dont on avait pourvu sa cage.
Cette épreuve démontra que les animaux, destinés par la nature à vivre sur la terre, pouvaient traverser les airs sans danger; et l’on songea à tenter un essai plus hardi. Un ballon fut construit plus vaste et plus beau que les précédents: on lui donna douze mètres de hauteur et trente-six de tour; sa couleur était bleu d’azur; sa partie supérieure fut ornée des douze signes du zodiaque en or; le milieu portait les chiffres du roi, aussi en or, entremêlés de soleils, et le bas était entouré de guirlandes et d’aigles aux ailes déployées, qui semblaient supporter, en volant, cette énorme machine. Au-dessous du ballon on fixa une nacelle en osier, revêtue de toiles peintes de diverses couleurs, et disposée pour recevoir commodément l’homme intrépide qui, le premier, aurait le courage d’aller prendre possession de l’air. Un physicien distingué, nommé Pilâtre de Rozier, se présenta et fut placé dans la nacelle. Le ballon, retenu par des cordes fixées au sol, s’éleva à diverses reprises jusqu’à 200 mètres; c’était la première fois qu’on voyait un homme monter et se soutenir dans les airs; bientôt après, Pilâtre de Rozier, enhardi par cette épreuve, osa se lancer à ballon perdu, partit du château de la Muette, au bois de Boulogne, et traversa, à une assez grande hauteur, tout Paris émerveillé d’un voyage si extraordinaire.
Dès ce jour, l’enthousiasme des hommes qui cherchent, dans les découvertes nouvelles, des perfectionnements utiles à la société, ne connut plus de bornes. Il ne restait plus qu’à apprendre l’art de diriger les ballons, et la navigation aérienne était inventée. Que d’avantages les sciences n’allaient-elles pas en retirer!!!
«On s’élèvera, disaient-ils, dans la région des nuages pour interroger la nature et pour assister à la formation de la neige, de la grêle et des phénomènes dont la physique ne peut expliquer les causes....
Les déserts brûlants dans lesquels l’homme craint d’être enseveli sous des monceaux de sables accumulés par les vents, ne seront plus un obstacle pour lui, dès qu’il aura des ballons pour les traverser....
Ces voyages aux pôles si souvent tentés et toujours entravés par les glaces, réussiront enfin, ajoutaient-ils; un vent favorable nous y conduira, en peu de temps, à travers les airs, et un vent contraire nous ramènera au point de départ....»
Je n’en finirais pas, mes enfants, si je vous disais toutes les espérances dont se bercèrent les savants; mais, hélas! il en fut de leurs illusions comme de celles de la laitière, dans la fable de la Laitière et du Pot au lait.
Au reste, la faveur qui s’attacha à cette invention, ne fut pas stérile pour ses inventeurs. L’Académie des sciences admit les deux frères dans son sein; Étienne Mongolfier fut décoré de l’ordre de Saint-Michel; Joseph eut une pension de 1,000 fr., et leur vieux père reçut de Louis XVI des lettres de noblesse.
L’engouement fut extrême pour les ascensions aérostatiques[7]; l’empressement de ceux qui voulurent monter dans ces frêles machines était tel, que plusieurs furent sur le point de soutenir leurs prétentions, les armes à la main. Mais un déplorable accident vint bientôt montrer les dangers de cette prétendue navigation.
Un aéronaute[8], M. Blanchard, s’était élevé, à Douvres, dans un ballon, et avait abordé à Calais en peu de temps, après avoir traversé la Manche. Pilâtre de Rozier, le même que nous avons vu entreprendre la première ascension à Paris, voulut, à son tour, passer de Boulogne en Angleterre; mais son ballon, élevé à peine à 150 mètres, s’enflamma soudain, et l’infortuné voyageur tomba sans vie, non loin du point d’où il était parti. Ce fut une perte bien vivement sentie que celle de ce jeune physicien mort à vingt-huit ans, victime de son ardent amour pour les sciences. Ce malheur et plusieurs autres semblables survenus depuis, refroidirent l’ardeur des aéronautes. D’un autre côté, toutes les tentatives faites pour diriger les ballons, soit au moyen de rames, comme les bateaux, soit avec des nageoires, à l’image des poissons, soit enfin à l’aide d’un mécanisme quelconque, ayant échoué contre la puissance de l’air et la force des vents, l’espoir de la navigation aérienne fut abandonné; et ces ascensions, ayant dégénéré en amusements, ne servent plus qu’à embellir nos fêtes et nos jeux publics.

|
C’est ainsi que l’on a nommé ces ascensions, du nom générique d’aérostats (c’est-à-dire qui se soutiennent dans l’air), donné aux ballons. |
|
On désigne, par ce nom, ceux qui s’élèvent dans les aérostats. |
La jeune Espagnole.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| Elle fit sa prière du soir en contemplant la croix qui venait de lui être donnée. | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Parmi les brigands fameux qui ont été le fléau et l’opprobre de l’humanité, Fra-Diavolo est de ceux qui dépassent les criminels vulgaires de toute la hauteur de leur front fatal et marqué d’un signe indélébile comme celui de Satan, dont ils semblent être la personnification sur la terre. Fra-Diavolo fut plus habile qu’aucun de ses confrères en infamie à prendre toutes les formes, tous les déguisements; on aurait plutôt reconnu les couleurs variables à l’infini du caméléon que celles dont se couvrait instantanément, et avec le plus perfide sang-froid, ce brigand espagnol. Il était parvenu à dresser à ses allures une bande nombreuse de scélérats, et il remplissait avec elle toute l’Espagne d’une terreur d’autant plus grande, qu’il avait su se rendre comme invisible, et qu’il frappait partout en ne se montrant, pour ainsi dire, nulle part. Un vol, un meurtre, un incendie, s’étaient consommés ici, et par ses mains, que déjà et pendant que l’on s’épuisait à chercher sa trace dans le voisinage, un autre crime se commettait toujours par ses mains sanglantes et impies à cinquante lieues de là. La conformation même du sol de l’Espagne, principal théâtre de ses forfaits, le servait dans ses mystérieuses exécutions; car l’Espagne est, au moins dans plusieurs de ses principales provinces, couverte de montagnes, au milieu desquelles sont pratiquées des routes difficiles, profondes et sinueuses, où l’on peut être égorgé à l’improviste sans que l’on ait à espérer d’y faire entendre un appel au secours, sans que l’on ait même le temps d’y crier grâce et pitié. La police a été toujours extrêmement mal faite en Espagne; les voyageurs n’y ont jamais trouvé que peu de protection contre les dévaliseurs de grand chemin. Mais, cette fois, l’effroi qu’inspiraient Fra-Diavolo et sa bande était devenu tel, qu’une armée entière avait été mise sur pied pour les saisir et les anéantir. On n’aurait pas fait davantage s’il se fût agi d’une invasion étrangère. Cependant on n’arrivait à rien, et ce déploiement de forces au contraire contre un brigand donnait à Fra-Diavolo une importance capable de le changer, à la première occasion, de chef d’assassins en chef de parti. Ce qu’une armée n’avait pu faire, une jeune fille, une enfant, le fit avec une prière à Dieu.
Dans une petite ville espagnole, située au milieu d’une gorge que dominaient les hautes montagnes et les forêts pleines d’ombre et de bruits vagues et sinistres, il y avait une hôtellerie où se rendaient nécessairement tous les voyageurs qui passaient; car elle était la seule du lieu et des environs. L’aubergiste, d’ailleurs, et sa femme étaient de braves gens qui conservaient la sympathie de tous ceux dont ils avaient reçu la visite. A l’époque de la fête patronale de l’église, principalement, on s’empressait de se rendre chez eux, sachant que l’on y trouverait bonne table et bonne mine. Le jour de la fête du saint patron était aussi celui que le curé de la ville choisissait ordinairement pour faire faire la première communion aux enfants de ses paroissiens; de sorte que beaucoup de personnes, attirées par cette solennité plus que par la pensée des plaisirs bruyants, augmentaient encore le nombre des voyageurs qui remplissaient l’hôtellerie, souvent dans des intentions bien différentes. Cette année, par une grâce particulière du ciel, la fille même de l’aubergiste, nommée Antonia, devait être du nombre des premières communiantes. Il est certains états dans la vie où il est plus difficile qu’en bien d’autres de demeurer pur et vertueux; ce sont ceux qui nous rendent en quelque sorte dépendants d’un public parfois injuste et grossier, qui se croit tout permis, insolence et sots propos, parce qu’on le sert et qu’il paie. L’état d’aubergiste est, sous ce rapport, l’un des plus délicats pour les femmes; il y faut avoir mille oreilles pour toutes les questions, pour toutes les politesses, et il n’y faut avoir aucune oreille pour les impertinents discours. Entre ce double écueil que l’intérêt rend encore plus dangereux, qui se préserve est un ange, et c’est ce qu’était Antonia. Pas une ombre n’obscurcissait son front ni son cœur; elle était ce que Dieu l’avait faite le jour où il l’avait laissée tomber de ses mains, une perle où se reflétait le ciel. Elle entrait dans sa treizième année. Comme cela a lieu pour les élus d’en-haut; il semblait qu’une sainte auréole serpentât, flamme céleste, au-dessus de sa tête: elle imprimait déjà le charme qui attire et le respect qui retient.
Le matin de la première communion, Antonia fut revêtue par sa mère d’habillements modestes, mais, comme la neige, éblouissants de blancheur. Le blanc calice d’un lis virginal était le seul ornement étranger dont on l’eût parée, et il semblait retenir sur le front modeste de la charmante enfant le long voile de rigueur, qui était rejeté sur ses épaules et traînait jusqu’à terre. Le bon aubergiste avait voulu acheter lui-même le beau cierge transparent qu’il mit entre les mains de sa fille. Ce fut ainsi que la jeune Antonia, entre son père et sa mère, se dirigea vers l’église. L’église avait également revêtu sa robe de fête; des feuillages et des fleurs s’enlaçaient avec grâce aux colonnes et retombaient négligemment en guirlandes sous les arceaux gothiques; des grenadiers mêlaient leur éclat au parfum des orangers sur les marches du maître-autel, auquel on ne parvenait qu’au milieu d’une double et symétrique allée d’arbustes, dont les caisses étaient enveloppées de beaux linges blancs parsemés de bouquets naturels. Dans le chœur, des bancs, disposés à cet effet et recouverts de tapis de couleur écarlate, attendaient les élus du Seigneur, les jeunes garçons d’un côté et les jeunes filles de l’autre.
Je ne réussirais pas à vous bien retracer la joie pleine de béatitude et mêlée d’un profond recueillement qui brilla sur le visage de toute cette pieuse jeunesse pendant l’auguste cérémonie; je n’entreprendrai de vous traduire ni la chaleureuse exhortation par laquelle un vieillard presque octogénaire sut faire passer en des âmes innocentes le feu religieux dont il était embrasé, ni le mouvement inspiré par lequel il convoqua les élus à venir enfin prendre leur part à la sainte table et somma les indignes de reculer pendant qu’ils le pouvaient encore; enfin je ne me hasarderai point à vous peindre ce quart d’heure d’initiation où les premiers communiants, au milieu des larmes qui débordaient de leur cœur en même temps que de celui du vénérable prêtre par qui s’accomplissait le sacrifice, vinrent tomber tour à tour, et par rangs égaux, aux marches de l’autel, pour se relever participants de la chair et du sang du Sauveur des hommes.
Les récents souvenirs ou les espérances prochaines de ceux qui m’écoutent, leur en diront plus que mes paroles.
Lorsque la cérémonie fut terminée, tous les parents, tous les amis, entourèrent les enfants et les félicitèrent. Antonia revint, comme elle était partie, entre son père et sa mère, dont les regards brillants annonçaient assez la joie. Pour couronner ce jour de fête, l’aubergiste avait fait dresser plusieurs tables auxquelles il fit asseoir non-seulement ses amis et ses proches, mais encore tous les voyageurs qui se trouvaient dans son hôtellerie, voulant, disait-il, que tout le monde fût heureux de son bonheur. Le repas fut gai sans être trop bruyant; la présence seule d’Antonia suffisait pour suspendre sur les lèvres les paroles trop vives.
Parmi les convives se trouvait une riche Anglaise qui venait, tous les trois ou quatre ans, en Espagne pour voir une de ses sœurs qui s’y était mariée. Il lui fallait absolument passer par la petite ville de la montagne, et déjà, plusieurs fois, elle était descendue dans l’hôtellerie, où on la traitait avec les plus grands égards et la plus haute considération. Il était aisé de voir à ses discours, à sa tenue, à ses manières, qu’elle appartenait aux plus hautes classes de la société.
Un Espagnol, au geste superbe et poli à la fois, et dont la conversation était empreinte de je ne sais quel air de grandeur, avait pris place à côté de la dame anglaise. Chacun le saluait avec respect du titre de comte, et plusieurs personnes, qui semblaient être de sa connaissance, ne lui répondaient, à la table, qu’avec toutes les apparences de l’infériorité et de la soumission. C’était, à n’en pouvoir douter, un grand d’Espagne de première classe, et lui-même il le donnait assez à entendre. Le comte espagnol et la dame anglaise s’étaient déjà rencontrés plusieurs fois en voyage. C’était à cause de cela que l’aubergiste attentif avait pris soin de dresser leurs couverts à côté l’un de l’autre. Entre le comte et la dame, l’entretien, par suite de leurs précédentes rencontres, était, on le comprend, assez animé; car il n’est personne qui n’éprouve un certain charme à renouer des connaissances de voyage, et à se rappeler les mille accidents, les rencontres fortuites et bizarres de la route et de l’hôtel.
Mais la dame se montrait plus préoccupée d’un accident de la veille que des événements déjà éloignés.
«Je ne sais si je me trompe, monsieur le comte, mais, il y a peu de jours, j’ai cru vous apercevoir à Barcelonne où j’ai débarqué à mon arrivée d’Angleterre. Vous étiez, je crois, sur le port; mais je n’eus pas plus tôt détourné mes regards pour donner des ordres à mes gens, que déjà vous aviez disparu. Assurément, si j’avais prévu l’accident qui m’est arrivé hier sur ces maudits chemins d’Espagne, je vous aurais fait chercher par toute la Catalogne, et je vous aurais supplié de m’accompagner.
—De quel accident parlez-vous donc, milady? demanda le comte avec une prévenante anxiété.
—Eh! mon Dieu, monsieur le comte, je suis tombée dans un affreux coupe-gorge; j’ai entendu de sinistres chuchotements sortir de derrière les broussailles à côté de moi; tout à coup les chuchotements se sont transformés en ce cri terrible, poussé par trente voix: «Arrêtez! arrêtez! ou vous êtes morts.» Je ne sus que m’évanouir dans ma voiture; mais, heureusement, j’avais des chevaux doués d’une vitesse extrême, et des gens habiles à les exciter encore; de sorte que, lorsque mon évanouissement se termina, j’étais ici; j’en avais été quitte pour la peur.
—Mes regrets sont grands, milady, de n’avoir pu vous être secourable en une si fâcheuse rencontre; mais moi-même, repartit le comte, il y a peu de jours que je n’ai dû mon salut qu’à mon énergie et à celle de mes gens: j’ai été attaqué par une bande de misérables; qui sait? peut-être par les mêmes que vous. Mes pistolets ont fait justice de deux, et les armes de mes gens, d’un nombre au moins égal. J’assure, du reste, que je n’ai pas pris le temps de les compter, m’estimant bien heureux d’échapper, et d’avoir au moins délivré le pays de quelques-uns des brigands qui l’infestent.
—Bon débarras! dit l’aubergiste en mêlant son mot à la conversation; car ce n’est pas moins que la bande de Fra-Diavolo, qui exploite à présent nos environs. Il faut que ce scélérat ait à son service quelque courrier du diable qui le transporte dans l’air avec des ailes, pour tomber ainsi d’un lieu à l’autre sans qu’on le saisisse au passage; car il n’y a pas huit jours qu’il faisait encore ses prouesses dans les montagnes de Séville, et maintenant le voilà dans les nôtres. Ah! monsieur le comte, vous n’avez pas eu le bonheur d’atteindre le brigand d’une de vos balles; je vous dis qu’il a un talisman du démon pour échapper; vous n’aurez atteint que d’obscurs subalternes.
—Je le crains, répondit le comte; cependant, d’après la description que j’ai souvent entendu faire de Fra-Diavolo, je serais tenté de croire qu’il a reçu dans la poitrine une de mes balles. Ce qu’il y a de positif, c’est que j’ai vu tomber un homme athlétique, à la barbe épaisse et rousse comme sa chevelure, aux sourcils longs et largement arqués. C’est bien là, si j’ai bonne mémoire, le portrait que l’on fait de Fra-Diavolo.
—Eh oui! reprit un des convives, c’est là le portrait que quelques-uns en font; mais d’autres l’ont vu sans barbe, avec des sourcils ras; il y en a même qui assurent avoir vu cet homme athlétique avec des formes grêles, et un visage à s’évaporer d’un souffle.
—Maudit fils du démon! s’écria le comte, il échappera donc toujours? Cependant, j’y persiste; si vous n’en entendez plus parler, c’est que certainement il aura été tué, l’autre jour, de ma main.
—Dieu soit loué! s’il en est ainsi, répéta en chœur toute l’assemblée.»
Le comte et la dame anglaise échangèrent encore quelques paroles, jusqu’au moment où les convives, un peu émus de la tournure qu’avait fini par prendre la conversation, bien éloignée de son début, se levèrent tous de table. Le jour baissait sensiblement, et le crépuscule du soir venait en outre jeter de vagues terreurs dans les esprits. Sur les lèvres de tous ces gens, il y a peu de moments encore heureux et souriants, n’apparaissait plus qu’une sombre inquiétude.
Pour toutes ces imaginations frappées, l’hôtellerie se peuplait de fantômes bizarres; il semblait que chaque chambre recélât quelque mystère derrière sa tapisserie; que les châssis des glaces ou des tableaux dussent s’ébranler et s’ouvrir soudainement pour découvrir une apparition, les vastes ciels-de-lit s’abaisser durant la nuit, pour les étouffer, sur ceux qui se livreraient à un sommeil imprudent. Chacun tremblait, et personne n’osait sonder l’objet de sa crainte.
La dame anglaise eut, pour sa part, tant d’appréhensions, qu’elle demanda à avoir quelqu’un auprès d’elle, ne fût-ce qu’un enfant, car telle est la faiblesse de l’esprit humain, qu’il est des terreurs dont il ne se rend pas compte, et auxquelles il croit parer en mettant un fétu de paille entre elles et lui.
«C’est moi, milady, si vous le permettez, qui serai votre protectrice, dit aussitôt Antonia, avec un air de gaîté rassurant.
—Oui, c’est vous, ma belle enfant, répondit la dame anglaise. Eh! pourrais-je mieux avoir? C’est la Vierge Marie qui gardera, par vous, ma nuit et mon sommeil.»
Et comme elle parlait, la dame anglaise détacha de son cou une jolie croix d’or qu’elle passa au cou d’Antonia.
«Prenez, dit-elle à la jeune fille, prenez, en souvenir de ce jour, en souvenir de moi, et quand vous contemplerez cette croix, je vous le demande, mon enfant, pensez à moi, priez pour moi. Contemplez-la dès ce soir, et, dès ce soir, pensez à moi, priez pour moi. Vous ne sauriez croire comme cette affreuse rencontre d’hier et ce vilain entretien de la fin du repas d’aujourd’hui, m’ont rempli l’esprit de sottes idées noires.
—N’y pensez pas, répondit Antonia; ne pensez ni à l’aventure d’hier, ni à l’entretien de ce soir, et ne voyez, milady, que les fêtes de ce matin. Avec l’image de mon bonheur, le calme et la gaîté rentreront dans votre âme.
—Sans doute, je le veux; il en sera ainsi, reprit la dame, que ces naïves paroles rendaient à la tranquillité.» Et elle souriait à la jeune fille, et lui donnait un baiser sur le front.
Il fallait passer par une petite pièce remplie de grandes armoires percées dans le mur, avant de pénétrer dans la chambre que devait occuper l’étrangère. On y dressa un lit pour Antonia.
La dame et la jeune fille montèrent ensemble: la première presque rassurée, et la seconde exempte de toute inquiétude; car la voix des anges avait passé dans son cœur. L’étrangère, avant d’entrer dans sa chambre et de laisser Antonia dans la sienne, lui serra affectueusement la main, déposant encore un baiser sur son front; puis, lui montrant la croix d’or, elle lui dit avec un sourire: «Souvenez-vous.»
Antonia répondit aux désirs de l’étrangère. Elle fit sa prière du soir en contemplant la croix qui venait de lui être donnée; elle pensa à ses bons parents, puis à la dame. Sa prière finie, elle se prit à chanter un cantique dont le retour final était toujours:
«Mon bon ange, partout, suis-moi, veille sur moi.»
La jeune fille était couchée, et ses paupières déjà fermées par le sommeil, que ses lèvres murmuraient encore le refrain du cantique. Il eût semblé, en ce moment, que le chœur des anges était venu voltiger au-dessus de l’innocence, et l’endormir au son décroissant de ses célestes concerts.
Le sommeil d’Antonia était divin; et si sa mère se fût approchée en cet instant de la couche où reposait l’enfant, elle aurait trouvé son visage empreint de tous les rêves inspirés par les pensées du jour précédent, par les fêtes de l’église; et, si elle avait pu deviner ce qui se passait dans le cœur de la jeune fille, elle l’aurait entrevue s’égarant avec des groupes de vierges célestes à travers des bocages aux fleurs, aux parfums inconnus, et tout pleins d’inexprimables harmonies; et même elle l’aurait surprise chantant encore jusque dans ses rêves:
«Mon bon ange, partout, suis-moi, veille sur moi.»
Minuit sonnait à l’horloge d’en bas, au timbre sec et perforant, à la vieille horloge en forme de haute et étroite armoire, et dont les deux poids, suspendus au bout de leur corde ascendante et descendante, marquaient lentement le cours des heures. Hormis les coups de cette horloge, et quelques rares craquements qui semblaient sortir des boiseries près de se disjoindre, pas un bruit ne s’était encore fait entendre dans l’hôtellerie, depuis que les voyageurs s’étaient retirés, chacun dans sa chambre. On eût dit que, blotti sous les couvertures, tout le monde avait peur de remuer seulement, et d’indiquer la vie par le moindre souffle de l’haleine. Quand je dis tout le monde, il n’y faut pas comprendre Antonia, la jeune fille, dont le sommeil d’ailleurs, après les rêves célestes, avait fini par devenir si calme, si parfait, que s’il y avait eu, par hasard, quelque fil de beau temps suspendu au-dessus de la paisible couche, il n’en eût pas même été agité.
Soudain, dans la chambre d’Antonia, une armoire s’ouvre, mais le plus doucement que possible. Cet étrange mouvement n’interrompt pas le sommeil de la jeune fille; seulement, comme si le plus divin de ses rêves précédents était revenu lui sourire, après l’avoir quelque temps abandonnée à elle-même, elle se reprit à murmurer, sans s’éveiller:
«Mon bon ange, partout, suis-moi, veille sur moi.»
A ce murmure, qui fut pris pour celui du réveil, l’armoire se referma plus silencieusement encore qu’elle ne s’était ouverte. Une heure après, quand Antonia parut rentrée dans un sommeil sans rêves et sans paroles, l’armoire se rouvrit avec la même précaution; mais de nouveau, du lit de la jeune fille, sortirent, dans un chant lent et harmonieux, les paroles du cantique:
«Mon bon ange, partout, suis-moi, veille sur moi.»
L’armoire se referma encore, mais cette fois pour tout à fait, jusqu’au lever du jour. Matinale et joyeuse comme l’oiseau qui salue dans le branchage le premier rayon du soleil, Antonia se leva, et, frappant doucement à la porte de l’étrangère, elle demanda si elle pouvait entrer: «Oui, certainement, répondit l’étrangère, entrez, ma jeune protectrice.
—Eh bien! demanda la jeune fille, quand elle fut entrée, avez-vous eu un bon sommeil?
—Mon sommeil a été assez calme, grâce à vous, mon enfant, répondit la dame; deux fois j’avais entendu du bruit, mais comme il partait de votre chambre, je me suis rassurée, en pensant que j’étais défendue par votre innocence et par la sainteté de vos prières.—Moi je n’ai rien entendu, reprit Antonia, que les concerts célestes, qui m’accompagnaient pendant que je chantais dans mes rêves:
«Mon bon ange, partout, suis-moi, veille sur moi.»
Le lendemain de la fête patronale de la ville était un jour de foire, jour de bonne aubaine pour les voleurs de la montagne. L’aubergiste conduisit sa femme et sa fille visiter les nombreuses allées de boutiques resplendissantes. Antonia s’arrêta, comme par instinct, devant un bel étalage d’images et de livres de piété. Pendant qu’elle examinait une Imitation de Jésus-Christ, reliée en velours avec un riche fermoir de vermeil, dont voulait lui faire cadeau son père, deux hommes à la mine rébarbative, qui chuchotaient depuis un moment entre eux, se mirent à fredonner d’un ton ironique le refrain du cantique de l’ange gardien. Antonia rougit, et les deux hommes s’éloignèrent. L’aubergiste demanda à sa fille quelle était la cause de sa soudaine émotion.
«Je l’avoue, mon père, je viens d’être bien surprise d’entendre répéter, et avec une intention marquée, à côté de moi, par les deux hommes qui sont déjà tout là-bas, des paroles qui ont été composées tout exprès pour moi, il n’y a pas encore deux jours, par M. le curé, et que je ne crois avoir chantées que seule et dans ma chambre. Mon père, il faudrait suivre ces hommes, et vous assurer si ce sont des gens que vous avez logés la nuit dernière chez vous.»
L’aubergiste suivit l’avis de sa fille; et, la laissant avec sa mère, il se trouva bientôt à trois pas derrière les deux hommes qui n’étaient point sur leurs gardes, et qui s’entretenaient, sans trop de gêne, de leurs prouesses passées et de leurs projets.
«Je te dis que c’est de ta faute. Elle rêvait, elle n’était pas éveillée, disait l’un; voilà un beau coup manqué. Le maître aura beau jeu pour nous reprocher longtemps notre sottise et notre irrésolution. Ne voilà-t-il pas de dignes élèves de Fra-Diavolo qui n’avaient plus qu’à s’emparer des trésors qu’il leur avait mis sous la main, et qui se sont laissés arrêter par une enfant qui chantait un cantique en dormant.
—Et moi je soutiens qu’elle ne dormait pas, repartit l’autre homme, et que si nous avions fait un pas hors de l’armoire, elle aurait poussé un cri, réveillé l’Anglaise, que nous aurions tout au plus réussi à tuer sans lui enlever sa cassette et en nous faisant arrêter nous-mêmes. Le maître n’est pas plus exigeant que de raison, et il nous sera aussi facile de nous introduire ce soir qu’hier dans l’hôtellerie; ce qui est différé n’est pas perdu.»
«L’hôtellerie, l’Anglaise, l’enfant qui chante un cantique, le maître, le domestique du maître, et le reste, qu’est-ce que cela? se demanda à part soi l’aubergiste, vivement préoccupé; je commence à croire que nous avons échappé, la nuit dernière, par quelques paroles de ma chère Antonia, à une terrible catastrophe.
Il se parlait encore ainsi, sans perdre de vue les deux hommes, quand il observa qu’ils abordaient une nouvelle connaissance, l’un des domestiques de ce même comte espagnol, qui s’était à peu près flatté la veille d’avoir tué Fra-Diavolo de sa main.
«Mais, mais, cela s’explique et touche presque au dénoûment, continua à se dire l’aubergiste en lui-même. Il ne s’agit que d’y mettre un peu d’adresse. Faisons arrêter sur-le-champ ces deux coquins qui se sont trahis et le domestique du comte, qui me paraît clairement être leur complice. Le moins de bruit et d’esclandre possible afin de ne pas effaroucher M. le comte et lui faire prendre l’alarme. Pour ce qui est de M. le comte lui-même, nous verrons ensuite à l’enfermer dans l’hôtellerie, et dans sa chambre dès qu’il y sera rentré.»
Ainsi pensé, ainsi fait; sur l’avis de l’aubergiste, les trois premiers compères furent arrêtés sans bruit, et à la fois, dans la première taverne où ils entrèrent pour boire et s’entretenir sans témoins. Le comte, qui ne se doutait de rien, s’en vint le front et le verbe haut, comme la veille, pour prendre son repas dans l’hôtellerie, et ensuite y passer la nuit; mais comme il se mettait à table, une demi-douzaine d’alguasils (gens de la police espagnole) entourèrent le prétendu Grand d’Espagne de première classe. Accoutumé à feindre, il essaya encore, par une foule de détours et de paroles captieuses, à donner le change à ceux qui l’avaient saisi et à tromper leur clairvoyance. Mais ce fut en vain: cette fois le brigand ne put parvenir à cacher son rôle véritable sous un rôle emprunté; le prétendu comte fut reconnu pour ce qu’il était, pour Fra-Diavolo. Quand il n’eut plus d’espérance de se sauver par la feinte, il eut recours au dernier moyen qui lui restait, à la force. Il lutta un moment avec la rage d’un désespéré; mais il dut succomber sous le nombre; il reçut plusieurs blessures, tomba et fut fait prisonnier. Bientôt il fut mis à mort, et sa bande, désormais sans chef, ne tarda pas à se disperser.
Quand la dame anglaise eut appris le danger qu’elle avait couru, et que c’était vers elle surtout, dans l’hôtellerie, que le trop célèbre brigand avait tourné ses dernières tentatives de vol et d’assassinat, toutes ses pensées reconnaissantes se reportèrent vers Dieu et vers la jeune fille qui l’avaient si évidemment protégée. Pour Antonia, elle ne cessa de mêler, chaque matin et chaque soir, à ses prières, les paroles du cantique sauveur:
«Mon bon ange, partout, suis-moi, veille sur moi.»


Dans le tronc noueux d’un vieux chêne
Dont le feuillage printanier
Abritait les fleurs de la plaine,
Ainsi qu’un toit hospitalier,
Une gentille tourterelle,
Au collier noir, à la blonde prunelle,
Avait bâti le nid de ses amours,
Nid dont les tendres œufs ne comptaient pas huit jours.
C’était l’heure où sur les vallées,
La nuit jette d’épais rideaux;
Où de blanches lueurs dansent sur les coteaux
Comme un essaim d’ombres voilées;
La tourterelle, au collier noir,
Pensait à son époux fidèle,
Qui s’en était allé loin d’elle
Chercher la pâture du soir.
En l’attendant, la jeune mère
Créait le plus bel avenir
A son nid bien-aimé qu’un suave zéphir
Caressait d’une aile légère.
Ce bonheur était doux; des bonheurs d’ici-bas,
Le plus doux est celui qu’on rêve,
Et les autres ne valent pas
La feuille que le vent enlève.
Il faut rêver toujours, si l’on veut être heureux;
Rêver, c’est le besoin de l’âme,
Que le temps ait ou non argenté nos cheveux,
Que l’on soit tourterelle ou femme.
Donc, la tourterelle rêvait;
Et, comme une aimable chimère,
Devant elle passaient les couleurs que revêt
Chaque songe de jeune mère.
Sur l’églantier des prés fleuris,
Sur le saule affligé qui penche,
Elle voyait, de branche en branche,
Voltiger ses charmants petits;
Parmi les détours du bocage,
Elle suivait leurs pas craintifs;
Le tableau de leurs jeux naïfs
La ramenait à son bel âge;
Avec eux elle s’amusait
Du bluet, de la fleur fanée,
Et le moissonneur qui passait
La prenait pour leur sœur aînée;
Puis elle les voyait bien grands,
Heureux, et surveillant, comme elle,
Les premiers pas de leurs enfants,
Dans les prés et l’herbe nouvelle.
Tandis que frais et pur comme un songe des cieux,
Ce rêve d’avenir passait devant ses yeux,
Protégé par la nuit épaisse,
Un énorme lézard sortant de son réduit,
Et s’approchant lentement et sans bruit,
Venait lui dérober les fruits de sa tendresse.
Le perfide! il a vu qu’au front du firmament
La lune cache sa lumière:
«Agissons, se dit-il, c’est, je crois, le moment;
La nuit de ses longs bras semble enlacer la terre;
Et j’ai l’appétit fort pressé...»
A ces mots, vers le nid, le monstre s’est glissé.
Mais il n’est point de nuit pour l’amour maternelle:
La tourterelle a vu s’approcher l’ennemi;
Posant la tête sous son aile,
Elle feint de dormir, mais elle ouvre à demi
Son œil bleu qui pétille ainsi qu’une étincelle.
Elle arrête le traître au premier coup de dent;
Son bec d’ivoire, à la forme si pure,
Le saisit à la gorge, et, comme un fer tranchant,
Lui fait une large blessure.
Le misérable se débat;
«Plus fort que son frêle adversaire,
Il est sûr de sortir vainqueur de cette affaire;
Trop inégal est le combat...»
Erreur! rien ne résiste aux forces d’une mère!
Blessé dans cent endroits et presque inanimé,
Bientôt le lézard roule aux bords d’une eau fangeuse,
Et la mère victorieuse
Revoie à son nid bien-aimé.
Un de ses œufs venait d’éclore,
Son époux était revenu;
Oubliant le danger couru,
Elle chanta jusqu’à l’aurore.
Et tout honteux de ses méfaits,
Sombre comme un oiseau d’orage,
Maître lézard devenu sage,
A part lui, se disait: «Jamais,
Je n’oublîrai cette aventure,
Et désormais, quand j’aurai faim,
Je n’irai chercher ma pâture
Que dans le nid d’un orphelin.»
Il est des âmes endurcies
Que le malheur foudroie et ne corrige pas;
Enfants, dans les sentiers où se perdent leurs vies,
Ah! n’égarez jamais vos pas!

Par une froide soirée d’automne de l’année 550, un homme gravissait péniblement la côte Saint-Sébastien qui s’élève au bord de la Loire, près de Nantes. Sa démarche était lente, car les cailloux pointus de la route déchiraient ses pieds nus. Une grande robe de bure, serrée à la taille par une corde, une gourde suspendue au côté et un bâton de houx, formaient tout le costume du pauvre voyageur. Un vaste capuchon couvrait sa tête chauve et retombait sur son front dégarni. Ses yeux avaient cette expression de douceur et de bonté qui inspire la confiance; ses joues pâles et amaigries annonçaient ses veilles et ses travaux. Sa grande barbe grise descendait jusque sur sa poitrine.
La nuit était arrivée, lorsqu’il atteignit le haut de la montagne. Il entra dans une petite grotte creusée entre deux masses de rochers; il y déposa sa gourde et son bâton, puis il vint s’asseoir sur une pierre près de l’entrée.
Longtemps il resta ainsi plongé dans une méditation profonde; enfin il se leva et alluma une chandelle de résine qu’il plaça dans une fente de rocher.
Quelques aliments grossiers étaient placés sur une table de pierre.—Après un frugal repas, le saint ermite pria Dieu et se coucha sur un peu de paille étendue dans un coin.
Le soleil commençait à peine à dorer les flots de la Loire, que déjà l’ermite était en prières. Il prit sa gourde et son bâton et se prépara à partir. Chaque jour, il descendait dans la vallée: un terrible fléau la ravageait. La guerre avait moissonné ses habitants, et maintenant une maladie cruelle portait, de tous côtés, la désolation et la mort.
La présence du saint, ses soins éclairés, son zèle, ses consolations adoucissaient les peines des malheureux, qui semblaient oublier leurs infortunes en le voyant.
A peine avait-il fait quelques pas hors de sa demeure, qu’il aperçut, au pied de la montagne, un groupe de cavaliers qui s’avançait vers lui; il attendit.
L’un d’eux s’approcha, descendit de cheval et s’agenouilla. «Mon père, lui dit-il avec respect, n’êtes-vous pas l’ermite Martin?—Oui, mon fils, que me voulez-vous?—Nous sommes envoyés par monseigneur Félix, évêque de Nantes, qui vous mande près de lui.—J’obéis,» répondit Martin. Il suivit les cavaliers, et bientôt ils arrivèrent au palais de l’évêque.
Félix, assis sur son siège épiscopal, était entouré de son clergé. C’était un vieillard dont la tête blanche, les traits nobles, inspiraient le respect. Martin se prosterna à ses pieds.
«Relevez-vous, mon fils, lui dit le saint évêque d’une voix douce... et écoutez-moi. Près de Nantes, à quelques lieues de la mer, vous trouverez une ville qu’on nomme Herbadilla. La corruption, le vice, l’idolâtrie y règnent sans partage. Il est de notre devoir de chrétien de ramener à Dieu ces âmes égarées. Je suis vieux, infirme, sans forces; à peine quelques jours me restent-ils à passer sur cette terre. Mon troupeau a besoin de son pasteur; je ne puis entreprendre la conversion de la ville idolâtre. Mais vous, Martin, vous, jeune et plein de vigueur, vous, dont la foi est ardente et le zèle pieux, vous, qui êtes saint entre tous les hommes, voulez-vous accomplir cette œuvre sainte!»
Martin résista par humilité, mais cependant il accepta avec courage les offres de saint Félix... Il partit pour Herbadilla.
Vers l’année 510, les Romains, commandés par Jules César, avaient envahi la Gaule. L’est et le sud de cette grande contrée furent bientôt en leur pouvoir. Alors ils s’avancèrent vers l’Armorique (Bretagne). Là, ils rencontrèrent une résistance sérieuse. Jules César vint enfin mettre le siège devant la ville des Namnètes (Nantes). Il fit camper sa flotte dans la rivière de la Chésine, sur laquelle un enfant peut maintenant jouer au colosse de Rhodes.
Nantes voulut résister à la puissance romaine. Longtemps elle tint en échec les légions de César, mais enfin, elle fut prise et livrée au pillage. Une partie de ses habitants fut massacrée; l’autre s’enfuit, et traînant après elle tout ce qu’elle avait pu arracher à la fureur du vainqueur, vint s’arrêter dans la forêt de Vertave. Cette forêt, entourée de marais, coupée de rivières nombreuses, était inaccessible; aussi bientôt la sécurité commença-t-elle à renaître parmi les réfugiés qui élevèrent une ville nouvelle, nommée par eux Herbadilla.
Cette ville s’accrut en peu de temps et devint puissante. La religion dominante (le druidisme) était si fortement enracinée chez ses habitants, que jusqu’alors aucun des missionnaires qui avaient essayé de faire parvenir jusqu’à eux la parole du Dieu rédempteur, n’avait pu réussir. Tous avaient été chassés et quelques-uns même massacrés.
Martin savait les difficultés qu’il avait à rencontrer, mais les dangers, les humiliations, la mort même, ne l’effrayaient pas. Il était résigné à tout. Il se recommanda à Dieu et marcha avec confiance vers le but qu’il voulait atteindre. Arrivé à Herbadilla, il commença ses prédications, mais personne ne l’écoutait.
La nuit venue, il s’enveloppait de son manteau, et la tête sur une pierre, les yeux levés au ciel, il lui demandait la force de continuer son œuvre et le priait de faire descendre la grâce sur les infidèles.
Un soir, après une journée de fatigue et de larmes, le saint allait commencer ses pieuses méditations, lorsque tout à coup un homme se précipite à ses genoux. «Vous parlez au nom du Dieu tout-puissant? lui dit-il.
—Oui, répond Martin, sa miséricorde est infinie et rien n’égale sa puissance.
—Alors venez... c’est au nom de ce Dieu que vous adorez que je vous implore... venez!» et cet homme entraîne Martin sur ses pas.
Après quelques instants d’une marche rapide, il s’arrête à la porte d’une chaumière, il entre et fait signe à Martin de le suivre. Aussitôt une femme s’élance au-devant d’eux; ses vêtements sont en désordre, ses yeux égarés, et sa poitrine haletante soulève les longues tresses de ses cheveux détachés.
Sans prononcer un seul mot, elle saisit la main de Martin et lui montre, sur l’âtre du foyer, son enfant. Le pauvre petit s’épuise en efforts impuissants; des convulsions affreuses le déchirent...
«Oh! sauvez-le... sauvez mon enfant!» s’écrie cette femme, et elle se met à danser en riant et en poussant des cris de désespoir.—La pauvre mère est devenue folle.
Saint Martin, les yeux levés au ciel, implore la toute-puissance. Au milieu de l’obscurité, une auréole céleste brille sur son front; soudain la pauvre folle s’arrête et recouvre la raison.
L’ermite étend sa main sur l’enfant; ses cris cessent, ses douleurs se calment, ses forces reviennent, ses traits décolorés reprennent quelque couleur; il se soulève en riant et vient jouer avec le bâton de voyage du saint prédicateur. Sa mère le presse contre son sein, le couvre de ses baisers et le voit bientôt s’endormir calme et tranquille.
Dès le lendemain, Romain (c’est le nom de cet homme), sa femme et son enfant sont baptisés. Martin reçoit asile chez eux, et, encouragé par ce succès, il continue avec un nouveau zèle ses prédications. Mais l’ignorance et la superstition arrêtent tous ses efforts. Alors Dieu résolut de punir cette ville impie.
Une nuit, celle de Noël 555, un sommeil profond s’était emparé du saint homme. Tout à coup, sa chambre est inondée d’une clarté brillante; un concert de voix célestes, d’instruments harmonieux se fait entendre. Saint Martin se réveille; un ange lui apparaît et lui dit:
—Dieu a vu tes peines... il veut punir les impies... va, pars avec Romain, sa femme et son fils, quitte cette ville.»
Au point du jour, ils se lèvent et se mettent en route. En les voyant passer, les habitants d’Herbadilla se moquent de la crédulité des nouveaux chrétiens. Ils leur lancent des pierres et les accablent de railleries.
Mais le soleil se couvre d’une large tache rouge qui s’étend sur une partie de son disque. Cette lueur horrible se répand partout et partout elle rougit les objets qu’elle éclaire. La terre tremble, le tonnerre gronde, les flots des rivières s’agitent et se dressent avec force les uns contre les autres... les joncs et les herbes des marais, soulevés par une force surnaturelle, sont jetés sur la rive... Une odeur de soufre remplit l’air... Les arbres de la forêt, agités par le vent, gémissent sourdement... un grand bruit se fait entendre... Herbadilla n’est plus!...
Les flots, vomis par une énorme ouverture, s’étendent de tous côtés et forment un lac immense qu’on appelle aujourd’hui le lac de Grand-Lieu.
Après cette terrible punition infligée par Dieu à la ville coupable, saint Martin fonda le monastère de Vertou où il vécut saintement. Romain et son fils allèrent à Nantes, où ils furent accueillis avec bonté par saint Félix, qui les protégea.

Une nuit près du Pôle Boréal.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| Le plus souvent le feu de leurs mousquets était impuissant, et ils ne parvenaient à éloigner ces ennemis redoutables qu’en poussant de grands cris. | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

La nature a répandu l’abondance et la variété dans les produits des climats tempérés, l’éclat et la majesté chez ceux des régions équatoriales; mais elle a frappé d’une effrayante stérilité les zones polaires. C’est dans les contrées brûlantes du globe que les oiseaux se couvrent du plus brillant plumage, que les plantes jouissent de la végétation la plus belle, que les animaux ont les formes les plus développées. Près des pôles, au contraire, la terre, presque toujours couverte de glaces et de neiges, ne produit que des arbres rabougris; l’été n’a pour parure que des mousses et des lichens, et les horreurs de l’hiver sont accrues encore par l’extrême longueur des nuits.
Il semblerait que l’amour de la patrie, qu’on trouve dans le cœur de tous les hommes, ne dût pas exister pour ces froides et stériles contrées: nulle part cependant cet amour du pays n’est porté à un plus haut degré; les naturels des zones polaires sont même les seuls peuples de la terre qui ne puissent vivre loin de leur climat: admirable prévision de la Providence! On dirait qu’elle a craint que ces contrées glacées restassent sans habitants. Transportés sous un ciel plus doux, sur des bords plus fertiles, ces peuples regrettent bientôt leurs huttes enfumées, leur nourriture grossière, leur sauvage indépendance; notre bien-être les fait dépérir; notre civilisation les tue. Ces regrets vous étonnent sans doute, mes enfants, mais vous en serez bien autrement surpris après avoir lu le récit que je vais vous faire.
Le 18 mai 1596, un vaisseau partit d’un des ports de la Hollande pour chercher, dans les mers du nord-est, un passage aux Indes-Orientales, à la Chine et au Japon. Après quelques mois d’une navigation heureuse, il s’était avancé jusqu’au 79e degré de latitude septentrionale, mais la grande quantité de glaces flottantes qu’il rencontra à cette hauteur arrêta sa marche, et le capitaine se vit forcé de renoncer à ses explorations. Au bout de quelques jours, il signala les côtes de la Nouvelle-Zemble, et il se dirigea vers un petit port où il espérait trouver un asile; mais les glaçons lui en ayant fermé l’entrée, il amarra (attacha) son vaisseau à un énorme banc de glace pour passer la nuit. Le lendemain, au point du jour, alors qu’il était sur le pont, occupé à donner des ordres, il aperçut un ours blanc qui cherchait à monter dans le navire: aussitôt les matelots s’armèrent de leurs crocs et de leurs mousquets; mais la crainte rendait sans doute leurs coups mal assurés, car l’ours tint bon pendant longtemps; toutefois ils parvinrent à le blesser et à lui faire lâcher prise; mais il échappa à leur poursuite.
Enfin les glaces ayant ouvert un passage, ils purent, après des peines infinies, pénétrer dans le port, qui reçut le nom de Port des Glaces. Vers le soir, le vent, qui soufflait avec force, poussa d’énormes bancs contre les flancs du vaisseau. Leurs chocs étaient si violents qu’on pouvait appréhender à chaque instant qu’il fût mis en pièces. Pendant la nuit, ses craquements annoncèrent que les glaces se resserraient toujours davantage; au point du jour, on découvrit que le navire se trouvait pris dans leurs masses épaisses, qui l’environnaient de toutes parts. Deux hommes se rendirent à terre; et, après avoir exploré la côte, ils retournèrent tristement annoncer à leurs compagnons qu’ils n’avaient aperçu aucun arbre, et découvert que des traces d’ours et de rennes.
Toutes les tentatives faites pour rompre la glace ayant été sans succès, il fallut bien renoncer à se dégager, et l’équipage, composé de seize hommes, dut se résoudre à passer l’hiver dans ces affreux parages. Il fut résolu que l’on construirait immédiatement, avec des bois provenant du vaisseau, une grande hutte où tout le monde pourrait se tenir abrité; et l’on se hâta d’apporter les objets nécessaires à ce travail, qui fut long et pénible, car le froid était terrible et les matelots avaient en outre à se défendre sans cesse contre de nombreux ours blancs qui les venaient attaquer avec audace. Le plus souvent, le feu de leurs mousquets était impuissant, et ils ne parvenaient à éloigner ces ennemis redoutables qu’en poussant de grands cris. Enfin dès que la hutte fut terminée, on s’y renferma après l’avoir approvisionnée de bois, de vivres, de poudre, de plomb et d’armes de toute espèce.
On approchait de la fin du mois d’octobre; les jours étaient déjà très-courts, et le soleil, dont la présence était le seul bien-être de ces infortunés, était près de les abandonner; il fallut se mettre eu garde contre les besoins qu’allait faire naître le nouveau genre de vie auquel on se voyait condamné; on monta une horloge, on disposa des lampes, et, à défaut d’huile, la graisse de quelques ours qui avaient été tués, fut préparée pour leur entretien. Le 1er décembre, le jour ne dura que quelques instants, et le 4, il cessa de paraître. Alors commença la longue et cruelle nuit d’hiver, et avec elle une série de maux incalculables.
D’abord le ciel fut brillant d’étoiles, et la lune, qui était à sa plus grande hauteur, parut pendant quelque temps sans interruption mais, à partir du 9 novembre, il tomba une si grande quantité de neige que la hutte resta comme ensevelie sous elle. Les Hollandais eurent, dès ce moment, un nouvel ennemi à combattre; la fumée, qui, ne trouvant plus d’issue, menaçait à chaque instant de les étouffer; et il fallait des efforts inouïs pour dégager la toiture. Le froid devint intolérable: malgré le feu, constamment allumé, le plancher et les murs étaient revêtus à l’intérieur d’une couche épaisse de glace; et, pendant plusieurs jours, ces infortunés n’obtenaient un peu de soulagement qu’en plaçant tour à tour, dans leurs lits, des pierres chauffées au foyer. Le vin leur manquait, la bierre avait été convertie par la gelée en une pâte épaisse et dure, et leur unique boisson était de la neige fondue. Le feu leur semblait manquer même de chaleur, et ce n’est qu’en les brûlant qu’ils parvenaient à réchauffer leurs pieds et leurs jambes. Il était d’ailleurs impossible de laver le linge, car à peine le retirait-on de l’eau bouillante que la gelée le roidissait; enfin, comme si ce n’eût point été assez déjà de tous ces maux, dès que l’un de ces malheureux, suffoqué par la fumée, qui ne cessait de remplir la hutte, se présentait à la porte pour respirer un peu, soudain tout son visage se couvrait de pustules.
Un matelot ayant profité, pour sortir, d’un moment où le froid était moins intolérable, fut assez heureux pour tuer un renard; il le porta bien vite à ses compagnons, qui le firent rôtir; il fut trouvé d’un goût délicieux. Dès ce jour, des pièges furent dressés tout autour de la hutte, et l’on prit un assez bon nombre de ces animaux: or, ce fut une bien grande ressource pour l’équipage, qui, depuis longtemps, était privé de viande fraîche, et qui trouvait d’ailleurs, dans les peaux de ces renards, une fourrure dont ils avaient si grand besoin.
L’année 1597 avait commencé sans apporter aucun adoucissement aux souffrances de nos pauvres navigateurs; leur misère était même au comble, car la graisse d’ours une fois épuisée, les lampes avaient cessé de les éclairer. Cependant, vers le milieu de janvier, l’intensité du froid diminua quelque peu; les matelots purent sortir assez librement pour donner un peu d’exercice à leurs membres engourdis; puis bientôt l’obscurité leur sembla moins grande, ils crurent même apercevoir dans l’air une lueur rougeâtre semblable à l’aurore; dès lors ils conçurent l’espoir que le jour ne tarderait pas à paraître. Deux matelots osèrent alors s’aventurer jusqu’à la rive opposée, et ils virent distinctement à l’horizon une partie du disque du soleil: cette nouvelle remplit l’équipage de joie, mais par malheur une brume épaisse vint obscurcir l’air pendant quelque temps, et ce ne fut que le 27 janvier que le soleil montra son globe tout entier.—Ainsi se passa cette affreuse nuit qui avait commencé le 4 novembre de l’année précédente et duré près de trois mois.
Les ours avaient disparu avec le jour; ils reparurent avec lui. Un de ces animaux s’avança un jour par les degrés qu’on avait dû creuser dans la neige pour descendre jusqu’à la hutte, et se dirigea vers la porte, qui se trouvait alors ouverte. Les Hollandais n’eurent que le temps de la fermer et de se grouper derrière pour résister aux efforts que faisait l’ours pour la renverser. Tout à coup l’animal furieux grimpe sur le toit, et s’attache à la cheminée qu’il agite avec violence; les matelots étaient tremblants; il leur semblait à chaque instant que leur ennemi allait se rendre maître de ce passage: heureusement il n’en fut rien, mais l’ours ne se retira qu’après avoir ravagé une partie de la toiture. Pendant qu’il s’éloignait, on l’atteignit d’un coup de feu dans les reins, puis on courut à lui pour l’achever. Sa graisse fut fondue et servit de nouveau à l’entretien des lampes.
Dès le 15 avril, le temps cessa d’être rigoureux; nos pauvres Hollandais s’empressèrent donc d’aller visiter leur vaisseau; ils le revirent encore engagé dans les glaces; leur joie fut grande en le retrouvant dans le même état où ils l’avaient laissé cinq mois auparavant, et dès lors ils purent espérer de revoir leur patrie. On s’occupa sur-le-champ des préparatifs de départ; le vaisseau fut radoubé (remis à neuf); puis on embarqua ce qui restait de vivres et d’approvisionnements.
Ce travail était souvent interrompu par l’attaque des ours, qui devenaient plus nombreux et plus acharnés, à mesure que leur proie était plus près de leur échapper. Enfin, le 14 juin, ils mirent à la voile après un séjour d’environ dix mois au milieu des glaces; leur navigation fut encore, plusieurs fois, entravée par des bancs flottants que le vent avait portés à de grandes distances; mais enfin, après bien des chances diverses, ils arrivèrent en Hollande, où ils furent accueillis avec l’enthousiasme et la sympathie que méritaient leur courage et leurs malheurs.


Dans le coin retiré d’un humble cimetière,
Près d’une simple croix qu’ombrageait un cyprès,
Un tout petit enfant, à genoux sur la terre,
Exhalait, en ces mots, ses douloureux regrets:
«Mère! prête l’oreille,
Répétait-il tout bas;
C’est moi qui te réveille,
Mère! N’entends-tu pas?
Oh! pour fâcher sa mère,
Réponds à ton enfant,
Qu’avait donc fait ton Pierre,
Ton fils qui t’aimait tant?
Mère! toi qui, mourante,
Pour me servir d’appui,
Comptais, trop confiante,
Sur le secours d’autrui;
Toi qui me fus si bonne,
A ton fils orphelin,
Sais-tu qu’il n’est personne
Qui veut tendre la main?
Que, sur la froide pierre,
Il serait mort de faim,
Si dans le presbytère
Il n’eût trouvé du pain?
Sais-tu?... la neige tombe;
Je tremble... j’ai bien froid.
Oh! viens, car je succombe:
Mère! reviens à moi.
Pour la revoir, sa mère,
Oh! qui donc lui dira
Ce qu’il lui faudrait faire
Ton Pierre le fera.
Faut-il être bien sage,
Toujours je le serai;
S’il se peut davantage,
Même je t’aimerai.
Mère! prête l’oreille,
Murmura-t-il plus bas;
C’est moi qui te réveille,
Mère! N’entends-tu pas?»
Il dit; et le soleil, commençant sa carrière,
Dorait déjà les cieux, que, dans le cimetière,
Au pied de l’humble croix, Pierre priait encor.
Mais, le soir de ce jour, dans un nuage d’or,
On dit qu’un jeune enfant s’envola de la terre,
Et que, tout radieux, il fuyait vers sa mère
Qu’il voyait lui sourire et lui tendre les mains;
Tandis que dans les cieux, en des concerts divins,
On entendait frémir les harpes d’or des anges
Qui chantaient du Seigneur les sublimes louanges,
Et saluaient l’enfant qui venait, dans le ciel,
Rendre un fils à sa mère, un ange à l’Éternel.
FIN DU VOLUME.
Note de Transcription
Les mots mal orthographiés et les erreurs d’impression ont été corrigées. Lorsque plusieurs orthographes se produisent, l’utilisation de la majorité a été employé.
Ponctuation a été maintenue sauf si évidente erreurs d’impression se produisent.
Certaines illustrations ont été déplacées pour faciliter la mise en page.
Une couverture a été créé pour cet eBook.
[Fin de Le Dimanche des Enfants, tome 3 par Various]